L’ÉGLISE : UNE ESQUISSE DE SON HISTOIRE PENDANT VINGT SIÈCLES
2 participants
Forum Religion : Le Forum des Religions Pluriel :: ○ Enseignement :: Chrétienté :: L'Église Catholique
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 •  1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5, 6 
 L’ÉGLISE : UNE ESQUISSE DE SON HISTOIRE PENDANT VINGT SIÈCLES
L’ÉGLISE : UNE ESQUISSE DE SON HISTOIRE PENDANT VINGT SIÈCLES
Rappel du premier message :
1 - Avant-propos
L’ouvrage dont nous présentons une édition augmentée est un ensemble composite.
La partie la plus étendue, savoir tous les chapitres qui vont jusqu’à la Réforme exclusivement, a été rédigée il y a plus d’un siècle par Adrien LADRIERRE à l’intention de la jeunesse. Le texte en parut mois par mois de 1887 à 1903 dans le périodique « La Bonne Nouvelle annoncée aux enfants » sous le titre « L’Église ou l’Assemblée, son histoire sur la terre ». L’auteur y exposait, dans un langage accessible à tous, les caractères essentiels de cette Église et retraçait quelques circonstances marquantes de sa carrière. Il n’avait nullement pour objet une étude rigoureuse, ni une relation suivie et complète : il voulait avant tout faire ressortir, au cours des siècles, la continuité de l’œuvre de Dieu en grâce, face au travail décevant des hommes. A. Ladrierre mourut en 1902, laissant cette esquisse inachevée. Ce qu’il avait publié fut édité, en trois tomes, sous le même titre que dans la Bonne Nouvelle.
Une continuation ne devait être donnée à ce travail qu’après plus de trente ans, par un quatrième tome qui parut en 1937. La Réforme avec ses suites y était traitée par le professeur Édouard RECORDON, et un important chapitre terminal, dû à Philippe TAPERNOUX, dégageait les grandes lignes depuis la fin du 18° siècle.
L’œuvre ainsi complétée fit en 1959 l’objet d’une nouvelle édition en deux volumes, sous un titre légèrement modifié : « L’Église, une esquisse de son histoire pendant vingt siècles ».
La présente édition n’apporte que peu ou pas de retouches au plus grand nombre de chapitres. On a estimé préférable de laisser à peu près intact le texte de A. Ladrierre, malgré soit des longueurs soit des lacunes auxquelles des lecteurs peuvent être sensibles : son cachet de simplicité et de ferveur, son insistance, pleine de sérieux et d’affection, sur les vérités fondamentales du christianisme, sont propres à toucher et à instruire bien d’autres que les enfants auxquels il était destiné.
Il a paru, en revanche, utile de faire du dernier chapitre une partie distincte. Tout en en respectant la structure, le fond, et une grande partie du texte, nous avons insisté un peu plus sur la grande action de réveil opérée par l’Esprit de Dieu dans la première moitié du 19° siècle et qui correspond, à n’en pas douter, au Cri de minuit de Matthieu 25.
Pas plus que dans le reste du livre on ne cherchera là une histoire au sens rigoureux du terme. Les faits en seraient, d’ailleurs, difficiles à rassembler. Du moins pourra-t-on tenir pour assuré qu’il a été fait appel au plus grand nombre possible de sources offrant les plus sérieuses garanties. Le caractère même de cet ouvrage impliquait que les références bibliographiques soient réduites à l’extrême. Les lecteurs curieux du passé regretteront de ne pas avoir plus de détails sur les ouvriers que le Seigneur employa alors, et, certes, nous avons à nous souvenir de nos conducteurs ! Mais notre but essentiel a été d’aider quiconque cherche la vérité à mieux saisir l’importance et le sens de ce que Dieu opéra par eux. Nous pensons surtout aux jeunes générations de croyants, désirant les voir prendre pleinement conscience du « témoignage de notre Seigneur » qu’à leur tour elles sont appelées à porter en attendant Sa prochaine venue. Dieu veuille bénir à cet effet ce trop succinct exposé de la façon dont nos devanciers ont été amenés à prendre la place que la Parole de Dieu leur indiquait. Quelques extraits de leurs lettres et publications, que nous donnons ensuite, permettront de prendre avec ceux du tout début un contact plus étroit que ne le feraient bien des biographies.
Pour la période tout à fait récente, on s’est borné à un bref Appendice, simple coup d’œil sur l’état de la chrétienté dans les temps où tout semble dire au fidèle : « Le Seigneur vient ».
Août 1971 André Gibert
L’ÉGLISE
L’ÉGLISE : UNE ESQUISSE DE SON HISTOIRE PENDANT VINGT SIÈCLES
1 - Avant-propos
L’ouvrage dont nous présentons une édition augmentée est un ensemble composite.
La partie la plus étendue, savoir tous les chapitres qui vont jusqu’à la Réforme exclusivement, a été rédigée il y a plus d’un siècle par Adrien LADRIERRE à l’intention de la jeunesse. Le texte en parut mois par mois de 1887 à 1903 dans le périodique « La Bonne Nouvelle annoncée aux enfants » sous le titre « L’Église ou l’Assemblée, son histoire sur la terre ». L’auteur y exposait, dans un langage accessible à tous, les caractères essentiels de cette Église et retraçait quelques circonstances marquantes de sa carrière. Il n’avait nullement pour objet une étude rigoureuse, ni une relation suivie et complète : il voulait avant tout faire ressortir, au cours des siècles, la continuité de l’œuvre de Dieu en grâce, face au travail décevant des hommes. A. Ladrierre mourut en 1902, laissant cette esquisse inachevée. Ce qu’il avait publié fut édité, en trois tomes, sous le même titre que dans la Bonne Nouvelle.
Une continuation ne devait être donnée à ce travail qu’après plus de trente ans, par un quatrième tome qui parut en 1937. La Réforme avec ses suites y était traitée par le professeur Édouard RECORDON, et un important chapitre terminal, dû à Philippe TAPERNOUX, dégageait les grandes lignes depuis la fin du 18° siècle.
L’œuvre ainsi complétée fit en 1959 l’objet d’une nouvelle édition en deux volumes, sous un titre légèrement modifié : « L’Église, une esquisse de son histoire pendant vingt siècles ».
La présente édition n’apporte que peu ou pas de retouches au plus grand nombre de chapitres. On a estimé préférable de laisser à peu près intact le texte de A. Ladrierre, malgré soit des longueurs soit des lacunes auxquelles des lecteurs peuvent être sensibles : son cachet de simplicité et de ferveur, son insistance, pleine de sérieux et d’affection, sur les vérités fondamentales du christianisme, sont propres à toucher et à instruire bien d’autres que les enfants auxquels il était destiné.
Il a paru, en revanche, utile de faire du dernier chapitre une partie distincte. Tout en en respectant la structure, le fond, et une grande partie du texte, nous avons insisté un peu plus sur la grande action de réveil opérée par l’Esprit de Dieu dans la première moitié du 19° siècle et qui correspond, à n’en pas douter, au Cri de minuit de Matthieu 25.
Pas plus que dans le reste du livre on ne cherchera là une histoire au sens rigoureux du terme. Les faits en seraient, d’ailleurs, difficiles à rassembler. Du moins pourra-t-on tenir pour assuré qu’il a été fait appel au plus grand nombre possible de sources offrant les plus sérieuses garanties. Le caractère même de cet ouvrage impliquait que les références bibliographiques soient réduites à l’extrême. Les lecteurs curieux du passé regretteront de ne pas avoir plus de détails sur les ouvriers que le Seigneur employa alors, et, certes, nous avons à nous souvenir de nos conducteurs ! Mais notre but essentiel a été d’aider quiconque cherche la vérité à mieux saisir l’importance et le sens de ce que Dieu opéra par eux. Nous pensons surtout aux jeunes générations de croyants, désirant les voir prendre pleinement conscience du « témoignage de notre Seigneur » qu’à leur tour elles sont appelées à porter en attendant Sa prochaine venue. Dieu veuille bénir à cet effet ce trop succinct exposé de la façon dont nos devanciers ont été amenés à prendre la place que la Parole de Dieu leur indiquait. Quelques extraits de leurs lettres et publications, que nous donnons ensuite, permettront de prendre avec ceux du tout début un contact plus étroit que ne le feraient bien des biographies.
Pour la période tout à fait récente, on s’est borné à un bref Appendice, simple coup d’œil sur l’état de la chrétienté dans les temps où tout semble dire au fidèle : « Le Seigneur vient ».
Août 1971 André Gibert
 Re: L’ÉGLISE : UNE ESQUISSE DE SON HISTOIRE PENDANT VINGT SIÈCLES
Re: L’ÉGLISE : UNE ESQUISSE DE SON HISTOIRE PENDANT VINGT SIÈCLES
5.6 - Le pape Léon Ier, dit le Grand (440 à 461)
Les évêques ou papes de Rome ne cessaient de chercher à établir et à faire reconnaître leur prééminence sur tous les autres évêques de la chrétienté. Ils se basaient sur la prétendue primauté de Pierre sur les autres apôtres, et se disaient ses successeurs. Ils argumentaient aussi sur ce que Rome étant la tête de l’empire, l’évêque de Rome devait aussi être considéré comme le chef de la chrétienté. Appuyant ainsi leurs prétentions, ils s’efforçaient, soit par les conciles, soit par les empereurs, d’obtenir une sanction qui leur assurât ce rang suprême. Mais ils rencontrèrent d’abord une forte opposition. Déjà au troisième siècle, Cyprien de Carthage résistait à ces prétentions, et pendant longtemps le titre d’évêque des évêques leur fut contesté. Les églises d’Occident, par suite de diverses circonstances, finirent par accepter leur suprématie ; mais l’Église grecque ou d’Orient, ainsi que les églises nestoriennes, arméniennes et autres dont nous parlerons, ne la reconnurent jamais. L’Église grecque, vers le milieu du 11° siècle, se sépara entièrement de Rome.
Parmi les papes qui revendiquèrent avec énergie la suprématie de Rome sur les autres églises, un des plus célèbres est Léon Ier, que l’on a surnommé le Grand. Il se distingua en effet par de grandes qualités, mais nous devons nous rappeler que la grandeur au point de vue humain n’est pas toujours la grandeur selon Dieu. Disons quelques mots sur ce pape célèbre à plusieurs égards.
Léon Ier devint évêque de Rome en l’an 440. Augustin était mort en 430, Léon était donc le contemporain de ses dernières années. Les temps où il vivait étaient particulièrement troublés. En Orient, l’empire était agité par des hérésies sans cesse renaissantes, par la jalousie des divers patriarches, ou supérieurs ecclésiastiques des différentes provinces, et par la crainte des Barbares qui menaçaient les frontières. L’Occident avait déjà été en partie envahi par eux (*) ; Rome même avait été prise et pillée par Alaric, roi des Visigoths, en 410. La dignité du nom impérial avait disparu avec Théodose le Grand. Ses faibles successeurs n’avaient pas l’énergie nécessaire pour repousser les attaques incessantes des ennemis de l’empire. Dans ces circonstances, Léon, par son courage et son habileté dans les négociations politiques, sut en imposer aux Barbares, sauver Rome, en même temps qu’il s’opposait aux hérétiques et maintenait la vérité touchant la Personne de Christ. On ne doit pas s’étonner si le siège épiscopal de Rome occupé par un tel homme, acquit un prestige de nature à grandir son autorité.
(*) Plusieurs de ces Barbares avaient déjà embrassé le christianisme en Orient, mais sous sa forme arienne : c’était le cas des peuples Goths, des Burgondes, des Vandales. Ils furent longtemps des adversaires pour l’Église romaine. D’autres, tels les Francs, les Saxons, étaient restés païens ; une fois amenés au christianisme par les évêques et les moines catholiques, ils prêtèrent une aide efficace au pape. Les rois francs, de Clovis (baptisé en 496 avec ses guerriers) à Charlemagne (proclamé empereur par le pape en 800) et à ses successeurs, tinrent là un rôle décisif.
En l’an 452, Attila, le terrible roi des Huns, après avoir ravagé la Lombardie, se dirigeait vers Rome dans l’intention de s’en emparer. L’empereur Valentinien s’était lâchement réfugié dans la ville forte de Ravenne. Rien ne semblait devoir arrêter la marche du roi barbare, lorsque le Sénat et le peuple de Rome décidèrent d’entrer en négociation avec lui. Mais qui choisir, et qui voudrait entreprendre cette affaire dangereuse et délicate ? Le pape Léon fut désigné comme chef de l’ambassade et deux sénateurs du plus haut rang se dévouèrent pour aller avec lui affronter le roi barbare. L’orgueil d’Attila fut flatté de voir la ville impériale, la maîtresse du monde, comme on l’appelait, s’abaisser jusqu’à lui demander la paix par la bouche d’aussi illustres représentants. Touché par le discours que lui adressa Léon, il accorda ce qu’on était venu lui demander, la paix, moyennant un tribut annuel. Un chroniqueur de ce temps, qui fut secrétaire de Léon, dit « qu’il s’en remit à l’assistance de Dieu, qui ne fait jamais défaut aux efforts des justes, et que le succès couronna sa foi ».
De nouveau Rome, trois ans plus tard, fut menacée par le cruel Genséric, roi des Vandales. Il n’y avait ni armée, ni général pour la défendre. Léon, à la tête de son clergé, alla à la rencontre du roi barbare, mais ne fut pas si heureux que lorsqu’il eut affaire avec Attila. Tout ce qu’il put obtenir, c’est qu’un frein fût mis aux excès des rudes et sauvages vainqueurs.
Si, dans ces deux grandes occasions, Léon eut à jouer un certain rôle politique, il se montra surtout plein de zèle et d’activité dans sa charge d’évêque. Comme tel il eut à combattre pour la vérité chrétienne.
Le manichéisme, ou doctrine de Manès, dont nous avons parlé à l’occasion d’Augustin, s’était répandu dans le nord de l’Afrique. Mais Carthage ayant été prise par Genséric, plusieurs des Manichéens cherchèrent un asile à Rome, et, cachant leurs mauvaises doctrines, voulurent se faire passer pour de vrais chrétiens. Léon rechercha diligemment ces hérétiques dont on trouva un grand nombre et, parmi eux, plusieurs évêques. Un tribunal, composé de magistrats et d’ecclésiastiques, les examina, et ils confessèrent que dans leurs réunions secrètes se commettaient de grossières immoralités. Les évêques ne pouvaient que condamner leurs erreurs et les exhorter à les abandonner ; les magistrats durent sévir contre ceux qui s’étaient rendus coupables de crimes. Les impénitents furent bannis de Rome, et Léon exhorta les évêques à être vigilants pour que ces hérétiques ne séduisissent pas les âmes faibles. Il eut aussi à s’opposer à l’hérésie des Priscilliens, dont les doctrines se rapprochaient de celles des Manichéens.
L’hérésie d’Eutychès touchant la Personne de Christ troublait l’Église d’Orient. Nous en parlerons plus tard. Léon, qui était au courant de cette grave affaire, envoya des légats au concile d’Éphèse (celui que l’on nomma concile de brigands) avec une lettre où il exposait la vraie doctrine relativement à Christ. Le faux concile d’Éphèse refusa de la lire, mais elle fut lue dans le concile de Chalcédoine, qui fut convoqué plus tard, et qui annula les actes du concile d’Éphèse et condamna Eutychès. Mais ce concile avait été amené à régler d’autres questions et en particulier celle du rang des patriarches. Il confirma le patriarche de Constantinople comme primat des églises d’Orient, mais n’accorda pas au siège de Rome la suprématie universelle. « Les Pères », dit le concile, « ont avec raison accordé la primauté au siège de l’ancienne Rome, parce qu’elle était la cité royale ; mais de même, les cent quatre-vingts évêques (ceux du concile) ont donné une primauté égale à la nouvelle Rome » (c’est-à-dire Constantinople). Toutefois ils ajoutaient : « immédiatement après l’ancienne Rome ».
Léon, par ses légats, ne donna pas sa sanction à ce canon ou article du concile. Être appelé évêque universel était l’ambition du pape de Rome, et il revendiquait ce titre, mais rencontrait encore de l’opposition, même en Occident.
Du temps de Léon, Hilaire, évêque d’Arles, qu’il ne faut pas confondre avec Hilaire de Poitiers, était le métropolitain des Gaules. Il était plus éclairé que plusieurs autres évêques de cette époque. Il avait été moine et, devenu évêque, il avait continué à vivre d’une manière simple et austère. Il labourait la terre de ses mains, afin de gagner de l’argent pour racheter de pauvres captifs. Il consacrait une grande partie de son temps à la prière et à l’étude, et il prêchait avec une puissance qui captivait ses auditeurs.
Comme métropolitain, il visitait les églises de la Gaule, et trouva un évêque, nommé Chélidonius, qui avait épousé une veuve, et qui, avant d’être évêque, étant juge, avait condamné à la mort un coupable. D’après les canons de l’Église, cela lui interdisait d’occuper un siège épiscopal. Hilaire convoqua un synode à Vienne et Chélidonius fut déposé. Mais Chélidonius en appela à Rome, où Hilaire se rendit pour convaincre Léon qu’il avait agi selon les canons de l’Église. Malgré cela, le pape rétablit Chélidonius dans sa charge et voulut remplacer Hilaire comme métropolitain des Gaules par l’évêque de Vienne ; il obtint même de l’empereur un rescrit contre Hilaire qu’il accusait de troubler la paix de l’Église. Hilaire résista aux prétentions de Léon et continua à remplir ses fonctions jusqu’à sa mort.
Léon, à part ses prétentions à la suprématie sur les autres évêques, fut le champion de la vérité pour autant qu’il la connaissait, et poursuivit avec un zèle infatigable les erreurs et les mauvaises doctrines relatives à la Personne du Seigneur.
Un grand nombre de ses sermons roulent sur la Personne de Christ, et s’étendent soit sur sa vraie divinité, soit sur sa réelle humanité, vérité des plus importantes et fondement du christianisme. Mais relativement à l’expiation, ses idées étaient erronées. Il pensait que l’homme étant esclave de Satan, l’expiation accomplie par le Seigneur était comme un prix payé au diable afin de délivrer l’homme de son autorité sur lui. Cette pensée, qui n’est pas celle de l’Écriture, se rencontre assez fréquemment de nos jours.
Bien qu’il parle des mérites et de la mort de Christ comme seule source de salut, il dit que par les mérites des saints s’opèrent des miracles sur la terre, et qu’ils sont en aide à l’Église. Il mentionne dans ce sens saint Paul, saint Pierre, saint Laurent, mais jamais la Vierge, et il ne dit pas qu’il faille leur adresser directement des prières. Quant au chemin du salut, il dit « Par la prière, on cherche la miséricorde de Dieu ; par le jeûne, les convoitises sont éteintes ; par les aumônes, les péchés sont expiés. Celui qui s’est racheté par des aumônes, ne doit pas douter que, même après plusieurs péchés, la splendeur de la nouvelle naissance ne soit restaurée en Lui ».
Voilà le chemin tracé du salut par les œuvres, bien différent du salut par grâce, et un commencement pour l’invocation des saints ! C’est ainsi que l’erreur s’introduit peu à peu. À côté de cela nous voyons aussi le recours à l’autorité civile, l’assujettissement au monde, mais le nom du Fils de Dieu est maintenu. C’est ce qui caractérise le temps représenté par l’assemblée de Pergame (Apocalypse 2:12-17), comme nous l’avons vu à plusieurs reprises.
5.7 - Le christianisme introduit en Écosse et en Irlande
Chrysostôme, Jérôme, Augustin et Léon Ier nous ont conduits en Orient, à Constantinople et en Syrie, puis en Occident, à Rome et dans l’Afrique septentrionale. Ces hommes étaient de zélés serviteurs de Dieu, qui insistaient sur la nécessité d’une vie pure et séparée du monde, et qui, Augustin surtout, connaissaient et annonçaient le salut par la pure grâce de Dieu. Mais ces mêmes hommes n’étaient pas étrangers aux abus et aux erreurs qui s’étaient introduits dans l’Église, et qui tendaient toujours plus à substituer un culte de formes et de cérémonies au culte en esprit et en vérité (Jean 4:23-24). En même temps, la domination du clergé, évêques et prêtres, sur les simples fidèles, s’accentuait toujours plus, et l’évêque de Rome, en particulier, commençait à vouloir dominer sur tous les autres. Mais avant de voir dans quel triste état l’Église tomba peu à peu, nous dirons comment le christianisme s’introduisit et se répandit en Écosse et en Irlande.
5.7.1 - Écosse
L’Évangile avait été apporté de bonne heure dans le sud de la Grande Bretagne. Chassés par la persécution, au temps de Dioclétien, plusieurs chrétiens de ces contrées se réfugièrent en Écosse, et s’y construisirent de simples demeures, semblables à celles des solitaires. Connus sous le nom de Culdées ou Culdéens, ces humbles chrétiens se sentirent pressés de prier pour le salut des païens qui les entouraient et leur annoncèrent l’Évangile. Les Culdées n’admettaient point les formes superstitieuses et la suprématie de l’Église de Rome, et n’espéraient le salut que par la foi au Seigneur Jésus Christ. Leur vie paisible et sainte frappa les sauvages habitants de ces contrées, et un grand nombre d’entre eux abandonnèrent leurs superstitions et les rites sanglants de leur religion pour se convertir à Christ. Mais les incursions incessantes des Pictes et des Scots, anciens habitants des montagnes de l’Écosse, obligèrent les Culdées à se réfugier dans les Hébrides (*). Plus tard ils durent les quitter, parce qu’ils ne voulaient point se soumettre aux exigences de l’Église romaine, et se dispersèrent dans l’est de l’Écosse où ils subsistèrent jusqu’à la fin du treizième siècle. Quelques années plus tard naissait Wiclef, un des précurseurs de la Réformation. Ainsi le flambeau de la vérité se maintenait, porté par des témoins que Dieu suscitait au milieu de l’erreur.
(*) Groupe d’îles au nord-ouest de l’Irlande.
5.7.2 - Écosse - Ninian
Dans le cinquième siècle, Ninian, « très saint homme de la nation des Bretons », comme le nomme un ancien historien, prêcha aussi l’Évangile dans les districts méridionaux de l’Écosse. Il avait été élevé à Rome et avait achevé ses études auprès du célèbre évêque Martin de Tours. Il se rendit ensuite en Écosse et fixa sa demeure à Galloway. D’après les récits qui nous ont été transmis, Ninian annonça partout autour de lui la parole de la croix. Les sauvages habitants de l’Écosse écoutaient avec surprise ses prédications entraînantes, et un grand nombre furent convertis. Plein de zèle, il poursuivait l’œuvre pour laquelle l’Esprit Saint l’avait envoyé. Partout où il se montrait, les foules accouraient et recevaient avec joie la bonne nouvelle. De toutes parts retentissaient les louanges du Seigneur. Il travaillait comme un fidèle et diligent ouvrier dans la vigne de son Maître, et des milliers d’âmes furent par son moyen amenées à Jésus et reçurent le baptême. Ce fut surtout parmi une tribu des Pictes que son travail eut des résultats. L’histoire se tait sur ceux qui lui succédèrent dans cette œuvre, et sur ce qui se passa chez ces nouveaux convertis. Sans doute, l’Évangile qu’il prêchait n’était plus aussi pur que l’Évangile des temps apostoliques, mais Christ, le Sauveur, le Fils de Dieu, était annoncé, et « celui qui croit au Fils a la vie éternelle ». Nous ne pouvons non plus douter que le Seigneur n’ait entretenu le feu qu’il avait allumé, et n’ait fait progresser et s’étendre la vérité qu’un si grand nombre avait reçue.
5.7.3 - Irlande - Patrick
Laissons, pour le moment, l’Écosse pour nous occuper de l’Irlande et du serviteur de Dieu qui y travailla durant de longues années à proclamer l’Évangile.
Vers l’an 372, naquit en Écosse, au village chrétien de Bonavern, non loin de Glasgow, un jeune garçon que ses parents avaient nommé Succat, mais qui est plus connu sous le nom de Patrick. Ses parents étaient des chrétiens sérieux. Son grand-père avait été presbytre ou ancien, et son père, Calpornus, homme simple et pieux, était diacre de l’église de Bonavern. Sa mère, nommée Conchessa, sœur de l’archevêque Martin de Tours, était une femme distinguée entre celles de son temps. Dès son jeune âge, les parents de Succat cherchèrent à faire pénétrer dans son cœur les vérités chrétiennes. Mais le jeune garçon, vif, impétueux, plein de vigueur, était peu disposé à prêter l’oreille aux enseignements de sa mère, ni à l’exhortation du sage : « Écoute, mon fils, l’instruction de ton père, et n’abandonne pas l’enseignement de ta mère » (Proverbes 1:8). Il aimait le plaisir et s’y livrait avec fougue, entraînant avec lui les jeunes gens de son âge. Emporté ainsi par ses passions, il tomba, à l’âge de quinze ans, dans une faute grave.
Il avait environ seize ans, lorsque ses parents furent appelés à quitter l’Écosse et allèrent s’établir dans l’Armorique (*). Là, Succat, se trouvant un jour sur le bord de la mer avec ses deux sœurs, Lupita et Tigris, des pirates irlandais, conduits par un chef nommé O’Neal, parurent tout à coup, se saisirent des trois jeunes gens, les entraînèrent dans leur barque et les transportèrent en Irlande, où ils furent vendus à l’un des chefs de ces peuples encore païens. Semblable au fils prodigué, Succat fut envoyé dans les pâturages pour y garder les pourceaux. Il passa là six années en esclavage, et eut beaucoup à souffrir. Mais Dieu se servit de ces rudes épreuves pour l’amener à réfléchir et à rentrer en lui-même. Seul dans ces campagnes, sans aucun secours religieux, l’Esprit Saint agit dans son cœur. Il se rappela sa vie passée, et il sentit peser lourdement sur son âme le péché qu’il avait autrefois commis. Jour et nuit, il y pensait. Dans son angoisse, il pleurait et priait, et les combats qui se livraient en lui étaient si grands, que son corps devenait comme insensible aux intempéries, à la fatigue, à la faim et à la soif. Mais en même temps que le souvenir de ses fautes le troublait ainsi, en repassant en lui-même les jours de son enfance, il se rappela les tendres paroles de sa mère, ses prières et les passages des saintes Écritures qu’elle lui récitait et où il était question du Sauveur. Dieu, qui est plein de grâce envers le pécheur repentant, se servit de ces souvenirs pour la bénédiction de Succat. Il se tourna vers le précieux Sauveur dont Conchessa lui avait parlé, et il trouva la paix auprès de Lui.
(*) La Bretagne d’aujourd’hui.
« J’avais seize ans », raconte-t-il lui-même, « et je ne connaissais pas le vrai Dieu ; mais le Seigneur, dans cette terre étrangère, ouvrit mon cœur incrédule, de sorte que, bien que tard, je me rappelai mes péchés et me convertis de tout mon cœur au Seigneur, mon Dieu, qui regarda à ma bassesse, eut pitié de ma jeunesse et de mon ignorance, et me consola comme un père console son enfant ». N’est-elle pas merveilleuse cette œuvre que sans instrument extérieur l’Esprit de Dieu opéra dans le cœur de ce jeune homme ? Œuvre d’amour où, comme dans l’histoire du fils prodigue, nous voyons Dieu donnant le b..... du pardon à son enfant repentant. Et c’est cette même œuvre que l’Esprit Saint opère encore aujourd’hui pour amener les âmes à Dieu. Il faut naître de nouveau, naître d’en haut.
Ainsi, dans ces contrées éloignées du centre de l’empire romain, loin de toutes les querelles théologiques qui agitaient les églises de l’Occident et de l’Orient, l’Évangile s’était conservé relativement pur. C’était la grâce du Seigneur Jésus qui apporte le salut, et la puissance du Saint Esprit qui l’applique à l’âme. Après en avoir fait l’expérience, voici ce que raconte encore Succat : « L’amour de Dieu croissait de plus en plus en moi avec la foi et la crainte de son nom. L’Esprit me pressait tellement que, jusqu’à cent fois dans un seul jour, je priais. Et même, quand je restais dans les forêts et les montagnes où je gardais mon troupeau, j’étais poussé avant le jour à prier, par la neige, par la gelée, par la pluie, parce que l’Esprit brûlait alors en moi. Dans ce temps-là, je ne ressentais pas dans mon cœur cette nonchalance que j’y trouve maintenant ». On peut voir en Succat une âme qui a été profondément exercée devant Dieu, et qui savait ce qu’est la communion personnelle et immédiate avec Dieu et Christ produite par l’action et la puissance de l’Esprit Saint, en dehors des formes du culte de Rome. Et tel était en général le christianisme des îles Britanniques au 4° et au 5° siècle.
Succat, délivré une première fois, fut de nouveau fait captif ; mais enfin il put aller retrouver sa famille. Mais bientôt il se sentit irrésistiblement poussé à retourner dans ce pays où il avait trouvé le salut. Il faut qu’il aille annoncer l’Évangile à ces païens de l’Irlande au milieu desquels il a vécu. En vain ses parents et ses amis cherchent à le retenir. Son ardent désir le suit dans ses rêves ; il lui semble entendre pendant la nuit des voix qui lui crient : « Viens, ô saint enfant, et demeure de nouveau parmi nous ». Son cœur en était profondément ému. Enfin, malgré ceux qui voulaient l’en empêcher, il partit, tout pénétré de l’amour de Christ. « Cela ne se fit pas dans ma propre force », dit-il, « ce fut Dieu qui surmonta tout ».
Succat, que nous nommerons maintenant Patrick, nom qui lui fut donné plus tard, retourna donc en Irlande, rempli de zèle pour le salut des païens de ce pays. Ingénieux dans les moyens à employer, il battait des timbales, et rassemblait ainsi autour de lui dans les champs ses auditeurs, auxquels il racontait dans leur propre langue, l’histoire de Jésus, le Fils de Dieu. Ces esprits encore grossiers et barbares, étaient peu à peu touchés par ces simples récits. La parole de Dieu exerçait sa divine puissance sur les cœurs, et beaucoup d’âmes furent converties au christianisme. C’est ainsi que sur cette terre païenne se formèrent des églises chrétiennes, où, mêlé peut-être à quelques erreurs, cependant l’Évangile était annoncé. Le fils d’un seigneur, que Patrick nomme Bénignus, apprenait de lui à prêcher l’Évangile, et le barde ou poète de la cour, au lieu des hymnes sanguinaires des druides, chantait des cantiques de louanges adressés à Jésus Christ. Patrick consacra le reste de sa vie exclusivement aux habitants de l’Irlande, et travailla au milieu d’eux à répandre la connaissance de Jésus Christ, à travers beaucoup de dangers et de difficultés. On ignore l’année de sa mort.
L’œuvre commencée en Irlande par Patrick continua à se développer après sa mort, et l’on put voir alors se manifester pleinement les fruits de son ministère. L’Irlande, au commencement du VIe siècle, nous est décrite comme une contrée bénie, siège de la pure doctrine chrétienne, de la piété et de la paix, ce qui lui avait valu le nom d’ « Île des saints ». Les monastères, où l’on étudiait diligemment les Écritures, étaient remplis de moines pieux, qui, ne trouvant pas autour d’eux un champ d’activité assez vaste et animés d’un ardent amour pour les âmes des pauvres païens, quittaient leur pays sous la conduite de quelque chef aimé, et allaient prêcher l’Évangile au loin. Telle fut la mission de Colomba. Il faut nous rappeler qu’à cette époque une grande partie de l’Europe était encore habitée par des peuples païens et barbares.
5.7.4 - Colomba
Colomba naquit en Irlande vers l’an 521 ; il vivait donc près de deux siècles après Patrick. Il était de sang royal, mais il avait estimé la croix de Christ plus qu’une position élevée dans le monde, et s’était tourné vers le Dieu Sauveur. Colomba sentait profondément combien il était important de répandre l’Évangile dans les contrées où il était encore ignoré. Sa pensée se portait surtout vers l’Écosse, ce pays d’où Succat était venu apporter en Irlande la bonne nouvelle du salut, mais qui était maintenant livré aux barbares Pictes et Scots. « J’irai », dit Colomba, « prêcher en Écosse la parole de Dieu ».
Il communiqua son dessein à quelques amis chrétiens, et ceux-ci, non seulement l’approuvèrent, mais se déclarèrent prêts à l’accompagner. C’était en l’an 565. Mais comment accomplir leur projet ? Les communications entre les différents pays n’étaient pas faciles comme de nos jours. Trouveront-ils un navire qui veuille les transporter où ils désirent aller ? Ils ne se laissent pas arrêter par la difficulté. Colomba et ses douze compagnons, qui savaient sans doute comment les pécheurs et les pirates construisaient leurs barques, descendent au bord de la mer, et là font avec des branches de saules entrelacées, un grossier esquif qu’ils recouvrent de peaux de bêtes. Ils quittent l’Irlande sur cette frêle embarcation, sous la conduite du Seigneur, et, après une longue et périlleuse navigation, les intrépides missionnaires atteignent l’archipel des Hébrides. Des pirates, non moins audacieux, sillonnaient aussi ces mers orageuses, mais c’était pour porter au loin le pillage et le meurtre ; les humbles et paisibles serviteurs de Christ exposaient leur vie pour apporter aux misérables païens le salut et la vie éternelle. Colomba s’arrêta près des stériles rochers de Mull, au sud des fameuses grottes basaltiques de Staffa, dans une petite île que l’on nomma I-colm-kill, ou île de la cellule de Colomba. Mais elle est plus connue sous le nom de Iona ou Jishona, ce qui veut dire Île sainte (*). Des druides (**), chassés autrefois de la Gaule et de la Bretagne par les Romains, s’étaient réfugiés dans ces îles. Il y en avait encore à Iona quand Colomba y aborda ; joints aux indigènes, ils témoignèrent d’abord aux nouveaux venus des sentiments hostiles. Mais peu à peu l’opposition cessa, et Conall, le roi des Pictes, donna à Colomba l’île de Iona.
(*) Nos lecteurs trouveront aisément ces endroits sur une carte des Îles Britanniques.
(**) Prêtres de la religion sanguinaire des Gaulois et des Bretons. Les druides, dans l’accomplissement de leurs rites religieux, immolaient souvent des victimes humaines. Ils enseignaient cependant l’immortalité de l’âme et une existence après cette vie. C’est dans ces croyances que les Gaulois puisaient le mépris de la mort qui les caractérisait.
Colomba y érigea une chapelle et fonda un monastère qui acquit une si grande réputation que, pendant des siècles, on le regarda comme la lumière du monde occidental. De toutes parts on s’y rendait, et de là des hommes pleins de zèle et de foi allèrent, en bravant les difficultés et en supportant bien des privations, répandre l’Évangile au loin, chez les Pictes d’Écosse, les Celtes et les Saxons de la Grande Bretagne. Colomba était un zélé serviteur du Seigneur, vivant en la présence de Dieu, traitant durement son corps, couchant sur la terre nue, mais portant toujours partout une figure rayonnante d’amour, et sur laquelle se peignaient la joie et la sérénité qui remplissaient son âme. Il ne voulait pas qu’aucun moment fût perdu pour le service de Dieu. Il consacrait tout son temps à prier, à lire, à écrire, à enseigner et à prêcher la parole de Dieu. À son exemple, les moines s’adonnaient à la lecture, à la méditation et à la prière. Mais ils ne se bornaient pas à cela ; ils se livraient à des travaux manuels, à la culture des champs et des jardins, et se nourrissaient des fruits du travail de leurs mains. Ils étaient ainsi en exemple aux habitants de Iona et des îles voisines, leur apprenant à cultiver leurs terres, tout en leur faisant connaître le chemin du salut. L’île ayant été donnée à Colomba, il y faisait régner l’ordre et la plus stricte moralité. Colomba résidait habituellement à Iona, mais de là il visitait les autres îles et l’Écosse. Avec une infatigable activité, il allait de maison en maison et de royaume en royaume, annonçant Christ, et faisant l’œuvre d’un évangéliste parmi les Pictes et les Scots encore barbares. Le roi des Pictes fut converti, ainsi qu’un grand nombre de ses sujets. Pendant quarante-trois ans, Colomba poursuivit ainsi son ministère, exerçant, par sa sagesse, sa vie sainte et son dévouement, une grande influence sur les gens de toutes les classes et de toutes les conditions. Mais son affaire principale était de former des hommes capables de porter l’Évangile au près et au loin. Pour cela, de précieux manuscrits furent transportés à Iona, et peu à peu s’y forma une bibliothèque qui devint célèbre. Les moines pouvaient ainsi s’instruire, mais les Écritures étaient toujours leur principale étude. Colomba mourut en 597, après une vie toute consacrée au service du Seigneur.
Le christianisme que l’on trouvait à Iona et dans les contrées évangélisées par les missionnaires, était bien différent du système religieux qui prévalait toujours plus dans d’autres parties de l’Europe sous l’influence et l’autorité croissante des prêtres et surtout de l’évêque de Rome, qui aspirait à la domination spirituelle universelle ; système qui tendait à remplacer le culte en esprit et en vérité par des formes et des cérémonies mêlées d’idolâtrie et de superstitions. Bien qu’à Iona il y eût certaines formes, ce n’était pas en elles que l’on cherchait le salut. Parmi ces chrétiens, il y avait à la tête des églises des anciens ou presbytres, et des évêques ou surveillants, mais ces deux charges étaient presque les mêmes. Iona était présidée par un simple ancien. Les missionnaires qui allaient évangéliser portaient le titre d’évêques et étaient mis à part par l’imposition des mains des anciens. Mais ce n’était pas une consécration humaine qui faisait un ancien, un évêque, ou un missionnaire. « C’est l’Esprit Saint », disait Colomha, « qui fait un serviteur de Dieu » (voir Actes 20:17-28). L’enseignement donné par les anciens était simple : « La Sainte Écriture », disaient-ils, « est la règle unique de la foi. Il n’y a dans les œuvres aucun mérite ; n’attendez votre salut que par la grâce de Dieu. Gardez-vous d’une religion qui consiste dans des pratiques extérieures ; conserver un cœur pur devant Dieu vaut mieux que s’abstenir des viandes. Jésus Christ est l’unique chef de l’Église. Les évêques et les presbytres sont égaux. Ils doivent être maris d’une seule femme et tenir leurs enfants dans la soumission ». Ce sont bien là les enseignements que nous trouvons dans la Parole de Dieu, et spécialement dans les épîtres de Paul.
Après Colomba, les Culdées, ces chrétiens qui s’étaient réfugiés dans les Hébrides, conservèrent les institutions du pieux serviteur de Dieu, et un long temps s’écoula avant que la Rome papale réussît à les assujettir à son joug et à ses erreurs. Combien il est précieux de voir la lumière de la vérité continuer à briller au sein des ténèbres qui, peu à peu, envahissaient la chrétienté ! Un grand zèle missionnaire se montrait toujours à Iona. Des serviteurs de Dieu partaient pour évangéliser, non seulement en Écosse et dans la Grande-Bretagne, mais aussi sur le continent parmi les peuples restés païens.
5.7.5 - Colomban
C’est ainsi que Colomban, qu’il ne faut pas confondre avec Colomba, bien qu’ils vécussent à peu près dans le même temps, « sentant », dit un auteur, « brûler dans son cœur le feu que le Seigneur est venu allumer sur la terre », résolut d’aller porter l’Évangile jusqu’au-delà des frontières de l’empire des Francs. Né en Irlande, il avait passé ses premières années à Iona, puis il avait été dans le grand et célèbre couvent de Bangor, en Irlande. Il partit de là, en l’an 590, avec douze missionnaires, et se rendit dans les Gaules. La renommée de sa piété était arrivée aux oreilles de Gontran, roi des Burgondes, qui l’engagea à s’arrêter dans son pays. Mais Colomban refusa, et alla s’établir dans la contrée des Vosges, encore inculte et presque inaccessible. Là, les missionnaires, au milieu des grossiers habitants de ce pays qui les regardaient avec défiance, eurent d’abord à souffrir de grandes privations, ne trouvant souvent pour se nourrir que des herbes sauvages, des écorces d’arbres et quelques poissons. Graduellement cependant, les farouches indigènes s’adoucirent à leur égard. La vie sainte et dévouée de ces moines étrangers leur inspira du respect. Ils leur apportèrent des vivres, et croyant que leurs prières avaient une grande efficacité, ils réclamèrent leurs intercessions auprès de Dieu. Bientôt une foule d’entre eux se convertirent, et Colomban érigea en divers endroits des monastères, où régnait une discipline sévère en même temps qu’une profonde piété.
Colomban, en fidèle serviteur de Dieu, ne craignait pas, à l’exemple de Jean le Baptiseur autrefois, de reprendre les grands de la terre à cause de leurs péchés. Alors régnait en Bourgogne, Thierry II, le petit-fils de Gontran. Ce roi, soutenu et encouragé par son aïeule Brunehaut, fameuse par ses crimes, menait une vie des plus dissolues. Il se rendait cependant souvent auprès de Colomban pour solliciter ses prières, croyant peut-être par là expier ses péchés. Mais l’homme de Dieu se mit à le reprendre sérieusement de ses débordements, et le roi promit de se corriger. Alors Brunehaut l’excita contre le serviteur du Seigneur, et fit tout pour perdre celui-ci. Colomban, sachant qu’elle préparait des embûches contre lui, se rendit à la maison royale où, étant arrivé, il ne voulut pas entrer. Ayant appris qu’il était là, le roi lui envoya des présents pour l’honorer. Mais Colomban les refusa en disant : « Le Très Haut réprouve les dons de l’impie ; son serviteur ne peut pas les accepter ». Le roi et Brunehaut effrayés vinrent le supplier de leur pardonner, promettant de s’amender. Mais bientôt ils retombèrent dans leur vie de péché, et, pour se débarrasser des avertissements de l’homme de Dieu, Thierry, n’osant le faire mourir, le chassa de son royaume et le fit conduire à Nantes, où Colomban s’embarqua pour l’Irlande. Une tempête ayant repoussé le navire sur les côtes de Bretagne, Colomban vit en cela un signe que le Seigneur voulait qu’il continuât sa mission sur le continent. Il se rendit en Suisse et resta quelque temps sur les bords du lac de Constance, évangélisant avec son fidèle compagnon Gall les idolâtres de ces contrées. Puis il passa en Italie, où il travailla activement parmi les Lombards (*). Il mourut en l’an 616, au monastère de Bobbio qu’il avait fondé. Il s’était toujours opposé aux prétentions du pape, ou évêque de Rome.
(*) Là aussi il eut à évangéliser des païens, mais bien davantage à combattre l’arianisme, qui était la forme de christianisme de ces Barbares redoutés entre tous, établis en Italie du Nord depuis 568. Il baptisa leur roi à Milan, mais l’ensemble du peuple lombard n’abjura l’arianisme qu’en 658, et les Lombards devaient être encore pendant un siècle, jusqu’à ce que Charlemagne détruisît leur royaume en 774, un obstacle à l’expansion spirituelle et temporelle de la papauté romaine.
Quand Colomban partit pour l’Italie, il dut laisser son disciple Gall qui était tombé malade. Gall resta en Suisse, et, plus tard, annonça dans leur propre langue l’Évangile aux habitants encore païens de ce pays, et un grand nombre furent convertis. Il fonda le célèbre monastère qui porte son nom, et est considéré comme l’apôtre de la Suisse. Il mourut en l’an 627.
Ainsi, par le zèle et le dévouement de ces moines venus d’Écosse et d’Irlande, le christianisme se répandit dans les Pays-Bas, la Gaule, la Suisse, une partie de l’Allemagne et le nord de l’Italie. Ces chrétiens, libres du joug de l’Église romaine, firent plus que celle-ci pour faire connaître l’Évangile dans l’Europe centrale. Malheureusement, profitant de l’ignorance des temps qui suivirent, l’Église de Rome finit par entraîner les populations dans ses erreurs et les fit passer sous sa domination. L’Écosse et l’Irlande n’y échappèrent pas ; elles succombèrent après bien des luttes, et il ne resta que quelques faibles foyers de lumière, épars çà et là, jusqu’aux jours de la Réformation.
5.8 - Grégoire le Grand
Au temps où Colomba et Colomban poursuivaient leurs travaux évangéliques, l’évêque ou pape de Rome était Grégoire, qu’on a surnommé le Grand. Il était né à Rome en 540, d’une famille noble, et aurait pu arriver aux places les plus éminentes, mais à l’âge de 35 ans, il renonça au monde et aux honneurs, employa ses richesses à fonder plusieurs monastères et à soulager les pauvres, et fit de son palais à Rome un couvent où il menait une vie ascétique rigoureuse, s’assujettissant aux travaux les plus humbles, et consacrant le reste de son temps à la prière et à des actes de pénitence. Pensait-il acquérir par-là le pardon de ses péchés et une place dans le ciel ? Nous pouvons espérer mieux que cela de lui, car il disait : « Dieu a sauvé les saints sans qu’ils eussent aucun mérite ; la félicité des saints est une grâce et ne s’acquiert point par des mérites », mais il croyait sans doute, comme plusieurs de nos jours, que des œuvres et des prières sont nécessaires pour attirer la miséricorde de Dieu et fléchir sa colère, ces personnes-là considérant Dieu comme un Juge et non comme un Père. Elles ne connaissent pas l’amour parfait de Dieu qui bannit toute crainte (1 Jean 4:18).
Les évêques ou papes de Rome ne cessaient de chercher à établir et à faire reconnaître leur prééminence sur tous les autres évêques de la chrétienté. Ils se basaient sur la prétendue primauté de Pierre sur les autres apôtres, et se disaient ses successeurs. Ils argumentaient aussi sur ce que Rome étant la tête de l’empire, l’évêque de Rome devait aussi être considéré comme le chef de la chrétienté. Appuyant ainsi leurs prétentions, ils s’efforçaient, soit par les conciles, soit par les empereurs, d’obtenir une sanction qui leur assurât ce rang suprême. Mais ils rencontrèrent d’abord une forte opposition. Déjà au troisième siècle, Cyprien de Carthage résistait à ces prétentions, et pendant longtemps le titre d’évêque des évêques leur fut contesté. Les églises d’Occident, par suite de diverses circonstances, finirent par accepter leur suprématie ; mais l’Église grecque ou d’Orient, ainsi que les églises nestoriennes, arméniennes et autres dont nous parlerons, ne la reconnurent jamais. L’Église grecque, vers le milieu du 11° siècle, se sépara entièrement de Rome.
Parmi les papes qui revendiquèrent avec énergie la suprématie de Rome sur les autres églises, un des plus célèbres est Léon Ier, que l’on a surnommé le Grand. Il se distingua en effet par de grandes qualités, mais nous devons nous rappeler que la grandeur au point de vue humain n’est pas toujours la grandeur selon Dieu. Disons quelques mots sur ce pape célèbre à plusieurs égards.
Léon Ier devint évêque de Rome en l’an 440. Augustin était mort en 430, Léon était donc le contemporain de ses dernières années. Les temps où il vivait étaient particulièrement troublés. En Orient, l’empire était agité par des hérésies sans cesse renaissantes, par la jalousie des divers patriarches, ou supérieurs ecclésiastiques des différentes provinces, et par la crainte des Barbares qui menaçaient les frontières. L’Occident avait déjà été en partie envahi par eux (*) ; Rome même avait été prise et pillée par Alaric, roi des Visigoths, en 410. La dignité du nom impérial avait disparu avec Théodose le Grand. Ses faibles successeurs n’avaient pas l’énergie nécessaire pour repousser les attaques incessantes des ennemis de l’empire. Dans ces circonstances, Léon, par son courage et son habileté dans les négociations politiques, sut en imposer aux Barbares, sauver Rome, en même temps qu’il s’opposait aux hérétiques et maintenait la vérité touchant la Personne de Christ. On ne doit pas s’étonner si le siège épiscopal de Rome occupé par un tel homme, acquit un prestige de nature à grandir son autorité.
(*) Plusieurs de ces Barbares avaient déjà embrassé le christianisme en Orient, mais sous sa forme arienne : c’était le cas des peuples Goths, des Burgondes, des Vandales. Ils furent longtemps des adversaires pour l’Église romaine. D’autres, tels les Francs, les Saxons, étaient restés païens ; une fois amenés au christianisme par les évêques et les moines catholiques, ils prêtèrent une aide efficace au pape. Les rois francs, de Clovis (baptisé en 496 avec ses guerriers) à Charlemagne (proclamé empereur par le pape en 800) et à ses successeurs, tinrent là un rôle décisif.
En l’an 452, Attila, le terrible roi des Huns, après avoir ravagé la Lombardie, se dirigeait vers Rome dans l’intention de s’en emparer. L’empereur Valentinien s’était lâchement réfugié dans la ville forte de Ravenne. Rien ne semblait devoir arrêter la marche du roi barbare, lorsque le Sénat et le peuple de Rome décidèrent d’entrer en négociation avec lui. Mais qui choisir, et qui voudrait entreprendre cette affaire dangereuse et délicate ? Le pape Léon fut désigné comme chef de l’ambassade et deux sénateurs du plus haut rang se dévouèrent pour aller avec lui affronter le roi barbare. L’orgueil d’Attila fut flatté de voir la ville impériale, la maîtresse du monde, comme on l’appelait, s’abaisser jusqu’à lui demander la paix par la bouche d’aussi illustres représentants. Touché par le discours que lui adressa Léon, il accorda ce qu’on était venu lui demander, la paix, moyennant un tribut annuel. Un chroniqueur de ce temps, qui fut secrétaire de Léon, dit « qu’il s’en remit à l’assistance de Dieu, qui ne fait jamais défaut aux efforts des justes, et que le succès couronna sa foi ».
De nouveau Rome, trois ans plus tard, fut menacée par le cruel Genséric, roi des Vandales. Il n’y avait ni armée, ni général pour la défendre. Léon, à la tête de son clergé, alla à la rencontre du roi barbare, mais ne fut pas si heureux que lorsqu’il eut affaire avec Attila. Tout ce qu’il put obtenir, c’est qu’un frein fût mis aux excès des rudes et sauvages vainqueurs.
Si, dans ces deux grandes occasions, Léon eut à jouer un certain rôle politique, il se montra surtout plein de zèle et d’activité dans sa charge d’évêque. Comme tel il eut à combattre pour la vérité chrétienne.
Le manichéisme, ou doctrine de Manès, dont nous avons parlé à l’occasion d’Augustin, s’était répandu dans le nord de l’Afrique. Mais Carthage ayant été prise par Genséric, plusieurs des Manichéens cherchèrent un asile à Rome, et, cachant leurs mauvaises doctrines, voulurent se faire passer pour de vrais chrétiens. Léon rechercha diligemment ces hérétiques dont on trouva un grand nombre et, parmi eux, plusieurs évêques. Un tribunal, composé de magistrats et d’ecclésiastiques, les examina, et ils confessèrent que dans leurs réunions secrètes se commettaient de grossières immoralités. Les évêques ne pouvaient que condamner leurs erreurs et les exhorter à les abandonner ; les magistrats durent sévir contre ceux qui s’étaient rendus coupables de crimes. Les impénitents furent bannis de Rome, et Léon exhorta les évêques à être vigilants pour que ces hérétiques ne séduisissent pas les âmes faibles. Il eut aussi à s’opposer à l’hérésie des Priscilliens, dont les doctrines se rapprochaient de celles des Manichéens.
L’hérésie d’Eutychès touchant la Personne de Christ troublait l’Église d’Orient. Nous en parlerons plus tard. Léon, qui était au courant de cette grave affaire, envoya des légats au concile d’Éphèse (celui que l’on nomma concile de brigands) avec une lettre où il exposait la vraie doctrine relativement à Christ. Le faux concile d’Éphèse refusa de la lire, mais elle fut lue dans le concile de Chalcédoine, qui fut convoqué plus tard, et qui annula les actes du concile d’Éphèse et condamna Eutychès. Mais ce concile avait été amené à régler d’autres questions et en particulier celle du rang des patriarches. Il confirma le patriarche de Constantinople comme primat des églises d’Orient, mais n’accorda pas au siège de Rome la suprématie universelle. « Les Pères », dit le concile, « ont avec raison accordé la primauté au siège de l’ancienne Rome, parce qu’elle était la cité royale ; mais de même, les cent quatre-vingts évêques (ceux du concile) ont donné une primauté égale à la nouvelle Rome » (c’est-à-dire Constantinople). Toutefois ils ajoutaient : « immédiatement après l’ancienne Rome ».
Léon, par ses légats, ne donna pas sa sanction à ce canon ou article du concile. Être appelé évêque universel était l’ambition du pape de Rome, et il revendiquait ce titre, mais rencontrait encore de l’opposition, même en Occident.
Du temps de Léon, Hilaire, évêque d’Arles, qu’il ne faut pas confondre avec Hilaire de Poitiers, était le métropolitain des Gaules. Il était plus éclairé que plusieurs autres évêques de cette époque. Il avait été moine et, devenu évêque, il avait continué à vivre d’une manière simple et austère. Il labourait la terre de ses mains, afin de gagner de l’argent pour racheter de pauvres captifs. Il consacrait une grande partie de son temps à la prière et à l’étude, et il prêchait avec une puissance qui captivait ses auditeurs.
Comme métropolitain, il visitait les églises de la Gaule, et trouva un évêque, nommé Chélidonius, qui avait épousé une veuve, et qui, avant d’être évêque, étant juge, avait condamné à la mort un coupable. D’après les canons de l’Église, cela lui interdisait d’occuper un siège épiscopal. Hilaire convoqua un synode à Vienne et Chélidonius fut déposé. Mais Chélidonius en appela à Rome, où Hilaire se rendit pour convaincre Léon qu’il avait agi selon les canons de l’Église. Malgré cela, le pape rétablit Chélidonius dans sa charge et voulut remplacer Hilaire comme métropolitain des Gaules par l’évêque de Vienne ; il obtint même de l’empereur un rescrit contre Hilaire qu’il accusait de troubler la paix de l’Église. Hilaire résista aux prétentions de Léon et continua à remplir ses fonctions jusqu’à sa mort.
Léon, à part ses prétentions à la suprématie sur les autres évêques, fut le champion de la vérité pour autant qu’il la connaissait, et poursuivit avec un zèle infatigable les erreurs et les mauvaises doctrines relatives à la Personne du Seigneur.
Un grand nombre de ses sermons roulent sur la Personne de Christ, et s’étendent soit sur sa vraie divinité, soit sur sa réelle humanité, vérité des plus importantes et fondement du christianisme. Mais relativement à l’expiation, ses idées étaient erronées. Il pensait que l’homme étant esclave de Satan, l’expiation accomplie par le Seigneur était comme un prix payé au diable afin de délivrer l’homme de son autorité sur lui. Cette pensée, qui n’est pas celle de l’Écriture, se rencontre assez fréquemment de nos jours.
Bien qu’il parle des mérites et de la mort de Christ comme seule source de salut, il dit que par les mérites des saints s’opèrent des miracles sur la terre, et qu’ils sont en aide à l’Église. Il mentionne dans ce sens saint Paul, saint Pierre, saint Laurent, mais jamais la Vierge, et il ne dit pas qu’il faille leur adresser directement des prières. Quant au chemin du salut, il dit « Par la prière, on cherche la miséricorde de Dieu ; par le jeûne, les convoitises sont éteintes ; par les aumônes, les péchés sont expiés. Celui qui s’est racheté par des aumônes, ne doit pas douter que, même après plusieurs péchés, la splendeur de la nouvelle naissance ne soit restaurée en Lui ».
Voilà le chemin tracé du salut par les œuvres, bien différent du salut par grâce, et un commencement pour l’invocation des saints ! C’est ainsi que l’erreur s’introduit peu à peu. À côté de cela nous voyons aussi le recours à l’autorité civile, l’assujettissement au monde, mais le nom du Fils de Dieu est maintenu. C’est ce qui caractérise le temps représenté par l’assemblée de Pergame (Apocalypse 2:12-17), comme nous l’avons vu à plusieurs reprises.
5.7 - Le christianisme introduit en Écosse et en Irlande
Chrysostôme, Jérôme, Augustin et Léon Ier nous ont conduits en Orient, à Constantinople et en Syrie, puis en Occident, à Rome et dans l’Afrique septentrionale. Ces hommes étaient de zélés serviteurs de Dieu, qui insistaient sur la nécessité d’une vie pure et séparée du monde, et qui, Augustin surtout, connaissaient et annonçaient le salut par la pure grâce de Dieu. Mais ces mêmes hommes n’étaient pas étrangers aux abus et aux erreurs qui s’étaient introduits dans l’Église, et qui tendaient toujours plus à substituer un culte de formes et de cérémonies au culte en esprit et en vérité (Jean 4:23-24). En même temps, la domination du clergé, évêques et prêtres, sur les simples fidèles, s’accentuait toujours plus, et l’évêque de Rome, en particulier, commençait à vouloir dominer sur tous les autres. Mais avant de voir dans quel triste état l’Église tomba peu à peu, nous dirons comment le christianisme s’introduisit et se répandit en Écosse et en Irlande.
5.7.1 - Écosse
L’Évangile avait été apporté de bonne heure dans le sud de la Grande Bretagne. Chassés par la persécution, au temps de Dioclétien, plusieurs chrétiens de ces contrées se réfugièrent en Écosse, et s’y construisirent de simples demeures, semblables à celles des solitaires. Connus sous le nom de Culdées ou Culdéens, ces humbles chrétiens se sentirent pressés de prier pour le salut des païens qui les entouraient et leur annoncèrent l’Évangile. Les Culdées n’admettaient point les formes superstitieuses et la suprématie de l’Église de Rome, et n’espéraient le salut que par la foi au Seigneur Jésus Christ. Leur vie paisible et sainte frappa les sauvages habitants de ces contrées, et un grand nombre d’entre eux abandonnèrent leurs superstitions et les rites sanglants de leur religion pour se convertir à Christ. Mais les incursions incessantes des Pictes et des Scots, anciens habitants des montagnes de l’Écosse, obligèrent les Culdées à se réfugier dans les Hébrides (*). Plus tard ils durent les quitter, parce qu’ils ne voulaient point se soumettre aux exigences de l’Église romaine, et se dispersèrent dans l’est de l’Écosse où ils subsistèrent jusqu’à la fin du treizième siècle. Quelques années plus tard naissait Wiclef, un des précurseurs de la Réformation. Ainsi le flambeau de la vérité se maintenait, porté par des témoins que Dieu suscitait au milieu de l’erreur.
(*) Groupe d’îles au nord-ouest de l’Irlande.
5.7.2 - Écosse - Ninian
Dans le cinquième siècle, Ninian, « très saint homme de la nation des Bretons », comme le nomme un ancien historien, prêcha aussi l’Évangile dans les districts méridionaux de l’Écosse. Il avait été élevé à Rome et avait achevé ses études auprès du célèbre évêque Martin de Tours. Il se rendit ensuite en Écosse et fixa sa demeure à Galloway. D’après les récits qui nous ont été transmis, Ninian annonça partout autour de lui la parole de la croix. Les sauvages habitants de l’Écosse écoutaient avec surprise ses prédications entraînantes, et un grand nombre furent convertis. Plein de zèle, il poursuivait l’œuvre pour laquelle l’Esprit Saint l’avait envoyé. Partout où il se montrait, les foules accouraient et recevaient avec joie la bonne nouvelle. De toutes parts retentissaient les louanges du Seigneur. Il travaillait comme un fidèle et diligent ouvrier dans la vigne de son Maître, et des milliers d’âmes furent par son moyen amenées à Jésus et reçurent le baptême. Ce fut surtout parmi une tribu des Pictes que son travail eut des résultats. L’histoire se tait sur ceux qui lui succédèrent dans cette œuvre, et sur ce qui se passa chez ces nouveaux convertis. Sans doute, l’Évangile qu’il prêchait n’était plus aussi pur que l’Évangile des temps apostoliques, mais Christ, le Sauveur, le Fils de Dieu, était annoncé, et « celui qui croit au Fils a la vie éternelle ». Nous ne pouvons non plus douter que le Seigneur n’ait entretenu le feu qu’il avait allumé, et n’ait fait progresser et s’étendre la vérité qu’un si grand nombre avait reçue.
5.7.3 - Irlande - Patrick
Laissons, pour le moment, l’Écosse pour nous occuper de l’Irlande et du serviteur de Dieu qui y travailla durant de longues années à proclamer l’Évangile.
Vers l’an 372, naquit en Écosse, au village chrétien de Bonavern, non loin de Glasgow, un jeune garçon que ses parents avaient nommé Succat, mais qui est plus connu sous le nom de Patrick. Ses parents étaient des chrétiens sérieux. Son grand-père avait été presbytre ou ancien, et son père, Calpornus, homme simple et pieux, était diacre de l’église de Bonavern. Sa mère, nommée Conchessa, sœur de l’archevêque Martin de Tours, était une femme distinguée entre celles de son temps. Dès son jeune âge, les parents de Succat cherchèrent à faire pénétrer dans son cœur les vérités chrétiennes. Mais le jeune garçon, vif, impétueux, plein de vigueur, était peu disposé à prêter l’oreille aux enseignements de sa mère, ni à l’exhortation du sage : « Écoute, mon fils, l’instruction de ton père, et n’abandonne pas l’enseignement de ta mère » (Proverbes 1:8). Il aimait le plaisir et s’y livrait avec fougue, entraînant avec lui les jeunes gens de son âge. Emporté ainsi par ses passions, il tomba, à l’âge de quinze ans, dans une faute grave.
Il avait environ seize ans, lorsque ses parents furent appelés à quitter l’Écosse et allèrent s’établir dans l’Armorique (*). Là, Succat, se trouvant un jour sur le bord de la mer avec ses deux sœurs, Lupita et Tigris, des pirates irlandais, conduits par un chef nommé O’Neal, parurent tout à coup, se saisirent des trois jeunes gens, les entraînèrent dans leur barque et les transportèrent en Irlande, où ils furent vendus à l’un des chefs de ces peuples encore païens. Semblable au fils prodigué, Succat fut envoyé dans les pâturages pour y garder les pourceaux. Il passa là six années en esclavage, et eut beaucoup à souffrir. Mais Dieu se servit de ces rudes épreuves pour l’amener à réfléchir et à rentrer en lui-même. Seul dans ces campagnes, sans aucun secours religieux, l’Esprit Saint agit dans son cœur. Il se rappela sa vie passée, et il sentit peser lourdement sur son âme le péché qu’il avait autrefois commis. Jour et nuit, il y pensait. Dans son angoisse, il pleurait et priait, et les combats qui se livraient en lui étaient si grands, que son corps devenait comme insensible aux intempéries, à la fatigue, à la faim et à la soif. Mais en même temps que le souvenir de ses fautes le troublait ainsi, en repassant en lui-même les jours de son enfance, il se rappela les tendres paroles de sa mère, ses prières et les passages des saintes Écritures qu’elle lui récitait et où il était question du Sauveur. Dieu, qui est plein de grâce envers le pécheur repentant, se servit de ces souvenirs pour la bénédiction de Succat. Il se tourna vers le précieux Sauveur dont Conchessa lui avait parlé, et il trouva la paix auprès de Lui.
(*) La Bretagne d’aujourd’hui.
« J’avais seize ans », raconte-t-il lui-même, « et je ne connaissais pas le vrai Dieu ; mais le Seigneur, dans cette terre étrangère, ouvrit mon cœur incrédule, de sorte que, bien que tard, je me rappelai mes péchés et me convertis de tout mon cœur au Seigneur, mon Dieu, qui regarda à ma bassesse, eut pitié de ma jeunesse et de mon ignorance, et me consola comme un père console son enfant ». N’est-elle pas merveilleuse cette œuvre que sans instrument extérieur l’Esprit de Dieu opéra dans le cœur de ce jeune homme ? Œuvre d’amour où, comme dans l’histoire du fils prodigue, nous voyons Dieu donnant le b..... du pardon à son enfant repentant. Et c’est cette même œuvre que l’Esprit Saint opère encore aujourd’hui pour amener les âmes à Dieu. Il faut naître de nouveau, naître d’en haut.
Ainsi, dans ces contrées éloignées du centre de l’empire romain, loin de toutes les querelles théologiques qui agitaient les églises de l’Occident et de l’Orient, l’Évangile s’était conservé relativement pur. C’était la grâce du Seigneur Jésus qui apporte le salut, et la puissance du Saint Esprit qui l’applique à l’âme. Après en avoir fait l’expérience, voici ce que raconte encore Succat : « L’amour de Dieu croissait de plus en plus en moi avec la foi et la crainte de son nom. L’Esprit me pressait tellement que, jusqu’à cent fois dans un seul jour, je priais. Et même, quand je restais dans les forêts et les montagnes où je gardais mon troupeau, j’étais poussé avant le jour à prier, par la neige, par la gelée, par la pluie, parce que l’Esprit brûlait alors en moi. Dans ce temps-là, je ne ressentais pas dans mon cœur cette nonchalance que j’y trouve maintenant ». On peut voir en Succat une âme qui a été profondément exercée devant Dieu, et qui savait ce qu’est la communion personnelle et immédiate avec Dieu et Christ produite par l’action et la puissance de l’Esprit Saint, en dehors des formes du culte de Rome. Et tel était en général le christianisme des îles Britanniques au 4° et au 5° siècle.
Succat, délivré une première fois, fut de nouveau fait captif ; mais enfin il put aller retrouver sa famille. Mais bientôt il se sentit irrésistiblement poussé à retourner dans ce pays où il avait trouvé le salut. Il faut qu’il aille annoncer l’Évangile à ces païens de l’Irlande au milieu desquels il a vécu. En vain ses parents et ses amis cherchent à le retenir. Son ardent désir le suit dans ses rêves ; il lui semble entendre pendant la nuit des voix qui lui crient : « Viens, ô saint enfant, et demeure de nouveau parmi nous ». Son cœur en était profondément ému. Enfin, malgré ceux qui voulaient l’en empêcher, il partit, tout pénétré de l’amour de Christ. « Cela ne se fit pas dans ma propre force », dit-il, « ce fut Dieu qui surmonta tout ».
Succat, que nous nommerons maintenant Patrick, nom qui lui fut donné plus tard, retourna donc en Irlande, rempli de zèle pour le salut des païens de ce pays. Ingénieux dans les moyens à employer, il battait des timbales, et rassemblait ainsi autour de lui dans les champs ses auditeurs, auxquels il racontait dans leur propre langue, l’histoire de Jésus, le Fils de Dieu. Ces esprits encore grossiers et barbares, étaient peu à peu touchés par ces simples récits. La parole de Dieu exerçait sa divine puissance sur les cœurs, et beaucoup d’âmes furent converties au christianisme. C’est ainsi que sur cette terre païenne se formèrent des églises chrétiennes, où, mêlé peut-être à quelques erreurs, cependant l’Évangile était annoncé. Le fils d’un seigneur, que Patrick nomme Bénignus, apprenait de lui à prêcher l’Évangile, et le barde ou poète de la cour, au lieu des hymnes sanguinaires des druides, chantait des cantiques de louanges adressés à Jésus Christ. Patrick consacra le reste de sa vie exclusivement aux habitants de l’Irlande, et travailla au milieu d’eux à répandre la connaissance de Jésus Christ, à travers beaucoup de dangers et de difficultés. On ignore l’année de sa mort.
L’œuvre commencée en Irlande par Patrick continua à se développer après sa mort, et l’on put voir alors se manifester pleinement les fruits de son ministère. L’Irlande, au commencement du VIe siècle, nous est décrite comme une contrée bénie, siège de la pure doctrine chrétienne, de la piété et de la paix, ce qui lui avait valu le nom d’ « Île des saints ». Les monastères, où l’on étudiait diligemment les Écritures, étaient remplis de moines pieux, qui, ne trouvant pas autour d’eux un champ d’activité assez vaste et animés d’un ardent amour pour les âmes des pauvres païens, quittaient leur pays sous la conduite de quelque chef aimé, et allaient prêcher l’Évangile au loin. Telle fut la mission de Colomba. Il faut nous rappeler qu’à cette époque une grande partie de l’Europe était encore habitée par des peuples païens et barbares.
5.7.4 - Colomba
Colomba naquit en Irlande vers l’an 521 ; il vivait donc près de deux siècles après Patrick. Il était de sang royal, mais il avait estimé la croix de Christ plus qu’une position élevée dans le monde, et s’était tourné vers le Dieu Sauveur. Colomba sentait profondément combien il était important de répandre l’Évangile dans les contrées où il était encore ignoré. Sa pensée se portait surtout vers l’Écosse, ce pays d’où Succat était venu apporter en Irlande la bonne nouvelle du salut, mais qui était maintenant livré aux barbares Pictes et Scots. « J’irai », dit Colomba, « prêcher en Écosse la parole de Dieu ».
Il communiqua son dessein à quelques amis chrétiens, et ceux-ci, non seulement l’approuvèrent, mais se déclarèrent prêts à l’accompagner. C’était en l’an 565. Mais comment accomplir leur projet ? Les communications entre les différents pays n’étaient pas faciles comme de nos jours. Trouveront-ils un navire qui veuille les transporter où ils désirent aller ? Ils ne se laissent pas arrêter par la difficulté. Colomba et ses douze compagnons, qui savaient sans doute comment les pécheurs et les pirates construisaient leurs barques, descendent au bord de la mer, et là font avec des branches de saules entrelacées, un grossier esquif qu’ils recouvrent de peaux de bêtes. Ils quittent l’Irlande sur cette frêle embarcation, sous la conduite du Seigneur, et, après une longue et périlleuse navigation, les intrépides missionnaires atteignent l’archipel des Hébrides. Des pirates, non moins audacieux, sillonnaient aussi ces mers orageuses, mais c’était pour porter au loin le pillage et le meurtre ; les humbles et paisibles serviteurs de Christ exposaient leur vie pour apporter aux misérables païens le salut et la vie éternelle. Colomba s’arrêta près des stériles rochers de Mull, au sud des fameuses grottes basaltiques de Staffa, dans une petite île que l’on nomma I-colm-kill, ou île de la cellule de Colomba. Mais elle est plus connue sous le nom de Iona ou Jishona, ce qui veut dire Île sainte (*). Des druides (**), chassés autrefois de la Gaule et de la Bretagne par les Romains, s’étaient réfugiés dans ces îles. Il y en avait encore à Iona quand Colomba y aborda ; joints aux indigènes, ils témoignèrent d’abord aux nouveaux venus des sentiments hostiles. Mais peu à peu l’opposition cessa, et Conall, le roi des Pictes, donna à Colomba l’île de Iona.
(*) Nos lecteurs trouveront aisément ces endroits sur une carte des Îles Britanniques.
(**) Prêtres de la religion sanguinaire des Gaulois et des Bretons. Les druides, dans l’accomplissement de leurs rites religieux, immolaient souvent des victimes humaines. Ils enseignaient cependant l’immortalité de l’âme et une existence après cette vie. C’est dans ces croyances que les Gaulois puisaient le mépris de la mort qui les caractérisait.
Colomba y érigea une chapelle et fonda un monastère qui acquit une si grande réputation que, pendant des siècles, on le regarda comme la lumière du monde occidental. De toutes parts on s’y rendait, et de là des hommes pleins de zèle et de foi allèrent, en bravant les difficultés et en supportant bien des privations, répandre l’Évangile au loin, chez les Pictes d’Écosse, les Celtes et les Saxons de la Grande Bretagne. Colomba était un zélé serviteur du Seigneur, vivant en la présence de Dieu, traitant durement son corps, couchant sur la terre nue, mais portant toujours partout une figure rayonnante d’amour, et sur laquelle se peignaient la joie et la sérénité qui remplissaient son âme. Il ne voulait pas qu’aucun moment fût perdu pour le service de Dieu. Il consacrait tout son temps à prier, à lire, à écrire, à enseigner et à prêcher la parole de Dieu. À son exemple, les moines s’adonnaient à la lecture, à la méditation et à la prière. Mais ils ne se bornaient pas à cela ; ils se livraient à des travaux manuels, à la culture des champs et des jardins, et se nourrissaient des fruits du travail de leurs mains. Ils étaient ainsi en exemple aux habitants de Iona et des îles voisines, leur apprenant à cultiver leurs terres, tout en leur faisant connaître le chemin du salut. L’île ayant été donnée à Colomba, il y faisait régner l’ordre et la plus stricte moralité. Colomba résidait habituellement à Iona, mais de là il visitait les autres îles et l’Écosse. Avec une infatigable activité, il allait de maison en maison et de royaume en royaume, annonçant Christ, et faisant l’œuvre d’un évangéliste parmi les Pictes et les Scots encore barbares. Le roi des Pictes fut converti, ainsi qu’un grand nombre de ses sujets. Pendant quarante-trois ans, Colomba poursuivit ainsi son ministère, exerçant, par sa sagesse, sa vie sainte et son dévouement, une grande influence sur les gens de toutes les classes et de toutes les conditions. Mais son affaire principale était de former des hommes capables de porter l’Évangile au près et au loin. Pour cela, de précieux manuscrits furent transportés à Iona, et peu à peu s’y forma une bibliothèque qui devint célèbre. Les moines pouvaient ainsi s’instruire, mais les Écritures étaient toujours leur principale étude. Colomba mourut en 597, après une vie toute consacrée au service du Seigneur.
Le christianisme que l’on trouvait à Iona et dans les contrées évangélisées par les missionnaires, était bien différent du système religieux qui prévalait toujours plus dans d’autres parties de l’Europe sous l’influence et l’autorité croissante des prêtres et surtout de l’évêque de Rome, qui aspirait à la domination spirituelle universelle ; système qui tendait à remplacer le culte en esprit et en vérité par des formes et des cérémonies mêlées d’idolâtrie et de superstitions. Bien qu’à Iona il y eût certaines formes, ce n’était pas en elles que l’on cherchait le salut. Parmi ces chrétiens, il y avait à la tête des églises des anciens ou presbytres, et des évêques ou surveillants, mais ces deux charges étaient presque les mêmes. Iona était présidée par un simple ancien. Les missionnaires qui allaient évangéliser portaient le titre d’évêques et étaient mis à part par l’imposition des mains des anciens. Mais ce n’était pas une consécration humaine qui faisait un ancien, un évêque, ou un missionnaire. « C’est l’Esprit Saint », disait Colomha, « qui fait un serviteur de Dieu » (voir Actes 20:17-28). L’enseignement donné par les anciens était simple : « La Sainte Écriture », disaient-ils, « est la règle unique de la foi. Il n’y a dans les œuvres aucun mérite ; n’attendez votre salut que par la grâce de Dieu. Gardez-vous d’une religion qui consiste dans des pratiques extérieures ; conserver un cœur pur devant Dieu vaut mieux que s’abstenir des viandes. Jésus Christ est l’unique chef de l’Église. Les évêques et les presbytres sont égaux. Ils doivent être maris d’une seule femme et tenir leurs enfants dans la soumission ». Ce sont bien là les enseignements que nous trouvons dans la Parole de Dieu, et spécialement dans les épîtres de Paul.
Après Colomba, les Culdées, ces chrétiens qui s’étaient réfugiés dans les Hébrides, conservèrent les institutions du pieux serviteur de Dieu, et un long temps s’écoula avant que la Rome papale réussît à les assujettir à son joug et à ses erreurs. Combien il est précieux de voir la lumière de la vérité continuer à briller au sein des ténèbres qui, peu à peu, envahissaient la chrétienté ! Un grand zèle missionnaire se montrait toujours à Iona. Des serviteurs de Dieu partaient pour évangéliser, non seulement en Écosse et dans la Grande-Bretagne, mais aussi sur le continent parmi les peuples restés païens.
5.7.5 - Colomban
C’est ainsi que Colomban, qu’il ne faut pas confondre avec Colomba, bien qu’ils vécussent à peu près dans le même temps, « sentant », dit un auteur, « brûler dans son cœur le feu que le Seigneur est venu allumer sur la terre », résolut d’aller porter l’Évangile jusqu’au-delà des frontières de l’empire des Francs. Né en Irlande, il avait passé ses premières années à Iona, puis il avait été dans le grand et célèbre couvent de Bangor, en Irlande. Il partit de là, en l’an 590, avec douze missionnaires, et se rendit dans les Gaules. La renommée de sa piété était arrivée aux oreilles de Gontran, roi des Burgondes, qui l’engagea à s’arrêter dans son pays. Mais Colomban refusa, et alla s’établir dans la contrée des Vosges, encore inculte et presque inaccessible. Là, les missionnaires, au milieu des grossiers habitants de ce pays qui les regardaient avec défiance, eurent d’abord à souffrir de grandes privations, ne trouvant souvent pour se nourrir que des herbes sauvages, des écorces d’arbres et quelques poissons. Graduellement cependant, les farouches indigènes s’adoucirent à leur égard. La vie sainte et dévouée de ces moines étrangers leur inspira du respect. Ils leur apportèrent des vivres, et croyant que leurs prières avaient une grande efficacité, ils réclamèrent leurs intercessions auprès de Dieu. Bientôt une foule d’entre eux se convertirent, et Colomban érigea en divers endroits des monastères, où régnait une discipline sévère en même temps qu’une profonde piété.
Colomban, en fidèle serviteur de Dieu, ne craignait pas, à l’exemple de Jean le Baptiseur autrefois, de reprendre les grands de la terre à cause de leurs péchés. Alors régnait en Bourgogne, Thierry II, le petit-fils de Gontran. Ce roi, soutenu et encouragé par son aïeule Brunehaut, fameuse par ses crimes, menait une vie des plus dissolues. Il se rendait cependant souvent auprès de Colomban pour solliciter ses prières, croyant peut-être par là expier ses péchés. Mais l’homme de Dieu se mit à le reprendre sérieusement de ses débordements, et le roi promit de se corriger. Alors Brunehaut l’excita contre le serviteur du Seigneur, et fit tout pour perdre celui-ci. Colomban, sachant qu’elle préparait des embûches contre lui, se rendit à la maison royale où, étant arrivé, il ne voulut pas entrer. Ayant appris qu’il était là, le roi lui envoya des présents pour l’honorer. Mais Colomban les refusa en disant : « Le Très Haut réprouve les dons de l’impie ; son serviteur ne peut pas les accepter ». Le roi et Brunehaut effrayés vinrent le supplier de leur pardonner, promettant de s’amender. Mais bientôt ils retombèrent dans leur vie de péché, et, pour se débarrasser des avertissements de l’homme de Dieu, Thierry, n’osant le faire mourir, le chassa de son royaume et le fit conduire à Nantes, où Colomban s’embarqua pour l’Irlande. Une tempête ayant repoussé le navire sur les côtes de Bretagne, Colomban vit en cela un signe que le Seigneur voulait qu’il continuât sa mission sur le continent. Il se rendit en Suisse et resta quelque temps sur les bords du lac de Constance, évangélisant avec son fidèle compagnon Gall les idolâtres de ces contrées. Puis il passa en Italie, où il travailla activement parmi les Lombards (*). Il mourut en l’an 616, au monastère de Bobbio qu’il avait fondé. Il s’était toujours opposé aux prétentions du pape, ou évêque de Rome.
(*) Là aussi il eut à évangéliser des païens, mais bien davantage à combattre l’arianisme, qui était la forme de christianisme de ces Barbares redoutés entre tous, établis en Italie du Nord depuis 568. Il baptisa leur roi à Milan, mais l’ensemble du peuple lombard n’abjura l’arianisme qu’en 658, et les Lombards devaient être encore pendant un siècle, jusqu’à ce que Charlemagne détruisît leur royaume en 774, un obstacle à l’expansion spirituelle et temporelle de la papauté romaine.
Quand Colomban partit pour l’Italie, il dut laisser son disciple Gall qui était tombé malade. Gall resta en Suisse, et, plus tard, annonça dans leur propre langue l’Évangile aux habitants encore païens de ce pays, et un grand nombre furent convertis. Il fonda le célèbre monastère qui porte son nom, et est considéré comme l’apôtre de la Suisse. Il mourut en l’an 627.
Ainsi, par le zèle et le dévouement de ces moines venus d’Écosse et d’Irlande, le christianisme se répandit dans les Pays-Bas, la Gaule, la Suisse, une partie de l’Allemagne et le nord de l’Italie. Ces chrétiens, libres du joug de l’Église romaine, firent plus que celle-ci pour faire connaître l’Évangile dans l’Europe centrale. Malheureusement, profitant de l’ignorance des temps qui suivirent, l’Église de Rome finit par entraîner les populations dans ses erreurs et les fit passer sous sa domination. L’Écosse et l’Irlande n’y échappèrent pas ; elles succombèrent après bien des luttes, et il ne resta que quelques faibles foyers de lumière, épars çà et là, jusqu’aux jours de la Réformation.
5.8 - Grégoire le Grand
Au temps où Colomba et Colomban poursuivaient leurs travaux évangéliques, l’évêque ou pape de Rome était Grégoire, qu’on a surnommé le Grand. Il était né à Rome en 540, d’une famille noble, et aurait pu arriver aux places les plus éminentes, mais à l’âge de 35 ans, il renonça au monde et aux honneurs, employa ses richesses à fonder plusieurs monastères et à soulager les pauvres, et fit de son palais à Rome un couvent où il menait une vie ascétique rigoureuse, s’assujettissant aux travaux les plus humbles, et consacrant le reste de son temps à la prière et à des actes de pénitence. Pensait-il acquérir par-là le pardon de ses péchés et une place dans le ciel ? Nous pouvons espérer mieux que cela de lui, car il disait : « Dieu a sauvé les saints sans qu’ils eussent aucun mérite ; la félicité des saints est une grâce et ne s’acquiert point par des mérites », mais il croyait sans doute, comme plusieurs de nos jours, que des œuvres et des prières sont nécessaires pour attirer la miséricorde de Dieu et fléchir sa colère, ces personnes-là considérant Dieu comme un Juge et non comme un Père. Elles ne connaissent pas l’amour parfait de Dieu qui bannit toute crainte (1 Jean 4:18).
 Re: L’ÉGLISE : UNE ESQUISSE DE SON HISTOIRE PENDANT VINGT SIÈCLES
Re: L’ÉGLISE : UNE ESQUISSE DE SON HISTOIRE PENDANT VINGT SIÈCLES
Grégoire devint abbé ou supérieur de son couvent ; il avait déjà été ordonné diacre, et, à la mort du pape Pélage, il fut nommé à sa place évêque de Rome, en 590, par le sénat, le clergé et le peuple, tant était grande la confiance que lui avait acquise son renom de charité et d’austérité. Grégoire se dévoua tout entier à la tâche difficile que lui imposait la charge dont il était revêtu. C’était un temps de troubles et de misère extrêmes, dans l’État et dans l’Église. Comme évêque de Rome, la première ville d’Occident, il fut obligé parfois d’intervenir dans les affaires politiques pour préserver son peuple contre les Barbares qui la menaçaient ; mais il consacra surtout son temps à combattre les hérétiques, et à corriger les vices du clergé. N’est-ce pas une chose étrange et triste à constater ? Ceux qui devaient être les conducteurs et les modèles du troupeau (1 Pierre 5:3), avaient à être corrigés de leurs vices ! Grégoire apporta aussi beaucoup de soins à l’organisation des services religieux. Il introduisit le mode de chant sacré qui porte encore son nom dans l’Église romaine. Jusqu’alors tout le peuple chantait, mais il établit des choristes à qui seuls était réservée cette partie du culte. Le peuple se contentait de quelques réponses. C’est à lui qu’est due la forme primitive du culte et l’ensemble de cérémonies qu’on appelle la messe chez les catholiques romains, mais à laquelle, depuis lui, on a beaucoup ajouté. C’est ainsi qu’au temps de Grégoire, le vin de la Cène était donné à tous les assistants, tandis que l’Église romaine a décidé que le clergé seul doit participer à la coupe. De même à cette époque, on n’enseignait pas encore la transsubstantiation, mot qui désigne la doctrine de l’Église romaine suivant laquelle, quand le prêtre a prononcé les paroles de la consécration : « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », le pain, ou plutôt l’hostie, est changé littéralement dans le corps du Seigneur. Mais nous parlerons de la messe plus tard.
Pour en revenir à Grégoire, il avait sans doute de bonnes intentions ; il pensait que les cérémonies et le chant attireraient et retiendraient le peuple dans les églises et qu’il en résulterait du bien. Mais qu’est-ce que Dieu demande ? Ce ne sont pas des formes religieuses ; elles ne sauvent pas, et ne constituent pas un vrai culte. Ce qui sauve, c’est la foi au Seigneur Jésus, et le vrai culte consiste, quand on est sauvé, à adorer Dieu en esprit et en vérité (Actes 16:31 ; Jean 4:23-24). À ce que je viens de dire, j’ajouterai que Grégoire avait une vénération extraordinaire et superstitieuse pour les reliques des saints, chose également étrangère à l’Écriture. De plus, tout en étant indigné de ce que le patriarche de Constantinople prenait le titre d’évêque universel, lui, Grégoire, maintenait la suprématie de l’Église de Rome sur les autres, prétendant que les papes étaient les successeurs de Pierre, à qui les clefs du royaume des cieux avaient été données. Il fut ainsi un des précurseurs du système antichrétien de la papauté, dont le chef, le pape de Rome, dit être le vicaire ou remplaçant de Jésus Christ sur la terre, et assume comme tel des honneurs presque divins. Bien que beaucoup d’erreurs se fussent déjà peu à peu introduites dans l’Église, on peut assigner à l’époque de Grégoire le commencement de ce temps du Moyen Âge qui spirituellement, fut une période de ténèbres, où régnèrent, sous la domination absolue des papes, des moines et du clergé, la superstition et l’idolâtrie, accompagnées d’une grande corruption des mœurs. C’est le temps que figure dans l’Apocalypse l’assemblée de Thyatire. Jésabel y représente la corruption dans l’Église (Apocalypse 2:20).
Grégoire, malgré tout, fut un homme charitable, dévoué, infatigable dans son zèle pour ce qu’il croyait bien ; mais cela n’excuse nullement ses erreurs, car il avait la parole de Dieu pour l’instruire et le guider. Il avait aussi à cœur la conversion des païens, mais tout en désirant d’abord qu’ils devinssent des chrétiens, il voulait qu’une fois tels, ils fussent rattachés à l’Église de Rome. On raconte qu’étant encore abbé, comme il traversait un jour le marché à Rome, son attention fut attirée par un certain nombre de jeunes captifs anglo-saxons exposés pour être vendus comme esclaves. Il fut frappé par la noblesse de leur attitude et la beauté de leurs visages.
— D’où viennent ces captifs ? demanda-t-il.
— De l’île de Bretagne, lui fut-il répondu.
— Les habitants de cette île sont-ils des chrétiens ?
— Non ; ils sont païens (*1).
— Quel dommage, dit Grégoire, que le prince des ténèbres possède des créatures d’une si belle apparence. Pourquoi manque-t-il à la beauté de leur visage celle de l’âme ? Mais quel est le nom de leur nation ?
— Ils sont appelés Angles.
Grégoire, jouant sur ce nom, dit :
— Ils sont bien nommés, car leurs faces sont semblables à celles des anges (*2). Ils devraient être, cohéritiers des anges dans le ciel. Quelle province de Bretagne habitent-ils ?
— Celle de Deïra (actuellement le Northumberland).
— Ah ! certainement ils doivent être affranchis de ira. (*3) Quel est le nom de leur roi ?
— Ella.
— Oui, dit Grégoire, alléluia doit être chanté dans ce royaume, à la gloire du Dieu qui a créé toutes choses.
(*1) Les chrétiens de la Bretagne avaient bien fait quelques efforts pour amener à la foi les conquérants saxons, dont les Angles faisaient partie, mais les vainqueurs refusèrent avec mépris d’écouter ceux qu’ils avaient vaincus.
(*2) « Angles », en latin, langue dont Grégoire se servait, « Angli », et anges « angeli ». Les deux mots sont presque les mêmes.
(*3) « De ira », mots latins signifiant « de la colère ».
Cette rencontre remplit Grégoire du désir d’être missionnaire parmi ce peuple et de le gagner à Christ. Il demanda permission au pape d’exécuter ce dessein et celui-ci, après s’y être longtemps opposé, y consentit enfin. Grégoire partit, mais il n’était pas encore bien loin que le peuple de Rome, qui le considérait comme un saint, força le pape à le faire revenir. Mais Grégoire n’oublia pas ce qu’il s’était proposé, et quand il fut devenu pape, il fit exécuter par un autre ce qu’il n’avait pu faire lui-même. Nous allons voir quelle fut cette mission d’un envoyé de l’Église romaine en Angleterre.
5.9 - La mission d’Augustin en Angleterre et ses suites
L’envoyé que Grégoire choisit pour aller évangéliser les païens d’Angleterre, était un de ses amis nommé Augustin, abbé d’un monastère. C’était un homme d’un grand zèle et d’une ardente piété, sur qui Grégoire pouvait compter. Mais à ces qualités, Augustin joignait beaucoup d’orgueil spirituel, et au désir de sauver les âmes, il joignait avant tout celui de rattacher les convertis à l’Église de Rome et de les soumettre à l’autorité du pape. Il partit en l’an 596 avec quarante missionnaires. Mais arrivés en Provence, ils furent effrayés à la pensée des difficultés de leur mission auprès de peuples barbares dont ils ignoraient la langue, et Augustin retourna à Rome pour demander au pape la permission d’abandonner l’entreprise (*). Mais Grégoire n’était pas homme à laisser une œuvre qui lui tenait à cœur, et à laquelle il avait beaucoup réfléchi. Il exhorta et encouragea Augustin à persévérer, plaçant devant lui et ses compagnons les récompenses divines qui seraient leur partage, et il donna à Augustin des lettres de recommandation pour les évêques des endroits où ils passeraient, ainsi que pour les rois francs Théodoric et Théodebert.
(*) Quand Paul et Barnabas furent envoyés par l’Esprit Saint, et non par un homme ou des hommes, ils ne reculèrent pas devant leur tâche.
Les missionnaires prirent courage, et, après un long et pénible voyage, ils débarquèrent en Angleterre, sur l’île de Thanet, dans le Kent. Le roi de ce pays était alors Ethelbert, le plus puissant des monarques anglo-saxons. Il avait épousé une princesse chrétienne, Berthe, fille de Charibet, roi de Paris. Augustin envoya à Ethelbert des messagers pour lui annoncer l’arrivée d’hommes qui apportaient la bonne nouvelle du chemin à suivre pour obtenir le bonheur éternel, la gloire du ciel, avec la paix et la bénédiction du vrai Dieu.
Ethelbert consentit à les recevoir, mais en plein air, de peur que ces étrangers n’usassent des artifices de la magie. Les prêtres païens pouvaient lui avoir suggéré cette pensée. Pour frapper ce peuple grossier et produire sur le roi une certaine impression, Augustin et ses moines se rangèrent en procession, firent porter devant eux une grande croix en argent avec l’image du Christ, et s’avancèrent, en chantant des cantiques latins, vers l’endroit où les attendaient le roi et sa cour. Augustin s’acquitta de son message, annonçant aux païens étonnés la bonne nouvelle des bénédictions éternelles du ciel. Le roi, bien que favorablement disposé, lui dit cependant qu’ils ne pouvaient, lui et son peuple, changer de religion sans de sérieuses considérations. Il promit aux missionnaires de les protéger, et leur dit que ceux de son peuple qui le voudraient, pourraient se joindre à eux. Puis il leur assigna pour célébrer leur culte une vieille chapelle ruinée située près de Cantorbéry, sa résidence, et qui avait servi autrefois aux chrétiens bretons.
La vie pieuse et dévouée d’Augustin et de ses compagnons et les miracles que, dit-on, ils opérèrent, gagnèrent la confiance du peuple, et bientôt le roi et nombre de ses sujets acceptèrent le christianisme tel qu’Augustin le leur apportait, c’est-à-dire quelques doctrines chrétiennes, mais en même temps les erreurs, les cérémonies et la suprématie de Rome. C’est ainsi que l’Église romaine s’implanta en Angleterre.
Augustin envoya à Rome la nouvelle de ses succès. Le pape le nomma archevêque de Cantorbéry et l’établit à la tête de douze évêques sur tous les chrétiens (*), non seulement sur les Saxons nouvellement convertis, mais aussi sur les Bretons descendants des premiers chrétiens. Ceux-ci, par suite des invasions des Pictes, des Scots, puis des Saxons, avaient cherché un refuge dans le pays de Galles. Là s’était fondé un grand monastère nommé Bangor, comme celui qui existait en Irlande. Près de trois mille hommes s’y trouvaient réunis, travaillant, étudiant et priant. Plusieurs missionnaires étaient sortis du milieu d’eux. Augustin voulut les amener à accepter les coutumes et la suprématie de l’Église de Rome et à le reconnaître comme évêque établi sur eux. Pour cela, il convoqua un synode des évêques saxons et bretons. Un petit nombre seulement de ceux-ci s’y rendirent. Dionoth, qui présidait la grande église de Bangor, répliqua à Augustin : « Nous voulons aimer tous les hommes, et ce que nous faisons pour toi, nous le ferons aussi pour celui que vous nommez le pape. Mais il ne doit pas s’appeler Père des pères, et la seule soumission que nous puissions lui accorder est celle qu’en tout temps nous devons à tous les chrétiens » (**) . Une seconde assemblée eut lieu, mais les évêques bretons tinrent ferme, et l’un d’eux déclara qu’ils ne pouvaient admettre ni l’orgueil des Romains, ni la tyrannie des Saxons. Augustin exhorta, supplia, censura, et même, dit-on, eut recours aux miracles, mais sans plus de succès.
(*) Il faut toujours entendre par là les chrétiens de profession.
(**) Lire Éphésiens 5:21.
Espérant toujours vaincre la résistance des évêques bretons, Augustin les convoqua une troisième fois. Que faire ? se demandaient ces pauvres évêques, intimidés et quelque peu ébranlés par le grand nom de Rome qui avait conservé un certain prestige sur les esprits des peuples éloignés. Il y avait un ermite pieux et sage, qui s’était acquis un grand renom de sainteté. Quelques-uns des Bretons allèrent le consulter. — Devons-nous abandonner nos coutumes et suivre Augustin ? lui dirent-ils. — S’il est un homme de Dieu, suivez-le, fut sa réponse. — Et à quoi le reconnaîtrons-nous ? — Le Seigneur a dit : « Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur ». Si Augustin est débonnaire et humble de cœur, il porte le joug de Christ et vous offre de porter le même joug ; mais s’il est violent et superbe, il n’est pas de Dieu et vous n’avez pas à faire attention à ce qu’il dit. — Comment connaîtrons-nous son humilité ? dirent-ils encore. — Faites en sorte que lui et les siens arrivent les premiers au lieu du rendez-vous. S’il se lève quand vous entrerez, obéissez-lui.
Telles furent les paroles de l’ermite ; mais les évêques bretons n’eussent-ils pas mieux fait de consulter la parole de Dieu et de se tenir à ses enseignements ? Ils y auraient vu que Christ est le seul vrai conducteur, et que Pierre recommandait aux anciens de ne pas paître le troupeau de Dieu comme dominant sur des héritages, mais en étant des modèles du troupeau (*).
(*) Matthieu 23:7-12 ; 1 Pierre 5:2, 3.
Qu’arriva-t-il ? Quand les évêques bretons entrèrent, Augustin, assis dans toute sa dignité et voulant leur montrer sa supériorité, ne se leva pas pour les saluer. Frappés à cette vue, les évêques bretons, pour la troisième fois, refusent de se soumettre au pape de Rome et ne veulent connaître d’autre maître que Christ. Augustin alors s’écrie : « Puisque vous ne voulez pas recevoir des frères qui vous apportent la paix, vous subirez des ennemis qui vous apporteront la guerre. Vous ne voulez pas vous unir à nous pour annoncer aux Saxons le chemin de la vie, eh bien, vous recevrez d’eux le coup de la mort ». Et il se retira.
Était-ce là l’esprit et la douceur de Christ ? Non, certainement ; mais on y voit l’orgueil et l’esprit de domination qui caractérisèrent de plus en plus l’Église de Rome aspirant à la suprématie universelle et l’établissant sur les autres églises.
Augustin n’avait donc pu amener les évêques bretons à se soumettre à l’autorité de Rome. Il eut plus de succès dans ses efforts pour convertir les païens. Outre ceux du Kent, il réussit auprès de Sébert, roi d’Essex, qui embrassa le christianisme avec tout son peuple, et il gagna aussi Redwald, roi de l’Est-Anglie (*). On ne peut que reconnaître le zèle et le dévouement d’Augustin, et, sans nul doute, le christianisme qu’il apporta en Angleterre, tout mélangé d’erreurs qu’il était, valait infiniment mieux que le paganisme cruel des Saxons ; mais combien il est regrettable qu’au lieu de prêcher le pur et simple Évangile qui annonce le salut à quiconque croit au Seigneur Jésus, il ait introduit une religion de formes et de cérémonies sous l’autorité d’un clergé soumis au pape de Rome. Ce n’est pas ainsi qu’agissaient les apôtres, et cela laissait les cœurs vides de Dieu. Trop souvent les païens ne faisaient que changer une forme de culte pour une autre, et, à la place de leurs dieux, mettaient des saints ou soi-disant tels.
(*) Nos lecteurs doivent se rappeler que les Saxons, peuple païen du nord-ouest de l’Allemagne, avaient envahi l’Angleterre dans le 5° et le 6° siècle, et y avaient formé sept royaumes : le Kent, le Sussex, le Wessex, l’Essex, le Northumberland, l’Est-Anglie et la Mercie. La Déirie faisait partie du Northumberland.
Grégoire en effet, pour ne pas heurter les populations païennes dans leurs habitudes, avait conseillé à Augustin de transformer les temples païens en églises, en les consacrant à tel ou tel saint. Les fêtes chrétiennes furent célébrées aux mêmes jours que l’avaient été les fêtes païennes. Dans ces fêtes, on élevait des baraques, on égorgeait des animaux, et le peuple s’en nourrissait, le tout sous l’invocation d’un saint. Les coutumes païennes étaient ainsi conservées sous une autre forme ; la nouvelle religion s’accommodait à l’ancienne. Était-ce vraiment le christianisme, celui de Paul qui écrivait : « Soyez séparés,… et ne touchez pas à ce qui est impur » ? (2 Corinthiens 6:17) (*). On pensait gagner ainsi plus aisément les populations, et ce n’est pas le seul fait de ce genre que présentent les missions catholiques romaines.
(*) Des coutumes païennes s’étaient ainsi glissées et conservées dès les premiers temps dans l’Église, aux fêtes dédiées aux saints. Augustin et Ambroise s’étaient fortement élevés contre elles, mais en vain. Au commencement du 5° siècle, on voit qu’en Italie, à Naples, elles existaient et Paulin de Nole, appelé saint par l’Église de Rome, les approuvait.
Augustin mourut vers l’an 605. On se rappelle sa cruelle menace contre les chrétiens bretons qui n’avaient pas voulu se soumettre au joug de Rome. Peu avant ou peu après sa mort, elle eut son accomplissement. Ethelfrid, roi du Northumberland, qui était païen, s’avança avec une nombreuse armée contre Bangor, le foyer du christianisme breton. Les moines effrayés s’enfuirent. Douze cent cinquante d’entre eux s’étaient réunis dans un endroit écarté pour implorer le secours du Seigneur. Ils furent découverts par leurs cruels ennemis. Ethelfrid, voyant ces hommes désarmés à genoux, demande ce qu’ils font. L’ayant appris, il s’écrie : « Ils combattent donc contre nous ! » et il ordonne à ses soldats de fondre sur ces hommes en prières. Douze cents furent égorgés, le reste réussit à s’échapper. Les Saxons marchèrent ensuite sur Bangor qu’ils détruisirent. Les prêtres virent dans ce fait la réalisation du présage du saint pontife Augustin, comme ils le nommaient ; mais dans le pays, que ce massacre remplit de douleur, on accusa Augustin d’avoir été l’instigateur de l’invasion d’Ethelfrid. Ce fut un coup fatal porté à l’église bretonne, bien qu’elle eût encore un moment d’éclat, comme nous le verrons.
Augustin eut pour successeur Laurent, un des missionnaires venus avec lui en Bretagne. Mais l’œuvre qu’ils avaient accomplie sembla à son tour sur le point d’être anéantie. Un grand nombre de ces soi-disant chrétiens, si facilement convertis, retournèrent au paganisme. Eadbold lui-même, roi de Kent, fils et successeur d’Ethelbert qui le premier avait accueilli les missionnaires, fut du nombre des apostats. Les évêques romains s’enfuirent dans les Gaules, et Laurent se prépara à les suivre. Il avait voulu passer une dernière nuit en prières dans l’église ; le matin venu, il vint, les vêtements en désordre, se présenter devant le roi, et, ôtant son manteau, lui montra son corps couvert de plaies. Le roi surpris lui demanda qui avait osé le maltraiter ainsi. « Saint Pierre, répondit Laurent, lui était apparu la nuit, et, lui reprochant d’abandonner son troupeau, l’avait châtié à coups de fouet. De là venaient ses meurtrissures ». Eadhold était superstitieux ; saisi de crainte, il se soumit de nouveau à la puissance du pape, successeur d’un apôtre qui traitait si rigoureusement les désobéissants. Laurent était-il de bonne foi ? On peut croire qu’agité par la pensée de laisser une œuvre à laquelle il s’était attaché et en ayant du remords, il ait eu un rêve, et qu’ensuite il se soit meurtri lui-même, afin d’essayer par ce moyen d’agir sur l’esprit du roi.
Edwin, qui fut roi du Northumberland après le cruel Ethelfrid, fut aussi converti, dit-on, par une intervention miraculeuse. Il vaut mieux penser qu’Edwin, dont la femme était chrétienne, fut amené par elle à embrasser le christianisme. Un grand nombre de ses sujets suivirent son exemple et furent baptisés. Mais Edwin ayant été tué dans un combat contre le païen Penda, roi de Mercie, presque tous les Northumbriens retournèrent au paganisme. On peut voir par là le peu de réalité de ces conversions. On embrassait un certain ensemble de pratiques religieuses, mais le cœur et la conscience n’avaient point été atteints, parce que Christ n’avait pas été vraiment prêché, et qu’il n’y avait pas eu une action de l’Esprit Saint. Quelle différence entre ces conversions et celles des Thessaloniciens, par exemple ! Eux avaient été vraiment « tournés (ou convertis) des idoles vers Dieu, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils Jésus » (1 Thessaloniciens 1:9-10). Ils avaient reçu l’Évangile, la parole de Dieu, dans la puissance de l’Esprit Saint et avec joie, bien qu’accompagné de tribulations, et ils étaient restés fidèles. Ils étaient vraiment chrétiens.
Un rayon de lumière vint encore briller un moment dans les ténèbres. Oswald, fils du cruel Ethelfrid, avait dû chercher un refuge en Écosse, avec son frère Oswy et quelques jeunes nobles. Il avait appris la langue du pays, avait entendu l’Évangile et avait été vraiment converti. Il fut baptisé ainsi que son frère. Les églises d’Écosse, comme nous le savons, et en particulier Iona, avaient conservé plus purement les vérités de la parole de Dieu. Oswald, dont le cœur avait été réellement saisi par la grâce du Seigneur, aimait à écouter les anciens de ces églises et désirait vivement marcher sur les traces de Jésus qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Il se montrait plein de compassion pour les pauvres, se dépouillant même de ses vêtements pour les couvrir. Il pensait aussi à ses compatriotes du Northumberland, près desquels il aurait voulu aller comme missionnaire, afin de les ramener au christianisme. Mais il crut qu’il y parviendrait mieux s’il était établi sur le trône. À la tête d’une petite armée, et se confiant en Dieu, il livra bataille à un ennemi beaucoup plus puissant que lui et remporta une grande victoire.
Devenu roi, Oswald s’occupa du bien spirituel de son peuple, et demanda aux églises d’Écosse un missionnaire. On lui envoya un moine nommé Corman, pieux, mais d’un caractère rude et austère, qui ne sut pas présenter la grâce aux populations barbares auxquelles il s’adressait. Il retourna découragé à Iona et dit aux anciens : « Les gens vers qui vous m’avez envoyé sont si obstinés qu’il faut renoncer à changer leur cœur ». Pauvre Corman ! Il semble avoir ignoré que c’est la puissante grâce de Dieu qui seule, par l’action de l’Esprit Saint, peut opérer ce changement. En entendant Corman, Aïdan, un des anciens d’Irlande, avait le cœur ému et se disait en lui-même : « Si ton amour, ô Sauveur, eût été présenté à ce peuple, les cœurs auraient été touchés ». Puis s’adressant à Corman : « Mon frère », lui dit-il, « tu as été trop sévère pour des auditeurs si peu en état de comprendre. Il fallait leur donner du lait à boire, avant de leur présenter des aliments plus solides ». Les anciens, à l’ouïe de ces paroles, s’écrièrent : « Aïdan est digne d’être évêque » (*), et ils lui imposèrent les mains.
(*) C’était le titre donné à un ancien que l’on envoyait comme missionnaire.
Aïdan partit et fut reçu avec joie par Oswald. Comme il ignorait la langue des Saxons, le roi l’accompagnait partout et interprétait lui-même ses paroles. D’autres missionnaires se joignirent à eux, et bientôt les populations vinrent en foule se presser autour du roi et des serviteurs du Seigneur, écoutant avec joie « la parole de Dieu », dit Bède, un ancien historien ecclésiastique. Bien que Bède fût attaché à l’Église de Rome et déplorât que ces missionnaires ignorassent les décrets des conciles (ce qui ne leur nuisait pas), il leur rend un beau témoignage : « Ils pratiquaient uniquement et diligemment », dit-il, « les préceptes de piété et de pureté qu’ils avaient appris des prophètes, des évangiles et des écrits des apôtres », c’est-à-dire qu’ils s’attachaient aux Écritures. Bède loue encore « leur zèle, leur générosité, leur humilité et leur simplicité, leur application sérieuse à l’étude des Écritures, leur franchise vis-à-vis des grands, leur douceur et leur charité envers les pauvres, dégagés qu’ils étaient de tout égoïsme et d’avarice, et enfin leur vie austère et dévouée ». C’est un bel éloge ! Ne voudrions-nous pas être comme eux ? C’est à l’école de Jésus que l’on apprend à être doux et humble de cœur ; c’est à ses pieds, comme Marie, que l’on comprend et goûte sa parole (Matthieu 11:29 ; Luc 10:39). Ces serviteurs de Dieu ne faisaient pas de la piété une source de gain ; ils ne bornaient pas leur ministère à célébrer les cérémonies d’un culte dans des murs consacrés ; mais, comme les apôtres, ils prêchaient et exhortaient de village en village, et de maison en maison. Qui peut dire tous les résultats bénis de leur activité ?
Oswald ne se bornait pas à aider les missionnaires dans leurs travaux. Il montrait aussi sa piété par ses œuvres. Il avait conservé son amour pour les pauvres qu’il aimait à soulager. On raconte qu’un jour de Pâques, comme il allait se mettre à table, il apprit qu’une troupe de pauvres pressés par la faim était devant sa porte. Aussitôt il ordonna de prendre les mets de sa table et de les leur porter. Puis il fit briser les vases et les plats d’argent qui étaient sur sa table et leur en distribua les morceaux. Étant allé dans le Wessex, pour épouser la fille du roi de ce pays, il y apporta la connaissance de l’Évangile.
Oswald ne régna que neuf ans. Les habitants idolâtres du royaume de Mercie, conduits par leur roi Penda, avaient envahi le Northumberland. Oswald, ayant marché contre eux pour les repousser, fut tué dans la bataille. On rapporte qu’en tombant il s’écria : « Seigneur ! aie pitié des âmes de mon peuple ! »
5.10 - Rome triomphe en Angleterre
La mort d’Oswald n’arrêta pas les travaux des missionnaires. Ils allaient, prêchant de lieu en lieu, et dès que, dans quelque endroit, on en voyait paraître un, la population accourait près de lui et le priait de leur faire entendre la parole de vie. Ainsi la doctrine chrétienne plus pure se répandait chez les Saxons du nord, tandis que ceux du sud reconnaissaient la suprématie de Rome, et suivaient les formes et les cérémonies de son culte. Les prêtres attachés à Rome désiraient ardemment amener les chrétiens Bretons à se soumettre à cette Église qui prétendait à la domination universelle ; l’occasion de le faire se présenta bientôt.
Oswy avait succédé à son frère Oswald, mais était bien différent de lui. Très ambitieux, il voulut agrandir ses États et marcha contre Oswin, son parent, roi de Déirie. Celui-ci, ne voulant point combattre, s’était enfui chez un noble qu’il croyait son ami. Il fut trahi, et Oswy le fit mettre à mort. Aïdan, en apprenant ce crime, mourut de douleur. Oswy s’empara de la Déirie et plus tard du royaume de Mercie. Il devint ainsi le plus puissant des rois saxons. En était-il plus heureux ? Non ; sa conscience ne le laissait pas tranquille.
La reine Earfeld était attachée à l’Église de Rome, et aurait voulu qu’Oswy s’y soumît aussi. Elle était soutenue par deux prêtres, l’un nommé Romain et l’autre Wilfrid, ce dernier, homme doué de grands talents, mais très ambitieux d’honneurs et de richesses. Il espérait, en amenait le roi et ses sujets sous l’autorité de l’Église de Rome, obtenir une place éminente dans le clergé et pouvoir ainsi satisfaire son avarice. Ce n’était donc pas l’amour de Christ et des âmes qui l’animait. Les tristes mobiles qui le faisaient agir, l’amour de la domination et de l’argent, existaient, hélas ! chez bien d’autres dans la chrétienté et s’y montrèrent de plus en plus. Oswy, troublé par le souvenir du meurtre d’Oswin et d’autres fautes, aurait voulu apaiser Dieu et se procurer une entrée au ciel. Où aurait-il dû chercher la paix de son âme ? Christ seul pouvait la lui donner, mais les prêtres romains lui faisaient croire que c’était dans leur église qu’il trouverait ce que son cœur désirait. Pour le décider, ils proposèrent qu’il y eût une conférence publique entre eux et les évêques bretons. Oswy y consentit, et l’on se réunit à Whitby.
Après la mort d’Aïdan, les anciens d’Iona avaient envoyé pour le remplacer un évêque nommé Colman, homme simple, mais énergique. Il vint à cette réunion avec les autres évêques bretons. Le roi commença ainsi : « Puisque nous sommes serviteurs d’un même Dieu, et que nous espérons un même héritage, nous devrions avoir ici-bas une même règle de vie, et il nous faut rechercher quelle est la vraie ». C’était bien, n’est-ce pas ? Mais où fallait-il chercher ? Dans l’Écriture, n’est-il pas vrai ? Et c’est ce que ne firent ni les uns, ni les autres. Colman répondit : « Nous suivons la doctrine de Colomba qui est celle de Jean, le disciple bien-aimé du Seigneur, et celle des églises qu’il présidait. Gardons-nous de la mépriser ! » Wilfrid, avec une grande habileté, et sachant comment frapper l’esprit du roi par l’aspect de la grandeur et du pouvoir, répliqua : « Nous, notre coutume est celle de Rome où ont enseigné les saints apôtres Pierre et Paul. Elle est répandue parmi toutes les nations. Les Pictes et les Bretons seuls, jetés aux bouts de la terre, veulent-ils lutter contre le monde universel ? Voulez-vous opposer, Colomba, si saint qu’il ait été, à Pierre, le prince des apôtres, auquel Christ a dit : Tu es Pierre, et je te donnerai les clefs du royaume des cieux ? ». Wilfrid omettait à dessein Jean, pour ne parler que de Colomba ; mais au lieu que les uns et les autres se tournassent vers les Écritures seules, on se réclamait de traditions, de coutumes, de règles soi-disant données par tel ou tel apôtre que l’on opposait l’un à l’autre. C’était comme chez les Corinthiens où l’on disait : « Moi, je suis de Paul ; et moi d’Apollos ; et moi de Céphas » (1 Corinthiens 1:12). Et puis, nous voyons s’affirmer cette prétention exorbitante, nullement justifiée par l’Écriture, que Pierre étant le prince des apôtres et le pape son successeur, celui-ci était le chef de l’Église universelle. Paul, inspiré par l’Esprit de Dieu, dit : « J’estime que je n’ai été en rien moindre que les plus excellents apôtres, quoique je ne sois rien » (2 Corinthiens 11:5 ; 12:11) ; il n’était rien en lui-même, ni par lui-même, mais ce qu’il était venait de la grâce du Seigneur. Paul n’étant en rien moindre que les plus excellents apôtres, où est la suprématie de Pierre ? Mais on pensera peut-être : Le Seigneur n’a-t-il pas donné à Pierre les clefs du royaume des cieux ? (Matthieu 16:19). Oui, sans doute, et Pierre s’en est servi. Il a ouvert les portes du royaume des cieux aux Juifs, le jour de la Pentecôte (Actes 2:37-41), et il les a ouvertes aux nations, d’après l’ordre du Seigneur, quand il alla annoncer Christ et la rémission des péchés par son nom, à Corneille et à sa maison et ses amis (lire Actes 10, et surtout versets 9-16, 28, 43, 44 ; et 11:1-18). Peut-être entendra-t-on dire : « Oui, mais le Seigneur a donné à Pierre l’autorité de lier et de délier sur la terre, et ce devait être ratifié dans le ciel » (selon Matthieu 16:19). C’est vrai, mais cela a été donné aussi à l’Assemblée (Matthieu 18:18), et aux disciples individuellement (Jean 20:23). Lier et délier, c’est déclarer le pardon à quiconque croit au Seigneur et la condamnation à quiconque refuse Christ (Jean 3:36), et c’est ce que Pierre a fait dans les deux occasions que nous avons citées. Une autre objection que font les partisans de Rome est celle-ci : « Le Seigneur n’a-t-il pas dit : Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église » ? (Matthieu 16:18). Et par cette Église, ils entendent celle de Rome. Mais les paroles du Seigneur ne signifiaient pas que ce soit sur Pierre que l’Église est fondée. Ce serait une contradiction avec d’autres passages où nous lisons que Christ est le fondement unique (1 Corinthiens 3:11). Il est bien dit que les saints sont « édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes » (Éphésiens 2:20), car ce sont eux qui ont proclamé le salut et révélé les pensées de Dieu, mais ce n’est pas plus Pierre que les autres, et Jésus Christ demeure seul la maîtresse pierre du coin, sans laquelle rien ne tient. Ce n’est pas sur Pierre que l’Église est fondée, mais sur la belle confession de Pierre : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » (Matthieu 16:16). Pierre était une pierre, une simple pierre dans l’édifice que devait construire Christ. Et quant à la prétention qui fait du pape le chef de l’Église sur la terre, rappelons nous que c’est Christ seul qui est le Chef ou la Tête de l’Assemblée (ou l’Église) qui est son corps, et que ce divin et unique Chef est dans le ciel (Éphésiens 1:22-23). Il est bon de se souvenir de ces choses, parce que dans les jours mauvais où nous sommes, on est exposé aux pièges de l’ennemi qui cherche, même en se servant des Écritures, à faire sortir les âmes du chemin de la vérité. Pauvre Oswy, s’il avait connu la parole de Dieu, il aurait pu résister à la subtilité des partisans de Rome ; pauvres évêques bretons aussi, qui ne surent pas se servir de cette arme puissante, l’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu ! (Éphésiens 6:17).
Après avoir entendu Wilfrid, le roi, se tournant vers Colman, lui dit : « Est-il vrai que le Seigneur ait adressé ces paroles à Pierre ? — Cela est vrai, ô roi ! répondit Colman. — Et pouvez-vous prouver qu’une aussi grande puissance ait été donnée à Colomba ? — Nous ne le pouvons ». Colman n’aurait-il pas dû laisser Colomba de côté, et dire au roi ce que l’Écriture enseigne ? Mais déjà, même à Iona, la connaissance de la parole de Dieu s’était affaiblie, et l’on s’attachait plus à des coutumes qu’à ce que Dieu a dit.
Oswy, heureux de pouvoir faire cesser une lutte qui se renouvelait sans cesse dans sa propre maison, heureux aussi, dans sa propre ignorance, d’avoir quelqu’un qui lui ouvrît le ciel, s’écria : « Pierre est le portier ; je veux lui obéir et à son successeur, de peur que, quand je me présenterai à la porte, il n’y ait personne qui m’ouvre ». Pauvre Oswy ! Il ne savait pas que Christ seul est la porte du salut, et qu’il ouvre et nul ne ferme (Jean 10:7, 9 ; Apocalypse 3:7). Ainsi l’Église de Rome triompha. Elle veut être assise comme reine comme dira Babylone (Apocalypse 18:7). Hors de la soumission à ses enseignements et à ses rites, et à celui qui ose se dire le vicaire de Christ ici-bas, il n’y a pas de salut, dit-elle. Mais que dit la parole de Dieu ? Il n’y a de salut en aucun autre que Christ, aucun autre nom qui soit donné par lequel nous puissions être sauvés (Actes 4:12). Et quant à l’Église, bien loin qu’elle ait à dominer, il nous est dit que la vraie Église est soumise au Christ (Éphésiens 5:24). Elle n’enseigne donc pas, mais est enseignée par la Parole (Versets 26, 29). C’est la fausse prophétesse Jésabel qui enseigne et domine (Apocalypse 2:20), et elle représente Rome et ses prétentions.
Colman, accablé de douleur, retourna en Écosse avec ceux des évêques que Wilfrid n’avait pu persuader. Oswy, espérant ainsi racheter son âme, déploya la plus grande activité pour amener ses sujets à l’obéissance de l’Église de Rome. Wilfrid l’y aida de tout son pouvoir. Il devint évêque d’un vaste diocèse, s’enrichit des biens qui avaient appartenu à plusieurs monastères, s’entoura d’une suite nombreuse, et n’était servi que dans de la vaisselle d’or et d’argent. Quelle différence avec les humbles évêques d’Iona ! Mais c’est cet orgueil, ce luxe, cette avidité, cet amour de la domination, des richesses et des jouissances de la chair, que l’on vit se répandre de plus en plus chez les hauts dignitaires du clergé romain et chez les papes, durant les siècles ténébreux du Moyen Âge, tandis que le bas clergé et le peuple demeuraient dans la plus triste ignorance et livrés à la superstition.
Mais le triomphe de Rome ne se borna pas là. Bientôt l’Écosse et Iona même succombèrent sous les efforts des prêtres romains. Ils s’adressèrent à Naïtam, roi des Pictes. On lui fit comprendre combien il serait plus digne d’un roi d’appartenir à une église puissante, à la tête de laquelle était un pontife universel, successeur direct de Pierre, plutôt que de se soumettre à des congrégations conduites par de chétifs anciens. On lui montra combien la pompe du culte romain convenait mieux à la pompe royale. Naïtam, séduit par la pensée de marcher à l’égal des illustres rois des Francs, céda et fit venir des architectes pour lui construire des églises en pierre, au lieu des humbles édifices en bois où Christ avait été annoncé. Puis il ordonna que tous les ecclésiastiques de son royaume reçussent la tonsure romaine (*), en signe de soumission à cette Église. Et il fut fait ainsi. Où était en tout cela la parole de Dieu et l’intérêt pour le salut des âmes ?
(*) Les moines et les ecclésiastiques, dès le 6° siècle, en Orient et en Occident, étaient tonsurés, c’est-à-dire qu’une partie de la tête était rasée. C’était la marque distinctive de leur consécration. En Orient, la tonsure se faisait en long, par devant, d’une oreille à l’autre, en forme de croissant. En Occident, elle se faisait en rond, sur le sommet de la tête. C’étaient toujours des ordonnances et non l’Écriture.
Les anciens de Iona résistaient encore à l’envahissement des coutumes romaines. Un jour, un moine, nommé Ecgbert, très enthousiaste pour Rome et d’un caractère très doux, vint les trouver. Il fut reçu avec une grande hospitalité, et sut bientôt s’insinuer dans les esprits. Par ses discours et par les riches dons qu’il répandait et qu’on lui avait confiés dans ce but, il commença à les ébranler. Mais ce fut surtout en se présentant comme ayant reçu de Dieu une mission auprès d’eux qu’il acheva de les gagner. « Une nuit », leur raconta-t-il, « un des bienheureux apparut à un frère du couvent et lui dit : « Dis à Ecgbert ces paroles : Va vers les monastères de Colomba, car leurs charrues ne cheminent pas droitement ; il faut que tu les remettes dans le droit sillon. Je ne voulais pas obéir, et je m’embarquai pour aller porter l’Évangile aux Germains. Mais une tempête jeta le navire sur le sable. Je vis que c’était à cause de moi, et je résolus d’obéir. Maintenant », ajouta-t-il, « soumettez-vous à la voix du ciel ».
Dieu peut parler aux hommes par des rêves (Job 33:14-15), mais Il ne parlera pas en faveur de ce qui est contraire aux Écritures, qui sont sa Parole. Les anciens de Iona, au lieu de rejeter ce rêve comme le produit de l’imagination d’un homme et de s’en tenir à la parole de Dieu, se laissèrent persuader par Ecgbert et crurent obéir à Dieu. Ils reçurent la tonsure qui les rangeait sous l’autorité du pape. Rome avait vaincu partout. Cependant, un petit nombre en Écosse, ne voulurent pas courber la tête sous son joug. « On les voyait », dit Bède, « clocher dans leurs sentiers, refuser de prendre part aux fêtes romaines et de se laisser tonsurer ». C’est au commencement du huitième siècle que Rome étendit ainsi son pouvoir sur toutes les îles Britanniques, mais Dieu se gardait un résidu ; au milieu des siècles de ténèbres, quelques faibles lumières éparses brillaient çà et là, en attendant qu’une pleine lumière se levât.
Cette Église d’Angleterre servit grandement la papauté par son zèle missionnaire. Des moines anglo-saxons, de l’ordre des Bénédictins (fondé par saint Benoît en 529), plus d’un siècle après Colomban, entreprirent de pousser plus loin que lui en Germanie, et de convertir les farouches païens d’entre Rhin et Elbe. Willibrod (mort en 739) parmi les Frisons, puis Winfrid, qui changea ensuite son nom en Boniface, parmi les Saxons, en furent les plus remarquables ouvriers. La célèbre abbaye de Fulda fut fondée en 744 par Sturm. Boniface que l’Église révère comme « l’apôtre des Germains », mourut en martyr, massacré dans la Frise en 755 avec quelques compagnons. Mais le rattachement au christianisme des Frisons, Saxons et Thuringiens ne fut effectif qu’un peu plus tard, quand Charlemagne conquit leur pays et contraignit sous peine de mort les païens à se faire baptiser. Ces régions ouvertes de façon aussi peu évangélique à la profession chrétienne sous l’autorité de Rome en devaient devenir à leur tour des foyers de propagation vers l’Est, chez les Slaves de l’Elbe, les Polonais, les Tchèques, les Hongrois, et se heurter aux populations évangélisées par des orthodoxes (Cyrille et Méthode) et relevant du patriarche de Constantinople.
Quoiqu’il en soit, lorsque, au début du 10° siècle les Normands et les Scandinaves eurent embrassé à leur tour la religion chrétienne, toute l’Europe occidentale et la majeure partie de l’Europe centrale furent catholiques et la puissance papale ne cessa de s’y renforcer pendant plusieurs siècles.
Pour en revenir à Grégoire, il avait sans doute de bonnes intentions ; il pensait que les cérémonies et le chant attireraient et retiendraient le peuple dans les églises et qu’il en résulterait du bien. Mais qu’est-ce que Dieu demande ? Ce ne sont pas des formes religieuses ; elles ne sauvent pas, et ne constituent pas un vrai culte. Ce qui sauve, c’est la foi au Seigneur Jésus, et le vrai culte consiste, quand on est sauvé, à adorer Dieu en esprit et en vérité (Actes 16:31 ; Jean 4:23-24). À ce que je viens de dire, j’ajouterai que Grégoire avait une vénération extraordinaire et superstitieuse pour les reliques des saints, chose également étrangère à l’Écriture. De plus, tout en étant indigné de ce que le patriarche de Constantinople prenait le titre d’évêque universel, lui, Grégoire, maintenait la suprématie de l’Église de Rome sur les autres, prétendant que les papes étaient les successeurs de Pierre, à qui les clefs du royaume des cieux avaient été données. Il fut ainsi un des précurseurs du système antichrétien de la papauté, dont le chef, le pape de Rome, dit être le vicaire ou remplaçant de Jésus Christ sur la terre, et assume comme tel des honneurs presque divins. Bien que beaucoup d’erreurs se fussent déjà peu à peu introduites dans l’Église, on peut assigner à l’époque de Grégoire le commencement de ce temps du Moyen Âge qui spirituellement, fut une période de ténèbres, où régnèrent, sous la domination absolue des papes, des moines et du clergé, la superstition et l’idolâtrie, accompagnées d’une grande corruption des mœurs. C’est le temps que figure dans l’Apocalypse l’assemblée de Thyatire. Jésabel y représente la corruption dans l’Église (Apocalypse 2:20).
Grégoire, malgré tout, fut un homme charitable, dévoué, infatigable dans son zèle pour ce qu’il croyait bien ; mais cela n’excuse nullement ses erreurs, car il avait la parole de Dieu pour l’instruire et le guider. Il avait aussi à cœur la conversion des païens, mais tout en désirant d’abord qu’ils devinssent des chrétiens, il voulait qu’une fois tels, ils fussent rattachés à l’Église de Rome. On raconte qu’étant encore abbé, comme il traversait un jour le marché à Rome, son attention fut attirée par un certain nombre de jeunes captifs anglo-saxons exposés pour être vendus comme esclaves. Il fut frappé par la noblesse de leur attitude et la beauté de leurs visages.
— D’où viennent ces captifs ? demanda-t-il.
— De l’île de Bretagne, lui fut-il répondu.
— Les habitants de cette île sont-ils des chrétiens ?
— Non ; ils sont païens (*1).
— Quel dommage, dit Grégoire, que le prince des ténèbres possède des créatures d’une si belle apparence. Pourquoi manque-t-il à la beauté de leur visage celle de l’âme ? Mais quel est le nom de leur nation ?
— Ils sont appelés Angles.
Grégoire, jouant sur ce nom, dit :
— Ils sont bien nommés, car leurs faces sont semblables à celles des anges (*2). Ils devraient être, cohéritiers des anges dans le ciel. Quelle province de Bretagne habitent-ils ?
— Celle de Deïra (actuellement le Northumberland).
— Ah ! certainement ils doivent être affranchis de ira. (*3) Quel est le nom de leur roi ?
— Ella.
— Oui, dit Grégoire, alléluia doit être chanté dans ce royaume, à la gloire du Dieu qui a créé toutes choses.
(*1) Les chrétiens de la Bretagne avaient bien fait quelques efforts pour amener à la foi les conquérants saxons, dont les Angles faisaient partie, mais les vainqueurs refusèrent avec mépris d’écouter ceux qu’ils avaient vaincus.
(*2) « Angles », en latin, langue dont Grégoire se servait, « Angli », et anges « angeli ». Les deux mots sont presque les mêmes.
(*3) « De ira », mots latins signifiant « de la colère ».
Cette rencontre remplit Grégoire du désir d’être missionnaire parmi ce peuple et de le gagner à Christ. Il demanda permission au pape d’exécuter ce dessein et celui-ci, après s’y être longtemps opposé, y consentit enfin. Grégoire partit, mais il n’était pas encore bien loin que le peuple de Rome, qui le considérait comme un saint, força le pape à le faire revenir. Mais Grégoire n’oublia pas ce qu’il s’était proposé, et quand il fut devenu pape, il fit exécuter par un autre ce qu’il n’avait pu faire lui-même. Nous allons voir quelle fut cette mission d’un envoyé de l’Église romaine en Angleterre.
5.9 - La mission d’Augustin en Angleterre et ses suites
L’envoyé que Grégoire choisit pour aller évangéliser les païens d’Angleterre, était un de ses amis nommé Augustin, abbé d’un monastère. C’était un homme d’un grand zèle et d’une ardente piété, sur qui Grégoire pouvait compter. Mais à ces qualités, Augustin joignait beaucoup d’orgueil spirituel, et au désir de sauver les âmes, il joignait avant tout celui de rattacher les convertis à l’Église de Rome et de les soumettre à l’autorité du pape. Il partit en l’an 596 avec quarante missionnaires. Mais arrivés en Provence, ils furent effrayés à la pensée des difficultés de leur mission auprès de peuples barbares dont ils ignoraient la langue, et Augustin retourna à Rome pour demander au pape la permission d’abandonner l’entreprise (*). Mais Grégoire n’était pas homme à laisser une œuvre qui lui tenait à cœur, et à laquelle il avait beaucoup réfléchi. Il exhorta et encouragea Augustin à persévérer, plaçant devant lui et ses compagnons les récompenses divines qui seraient leur partage, et il donna à Augustin des lettres de recommandation pour les évêques des endroits où ils passeraient, ainsi que pour les rois francs Théodoric et Théodebert.
(*) Quand Paul et Barnabas furent envoyés par l’Esprit Saint, et non par un homme ou des hommes, ils ne reculèrent pas devant leur tâche.
Les missionnaires prirent courage, et, après un long et pénible voyage, ils débarquèrent en Angleterre, sur l’île de Thanet, dans le Kent. Le roi de ce pays était alors Ethelbert, le plus puissant des monarques anglo-saxons. Il avait épousé une princesse chrétienne, Berthe, fille de Charibet, roi de Paris. Augustin envoya à Ethelbert des messagers pour lui annoncer l’arrivée d’hommes qui apportaient la bonne nouvelle du chemin à suivre pour obtenir le bonheur éternel, la gloire du ciel, avec la paix et la bénédiction du vrai Dieu.
Ethelbert consentit à les recevoir, mais en plein air, de peur que ces étrangers n’usassent des artifices de la magie. Les prêtres païens pouvaient lui avoir suggéré cette pensée. Pour frapper ce peuple grossier et produire sur le roi une certaine impression, Augustin et ses moines se rangèrent en procession, firent porter devant eux une grande croix en argent avec l’image du Christ, et s’avancèrent, en chantant des cantiques latins, vers l’endroit où les attendaient le roi et sa cour. Augustin s’acquitta de son message, annonçant aux païens étonnés la bonne nouvelle des bénédictions éternelles du ciel. Le roi, bien que favorablement disposé, lui dit cependant qu’ils ne pouvaient, lui et son peuple, changer de religion sans de sérieuses considérations. Il promit aux missionnaires de les protéger, et leur dit que ceux de son peuple qui le voudraient, pourraient se joindre à eux. Puis il leur assigna pour célébrer leur culte une vieille chapelle ruinée située près de Cantorbéry, sa résidence, et qui avait servi autrefois aux chrétiens bretons.
La vie pieuse et dévouée d’Augustin et de ses compagnons et les miracles que, dit-on, ils opérèrent, gagnèrent la confiance du peuple, et bientôt le roi et nombre de ses sujets acceptèrent le christianisme tel qu’Augustin le leur apportait, c’est-à-dire quelques doctrines chrétiennes, mais en même temps les erreurs, les cérémonies et la suprématie de Rome. C’est ainsi que l’Église romaine s’implanta en Angleterre.
Augustin envoya à Rome la nouvelle de ses succès. Le pape le nomma archevêque de Cantorbéry et l’établit à la tête de douze évêques sur tous les chrétiens (*), non seulement sur les Saxons nouvellement convertis, mais aussi sur les Bretons descendants des premiers chrétiens. Ceux-ci, par suite des invasions des Pictes, des Scots, puis des Saxons, avaient cherché un refuge dans le pays de Galles. Là s’était fondé un grand monastère nommé Bangor, comme celui qui existait en Irlande. Près de trois mille hommes s’y trouvaient réunis, travaillant, étudiant et priant. Plusieurs missionnaires étaient sortis du milieu d’eux. Augustin voulut les amener à accepter les coutumes et la suprématie de l’Église de Rome et à le reconnaître comme évêque établi sur eux. Pour cela, il convoqua un synode des évêques saxons et bretons. Un petit nombre seulement de ceux-ci s’y rendirent. Dionoth, qui présidait la grande église de Bangor, répliqua à Augustin : « Nous voulons aimer tous les hommes, et ce que nous faisons pour toi, nous le ferons aussi pour celui que vous nommez le pape. Mais il ne doit pas s’appeler Père des pères, et la seule soumission que nous puissions lui accorder est celle qu’en tout temps nous devons à tous les chrétiens » (**) . Une seconde assemblée eut lieu, mais les évêques bretons tinrent ferme, et l’un d’eux déclara qu’ils ne pouvaient admettre ni l’orgueil des Romains, ni la tyrannie des Saxons. Augustin exhorta, supplia, censura, et même, dit-on, eut recours aux miracles, mais sans plus de succès.
(*) Il faut toujours entendre par là les chrétiens de profession.
(**) Lire Éphésiens 5:21.
Espérant toujours vaincre la résistance des évêques bretons, Augustin les convoqua une troisième fois. Que faire ? se demandaient ces pauvres évêques, intimidés et quelque peu ébranlés par le grand nom de Rome qui avait conservé un certain prestige sur les esprits des peuples éloignés. Il y avait un ermite pieux et sage, qui s’était acquis un grand renom de sainteté. Quelques-uns des Bretons allèrent le consulter. — Devons-nous abandonner nos coutumes et suivre Augustin ? lui dirent-ils. — S’il est un homme de Dieu, suivez-le, fut sa réponse. — Et à quoi le reconnaîtrons-nous ? — Le Seigneur a dit : « Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur ». Si Augustin est débonnaire et humble de cœur, il porte le joug de Christ et vous offre de porter le même joug ; mais s’il est violent et superbe, il n’est pas de Dieu et vous n’avez pas à faire attention à ce qu’il dit. — Comment connaîtrons-nous son humilité ? dirent-ils encore. — Faites en sorte que lui et les siens arrivent les premiers au lieu du rendez-vous. S’il se lève quand vous entrerez, obéissez-lui.
Telles furent les paroles de l’ermite ; mais les évêques bretons n’eussent-ils pas mieux fait de consulter la parole de Dieu et de se tenir à ses enseignements ? Ils y auraient vu que Christ est le seul vrai conducteur, et que Pierre recommandait aux anciens de ne pas paître le troupeau de Dieu comme dominant sur des héritages, mais en étant des modèles du troupeau (*).
(*) Matthieu 23:7-12 ; 1 Pierre 5:2, 3.
Qu’arriva-t-il ? Quand les évêques bretons entrèrent, Augustin, assis dans toute sa dignité et voulant leur montrer sa supériorité, ne se leva pas pour les saluer. Frappés à cette vue, les évêques bretons, pour la troisième fois, refusent de se soumettre au pape de Rome et ne veulent connaître d’autre maître que Christ. Augustin alors s’écrie : « Puisque vous ne voulez pas recevoir des frères qui vous apportent la paix, vous subirez des ennemis qui vous apporteront la guerre. Vous ne voulez pas vous unir à nous pour annoncer aux Saxons le chemin de la vie, eh bien, vous recevrez d’eux le coup de la mort ». Et il se retira.
Était-ce là l’esprit et la douceur de Christ ? Non, certainement ; mais on y voit l’orgueil et l’esprit de domination qui caractérisèrent de plus en plus l’Église de Rome aspirant à la suprématie universelle et l’établissant sur les autres églises.
Augustin n’avait donc pu amener les évêques bretons à se soumettre à l’autorité de Rome. Il eut plus de succès dans ses efforts pour convertir les païens. Outre ceux du Kent, il réussit auprès de Sébert, roi d’Essex, qui embrassa le christianisme avec tout son peuple, et il gagna aussi Redwald, roi de l’Est-Anglie (*). On ne peut que reconnaître le zèle et le dévouement d’Augustin, et, sans nul doute, le christianisme qu’il apporta en Angleterre, tout mélangé d’erreurs qu’il était, valait infiniment mieux que le paganisme cruel des Saxons ; mais combien il est regrettable qu’au lieu de prêcher le pur et simple Évangile qui annonce le salut à quiconque croit au Seigneur Jésus, il ait introduit une religion de formes et de cérémonies sous l’autorité d’un clergé soumis au pape de Rome. Ce n’est pas ainsi qu’agissaient les apôtres, et cela laissait les cœurs vides de Dieu. Trop souvent les païens ne faisaient que changer une forme de culte pour une autre, et, à la place de leurs dieux, mettaient des saints ou soi-disant tels.
(*) Nos lecteurs doivent se rappeler que les Saxons, peuple païen du nord-ouest de l’Allemagne, avaient envahi l’Angleterre dans le 5° et le 6° siècle, et y avaient formé sept royaumes : le Kent, le Sussex, le Wessex, l’Essex, le Northumberland, l’Est-Anglie et la Mercie. La Déirie faisait partie du Northumberland.
Grégoire en effet, pour ne pas heurter les populations païennes dans leurs habitudes, avait conseillé à Augustin de transformer les temples païens en églises, en les consacrant à tel ou tel saint. Les fêtes chrétiennes furent célébrées aux mêmes jours que l’avaient été les fêtes païennes. Dans ces fêtes, on élevait des baraques, on égorgeait des animaux, et le peuple s’en nourrissait, le tout sous l’invocation d’un saint. Les coutumes païennes étaient ainsi conservées sous une autre forme ; la nouvelle religion s’accommodait à l’ancienne. Était-ce vraiment le christianisme, celui de Paul qui écrivait : « Soyez séparés,… et ne touchez pas à ce qui est impur » ? (2 Corinthiens 6:17) (*). On pensait gagner ainsi plus aisément les populations, et ce n’est pas le seul fait de ce genre que présentent les missions catholiques romaines.
(*) Des coutumes païennes s’étaient ainsi glissées et conservées dès les premiers temps dans l’Église, aux fêtes dédiées aux saints. Augustin et Ambroise s’étaient fortement élevés contre elles, mais en vain. Au commencement du 5° siècle, on voit qu’en Italie, à Naples, elles existaient et Paulin de Nole, appelé saint par l’Église de Rome, les approuvait.
Augustin mourut vers l’an 605. On se rappelle sa cruelle menace contre les chrétiens bretons qui n’avaient pas voulu se soumettre au joug de Rome. Peu avant ou peu après sa mort, elle eut son accomplissement. Ethelfrid, roi du Northumberland, qui était païen, s’avança avec une nombreuse armée contre Bangor, le foyer du christianisme breton. Les moines effrayés s’enfuirent. Douze cent cinquante d’entre eux s’étaient réunis dans un endroit écarté pour implorer le secours du Seigneur. Ils furent découverts par leurs cruels ennemis. Ethelfrid, voyant ces hommes désarmés à genoux, demande ce qu’ils font. L’ayant appris, il s’écrie : « Ils combattent donc contre nous ! » et il ordonne à ses soldats de fondre sur ces hommes en prières. Douze cents furent égorgés, le reste réussit à s’échapper. Les Saxons marchèrent ensuite sur Bangor qu’ils détruisirent. Les prêtres virent dans ce fait la réalisation du présage du saint pontife Augustin, comme ils le nommaient ; mais dans le pays, que ce massacre remplit de douleur, on accusa Augustin d’avoir été l’instigateur de l’invasion d’Ethelfrid. Ce fut un coup fatal porté à l’église bretonne, bien qu’elle eût encore un moment d’éclat, comme nous le verrons.
Augustin eut pour successeur Laurent, un des missionnaires venus avec lui en Bretagne. Mais l’œuvre qu’ils avaient accomplie sembla à son tour sur le point d’être anéantie. Un grand nombre de ces soi-disant chrétiens, si facilement convertis, retournèrent au paganisme. Eadbold lui-même, roi de Kent, fils et successeur d’Ethelbert qui le premier avait accueilli les missionnaires, fut du nombre des apostats. Les évêques romains s’enfuirent dans les Gaules, et Laurent se prépara à les suivre. Il avait voulu passer une dernière nuit en prières dans l’église ; le matin venu, il vint, les vêtements en désordre, se présenter devant le roi, et, ôtant son manteau, lui montra son corps couvert de plaies. Le roi surpris lui demanda qui avait osé le maltraiter ainsi. « Saint Pierre, répondit Laurent, lui était apparu la nuit, et, lui reprochant d’abandonner son troupeau, l’avait châtié à coups de fouet. De là venaient ses meurtrissures ». Eadhold était superstitieux ; saisi de crainte, il se soumit de nouveau à la puissance du pape, successeur d’un apôtre qui traitait si rigoureusement les désobéissants. Laurent était-il de bonne foi ? On peut croire qu’agité par la pensée de laisser une œuvre à laquelle il s’était attaché et en ayant du remords, il ait eu un rêve, et qu’ensuite il se soit meurtri lui-même, afin d’essayer par ce moyen d’agir sur l’esprit du roi.
Edwin, qui fut roi du Northumberland après le cruel Ethelfrid, fut aussi converti, dit-on, par une intervention miraculeuse. Il vaut mieux penser qu’Edwin, dont la femme était chrétienne, fut amené par elle à embrasser le christianisme. Un grand nombre de ses sujets suivirent son exemple et furent baptisés. Mais Edwin ayant été tué dans un combat contre le païen Penda, roi de Mercie, presque tous les Northumbriens retournèrent au paganisme. On peut voir par là le peu de réalité de ces conversions. On embrassait un certain ensemble de pratiques religieuses, mais le cœur et la conscience n’avaient point été atteints, parce que Christ n’avait pas été vraiment prêché, et qu’il n’y avait pas eu une action de l’Esprit Saint. Quelle différence entre ces conversions et celles des Thessaloniciens, par exemple ! Eux avaient été vraiment « tournés (ou convertis) des idoles vers Dieu, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils Jésus » (1 Thessaloniciens 1:9-10). Ils avaient reçu l’Évangile, la parole de Dieu, dans la puissance de l’Esprit Saint et avec joie, bien qu’accompagné de tribulations, et ils étaient restés fidèles. Ils étaient vraiment chrétiens.
Un rayon de lumière vint encore briller un moment dans les ténèbres. Oswald, fils du cruel Ethelfrid, avait dû chercher un refuge en Écosse, avec son frère Oswy et quelques jeunes nobles. Il avait appris la langue du pays, avait entendu l’Évangile et avait été vraiment converti. Il fut baptisé ainsi que son frère. Les églises d’Écosse, comme nous le savons, et en particulier Iona, avaient conservé plus purement les vérités de la parole de Dieu. Oswald, dont le cœur avait été réellement saisi par la grâce du Seigneur, aimait à écouter les anciens de ces églises et désirait vivement marcher sur les traces de Jésus qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Il se montrait plein de compassion pour les pauvres, se dépouillant même de ses vêtements pour les couvrir. Il pensait aussi à ses compatriotes du Northumberland, près desquels il aurait voulu aller comme missionnaire, afin de les ramener au christianisme. Mais il crut qu’il y parviendrait mieux s’il était établi sur le trône. À la tête d’une petite armée, et se confiant en Dieu, il livra bataille à un ennemi beaucoup plus puissant que lui et remporta une grande victoire.
Devenu roi, Oswald s’occupa du bien spirituel de son peuple, et demanda aux églises d’Écosse un missionnaire. On lui envoya un moine nommé Corman, pieux, mais d’un caractère rude et austère, qui ne sut pas présenter la grâce aux populations barbares auxquelles il s’adressait. Il retourna découragé à Iona et dit aux anciens : « Les gens vers qui vous m’avez envoyé sont si obstinés qu’il faut renoncer à changer leur cœur ». Pauvre Corman ! Il semble avoir ignoré que c’est la puissante grâce de Dieu qui seule, par l’action de l’Esprit Saint, peut opérer ce changement. En entendant Corman, Aïdan, un des anciens d’Irlande, avait le cœur ému et se disait en lui-même : « Si ton amour, ô Sauveur, eût été présenté à ce peuple, les cœurs auraient été touchés ». Puis s’adressant à Corman : « Mon frère », lui dit-il, « tu as été trop sévère pour des auditeurs si peu en état de comprendre. Il fallait leur donner du lait à boire, avant de leur présenter des aliments plus solides ». Les anciens, à l’ouïe de ces paroles, s’écrièrent : « Aïdan est digne d’être évêque » (*), et ils lui imposèrent les mains.
(*) C’était le titre donné à un ancien que l’on envoyait comme missionnaire.
Aïdan partit et fut reçu avec joie par Oswald. Comme il ignorait la langue des Saxons, le roi l’accompagnait partout et interprétait lui-même ses paroles. D’autres missionnaires se joignirent à eux, et bientôt les populations vinrent en foule se presser autour du roi et des serviteurs du Seigneur, écoutant avec joie « la parole de Dieu », dit Bède, un ancien historien ecclésiastique. Bien que Bède fût attaché à l’Église de Rome et déplorât que ces missionnaires ignorassent les décrets des conciles (ce qui ne leur nuisait pas), il leur rend un beau témoignage : « Ils pratiquaient uniquement et diligemment », dit-il, « les préceptes de piété et de pureté qu’ils avaient appris des prophètes, des évangiles et des écrits des apôtres », c’est-à-dire qu’ils s’attachaient aux Écritures. Bède loue encore « leur zèle, leur générosité, leur humilité et leur simplicité, leur application sérieuse à l’étude des Écritures, leur franchise vis-à-vis des grands, leur douceur et leur charité envers les pauvres, dégagés qu’ils étaient de tout égoïsme et d’avarice, et enfin leur vie austère et dévouée ». C’est un bel éloge ! Ne voudrions-nous pas être comme eux ? C’est à l’école de Jésus que l’on apprend à être doux et humble de cœur ; c’est à ses pieds, comme Marie, que l’on comprend et goûte sa parole (Matthieu 11:29 ; Luc 10:39). Ces serviteurs de Dieu ne faisaient pas de la piété une source de gain ; ils ne bornaient pas leur ministère à célébrer les cérémonies d’un culte dans des murs consacrés ; mais, comme les apôtres, ils prêchaient et exhortaient de village en village, et de maison en maison. Qui peut dire tous les résultats bénis de leur activité ?
Oswald ne se bornait pas à aider les missionnaires dans leurs travaux. Il montrait aussi sa piété par ses œuvres. Il avait conservé son amour pour les pauvres qu’il aimait à soulager. On raconte qu’un jour de Pâques, comme il allait se mettre à table, il apprit qu’une troupe de pauvres pressés par la faim était devant sa porte. Aussitôt il ordonna de prendre les mets de sa table et de les leur porter. Puis il fit briser les vases et les plats d’argent qui étaient sur sa table et leur en distribua les morceaux. Étant allé dans le Wessex, pour épouser la fille du roi de ce pays, il y apporta la connaissance de l’Évangile.
Oswald ne régna que neuf ans. Les habitants idolâtres du royaume de Mercie, conduits par leur roi Penda, avaient envahi le Northumberland. Oswald, ayant marché contre eux pour les repousser, fut tué dans la bataille. On rapporte qu’en tombant il s’écria : « Seigneur ! aie pitié des âmes de mon peuple ! »
5.10 - Rome triomphe en Angleterre
La mort d’Oswald n’arrêta pas les travaux des missionnaires. Ils allaient, prêchant de lieu en lieu, et dès que, dans quelque endroit, on en voyait paraître un, la population accourait près de lui et le priait de leur faire entendre la parole de vie. Ainsi la doctrine chrétienne plus pure se répandait chez les Saxons du nord, tandis que ceux du sud reconnaissaient la suprématie de Rome, et suivaient les formes et les cérémonies de son culte. Les prêtres attachés à Rome désiraient ardemment amener les chrétiens Bretons à se soumettre à cette Église qui prétendait à la domination universelle ; l’occasion de le faire se présenta bientôt.
Oswy avait succédé à son frère Oswald, mais était bien différent de lui. Très ambitieux, il voulut agrandir ses États et marcha contre Oswin, son parent, roi de Déirie. Celui-ci, ne voulant point combattre, s’était enfui chez un noble qu’il croyait son ami. Il fut trahi, et Oswy le fit mettre à mort. Aïdan, en apprenant ce crime, mourut de douleur. Oswy s’empara de la Déirie et plus tard du royaume de Mercie. Il devint ainsi le plus puissant des rois saxons. En était-il plus heureux ? Non ; sa conscience ne le laissait pas tranquille.
La reine Earfeld était attachée à l’Église de Rome, et aurait voulu qu’Oswy s’y soumît aussi. Elle était soutenue par deux prêtres, l’un nommé Romain et l’autre Wilfrid, ce dernier, homme doué de grands talents, mais très ambitieux d’honneurs et de richesses. Il espérait, en amenait le roi et ses sujets sous l’autorité de l’Église de Rome, obtenir une place éminente dans le clergé et pouvoir ainsi satisfaire son avarice. Ce n’était donc pas l’amour de Christ et des âmes qui l’animait. Les tristes mobiles qui le faisaient agir, l’amour de la domination et de l’argent, existaient, hélas ! chez bien d’autres dans la chrétienté et s’y montrèrent de plus en plus. Oswy, troublé par le souvenir du meurtre d’Oswin et d’autres fautes, aurait voulu apaiser Dieu et se procurer une entrée au ciel. Où aurait-il dû chercher la paix de son âme ? Christ seul pouvait la lui donner, mais les prêtres romains lui faisaient croire que c’était dans leur église qu’il trouverait ce que son cœur désirait. Pour le décider, ils proposèrent qu’il y eût une conférence publique entre eux et les évêques bretons. Oswy y consentit, et l’on se réunit à Whitby.
Après la mort d’Aïdan, les anciens d’Iona avaient envoyé pour le remplacer un évêque nommé Colman, homme simple, mais énergique. Il vint à cette réunion avec les autres évêques bretons. Le roi commença ainsi : « Puisque nous sommes serviteurs d’un même Dieu, et que nous espérons un même héritage, nous devrions avoir ici-bas une même règle de vie, et il nous faut rechercher quelle est la vraie ». C’était bien, n’est-ce pas ? Mais où fallait-il chercher ? Dans l’Écriture, n’est-il pas vrai ? Et c’est ce que ne firent ni les uns, ni les autres. Colman répondit : « Nous suivons la doctrine de Colomba qui est celle de Jean, le disciple bien-aimé du Seigneur, et celle des églises qu’il présidait. Gardons-nous de la mépriser ! » Wilfrid, avec une grande habileté, et sachant comment frapper l’esprit du roi par l’aspect de la grandeur et du pouvoir, répliqua : « Nous, notre coutume est celle de Rome où ont enseigné les saints apôtres Pierre et Paul. Elle est répandue parmi toutes les nations. Les Pictes et les Bretons seuls, jetés aux bouts de la terre, veulent-ils lutter contre le monde universel ? Voulez-vous opposer, Colomba, si saint qu’il ait été, à Pierre, le prince des apôtres, auquel Christ a dit : Tu es Pierre, et je te donnerai les clefs du royaume des cieux ? ». Wilfrid omettait à dessein Jean, pour ne parler que de Colomba ; mais au lieu que les uns et les autres se tournassent vers les Écritures seules, on se réclamait de traditions, de coutumes, de règles soi-disant données par tel ou tel apôtre que l’on opposait l’un à l’autre. C’était comme chez les Corinthiens où l’on disait : « Moi, je suis de Paul ; et moi d’Apollos ; et moi de Céphas » (1 Corinthiens 1:12). Et puis, nous voyons s’affirmer cette prétention exorbitante, nullement justifiée par l’Écriture, que Pierre étant le prince des apôtres et le pape son successeur, celui-ci était le chef de l’Église universelle. Paul, inspiré par l’Esprit de Dieu, dit : « J’estime que je n’ai été en rien moindre que les plus excellents apôtres, quoique je ne sois rien » (2 Corinthiens 11:5 ; 12:11) ; il n’était rien en lui-même, ni par lui-même, mais ce qu’il était venait de la grâce du Seigneur. Paul n’étant en rien moindre que les plus excellents apôtres, où est la suprématie de Pierre ? Mais on pensera peut-être : Le Seigneur n’a-t-il pas donné à Pierre les clefs du royaume des cieux ? (Matthieu 16:19). Oui, sans doute, et Pierre s’en est servi. Il a ouvert les portes du royaume des cieux aux Juifs, le jour de la Pentecôte (Actes 2:37-41), et il les a ouvertes aux nations, d’après l’ordre du Seigneur, quand il alla annoncer Christ et la rémission des péchés par son nom, à Corneille et à sa maison et ses amis (lire Actes 10, et surtout versets 9-16, 28, 43, 44 ; et 11:1-18). Peut-être entendra-t-on dire : « Oui, mais le Seigneur a donné à Pierre l’autorité de lier et de délier sur la terre, et ce devait être ratifié dans le ciel » (selon Matthieu 16:19). C’est vrai, mais cela a été donné aussi à l’Assemblée (Matthieu 18:18), et aux disciples individuellement (Jean 20:23). Lier et délier, c’est déclarer le pardon à quiconque croit au Seigneur et la condamnation à quiconque refuse Christ (Jean 3:36), et c’est ce que Pierre a fait dans les deux occasions que nous avons citées. Une autre objection que font les partisans de Rome est celle-ci : « Le Seigneur n’a-t-il pas dit : Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église » ? (Matthieu 16:18). Et par cette Église, ils entendent celle de Rome. Mais les paroles du Seigneur ne signifiaient pas que ce soit sur Pierre que l’Église est fondée. Ce serait une contradiction avec d’autres passages où nous lisons que Christ est le fondement unique (1 Corinthiens 3:11). Il est bien dit que les saints sont « édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes » (Éphésiens 2:20), car ce sont eux qui ont proclamé le salut et révélé les pensées de Dieu, mais ce n’est pas plus Pierre que les autres, et Jésus Christ demeure seul la maîtresse pierre du coin, sans laquelle rien ne tient. Ce n’est pas sur Pierre que l’Église est fondée, mais sur la belle confession de Pierre : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » (Matthieu 16:16). Pierre était une pierre, une simple pierre dans l’édifice que devait construire Christ. Et quant à la prétention qui fait du pape le chef de l’Église sur la terre, rappelons nous que c’est Christ seul qui est le Chef ou la Tête de l’Assemblée (ou l’Église) qui est son corps, et que ce divin et unique Chef est dans le ciel (Éphésiens 1:22-23). Il est bon de se souvenir de ces choses, parce que dans les jours mauvais où nous sommes, on est exposé aux pièges de l’ennemi qui cherche, même en se servant des Écritures, à faire sortir les âmes du chemin de la vérité. Pauvre Oswy, s’il avait connu la parole de Dieu, il aurait pu résister à la subtilité des partisans de Rome ; pauvres évêques bretons aussi, qui ne surent pas se servir de cette arme puissante, l’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu ! (Éphésiens 6:17).
Après avoir entendu Wilfrid, le roi, se tournant vers Colman, lui dit : « Est-il vrai que le Seigneur ait adressé ces paroles à Pierre ? — Cela est vrai, ô roi ! répondit Colman. — Et pouvez-vous prouver qu’une aussi grande puissance ait été donnée à Colomba ? — Nous ne le pouvons ». Colman n’aurait-il pas dû laisser Colomba de côté, et dire au roi ce que l’Écriture enseigne ? Mais déjà, même à Iona, la connaissance de la parole de Dieu s’était affaiblie, et l’on s’attachait plus à des coutumes qu’à ce que Dieu a dit.
Oswy, heureux de pouvoir faire cesser une lutte qui se renouvelait sans cesse dans sa propre maison, heureux aussi, dans sa propre ignorance, d’avoir quelqu’un qui lui ouvrît le ciel, s’écria : « Pierre est le portier ; je veux lui obéir et à son successeur, de peur que, quand je me présenterai à la porte, il n’y ait personne qui m’ouvre ». Pauvre Oswy ! Il ne savait pas que Christ seul est la porte du salut, et qu’il ouvre et nul ne ferme (Jean 10:7, 9 ; Apocalypse 3:7). Ainsi l’Église de Rome triompha. Elle veut être assise comme reine comme dira Babylone (Apocalypse 18:7). Hors de la soumission à ses enseignements et à ses rites, et à celui qui ose se dire le vicaire de Christ ici-bas, il n’y a pas de salut, dit-elle. Mais que dit la parole de Dieu ? Il n’y a de salut en aucun autre que Christ, aucun autre nom qui soit donné par lequel nous puissions être sauvés (Actes 4:12). Et quant à l’Église, bien loin qu’elle ait à dominer, il nous est dit que la vraie Église est soumise au Christ (Éphésiens 5:24). Elle n’enseigne donc pas, mais est enseignée par la Parole (Versets 26, 29). C’est la fausse prophétesse Jésabel qui enseigne et domine (Apocalypse 2:20), et elle représente Rome et ses prétentions.
Colman, accablé de douleur, retourna en Écosse avec ceux des évêques que Wilfrid n’avait pu persuader. Oswy, espérant ainsi racheter son âme, déploya la plus grande activité pour amener ses sujets à l’obéissance de l’Église de Rome. Wilfrid l’y aida de tout son pouvoir. Il devint évêque d’un vaste diocèse, s’enrichit des biens qui avaient appartenu à plusieurs monastères, s’entoura d’une suite nombreuse, et n’était servi que dans de la vaisselle d’or et d’argent. Quelle différence avec les humbles évêques d’Iona ! Mais c’est cet orgueil, ce luxe, cette avidité, cet amour de la domination, des richesses et des jouissances de la chair, que l’on vit se répandre de plus en plus chez les hauts dignitaires du clergé romain et chez les papes, durant les siècles ténébreux du Moyen Âge, tandis que le bas clergé et le peuple demeuraient dans la plus triste ignorance et livrés à la superstition.
Mais le triomphe de Rome ne se borna pas là. Bientôt l’Écosse et Iona même succombèrent sous les efforts des prêtres romains. Ils s’adressèrent à Naïtam, roi des Pictes. On lui fit comprendre combien il serait plus digne d’un roi d’appartenir à une église puissante, à la tête de laquelle était un pontife universel, successeur direct de Pierre, plutôt que de se soumettre à des congrégations conduites par de chétifs anciens. On lui montra combien la pompe du culte romain convenait mieux à la pompe royale. Naïtam, séduit par la pensée de marcher à l’égal des illustres rois des Francs, céda et fit venir des architectes pour lui construire des églises en pierre, au lieu des humbles édifices en bois où Christ avait été annoncé. Puis il ordonna que tous les ecclésiastiques de son royaume reçussent la tonsure romaine (*), en signe de soumission à cette Église. Et il fut fait ainsi. Où était en tout cela la parole de Dieu et l’intérêt pour le salut des âmes ?
(*) Les moines et les ecclésiastiques, dès le 6° siècle, en Orient et en Occident, étaient tonsurés, c’est-à-dire qu’une partie de la tête était rasée. C’était la marque distinctive de leur consécration. En Orient, la tonsure se faisait en long, par devant, d’une oreille à l’autre, en forme de croissant. En Occident, elle se faisait en rond, sur le sommet de la tête. C’étaient toujours des ordonnances et non l’Écriture.
Les anciens de Iona résistaient encore à l’envahissement des coutumes romaines. Un jour, un moine, nommé Ecgbert, très enthousiaste pour Rome et d’un caractère très doux, vint les trouver. Il fut reçu avec une grande hospitalité, et sut bientôt s’insinuer dans les esprits. Par ses discours et par les riches dons qu’il répandait et qu’on lui avait confiés dans ce but, il commença à les ébranler. Mais ce fut surtout en se présentant comme ayant reçu de Dieu une mission auprès d’eux qu’il acheva de les gagner. « Une nuit », leur raconta-t-il, « un des bienheureux apparut à un frère du couvent et lui dit : « Dis à Ecgbert ces paroles : Va vers les monastères de Colomba, car leurs charrues ne cheminent pas droitement ; il faut que tu les remettes dans le droit sillon. Je ne voulais pas obéir, et je m’embarquai pour aller porter l’Évangile aux Germains. Mais une tempête jeta le navire sur le sable. Je vis que c’était à cause de moi, et je résolus d’obéir. Maintenant », ajouta-t-il, « soumettez-vous à la voix du ciel ».
Dieu peut parler aux hommes par des rêves (Job 33:14-15), mais Il ne parlera pas en faveur de ce qui est contraire aux Écritures, qui sont sa Parole. Les anciens de Iona, au lieu de rejeter ce rêve comme le produit de l’imagination d’un homme et de s’en tenir à la parole de Dieu, se laissèrent persuader par Ecgbert et crurent obéir à Dieu. Ils reçurent la tonsure qui les rangeait sous l’autorité du pape. Rome avait vaincu partout. Cependant, un petit nombre en Écosse, ne voulurent pas courber la tête sous son joug. « On les voyait », dit Bède, « clocher dans leurs sentiers, refuser de prendre part aux fêtes romaines et de se laisser tonsurer ». C’est au commencement du huitième siècle que Rome étendit ainsi son pouvoir sur toutes les îles Britanniques, mais Dieu se gardait un résidu ; au milieu des siècles de ténèbres, quelques faibles lumières éparses brillaient çà et là, en attendant qu’une pleine lumière se levât.
Cette Église d’Angleterre servit grandement la papauté par son zèle missionnaire. Des moines anglo-saxons, de l’ordre des Bénédictins (fondé par saint Benoît en 529), plus d’un siècle après Colomban, entreprirent de pousser plus loin que lui en Germanie, et de convertir les farouches païens d’entre Rhin et Elbe. Willibrod (mort en 739) parmi les Frisons, puis Winfrid, qui changea ensuite son nom en Boniface, parmi les Saxons, en furent les plus remarquables ouvriers. La célèbre abbaye de Fulda fut fondée en 744 par Sturm. Boniface que l’Église révère comme « l’apôtre des Germains », mourut en martyr, massacré dans la Frise en 755 avec quelques compagnons. Mais le rattachement au christianisme des Frisons, Saxons et Thuringiens ne fut effectif qu’un peu plus tard, quand Charlemagne conquit leur pays et contraignit sous peine de mort les païens à se faire baptiser. Ces régions ouvertes de façon aussi peu évangélique à la profession chrétienne sous l’autorité de Rome en devaient devenir à leur tour des foyers de propagation vers l’Est, chez les Slaves de l’Elbe, les Polonais, les Tchèques, les Hongrois, et se heurter aux populations évangélisées par des orthodoxes (Cyrille et Méthode) et relevant du patriarche de Constantinople.
Quoiqu’il en soit, lorsque, au début du 10° siècle les Normands et les Scandinaves eurent embrassé à leur tour la religion chrétienne, toute l’Europe occidentale et la majeure partie de l’Europe centrale furent catholiques et la puissance papale ne cessa de s’y renforcer pendant plusieurs siècles.
 Re: L’ÉGLISE : UNE ESQUISSE DE SON HISTOIRE PENDANT VINGT SIÈCLES
Re: L’ÉGLISE : UNE ESQUISSE DE SON HISTOIRE PENDANT VINGT SIÈCLES
5.11 - Nestorius et les Nestoriens
Après nous être occupés de ce qui se passait dans l’Église aux extrémités de l’Europe occidentale, en Irlande, en Écosse et dans la Grande Bretagne, nous reviendrons en Orient. En Occident, la puissance de l’Église romaine allait toujours croissant, sous la main de papes habiles et énergiques ; en Orient, ce que l’on voit tristement dominer, ce sont les discussions religieuses sans fin, attisées par les ambitions et les rivalités des évêques des grandes villes de Constantinople, d’Antioche et d’Alexandrie, produisant des hérésies et des divisions, et amenant souvent des conflits sanglants, parce qu’au lieu de l’épée de l’Esprit, la parole de Dieu, on se servait d’armes charnelles, en cherchant un appui auprès des empereurs.
Ces discussions et ces hérésies portaient le plus souvent sur la Personne adorable du Seigneur. Satan est l’ennemi de Christ qui est venu détruire sa puissance, et tous ses efforts et ses ruses tendent à attaquer et détruire ce que la parole de Dieu nous enseigne touchant Jésus, le Fils de Dieu. Il sait bien qu’avec Christ tout tombe, et qu’en s’attaquant au Rédempteur, on diminue ou l’on annule la rédemption. Pour arriver à ses fins, Satan induit les hommes à raisonner sur la Personne du Seigneur, qui, nous le savons par les Écritures, est à la fois vrai Dieu et vrai homme : Dieu sur toutes choses béni éternellement, et manifesté en chair. « La Parole devint chair », nous dit Jean, et « la Parole était Dieu » (Romains 9:5 ; 1 Timothée 3:16 ; Jean 1:1, 14). Qui peut expliquer cela ? Personne ; c’est un mystère insondable, car, nous dit Jésus lui-même : « Personne ne connaît le Fils, si ce n’est le Père » (Matthieu 11:27).
Lorsque des difficultés touchant la doctrine surgissaient, on convoquait, il est vrai, des conciles, ou assemblées d’évêques, mais ils étaient ordinairement sous la main des empereurs et influencés par lui ou par ceux qui exerçaient le pouvoir ; souvent aussi, ils étaient le théâtre de violences et de jugements iniques, comme nous l’avons vu dans le cas de Chrysostôme. Quelques conciles cependant maintinrent la vérité, comme, par exemple, celui de Nicée qui affirma la divinité de Christ conformément aux Écritures. Mais lorsqu’on a la parole de Dieu et qu’on la reçoit avec simplicité, qu’est-il besoin de conciles ? On ne peut admettre d’eux que ce qui est conforme aux Écritures. Or celles-ci nous montrent clairement d’une part que Jésus était réellement un homme. Il fut petit enfant, né de Marie ; il grandit, croissant en stature ainsi qu’en sagesse, et il devint un homme fait. Il mangeait et buvait, il était fatigué et se reposait, il dormait ; il se réjouissait et s’affligeait, il souffrait dans son corps et dans son âme. Et ce qui est si précieux pour nous, il avait toutes les affections et les sentiments d’un homme, mais d’un homme parfait, sans péché. Mais en même temps, il était réellement Dieu, ressuscitant les morts par une parole, calmant les vents et les flots en disant : « Taisez-vous », et opérant par lui-même bien d’autres miracles que la simple puissance de l’homme ne pouvait accomplir. Les prophètes et les apôtres en ont fait, mais c’était au nom de l’Éternel ou au nom de Lui, Jésus de Nazareth, tandis que Lui les faisait par sa propre divine puissance. La voix de Dieu le proclame son Fils bien-aimé ; par Lui les mondes ont été créés et subsistent par Lui ; les anges de Dieu l’adorent ; il est le Vivant, Celui qui vit aux siècles des siècles. À Lui appartient toute gloire. Voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne, et ce qu’il nous faut retenir.
Une grande controverse surgit en Orient au sujet de la Personne du Seigneur. Vingt et un ans après la mort de Chrysostôme, le siège épiscopal de Constantinople vint à vaquer. L’empereur Théodose II appela, pour occuper cette place importante, un prêtre de l’église d’Antioche, nommé Nestorius, qu’on lui disait être aussi distingué par ses talents que par sa piété. Mais avec des qualités réelles, Nestorius était hautain et intolérant. Dès qu’il fut établi évêque de Constantinople, il se mit à persécuter violemment tous ceux qui était en dehors de la communion de l’Église, tels que les Ariens et d’autres, même ceux qui n’étaient séparés que sur un point insignifiant, par exemple l’époque de la célébration de la fête de Pâques. Dans un discours à l’empereur, Nestorius avait été jusqu’à dire : « Empereur, donne-moi une terre purgée d’hérétiques et je te donnerai le ciel ; combats avec moi les hérétiques et je t’aiderai à vaincre les Perses ». Paroles bien étranges et orgueilleuses, n’est-ce pas, dans la bouche d’un faible mortel et d’un conducteur d’âmes ? Pauvre Nestorius ! il ne se doutait guère qu’il allait bientôt être lui-même accusé d’hérésie et condamné.
Déjà alors on commençait à entourer Marie, la mère du Sauveur, d’une sorte de vénération superstitieuse. On lui consacrait des églises, on l’invoquait en lui donnant le nom de « mère de Dieu ». On prétendait qu’elle était morte à Éphèse, on y montrait son tombeau qui attirait une foule de pèlerins, et c’était pour les Éphésiens une source d’abondants revenus. Elle était ainsi regardée, non seulement comme la patronne, mais comme la nourricière d’Éphèse. C’était elle, disait-on, qui faisait pleuvoir sur la ville et sur l’Asie entière toute sorte de prospérités. Aussi avait-on érigé une riche basilique sous son nom. Cela ne nous rappelle-t-il pas l’histoire rapportée au chapitre 19 des Actes ? C’était environ 400 ans auparavant que, dans cette même ville d’Éphèse, s’élevait le temple magnifique de la grande déesse Diane que l’Asie entière révérait, à laquelle la ville des Éphésiens était consacrée, et qui était aussi une source de richesses pour les habitants. Paul, le serviteur de Dieu, avait annoncé Christ, et le culte de Diane et l’idolâtrie étaient tombés, et maintenant une nouvelle idolâtrie, bien pire que la première, avait remplacé celle-ci. Ce n’était pas seulement la mère de Jésus dont on faisait une sorte de divinité, une reine du ciel, mais on regarda bientôt les saints, — les apôtres, les martyrs — comme des sortes de médiateurs entre Dieu et les hommes, on éleva des églises placées sous leur invocation, on leur adressa des prières et on vénéra leurs reliques auxquelles on attribua même le pouvoir de faire des miracles. Et ce mal terrible continua d’envahir de plus en plus l’Église. Oh ! quelle puissance d’aveuglement Satan exerce sur le cœur de l’homme !
Mais revenons à Nestorius. C’était donc un usage commun, déjà dans le 4° siècle, de donner à Marie le nom de « mère de Dieu », expression qui ne se trouve nulle part dans l’Écriture, bien que nous sachions que de Marie « est né Jésus, qui est appelé Christ » (Matthieu 1:16), et que « le Christ est sur toutes choses Dieu béni éternellement » (Romains 9:5). Or dans un discours prononcé à Constantinople, Anastase, prêtre que Nestorius avait amené d’Antioche, s’éleva contre le titre de « mère de Dieu » attribué à Marie, et Nestorius l’approuva. Cela causa un grand tumulte dans l’église de Constantinople où l’on vénérait Marie non moins qu’à Éphèse ; on regarda ces paroles comme un outrage fait à la mère du Seigneur. Nestorius voulut expliquer dans un discours pourquoi il ne pouvait admettre que le titre de « mère de Dieu » convînt à Marie. Mais il le fit de telle manière que l’on pouvait conclure de ses paroles qu’il enseignait que, de même qu’il y a en Christ deux natures, la divine et l’humaine, il y avait aussi deux personnes, l’homme, fils de Marie, et le Fils de Dieu. Il divisait ainsi la Personne adorable du Seigneur que nous voyons toujours une — un seul Christ. Plusieurs expressions dont il se servit montrent bien que telle était sa pensée, et il alla jusqu’à l’exprimer d’une manière tout à fait irrespectueuse, disant : « Je n’admettrai jamais un Dieu de deux mois, un Dieu de trois mois ; jamais je n’adorerai comme tel un enfant qui a su.. le lait de sa mère, et qui s’est enfui en Égypte pour sauver sa vie ». C’était un vrai blasphème, et cela nous montre jusqu’où l’on peut être entraîné lorsqu’on veut raisonner sur ce qui est infini, hors de notre portée, et connu de Dieu seul. Le petit enfant dans la crèche, celui que les anges exaltaient, que les bergers et les mages adoraient, que Siméon prenait dans ses bras, et qui, en effet, fut conduit avec sa mère par Joseph en Égypte, était bien le Fils de Dieu, Dieu lui-même qui, par un mystère insondable, le mystère de l’amour, s’est ainsi abaissé jusqu’à nous.
L’évêque d’Alexandrie, Cyrille, attaqua vivement Nestorius et ses doctrines, mais en le faisant il tomba lui-même dans des erreurs capitales, qui furent signalées par Jean, évêque d’Antioche. Jean cependant, bien qu’ami de Nestorius, n’admettait point ce que l’on condamnait chez celui-ci, et lui avait même écrit pour lui faire sentir qu’il avait tort. D’un autre côté, Cyrille avait su gagner à sa cause l’évêque de Rome, Célestin. Pour mettre un terme à ces disputes, l’empereur convoqua un concile général à Éphèse, en l’an 431. On aurait dû attendre que tous les évêques convoqués fussent réunis, mais Cyrille, par ses intrigues, sut si bien faire que le concile s’ouvrit avant l’arrivée de Jean et des évêques qui étaient avec lui, et que Cyrille lui-même, bien qu’accusé, le présida. La conséquence en fut la condamnation et la déposition de Nestorius. Mais alors arrivèrent Jean et les évêques syriens qui se constituèrent aussi en concile, déclarèrent que l’assemblée réunie par Cyrille était un faux concile, et l’excommunièrent. On voit quelle étrange confusion régnait parmi ceux qui s’intitulaient les conducteurs de l’Église. Mais la lutte n’était pas finie. On porta la chose devant l’empereur que Cyrille réussit à convaincre de la justice de sa cause et de l’intégrité du concile d’Éphèse qu’il avait présidé. Le faible empereur finit par l’approuver, et ainsi la déposition de Nestorius fut confirmée. Ses plus fidèles amis à la cour l’avaient abandonné, et Jean d’Antioche lui-même demanda son éloignement.
Nestorius s’était d’abord retiré dans le monastère où il avait passé sa jeunesse, situé à peu de distance d’Antioche. Mais là, il ne sut pas rester tranquille. Il y publia quelques livres et, par ses prédications éloquentes, il attirait beaucoup de personnes distinguées de la ville d’Antioche. Ses ennemis s’en émurent. Poussé par eux, le pape Célestin demanda à l’empereur que l’ennemi de la Vierge et de son Fils fût retranché de la société des hommes qu’il s’obstinait à perdre, et il pressa les évêques de se joindre à sa demande ! L’empereur l’exila à Pétra, en Arabie, et proscrivit également ses amis et ses partisans. Les ennemis de Nestorius trouvèrent que le lieu de son exil n’était pas encore assez éloigné, et il fut envoyé en Égypte, dans l’oasis d’Ibis, où l’on déportait les grands criminels d’État. C’était un endroit entouré d’un vaste océan de sables et d’où l’on ne pouvait s’échapper sans risquer sa vie. Là Nestorius se mit à écrire sa biographie, ouvrage qui ne nous est point parvenu. Fait prisonnier par une troupe d’Arabes nomades qui s’étaient jetés sur l’oasis pour la piller, il fut laissé par eux et put gagner Panopolis, petite ville de la province de Thèbes. Le gouverneur de Thèbes ne permit pas que l’infortuné Nestorius restât là. Il donna l’ordre de le transférer à Éléphantine sur la frontière d’Éthiopie. Mais accablé par l’âge et la fatigue, il tomba de cheval et se blessa grièvement. Ramené à Panopolis, il y mourut en l’an 440.
Un certain nombre d’évêques n’avaient pu accepter les décisions du concile d’Éphèse concernant la déposition de Nestorius. On les y força de la part de l’empereur, en ne leur laissant d’autre alternative que de souscrire ou d’être déclarés Nestoriens, et comme tels, poursuivis, déposés, exilés ou envoyés aux mines. Tel était le résultat de l’association de l’Église avec l’État ; celle-là se servant de l’épée du prince pour persécuter ceux qui ne se soumettaient pas à elle ! La plupart des évêques cédèrent, mais quelques-uns restèrent fermes. L’un d’eux, nommé Alexandre, évêque d’Hiérapolis, d’un âge très avancé, montra une fermeté inébranlable. À des amis, qui le sollicitaient de signer comme d’autres, il répondit : « Tenez-vous en repos. Je ne me soucie point de ce que font les autres, mais quand tous les morts ressusciteraient et nommeraient piété l’abomination d’Égypte (il voulait dire la conduite de Cyrille d’Alexandrie), je ne les croirais pas dignes de foi ». Il rompit avec ses amis, et sommé par le gouverneur de souscrire ou de quitter la ville, il sortit. Mais aussitôt toute la ville ferma ses églises. Le gouvernement fit enfoncer les portes et célébrer le culte sous la protection des soldats ! Quant au vieil évêque, il fut condamné au travail des mines en Égypte et y mourut. Voilà comment de soi-disant chrétiens agissaient envers ceux qui se réclamaient du nom du même Seigneur.
Fomentée par Cyrille, la persécution contre les Nestoriens sévit de toutes parts. Qu’arriva-t-il ? Ce fut un moyen dont Dieu se servit pour propager, non les fausses doctrines attribuées à Nestorius, mais le christianisme même. Ceux que l’on appela Nestoriens, parce qu’ils n’avaient pas voulu souscrire aux lois d’un concile qu’ils ne pouvaient reconnaître, et qui pour cela étaient violemment persécutés, se retirèrent en Perse. Ils y furent bien accueillis et protégés par les rois de cette contrée, par haine de l’empire grec. Ils y fondèrent une église indépendante de celle de Constantinople, et à laquelle un nommé Barsumas, évêque de Nisibe en Mésopotamie, donna une constitution.
Les Nestoriens se répandirent dans les contrées traversées par l’Euphrate, et animés d’un grand zèle missionnaire, ils évangélisèrent en Arabie, en Perse, dans l’Inde et jusqu’en Chine, où existaient encore quelques-unes de leurs églises dans le 13° siècle ; mais dans le 16° siècle, il n’en restait plus trace. Les descendants des Nestoriens fixés en Perse, subsistent encore. Nous en dirons quelques mots.
Au nord de la Perse, à la base de hautes montagnes couvertes de neige, est une vaste plaine d’une grande beauté. C’est la province d’Urmiah ou Oroomiah, et c’est là que demeurent les chrétiens nestoriens. Cette plaine, bornée par des montagnes escarpées, est couverte de villages entourés d’arbres verdoyants et de champs de blé. Au-delà se trouve le lac Urmiah tout parsemé d’îles. En différents points de la plaine se voient des espèces de buttes formées de cendres, recouvertes d’une mince couche de terre. On suppose que ce sont les endroits où brûlait sans cesse le feu sacré et où les prêtres Parsis se prosternaient devant le soleil levant (*).
(*) Les Parsis, descendants des anciens Perses et disciples de Zoroastre, étaient des adorateurs du feu, dont le soleil est pour eux le type le plus pur, en même temps qu’il est l’image de la divinité. Les Mahométans les nomment aussi Guèbres ou infidèles. Il en reste un petit nombre dans la province de Bombay.
Les Nestoriens sont un peuple intéressant à bien des égards. Leur langue, le syriaque, se rapproche beaucoup de l’hébreu, et était parlée plusieurs siècles avant la naissance du Sauveur. Elle est presque la même que celle qui était généralement employée en Palestine aux jours du Seigneur, et dont il se servait pour converser avec ses disciples et instruire le peuple. C’est dans cette même langue que, sur la croix, il s’écria : « Éloï ! Éloï ! lama sabachthani ? Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »
Les Nestoriens étaient nombreux et poursuivaient en paix leurs occupations comme agriculteurs et commerçants, ainsi que leurs travaux missionnaires, lorsque eut lieu l’invasion islamique en Perse, vers le milieu du septième siècle. Non seulement le culte du feu disparut de la Perse, mais les Nestoriens furent violemment persécutés par les vainqueurs. Ils n’avaient d’autre alternative — comme les malheureux Arméniens de naguère — que le Koran ou la mort. Leur nombre fondit comme la neige au printemps, et actuellement on n’en compte plus qu’environ 400000. En même temps, ils tombèrent peu à peu dans l’ignorance, la démoralisation et la superstition. Cependant, malgré la profonde déchéance de leur église, les Nestoriens sont restés, quant à la doctrine, plus rapprochés de la Bible que les catholiques romains, les Grecs et les Arméniens. « Je n’ai jamais rencontré », dit un missionnaire, « un Nestorien qui niât la suprême autorité de la parole de Dieu ». Ils abhorrent le culte des images, et n’admettent point la confession auriculaire et l’absolution donnée par le prêtre. Ils ne connaissent ni la messe, ni l’adoration de l’hostie. Ils rejettent, comme mauvaises et antiscripturaires, les doctrines de la régénération baptismale (*1), de la pénitence (*2), du purgatoire (*3). Ils croient en Christ comme en une seule Personne, à la fois vrai Dieu et vrai homme. Ils reçoivent avec joie ceux qui viennent à eux, au nom du Christ Jésus. Les missionnaires américains, venus parmi eux, ont été bien reçus et ont travaillé à répandre les vérités scripturaires, en les exhortant, en même temps, à mener une vie humble et sainte.
(*1) Doctrine qui prétend que le baptême d’eau opère dans l’âme la nouvelle naissance ou la régénération.
(*2) La pénitence, ce sont des actes imposés par le prêtre comme réparation ou châtiment des fautes commises.
(*3) Le purgatoire est, selon les catholiques romains, un lieu intermédiaire entre le ciel et l’enfer, où le feu achève de purifier l’âme qui ne l’a pas été complètement ici-bas.
Le premier missionnaire qui vint au milieu d’eux, trouva cette ancienne église en ruines et comme renversée dans la poussière. Le peuple était plongé dans la plus grossière ignorance. Il n’y avait point d’écoles, et à peine dans un village une demi-douzaine d’habitants savaient-ils lire. Ils n’avaient d’ailleurs pour livres que de rares manuscrits, dont le prix était très élevé. Le vol, parmi eux, était général et mentir une habitude invétérée. « Nous mentons tous », disaient-ils ; « comment pourrions-nous faire nos affaires, si nous ne mentions pas ? ». Ils buvaient du vin comme de l’eau, et quant à la religion, tout en conservant une certaine orthodoxie, elle n’était pour eux qu’une affaire de forme et d’apparence.
Maintenant il y a des écoles dans un grand nombre de villages, et l’on a fondé des établissements pour élever et former des jeunes gens des deux sexes capables d’instruire le peuple, et ainsi de réparer des maux accumulés durant tant de générations. Les Saintes Écritures ont été imprimées dans leur entier, tant dans l’ancienne langue des Nestoriens que dans celle qu’ils parlent actuellement.
« L’influence des Saintes Écritures sur nos élèves et dans les collèges », dit un missionnaire, « puis sur les centaines de Nestoriens adultes qui apprennent à lire dans les écoles du dimanche, cette influence s’exerçant dans leurs humbles demeures, et, par tous ces lecteurs, sur la masse du peuple, est incalculable ». Plusieurs sont comme des gens qui se réveillent d’un profond sommeil, et se demandent : « Comment se fait-il que nous ayons été gardés si longtemps dans l’ignorance ? ». Et les prêtres répondent : « Nous-mêmes, nous sommes restés jusqu’à ce jour, comme morts dans nos fautes et dans nos péchés, et notre péché est plus grand que le vôtre pour vous avoir caché si longtemps la lumière ». Les missionnaires américains ont à lutter contre des missionnaires catholiques romains qui voudraient rattacher à Rome l’église nestorienne. D’un autre côté, il semble qu’un certain nombre de Nestoriens se tournent du côté de l’Église grecque, afin d’être protégés contre les musulmans de Perse (*).
(*) Aujourd’hui, après avoir été fortement et même tragiquement éprouvés par les répercussions des deux guerres mondiales, les communautés nestoriennes ne subsistent qu’en très petits groupes dispersés en Iran, Irak, Turquie, Syrie, Liban, Inde, Arménie et aux États-Unis. Elles ne comptent pas 80000 personnes.
5.12 - Eutychès et les Arméniens
5.12.1 - Eutychès
Peu après la mort de Nestorius, l’Église d’Orient fut de nouveau troublée à l’occasion de doctrines tenues par un moine nommé Eutychès, archimandrite ou supérieur d’un couvent de trois cents moines, près de Constantinople. Eutychès s’était fortement opposé à Nestorius quand celui-ci fut condamné, mais lui-même tomba dans d’autres erreurs touchant la Personne adorable du Seigneur. Il disait bien que Christ, né de la vierge Marie, était vrai Dieu et vrai homme, mais que le corps de Jésus n’était pas de la même substance que le nôtre, contrairement à l’Écriture qui nous dit que Christ a participé au sang et à la chair (Hébreux 2:14). De plus, il enseignait que les deux natures divine et humaine du Seigneur n’en formaient qu’une, la nature humaine étant absorbée par la nature divine ou confondue avec elle. Nous pouvons voir par là combien l’on s’égare quand on veut raisonner sur ce qui est au dessus de notre conception, et expliquer ce que Dieu ne nous explique pas. Combien la parole de Dieu est plus simple ! Si nous nous tenons comme de petits enfants à ce qu’elle dit, nous ne courrons pas risque de faire fausse route.
Eutychès avait pour ami un nommé Eusèbe, évêque de Dorylée en Phrygie qui, avant d’occuper cette charge, s’était fortement prononcé contre Nestorius. Devenu évêque, il eut à venir à Constantinople pour les affaires de son église, et alla voir Eutychès. En s’entretenant avec lui, sa surprise fut grande d’entendre quelles doctrines il professait. Eusèbe eut beau les combattre, Eutychès ne voulut rien céder. Or la même année, Flavien, patriarche de Constantinople, réunit un synode pour régler certaines questions. Eusèbe s’y trouva et y accusa Eutychès de soutenir des doctrines contraires à la vraie foi. Le synode envoya à Eutychès des messagers pour le sommer de venir se défendre et exposer ses vues. Deux fois il refusa ; à la troisième sommation, il promit de venir. Il arriva en effet accompagné d’une troupe de moines, et escorté par des soldats ; en même temps se présentait aussi un envoyé de l’empereur avec une lettre demandant qu’il assistât aux séances.
Après une longue discussion où Eutychès chercha, par un semblant d’humilité et par des subtilités, à échapper à ceux qui le pressaient d’exposer sa foi, il fut à la fin obligé de confesser son erreur tout en la maintenant. Or cette erreur qui consiste à dire que Christ n’a pas été réellement un homme comme nous, à part le péché, c’est anéantir la rédemption. Eutychès fut condamné comme ayant blasphémé Christ, et fut exclu de la prêtrise, de la communion, et déposé de sa place d’archimandrite de son monastère. Trente évêques et vingt-trois archimandrites signèrent sa condamnation.
Eutychès sortit du synode en disant qu’il en appellerait à l’évêque de Rome, ce qu’il fit, en effet. Flavien fit répandre partout le décret qui condamnait Eutychès, demandant que chacun s’y soumît. Mais un grand nombre, surtout des moines, partisans d’Eutychès, refusèrent, et un grand trouble s’ensuivit dans l’Église.
Eutychès avait pour ami, à la cour impériale, le chef des eunuques Chrysaphius, dont il avait été le parrain à son baptême, et qui avait une grande influence sur l’empereur, le faible Théodose II. Chrysaphius, qui était avare et cherchait par toutes sortes de moyens à accroître ses richesses, détestait Flavien, parce que celui-ci n’avait pas voulu prêter les mains à une spoliation des biens de l’Église, et de plus avait refusé son concours à un complot tramé par Chrysaphius pour faire entrer dans un couvent Pulchérie, la sœur de l’empereur, dont il redoutait l’influence. C’est à cet ennemi de Flavien qu’Eutychès s’adressa et il réussit à faire convoquer par l’empereur un concile où il porterait sa cause. L’empereur était d’ailleurs gagné à ses vues.
Le concile se réunit à Éphèse en 449. Il comptait cent vingt-huit évêques présents, et le pape de Rome, Léon Ier, y avait envoyé, pour l’y représenter, trois légats porteurs d’une lettre où il exposait la foi de l’Église romaine touchant le mystère de l’incarnation du Fils de Dieu. Cette lettre était dirigée contre l’hérésie d’Eutychès. En résumé, elle établit qu’en Christ il y a deux natures, la divine et l’humaine, unies sans confusion, sans changement et sans séparation dans un seul et même Christ. Et Léon ajoute que l’erreur touchant la nature du corps du Seigneur anéantit sa passion et l’efficacité de son sacrifice. Il cite à ce propos le passage de 1 Jean 4:2-3: « Tout esprit qui confesse Jésus Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus Christ venu en chair n’est pas de Dieu ». On est heureux de voir maintenir, dans ces temps où tant d’erreurs s’étaient glissées dans l’Église, la vérité quant à la Personne du Fils de Dieu.
L’empereur avait désigné Dioscore, patriarche d’Alexandrie, pour présider le concile. Comme les autres patriarches, il devait amener avec lui dix métropolitains et dix autres évêques. Il les choisit selon ses vues qui étaient celles d’Eutychès. Dioscore était un homme qui, pour la violence et la rapacité, marchait sur les traces de son prédécesseur Théophile que nous avons vu dans l’histoire de Chrysostôme ; ses mœurs étaient à l’avenant. Mais il était soutenu par Chrysaphius et ne redoutait rien. Tout fut disposé d’avance pour disculper Eutychès et faire condamner Flavien. Théodose ordonna que les évêques qui avaient figuré comme juges au synode de Constantinople seraient exclus de la discussion et du vote. Eusèbe de Dorylée reçut la défense de quitter le territoire de son église, à moins que le concile ne l’appelât. Ainsi sur 128 évêques, 42 étaient privés du droit de parler et de voter. À ceux-là Dioscore en joignit quinze autres des opinions desquels il n’était pas sûr. Deux officiers de l’empereur avaient droit de prendre part aux discussions. De plus Théodose donna le droit de voter à un archimandrite syrien, nommé Barsumas, moine grossier qui, à la tête de mille moines aussi sauvages et barbares que lui et armés d’énormes bâtons, donnait la chasse aux Nestoriens, ou a ceux qui lui paraissaient tels, saccageait les églises, brûlait les monastères, tuait ou chassait les évêques qu’il ne croyait pas orthodoxes.
Telle était la composition du concile, et tels les auxiliaires de Dioscore, sans compter les parabolans (*) qu’il avait amenés d’Égypte, et qui, au besoin, étaient prêts à agir de leurs bras pour soutenir leur évêque.
(*) Hommes de peine et infirmiers placés sous les ordres immédiats de l’évêque.
Le concile s’ouvrit. Le premier légat du pape prit d’abord la parole pour demander qu’avant tout on lût la lettre de Léon. Mais comme on savait bien quelles étaient les pensées du pape touchant les doctrines d’Eutychès, on trouva moyen, malgré les instances réitérées des légats, de la laisser de côté. Alors Eutychès fut introduit, et il se présenta, non plus avec cette apparence d’humilité qu’il avait apportée au synode de Constantinople, mais la tête haute, comme sûr de son triomphe. Il portait à la main un rouleau dont il demanda la lecture et qui commençait par la transcription du symbole de Nicée. Il y déclarait qu’il vivrait et mourrait dans ces sentiments, et qu’il anathématisait tous les hérétiques. Puis il porta, contre Eusèbe de Dorylée et Flavien, une accusation fondée sur la manière dont il avait été traité et condamné dans le synode.
Après cette lecture, Flavien se leva et dit : « Il faudrait maintenant entendre Eusèbe ». Mais l’officier de l’empereur dit : « Ce n’est pas nécessaire ; l’empereur l’a exclu. Vous êtes réunis pour voir s’il faut casser ou confirmer le jugement rendu, et non pour recommencer le procès ».
Dioscore proposa alors qu’on lût les actes du synode de Constantinople. Tous les évêques l’approuvèrent, sauf les légats du pape qui insistèrent encore pour que d’abord sa lettre fût lue. Eutychès, craignant qu’on ne le leur accordât, se hâta de récuser les légats, parce que, disait-il, ils logeaient chez Flavien et avaient reçu de lui des services. Cependant Dioscore dit que, pour l’ordre, on devait d’abord lire les actes du synode, et qu’ensuite on lirait la lettre du pape, ce qui n’eut pas lieu.
Dans le synode de Constantinople, Eusèbe, l’accusateur d’Eutychès, avait pressé celui-ci de confesser la vérité touchant la Personne de Christ ; mais quand, dans la lecture des actes, on en vint à l’endroit où cela était rapporté (*), un grand nombre d’évêques gagnés à la cause d’Eutychès, s’écrièrent : « Qu’on chasse, qu’on brûle Eusèbe ! Qu’Eusèbe soit brûlé vif ; qu’il soit coupé en morceaux ! » Tel était l’esprit qui animait ceux qui se disaient les serviteurs de Christ, de Celui qui était doux et humble de cœur et ne voulait pas faire descendre le feu du ciel sur ses ennemis ! Dioscore mit alors aux voix cette proposition : « Approuvez-vous la profession de foi d’Eutychès ou celle d’Eusèbe ? ». Au milieu des clameurs, la doctrine d’Eutychès fut acceptée, et lui-même rétabli dans son rang et rendu à son monastère. Les légats du pape s’abstinrent, mais Eutychès avait gain de cause et se retira triomphant.
(*) Dans les synodes ou conciles, il y avait toujours plusieurs écrivains nommés notaires qui prenaient note de ce qui était dit ou fait. Les séances terminées, ils comparaient leurs notes et rédigeaient les actes du conciles ou du synode que l’on conservait soigneusement.
Les moines du monastère d’Eutychès que Flavien avait exclus de la communion, parce qu’ils avaient soutenu leur supérieur après sa condamnation, envoyèrent une députation au concile. Ils lui adressaient une requête contre Flavien qu’ils accusaient, non seulement d’avoir abusé de son pouvoir à leur égard, mais d’avoir mis à son profit le séquestre sur les biens de la communauté : accusation tout à fait fausse. Les moines déclarèrent aussi que, quant à leur foi, elle était la même que celle de leur supérieur. Dioscore, ni personne dans le concile, ne s’enquirent si les accusations contre Flavien étaient justifiées, mais, passant outre, ils rétablirent les moines dans leurs fonctions. C’était un nouveau triomphe sur Flavien ; mais ce n’était pas tout : il fallait le perdre et Dioscore en trouva le moyen.
Dans un précédent concile tenu à Éphèse, celui où Nestorius avait été condamné, on avait interdit toute composition ou publication de symboles (ou professions de foi) changeant quelque chose à celui de Nicée. Cela ne voulait pas dire qu’on ne pût expliquer les vérités que contenaient le symbole de Nicée. Or Flavien, dans le synode de Constantinople, avait fait brièvement une confession de foi où il reconnaissait Jésus, fils de Marie, comme vrai Dieu et vrai homme en une Personne. Dioscore prétendit qu’en faisant cela, Flavien avait contrevenu au décret du concile d’Éphèse, et avait mérité, ainsi qu’Eusèbe, d’être déposé et privé de toute dignité épiscopale et sacerdotale. Et il demanda que les évêques approuvassent par leur signature cette sentence. Alors Flavien se levant, dit : « J’en appelle », et il remit à l’un des légats son recours au pape et aux évêques d’Occident. Puis un autre légat, au nom de l’Église romaine, prononça son opposition à la sentence rendue par Dioscore. À ce moment quatre évêques vinrent se jeter aux genoux de celui-ci, et le supplièrent de réfléchir à ce qu’il faisait, Flavien, disaient-ils, n’ayant pas mérité la déposition. Mais Dioscore les repoussa en disant qu’il avait fait son devoir. Puis comme les évêques insistaient et que d’autres accouraient pour savoir ce qui se passait, il se leva irrité, et fit appel aux officiers de l’empereur. Ceux-ci croyant Dioscore en danger, firent entrer les soldats qui, les uns l’épée nue, les autres portant des chaînes comme s’il s’agissait de lier des malfaiteurs, se précipitèrent dans l’église et écartèrent brutalement les évêques qui continuaient à supplier Dioscore.
Le tumulte fut alors à son comble. Des gens du peuple, les parabolans de Dioscore, les moines de Barsumas avec leurs massues, s’étaient aussi répandus dans l’église, poussant des cris féroces : « Il faut chasser, il faut tuer ceux qui n’obéissent pas à Dioscore ». Quelle scène dans un lieu consacré au culte divin, et parmi des serviteurs du Dieu de paix !
Les évêques effrayés fuyaient dans tous les coins, mais on avait fermé les portes afin de recueillir les voix. Les évêques d’Égypte, joints aux moines et aux parabolans, menaçaient de la déposition et battaient ceux qui faisaient mine de réclamer. Dioscore, debout sur son estrade, annonça qu’on allait recueillir les opinions. « Et si quelqu’un refuse d’opiner », dit-il, « c’est à moi qu’il aura affaire, et l’empereur le saura ». Quelle arrogance chez un homme qui se disait ministre de Christ ! Ils opinèrent donc.
Mais il fallait encore signer la sentence, et, dans le tumulte, les notaires n’avaient pu rédiger le procès verbal de la séance. Il fut résolu par Dioscore qu’on signerait en blanc avec ces mots : « J’ai jugé et j’ai souscrit ». Et alors Dioscore, accompagné de deux hommes à l’air menaçant, alla de banc en banc recueillir les signatures. Saisis de terreur, les évêques signèrent, ceux qui essayaient de protester étant menacés et battus.
La dernière et plus affreuse scène de ce procès inique reste à dire. Flavien s’était retiré dans un coin de la nef, attendant le moment de sortir. Dioscore l’aperçut et courut vers lui en l’insultant ; puis il le frappa du poing au visage, et deux de ses diacres, saisissant le malheureux évêque par le milieu du corps, le jetèrent par terre. Dioscore le foula aux pieds, lui frappant du talon les côtes et la poitrine, tandis que les moines de Barsumas, excités par leur maître qui criait : « Tue, tue ! », frappaient Flavien de leurs bâtons et le piétinaient sous leurs sandales.
Flavien traîné dehors par les soldats, fut jeté demi-mort dans un cachot. On devait le conduire en exil, mais il mourut en route trois jours après sa condamnation, par suite des mauvais traitements qu’il avait essuyés. Tel fut le triomphe d’Eutychès et de Dioscore. Celui-ci se hâta de se rendre à Constantinople pour y installer un nouveau patriarche. En s’y rendant, il s’arrêta à Nicée, et formant un synode des évêques égyptiens qui l’accompagnaient, il excommunia le pape Léon comme hérétique. Les légats de celui-ci avaient réussi à s’enfuir et avaient porté à Rome le recours de Flavien.
Mais ce qui s’était passé remplit d’horreur la chrétienté ; on flétrit ce concile sous le nom de Brigandage d’Éphèse, et il ne fut pas inscrit au nombre des conciles reconnus. Cependant Chrysaphius fit approuver par l’empereur les actes de ce concile de brigands, et une loi de Théodose vint ordonner la persécution contre ceux qui ne les accepteraient pas. Mais bientôt les choses changèrent de face. Un an après la mort de Flavien, l’empereur Théodose mourut des suites d’une chute de cheval. Sa sœur Pulchérie qui avait soutenu Flavien, lui succéda à l’empire et y associa Marcien, qu’elle épousa. C’était un vieux soldat, franc, juste et ferme, qui défendit l’empire contre les Barbares et y rétablit l’ordre. Il partageait les vues de Pulchérie à l’égard d’Eutychès, qu’elle condamnait. Il suspendit les persécutions, abrogea l’obligation de reconnaître les actes du faux concile ; les évêques exilés furent rappelés, ceux qui avaient été déposés furent rétablis, et Eutychès fut chassé de son monastère. Chrysaphius fut mis à mort.
Léon de Rome avait d’abord demandé qu’un nouveau concile général fût convoqué à Rome, mais l’empereur refusa, et il fut ensuite convenu qu’il se réunirait à Nicée sous la présidence des légats du pape. Dioscore ne devait pas y siéger comme évêque. Avant qu’il fût réuni, les restes de Flavien furent transportés solennellement à Constantinople, et il fut enseveli auprès de Chrysostôme, mort comme lui victime de l’inimitié des évêques.
L’empereur transféra ensuite le concile à Chalcédoine, afin qu’il fût plus près de Constantinople, et que lui pût y assister plus facilement. Ce concile fut le plus nombreux qu’il y eût encore eu. Plus de cinq cents évêques ou autres prélats y siégèrent. D’un côté se rangèrent les évêques d’Égypte et ceux qui soutenaient Dioscore ; de l’autre, les évêques d’Orient, du Pont, de l’Asie et de la Cappadoce. Les légats du pape déclarèrent qu’ils ne pouvaient siéger avec Dioscore, et Eusèbe de Dorylée se porta son accusateur. Mais bientôt des scènes violentes se produisirent à l’entrée de Théodoret de Cyr (Kars) qui avait été exclu du faux concile d’Éphèse sans autre raison que son opposition à Eutychès. En le voyant paraître, les partisans de Dioscore se mirent à pousser des clameurs : « Hors d’ici, l’ennemi de Dieu », disaient-ils. Les évêques d’Orient répondaient : « Hors d’ici, les hérétiques, les meurtriers de Flavien ». Le tumulte augmentant, le chef des magistrats représentant l’empereur se leva et dit : « Ces cris sont indignes d’une réunion d’évêques ; faites silence, et ne troublez plus l’ordre du concile ».
Dioscore accusé voulait rejeter la responsabilité de tout ce qui s’était passé sur les quatre assesseurs que l’empereur lui avait adjoints, et ensuite sur l’assemblée elle-même qui avait tout approuvé ; mais alors les évêques d’Orient lui donnèrent un démenti violent, disant : « Nous avons été forcés, nous avons été frappés, nous avons cédé aux menaces et aux violences ». Et alors suivirent les détails sur la manière dont Dioscore arrachait les votes et les signatures, et empêchait les notaires d’écrire, leur enlevant de force leurs tablettes. On en vint à la profession de foi d’Eutychès. Un évêque, Basile de Séleucie, dit que, dans le concile d’Éphèse, il avait pressé Eutychès de reconnaître qu’il y a deux natures en Christ, mais qu’Eutychès s’y était refusé. « Pourquoi donc », dirent les magistrats à Basile, « avez-vous souscrit à l’absolution d’Eutychès et à la déposition de Flavien ? ». « Parce que j’ai été forcé d’obéir », répondit Basile. « J’ai failli » ajouta-t-il. Et tous les Orientaux qui, de même que lui, avaient cédé à la force, s’écrièrent : « Nous avons tous failli ; tous nous demandons pardon ».
On lut ensuite la profession de foi de Flavien au synode de Constantinople, et le concile, sauf quelques partisans de Dioscore, déclara orthodoxe la doctrine du martyr Flavien. À ce moment, Juvénal, évêque de Jérusalem, qui jusqu’alors avait soutenu Dioscore, et avec lui les évêques de la Palestine, dirent : « Nous croyons tous la même chose », et, se levant, ils passèrent du côté des évêques d’Orient. Leur exemple fut suivi par les évêques de Grèce, de Crète et de Macédoine ; quatre évêques égyptiens même les imitèrent. Dioscore restait presque seul.
Puis vint la constatation des violences exercées par Dioscore au concile d’Éphèse, et, pendant que le concile était rassemblé, quatre Égyptiens, dont un prêtre et deux diacres, lésés tous quatre par Dioscore, apportèrent contre lui les accusations les plus graves concernant son caractère, sa conduite et ses mœurs. Avant la présentation de leur requête, Eusèbe de Dorylée avait demandé que Dioscore fût condamné et puni pour avoir soutenu la doctrine d’Eutychès, que celle-ci fût anathématisée, et que l’assemblée d’Éphèse fût rayée de la liste des conciles. Il insista pour que l’accusé comparût, afin de se défendre. Mais malgré trois sommations, Dioscore refusa, bien que dans la dernière on lui eût dit les accusations dont il était l’objet de la part des quatre Égyptiens, et que, pour l’honneur de l’Église, il devait y répondre.
Les légats du pape ayant alors résumé ce qui était à sa charge, le concile prononça sa condamnation, le dépouillant de sa charge et dignité d’évêque et de tout ministère sacerdotal. La condamnation fut signifiée au condamné, et la sentence rendue publique. Mais Dioscore ayant déclaré qu’il se souciait peu du concile, et se vantant de rependre bientôt sa place d’évêque, l’empereur l’exila à Gangres, en Paphlagonie. Le concile avait aussi décidé, et l’empereur avait confirmé, la question de doctrine. Ce dernier avait déclaré aussi qu’il agirait contre ceux qui n’obéiraient pas aux décrets du concile. Nous voyons par là et par tout ce qui précède, combien l’Église s’était asservie au pouvoir séculier. Elle habitait dans le monde, où Satan a son trône (Apocalypse 2:13), bien qu’elle retînt encore la vérité touchant la Personne du Fils de Dieu.
Après nous être occupés de ce qui se passait dans l’Église aux extrémités de l’Europe occidentale, en Irlande, en Écosse et dans la Grande Bretagne, nous reviendrons en Orient. En Occident, la puissance de l’Église romaine allait toujours croissant, sous la main de papes habiles et énergiques ; en Orient, ce que l’on voit tristement dominer, ce sont les discussions religieuses sans fin, attisées par les ambitions et les rivalités des évêques des grandes villes de Constantinople, d’Antioche et d’Alexandrie, produisant des hérésies et des divisions, et amenant souvent des conflits sanglants, parce qu’au lieu de l’épée de l’Esprit, la parole de Dieu, on se servait d’armes charnelles, en cherchant un appui auprès des empereurs.
Ces discussions et ces hérésies portaient le plus souvent sur la Personne adorable du Seigneur. Satan est l’ennemi de Christ qui est venu détruire sa puissance, et tous ses efforts et ses ruses tendent à attaquer et détruire ce que la parole de Dieu nous enseigne touchant Jésus, le Fils de Dieu. Il sait bien qu’avec Christ tout tombe, et qu’en s’attaquant au Rédempteur, on diminue ou l’on annule la rédemption. Pour arriver à ses fins, Satan induit les hommes à raisonner sur la Personne du Seigneur, qui, nous le savons par les Écritures, est à la fois vrai Dieu et vrai homme : Dieu sur toutes choses béni éternellement, et manifesté en chair. « La Parole devint chair », nous dit Jean, et « la Parole était Dieu » (Romains 9:5 ; 1 Timothée 3:16 ; Jean 1:1, 14). Qui peut expliquer cela ? Personne ; c’est un mystère insondable, car, nous dit Jésus lui-même : « Personne ne connaît le Fils, si ce n’est le Père » (Matthieu 11:27).
Lorsque des difficultés touchant la doctrine surgissaient, on convoquait, il est vrai, des conciles, ou assemblées d’évêques, mais ils étaient ordinairement sous la main des empereurs et influencés par lui ou par ceux qui exerçaient le pouvoir ; souvent aussi, ils étaient le théâtre de violences et de jugements iniques, comme nous l’avons vu dans le cas de Chrysostôme. Quelques conciles cependant maintinrent la vérité, comme, par exemple, celui de Nicée qui affirma la divinité de Christ conformément aux Écritures. Mais lorsqu’on a la parole de Dieu et qu’on la reçoit avec simplicité, qu’est-il besoin de conciles ? On ne peut admettre d’eux que ce qui est conforme aux Écritures. Or celles-ci nous montrent clairement d’une part que Jésus était réellement un homme. Il fut petit enfant, né de Marie ; il grandit, croissant en stature ainsi qu’en sagesse, et il devint un homme fait. Il mangeait et buvait, il était fatigué et se reposait, il dormait ; il se réjouissait et s’affligeait, il souffrait dans son corps et dans son âme. Et ce qui est si précieux pour nous, il avait toutes les affections et les sentiments d’un homme, mais d’un homme parfait, sans péché. Mais en même temps, il était réellement Dieu, ressuscitant les morts par une parole, calmant les vents et les flots en disant : « Taisez-vous », et opérant par lui-même bien d’autres miracles que la simple puissance de l’homme ne pouvait accomplir. Les prophètes et les apôtres en ont fait, mais c’était au nom de l’Éternel ou au nom de Lui, Jésus de Nazareth, tandis que Lui les faisait par sa propre divine puissance. La voix de Dieu le proclame son Fils bien-aimé ; par Lui les mondes ont été créés et subsistent par Lui ; les anges de Dieu l’adorent ; il est le Vivant, Celui qui vit aux siècles des siècles. À Lui appartient toute gloire. Voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne, et ce qu’il nous faut retenir.
Une grande controverse surgit en Orient au sujet de la Personne du Seigneur. Vingt et un ans après la mort de Chrysostôme, le siège épiscopal de Constantinople vint à vaquer. L’empereur Théodose II appela, pour occuper cette place importante, un prêtre de l’église d’Antioche, nommé Nestorius, qu’on lui disait être aussi distingué par ses talents que par sa piété. Mais avec des qualités réelles, Nestorius était hautain et intolérant. Dès qu’il fut établi évêque de Constantinople, il se mit à persécuter violemment tous ceux qui était en dehors de la communion de l’Église, tels que les Ariens et d’autres, même ceux qui n’étaient séparés que sur un point insignifiant, par exemple l’époque de la célébration de la fête de Pâques. Dans un discours à l’empereur, Nestorius avait été jusqu’à dire : « Empereur, donne-moi une terre purgée d’hérétiques et je te donnerai le ciel ; combats avec moi les hérétiques et je t’aiderai à vaincre les Perses ». Paroles bien étranges et orgueilleuses, n’est-ce pas, dans la bouche d’un faible mortel et d’un conducteur d’âmes ? Pauvre Nestorius ! il ne se doutait guère qu’il allait bientôt être lui-même accusé d’hérésie et condamné.
Déjà alors on commençait à entourer Marie, la mère du Sauveur, d’une sorte de vénération superstitieuse. On lui consacrait des églises, on l’invoquait en lui donnant le nom de « mère de Dieu ». On prétendait qu’elle était morte à Éphèse, on y montrait son tombeau qui attirait une foule de pèlerins, et c’était pour les Éphésiens une source d’abondants revenus. Elle était ainsi regardée, non seulement comme la patronne, mais comme la nourricière d’Éphèse. C’était elle, disait-on, qui faisait pleuvoir sur la ville et sur l’Asie entière toute sorte de prospérités. Aussi avait-on érigé une riche basilique sous son nom. Cela ne nous rappelle-t-il pas l’histoire rapportée au chapitre 19 des Actes ? C’était environ 400 ans auparavant que, dans cette même ville d’Éphèse, s’élevait le temple magnifique de la grande déesse Diane que l’Asie entière révérait, à laquelle la ville des Éphésiens était consacrée, et qui était aussi une source de richesses pour les habitants. Paul, le serviteur de Dieu, avait annoncé Christ, et le culte de Diane et l’idolâtrie étaient tombés, et maintenant une nouvelle idolâtrie, bien pire que la première, avait remplacé celle-ci. Ce n’était pas seulement la mère de Jésus dont on faisait une sorte de divinité, une reine du ciel, mais on regarda bientôt les saints, — les apôtres, les martyrs — comme des sortes de médiateurs entre Dieu et les hommes, on éleva des églises placées sous leur invocation, on leur adressa des prières et on vénéra leurs reliques auxquelles on attribua même le pouvoir de faire des miracles. Et ce mal terrible continua d’envahir de plus en plus l’Église. Oh ! quelle puissance d’aveuglement Satan exerce sur le cœur de l’homme !
Mais revenons à Nestorius. C’était donc un usage commun, déjà dans le 4° siècle, de donner à Marie le nom de « mère de Dieu », expression qui ne se trouve nulle part dans l’Écriture, bien que nous sachions que de Marie « est né Jésus, qui est appelé Christ » (Matthieu 1:16), et que « le Christ est sur toutes choses Dieu béni éternellement » (Romains 9:5). Or dans un discours prononcé à Constantinople, Anastase, prêtre que Nestorius avait amené d’Antioche, s’éleva contre le titre de « mère de Dieu » attribué à Marie, et Nestorius l’approuva. Cela causa un grand tumulte dans l’église de Constantinople où l’on vénérait Marie non moins qu’à Éphèse ; on regarda ces paroles comme un outrage fait à la mère du Seigneur. Nestorius voulut expliquer dans un discours pourquoi il ne pouvait admettre que le titre de « mère de Dieu » convînt à Marie. Mais il le fit de telle manière que l’on pouvait conclure de ses paroles qu’il enseignait que, de même qu’il y a en Christ deux natures, la divine et l’humaine, il y avait aussi deux personnes, l’homme, fils de Marie, et le Fils de Dieu. Il divisait ainsi la Personne adorable du Seigneur que nous voyons toujours une — un seul Christ. Plusieurs expressions dont il se servit montrent bien que telle était sa pensée, et il alla jusqu’à l’exprimer d’une manière tout à fait irrespectueuse, disant : « Je n’admettrai jamais un Dieu de deux mois, un Dieu de trois mois ; jamais je n’adorerai comme tel un enfant qui a su.. le lait de sa mère, et qui s’est enfui en Égypte pour sauver sa vie ». C’était un vrai blasphème, et cela nous montre jusqu’où l’on peut être entraîné lorsqu’on veut raisonner sur ce qui est infini, hors de notre portée, et connu de Dieu seul. Le petit enfant dans la crèche, celui que les anges exaltaient, que les bergers et les mages adoraient, que Siméon prenait dans ses bras, et qui, en effet, fut conduit avec sa mère par Joseph en Égypte, était bien le Fils de Dieu, Dieu lui-même qui, par un mystère insondable, le mystère de l’amour, s’est ainsi abaissé jusqu’à nous.
L’évêque d’Alexandrie, Cyrille, attaqua vivement Nestorius et ses doctrines, mais en le faisant il tomba lui-même dans des erreurs capitales, qui furent signalées par Jean, évêque d’Antioche. Jean cependant, bien qu’ami de Nestorius, n’admettait point ce que l’on condamnait chez celui-ci, et lui avait même écrit pour lui faire sentir qu’il avait tort. D’un autre côté, Cyrille avait su gagner à sa cause l’évêque de Rome, Célestin. Pour mettre un terme à ces disputes, l’empereur convoqua un concile général à Éphèse, en l’an 431. On aurait dû attendre que tous les évêques convoqués fussent réunis, mais Cyrille, par ses intrigues, sut si bien faire que le concile s’ouvrit avant l’arrivée de Jean et des évêques qui étaient avec lui, et que Cyrille lui-même, bien qu’accusé, le présida. La conséquence en fut la condamnation et la déposition de Nestorius. Mais alors arrivèrent Jean et les évêques syriens qui se constituèrent aussi en concile, déclarèrent que l’assemblée réunie par Cyrille était un faux concile, et l’excommunièrent. On voit quelle étrange confusion régnait parmi ceux qui s’intitulaient les conducteurs de l’Église. Mais la lutte n’était pas finie. On porta la chose devant l’empereur que Cyrille réussit à convaincre de la justice de sa cause et de l’intégrité du concile d’Éphèse qu’il avait présidé. Le faible empereur finit par l’approuver, et ainsi la déposition de Nestorius fut confirmée. Ses plus fidèles amis à la cour l’avaient abandonné, et Jean d’Antioche lui-même demanda son éloignement.
Nestorius s’était d’abord retiré dans le monastère où il avait passé sa jeunesse, situé à peu de distance d’Antioche. Mais là, il ne sut pas rester tranquille. Il y publia quelques livres et, par ses prédications éloquentes, il attirait beaucoup de personnes distinguées de la ville d’Antioche. Ses ennemis s’en émurent. Poussé par eux, le pape Célestin demanda à l’empereur que l’ennemi de la Vierge et de son Fils fût retranché de la société des hommes qu’il s’obstinait à perdre, et il pressa les évêques de se joindre à sa demande ! L’empereur l’exila à Pétra, en Arabie, et proscrivit également ses amis et ses partisans. Les ennemis de Nestorius trouvèrent que le lieu de son exil n’était pas encore assez éloigné, et il fut envoyé en Égypte, dans l’oasis d’Ibis, où l’on déportait les grands criminels d’État. C’était un endroit entouré d’un vaste océan de sables et d’où l’on ne pouvait s’échapper sans risquer sa vie. Là Nestorius se mit à écrire sa biographie, ouvrage qui ne nous est point parvenu. Fait prisonnier par une troupe d’Arabes nomades qui s’étaient jetés sur l’oasis pour la piller, il fut laissé par eux et put gagner Panopolis, petite ville de la province de Thèbes. Le gouverneur de Thèbes ne permit pas que l’infortuné Nestorius restât là. Il donna l’ordre de le transférer à Éléphantine sur la frontière d’Éthiopie. Mais accablé par l’âge et la fatigue, il tomba de cheval et se blessa grièvement. Ramené à Panopolis, il y mourut en l’an 440.
Un certain nombre d’évêques n’avaient pu accepter les décisions du concile d’Éphèse concernant la déposition de Nestorius. On les y força de la part de l’empereur, en ne leur laissant d’autre alternative que de souscrire ou d’être déclarés Nestoriens, et comme tels, poursuivis, déposés, exilés ou envoyés aux mines. Tel était le résultat de l’association de l’Église avec l’État ; celle-là se servant de l’épée du prince pour persécuter ceux qui ne se soumettaient pas à elle ! La plupart des évêques cédèrent, mais quelques-uns restèrent fermes. L’un d’eux, nommé Alexandre, évêque d’Hiérapolis, d’un âge très avancé, montra une fermeté inébranlable. À des amis, qui le sollicitaient de signer comme d’autres, il répondit : « Tenez-vous en repos. Je ne me soucie point de ce que font les autres, mais quand tous les morts ressusciteraient et nommeraient piété l’abomination d’Égypte (il voulait dire la conduite de Cyrille d’Alexandrie), je ne les croirais pas dignes de foi ». Il rompit avec ses amis, et sommé par le gouverneur de souscrire ou de quitter la ville, il sortit. Mais aussitôt toute la ville ferma ses églises. Le gouvernement fit enfoncer les portes et célébrer le culte sous la protection des soldats ! Quant au vieil évêque, il fut condamné au travail des mines en Égypte et y mourut. Voilà comment de soi-disant chrétiens agissaient envers ceux qui se réclamaient du nom du même Seigneur.
Fomentée par Cyrille, la persécution contre les Nestoriens sévit de toutes parts. Qu’arriva-t-il ? Ce fut un moyen dont Dieu se servit pour propager, non les fausses doctrines attribuées à Nestorius, mais le christianisme même. Ceux que l’on appela Nestoriens, parce qu’ils n’avaient pas voulu souscrire aux lois d’un concile qu’ils ne pouvaient reconnaître, et qui pour cela étaient violemment persécutés, se retirèrent en Perse. Ils y furent bien accueillis et protégés par les rois de cette contrée, par haine de l’empire grec. Ils y fondèrent une église indépendante de celle de Constantinople, et à laquelle un nommé Barsumas, évêque de Nisibe en Mésopotamie, donna une constitution.
Les Nestoriens se répandirent dans les contrées traversées par l’Euphrate, et animés d’un grand zèle missionnaire, ils évangélisèrent en Arabie, en Perse, dans l’Inde et jusqu’en Chine, où existaient encore quelques-unes de leurs églises dans le 13° siècle ; mais dans le 16° siècle, il n’en restait plus trace. Les descendants des Nestoriens fixés en Perse, subsistent encore. Nous en dirons quelques mots.
Au nord de la Perse, à la base de hautes montagnes couvertes de neige, est une vaste plaine d’une grande beauté. C’est la province d’Urmiah ou Oroomiah, et c’est là que demeurent les chrétiens nestoriens. Cette plaine, bornée par des montagnes escarpées, est couverte de villages entourés d’arbres verdoyants et de champs de blé. Au-delà se trouve le lac Urmiah tout parsemé d’îles. En différents points de la plaine se voient des espèces de buttes formées de cendres, recouvertes d’une mince couche de terre. On suppose que ce sont les endroits où brûlait sans cesse le feu sacré et où les prêtres Parsis se prosternaient devant le soleil levant (*).
(*) Les Parsis, descendants des anciens Perses et disciples de Zoroastre, étaient des adorateurs du feu, dont le soleil est pour eux le type le plus pur, en même temps qu’il est l’image de la divinité. Les Mahométans les nomment aussi Guèbres ou infidèles. Il en reste un petit nombre dans la province de Bombay.
Les Nestoriens sont un peuple intéressant à bien des égards. Leur langue, le syriaque, se rapproche beaucoup de l’hébreu, et était parlée plusieurs siècles avant la naissance du Sauveur. Elle est presque la même que celle qui était généralement employée en Palestine aux jours du Seigneur, et dont il se servait pour converser avec ses disciples et instruire le peuple. C’est dans cette même langue que, sur la croix, il s’écria : « Éloï ! Éloï ! lama sabachthani ? Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »
Les Nestoriens étaient nombreux et poursuivaient en paix leurs occupations comme agriculteurs et commerçants, ainsi que leurs travaux missionnaires, lorsque eut lieu l’invasion islamique en Perse, vers le milieu du septième siècle. Non seulement le culte du feu disparut de la Perse, mais les Nestoriens furent violemment persécutés par les vainqueurs. Ils n’avaient d’autre alternative — comme les malheureux Arméniens de naguère — que le Koran ou la mort. Leur nombre fondit comme la neige au printemps, et actuellement on n’en compte plus qu’environ 400000. En même temps, ils tombèrent peu à peu dans l’ignorance, la démoralisation et la superstition. Cependant, malgré la profonde déchéance de leur église, les Nestoriens sont restés, quant à la doctrine, plus rapprochés de la Bible que les catholiques romains, les Grecs et les Arméniens. « Je n’ai jamais rencontré », dit un missionnaire, « un Nestorien qui niât la suprême autorité de la parole de Dieu ». Ils abhorrent le culte des images, et n’admettent point la confession auriculaire et l’absolution donnée par le prêtre. Ils ne connaissent ni la messe, ni l’adoration de l’hostie. Ils rejettent, comme mauvaises et antiscripturaires, les doctrines de la régénération baptismale (*1), de la pénitence (*2), du purgatoire (*3). Ils croient en Christ comme en une seule Personne, à la fois vrai Dieu et vrai homme. Ils reçoivent avec joie ceux qui viennent à eux, au nom du Christ Jésus. Les missionnaires américains, venus parmi eux, ont été bien reçus et ont travaillé à répandre les vérités scripturaires, en les exhortant, en même temps, à mener une vie humble et sainte.
(*1) Doctrine qui prétend que le baptême d’eau opère dans l’âme la nouvelle naissance ou la régénération.
(*2) La pénitence, ce sont des actes imposés par le prêtre comme réparation ou châtiment des fautes commises.
(*3) Le purgatoire est, selon les catholiques romains, un lieu intermédiaire entre le ciel et l’enfer, où le feu achève de purifier l’âme qui ne l’a pas été complètement ici-bas.
Le premier missionnaire qui vint au milieu d’eux, trouva cette ancienne église en ruines et comme renversée dans la poussière. Le peuple était plongé dans la plus grossière ignorance. Il n’y avait point d’écoles, et à peine dans un village une demi-douzaine d’habitants savaient-ils lire. Ils n’avaient d’ailleurs pour livres que de rares manuscrits, dont le prix était très élevé. Le vol, parmi eux, était général et mentir une habitude invétérée. « Nous mentons tous », disaient-ils ; « comment pourrions-nous faire nos affaires, si nous ne mentions pas ? ». Ils buvaient du vin comme de l’eau, et quant à la religion, tout en conservant une certaine orthodoxie, elle n’était pour eux qu’une affaire de forme et d’apparence.
Maintenant il y a des écoles dans un grand nombre de villages, et l’on a fondé des établissements pour élever et former des jeunes gens des deux sexes capables d’instruire le peuple, et ainsi de réparer des maux accumulés durant tant de générations. Les Saintes Écritures ont été imprimées dans leur entier, tant dans l’ancienne langue des Nestoriens que dans celle qu’ils parlent actuellement.
« L’influence des Saintes Écritures sur nos élèves et dans les collèges », dit un missionnaire, « puis sur les centaines de Nestoriens adultes qui apprennent à lire dans les écoles du dimanche, cette influence s’exerçant dans leurs humbles demeures, et, par tous ces lecteurs, sur la masse du peuple, est incalculable ». Plusieurs sont comme des gens qui se réveillent d’un profond sommeil, et se demandent : « Comment se fait-il que nous ayons été gardés si longtemps dans l’ignorance ? ». Et les prêtres répondent : « Nous-mêmes, nous sommes restés jusqu’à ce jour, comme morts dans nos fautes et dans nos péchés, et notre péché est plus grand que le vôtre pour vous avoir caché si longtemps la lumière ». Les missionnaires américains ont à lutter contre des missionnaires catholiques romains qui voudraient rattacher à Rome l’église nestorienne. D’un autre côté, il semble qu’un certain nombre de Nestoriens se tournent du côté de l’Église grecque, afin d’être protégés contre les musulmans de Perse (*).
(*) Aujourd’hui, après avoir été fortement et même tragiquement éprouvés par les répercussions des deux guerres mondiales, les communautés nestoriennes ne subsistent qu’en très petits groupes dispersés en Iran, Irak, Turquie, Syrie, Liban, Inde, Arménie et aux États-Unis. Elles ne comptent pas 80000 personnes.
5.12 - Eutychès et les Arméniens
5.12.1 - Eutychès
Peu après la mort de Nestorius, l’Église d’Orient fut de nouveau troublée à l’occasion de doctrines tenues par un moine nommé Eutychès, archimandrite ou supérieur d’un couvent de trois cents moines, près de Constantinople. Eutychès s’était fortement opposé à Nestorius quand celui-ci fut condamné, mais lui-même tomba dans d’autres erreurs touchant la Personne adorable du Seigneur. Il disait bien que Christ, né de la vierge Marie, était vrai Dieu et vrai homme, mais que le corps de Jésus n’était pas de la même substance que le nôtre, contrairement à l’Écriture qui nous dit que Christ a participé au sang et à la chair (Hébreux 2:14). De plus, il enseignait que les deux natures divine et humaine du Seigneur n’en formaient qu’une, la nature humaine étant absorbée par la nature divine ou confondue avec elle. Nous pouvons voir par là combien l’on s’égare quand on veut raisonner sur ce qui est au dessus de notre conception, et expliquer ce que Dieu ne nous explique pas. Combien la parole de Dieu est plus simple ! Si nous nous tenons comme de petits enfants à ce qu’elle dit, nous ne courrons pas risque de faire fausse route.
Eutychès avait pour ami un nommé Eusèbe, évêque de Dorylée en Phrygie qui, avant d’occuper cette charge, s’était fortement prononcé contre Nestorius. Devenu évêque, il eut à venir à Constantinople pour les affaires de son église, et alla voir Eutychès. En s’entretenant avec lui, sa surprise fut grande d’entendre quelles doctrines il professait. Eusèbe eut beau les combattre, Eutychès ne voulut rien céder. Or la même année, Flavien, patriarche de Constantinople, réunit un synode pour régler certaines questions. Eusèbe s’y trouva et y accusa Eutychès de soutenir des doctrines contraires à la vraie foi. Le synode envoya à Eutychès des messagers pour le sommer de venir se défendre et exposer ses vues. Deux fois il refusa ; à la troisième sommation, il promit de venir. Il arriva en effet accompagné d’une troupe de moines, et escorté par des soldats ; en même temps se présentait aussi un envoyé de l’empereur avec une lettre demandant qu’il assistât aux séances.
Après une longue discussion où Eutychès chercha, par un semblant d’humilité et par des subtilités, à échapper à ceux qui le pressaient d’exposer sa foi, il fut à la fin obligé de confesser son erreur tout en la maintenant. Or cette erreur qui consiste à dire que Christ n’a pas été réellement un homme comme nous, à part le péché, c’est anéantir la rédemption. Eutychès fut condamné comme ayant blasphémé Christ, et fut exclu de la prêtrise, de la communion, et déposé de sa place d’archimandrite de son monastère. Trente évêques et vingt-trois archimandrites signèrent sa condamnation.
Eutychès sortit du synode en disant qu’il en appellerait à l’évêque de Rome, ce qu’il fit, en effet. Flavien fit répandre partout le décret qui condamnait Eutychès, demandant que chacun s’y soumît. Mais un grand nombre, surtout des moines, partisans d’Eutychès, refusèrent, et un grand trouble s’ensuivit dans l’Église.
Eutychès avait pour ami, à la cour impériale, le chef des eunuques Chrysaphius, dont il avait été le parrain à son baptême, et qui avait une grande influence sur l’empereur, le faible Théodose II. Chrysaphius, qui était avare et cherchait par toutes sortes de moyens à accroître ses richesses, détestait Flavien, parce que celui-ci n’avait pas voulu prêter les mains à une spoliation des biens de l’Église, et de plus avait refusé son concours à un complot tramé par Chrysaphius pour faire entrer dans un couvent Pulchérie, la sœur de l’empereur, dont il redoutait l’influence. C’est à cet ennemi de Flavien qu’Eutychès s’adressa et il réussit à faire convoquer par l’empereur un concile où il porterait sa cause. L’empereur était d’ailleurs gagné à ses vues.
Le concile se réunit à Éphèse en 449. Il comptait cent vingt-huit évêques présents, et le pape de Rome, Léon Ier, y avait envoyé, pour l’y représenter, trois légats porteurs d’une lettre où il exposait la foi de l’Église romaine touchant le mystère de l’incarnation du Fils de Dieu. Cette lettre était dirigée contre l’hérésie d’Eutychès. En résumé, elle établit qu’en Christ il y a deux natures, la divine et l’humaine, unies sans confusion, sans changement et sans séparation dans un seul et même Christ. Et Léon ajoute que l’erreur touchant la nature du corps du Seigneur anéantit sa passion et l’efficacité de son sacrifice. Il cite à ce propos le passage de 1 Jean 4:2-3: « Tout esprit qui confesse Jésus Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus Christ venu en chair n’est pas de Dieu ». On est heureux de voir maintenir, dans ces temps où tant d’erreurs s’étaient glissées dans l’Église, la vérité quant à la Personne du Fils de Dieu.
L’empereur avait désigné Dioscore, patriarche d’Alexandrie, pour présider le concile. Comme les autres patriarches, il devait amener avec lui dix métropolitains et dix autres évêques. Il les choisit selon ses vues qui étaient celles d’Eutychès. Dioscore était un homme qui, pour la violence et la rapacité, marchait sur les traces de son prédécesseur Théophile que nous avons vu dans l’histoire de Chrysostôme ; ses mœurs étaient à l’avenant. Mais il était soutenu par Chrysaphius et ne redoutait rien. Tout fut disposé d’avance pour disculper Eutychès et faire condamner Flavien. Théodose ordonna que les évêques qui avaient figuré comme juges au synode de Constantinople seraient exclus de la discussion et du vote. Eusèbe de Dorylée reçut la défense de quitter le territoire de son église, à moins que le concile ne l’appelât. Ainsi sur 128 évêques, 42 étaient privés du droit de parler et de voter. À ceux-là Dioscore en joignit quinze autres des opinions desquels il n’était pas sûr. Deux officiers de l’empereur avaient droit de prendre part aux discussions. De plus Théodose donna le droit de voter à un archimandrite syrien, nommé Barsumas, moine grossier qui, à la tête de mille moines aussi sauvages et barbares que lui et armés d’énormes bâtons, donnait la chasse aux Nestoriens, ou a ceux qui lui paraissaient tels, saccageait les églises, brûlait les monastères, tuait ou chassait les évêques qu’il ne croyait pas orthodoxes.
Telle était la composition du concile, et tels les auxiliaires de Dioscore, sans compter les parabolans (*) qu’il avait amenés d’Égypte, et qui, au besoin, étaient prêts à agir de leurs bras pour soutenir leur évêque.
(*) Hommes de peine et infirmiers placés sous les ordres immédiats de l’évêque.
Le concile s’ouvrit. Le premier légat du pape prit d’abord la parole pour demander qu’avant tout on lût la lettre de Léon. Mais comme on savait bien quelles étaient les pensées du pape touchant les doctrines d’Eutychès, on trouva moyen, malgré les instances réitérées des légats, de la laisser de côté. Alors Eutychès fut introduit, et il se présenta, non plus avec cette apparence d’humilité qu’il avait apportée au synode de Constantinople, mais la tête haute, comme sûr de son triomphe. Il portait à la main un rouleau dont il demanda la lecture et qui commençait par la transcription du symbole de Nicée. Il y déclarait qu’il vivrait et mourrait dans ces sentiments, et qu’il anathématisait tous les hérétiques. Puis il porta, contre Eusèbe de Dorylée et Flavien, une accusation fondée sur la manière dont il avait été traité et condamné dans le synode.
Après cette lecture, Flavien se leva et dit : « Il faudrait maintenant entendre Eusèbe ». Mais l’officier de l’empereur dit : « Ce n’est pas nécessaire ; l’empereur l’a exclu. Vous êtes réunis pour voir s’il faut casser ou confirmer le jugement rendu, et non pour recommencer le procès ».
Dioscore proposa alors qu’on lût les actes du synode de Constantinople. Tous les évêques l’approuvèrent, sauf les légats du pape qui insistèrent encore pour que d’abord sa lettre fût lue. Eutychès, craignant qu’on ne le leur accordât, se hâta de récuser les légats, parce que, disait-il, ils logeaient chez Flavien et avaient reçu de lui des services. Cependant Dioscore dit que, pour l’ordre, on devait d’abord lire les actes du synode, et qu’ensuite on lirait la lettre du pape, ce qui n’eut pas lieu.
Dans le synode de Constantinople, Eusèbe, l’accusateur d’Eutychès, avait pressé celui-ci de confesser la vérité touchant la Personne de Christ ; mais quand, dans la lecture des actes, on en vint à l’endroit où cela était rapporté (*), un grand nombre d’évêques gagnés à la cause d’Eutychès, s’écrièrent : « Qu’on chasse, qu’on brûle Eusèbe ! Qu’Eusèbe soit brûlé vif ; qu’il soit coupé en morceaux ! » Tel était l’esprit qui animait ceux qui se disaient les serviteurs de Christ, de Celui qui était doux et humble de cœur et ne voulait pas faire descendre le feu du ciel sur ses ennemis ! Dioscore mit alors aux voix cette proposition : « Approuvez-vous la profession de foi d’Eutychès ou celle d’Eusèbe ? ». Au milieu des clameurs, la doctrine d’Eutychès fut acceptée, et lui-même rétabli dans son rang et rendu à son monastère. Les légats du pape s’abstinrent, mais Eutychès avait gain de cause et se retira triomphant.
(*) Dans les synodes ou conciles, il y avait toujours plusieurs écrivains nommés notaires qui prenaient note de ce qui était dit ou fait. Les séances terminées, ils comparaient leurs notes et rédigeaient les actes du conciles ou du synode que l’on conservait soigneusement.
Les moines du monastère d’Eutychès que Flavien avait exclus de la communion, parce qu’ils avaient soutenu leur supérieur après sa condamnation, envoyèrent une députation au concile. Ils lui adressaient une requête contre Flavien qu’ils accusaient, non seulement d’avoir abusé de son pouvoir à leur égard, mais d’avoir mis à son profit le séquestre sur les biens de la communauté : accusation tout à fait fausse. Les moines déclarèrent aussi que, quant à leur foi, elle était la même que celle de leur supérieur. Dioscore, ni personne dans le concile, ne s’enquirent si les accusations contre Flavien étaient justifiées, mais, passant outre, ils rétablirent les moines dans leurs fonctions. C’était un nouveau triomphe sur Flavien ; mais ce n’était pas tout : il fallait le perdre et Dioscore en trouva le moyen.
Dans un précédent concile tenu à Éphèse, celui où Nestorius avait été condamné, on avait interdit toute composition ou publication de symboles (ou professions de foi) changeant quelque chose à celui de Nicée. Cela ne voulait pas dire qu’on ne pût expliquer les vérités que contenaient le symbole de Nicée. Or Flavien, dans le synode de Constantinople, avait fait brièvement une confession de foi où il reconnaissait Jésus, fils de Marie, comme vrai Dieu et vrai homme en une Personne. Dioscore prétendit qu’en faisant cela, Flavien avait contrevenu au décret du concile d’Éphèse, et avait mérité, ainsi qu’Eusèbe, d’être déposé et privé de toute dignité épiscopale et sacerdotale. Et il demanda que les évêques approuvassent par leur signature cette sentence. Alors Flavien se levant, dit : « J’en appelle », et il remit à l’un des légats son recours au pape et aux évêques d’Occident. Puis un autre légat, au nom de l’Église romaine, prononça son opposition à la sentence rendue par Dioscore. À ce moment quatre évêques vinrent se jeter aux genoux de celui-ci, et le supplièrent de réfléchir à ce qu’il faisait, Flavien, disaient-ils, n’ayant pas mérité la déposition. Mais Dioscore les repoussa en disant qu’il avait fait son devoir. Puis comme les évêques insistaient et que d’autres accouraient pour savoir ce qui se passait, il se leva irrité, et fit appel aux officiers de l’empereur. Ceux-ci croyant Dioscore en danger, firent entrer les soldats qui, les uns l’épée nue, les autres portant des chaînes comme s’il s’agissait de lier des malfaiteurs, se précipitèrent dans l’église et écartèrent brutalement les évêques qui continuaient à supplier Dioscore.
Le tumulte fut alors à son comble. Des gens du peuple, les parabolans de Dioscore, les moines de Barsumas avec leurs massues, s’étaient aussi répandus dans l’église, poussant des cris féroces : « Il faut chasser, il faut tuer ceux qui n’obéissent pas à Dioscore ». Quelle scène dans un lieu consacré au culte divin, et parmi des serviteurs du Dieu de paix !
Les évêques effrayés fuyaient dans tous les coins, mais on avait fermé les portes afin de recueillir les voix. Les évêques d’Égypte, joints aux moines et aux parabolans, menaçaient de la déposition et battaient ceux qui faisaient mine de réclamer. Dioscore, debout sur son estrade, annonça qu’on allait recueillir les opinions. « Et si quelqu’un refuse d’opiner », dit-il, « c’est à moi qu’il aura affaire, et l’empereur le saura ». Quelle arrogance chez un homme qui se disait ministre de Christ ! Ils opinèrent donc.
Mais il fallait encore signer la sentence, et, dans le tumulte, les notaires n’avaient pu rédiger le procès verbal de la séance. Il fut résolu par Dioscore qu’on signerait en blanc avec ces mots : « J’ai jugé et j’ai souscrit ». Et alors Dioscore, accompagné de deux hommes à l’air menaçant, alla de banc en banc recueillir les signatures. Saisis de terreur, les évêques signèrent, ceux qui essayaient de protester étant menacés et battus.
La dernière et plus affreuse scène de ce procès inique reste à dire. Flavien s’était retiré dans un coin de la nef, attendant le moment de sortir. Dioscore l’aperçut et courut vers lui en l’insultant ; puis il le frappa du poing au visage, et deux de ses diacres, saisissant le malheureux évêque par le milieu du corps, le jetèrent par terre. Dioscore le foula aux pieds, lui frappant du talon les côtes et la poitrine, tandis que les moines de Barsumas, excités par leur maître qui criait : « Tue, tue ! », frappaient Flavien de leurs bâtons et le piétinaient sous leurs sandales.
Flavien traîné dehors par les soldats, fut jeté demi-mort dans un cachot. On devait le conduire en exil, mais il mourut en route trois jours après sa condamnation, par suite des mauvais traitements qu’il avait essuyés. Tel fut le triomphe d’Eutychès et de Dioscore. Celui-ci se hâta de se rendre à Constantinople pour y installer un nouveau patriarche. En s’y rendant, il s’arrêta à Nicée, et formant un synode des évêques égyptiens qui l’accompagnaient, il excommunia le pape Léon comme hérétique. Les légats de celui-ci avaient réussi à s’enfuir et avaient porté à Rome le recours de Flavien.
Mais ce qui s’était passé remplit d’horreur la chrétienté ; on flétrit ce concile sous le nom de Brigandage d’Éphèse, et il ne fut pas inscrit au nombre des conciles reconnus. Cependant Chrysaphius fit approuver par l’empereur les actes de ce concile de brigands, et une loi de Théodose vint ordonner la persécution contre ceux qui ne les accepteraient pas. Mais bientôt les choses changèrent de face. Un an après la mort de Flavien, l’empereur Théodose mourut des suites d’une chute de cheval. Sa sœur Pulchérie qui avait soutenu Flavien, lui succéda à l’empire et y associa Marcien, qu’elle épousa. C’était un vieux soldat, franc, juste et ferme, qui défendit l’empire contre les Barbares et y rétablit l’ordre. Il partageait les vues de Pulchérie à l’égard d’Eutychès, qu’elle condamnait. Il suspendit les persécutions, abrogea l’obligation de reconnaître les actes du faux concile ; les évêques exilés furent rappelés, ceux qui avaient été déposés furent rétablis, et Eutychès fut chassé de son monastère. Chrysaphius fut mis à mort.
Léon de Rome avait d’abord demandé qu’un nouveau concile général fût convoqué à Rome, mais l’empereur refusa, et il fut ensuite convenu qu’il se réunirait à Nicée sous la présidence des légats du pape. Dioscore ne devait pas y siéger comme évêque. Avant qu’il fût réuni, les restes de Flavien furent transportés solennellement à Constantinople, et il fut enseveli auprès de Chrysostôme, mort comme lui victime de l’inimitié des évêques.
L’empereur transféra ensuite le concile à Chalcédoine, afin qu’il fût plus près de Constantinople, et que lui pût y assister plus facilement. Ce concile fut le plus nombreux qu’il y eût encore eu. Plus de cinq cents évêques ou autres prélats y siégèrent. D’un côté se rangèrent les évêques d’Égypte et ceux qui soutenaient Dioscore ; de l’autre, les évêques d’Orient, du Pont, de l’Asie et de la Cappadoce. Les légats du pape déclarèrent qu’ils ne pouvaient siéger avec Dioscore, et Eusèbe de Dorylée se porta son accusateur. Mais bientôt des scènes violentes se produisirent à l’entrée de Théodoret de Cyr (Kars) qui avait été exclu du faux concile d’Éphèse sans autre raison que son opposition à Eutychès. En le voyant paraître, les partisans de Dioscore se mirent à pousser des clameurs : « Hors d’ici, l’ennemi de Dieu », disaient-ils. Les évêques d’Orient répondaient : « Hors d’ici, les hérétiques, les meurtriers de Flavien ». Le tumulte augmentant, le chef des magistrats représentant l’empereur se leva et dit : « Ces cris sont indignes d’une réunion d’évêques ; faites silence, et ne troublez plus l’ordre du concile ».
Dioscore accusé voulait rejeter la responsabilité de tout ce qui s’était passé sur les quatre assesseurs que l’empereur lui avait adjoints, et ensuite sur l’assemblée elle-même qui avait tout approuvé ; mais alors les évêques d’Orient lui donnèrent un démenti violent, disant : « Nous avons été forcés, nous avons été frappés, nous avons cédé aux menaces et aux violences ». Et alors suivirent les détails sur la manière dont Dioscore arrachait les votes et les signatures, et empêchait les notaires d’écrire, leur enlevant de force leurs tablettes. On en vint à la profession de foi d’Eutychès. Un évêque, Basile de Séleucie, dit que, dans le concile d’Éphèse, il avait pressé Eutychès de reconnaître qu’il y a deux natures en Christ, mais qu’Eutychès s’y était refusé. « Pourquoi donc », dirent les magistrats à Basile, « avez-vous souscrit à l’absolution d’Eutychès et à la déposition de Flavien ? ». « Parce que j’ai été forcé d’obéir », répondit Basile. « J’ai failli » ajouta-t-il. Et tous les Orientaux qui, de même que lui, avaient cédé à la force, s’écrièrent : « Nous avons tous failli ; tous nous demandons pardon ».
On lut ensuite la profession de foi de Flavien au synode de Constantinople, et le concile, sauf quelques partisans de Dioscore, déclara orthodoxe la doctrine du martyr Flavien. À ce moment, Juvénal, évêque de Jérusalem, qui jusqu’alors avait soutenu Dioscore, et avec lui les évêques de la Palestine, dirent : « Nous croyons tous la même chose », et, se levant, ils passèrent du côté des évêques d’Orient. Leur exemple fut suivi par les évêques de Grèce, de Crète et de Macédoine ; quatre évêques égyptiens même les imitèrent. Dioscore restait presque seul.
Puis vint la constatation des violences exercées par Dioscore au concile d’Éphèse, et, pendant que le concile était rassemblé, quatre Égyptiens, dont un prêtre et deux diacres, lésés tous quatre par Dioscore, apportèrent contre lui les accusations les plus graves concernant son caractère, sa conduite et ses mœurs. Avant la présentation de leur requête, Eusèbe de Dorylée avait demandé que Dioscore fût condamné et puni pour avoir soutenu la doctrine d’Eutychès, que celle-ci fût anathématisée, et que l’assemblée d’Éphèse fût rayée de la liste des conciles. Il insista pour que l’accusé comparût, afin de se défendre. Mais malgré trois sommations, Dioscore refusa, bien que dans la dernière on lui eût dit les accusations dont il était l’objet de la part des quatre Égyptiens, et que, pour l’honneur de l’Église, il devait y répondre.
Les légats du pape ayant alors résumé ce qui était à sa charge, le concile prononça sa condamnation, le dépouillant de sa charge et dignité d’évêque et de tout ministère sacerdotal. La condamnation fut signifiée au condamné, et la sentence rendue publique. Mais Dioscore ayant déclaré qu’il se souciait peu du concile, et se vantant de rependre bientôt sa place d’évêque, l’empereur l’exila à Gangres, en Paphlagonie. Le concile avait aussi décidé, et l’empereur avait confirmé, la question de doctrine. Ce dernier avait déclaré aussi qu’il agirait contre ceux qui n’obéiraient pas aux décrets du concile. Nous voyons par là et par tout ce qui précède, combien l’Église s’était asservie au pouvoir séculier. Elle habitait dans le monde, où Satan a son trône (Apocalypse 2:13), bien qu’elle retînt encore la vérité touchant la Personne du Fils de Dieu.
 Re: L’ÉGLISE : UNE ESQUISSE DE SON HISTOIRE PENDANT VINGT SIÈCLES
Re: L’ÉGLISE : UNE ESQUISSE DE SON HISTOIRE PENDANT VINGT SIÈCLES
Mais ni la déclaration du concile qui, pour la doctrine, adhéra à la lettre de Léon, ni la condamnation d’Eutychès et de Dioscore, ne mirent fin aux luttes entre les orthodoxes et les partisans d’Eutychès. Elles durèrent pendant plus de cent ans. Les adhérents à la doctrine d’Euthychès, nommés monophysites, ce qui veut dire une seule nature, finirent par rompre avec l’Église grecque, et formèrent plusieurs églises distinctes : celles d’Abyssinie, d’Égypte (l’Église copte), des Jacobites en Syrie, et enfin d’Arménie, ayant chacune leur patriarche particulier.
C’est de la dernière de ces églises que nous dirons quelques mots. Si nous avons parlé un peu longuement des deux conciles, c’était pour montrer dans quel triste état se trouvait l’Église, et l’impossibilité pour l’homme de réparer ses ruines. Au milieu du désordre, on est heureux de voir cependant quelques étincelles de la vérité.
5.12.2 - Arméniens
Le nom d’Arménien n’est inconnu à aucun de nous. Les souffrances de ce peuple, voué par les Turcs à l’extermination, sont venues à la connaissance de tout le monde. L’Arménie est une contrée montagneuse située entre la mer Noire et la mer Caspienne, et s’étend du mont Caucase aux monts Taurus et aux plaines de la Mésopotamie. À l’est se trouve l’Iran, à l’ouest elle confine aux provinces de l’Asie mineure. C’est en Arménie que se trouve le mont Ararat où l’Arche de Noé s’arrêta (Genèse 8:4), et c’est aussi dans cette contrée que prennent leur source l’Euphrate et le Tigre, le premier fleuve souvent nommé dans la Bible, et le second mentionné sous le nom de Hiddékel (Genèse 2:14 ; Daniel 10:4).
Les chrétiens arméniens habitant l’Arménie turque comptaient environ 800000 âmes, mais les affreux massacres ordonnés par le sultan, et la mort causée par les souffrances endurées par ceux qui avaient survécu, ont bien réduit ce nombre. Outre ceux-là, beaucoup d’Arméniens sont dispersés dans diverses contrées où ils s’occupent surtout de commerce.
Le christianisme existait déjà en Arménie dans le second siècle, mais c’est au quatrième qu’il s’y établit définitivement. Un prêtre païen, fils d’un prince parthe, ayant été converti, déploya une très grande activité pour l’évangélisation de l’Arménie, et fut l’instrument de la conversion du roi et de tout son peuple. Ce zélé évangéliste se nommait Grégoire et fut surnommé l’Illuminateur, celui qui éclaire. Les Arméniens avaient une langue à eux, une des plus anciennes qui existent, et vers l’an 400, un nommé Mesrob, avec un autre du nom de Sahak, traduisirent la Bible du syriaque en langue arménienne. De nos jours, les missionnaires américains venus dans ce pays, y ont largement répandu la parole de Dieu.
Eutychès et ses partisans avaient été condamnés par le concile de Chalcédoine, en 451. Mais les églises arméniennes, très nombreuses, puisqu’elles comptaient plus de six cents évêques, repoussèrent les décisions de ce concile et se séparèrent de l’Église d’Orient, tout en conservant le même culte et les mêmes erreurs touchant la transsubstantiation, les sept sacrements, le culte de la Vierge et des saints. Un certain nombre se sont rattachés à l’Église romaine. Nous dirons quelques mots de ce que Dieu a opéré de nos jours parmi eux.
La vie religieuse était bien déchue chez les chrétiens arméniens ; ils ne s’attachaient plus qu’aux formes extérieures, mais retenaient cependant toujours le nom de Jésus Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur, lorsqu’en 1832, Dieu mit au cœur de missionnaires américains de venir les évangéliser. Ces serviteurs de Dieu avaient pour but de réveiller les âmes par le moyen de la parole de Dieu, et de répandre l’instruction parmi les Arméniens qui étaient plongés dans une grande ignorance.
La première chose à effectuer était de faire imprimer la Bible dans la langue arménienne actuelle. C’est en 1842 que fut terminée l’impression du Nouveau Testament dans cette langue, et aussitôt on en répandit un grand nombre d’exemplaires. L’œuvre fut manifestement bénie de Dieu. Voici ce qu’écrivait un des missionnaires : « Il n’a probablement pas une ville dans le pays où les Écritures n’aient été portées. Nous pourrions en mentionner vingt où l’on trouverait des Arméniens qui sondent journellement la parole de Dieu, et qui désirent conformer leur vie à ses enseignements. En plusieurs endroits, le saint volume, imprimé dans l’arménien moderne, est regardé comme un nouveau message du ciel. Dans ces villes, il y a, tous les dimanches, des réunions dont le but spécial est l’étude des Écritures, et cela a lieu même dans des endroits où n’a jamais été aucun missionnaire étranger. C’est l’œuvre de la Bible seule. La Bible, dans leur ancienne langue, a toujours été pour les Arméniens un objet de vénération. Placée sur l’autel, elle est journellement présentée, après les prières, au peuple qui la baise dévotement. C’était presque un acte de superstition, mais cela a servi, sans doute, à leur faire recevoir avec respect ses enseignements, lorsqu’ils ont pu la lire dans une langue qu’ils comprennent. La lecture des Écritures a guéri plusieurs Arméniens de leur scepticisme. Ils ont été convaincus que, quelques manquements qu’ils aient vus chez les chrétiens de profession qui les entourent, la Bible renferme la vérité pure et vivante ». Un banquier arménien disait : « Notre nation a contracté une grande dette de reconnaissance envers ceux qui nous ont fait connaître la Bible et l’ont répandue dans une langue que nous comprenons. Ils ont sauvé de l’incrédulité, non seulement moi, mais plusieurs autres, car nous avons trouvé que le christianisme repose sur des fondements plus solides et plus profonds que nous ne le supposions, et qu’il y a dans la parole de Dieu quelque chose pour établir notre foi ».
Un jeune homme vint un jour pour acheter plusieurs exemplaires des Écritures en langue arménienne. « On m’a écrit », dit-il, « de ma ville natale, afin de me demander de l’argent pour la construction d’une église. Mais comme je désire plutôt bâtir une église de pierres vivantes, j’enverrai ma contribution sous la forme d’exemplaires de la parole de Dieu ». Dans un village, près de Nicomédie, une congrégation s’est formée, adoptant les Écritures comme unique règle de foi. Nul missionnaire n’avait été parmi eux, sauf le grand Missionnaire, la Bible. On raconte la même chose d’Alep, où plus de deux cents personnes se sont ainsi réunies, et il s’y en ajoutait journellement d’autres. Là aussi, c’est la lecture seule des Écritures qui a opéré dans les âmes sans l’action d’aucun missionnaire. Ainsi s’est répandue la parole de Dieu chez les Arméniens, jusqu’en des districts fort reculés et parfois par des moyens merveilleux. Ainsi, un certain nombre d’exemplaires des Écritures étaient tombés entre les mains d’une bande de Kurdes nomades, au nord de la Syrie. Ne sachant que faire de ces livres, ils les distribuèrent à la population arménienne qui demeurait près de leur campement, et qui les reçut avec joie.
C’est de cette manière que la parole de Dieu, en se répandant, se montrait ce qu’elle est, l’épée de l’Esprit, pour atteindre les cœurs et les consciences, la lumière pour éclairer l’intelligence et faire connaître les choses de Dieu et la puissance pour transformer la vie. Mais là où Dieu opère, Satan s’oppose. Les lecteurs de la Bible, que l’on nomma protestants, furent persécutés par les évêques qui accusaient les missionnaires de troubler et de diviser leur église nationale. Cela conduisit ceux qui avaient reçu l’Évangile à se constituer en Église séparée. Cependant les missionnaires avaient fondé des collèges, des séminaires, des écoles supérieures et primaires, de sorte qu’en même temps que la parole de Dieu, se propageait aussi l’instruction.
Nous n’avons pas à entrer ici dans le détail des persécutions sanglantes, des massacres en masse et en détail des malheureux Arméniens depuis 1890, et surtout en 1895-1896 ; massacres qui n’ont pas entièrement cessé, et qui ont amené la désolation et la misère dans ce pays (*). Les œuvres dont nous avons parlé en ont été plus ou moins entravées ; mais un fruit en a été porté et restera. Et Dieu connaît ceux qui, souvent peu éclairés, ont cependant préféré la mort au reniement du nom de Jésus.
(*) Depuis que ces lignes ont été écrites, il y a eu les terribles massacres de 1915, pendant la Première Guerre mondiale, et l’émigration d’un grand nombre d’Arméniens en Europe, en particulier en France. L’Église arménienne doit compter au total environ 3 millions et demi de fidèles dans le monde.
5.13 - Diverses formes religieuses
En parlant des Arméniens, nous avons été conduit à nommer les Turcs, leurs dominateurs. Cela nous amène naturellement à parler de Mahomet et de la religion qu’il a établie, qui porte son nom et que professent les Turcs.
L’apôtre Paul mentionne trois systèmes religieux dans lesquels se rangeaient de son temps tous les hommes. Il y avait les Juifs, les Grecs qui étaient idolâtres, et l’Assemblée de Dieu, c’est-à-dire les chrétiens (1 Corinthiens 10:32). C’est comme nous dirions maintenant, le paganisme, le judaïsme et le christianisme. À ces trois formes religieuses, qui existent encore de nos jours, il faut en joindre à présent une quatrième, l’islam (ou islamisme).
Les idolâtres ou païens formaient du temps de Paul comme aujourd’hui, la classe la plus nombreuse. Ce sont ceux qui adorent une multitude de divinités appelées idoles, nom donné surtout à leurs représentations en or, en argent, en pierre ou en bois (*1). Ces divinités étaient, ou les astres (*2), auxquels on attribuait plus qu’une existence matérielle, ou des êtres imaginaires dont on peuplait le ciel, la terre et les mers, attribuant à chacun une fonction et une puissance particulières, ou bien des animaux, même des reptiles et des plantes (*3). L’homme sent en lui-même le besoin d’une religion, c’est-à-dire de se rattacher à une puissance supérieure, à laquelle il puisse s’adresser pour être aidé ; mais le péché l’a éloigné de Dieu dont il n’a pas gardé la connaissance (*4), et Satan l’a conduit à l’idolâtrie, de sorte que, derrière les idoles, se trouvent en réalité les démons (*5). Mais ces dieux, loin de donner la paix à l’âme, la remplissent de terreur. Il faut toujours chercher à les apaiser, à gagner leur faveur. Qu’ils sont encore nombreux de nos jours les pauvres idolâtres ! À quelles superstitions impures et souvent sanglantes ne sont-ils pas adonnés ! Quelle dégradation n’y a-t-il pas chez un grand nombre ! Ils sont vraiment dans les ténèbres de l’ombre de la mort (*6). Depuis le commencement du christianisme, des messagers de bonnes nouvelles ont travaillé et travaillent encore parmi eux pour les amener à la connaissance du vrai Dieu et de Jésus Christ, son Fils, qu’il a envoyé dans ce monde pour sauver les pécheurs et les conduire dans le chemin de la paix et à la jouissance de la vie éternelle et bienheureuse. Que Dieu soutienne dans cette œuvre ceux qui s’y occupent. Prions pour eux.
(*1) Psaume 115:4 ; Jérémie 2:27 ; Actes 17:29.
(*2) 2 Rois 21:3 ; Sophonie 1:5.
(*3) Romains 1:22-23.
(*4) Romains 1:19-21.
(*5) 1 Corinthiens 10:20-21.
(*6) Ésaïe 9:2 ; Luc 1:79 ; Matthieu 4:16. 3.
L’idolâtrie a pris naissance très peu de temps après le déluge, car Josué dit au peuple d’Israël que leurs pères, avant Abraham, avaient servi d’autres dieux (*1). Elle se répandit bien vite sur la terre. Alors Dieu résolut de se choisir un peuple (*2) à qui il se ferait connaître, au sein duquel sa connaissance, comme seul vrai Dieu, serait gardée, son culte conservé (*3), et à qui il confierait ses oracles (*4) renfermant le grand dessein de ses pensées éternelles, l’envoi d’un Libérateur qui naîtrait au sein de ce peuple. Le peuple choisi devait avoir en horreur l’idolâtrie et rester absolument séparé des nations païennes (*6). Pour accomplir ce qu’il s’était proposé, Dieu se révéla à Abraham (*7), le fidèle croyant, dont les descendants, par Isaac et Jacob, devaient constituer le peuple choisi. Ce sont les Juifs, avec qui Dieu avait fait alliance, à qui il avait donné une loi, prescrit un culte, ordonné une sacrificature et qui avaient reçu de magnifiques promesses. Mais ce peuple comblé de tant de grâces, s’est montré ingrat, constamment rebelle, s’adonnant à l’idolâtrie, et perdant ainsi son caractère glorieux de témoin de Dieu, et cela malgré les avertissements, les menaces et les châtiments que Dieu multiplia, jusqu’à ce qu’il n’y eût plus de remède. Ils furent emmenés en captivité et assujettis à des rois étrangers et idolâtres. Dieu en ramena un certain nombre dans leur pays, afin que s’accomplît parmi eux la promesse du Libérateur, du Messie prédit par les prophètes (*8), et le Fils de Dieu lui-même, devenu un homme, a paru au milieu d’eux. Il était né de femme, descendant d’Abraham, de la race de David, selon les promesses (*9). Il venait les sauver de leurs péchés et établir le royaume de Dieu (*10). Mais les Juifs, sauf un très petit nombre, le rejetèrent et le firent mourir. Alors Dieu ne les reconnut plus pour un temps comme son peuple, et les plus terribles jugements tombèrent sur eux. Ils furent dispersés partout, n’ayant plus de pays, de ville sainte, de temple, de sacrifices. Nous les voyons dans cet état, et ils y resteront jusqu’à ce qu’ils se repentent et reconnaissent pour leur Messie et leur Roi, Celui qu’ils ont rejeté (*11).
(*1) Josué 24:2
(*2) Deutéronome 7:7 ; 10:15.
(*3) Deutéronome 7:9 ; 6:4 ; 10:12, etc. ; 12:10-14.
(*4) Romains 3:2.
(*5) Galates 4:4.
(*6) Deutéronome 5:6-10 ; 6:14 ; 7:3-6, 25, 26 ; 11:16.
(*7) Actes 7:2.
(*8) Michée 5:2 ; Ésaïe 7:14 ; 9:6-7 ; 11:1-10 ; Daniel 9:24-26.
(*9) Galates 4:4 ; Luc 2:7 ; Matthieu 1:1.
(*10) Matthieu 1:21 ; Marc 1:15.
(*11) Osée 3:4-5 ; Zacharie 12:10 ; 13:1.
En attendant, Dieu s’est tourné vers les pauvres païens plongés dans les ténèbres de leur ignorance, et a fait lever sur eux la lumière (*1). Il leur a fait annoncer l’Évangile, la bonne nouvelle du salut pour quiconque croit en Jésus mort, ressuscité et glorifié dans le ciel (*2) ; et il a envoyé l’Esprit Saint pour rendre témoignage à la gloire de Christ, pour demeurer en chaque croyant, et pour former l’Assemblée chrétienne en rassemblant les croyants autour du Seigneur (*3). Bien que les juifs, comme nation, aient été mis de côté, quiconque d’entre eux croit au Seigneur Jésus, est sauvé et fait partie de l’Assemblée ; mais il n’est plus Juif, il est chrétien, car dans l’Assemblée, il n’y a ni Juif, ni Grec, mais Christ est tout (*4). Quels précieux privilèges nous avons comme chrétiens ! Le grand, le merveilleux avantage que nous possédons, c’est d’avoir la révélation de tout ce qu’est Dieu, que « le Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous a fait connaître » (*5).
(*1) Actes 13:46-47 ; 28:28.
(*2) Actes 13:38-39 ; 10:43.
(*3) Jean 14:16-17 ; 16:14 ; 1 Corinthiens 12:13.
(*4) Colossiens 3:11.
(*5) Jean 1:18.
Comme nous l’avons vu, Satan a réussi à faire entrer le mal dans l’assemblée chrétienne. Peu à peu elle a déchu de la pureté et de la simplicité primitives. Les grandes vérités du salut par la grâce ont été obscurcies, et l’on y a substitué le salut par les œuvres ; la vie a été remplacée par des formes extérieures ; à la place du culte en esprit et en vérité, on a établi un culte de cérémonies empruntées au judaïsme et au paganisme. L’Église s’est d’abord assujettie à l’État, pour avoir sa protection au lieu de celle de Dieu ; puis, enflée d’orgueil, elle a voulu le dominer à son tour. La mondanité s’est introduite chez elle, ensuite elle a glissé dans une idolâtrie pire que celle du paganisme, rendant un culte aux saints et à la Vierge et se prosternant devant des images. Des disputes incessantes l’ont déchirée ; d’un autre côté s’est élevée la puissance du pape de Rome, se prétendant vicaire de Jésus Christ sur la terre, et revendiquant l’autorité suprême sur toute l’Église, tandis que les évêques et les prêtres qui lui étaient soumis, exerçaient leur autorité sur les troupeaux. À cela il faut joindre une ignorance profonde.
Tel était l’état des choses dans la chrétienté, quand Mahomet parut et fonda sa nouvelle religion qui répudiait le paganisme, mais n’acceptait ni le judaïsme, ni le christianisme. L’islam, ou religion musulmane, fut un fléau terrible pour la chrétienté, surtout en Orient, et on peut dire pour tout le monde. Est-ce une religion vraie, ou qui a quelque chose de vrai ? Non. Malgré ses prétentions, elle est entièrement fausse. Mahomet est un faux prophète, et le Dieu qu’il veut qu’on adore, n’est pas le vrai Dieu. Souvenons-nous toujours qu’il n’y a qu’une seule et unique révélation de Dieu : celle qu’il a donnée par les prophètes, par son Fils et ses apôtres, et qui est contenue dans la Bible, laquelle tout entière est la parole de Dieu.
Ainsi, maintenant, sur la terre, il y a quatre grandes formes religieuses : le paganisme qui se subdivise en une multitude de formes diverses, depuis le bouddhisme jusqu’au fétichisme ou culte d’objets inanimés, et où Satan retient encore dans ses chaînes des multitudes d’esclaves. Ensuite l’islam qui prétend venir de Dieu, mais qui n’est qu’une illusion, une déception et un piège, encore plus funestes, de l’ennemi qui tient ainsi des millions d’hommes sous sa domination et dans les liens d’une erreur mortelle. En troisième lieu, le judaïsme, qui a bien le vrai Dieu, qui possède dans l’Ancien Testament une partie de la révélation de Dieu. Mais les Juifs sont désobéissants au vrai Dieu, en ne recevant pas le Christ, le Messie que l’Ancien Testament avait annoncé. Enfin, le christianisme qui a la pleine et complète révélation de Dieu dans l’Ancien et le Nouveau Testament. Les chrétiens ont le vrai Dieu, Père, Fils, et Saint Esprit. Le christianisme, dans sa forme extérieure, est la chrétienté avec ses nombreuses sectes. Mais quel que soit le déclin de l’Église ou l’Assemblée, c’est dans le christianisme seul que se trouve la vérité qui sauve. C’est là qu’est proclamé le nom de Jésus, le seul qui ait été donné parmi les hommes, et par lequel il nous faille être sauvés (*).
(*) Actes 4:12
L’Église a été désobéissante et est déchue. Le temps vient pour elle où elle sera vomie de la bouche du Seigneur (*1). Mais dans tous les temps Dieu a eu un résidu de témoins fidèles (*2). Et à certaines époques, il a suscité des hommes qui ont remis en lumière des vérités oubliées. C’est ainsi qu’au temps de la réformation, en combattant les erreurs de Rome, Luther, Calvin, Farel et d’autres ont remis en lumière la Bible, parole de Dieu, seule autorité infaillible, et la justification du pécheur par la foi en Jésus. Actuellement, ce qui a été rappelé aux chrétiens, c’est la vraie notion de ce qu’est l’Église et la grande vérité du retour prochain du Seigneur pour prendre les siens avec Lui. Nous sommes aux derniers temps, temps bien sérieux, et la parole du Seigneur à ceux — en petit nombre — qui ont reçu ces vérités, c’est : « Voici, je viens bientôt ; tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne » (*3).
(*1) Apocalypse 3:16.
(*2) Apocalypse 2:13, 24 ; 3:4.
(*3) Apocalypse 3:11.
5.14 - Mahomet et sa religion
Mahomet naquit en l’an 570 à la Mecque, en Arabie, où l’idolâtrie subsistait presque partout. Ayant perdu son père de très bonne heure, il fut élevé par son oncle Abou Taleb, qui le mit dans le commerce. Il eut ainsi l’occasion de faire de fréquents voyages en Syrie, et là, ayant été en contact avec des chrétiens et avec des Juifs, il apprit à connaître l’Ancien et le Nouveau Testament. Mais là il fut aussi témoin des divisions, des pratiques superstitieuses et de la mondanité qui s’étaient glissées dans l’Église et qui déshonoraient le nom de Christ. Mahomet voyait donc d’un côté la folie de l’idolâtrie, et d’un autre ne voulait ni du judaïsme, ni du christianisme défiguré qu’il avait eu sous les yeux. Il pensa alors établir une religion plus pure, en prenant dans les livres saints des Juifs et des chrétiens ce qui lui convenait, et il y mêla ses propres pensées. Pour faire recevoir cette religion, il prétendit avoir eu des révélations de Dieu.
En lisant les Écritures, Mahomet n’avait pas appris à connaître le Dieu vivant et vrai qu’elles révèlent, ni Jésus Christ, son Fils, le Sauveur, qu’elles nous présentent. D’où lui venait donc la pensée d’établir une nouvelle forme religieuse ? Ce n’était pas de Dieu assurément, mais de celui qui autrefois avait poussé les hommes à l’idolâtrie, de Satan, le père du mensonge, menteur et meurtrier dès le commencement (Jean 8:44), car, en effet, l’islam est basé sur un mensonge, et est une religion de sang. Et c’était une séduction d’autant plus dangereuse qu’elle se voilait sous une belle apparence, celle de proclamer un Dieu unique. Dans les terribles temps à venir, Satan réussira encore à susciter un faux prophète plus dangereux que Mahomet même, qui séduira les hommes et leur fera croire au mensonge (lire Apocalypse 12:9 ; 13:14 ; 19:20 ; 2 Thessaloniciens 2:8-11).
Ce ne fut qu’à l’âge de quarante ans que Mahomet commença à se donner comme prophète, envoyé de Dieu. Il avait épousé à 25 ans, une riche veuve plus âgée que lui, et pendant les quinze années qui suivirent son mariage, il se retirait fréquemment dans une caverne du mont Hira, près de la Mecque. Un jour, en revenant de sa retraite, il déclara à sa femme qu’il avait reçu la visite de l’ange Gabriel qui lui avait annoncé sa mission d’envoyé de Dieu. Dès lors il commença à enseigner sa doctrine, mais seulement dans sa maison et à un petit cercle d’amis et de connaissances. Sa femme fut son premier disciple ; puis il gagna plusieurs membres de sa famille et quelques personnages notables de la ville. Il leur enseignait qu’il fallait croire en un seul Dieu, et le reconnaître, lui, Mahomet, pour son prophète ; ensuite croire à des récompenses et des châtiments à venir, et comme formes religieuses, il imposait des ablutions et des prières. Ce n’était pas, disait-il, une nouvelle religion, mais celle de leur ancêtre Abraham (*), restaurée dans sa pureté. Il appuyait ses doctrines sur de prétendues révélations que lui apportait, disait-il, l’ange Gabriel. Ces révélations recueillies et réunies dans la suite, formèrent le Coran, ou livre sacré des mahométans.
(*) Les Arabes, issus en partie d’Ismaël, sont de fait descendants d’Abraham.
Après trois ans, le nombre de ses adhérents ne montait encore qu’à quarante. Il n’avait jusqu’alors fait connaître sa doctrine qu’à un nombre restreint de personnes, mais enfin il se décida à l’annoncer publiquement et à attaquer avec force l’idolâtrie de ses compatriotes. Ceux-ci irrités, l’auraient tué sans l’intervention de son oncle. L’opposition ne découragea pas Mahomet, il continua à prêcher et vit le nombre de ses partisans s’accroître. Mais en l’an 622, ses adversaires excitèrent le peuple contre lui, et il se vit obligé de s’enfuir à Yatreb, ville qui depuis fut nommée Médine (Médinet al Nabi, c’est-à-dire ville du prophète). C’est de cette année que date l’ère mahométane (*) nommée hégire, ou fuite. Mahomet avait à Médine un certain nombre de partisans qui avaient gagné les habitants à sa cause. Ils vinrent à la rencontre du prophète méprisé, et le saluèrent comme roi et prophète.
(*) C’est-à-dire que c’est à partir de cette époque que les mahométans comptent leurs années, comme nous les comptons à partir de la naissance du Seigneur.
Ce fut le commencement de ses succès. Ses révélations lui ordonnèrent d’employer le glaive contre les idolâtres et ceux qui ne se soumettraient pas à lui. Une grande armée de ses ennemis, à laquelle s’étaient joints les Juifs, vint investir Médine ; mais Mahomet réussit à semer la division parmi les principaux chefs qui, l’un après l’autre, abandonnèrent le siège. Une trêve de dix ans fut conclue, d’où les Juifs étaient exclus. Mahomet assiégea et prit plusieurs de leurs villes, s’empara de leurs biens, fit prisonniers leurs femmes et leurs enfants, et tua la plupart des hommes.
Les habitants de la Mecque ayant violé la trêve, Mahomet, à la tête de dix mille guerriers, les attaqua et s’empara de la ville. Les habitants se soumirent à lui et il pardonna à tous ceux qui embrassèrent sa foi. Ensuite il détruisit les 360 idoles qu’ils adoraient, fit disparaître tout vestige d’idolâtrie, orna leur temple et le consacra au culte du seul Dieu. Puis il fit ses prières et ses dévotions dans le sanctuaire appelé Kaaba, petit édifice qui se trouve au milieu du temple et que l’on dit avoir été érigé par Abraham. Là se trouve une pierre noire, objet de la vénération des fidèles, et qui passe pour avoir été autrefois un autel consacré au vrai Dieu (*).
(*) Chaque année des milliers de mahométans de tous pays viennent en pèlerinage à la Mecque, la ville sainte. Tout mahométan doit faire ce pèlerinage au moins une fois en sa vie. Il en rapporte le titre de « hadji », c’est-à-dire pèlerin.
Mahomet devint ainsi chef suprême, à la fois religieux et temporel, de toute l’Arabie. Il projetait d’attaquer l’empire romain d’Orient qui subsistait encore, mais la mort mit un terme à ses desseins. En l’an 632, il fit encore un pèlerinage à la Mecque, et là, après avoir fait ses dévotions, s’adressant à la foule qui l’entourait, il dit : « Écoutez mes paroles et qu’elles descendent dans vos cœurs. Je vous ai laissé une loi. Si vous vous y attachez, elle vous préservera toujours de l’erreur. C’est une loi claire et positive, un livre dicté d’en haut. Ô mon Dieu ! ai-je accompli ma mission ? ». Et mille voix répondirent : « Oui, tu l’as accomplie ! » Le prophète ajouta : « Ô mon Dieu ! entends ce témoignage ». On voit comment jusqu’au bout, il séduisait les autres, étant séduit lui-même (2 Timothée 3:13). L’esprit de mensonge, sous de beaux semblants, parlait par sa bouche.
Mahomet retourna chez lui et mourut peu après. La nouvelle de sa mort jeta une grande consternation chez tous ses sectateurs, qui avaient pensé qu’un prophète tel que lui ne pouvait pas mourir. Mais quelqu’un de la foule s’écria : « Musulmans, sachez que Mahomet est mort, mais Dieu est vivant et ne peut mourir. Oubliez-vous ce passage du Coran : « Mahomet n’est pas plus qu’un apôtre ; d’autres apôtres sont morts avant lui ». Et cet autre passage : « Tu mourras certainement, ô Mahomet ! et eux aussi mourront » ?
Cette citation du Coran apaisa les esprits : il était clairement révélé que le prophète devait mourir. Alors se posa la question importante de savoir qui lui succéderait. Abou Bekr, dont Mahomet avait épousé la fille, fut élu, et devint ainsi le premier « calife », c’est-à-dire le vicaire ou remplaçant de Mahomet.
* * *
Le caractère personnel de Mahomet n’apparaît pas sous un jour bien élevé. Avait-il besoin d’une sanction sur un de ses actes, si injuste ou déloyal ou immoral fût-il, il apportait aussitôt une révélation qu’il disait tenir de Dieu. Plus d’une fois il se justifia ainsi d’avoir tué ses ennemis, violé ses serments et épousé l’une après l’autre plusieurs femmes. Nous avons déjà dit un mot de sa doctrine. Il reconnaissait les Écritures saintes, auxquelles il avait emprunté plusieurs choses, comme étant des livres divins, mais il prétendait que les Juifs et les chrétiens les avaient altérées, et que lui avait été envoyé pour rétablir la vérité. Il tenait pour des prophètes suscités pour instruire les hommes, Noé, Abraham, Moïse et d’autres, nommés dans l’Ancien Testament. Mais à l’égard du Seigneur Jésus, notre adorable Sauveur, son langage est tout à fait blasphématoire. Il dit bien : « Le plus grand de tous les prophètes est Jésus, le Fils de Marie », mais il niait qu’il fût le Fils de Dieu. « Le Messie Jésus », dit-il, « le fils de Marie, n’est qu’un apôtre de Dieu… Dieu est un seul Dieu ; c’est porter atteinte à sa gloire de dire qu’il a un Fils. Ce sont des infidèles ceux qui disent que le Messie, fils de Marie, est Dieu. Dieu est un, Dieu est éternel ; il n’engendre point et n’a pas été engendré. Il n’y a personne qui lui soit semblable ». Tout cela est formellement opposé à ce que nous dit la parole de Dieu (lire avec soin Jean 1:1, 14, 18 ; Romains 1:3-4 ; 9:5 ; Philippiens 2:6 ; Colossiens 1:14-17 ; Hébreux 1:1-3 ; 1 Jean 1:1 ; 4:15). Que nous dit encore l’apôtre Jean : « Quiconque nie le Fils n’a pas non plus le Père » (1 Jean 2:23), c’est-à-dire qu’il ne connaît pas vraiment Dieu, et ne peut être son enfant. Jean dit aussi : « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie » (1 Jean 5:12). Et cette vie est la vie éternelle. On n’a donc la vie éternelle, on ne peut donc être sauvé qu’en reconnaissant Jésus comme étant le Fils de Dieu, et en croyant en Lui (Jean 3:16, 18, 36). Nous voyons ainsi dans quelle erreur mortelle l’islam retient les âmes.
Mahomet insistait sur l’unité de Dieu. Il semble beau et grand de dire : « Il n’y a qu’un seul Dieu ; Dieu est éternel, etc ». Cela est certain du vrai Dieu, mais le Dieu de Mahomet est-il le vrai Dieu, Celui que l’Écriture nous révèle ? Non. Dieu est lumière, et le Coran n’est que ténèbres, car il ne révèle pas Dieu dans sa nature comme Père, Fils et Saint Esprit, ni dans son caractère moral, et il ne fait pas connaître le moyen, pour l’homme pécheur, d’être sauvé et d’approcher d’un Dieu juste et saint. Dieu est amour, et le Coran ne respire que haine, vengeance et meurtre. Dieu est saint et pur, et le Coran sanctionne toutes les convoitises et va jusqu’à promettre à ses sectateurs un paradis de jouissances sensuelles. C’est un des moyens par lesquels il retient les hommes dans ses liens, en flattant la chair et ses passions, tandis que l’apôtre Paul nous dit que « ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises » (Galates 5:24).
L’islam est donc tout l’opposé du vrai christianisme ; il est une œuvre du diable, une affreuse séduction de l’ennemi, qui a ainsi entraîné des millions d’âmes et en retient des millions dans une erreur mortelle, loin du vrai Dieu et du salut. Les conquêtes des successeurs de Mahomet furent rapides et s’étendirent au loin, et, de nos jours, deux cents millions d’hommes sont courbés sous ce joug. On pourrait penser que la religion de Mahomet est un progrès sur le paganisme, en ce qu’elle tourne les pensées de l’homme vers un Dieu unique, invisible et éternel. Mais ce Dieu n’est pas plus le vrai Dieu que ne le sont les idoles, puisque comme elles, il laisse l’homme se livrer à ses passions, et qu’il n’ouvre pas, au pécheur perdu, la voie du salut, de la vie et de la paix. « C’est ici la vie éternelle », dit le Seigneur, « qu’ils te connaissent seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ » (Jean 17:3). Voilà la voie royale, celle du salut, de la vie et du ciel, car Jésus a dit : « Je suis le chemin, et la vérité, et la vie ; nul ne vient au Père que par moi » (Jean 14:6). Quel contraste avec l’islam qui proclame : « Il y a un seul Dieu, et Mahomet est son prophète », qui tolère le péché et verse le sang ! L’islam, précisément parce qu’il a une certaine apparence de vérité supérieure au paganisme, tient d’autant plus loin de Christ ses sectateurs. C’est une chose très rare de voir un mahométan devenir chrétien, tandis que des millions de païens croient en Christ pour le salut. Quel accord peut-il y avoir entre un mahométan et un vrai chrétien, si ce n’est que celui-ci priera pour l’autre, afin que Dieu l’éclaire ? Rendons grâces à Dieu qui s’est fait connaître à nous par son Fils, en qui sont venues « la grâce et la vérité », et prions pour les mahométans, aussi bien que pour les païens, et pour les ouvriers du Seigneur qui travaillent chez les uns et chez les autres.
C’est de la dernière de ces églises que nous dirons quelques mots. Si nous avons parlé un peu longuement des deux conciles, c’était pour montrer dans quel triste état se trouvait l’Église, et l’impossibilité pour l’homme de réparer ses ruines. Au milieu du désordre, on est heureux de voir cependant quelques étincelles de la vérité.
5.12.2 - Arméniens
Le nom d’Arménien n’est inconnu à aucun de nous. Les souffrances de ce peuple, voué par les Turcs à l’extermination, sont venues à la connaissance de tout le monde. L’Arménie est une contrée montagneuse située entre la mer Noire et la mer Caspienne, et s’étend du mont Caucase aux monts Taurus et aux plaines de la Mésopotamie. À l’est se trouve l’Iran, à l’ouest elle confine aux provinces de l’Asie mineure. C’est en Arménie que se trouve le mont Ararat où l’Arche de Noé s’arrêta (Genèse 8:4), et c’est aussi dans cette contrée que prennent leur source l’Euphrate et le Tigre, le premier fleuve souvent nommé dans la Bible, et le second mentionné sous le nom de Hiddékel (Genèse 2:14 ; Daniel 10:4).
Les chrétiens arméniens habitant l’Arménie turque comptaient environ 800000 âmes, mais les affreux massacres ordonnés par le sultan, et la mort causée par les souffrances endurées par ceux qui avaient survécu, ont bien réduit ce nombre. Outre ceux-là, beaucoup d’Arméniens sont dispersés dans diverses contrées où ils s’occupent surtout de commerce.
Le christianisme existait déjà en Arménie dans le second siècle, mais c’est au quatrième qu’il s’y établit définitivement. Un prêtre païen, fils d’un prince parthe, ayant été converti, déploya une très grande activité pour l’évangélisation de l’Arménie, et fut l’instrument de la conversion du roi et de tout son peuple. Ce zélé évangéliste se nommait Grégoire et fut surnommé l’Illuminateur, celui qui éclaire. Les Arméniens avaient une langue à eux, une des plus anciennes qui existent, et vers l’an 400, un nommé Mesrob, avec un autre du nom de Sahak, traduisirent la Bible du syriaque en langue arménienne. De nos jours, les missionnaires américains venus dans ce pays, y ont largement répandu la parole de Dieu.
Eutychès et ses partisans avaient été condamnés par le concile de Chalcédoine, en 451. Mais les églises arméniennes, très nombreuses, puisqu’elles comptaient plus de six cents évêques, repoussèrent les décisions de ce concile et se séparèrent de l’Église d’Orient, tout en conservant le même culte et les mêmes erreurs touchant la transsubstantiation, les sept sacrements, le culte de la Vierge et des saints. Un certain nombre se sont rattachés à l’Église romaine. Nous dirons quelques mots de ce que Dieu a opéré de nos jours parmi eux.
La vie religieuse était bien déchue chez les chrétiens arméniens ; ils ne s’attachaient plus qu’aux formes extérieures, mais retenaient cependant toujours le nom de Jésus Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur, lorsqu’en 1832, Dieu mit au cœur de missionnaires américains de venir les évangéliser. Ces serviteurs de Dieu avaient pour but de réveiller les âmes par le moyen de la parole de Dieu, et de répandre l’instruction parmi les Arméniens qui étaient plongés dans une grande ignorance.
La première chose à effectuer était de faire imprimer la Bible dans la langue arménienne actuelle. C’est en 1842 que fut terminée l’impression du Nouveau Testament dans cette langue, et aussitôt on en répandit un grand nombre d’exemplaires. L’œuvre fut manifestement bénie de Dieu. Voici ce qu’écrivait un des missionnaires : « Il n’a probablement pas une ville dans le pays où les Écritures n’aient été portées. Nous pourrions en mentionner vingt où l’on trouverait des Arméniens qui sondent journellement la parole de Dieu, et qui désirent conformer leur vie à ses enseignements. En plusieurs endroits, le saint volume, imprimé dans l’arménien moderne, est regardé comme un nouveau message du ciel. Dans ces villes, il y a, tous les dimanches, des réunions dont le but spécial est l’étude des Écritures, et cela a lieu même dans des endroits où n’a jamais été aucun missionnaire étranger. C’est l’œuvre de la Bible seule. La Bible, dans leur ancienne langue, a toujours été pour les Arméniens un objet de vénération. Placée sur l’autel, elle est journellement présentée, après les prières, au peuple qui la baise dévotement. C’était presque un acte de superstition, mais cela a servi, sans doute, à leur faire recevoir avec respect ses enseignements, lorsqu’ils ont pu la lire dans une langue qu’ils comprennent. La lecture des Écritures a guéri plusieurs Arméniens de leur scepticisme. Ils ont été convaincus que, quelques manquements qu’ils aient vus chez les chrétiens de profession qui les entourent, la Bible renferme la vérité pure et vivante ». Un banquier arménien disait : « Notre nation a contracté une grande dette de reconnaissance envers ceux qui nous ont fait connaître la Bible et l’ont répandue dans une langue que nous comprenons. Ils ont sauvé de l’incrédulité, non seulement moi, mais plusieurs autres, car nous avons trouvé que le christianisme repose sur des fondements plus solides et plus profonds que nous ne le supposions, et qu’il y a dans la parole de Dieu quelque chose pour établir notre foi ».
Un jeune homme vint un jour pour acheter plusieurs exemplaires des Écritures en langue arménienne. « On m’a écrit », dit-il, « de ma ville natale, afin de me demander de l’argent pour la construction d’une église. Mais comme je désire plutôt bâtir une église de pierres vivantes, j’enverrai ma contribution sous la forme d’exemplaires de la parole de Dieu ». Dans un village, près de Nicomédie, une congrégation s’est formée, adoptant les Écritures comme unique règle de foi. Nul missionnaire n’avait été parmi eux, sauf le grand Missionnaire, la Bible. On raconte la même chose d’Alep, où plus de deux cents personnes se sont ainsi réunies, et il s’y en ajoutait journellement d’autres. Là aussi, c’est la lecture seule des Écritures qui a opéré dans les âmes sans l’action d’aucun missionnaire. Ainsi s’est répandue la parole de Dieu chez les Arméniens, jusqu’en des districts fort reculés et parfois par des moyens merveilleux. Ainsi, un certain nombre d’exemplaires des Écritures étaient tombés entre les mains d’une bande de Kurdes nomades, au nord de la Syrie. Ne sachant que faire de ces livres, ils les distribuèrent à la population arménienne qui demeurait près de leur campement, et qui les reçut avec joie.
C’est de cette manière que la parole de Dieu, en se répandant, se montrait ce qu’elle est, l’épée de l’Esprit, pour atteindre les cœurs et les consciences, la lumière pour éclairer l’intelligence et faire connaître les choses de Dieu et la puissance pour transformer la vie. Mais là où Dieu opère, Satan s’oppose. Les lecteurs de la Bible, que l’on nomma protestants, furent persécutés par les évêques qui accusaient les missionnaires de troubler et de diviser leur église nationale. Cela conduisit ceux qui avaient reçu l’Évangile à se constituer en Église séparée. Cependant les missionnaires avaient fondé des collèges, des séminaires, des écoles supérieures et primaires, de sorte qu’en même temps que la parole de Dieu, se propageait aussi l’instruction.
Nous n’avons pas à entrer ici dans le détail des persécutions sanglantes, des massacres en masse et en détail des malheureux Arméniens depuis 1890, et surtout en 1895-1896 ; massacres qui n’ont pas entièrement cessé, et qui ont amené la désolation et la misère dans ce pays (*). Les œuvres dont nous avons parlé en ont été plus ou moins entravées ; mais un fruit en a été porté et restera. Et Dieu connaît ceux qui, souvent peu éclairés, ont cependant préféré la mort au reniement du nom de Jésus.
(*) Depuis que ces lignes ont été écrites, il y a eu les terribles massacres de 1915, pendant la Première Guerre mondiale, et l’émigration d’un grand nombre d’Arméniens en Europe, en particulier en France. L’Église arménienne doit compter au total environ 3 millions et demi de fidèles dans le monde.
5.13 - Diverses formes religieuses
En parlant des Arméniens, nous avons été conduit à nommer les Turcs, leurs dominateurs. Cela nous amène naturellement à parler de Mahomet et de la religion qu’il a établie, qui porte son nom et que professent les Turcs.
L’apôtre Paul mentionne trois systèmes religieux dans lesquels se rangeaient de son temps tous les hommes. Il y avait les Juifs, les Grecs qui étaient idolâtres, et l’Assemblée de Dieu, c’est-à-dire les chrétiens (1 Corinthiens 10:32). C’est comme nous dirions maintenant, le paganisme, le judaïsme et le christianisme. À ces trois formes religieuses, qui existent encore de nos jours, il faut en joindre à présent une quatrième, l’islam (ou islamisme).
Les idolâtres ou païens formaient du temps de Paul comme aujourd’hui, la classe la plus nombreuse. Ce sont ceux qui adorent une multitude de divinités appelées idoles, nom donné surtout à leurs représentations en or, en argent, en pierre ou en bois (*1). Ces divinités étaient, ou les astres (*2), auxquels on attribuait plus qu’une existence matérielle, ou des êtres imaginaires dont on peuplait le ciel, la terre et les mers, attribuant à chacun une fonction et une puissance particulières, ou bien des animaux, même des reptiles et des plantes (*3). L’homme sent en lui-même le besoin d’une religion, c’est-à-dire de se rattacher à une puissance supérieure, à laquelle il puisse s’adresser pour être aidé ; mais le péché l’a éloigné de Dieu dont il n’a pas gardé la connaissance (*4), et Satan l’a conduit à l’idolâtrie, de sorte que, derrière les idoles, se trouvent en réalité les démons (*5). Mais ces dieux, loin de donner la paix à l’âme, la remplissent de terreur. Il faut toujours chercher à les apaiser, à gagner leur faveur. Qu’ils sont encore nombreux de nos jours les pauvres idolâtres ! À quelles superstitions impures et souvent sanglantes ne sont-ils pas adonnés ! Quelle dégradation n’y a-t-il pas chez un grand nombre ! Ils sont vraiment dans les ténèbres de l’ombre de la mort (*6). Depuis le commencement du christianisme, des messagers de bonnes nouvelles ont travaillé et travaillent encore parmi eux pour les amener à la connaissance du vrai Dieu et de Jésus Christ, son Fils, qu’il a envoyé dans ce monde pour sauver les pécheurs et les conduire dans le chemin de la paix et à la jouissance de la vie éternelle et bienheureuse. Que Dieu soutienne dans cette œuvre ceux qui s’y occupent. Prions pour eux.
(*1) Psaume 115:4 ; Jérémie 2:27 ; Actes 17:29.
(*2) 2 Rois 21:3 ; Sophonie 1:5.
(*3) Romains 1:22-23.
(*4) Romains 1:19-21.
(*5) 1 Corinthiens 10:20-21.
(*6) Ésaïe 9:2 ; Luc 1:79 ; Matthieu 4:16. 3.
L’idolâtrie a pris naissance très peu de temps après le déluge, car Josué dit au peuple d’Israël que leurs pères, avant Abraham, avaient servi d’autres dieux (*1). Elle se répandit bien vite sur la terre. Alors Dieu résolut de se choisir un peuple (*2) à qui il se ferait connaître, au sein duquel sa connaissance, comme seul vrai Dieu, serait gardée, son culte conservé (*3), et à qui il confierait ses oracles (*4) renfermant le grand dessein de ses pensées éternelles, l’envoi d’un Libérateur qui naîtrait au sein de ce peuple. Le peuple choisi devait avoir en horreur l’idolâtrie et rester absolument séparé des nations païennes (*6). Pour accomplir ce qu’il s’était proposé, Dieu se révéla à Abraham (*7), le fidèle croyant, dont les descendants, par Isaac et Jacob, devaient constituer le peuple choisi. Ce sont les Juifs, avec qui Dieu avait fait alliance, à qui il avait donné une loi, prescrit un culte, ordonné une sacrificature et qui avaient reçu de magnifiques promesses. Mais ce peuple comblé de tant de grâces, s’est montré ingrat, constamment rebelle, s’adonnant à l’idolâtrie, et perdant ainsi son caractère glorieux de témoin de Dieu, et cela malgré les avertissements, les menaces et les châtiments que Dieu multiplia, jusqu’à ce qu’il n’y eût plus de remède. Ils furent emmenés en captivité et assujettis à des rois étrangers et idolâtres. Dieu en ramena un certain nombre dans leur pays, afin que s’accomplît parmi eux la promesse du Libérateur, du Messie prédit par les prophètes (*8), et le Fils de Dieu lui-même, devenu un homme, a paru au milieu d’eux. Il était né de femme, descendant d’Abraham, de la race de David, selon les promesses (*9). Il venait les sauver de leurs péchés et établir le royaume de Dieu (*10). Mais les Juifs, sauf un très petit nombre, le rejetèrent et le firent mourir. Alors Dieu ne les reconnut plus pour un temps comme son peuple, et les plus terribles jugements tombèrent sur eux. Ils furent dispersés partout, n’ayant plus de pays, de ville sainte, de temple, de sacrifices. Nous les voyons dans cet état, et ils y resteront jusqu’à ce qu’ils se repentent et reconnaissent pour leur Messie et leur Roi, Celui qu’ils ont rejeté (*11).
(*1) Josué 24:2
(*2) Deutéronome 7:7 ; 10:15.
(*3) Deutéronome 7:9 ; 6:4 ; 10:12, etc. ; 12:10-14.
(*4) Romains 3:2.
(*5) Galates 4:4.
(*6) Deutéronome 5:6-10 ; 6:14 ; 7:3-6, 25, 26 ; 11:16.
(*7) Actes 7:2.
(*8) Michée 5:2 ; Ésaïe 7:14 ; 9:6-7 ; 11:1-10 ; Daniel 9:24-26.
(*9) Galates 4:4 ; Luc 2:7 ; Matthieu 1:1.
(*10) Matthieu 1:21 ; Marc 1:15.
(*11) Osée 3:4-5 ; Zacharie 12:10 ; 13:1.
En attendant, Dieu s’est tourné vers les pauvres païens plongés dans les ténèbres de leur ignorance, et a fait lever sur eux la lumière (*1). Il leur a fait annoncer l’Évangile, la bonne nouvelle du salut pour quiconque croit en Jésus mort, ressuscité et glorifié dans le ciel (*2) ; et il a envoyé l’Esprit Saint pour rendre témoignage à la gloire de Christ, pour demeurer en chaque croyant, et pour former l’Assemblée chrétienne en rassemblant les croyants autour du Seigneur (*3). Bien que les juifs, comme nation, aient été mis de côté, quiconque d’entre eux croit au Seigneur Jésus, est sauvé et fait partie de l’Assemblée ; mais il n’est plus Juif, il est chrétien, car dans l’Assemblée, il n’y a ni Juif, ni Grec, mais Christ est tout (*4). Quels précieux privilèges nous avons comme chrétiens ! Le grand, le merveilleux avantage que nous possédons, c’est d’avoir la révélation de tout ce qu’est Dieu, que « le Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous a fait connaître » (*5).
(*1) Actes 13:46-47 ; 28:28.
(*2) Actes 13:38-39 ; 10:43.
(*3) Jean 14:16-17 ; 16:14 ; 1 Corinthiens 12:13.
(*4) Colossiens 3:11.
(*5) Jean 1:18.
Comme nous l’avons vu, Satan a réussi à faire entrer le mal dans l’assemblée chrétienne. Peu à peu elle a déchu de la pureté et de la simplicité primitives. Les grandes vérités du salut par la grâce ont été obscurcies, et l’on y a substitué le salut par les œuvres ; la vie a été remplacée par des formes extérieures ; à la place du culte en esprit et en vérité, on a établi un culte de cérémonies empruntées au judaïsme et au paganisme. L’Église s’est d’abord assujettie à l’État, pour avoir sa protection au lieu de celle de Dieu ; puis, enflée d’orgueil, elle a voulu le dominer à son tour. La mondanité s’est introduite chez elle, ensuite elle a glissé dans une idolâtrie pire que celle du paganisme, rendant un culte aux saints et à la Vierge et se prosternant devant des images. Des disputes incessantes l’ont déchirée ; d’un autre côté s’est élevée la puissance du pape de Rome, se prétendant vicaire de Jésus Christ sur la terre, et revendiquant l’autorité suprême sur toute l’Église, tandis que les évêques et les prêtres qui lui étaient soumis, exerçaient leur autorité sur les troupeaux. À cela il faut joindre une ignorance profonde.
Tel était l’état des choses dans la chrétienté, quand Mahomet parut et fonda sa nouvelle religion qui répudiait le paganisme, mais n’acceptait ni le judaïsme, ni le christianisme. L’islam, ou religion musulmane, fut un fléau terrible pour la chrétienté, surtout en Orient, et on peut dire pour tout le monde. Est-ce une religion vraie, ou qui a quelque chose de vrai ? Non. Malgré ses prétentions, elle est entièrement fausse. Mahomet est un faux prophète, et le Dieu qu’il veut qu’on adore, n’est pas le vrai Dieu. Souvenons-nous toujours qu’il n’y a qu’une seule et unique révélation de Dieu : celle qu’il a donnée par les prophètes, par son Fils et ses apôtres, et qui est contenue dans la Bible, laquelle tout entière est la parole de Dieu.
Ainsi, maintenant, sur la terre, il y a quatre grandes formes religieuses : le paganisme qui se subdivise en une multitude de formes diverses, depuis le bouddhisme jusqu’au fétichisme ou culte d’objets inanimés, et où Satan retient encore dans ses chaînes des multitudes d’esclaves. Ensuite l’islam qui prétend venir de Dieu, mais qui n’est qu’une illusion, une déception et un piège, encore plus funestes, de l’ennemi qui tient ainsi des millions d’hommes sous sa domination et dans les liens d’une erreur mortelle. En troisième lieu, le judaïsme, qui a bien le vrai Dieu, qui possède dans l’Ancien Testament une partie de la révélation de Dieu. Mais les Juifs sont désobéissants au vrai Dieu, en ne recevant pas le Christ, le Messie que l’Ancien Testament avait annoncé. Enfin, le christianisme qui a la pleine et complète révélation de Dieu dans l’Ancien et le Nouveau Testament. Les chrétiens ont le vrai Dieu, Père, Fils, et Saint Esprit. Le christianisme, dans sa forme extérieure, est la chrétienté avec ses nombreuses sectes. Mais quel que soit le déclin de l’Église ou l’Assemblée, c’est dans le christianisme seul que se trouve la vérité qui sauve. C’est là qu’est proclamé le nom de Jésus, le seul qui ait été donné parmi les hommes, et par lequel il nous faille être sauvés (*).
(*) Actes 4:12
L’Église a été désobéissante et est déchue. Le temps vient pour elle où elle sera vomie de la bouche du Seigneur (*1). Mais dans tous les temps Dieu a eu un résidu de témoins fidèles (*2). Et à certaines époques, il a suscité des hommes qui ont remis en lumière des vérités oubliées. C’est ainsi qu’au temps de la réformation, en combattant les erreurs de Rome, Luther, Calvin, Farel et d’autres ont remis en lumière la Bible, parole de Dieu, seule autorité infaillible, et la justification du pécheur par la foi en Jésus. Actuellement, ce qui a été rappelé aux chrétiens, c’est la vraie notion de ce qu’est l’Église et la grande vérité du retour prochain du Seigneur pour prendre les siens avec Lui. Nous sommes aux derniers temps, temps bien sérieux, et la parole du Seigneur à ceux — en petit nombre — qui ont reçu ces vérités, c’est : « Voici, je viens bientôt ; tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne » (*3).
(*1) Apocalypse 3:16.
(*2) Apocalypse 2:13, 24 ; 3:4.
(*3) Apocalypse 3:11.
5.14 - Mahomet et sa religion
Mahomet naquit en l’an 570 à la Mecque, en Arabie, où l’idolâtrie subsistait presque partout. Ayant perdu son père de très bonne heure, il fut élevé par son oncle Abou Taleb, qui le mit dans le commerce. Il eut ainsi l’occasion de faire de fréquents voyages en Syrie, et là, ayant été en contact avec des chrétiens et avec des Juifs, il apprit à connaître l’Ancien et le Nouveau Testament. Mais là il fut aussi témoin des divisions, des pratiques superstitieuses et de la mondanité qui s’étaient glissées dans l’Église et qui déshonoraient le nom de Christ. Mahomet voyait donc d’un côté la folie de l’idolâtrie, et d’un autre ne voulait ni du judaïsme, ni du christianisme défiguré qu’il avait eu sous les yeux. Il pensa alors établir une religion plus pure, en prenant dans les livres saints des Juifs et des chrétiens ce qui lui convenait, et il y mêla ses propres pensées. Pour faire recevoir cette religion, il prétendit avoir eu des révélations de Dieu.
En lisant les Écritures, Mahomet n’avait pas appris à connaître le Dieu vivant et vrai qu’elles révèlent, ni Jésus Christ, son Fils, le Sauveur, qu’elles nous présentent. D’où lui venait donc la pensée d’établir une nouvelle forme religieuse ? Ce n’était pas de Dieu assurément, mais de celui qui autrefois avait poussé les hommes à l’idolâtrie, de Satan, le père du mensonge, menteur et meurtrier dès le commencement (Jean 8:44), car, en effet, l’islam est basé sur un mensonge, et est une religion de sang. Et c’était une séduction d’autant plus dangereuse qu’elle se voilait sous une belle apparence, celle de proclamer un Dieu unique. Dans les terribles temps à venir, Satan réussira encore à susciter un faux prophète plus dangereux que Mahomet même, qui séduira les hommes et leur fera croire au mensonge (lire Apocalypse 12:9 ; 13:14 ; 19:20 ; 2 Thessaloniciens 2:8-11).
Ce ne fut qu’à l’âge de quarante ans que Mahomet commença à se donner comme prophète, envoyé de Dieu. Il avait épousé à 25 ans, une riche veuve plus âgée que lui, et pendant les quinze années qui suivirent son mariage, il se retirait fréquemment dans une caverne du mont Hira, près de la Mecque. Un jour, en revenant de sa retraite, il déclara à sa femme qu’il avait reçu la visite de l’ange Gabriel qui lui avait annoncé sa mission d’envoyé de Dieu. Dès lors il commença à enseigner sa doctrine, mais seulement dans sa maison et à un petit cercle d’amis et de connaissances. Sa femme fut son premier disciple ; puis il gagna plusieurs membres de sa famille et quelques personnages notables de la ville. Il leur enseignait qu’il fallait croire en un seul Dieu, et le reconnaître, lui, Mahomet, pour son prophète ; ensuite croire à des récompenses et des châtiments à venir, et comme formes religieuses, il imposait des ablutions et des prières. Ce n’était pas, disait-il, une nouvelle religion, mais celle de leur ancêtre Abraham (*), restaurée dans sa pureté. Il appuyait ses doctrines sur de prétendues révélations que lui apportait, disait-il, l’ange Gabriel. Ces révélations recueillies et réunies dans la suite, formèrent le Coran, ou livre sacré des mahométans.
(*) Les Arabes, issus en partie d’Ismaël, sont de fait descendants d’Abraham.
Après trois ans, le nombre de ses adhérents ne montait encore qu’à quarante. Il n’avait jusqu’alors fait connaître sa doctrine qu’à un nombre restreint de personnes, mais enfin il se décida à l’annoncer publiquement et à attaquer avec force l’idolâtrie de ses compatriotes. Ceux-ci irrités, l’auraient tué sans l’intervention de son oncle. L’opposition ne découragea pas Mahomet, il continua à prêcher et vit le nombre de ses partisans s’accroître. Mais en l’an 622, ses adversaires excitèrent le peuple contre lui, et il se vit obligé de s’enfuir à Yatreb, ville qui depuis fut nommée Médine (Médinet al Nabi, c’est-à-dire ville du prophète). C’est de cette année que date l’ère mahométane (*) nommée hégire, ou fuite. Mahomet avait à Médine un certain nombre de partisans qui avaient gagné les habitants à sa cause. Ils vinrent à la rencontre du prophète méprisé, et le saluèrent comme roi et prophète.
(*) C’est-à-dire que c’est à partir de cette époque que les mahométans comptent leurs années, comme nous les comptons à partir de la naissance du Seigneur.
Ce fut le commencement de ses succès. Ses révélations lui ordonnèrent d’employer le glaive contre les idolâtres et ceux qui ne se soumettraient pas à lui. Une grande armée de ses ennemis, à laquelle s’étaient joints les Juifs, vint investir Médine ; mais Mahomet réussit à semer la division parmi les principaux chefs qui, l’un après l’autre, abandonnèrent le siège. Une trêve de dix ans fut conclue, d’où les Juifs étaient exclus. Mahomet assiégea et prit plusieurs de leurs villes, s’empara de leurs biens, fit prisonniers leurs femmes et leurs enfants, et tua la plupart des hommes.
Les habitants de la Mecque ayant violé la trêve, Mahomet, à la tête de dix mille guerriers, les attaqua et s’empara de la ville. Les habitants se soumirent à lui et il pardonna à tous ceux qui embrassèrent sa foi. Ensuite il détruisit les 360 idoles qu’ils adoraient, fit disparaître tout vestige d’idolâtrie, orna leur temple et le consacra au culte du seul Dieu. Puis il fit ses prières et ses dévotions dans le sanctuaire appelé Kaaba, petit édifice qui se trouve au milieu du temple et que l’on dit avoir été érigé par Abraham. Là se trouve une pierre noire, objet de la vénération des fidèles, et qui passe pour avoir été autrefois un autel consacré au vrai Dieu (*).
(*) Chaque année des milliers de mahométans de tous pays viennent en pèlerinage à la Mecque, la ville sainte. Tout mahométan doit faire ce pèlerinage au moins une fois en sa vie. Il en rapporte le titre de « hadji », c’est-à-dire pèlerin.
Mahomet devint ainsi chef suprême, à la fois religieux et temporel, de toute l’Arabie. Il projetait d’attaquer l’empire romain d’Orient qui subsistait encore, mais la mort mit un terme à ses desseins. En l’an 632, il fit encore un pèlerinage à la Mecque, et là, après avoir fait ses dévotions, s’adressant à la foule qui l’entourait, il dit : « Écoutez mes paroles et qu’elles descendent dans vos cœurs. Je vous ai laissé une loi. Si vous vous y attachez, elle vous préservera toujours de l’erreur. C’est une loi claire et positive, un livre dicté d’en haut. Ô mon Dieu ! ai-je accompli ma mission ? ». Et mille voix répondirent : « Oui, tu l’as accomplie ! » Le prophète ajouta : « Ô mon Dieu ! entends ce témoignage ». On voit comment jusqu’au bout, il séduisait les autres, étant séduit lui-même (2 Timothée 3:13). L’esprit de mensonge, sous de beaux semblants, parlait par sa bouche.
Mahomet retourna chez lui et mourut peu après. La nouvelle de sa mort jeta une grande consternation chez tous ses sectateurs, qui avaient pensé qu’un prophète tel que lui ne pouvait pas mourir. Mais quelqu’un de la foule s’écria : « Musulmans, sachez que Mahomet est mort, mais Dieu est vivant et ne peut mourir. Oubliez-vous ce passage du Coran : « Mahomet n’est pas plus qu’un apôtre ; d’autres apôtres sont morts avant lui ». Et cet autre passage : « Tu mourras certainement, ô Mahomet ! et eux aussi mourront » ?
Cette citation du Coran apaisa les esprits : il était clairement révélé que le prophète devait mourir. Alors se posa la question importante de savoir qui lui succéderait. Abou Bekr, dont Mahomet avait épousé la fille, fut élu, et devint ainsi le premier « calife », c’est-à-dire le vicaire ou remplaçant de Mahomet.
* * *
Le caractère personnel de Mahomet n’apparaît pas sous un jour bien élevé. Avait-il besoin d’une sanction sur un de ses actes, si injuste ou déloyal ou immoral fût-il, il apportait aussitôt une révélation qu’il disait tenir de Dieu. Plus d’une fois il se justifia ainsi d’avoir tué ses ennemis, violé ses serments et épousé l’une après l’autre plusieurs femmes. Nous avons déjà dit un mot de sa doctrine. Il reconnaissait les Écritures saintes, auxquelles il avait emprunté plusieurs choses, comme étant des livres divins, mais il prétendait que les Juifs et les chrétiens les avaient altérées, et que lui avait été envoyé pour rétablir la vérité. Il tenait pour des prophètes suscités pour instruire les hommes, Noé, Abraham, Moïse et d’autres, nommés dans l’Ancien Testament. Mais à l’égard du Seigneur Jésus, notre adorable Sauveur, son langage est tout à fait blasphématoire. Il dit bien : « Le plus grand de tous les prophètes est Jésus, le Fils de Marie », mais il niait qu’il fût le Fils de Dieu. « Le Messie Jésus », dit-il, « le fils de Marie, n’est qu’un apôtre de Dieu… Dieu est un seul Dieu ; c’est porter atteinte à sa gloire de dire qu’il a un Fils. Ce sont des infidèles ceux qui disent que le Messie, fils de Marie, est Dieu. Dieu est un, Dieu est éternel ; il n’engendre point et n’a pas été engendré. Il n’y a personne qui lui soit semblable ». Tout cela est formellement opposé à ce que nous dit la parole de Dieu (lire avec soin Jean 1:1, 14, 18 ; Romains 1:3-4 ; 9:5 ; Philippiens 2:6 ; Colossiens 1:14-17 ; Hébreux 1:1-3 ; 1 Jean 1:1 ; 4:15). Que nous dit encore l’apôtre Jean : « Quiconque nie le Fils n’a pas non plus le Père » (1 Jean 2:23), c’est-à-dire qu’il ne connaît pas vraiment Dieu, et ne peut être son enfant. Jean dit aussi : « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie » (1 Jean 5:12). Et cette vie est la vie éternelle. On n’a donc la vie éternelle, on ne peut donc être sauvé qu’en reconnaissant Jésus comme étant le Fils de Dieu, et en croyant en Lui (Jean 3:16, 18, 36). Nous voyons ainsi dans quelle erreur mortelle l’islam retient les âmes.
Mahomet insistait sur l’unité de Dieu. Il semble beau et grand de dire : « Il n’y a qu’un seul Dieu ; Dieu est éternel, etc ». Cela est certain du vrai Dieu, mais le Dieu de Mahomet est-il le vrai Dieu, Celui que l’Écriture nous révèle ? Non. Dieu est lumière, et le Coran n’est que ténèbres, car il ne révèle pas Dieu dans sa nature comme Père, Fils et Saint Esprit, ni dans son caractère moral, et il ne fait pas connaître le moyen, pour l’homme pécheur, d’être sauvé et d’approcher d’un Dieu juste et saint. Dieu est amour, et le Coran ne respire que haine, vengeance et meurtre. Dieu est saint et pur, et le Coran sanctionne toutes les convoitises et va jusqu’à promettre à ses sectateurs un paradis de jouissances sensuelles. C’est un des moyens par lesquels il retient les hommes dans ses liens, en flattant la chair et ses passions, tandis que l’apôtre Paul nous dit que « ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises » (Galates 5:24).
L’islam est donc tout l’opposé du vrai christianisme ; il est une œuvre du diable, une affreuse séduction de l’ennemi, qui a ainsi entraîné des millions d’âmes et en retient des millions dans une erreur mortelle, loin du vrai Dieu et du salut. Les conquêtes des successeurs de Mahomet furent rapides et s’étendirent au loin, et, de nos jours, deux cents millions d’hommes sont courbés sous ce joug. On pourrait penser que la religion de Mahomet est un progrès sur le paganisme, en ce qu’elle tourne les pensées de l’homme vers un Dieu unique, invisible et éternel. Mais ce Dieu n’est pas plus le vrai Dieu que ne le sont les idoles, puisque comme elles, il laisse l’homme se livrer à ses passions, et qu’il n’ouvre pas, au pécheur perdu, la voie du salut, de la vie et de la paix. « C’est ici la vie éternelle », dit le Seigneur, « qu’ils te connaissent seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ » (Jean 17:3). Voilà la voie royale, celle du salut, de la vie et du ciel, car Jésus a dit : « Je suis le chemin, et la vérité, et la vie ; nul ne vient au Père que par moi » (Jean 14:6). Quel contraste avec l’islam qui proclame : « Il y a un seul Dieu, et Mahomet est son prophète », qui tolère le péché et verse le sang ! L’islam, précisément parce qu’il a une certaine apparence de vérité supérieure au paganisme, tient d’autant plus loin de Christ ses sectateurs. C’est une chose très rare de voir un mahométan devenir chrétien, tandis que des millions de païens croient en Christ pour le salut. Quel accord peut-il y avoir entre un mahométan et un vrai chrétien, si ce n’est que celui-ci priera pour l’autre, afin que Dieu l’éclaire ? Rendons grâces à Dieu qui s’est fait connaître à nous par son Fils, en qui sont venues « la grâce et la vérité », et prions pour les mahométans, aussi bien que pour les païens, et pour les ouvriers du Seigneur qui travaillent chez les uns et chez les autres.
 Re: L’ÉGLISE : UNE ESQUISSE DE SON HISTOIRE PENDANT VINGT SIÈCLES
Re: L’ÉGLISE : UNE ESQUISSE DE SON HISTOIRE PENDANT VINGT SIÈCLES
6 - L’Église Romaine et sa Domination
6.1 - La Papauté et le Papisme
Tandis que l’islam, la religion du faux prophète, envahissait de vastes contrées, principalement en Orient, et en faisait presque disparaître le nom chrétien, que devenait l’Église ? Laissant de côté, si importante que serait leur histoire, ce que l’on nomme l’Église grecque et les diverses églises et sectes chrétiennes de l’Orient, nous nous bornerons presque exclusivement à l’Église occidentale. Elle subsiste encore maintenant, bien qu’amoindrie, et prend le nom d’Église catholique, apostolique et romaine. Nous en avons déjà dit quelques mots.
Cette Église constitue un vaste système qui s’est formé peu à peu sur les ruines de l’Église primitive à laquelle elle prétend se rattacher, mais dont elle n’est que la corruption, et qui s’est développé surtout au Moyen Âge, son apogée se plaçant du 11° au 14° siècle. Elle se pare du titre de catholique ou universelle, mais à tort, car nombre de ceux qui professent le christianisme, comme les adhérents aux Églises d’Orient et aux diverses dénominations protestantes, se sont séparés d’elle : elle groupe à peu près la moitié des hommes qui se disent chrétiens. Elle prend le nom d’apostolique, parce qu’elle se dit fondée par des apôtres, ce qui est inexact, et parce qu’elle prétend suivre leurs enseignements, dont, au contraire, elle s’est largement écartée, ainsi que son histoire et ses doctrines le montrent. Enfin, elle ajoute à ces titres celui de romaine, et à bon droit, parce que le pape, qui dans l’origine, était simplement l’évêque de Rome, en est le chef suprême. De là vient le nom de Romanisme que l’on donne à l’ensemble de son organisation, de son culte et de ses doctrines. On emploie aussi les termes de Papauté et de Papisme, le premier de ces mots s’appliquant à la suite des papes et à leur pouvoir, le second au système religieux dont le pape est le chef.
6.2 - La Papauté
L’Église romaine dit être la seule vraie Église, et ses docteurs prétendent que hors d’elle il n’y a point de salut. C’est ainsi que, par la crainte d’être perdues, elle retient dans son sein quantité d’âmes ignorantes. Cette prétention est-elle vraie ? Ceux qui ne possèdent pas la Bible, la parole de Dieu, peuvent le croire sur la foi des prêtres et des catéchismes qui les instruisent, mais que dit l’Écriture sainte ? C’est que la vraie Église — l’Église de Dieu — est formée de tous les vrais croyants au Seigneur Jésus, qui sont lavés de leurs péchés dans le sang de l’Agneau et scellés de l’Esprit Saint, qu’ils appartiennent ou non à l’Église romaine. Ils ne sont pas sauvés parce qu’ils font partie d’une Église ou d’une forme religieuse quelconque, mais ils sont sauvés parce qu’ils croient au Seigneur Jésus, et alors ils appartiennent à l’Église ou l’Assemblée de Dieu. L’Écriture dit : « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé », et non : crois à l’Église ; et encore : « Il n’y a de salut en aucun autre (que Jésus) ; car aussi il n’y point d’autre nom sous le ciel, qui soit donné parmi les hommes, par lequel il nous faille être sauvés » (Actes 16:31 ; 4:12) ; mais elle ne dit pas « hors de l’Église romaine ou d’une autre, il n’y a point de salut ».
L’Église romaine, comme celle d’Orient et d’autres systèmes religieux dans la chrétienté, se compose de deux classes de personnes, le clergé et le peuple ou les laïques : distinction que nous ne trouvons pas dans la parole de Dieu. Le Seigneur disait à ses disciples : « Vous êtes tous frères » (Matthieu 23:8). Il est vrai que, dans sa grâce, il a donné des apôtres et prophètes, des évangélistes, des pasteurs et docteurs, pour fonder et former l’Église ou l’Assemblée, puis pour l’édifier, la nourrir, l’exhorter et l’instruire (Éphésiens 4:11-13) ; mais ils ne constituent pas une caste à part ; ils sont des serviteurs de Christ et de l’Église (Colossiens 1:23-25), et des membres du corps de Christ, sans plus de prérogative ou d’autorité que le plus faible chrétien (1 Corinthiens 12:13, 18-23, 28).
Le clergé, dans l’Église romaine, comprend tous les prêtres, évêques, archevêques, cardinaux, et enfin à la tête de tous, le pape, qui s’intitule chef de l’Église et vicaire de Jésus Christ, c’est-à-dire son représentant ou son substitut sur la terre. On peut aisément voir combien cette prétention est contraire à la parole de Dieu. Celle-ci nous dit que Christ, dans le ciel, est le Chef ou la Tête de l’Église ou l’Assemblée qui est son corps (Éphésiens 1:22-23 ; Colossiens 1:18), et nulle part, elle ne nous parle d’un chef sur la terre. Sur quoi donc les papes de Rome s’appuient-ils pour s’arroger une telle position ? Ils disent que c’est comme successeurs de l’apôtre Pierre, qui, d’après eux, était le chef des apôtres, et qui a été le premier évêque ou pape de Rome, selon leur dire. Ils citent comme preuve les passages où il est dit : « Tu es Pierre (*) ; et sur cette pierre (**) je bâtirai mon assemblée (ou Église), et les portes du hadès (***) ne prévaudront pas contre elle ». Et encore : « Je te donnerai les clefs du royaume des cieux ; et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux ; et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux » (Matthieu 16:18-19). Mais ni ces passages, ni aucun autre dans l’Écriture, ne disent que Pierre eût une autorité quelconque sur les autres apôtres. En premier lieu, le roc sur lequel l’Église est bâtie, n’est pas Pierre, mais la vérité contenue dans la confession qu’il fit que Jésus était « le Christ, le Fils du Dieu vivant » (Verset 16). Pierre n’était qu’une pierre dans l’édifice de l’Église qui devait s’élever après la mort, la résurrection et l’ascension du Seigneur. Il est vrai que les apôtres et prophètes sont le fondement de l’Église, mais Pierre ne l’est pas plus qu’un autre (Éph. 2:20 ; Apoc. 21:14), et la maîtresse pierre du coin n’est pas Pierre, mais Jésus Christ, comme Pierre lui-même le dit (1 Pierre 2:4-6). Ainsi les prétentions des papes n’ont aucun fondement de vérité et ravissent au Seigneur Jésus sa gloire.
(*) Littéralement « une pierre ».
(**) Littéralement « ce roc ».
(***) Le hadès, le lieu invisible, où les âmes des hommes vont après la mort. Ce mot a été traduit improprement par enfer.
Les docteurs de l’Église romaine prétendent aussi que les paroles du Seigneur à Pierre : « Pais mes brebis » et « pais mes agneaux » (Jean 21:15-17), sont une preuve que Pierre et ses successeurs étaient établis sur les prêtres en général, désignés par les brebis, et sur les laïques, représentés par les agneaux. Mais la triple exhortation du Seigneur avait pour but de réintégrer Pierre après sa chute, et de lui confier les agneaux et les brebis de la circoncision, c’est-à-dire les Juifs qui se convertiraient. Pierre était essentiellement l’apôtre de la circoncision, c’est-à-dire l’envoyé du Seigneur auprès des Juifs, comme Paul était l’apôtre de l’incirconcision, c’est-à-dire l’envoyé du Seigneur auprès des nations, des païens (Galates 2:7-10), bien qu’à l’occasion, Pierre ait prêché l’Évangile aux nations, et Paul aux Juifs. À qui s’adresse la première épître de Pierre ? C’est aux Juifs convertis dispersés parmi les nations. Et d’où l’écrivait-il ? De Babylone, loin de Rome, au milieu des nombreux Juifs qui s’y trouvaient (1 Pierre 1:1 ; 5:13). Qu’il ait jamais été à Rome, est une chose douteuse ; qu’il en ait été le premier pape, n’a point de fondement solide.
Enfin, quant aux clefs du royaume des cieux confiées à Pierre, en tout cas ce ne sont pas celles du ciel. Il ouvrit le royaume des cieux aux Juifs le jour de la Pentecôte, en leur annonçant l’Évangile, et il l’ouvrit à Corneille et aux gentils, en leur prêchant Christ (Actes 2:36-41 ; 10:43-48). Les Juifs y étaient reçus, bien qu’ils eussent rejeté Christ, s’ils se repentaient et croyaient en Lui ; et les gentils, bien que n’y ayant aucun droit, y étaient aussi reçus en croyant au Seigneur, et ainsi des deux peuples, Christ n’en faisait qu’un (Éphésiens 2:13-15). C’est ainsi que Pierre fit usage des clefs qui lui étaient confiées par le Seigneur. Il lia et délia, en annonçant aux uns et aux autres que leurs péchés étaient pardonnés s’ils croyaient au Seigneur Jésus ; mais que, s’ils étaient incrédules, ils périraient. Mais lier et délier n’appartenait pas seulement à Pierre. Le Seigneur dit que c’est le privilège des deux ou trois assemblés en son nom, c’est-à-dire de toute assemblée ou Église de Dieu, si peu nombreuse soit-elle ; et il étend le même privilège de remettre ou retenir les péchés à tous les disciples individuellement (Matthieu 18:18-20 ; Jean 20:23). Sans doute que le Seigneur accorda un grand honneur à Pierre ; mais a-t-il eu des successeurs ? Nulle part, dans la parole de Dieu, il n’est question de succession apostolique, ni de succession d’aucun genre à des charges ecclésiastiques. Paul, avant son départ, dit aux anciens d’Éphèse : « Je vous recommande à Dieu, et à la parole de sa grâce » (Actes 20:32), et non aux prêtres, aux évêques, ni au pape, ni à l’Église.
À proprement parler, le clergé, et le pape à sa tête, est ce qui constitue l’Église romaine. Ils forment une caste à part, et sont les intermédiaires entre Dieu et les hommes. Les laïques ne sont rien, et n’ont qu’à recevoir et croire les yeux fermés ce que l’Église dit ; car l’Église n’a pas erré, et ne peut errer, disent les docteurs romains. Elle est infaillible dans ses enseignements, et son chef, le pape, est infaillible lorsqu’il parle ex cathedra (du haut de la chaire) pour définir une doctrine de l’Église universelle. Aux laïques il appartient d’obéir, et ceux qui, laïques on non, ne se soumettent pas en tout aux enseignements de l’Église ou s’en écartent, sont des hérétiques, que l’Église rejette de son sein, et même, quand elle en a eu le pouvoir, elle les a livrés au bras séculier pour être punis. C’est ainsi qu’au Moyen Âge surtout, ont sévi de cruelles persécutions contre les saints qui s’attachaient à la parole de Dieu et dont l’Église romaine a fait verser le sang (Apocalypse 17:6).
L’Écriture, qui parle d’anciens et de serviteurs de Dieu dans l’Assemblée ou l’Église, ne forme d’eux nullement une caste à part. Ils sont appelés à être les modèles du troupeau, et ne doivent pas dominer sur lui (1 Pierre 5:2-4). Ils sont établis de Dieu, et non par l’homme, ni en vertu d’une succession (Actes 20:28). Et quant à l’Église, elle n’enseigne pas, mais elle doit être la colonne et le soutien de la vérité (1 Timothée 3:15), et cette vérité est la parole de Dieu, que les serviteurs de Dieu annoncent, expliquent et appliquent, et que l’Église a la responsabilité de maintenir. Or l’Église romaine, loin d’être la colonne de la vérité, s’en prétend la source et, en fait, enseigne et soutient l’erreur mêlée à la vérité.
L’Église romaine se vante aussi de son unité. Elle est une en effet extérieurement, en ce sens que tous ceux qui professent la reconnaître sont soumis à son joug. La vraie Église de Christ, l’Assemblée qui est son corps, est seule réellement une, selon ce que dit l’apôtre : « Il y a un seul corps », dont Christ est la Tête, et dont tous les vrais croyants sont les membres (Éphésiens 1:23 ; 4:4 ; 1 Corinthiens 12:12, 13). Mais l’Église a sa manifestation extérieure, et aurait dû en cela montrer l’unité. Malheureusement Satan a réussi à y semer la division ; l’Église a manqué, et l’on ne voit, dans ce qui se nomme la chrétienté, que divisions et sectes.
On aurait peine à s’imaginer, si l’histoire ne l’attestait, jusqu’où l’ambition a pu conduire certains papes de Rome. Non contents de dominer sur le clergé entier et par le clergé sur le peuple, ils prétendirent être au-dessus des princes, des rois et des empereurs. Tous leurs efforts, durant des siècles, ont tendu à établir ce pouvoir universel, au temporel aussi bien qu’au spirituel. Sans entrer dans des détails, ni présenter l’histoire des usurpations successives des papes dans ces deux domaines, je citerai quelques exemples.
Le pape Grégoire VII (*), homme énergique, qui voulait réformer l’Église et la purifier de la corruption profonde dans laquelle le clergé était tombé, disait, non sans orgueil : « Le pontife romain est évêque universel ; son nom n’a point son pareil dans le monde entier. À lui seul appartient de déposer les évêques, comme aussi de les réintégrer. Tous les princes sont tenus de lui b..... les pieds. Il a le droit de déposer les empereurs, et de délier les sujets de leurs devoirs envers eux… Tous les royaumes doivent être regardés comme des fiefs (comme dépendants) du siège de saint Pierre. L’Église ne doit pas être la servante des princes, mais leur maîtresse. Ayant reçu le pouvoir de lier et délier dans le ciel, à plus forte raison l’a-t-elle dans les choses terrestres ». Ces paroles audacieuses rappellent ce que nous dit l’Esprit Saint, au 17° chapitre de l’Apocalypse, où la fausse Église de l’avenir, Babylone, est représentée comme une femme assise sur la bête qui figure la puissance impériale (Versets 3 à 6).
(*) Il occupa le siège pontifical de 1073 à 1085.
C’est ce même pape qui exigea que tous les ecclésiastiques fussent voués au célibat, afin d’avoir toute une armée d’hommes dégagés des liens de famille et dévoués à l’Église romaine, et qui n’attendissent que de Rome leur mot d’ordre. Auparavant les prêtres pouvaient être mariés ou non ; les moines seuls ne devaient pas l’être. Grégoire voulut que les prêtres qui étaient mariés se séparassent de leurs femmes, et comme un grand nombre se révoltaient contre cette mesure, il leur dit : « Peut-il espérer d’avoir le pardon de ses péchés, celui qui méprise l’homme qui ouvre et ferme à sa volonté la porte du ciel (*) ? Ceux-là attirent sur leurs têtes la colère divine et la malédiction apostolique ». Ce célibat forcé n’est-il pas en opposition avec ce que nous apprend Paul, quand il dit : « Il faut que le surveillant (ou évêque) soit irrépréhensible, mari d’une seule femme » (1 Timothée 3:2), et qu’à Tite il dit que l’ancien (ou prêtre) soit « mari d’une seule femme » ? (Tite 1:6). Et n’est-ce pas la réalisation des paroles prophétiques de Paul : « Défendant de se marier » ? (1 Timothée 4:3).
(*) Nous voyons par ces paroles quelle autorité Grégoire VII attribuait aux papes. Qui peut ouvrir ou fermer, si ce n’est Christ ? (Apocalypse 3:7).
Innocent III, l’un des successeurs de Grégoire (*), et grand persécuteur des fidèles de son temps, disait : « Le serviteur que le Seigneur a établi sur son peuple, est le vicaire de Christ, le successeur de saint Pierre. Il est l’oint du Seigneur : entre Dieu et les hommes : au-dessous de Dieu, au-dessus des hommes ; moindre que Dieu, plus que l’homme. Il juge tout et n’est jugé par personne ». Quel langage audacieux et blasphématoire, qui rappelle ce que l’apôtre dit de l’homme de péché ! (2 Thessaloniciens 2:3-4). Ce n’est pas que les papes soient l’homme de péché : celui-ci paraîtra quand les saints auront été ravis auprès du Seigneur, mais ils portent le même caractère d’orgueil. Quelle différence avec Pierre, dont ils se disent les successeurs ! Le saint apôtre écrivait : « J’exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux » (**), et non au-dessus d’eux.
(*) Il fut pape de 1198 à 1216.
(**) 1 Pierre 5:1.
Quels sombres temps que ceux que l’on nomme le Moyen Âge ! Pour tenir les princes et leurs sujets sous leur domination et celle du clergé, les papes se servirent d’une arme redoutable, surtout dans ces temps d’ignorance et de superstition. C’est l’interdit. Plus tard, ils établirent le terrible tribunal de l’inquisition, dont nous parlerons.
L’interdit était une sentence par laquelle étaient défendus l’administration des sacrements, le culte public et les funérailles ecclésiastiques, c’est-à-dire accomplies avec les cérémonies de l’Église. L’interdit pouvait être prononcé contre une personne ; elle était ainsi excommuniée, privée de tout culte, ne pouvant entrer dans une église, et considérée comme un lépreux avec qui on ne devait avoir aucune communication. Elle était séparée de la communion chrétienne et bannie du royaume céleste, disait Rome. Les papes, au temps de leur puissance, osèrent frapper d’interdit des rois et des empereurs, comme l’histoire nous l’apprend, et causèrent ainsi de grands troubles et des guerres. Quelquefois l’interdit frappait une ville, un territoire ou un pays, et alors tous les habitants étaient comme excommuniés. Les enfants restaient sans baptême, on ne sonnait plus les cloches pour appeler les fidèles aux églises, on ne célébrait aucun culte, ni cérémonie religieuse, le clergé ne portait plus aux malades et aux mourants les consolations de la religion, et les morts étaient portés en terre sans qu’un prêtre les accompagnât. La terreur était ainsi jetée dans les âmes simples et superstitieuses de cette époque. Tel est encore un trait de la puissance que les papes s’étaient arrogée sur les âmes pour les soumettre.
On comprend que les princes et les peuples aient porté impatiemment ce joug et lutté pour s’y soustraire. Depuis les temps de la Réformation, l’Église romaine a dû renoncer à faire valoir ses prétentions de domination sur les princes et leurs sujets, et à se servir de l’interdit. Mais au fond, elle n’a pas changé. Ne pouvant dominer ouvertement, elle cherche à s’assujettir les consciences, et a bien des moyens pour y parvenir, étant d’une habileté consommée pour arriver à ses fins. C’est une puissance en apparence très déchue et amoindrie, mais qui subsiste toujours et a une grande vitalité. Nous vivons au milieu d’elle, et elle est industrieuse pour attirer à elle et séduire les âmes par ses cérémonies, son culte pompeux qui parle aux sens, et parce qu’elle sait revêtir un beau semblant de piété et de vérité, de manière à répondre aux besoins religieux de certaines âmes. Et c’est parce qu’on peut aisément se laisser enlacer par les séductions (Apocalypse 2:20) de cette Église qui se dit la seule vraie, qu’il est bon qu’elle soit présentée sous ses véritables traits, en présence de la parole de Dieu.
Mais avant de parler de ses enseignements erronés, il faut nous rappeler qu’elle confesse et conserve les grandes vérités fondamentales que nous enseigne la parole de Dieu. Ainsi, elle maintient qu’il n’y a qu’un seul Dieu en trois Personnes, le Père, le Fils, et le Saint Esprit (Matthieu 28:19). Elle confesse aussi que Jésus Christ, le Fils unique et éternel de Dieu, une Personne divine, est devenu un homme sur la terre, pour accomplir sur la croix la rédemption des pécheurs (Jean 1:1-18). Elle reconnaît qu’il y a un ciel pour les sauvés, et un enfer pour les incrédules. Il peut donc y avoir, et il y a eu dans son sein de vrais enfants de Dieu, des âmes qui, croyant simplement au nom, à l’amour et au sacrifice du Seigneur Jésus, sont sauvés, car « celui qui croit au Fils a la vie éternelle » (Jean 3:36). Mais l’Église romaine a enfoui ces saintes vérités et d’autres qui s’y rapportent, sous un amas d’ordonnances, de cérémonies et de pratiques extérieures, et y a joint quantité d’erreurs, de sorte que ce sont ces choses-là qui prédominent, et qu’elle présente comme nécessaires au salut, au lieu de la foi simple au Seigneur Jésus. De cette manière, les âmes sont retenues loin de Dieu et du Sauveur, et ainsi elles sont privées de la paix ; et de plus, elles sont livrées, comme nous le verrons, à une idolâtrie pire que celle du paganisme. Le christianisme par elle est entièrement défiguré, et quantité d’âmes sont conduites à la perdition.
On demandera peut-être : « Cette Église ne reconnaît-elle donc pas la Bible, les Écritures, comme la parole de Dieu, puisqu’elle s’écarte tellement de son enseignement ? ». Oui, certainement elle les reconnaît comme telle, et c’est même un fait digne de remarque que c’est elle qui a conservé ce dépôt des Écritures qui la condamnent, de même qu’autrefois les Juifs conservaient l’Ancien Testament (Romains 3:2). C’est dans les couvents de l’Église romaine que des moines copiaient les manuscrits de la Bible et les gardaient soigneusement. Mais comme les Juifs l’avaient fait aussi — sans parler des livres apocryphes (*), qu’elle a joints au saint volume — elle a mis à côté de l’Écriture la tradition qu’elle nomme la parole de Dieu non écrite, et dont elle prétend avoir le dépôt. C’est sur la tradition qu’elle appuie ses erreurs et ses pratiques religieuses, et ainsi, comme autrefois le Seigneur le reprochait aux Juifs, elle annule l’Écriture par ses traditions (Matthieu 15:3-6).
(*) Les livres apocryphes (ou cachés) sont des compositions qui n’ont jamais été reçues comme inspirées, par les Juifs, auxquels les oracles de Dieu ont été confiés (Romains 3:2) ; néanmoins le concile de Trente (dans le seizième siècle) les a déclarés divins.
Mais il y a plus. Une autre chose empêche les âmes soumises au joug de l’Église romaine de venir s’éclairer à la pure lumière de la parole de Dieu. Elle a longtemps défendu aux laïques la lecture des saintes Écritures. Seule l’Église peut les interpréter, et ceux qui s’écartent du sens qu’elle leur donne sont condamnés. Il était même défendu autrefois de les traduire en langue vulgaire, et si le fait se produisait, on brûlait les exemplaires que l’on pouvait saisir. Telle était la loi de l’Église au Moyen Âge. Nous en avons la preuve dans un décret du concile de Toulouse tenu en 1229, qui le premier défendit d’une manière formelle la lecture de la Bible : « Nous défendons aussi au commun peuple, de posséder aucun des livres de l’Ancien ou du Nouveau Testament, sauf peut-être le Psautier, ou le Bréviaire, ou les Heures de la Sainte Vierge, que quelques-uns par dévotion désireraient posséder, mais avoir un seul même de ces livres en langue vulgaire est strictement défendu ». Or l’on sait que les Heures de la Vierge, livre de dévotions adressées à la Vierge, ne font pas du tout partie des Écritures, non plus que le Bréviaire qui, à côté de portions de la Bible, renferme beaucoup de choses qui lui sont contraires. Mais le clergé ne voulait pas que le peuple illettré et aveuglé s’aperçût de cette distinction. C’était en effet un temps de grande ignorance où un bien petit nombre de personnes savaient lire. Le clergé en profitait pour exercer une autorité d’autant plus absolue sur le peuple. Il usait aussi de son influence pour engager le pouvoir civil à défendre la lecture de la Bible. Ainsi, en 1394, un arrêt de la Chambre des Lords en Angleterre l’interdisait. Les prêtres disaient à propos de la traduction de la Bible en langue vulgaire : « Hélas ! la perle de l’Évangile est maintenant jetée aux pourceaux et foulée par eux. L’Évangile que Christ avait donné au clergé pour qu’il le garde, devient maintenant le partage des laïques ».
On dira peut-être : « C’est dans le Moyen Âge seulement que les choses se passaient ainsi ». Ce serait une erreur de le penser. En l’an 1526, ce que l’on nomme le Moyen Âge était passé, et l’Anglais Tyndall, un serviteur de Dieu, avait traduit dans sa langue maternelle et fait imprimer le Nouveau Testament. L’évêque de Londres ayant appris que ces livres étaient destinés à être répandus en Angleterre, acheta toute l’édition et la fit brûler à Londres. En 1530, le même fait se renouvela. On ne se contentait même pas de brûler les saintes Écritures ; maintes fois le même sort atteignait ceux qui les possédaient et les lisaient. Ainsi, en 1519, une pauvre veuve, mère de plusieurs enfants, fut brûlée vive, parce qu’on avait trouvé sur elle l’oraison dominicale, les dix commandements et le symbole des apôtres en anglais. Telle était la frayeur qu’inspirait au clergé la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que la Bible condamne les erreurs et les pratiques de l’Église de Rome. Le clergé, en voyant l’usage que de prétendus hérétiques faisaient des Écritures, pour dévoiler et combattre les abus et les fausses doctrines de cette Église, ne trouvait rien de mieux que d’en défendre la lecture, de peur que les âmes ne vinssent à la lumière. Il inculquait au peuple la pensée — et il cherche encore à le faire — que les laïques ne peuvent comprendre la Bible et que, par sa lecture, ils risquent le salut de leur âme. Un évêque anglais qui vivait à la même époque que la veuve dont j’ai parlé, disait du haut de la chaire : « Ôtez ces traductions nouvelles (celles de la Bible), sans cela une ruine totale menace la religion de Jésus Christ ». Il voulait dire par là l’Église romaine. Et il suppliait le roi de fermer à ce livre l’entrée du royaume.
Mais de nos jours, dira-t-on, il n’en est pas ainsi. L’Église romaine ne change pas. De nos jours, il est vrai, les prêtres catholiques ont traduit en langage vulgaire les saintes Écritures et l’Église autorise les traductions faites par des laïques, mais un laïque soumis à l’Église n’osera pas les lire sans l’approbation du prêtre, et il faudra qu’il accepte l’interprétation que l’Église donne. Encore, en 1883, à Barcelone, par ordre du gouvernement, un certain nombre d’exemplaires des Évangiles furent livrés aux flammes. Et un journal non seulement approuvait ce fait, mais exprimait le désir que les hérétiques qui cherchaient à répandre ce livre partageassent le même sort. Si l’Église romaine ne peut plus, comme au Moyen Âge, faire dresser des bûchers et y faire périr ceux qui ne se soumettent pas à elle, son esprit est resté le même. La parole de Dieu parle de « la femme enivrée du sang des saints, et du sang des témoins de Jésus » (Apocalypse 17:6). Nous verrons, dans la suite de ces pages, combien, hélas ! cela, bien qu’encore futur, a pu déjà s’appliquer à elle.
La défense de lire les Écritures est totalement opposée au témoignage qu’elles rendent. Même un jeune enfant, je veux dire Timothée, avait dès son jeune âge la connaissance des saintes lettres qui rendent sage à salut (2 Timothée 3:15). Paul adjurait les saints que ses lettres fussent lues à tous les saints frères (1 Thessaloniciens 5:27), et qu’elles passassent d’une assemblée à une autre (Colossiens 4:16). L’Esprit Saint louait les Béréens de ce qu’ils contrôlaient par les Écritures les paroles même d’un apôtre (Actes 17:11). Souvenons-nous aussi des paroles de notre Seigneur et Sauveur : « Sondez les Écritures, car vous, vous estimez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi » (Jean 5:39). Tenons donc ferme à la sainte Parole par laquelle nous pouvons juger de toutes choses.
6.3 - Le Papisme
6.3.1 - Les sacrements dans ‘Église Romaine
Après les quelques pages que nous avons consacrées à la papauté, et passant sous silence la triste histoire de la succession des papes, chefs de l’Église romaine, nous passerons à l’examen du culte, des pratiques et des doctrines de cette Église, ce que l’on nomme spécialement le papisme.
Dans le Nouveau Testament, le Seigneur a établi seulement deux ordonnances. D’abord le baptêmes (*1), qui est le signe de l’introduction dans l’Église, la maison de Dieu sur la terre, fondée sur la mort et la résurrection du Seigneur. Mais le baptême ne sauve pas, ne régénère pas, comme l’enseigne l’Église romaine qui affirme que le baptême lave de ce qu’elle appelle le péché originel. L’apôtre Pierre le dit expressément (*2). Par conséquent, quand le Seigneur Jésus dit à Nicodème : « Si quelqu’un n’est né d’eau et de l’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu » (*3), l’eau ne désigne pas le baptême, mais la parole de Dieu, comme Jacques le dit en parlant des chrétiens : « De sa propre volonté », Dieu, le Père des lumières, « nous a engendrés (ou fait naître) par la parole de la vérité » (*4). C’est pourquoi l’apôtre Paul dit : « Dieu… nous sauva… selon sa propre miséricorde, par le lavage de la régénération et le renouvellement de l’Esprit Saint » (*5). Et Pierre dit aussi : « Vous êtes régénérés (ou nés de nouveau)… par la vivante et permanente parole de Dieu » (*6). Ce n’est donc pas le baptême d’eau qui produit la nouvelle naissance, sans laquelle on ne peut entrer dans le royaume de Dieu, mais c’est la parole de Dieu reçue dans le cœur et appliquée à l’âme par la puissance de l’Esprit Saint. C’est l’Esprit Saint qui, par le moyen de la Parole, produit en nous une nature et une vie nouvelles. Le Seigneur dit : « Celui qui entend ma parole, et qui croit celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle » (*7). Ainsi il ne suffit pas d’avoir été baptisé et de porter le nom de chrétien. Pour posséder la vie éternelle, il faut croire du cœur au nom du Fils de Dieu.
(*1) Matthieu 28:19.
(*2) « Or cet antitype (l’antitype de l’arche) vous sauve aussi maintenant, c’est-à-dire le baptême, non le dépouillement de la saleté de la chair, mais la demande à Dieu d’une bonne conscience, par la résurrection de Jésus Christ » (1 Pierre 3:21).
(*3) Jean 3:5
(*4) Jacques 1:18.
(*5) Tite 3:5.
(*6) 1 Pierre 1:23
(*7) Jean 5:24
L’Église romaine, au contraire, présente le baptême comme nécessaire au salut, de sorte qu’un petit enfant n’irait pas au ciel, s’il venait à mourir non baptisé (*), et qu’un adulte qui croirait au Seigneur, mais qui mourrait sans baptême alors qu’il aurait eu la possibilité d’être baptisé, ne serait pas sauvé. L’Écriture nous dit quant aux petits enfants que Jésus est venu les sauver (Matthieu 18:11, 14), et quant à ceux qui sont en âge de raison, elle déclare simplement que celui « qui croit au Fils a la vie éternelle » (Jean 3:36), sans qu’il soit question de baptême. Les apôtres du Seigneur furent-ils baptisés du baptême chrétien ? Non. Le brigand converti sur la croix fut-il baptisé ? Non, et cependant il alla le même jour au Paradis. Toutefois, bien que le baptême d’eau ne sauve pas, cette figure de la mort de Christ, plaçant des « disciples » sous Son autorité, est d’une grande et précieuse signification (Matt. 28:29).
(*) Il va, selon la théologie catholique, dans les limbes, séjour mal défini où les âmes vivent d’une vie inférieure.
L’Église romaine a aussi ajouté plusieurs choses à l’ordonnance du Seigneur. D’abord elle veut que l’eau du baptême soit consacrée par le prêtre — c’est l’eau bénite, à laquelle on attribue bien des vertus, entre autres celle de chasser le démon loin des baptisés. Ensuite, sauf des cas extrêmes, le prêtre seul a le droit d’administrer le baptême. Nous ne voyons rien de semblable dans l’Écriture. C’est d’eau pure et simple que l’on se servait pour baptiser ; c’est Ananias, un simple disciple, qui baptise Paul ; c’est Philippe, qui n’était que diacre ou serviteur, qui baptise l’officier éthiopien ; ce sont les frères de Joppé, venus avec Pierre, qui administrent le baptême à Corneille et aux autres convertis (Actes 8:38 ; 9:18 ; 22:16 ; 10: 47-48).
La seconde ordonnance est la Cène ou souper du Seigneur. Jésus l’a instituée avant sa mort, lorsqu’il était pour la dernière fois à table avec ses bien-aimés disciples et qu’il avait mangé avec eux la Pâque (*1). Mais après être monté dans la gloire, il a rappelé à l’apôtre Paul ce qu’il avait établi la nuit qu’il fut livré, pour que tous les vrais croyants y participent (*2). Nous voyons par là combien notre précieux Sauveur tient à ce que la Cène soit célébrée, de même qu’autrefois l’Éternel tenait à ce que les enfants d’Israël ne négligeassent pas de garder l’ordonnance de la Pâque, qui leur rappelait leur délivrance du pays d’Égypte (*3). C’est que la Cène rappelle aussi aux chrétiens la délivrance bien plus grande dont ils sont les objets. Elle remet en mémoire aux croyants que Christ, dans son amour, a souffert et est mort pour eux. C’est pourquoi Il est appelé « notre Pâque ». « Notre pâque, Christ », dit Paul, « a été sacrifiée » pour nous (*4). La Cène du Seigneur se célèbre très simplement, quand on suit la parole de Dieu. Le pain que l’on rompt et qui est partagé entre tous, représente et rappelle le corps du Seigneur qui a été livré pour nous et offert en sacrifice sur la croix. Le vin contenu dans la coupe, à laquelle tous participent, parce que le Seigneur a dit : « Buvez-en tous » (*5), est le mémorial du sang précieux de Christ, l’Agneau sans défaut et sans tache, qui a été versé pour la rémission des péchés afin de nous racheter et de nous purifier du péché (*6). Et le Seigneur a dit en instituant la Cène, soit en rompant le pain, soit en distribuant la coupe : « Faites ceci en mémoire de moi ». Quelle chose douce et précieuse pour le cœur du chrétien de se rappeler d’une manière spéciale, chaque premier jour de la semaine, le grand et ineffable amour du Sauveur envers lui ! Et il le fait en communion d’amour avec les autres croyants, qui sont, comme lui, membres du corps de Christ (*7).
(*1) Luc 22:19-20.
(*2) 1 Corinthiens 11:23-26
(*3) Deutéronome 16:1-2 ; Exode 12:21-27 ; 34:18 ; Lévitique 23:5 ; Nombres 28:16-17.
(*4) 1 Corinthiens 5:7.
(*5) Matthieu 26:27.
(*6) 1 Pierre 1:18-19 ; 1 Jean 1:7 ; Apocalypse 1:5.
(*7) 1 Corinthiens 12:13 ; 10:17 ; Éphésiens 5:30.
L’apôtre Paul rappelle encore une chose relativement à ce saint repas. Il dit : « Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne » (*). Ainsi, dans la Cène, nous sommes mis en présence de l’amour infini du Seigneur mort pour nous, nous annonçons cette mort au monde coupable, puis nos pensées sont portées en avant vers ce bienheureux jour où Christ reviendra pour consommer sa victoire en transformant nos corps et en nous introduisant dans la gloire avec Lui. Tout nous parle là de son amour. Quel bonheur d’avoir sa place à la table du Seigneur !
(*) 1 Corinthiens 11:26.
Ces ordonnances du Seigneur sont appelées par quelques-uns, et surtout par l’Église romaine, des sacrements. À ce mot se rattache l’idée qu’elles confèrent une certaine grâce spirituelle à celui qui y a part. Nous avons vu qu’aucune grâce n’est conférée par le baptême. C’est un privilège, sans doute, d’être introduit par le baptême dans la maison de Dieu sur la terre ; mais le baptême n’est qu’un signe. Il n’apporte aucun changement dans l’âme de celui qui le reçoit. C’est un très grand privilège de participer à la Cène du Seigneur ; mais on le fait et on en jouit, parce que l’on est déjà sauvé par la mort du Christ, que l’on est membre de son corps, et béni en Lui de toute bénédiction spirituelle (*1). On est heureux de rappeler son amour, on Lui rend grâces et on rend grâces au Père qui nous a introduits dans le royaume du Fils de son amour, et nous a donné une part avec les saints dans la lumière (*2). On adore le Père et le Fils par l’Esprit Saint qui nous a été donné ; mais on a déjà tout reçu en fait de grâces. Seulement dans la Cène, le croyant jouissant de tout ce qu’il a reçu en bénit son Seigneur et son Dieu, et c’est une grâce de pouvoir le faire. Nous verrons plus loin, en parlant de la messe, ce que l’Église romaine a fait de cette ordonnance de la Cène.
(*1) Éphésiens 1:3.
(*2) Colossiens 1:12-14.
6.3.2 - La Confirmation et la Pénitence
Non contente des deux ordonnances établies par le Seigneur, l’Église de Rome a, de son chef, ajouté cinq sacrements au baptême et à la Cène. Le fameux concile de Trente, tenu au 16° siècle (1545-1563), et qui a fixé la doctrine romaine, énumère ainsi les sacrements : le baptême, la confirmation, l’eucharistie (*) ou cène, la pénitence, l’extrême onction, l’ordre (le caractère ecclésiastique des prêtres), et le mariage. À part le baptême et la Cène, les autres sacrements sont des inventions humaines dont nous ne trouvons aucune trace dans l’Écriture. Nous avons parlé du baptême ; disons quelques mots des autres sacrements.
(*) Ce mot signifie actions de grâces. Il désignait d’abord les prières qui accompagnaient la communion ou Cène, et a fini par s’appliquer à la Cène même.
La confirmation, dans l’Église romaine, est une cérémonie qui a pour but de confirmer les grâces du baptême. En général, elle a lieu pour les enfants de 11 à 12 ans avant de les admettre à ce que l’on appelle la première communion, la première participation à la Cène. On prétend les rendre ainsi « parfaits chrétiens, en leur communiquant l’abondance des grâces et des dons de l’Esprit Saint ». C’est à l’évêque qu’il appartient de confirmer. Il le fait par l’imposition des mains, le signe de la croix et l’onction avec l’huile consacrée. Il y ajoute un léger soufflet sur la joue, avec ces mots : « La paix soit avec vous ». Pouvons-nous penser que de semblables actes rendent chrétiens, sinon parfaits chrétiens, ou communiquent l’Esprit Saint ? Est-il question de cela dans l’Écriture ? Nullement. Ces pauvres enfants que l’on confirme ne sont peut-être pas même sauvés. Car c’est par la foi au Seigneur Jésus que nous avons la rédemption, la rémission des péchés par son sang, et ayant cru en Lui, nous recevons l’Esprit Saint. Lisons ce que l’apôtre Paul dit en Éphésiens 1:13: « Ayant entendu la parole de la vérité, l’évangile de votre salut, auquel aussi ayant cru, vous avez été scellés du Saint Esprit de la promesse ». Là il n’est question ni d’évêque, ni d’imposition des mains, ni d’onction. L’homme et ses cérémonies n’y sont pour rien. Tout est de Dieu pour celui qui croit. On entend l’Évangile, on y croit, et Dieu nous donne l’Esprit Saint. Quelle simplicité, quelle grâce !
La pénitence est pour l’Église romaine, le sacrement par lequel sont pardonnés les péchés commis après le baptême. Il requiert du pécheur certaines dispositions qui sont la contrition, la confession, la satisfaction (c’est-à-dire la réparation de l’injure faire à Dieu, par certains actes de piété ou dons, et du tort causé au prochain), et le ferme propos de ne plus commettre une telle faute. Ce sacrement est dispensé uniquement par les évêques ou les prêtres, par la sentence de l’absolution « Je t’absous de tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit ». Où trouvons-nous cela dans l’Écriture ? Où voyons-nous qu’un homme ait le pouvoir de donner l’absolution des péchés ? Où est-il dit que l’on ait à confesser à un tel homme, dans le secret, les fautes que l’on a commises, et qu’il ait l’autorité d’infliger une peine pour les expier ? Nulle part. Sans doute que, si un chrétien est tombé dans quelque faute, il doit la juger, s’en repentir et en avoir horreur. Mais à qui la confessera-t-il ? La parole de Dieu le dit : « Si nous confessons nos péchés, il (c’est-à-dire Dieu) est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité » (*1). À qui David confessa-t-il ses transgressions ? Il le dit : « J’ai dit : Je confesserai mes transgressions à l’Éternel ; et toi, tu as pardonné l’iniquité de mon péché » (*2). Il est vrai qu’en Jacques 5:16, il est écrit : « Confessez donc vos fautes l’un à l’autre, et priez l’un pour l’autre » ; mais cela ne veut pas dire : Confessez vos fautes à un prêtre, mais si vous avez manqué envers un autre, confessez-le lui. C’est une chose que nul ne doit négliger. Les enfants et les jeunes gens ont à confesser à leurs parents et à leurs supérieurs les fautes qu’ils ont commises à leur égard, si cachées qu’elles aient pu être. On n’est jamais heureux quand il reste sur la conscience le poids d’une faute commise (*3). Ont-ils manqué envers un camarade, envers un ami, envers leurs frères ou sœurs, envers leurs parents ou leurs maîtres, envers qui, que ce soit, il faut le confesser simplement, sans restriction et sans excuse et le cœur sera allégé. Et il en est ainsi pour chacun. Mais par-dessus tout, confessez tout à Dieu, qui pardonne, comme il le dit dans sa Parole. Quant à l’absolution donnée par un homme, qui peut pardonner les péchés que Dieu seul ? C’est ce que toute l’Écriture enseigne. Il est bien dit : « À quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis ; et à quiconque vous les retiendrez, ils sont retenus » (*4). Mais il ne s’agit pas ici de l’absolution donnée après une confession secrète à l’oreille d’un prêtre. Le Seigneur, par ces paroles, confie aux disciples la mission d’annoncer au monde la rémission des péchés à ceux qui croient, et au contraire le jugement à ceux qui ne croient pas (*5).
6.1 - La Papauté et le Papisme
Tandis que l’islam, la religion du faux prophète, envahissait de vastes contrées, principalement en Orient, et en faisait presque disparaître le nom chrétien, que devenait l’Église ? Laissant de côté, si importante que serait leur histoire, ce que l’on nomme l’Église grecque et les diverses églises et sectes chrétiennes de l’Orient, nous nous bornerons presque exclusivement à l’Église occidentale. Elle subsiste encore maintenant, bien qu’amoindrie, et prend le nom d’Église catholique, apostolique et romaine. Nous en avons déjà dit quelques mots.
Cette Église constitue un vaste système qui s’est formé peu à peu sur les ruines de l’Église primitive à laquelle elle prétend se rattacher, mais dont elle n’est que la corruption, et qui s’est développé surtout au Moyen Âge, son apogée se plaçant du 11° au 14° siècle. Elle se pare du titre de catholique ou universelle, mais à tort, car nombre de ceux qui professent le christianisme, comme les adhérents aux Églises d’Orient et aux diverses dénominations protestantes, se sont séparés d’elle : elle groupe à peu près la moitié des hommes qui se disent chrétiens. Elle prend le nom d’apostolique, parce qu’elle se dit fondée par des apôtres, ce qui est inexact, et parce qu’elle prétend suivre leurs enseignements, dont, au contraire, elle s’est largement écartée, ainsi que son histoire et ses doctrines le montrent. Enfin, elle ajoute à ces titres celui de romaine, et à bon droit, parce que le pape, qui dans l’origine, était simplement l’évêque de Rome, en est le chef suprême. De là vient le nom de Romanisme que l’on donne à l’ensemble de son organisation, de son culte et de ses doctrines. On emploie aussi les termes de Papauté et de Papisme, le premier de ces mots s’appliquant à la suite des papes et à leur pouvoir, le second au système religieux dont le pape est le chef.
6.2 - La Papauté
L’Église romaine dit être la seule vraie Église, et ses docteurs prétendent que hors d’elle il n’y a point de salut. C’est ainsi que, par la crainte d’être perdues, elle retient dans son sein quantité d’âmes ignorantes. Cette prétention est-elle vraie ? Ceux qui ne possèdent pas la Bible, la parole de Dieu, peuvent le croire sur la foi des prêtres et des catéchismes qui les instruisent, mais que dit l’Écriture sainte ? C’est que la vraie Église — l’Église de Dieu — est formée de tous les vrais croyants au Seigneur Jésus, qui sont lavés de leurs péchés dans le sang de l’Agneau et scellés de l’Esprit Saint, qu’ils appartiennent ou non à l’Église romaine. Ils ne sont pas sauvés parce qu’ils font partie d’une Église ou d’une forme religieuse quelconque, mais ils sont sauvés parce qu’ils croient au Seigneur Jésus, et alors ils appartiennent à l’Église ou l’Assemblée de Dieu. L’Écriture dit : « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé », et non : crois à l’Église ; et encore : « Il n’y a de salut en aucun autre (que Jésus) ; car aussi il n’y point d’autre nom sous le ciel, qui soit donné parmi les hommes, par lequel il nous faille être sauvés » (Actes 16:31 ; 4:12) ; mais elle ne dit pas « hors de l’Église romaine ou d’une autre, il n’y a point de salut ».
L’Église romaine, comme celle d’Orient et d’autres systèmes religieux dans la chrétienté, se compose de deux classes de personnes, le clergé et le peuple ou les laïques : distinction que nous ne trouvons pas dans la parole de Dieu. Le Seigneur disait à ses disciples : « Vous êtes tous frères » (Matthieu 23:8). Il est vrai que, dans sa grâce, il a donné des apôtres et prophètes, des évangélistes, des pasteurs et docteurs, pour fonder et former l’Église ou l’Assemblée, puis pour l’édifier, la nourrir, l’exhorter et l’instruire (Éphésiens 4:11-13) ; mais ils ne constituent pas une caste à part ; ils sont des serviteurs de Christ et de l’Église (Colossiens 1:23-25), et des membres du corps de Christ, sans plus de prérogative ou d’autorité que le plus faible chrétien (1 Corinthiens 12:13, 18-23, 28).
Le clergé, dans l’Église romaine, comprend tous les prêtres, évêques, archevêques, cardinaux, et enfin à la tête de tous, le pape, qui s’intitule chef de l’Église et vicaire de Jésus Christ, c’est-à-dire son représentant ou son substitut sur la terre. On peut aisément voir combien cette prétention est contraire à la parole de Dieu. Celle-ci nous dit que Christ, dans le ciel, est le Chef ou la Tête de l’Église ou l’Assemblée qui est son corps (Éphésiens 1:22-23 ; Colossiens 1:18), et nulle part, elle ne nous parle d’un chef sur la terre. Sur quoi donc les papes de Rome s’appuient-ils pour s’arroger une telle position ? Ils disent que c’est comme successeurs de l’apôtre Pierre, qui, d’après eux, était le chef des apôtres, et qui a été le premier évêque ou pape de Rome, selon leur dire. Ils citent comme preuve les passages où il est dit : « Tu es Pierre (*) ; et sur cette pierre (**) je bâtirai mon assemblée (ou Église), et les portes du hadès (***) ne prévaudront pas contre elle ». Et encore : « Je te donnerai les clefs du royaume des cieux ; et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux ; et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux » (Matthieu 16:18-19). Mais ni ces passages, ni aucun autre dans l’Écriture, ne disent que Pierre eût une autorité quelconque sur les autres apôtres. En premier lieu, le roc sur lequel l’Église est bâtie, n’est pas Pierre, mais la vérité contenue dans la confession qu’il fit que Jésus était « le Christ, le Fils du Dieu vivant » (Verset 16). Pierre n’était qu’une pierre dans l’édifice de l’Église qui devait s’élever après la mort, la résurrection et l’ascension du Seigneur. Il est vrai que les apôtres et prophètes sont le fondement de l’Église, mais Pierre ne l’est pas plus qu’un autre (Éph. 2:20 ; Apoc. 21:14), et la maîtresse pierre du coin n’est pas Pierre, mais Jésus Christ, comme Pierre lui-même le dit (1 Pierre 2:4-6). Ainsi les prétentions des papes n’ont aucun fondement de vérité et ravissent au Seigneur Jésus sa gloire.
(*) Littéralement « une pierre ».
(**) Littéralement « ce roc ».
(***) Le hadès, le lieu invisible, où les âmes des hommes vont après la mort. Ce mot a été traduit improprement par enfer.
Les docteurs de l’Église romaine prétendent aussi que les paroles du Seigneur à Pierre : « Pais mes brebis » et « pais mes agneaux » (Jean 21:15-17), sont une preuve que Pierre et ses successeurs étaient établis sur les prêtres en général, désignés par les brebis, et sur les laïques, représentés par les agneaux. Mais la triple exhortation du Seigneur avait pour but de réintégrer Pierre après sa chute, et de lui confier les agneaux et les brebis de la circoncision, c’est-à-dire les Juifs qui se convertiraient. Pierre était essentiellement l’apôtre de la circoncision, c’est-à-dire l’envoyé du Seigneur auprès des Juifs, comme Paul était l’apôtre de l’incirconcision, c’est-à-dire l’envoyé du Seigneur auprès des nations, des païens (Galates 2:7-10), bien qu’à l’occasion, Pierre ait prêché l’Évangile aux nations, et Paul aux Juifs. À qui s’adresse la première épître de Pierre ? C’est aux Juifs convertis dispersés parmi les nations. Et d’où l’écrivait-il ? De Babylone, loin de Rome, au milieu des nombreux Juifs qui s’y trouvaient (1 Pierre 1:1 ; 5:13). Qu’il ait jamais été à Rome, est une chose douteuse ; qu’il en ait été le premier pape, n’a point de fondement solide.
Enfin, quant aux clefs du royaume des cieux confiées à Pierre, en tout cas ce ne sont pas celles du ciel. Il ouvrit le royaume des cieux aux Juifs le jour de la Pentecôte, en leur annonçant l’Évangile, et il l’ouvrit à Corneille et aux gentils, en leur prêchant Christ (Actes 2:36-41 ; 10:43-48). Les Juifs y étaient reçus, bien qu’ils eussent rejeté Christ, s’ils se repentaient et croyaient en Lui ; et les gentils, bien que n’y ayant aucun droit, y étaient aussi reçus en croyant au Seigneur, et ainsi des deux peuples, Christ n’en faisait qu’un (Éphésiens 2:13-15). C’est ainsi que Pierre fit usage des clefs qui lui étaient confiées par le Seigneur. Il lia et délia, en annonçant aux uns et aux autres que leurs péchés étaient pardonnés s’ils croyaient au Seigneur Jésus ; mais que, s’ils étaient incrédules, ils périraient. Mais lier et délier n’appartenait pas seulement à Pierre. Le Seigneur dit que c’est le privilège des deux ou trois assemblés en son nom, c’est-à-dire de toute assemblée ou Église de Dieu, si peu nombreuse soit-elle ; et il étend le même privilège de remettre ou retenir les péchés à tous les disciples individuellement (Matthieu 18:18-20 ; Jean 20:23). Sans doute que le Seigneur accorda un grand honneur à Pierre ; mais a-t-il eu des successeurs ? Nulle part, dans la parole de Dieu, il n’est question de succession apostolique, ni de succession d’aucun genre à des charges ecclésiastiques. Paul, avant son départ, dit aux anciens d’Éphèse : « Je vous recommande à Dieu, et à la parole de sa grâce » (Actes 20:32), et non aux prêtres, aux évêques, ni au pape, ni à l’Église.
À proprement parler, le clergé, et le pape à sa tête, est ce qui constitue l’Église romaine. Ils forment une caste à part, et sont les intermédiaires entre Dieu et les hommes. Les laïques ne sont rien, et n’ont qu’à recevoir et croire les yeux fermés ce que l’Église dit ; car l’Église n’a pas erré, et ne peut errer, disent les docteurs romains. Elle est infaillible dans ses enseignements, et son chef, le pape, est infaillible lorsqu’il parle ex cathedra (du haut de la chaire) pour définir une doctrine de l’Église universelle. Aux laïques il appartient d’obéir, et ceux qui, laïques on non, ne se soumettent pas en tout aux enseignements de l’Église ou s’en écartent, sont des hérétiques, que l’Église rejette de son sein, et même, quand elle en a eu le pouvoir, elle les a livrés au bras séculier pour être punis. C’est ainsi qu’au Moyen Âge surtout, ont sévi de cruelles persécutions contre les saints qui s’attachaient à la parole de Dieu et dont l’Église romaine a fait verser le sang (Apocalypse 17:6).
L’Écriture, qui parle d’anciens et de serviteurs de Dieu dans l’Assemblée ou l’Église, ne forme d’eux nullement une caste à part. Ils sont appelés à être les modèles du troupeau, et ne doivent pas dominer sur lui (1 Pierre 5:2-4). Ils sont établis de Dieu, et non par l’homme, ni en vertu d’une succession (Actes 20:28). Et quant à l’Église, elle n’enseigne pas, mais elle doit être la colonne et le soutien de la vérité (1 Timothée 3:15), et cette vérité est la parole de Dieu, que les serviteurs de Dieu annoncent, expliquent et appliquent, et que l’Église a la responsabilité de maintenir. Or l’Église romaine, loin d’être la colonne de la vérité, s’en prétend la source et, en fait, enseigne et soutient l’erreur mêlée à la vérité.
L’Église romaine se vante aussi de son unité. Elle est une en effet extérieurement, en ce sens que tous ceux qui professent la reconnaître sont soumis à son joug. La vraie Église de Christ, l’Assemblée qui est son corps, est seule réellement une, selon ce que dit l’apôtre : « Il y a un seul corps », dont Christ est la Tête, et dont tous les vrais croyants sont les membres (Éphésiens 1:23 ; 4:4 ; 1 Corinthiens 12:12, 13). Mais l’Église a sa manifestation extérieure, et aurait dû en cela montrer l’unité. Malheureusement Satan a réussi à y semer la division ; l’Église a manqué, et l’on ne voit, dans ce qui se nomme la chrétienté, que divisions et sectes.
On aurait peine à s’imaginer, si l’histoire ne l’attestait, jusqu’où l’ambition a pu conduire certains papes de Rome. Non contents de dominer sur le clergé entier et par le clergé sur le peuple, ils prétendirent être au-dessus des princes, des rois et des empereurs. Tous leurs efforts, durant des siècles, ont tendu à établir ce pouvoir universel, au temporel aussi bien qu’au spirituel. Sans entrer dans des détails, ni présenter l’histoire des usurpations successives des papes dans ces deux domaines, je citerai quelques exemples.
Le pape Grégoire VII (*), homme énergique, qui voulait réformer l’Église et la purifier de la corruption profonde dans laquelle le clergé était tombé, disait, non sans orgueil : « Le pontife romain est évêque universel ; son nom n’a point son pareil dans le monde entier. À lui seul appartient de déposer les évêques, comme aussi de les réintégrer. Tous les princes sont tenus de lui b..... les pieds. Il a le droit de déposer les empereurs, et de délier les sujets de leurs devoirs envers eux… Tous les royaumes doivent être regardés comme des fiefs (comme dépendants) du siège de saint Pierre. L’Église ne doit pas être la servante des princes, mais leur maîtresse. Ayant reçu le pouvoir de lier et délier dans le ciel, à plus forte raison l’a-t-elle dans les choses terrestres ». Ces paroles audacieuses rappellent ce que nous dit l’Esprit Saint, au 17° chapitre de l’Apocalypse, où la fausse Église de l’avenir, Babylone, est représentée comme une femme assise sur la bête qui figure la puissance impériale (Versets 3 à 6).
(*) Il occupa le siège pontifical de 1073 à 1085.
C’est ce même pape qui exigea que tous les ecclésiastiques fussent voués au célibat, afin d’avoir toute une armée d’hommes dégagés des liens de famille et dévoués à l’Église romaine, et qui n’attendissent que de Rome leur mot d’ordre. Auparavant les prêtres pouvaient être mariés ou non ; les moines seuls ne devaient pas l’être. Grégoire voulut que les prêtres qui étaient mariés se séparassent de leurs femmes, et comme un grand nombre se révoltaient contre cette mesure, il leur dit : « Peut-il espérer d’avoir le pardon de ses péchés, celui qui méprise l’homme qui ouvre et ferme à sa volonté la porte du ciel (*) ? Ceux-là attirent sur leurs têtes la colère divine et la malédiction apostolique ». Ce célibat forcé n’est-il pas en opposition avec ce que nous apprend Paul, quand il dit : « Il faut que le surveillant (ou évêque) soit irrépréhensible, mari d’une seule femme » (1 Timothée 3:2), et qu’à Tite il dit que l’ancien (ou prêtre) soit « mari d’une seule femme » ? (Tite 1:6). Et n’est-ce pas la réalisation des paroles prophétiques de Paul : « Défendant de se marier » ? (1 Timothée 4:3).
(*) Nous voyons par ces paroles quelle autorité Grégoire VII attribuait aux papes. Qui peut ouvrir ou fermer, si ce n’est Christ ? (Apocalypse 3:7).
Innocent III, l’un des successeurs de Grégoire (*), et grand persécuteur des fidèles de son temps, disait : « Le serviteur que le Seigneur a établi sur son peuple, est le vicaire de Christ, le successeur de saint Pierre. Il est l’oint du Seigneur : entre Dieu et les hommes : au-dessous de Dieu, au-dessus des hommes ; moindre que Dieu, plus que l’homme. Il juge tout et n’est jugé par personne ». Quel langage audacieux et blasphématoire, qui rappelle ce que l’apôtre dit de l’homme de péché ! (2 Thessaloniciens 2:3-4). Ce n’est pas que les papes soient l’homme de péché : celui-ci paraîtra quand les saints auront été ravis auprès du Seigneur, mais ils portent le même caractère d’orgueil. Quelle différence avec Pierre, dont ils se disent les successeurs ! Le saint apôtre écrivait : « J’exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux » (**), et non au-dessus d’eux.
(*) Il fut pape de 1198 à 1216.
(**) 1 Pierre 5:1.
Quels sombres temps que ceux que l’on nomme le Moyen Âge ! Pour tenir les princes et leurs sujets sous leur domination et celle du clergé, les papes se servirent d’une arme redoutable, surtout dans ces temps d’ignorance et de superstition. C’est l’interdit. Plus tard, ils établirent le terrible tribunal de l’inquisition, dont nous parlerons.
L’interdit était une sentence par laquelle étaient défendus l’administration des sacrements, le culte public et les funérailles ecclésiastiques, c’est-à-dire accomplies avec les cérémonies de l’Église. L’interdit pouvait être prononcé contre une personne ; elle était ainsi excommuniée, privée de tout culte, ne pouvant entrer dans une église, et considérée comme un lépreux avec qui on ne devait avoir aucune communication. Elle était séparée de la communion chrétienne et bannie du royaume céleste, disait Rome. Les papes, au temps de leur puissance, osèrent frapper d’interdit des rois et des empereurs, comme l’histoire nous l’apprend, et causèrent ainsi de grands troubles et des guerres. Quelquefois l’interdit frappait une ville, un territoire ou un pays, et alors tous les habitants étaient comme excommuniés. Les enfants restaient sans baptême, on ne sonnait plus les cloches pour appeler les fidèles aux églises, on ne célébrait aucun culte, ni cérémonie religieuse, le clergé ne portait plus aux malades et aux mourants les consolations de la religion, et les morts étaient portés en terre sans qu’un prêtre les accompagnât. La terreur était ainsi jetée dans les âmes simples et superstitieuses de cette époque. Tel est encore un trait de la puissance que les papes s’étaient arrogée sur les âmes pour les soumettre.
On comprend que les princes et les peuples aient porté impatiemment ce joug et lutté pour s’y soustraire. Depuis les temps de la Réformation, l’Église romaine a dû renoncer à faire valoir ses prétentions de domination sur les princes et leurs sujets, et à se servir de l’interdit. Mais au fond, elle n’a pas changé. Ne pouvant dominer ouvertement, elle cherche à s’assujettir les consciences, et a bien des moyens pour y parvenir, étant d’une habileté consommée pour arriver à ses fins. C’est une puissance en apparence très déchue et amoindrie, mais qui subsiste toujours et a une grande vitalité. Nous vivons au milieu d’elle, et elle est industrieuse pour attirer à elle et séduire les âmes par ses cérémonies, son culte pompeux qui parle aux sens, et parce qu’elle sait revêtir un beau semblant de piété et de vérité, de manière à répondre aux besoins religieux de certaines âmes. Et c’est parce qu’on peut aisément se laisser enlacer par les séductions (Apocalypse 2:20) de cette Église qui se dit la seule vraie, qu’il est bon qu’elle soit présentée sous ses véritables traits, en présence de la parole de Dieu.
Mais avant de parler de ses enseignements erronés, il faut nous rappeler qu’elle confesse et conserve les grandes vérités fondamentales que nous enseigne la parole de Dieu. Ainsi, elle maintient qu’il n’y a qu’un seul Dieu en trois Personnes, le Père, le Fils, et le Saint Esprit (Matthieu 28:19). Elle confesse aussi que Jésus Christ, le Fils unique et éternel de Dieu, une Personne divine, est devenu un homme sur la terre, pour accomplir sur la croix la rédemption des pécheurs (Jean 1:1-18). Elle reconnaît qu’il y a un ciel pour les sauvés, et un enfer pour les incrédules. Il peut donc y avoir, et il y a eu dans son sein de vrais enfants de Dieu, des âmes qui, croyant simplement au nom, à l’amour et au sacrifice du Seigneur Jésus, sont sauvés, car « celui qui croit au Fils a la vie éternelle » (Jean 3:36). Mais l’Église romaine a enfoui ces saintes vérités et d’autres qui s’y rapportent, sous un amas d’ordonnances, de cérémonies et de pratiques extérieures, et y a joint quantité d’erreurs, de sorte que ce sont ces choses-là qui prédominent, et qu’elle présente comme nécessaires au salut, au lieu de la foi simple au Seigneur Jésus. De cette manière, les âmes sont retenues loin de Dieu et du Sauveur, et ainsi elles sont privées de la paix ; et de plus, elles sont livrées, comme nous le verrons, à une idolâtrie pire que celle du paganisme. Le christianisme par elle est entièrement défiguré, et quantité d’âmes sont conduites à la perdition.
On demandera peut-être : « Cette Église ne reconnaît-elle donc pas la Bible, les Écritures, comme la parole de Dieu, puisqu’elle s’écarte tellement de son enseignement ? ». Oui, certainement elle les reconnaît comme telle, et c’est même un fait digne de remarque que c’est elle qui a conservé ce dépôt des Écritures qui la condamnent, de même qu’autrefois les Juifs conservaient l’Ancien Testament (Romains 3:2). C’est dans les couvents de l’Église romaine que des moines copiaient les manuscrits de la Bible et les gardaient soigneusement. Mais comme les Juifs l’avaient fait aussi — sans parler des livres apocryphes (*), qu’elle a joints au saint volume — elle a mis à côté de l’Écriture la tradition qu’elle nomme la parole de Dieu non écrite, et dont elle prétend avoir le dépôt. C’est sur la tradition qu’elle appuie ses erreurs et ses pratiques religieuses, et ainsi, comme autrefois le Seigneur le reprochait aux Juifs, elle annule l’Écriture par ses traditions (Matthieu 15:3-6).
(*) Les livres apocryphes (ou cachés) sont des compositions qui n’ont jamais été reçues comme inspirées, par les Juifs, auxquels les oracles de Dieu ont été confiés (Romains 3:2) ; néanmoins le concile de Trente (dans le seizième siècle) les a déclarés divins.
Mais il y a plus. Une autre chose empêche les âmes soumises au joug de l’Église romaine de venir s’éclairer à la pure lumière de la parole de Dieu. Elle a longtemps défendu aux laïques la lecture des saintes Écritures. Seule l’Église peut les interpréter, et ceux qui s’écartent du sens qu’elle leur donne sont condamnés. Il était même défendu autrefois de les traduire en langue vulgaire, et si le fait se produisait, on brûlait les exemplaires que l’on pouvait saisir. Telle était la loi de l’Église au Moyen Âge. Nous en avons la preuve dans un décret du concile de Toulouse tenu en 1229, qui le premier défendit d’une manière formelle la lecture de la Bible : « Nous défendons aussi au commun peuple, de posséder aucun des livres de l’Ancien ou du Nouveau Testament, sauf peut-être le Psautier, ou le Bréviaire, ou les Heures de la Sainte Vierge, que quelques-uns par dévotion désireraient posséder, mais avoir un seul même de ces livres en langue vulgaire est strictement défendu ». Or l’on sait que les Heures de la Vierge, livre de dévotions adressées à la Vierge, ne font pas du tout partie des Écritures, non plus que le Bréviaire qui, à côté de portions de la Bible, renferme beaucoup de choses qui lui sont contraires. Mais le clergé ne voulait pas que le peuple illettré et aveuglé s’aperçût de cette distinction. C’était en effet un temps de grande ignorance où un bien petit nombre de personnes savaient lire. Le clergé en profitait pour exercer une autorité d’autant plus absolue sur le peuple. Il usait aussi de son influence pour engager le pouvoir civil à défendre la lecture de la Bible. Ainsi, en 1394, un arrêt de la Chambre des Lords en Angleterre l’interdisait. Les prêtres disaient à propos de la traduction de la Bible en langue vulgaire : « Hélas ! la perle de l’Évangile est maintenant jetée aux pourceaux et foulée par eux. L’Évangile que Christ avait donné au clergé pour qu’il le garde, devient maintenant le partage des laïques ».
On dira peut-être : « C’est dans le Moyen Âge seulement que les choses se passaient ainsi ». Ce serait une erreur de le penser. En l’an 1526, ce que l’on nomme le Moyen Âge était passé, et l’Anglais Tyndall, un serviteur de Dieu, avait traduit dans sa langue maternelle et fait imprimer le Nouveau Testament. L’évêque de Londres ayant appris que ces livres étaient destinés à être répandus en Angleterre, acheta toute l’édition et la fit brûler à Londres. En 1530, le même fait se renouvela. On ne se contentait même pas de brûler les saintes Écritures ; maintes fois le même sort atteignait ceux qui les possédaient et les lisaient. Ainsi, en 1519, une pauvre veuve, mère de plusieurs enfants, fut brûlée vive, parce qu’on avait trouvé sur elle l’oraison dominicale, les dix commandements et le symbole des apôtres en anglais. Telle était la frayeur qu’inspirait au clergé la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que la Bible condamne les erreurs et les pratiques de l’Église de Rome. Le clergé, en voyant l’usage que de prétendus hérétiques faisaient des Écritures, pour dévoiler et combattre les abus et les fausses doctrines de cette Église, ne trouvait rien de mieux que d’en défendre la lecture, de peur que les âmes ne vinssent à la lumière. Il inculquait au peuple la pensée — et il cherche encore à le faire — que les laïques ne peuvent comprendre la Bible et que, par sa lecture, ils risquent le salut de leur âme. Un évêque anglais qui vivait à la même époque que la veuve dont j’ai parlé, disait du haut de la chaire : « Ôtez ces traductions nouvelles (celles de la Bible), sans cela une ruine totale menace la religion de Jésus Christ ». Il voulait dire par là l’Église romaine. Et il suppliait le roi de fermer à ce livre l’entrée du royaume.
Mais de nos jours, dira-t-on, il n’en est pas ainsi. L’Église romaine ne change pas. De nos jours, il est vrai, les prêtres catholiques ont traduit en langage vulgaire les saintes Écritures et l’Église autorise les traductions faites par des laïques, mais un laïque soumis à l’Église n’osera pas les lire sans l’approbation du prêtre, et il faudra qu’il accepte l’interprétation que l’Église donne. Encore, en 1883, à Barcelone, par ordre du gouvernement, un certain nombre d’exemplaires des Évangiles furent livrés aux flammes. Et un journal non seulement approuvait ce fait, mais exprimait le désir que les hérétiques qui cherchaient à répandre ce livre partageassent le même sort. Si l’Église romaine ne peut plus, comme au Moyen Âge, faire dresser des bûchers et y faire périr ceux qui ne se soumettent pas à elle, son esprit est resté le même. La parole de Dieu parle de « la femme enivrée du sang des saints, et du sang des témoins de Jésus » (Apocalypse 17:6). Nous verrons, dans la suite de ces pages, combien, hélas ! cela, bien qu’encore futur, a pu déjà s’appliquer à elle.
La défense de lire les Écritures est totalement opposée au témoignage qu’elles rendent. Même un jeune enfant, je veux dire Timothée, avait dès son jeune âge la connaissance des saintes lettres qui rendent sage à salut (2 Timothée 3:15). Paul adjurait les saints que ses lettres fussent lues à tous les saints frères (1 Thessaloniciens 5:27), et qu’elles passassent d’une assemblée à une autre (Colossiens 4:16). L’Esprit Saint louait les Béréens de ce qu’ils contrôlaient par les Écritures les paroles même d’un apôtre (Actes 17:11). Souvenons-nous aussi des paroles de notre Seigneur et Sauveur : « Sondez les Écritures, car vous, vous estimez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi » (Jean 5:39). Tenons donc ferme à la sainte Parole par laquelle nous pouvons juger de toutes choses.
6.3 - Le Papisme
6.3.1 - Les sacrements dans ‘Église Romaine
Après les quelques pages que nous avons consacrées à la papauté, et passant sous silence la triste histoire de la succession des papes, chefs de l’Église romaine, nous passerons à l’examen du culte, des pratiques et des doctrines de cette Église, ce que l’on nomme spécialement le papisme.
Dans le Nouveau Testament, le Seigneur a établi seulement deux ordonnances. D’abord le baptêmes (*1), qui est le signe de l’introduction dans l’Église, la maison de Dieu sur la terre, fondée sur la mort et la résurrection du Seigneur. Mais le baptême ne sauve pas, ne régénère pas, comme l’enseigne l’Église romaine qui affirme que le baptême lave de ce qu’elle appelle le péché originel. L’apôtre Pierre le dit expressément (*2). Par conséquent, quand le Seigneur Jésus dit à Nicodème : « Si quelqu’un n’est né d’eau et de l’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu » (*3), l’eau ne désigne pas le baptême, mais la parole de Dieu, comme Jacques le dit en parlant des chrétiens : « De sa propre volonté », Dieu, le Père des lumières, « nous a engendrés (ou fait naître) par la parole de la vérité » (*4). C’est pourquoi l’apôtre Paul dit : « Dieu… nous sauva… selon sa propre miséricorde, par le lavage de la régénération et le renouvellement de l’Esprit Saint » (*5). Et Pierre dit aussi : « Vous êtes régénérés (ou nés de nouveau)… par la vivante et permanente parole de Dieu » (*6). Ce n’est donc pas le baptême d’eau qui produit la nouvelle naissance, sans laquelle on ne peut entrer dans le royaume de Dieu, mais c’est la parole de Dieu reçue dans le cœur et appliquée à l’âme par la puissance de l’Esprit Saint. C’est l’Esprit Saint qui, par le moyen de la Parole, produit en nous une nature et une vie nouvelles. Le Seigneur dit : « Celui qui entend ma parole, et qui croit celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle » (*7). Ainsi il ne suffit pas d’avoir été baptisé et de porter le nom de chrétien. Pour posséder la vie éternelle, il faut croire du cœur au nom du Fils de Dieu.
(*1) Matthieu 28:19.
(*2) « Or cet antitype (l’antitype de l’arche) vous sauve aussi maintenant, c’est-à-dire le baptême, non le dépouillement de la saleté de la chair, mais la demande à Dieu d’une bonne conscience, par la résurrection de Jésus Christ » (1 Pierre 3:21).
(*3) Jean 3:5
(*4) Jacques 1:18.
(*5) Tite 3:5.
(*6) 1 Pierre 1:23
(*7) Jean 5:24
L’Église romaine, au contraire, présente le baptême comme nécessaire au salut, de sorte qu’un petit enfant n’irait pas au ciel, s’il venait à mourir non baptisé (*), et qu’un adulte qui croirait au Seigneur, mais qui mourrait sans baptême alors qu’il aurait eu la possibilité d’être baptisé, ne serait pas sauvé. L’Écriture nous dit quant aux petits enfants que Jésus est venu les sauver (Matthieu 18:11, 14), et quant à ceux qui sont en âge de raison, elle déclare simplement que celui « qui croit au Fils a la vie éternelle » (Jean 3:36), sans qu’il soit question de baptême. Les apôtres du Seigneur furent-ils baptisés du baptême chrétien ? Non. Le brigand converti sur la croix fut-il baptisé ? Non, et cependant il alla le même jour au Paradis. Toutefois, bien que le baptême d’eau ne sauve pas, cette figure de la mort de Christ, plaçant des « disciples » sous Son autorité, est d’une grande et précieuse signification (Matt. 28:29).
(*) Il va, selon la théologie catholique, dans les limbes, séjour mal défini où les âmes vivent d’une vie inférieure.
L’Église romaine a aussi ajouté plusieurs choses à l’ordonnance du Seigneur. D’abord elle veut que l’eau du baptême soit consacrée par le prêtre — c’est l’eau bénite, à laquelle on attribue bien des vertus, entre autres celle de chasser le démon loin des baptisés. Ensuite, sauf des cas extrêmes, le prêtre seul a le droit d’administrer le baptême. Nous ne voyons rien de semblable dans l’Écriture. C’est d’eau pure et simple que l’on se servait pour baptiser ; c’est Ananias, un simple disciple, qui baptise Paul ; c’est Philippe, qui n’était que diacre ou serviteur, qui baptise l’officier éthiopien ; ce sont les frères de Joppé, venus avec Pierre, qui administrent le baptême à Corneille et aux autres convertis (Actes 8:38 ; 9:18 ; 22:16 ; 10: 47-48).
La seconde ordonnance est la Cène ou souper du Seigneur. Jésus l’a instituée avant sa mort, lorsqu’il était pour la dernière fois à table avec ses bien-aimés disciples et qu’il avait mangé avec eux la Pâque (*1). Mais après être monté dans la gloire, il a rappelé à l’apôtre Paul ce qu’il avait établi la nuit qu’il fut livré, pour que tous les vrais croyants y participent (*2). Nous voyons par là combien notre précieux Sauveur tient à ce que la Cène soit célébrée, de même qu’autrefois l’Éternel tenait à ce que les enfants d’Israël ne négligeassent pas de garder l’ordonnance de la Pâque, qui leur rappelait leur délivrance du pays d’Égypte (*3). C’est que la Cène rappelle aussi aux chrétiens la délivrance bien plus grande dont ils sont les objets. Elle remet en mémoire aux croyants que Christ, dans son amour, a souffert et est mort pour eux. C’est pourquoi Il est appelé « notre Pâque ». « Notre pâque, Christ », dit Paul, « a été sacrifiée » pour nous (*4). La Cène du Seigneur se célèbre très simplement, quand on suit la parole de Dieu. Le pain que l’on rompt et qui est partagé entre tous, représente et rappelle le corps du Seigneur qui a été livré pour nous et offert en sacrifice sur la croix. Le vin contenu dans la coupe, à laquelle tous participent, parce que le Seigneur a dit : « Buvez-en tous » (*5), est le mémorial du sang précieux de Christ, l’Agneau sans défaut et sans tache, qui a été versé pour la rémission des péchés afin de nous racheter et de nous purifier du péché (*6). Et le Seigneur a dit en instituant la Cène, soit en rompant le pain, soit en distribuant la coupe : « Faites ceci en mémoire de moi ». Quelle chose douce et précieuse pour le cœur du chrétien de se rappeler d’une manière spéciale, chaque premier jour de la semaine, le grand et ineffable amour du Sauveur envers lui ! Et il le fait en communion d’amour avec les autres croyants, qui sont, comme lui, membres du corps de Christ (*7).
(*1) Luc 22:19-20.
(*2) 1 Corinthiens 11:23-26
(*3) Deutéronome 16:1-2 ; Exode 12:21-27 ; 34:18 ; Lévitique 23:5 ; Nombres 28:16-17.
(*4) 1 Corinthiens 5:7.
(*5) Matthieu 26:27.
(*6) 1 Pierre 1:18-19 ; 1 Jean 1:7 ; Apocalypse 1:5.
(*7) 1 Corinthiens 12:13 ; 10:17 ; Éphésiens 5:30.
L’apôtre Paul rappelle encore une chose relativement à ce saint repas. Il dit : « Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne » (*). Ainsi, dans la Cène, nous sommes mis en présence de l’amour infini du Seigneur mort pour nous, nous annonçons cette mort au monde coupable, puis nos pensées sont portées en avant vers ce bienheureux jour où Christ reviendra pour consommer sa victoire en transformant nos corps et en nous introduisant dans la gloire avec Lui. Tout nous parle là de son amour. Quel bonheur d’avoir sa place à la table du Seigneur !
(*) 1 Corinthiens 11:26.
Ces ordonnances du Seigneur sont appelées par quelques-uns, et surtout par l’Église romaine, des sacrements. À ce mot se rattache l’idée qu’elles confèrent une certaine grâce spirituelle à celui qui y a part. Nous avons vu qu’aucune grâce n’est conférée par le baptême. C’est un privilège, sans doute, d’être introduit par le baptême dans la maison de Dieu sur la terre ; mais le baptême n’est qu’un signe. Il n’apporte aucun changement dans l’âme de celui qui le reçoit. C’est un très grand privilège de participer à la Cène du Seigneur ; mais on le fait et on en jouit, parce que l’on est déjà sauvé par la mort du Christ, que l’on est membre de son corps, et béni en Lui de toute bénédiction spirituelle (*1). On est heureux de rappeler son amour, on Lui rend grâces et on rend grâces au Père qui nous a introduits dans le royaume du Fils de son amour, et nous a donné une part avec les saints dans la lumière (*2). On adore le Père et le Fils par l’Esprit Saint qui nous a été donné ; mais on a déjà tout reçu en fait de grâces. Seulement dans la Cène, le croyant jouissant de tout ce qu’il a reçu en bénit son Seigneur et son Dieu, et c’est une grâce de pouvoir le faire. Nous verrons plus loin, en parlant de la messe, ce que l’Église romaine a fait de cette ordonnance de la Cène.
(*1) Éphésiens 1:3.
(*2) Colossiens 1:12-14.
6.3.2 - La Confirmation et la Pénitence
Non contente des deux ordonnances établies par le Seigneur, l’Église de Rome a, de son chef, ajouté cinq sacrements au baptême et à la Cène. Le fameux concile de Trente, tenu au 16° siècle (1545-1563), et qui a fixé la doctrine romaine, énumère ainsi les sacrements : le baptême, la confirmation, l’eucharistie (*) ou cène, la pénitence, l’extrême onction, l’ordre (le caractère ecclésiastique des prêtres), et le mariage. À part le baptême et la Cène, les autres sacrements sont des inventions humaines dont nous ne trouvons aucune trace dans l’Écriture. Nous avons parlé du baptême ; disons quelques mots des autres sacrements.
(*) Ce mot signifie actions de grâces. Il désignait d’abord les prières qui accompagnaient la communion ou Cène, et a fini par s’appliquer à la Cène même.
La confirmation, dans l’Église romaine, est une cérémonie qui a pour but de confirmer les grâces du baptême. En général, elle a lieu pour les enfants de 11 à 12 ans avant de les admettre à ce que l’on appelle la première communion, la première participation à la Cène. On prétend les rendre ainsi « parfaits chrétiens, en leur communiquant l’abondance des grâces et des dons de l’Esprit Saint ». C’est à l’évêque qu’il appartient de confirmer. Il le fait par l’imposition des mains, le signe de la croix et l’onction avec l’huile consacrée. Il y ajoute un léger soufflet sur la joue, avec ces mots : « La paix soit avec vous ». Pouvons-nous penser que de semblables actes rendent chrétiens, sinon parfaits chrétiens, ou communiquent l’Esprit Saint ? Est-il question de cela dans l’Écriture ? Nullement. Ces pauvres enfants que l’on confirme ne sont peut-être pas même sauvés. Car c’est par la foi au Seigneur Jésus que nous avons la rédemption, la rémission des péchés par son sang, et ayant cru en Lui, nous recevons l’Esprit Saint. Lisons ce que l’apôtre Paul dit en Éphésiens 1:13: « Ayant entendu la parole de la vérité, l’évangile de votre salut, auquel aussi ayant cru, vous avez été scellés du Saint Esprit de la promesse ». Là il n’est question ni d’évêque, ni d’imposition des mains, ni d’onction. L’homme et ses cérémonies n’y sont pour rien. Tout est de Dieu pour celui qui croit. On entend l’Évangile, on y croit, et Dieu nous donne l’Esprit Saint. Quelle simplicité, quelle grâce !
La pénitence est pour l’Église romaine, le sacrement par lequel sont pardonnés les péchés commis après le baptême. Il requiert du pécheur certaines dispositions qui sont la contrition, la confession, la satisfaction (c’est-à-dire la réparation de l’injure faire à Dieu, par certains actes de piété ou dons, et du tort causé au prochain), et le ferme propos de ne plus commettre une telle faute. Ce sacrement est dispensé uniquement par les évêques ou les prêtres, par la sentence de l’absolution « Je t’absous de tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit ». Où trouvons-nous cela dans l’Écriture ? Où voyons-nous qu’un homme ait le pouvoir de donner l’absolution des péchés ? Où est-il dit que l’on ait à confesser à un tel homme, dans le secret, les fautes que l’on a commises, et qu’il ait l’autorité d’infliger une peine pour les expier ? Nulle part. Sans doute que, si un chrétien est tombé dans quelque faute, il doit la juger, s’en repentir et en avoir horreur. Mais à qui la confessera-t-il ? La parole de Dieu le dit : « Si nous confessons nos péchés, il (c’est-à-dire Dieu) est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité » (*1). À qui David confessa-t-il ses transgressions ? Il le dit : « J’ai dit : Je confesserai mes transgressions à l’Éternel ; et toi, tu as pardonné l’iniquité de mon péché » (*2). Il est vrai qu’en Jacques 5:16, il est écrit : « Confessez donc vos fautes l’un à l’autre, et priez l’un pour l’autre » ; mais cela ne veut pas dire : Confessez vos fautes à un prêtre, mais si vous avez manqué envers un autre, confessez-le lui. C’est une chose que nul ne doit négliger. Les enfants et les jeunes gens ont à confesser à leurs parents et à leurs supérieurs les fautes qu’ils ont commises à leur égard, si cachées qu’elles aient pu être. On n’est jamais heureux quand il reste sur la conscience le poids d’une faute commise (*3). Ont-ils manqué envers un camarade, envers un ami, envers leurs frères ou sœurs, envers leurs parents ou leurs maîtres, envers qui, que ce soit, il faut le confesser simplement, sans restriction et sans excuse et le cœur sera allégé. Et il en est ainsi pour chacun. Mais par-dessus tout, confessez tout à Dieu, qui pardonne, comme il le dit dans sa Parole. Quant à l’absolution donnée par un homme, qui peut pardonner les péchés que Dieu seul ? C’est ce que toute l’Écriture enseigne. Il est bien dit : « À quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis ; et à quiconque vous les retiendrez, ils sont retenus » (*4). Mais il ne s’agit pas ici de l’absolution donnée après une confession secrète à l’oreille d’un prêtre. Le Seigneur, par ces paroles, confie aux disciples la mission d’annoncer au monde la rémission des péchés à ceux qui croient, et au contraire le jugement à ceux qui ne croient pas (*5).
 Re: L’ÉGLISE : UNE ESQUISSE DE SON HISTOIRE PENDANT VINGT SIÈCLES
Re: L’ÉGLISE : UNE ESQUISSE DE SON HISTOIRE PENDANT VINGT SIÈCLES
(*1) 1 Jean 1:9.
(*2) Psaume 32:5.
(*3) Voyez Psaume 32:3.
(*4) Jean 20:23.
(*5) Voyez ce que Pierre dit aux Juifs : Actes 2:38 ; 3:19 ; 5:31 ; voyez aussi ce que dit Paul : 13:38-41 ; 16:31 ; 28:23-28.
Dans les premiers temps de l’Église, on demandait que ceux qui avaient commis un grand péché en fissent une confession publique avant d’être de nouveau reçus dans la communion chrétienne. Le grand empereur Théodose fut obligé de s’humilier ainsi devant tout son peuple, à Milan. Peu à peu on en vint à se confesser aux prêtres, et en l’an 1215, le pape Innocent III établit la confession auriculaire comme obligatoire, et l’on dut se confesser pour pouvoir communier, pour être marié et pour recevoir les derniers sacrements avant de mourir. Les consciences étaient ainsi liées par la crainte que l’on avait d’être perdu, si l’on mourait sans absolution, car c’est ce que Rome enseigne, et le pouvoir des prêtres et par conséquent de Rome était fermement établi sur les âmes. Cette pratique d’invention humaine a donné lieu, on l’imagine sans peine, à toutes sortes d’abus et de désordres moraux.
6.3.3 - L’Eucharistie (la Cène), la Messe, le saint sacrement, la transubstantiation
Après le sacrement de pénitence, le concile de Trente place l’Eucharistie ou la Cène. Mais combien dans l’Église romaine, elle diffère du simple repas institué par le Seigneur en mémoire de sa mort ! La Cène est devenue la Messe (*). C’est le grand acte de culte de l’Église de Rome. Ce fut le pape Grégoire I, dit le Grand, qui établit le service de la messe dans ses traits principaux. Le concile de Trente lui donna la forme définitive qu’elle a maintenant dans toutes les Églises romaines. La Messe se divise en deux parties principales — la première, appelée autrefois messe des catéchumènes parce qu’à l’origine ceux-ci n’étaient admis qu’à cette première partie, est composée de prières, lectures de la Bible, cantiques, prédication, qui constituent une préparation ou introduction à la Messe — La deuxième partie, appelée autrefois la messe des fidèles, constitue le sacrifice proprement dit, et comprend l’offertoire, l’offrande à Dieu du pain (**) et du vin destinés à être consacrés de la Cène, la consécration où par les paroles de l’institution de la Cène prononcées par le prêtre s’accomplit, selon l’Église romaine, le mystère de la transsubstantiation dont nous parlerons plus loin, la communion prise par le prêtre avec le pain et la coupe, et avec le pain seulement, par les assistants qui l’ont demandée. La messe se termine par l’action de grâces, et l’assemblée est congédiée par ces mots : « Ite, missa est ».
(*) En rapport avec les mots qui terminent l’essentiel de la cérémonie : « Ite, missa est ecclesia », c’est-à-dire : « Allez, l’assemblée est congédiée ». De missa, on a fait messe.
(**) Le pain de la communion est une sorte d’oublie faite de farine et d’eau, sans levain, et sur laquelle est l’empreinte d’une croix. On lui donne le nom d’hostie ou sacrifice, nous verrons pourquoi. On la conserve dans l’ostensoir, vase plus ou moins richement orné, dans lequel on l’expose ou on la transporte. Il n’y a rien de semblable dans la parole de Dieu. Le pain que rompit le Seigneur Jésus, était celui dont on se servait à table.
Sans parler de tout ce qui accompagne la célébration de la messe, les ornements de l’autel, les cierges et l’encens, les vêtements des prêtres et de ceux qui l’assistent, choses qui rappellent les formes du judaïsme et même du paganisme, on voit aisément combien l’Église romaine s’est écartée du culte « en esprit et en vérité » dont parle le Seigneur (*), et l’a remplacé par des cérémonies arrêtées d’avance et des choses qui agissent sur les sens. C’est un culte charnel, inventé par l’homme, où rien n’est laissé à la libre action de l’Esprit Saint. De plus, le prêtre est là, ayant seul le droit d’officier, faisant partie d’une classe à part, tandis que, selon la parole de Dieu, tous les croyants sont une « sainte sacrificature » (**), chacun de ceux qui la composent ayant le privilège de rendre l’action de grâces à la table du Seigneur, sous la direction de l’Esprit Saint.
(*) Jean 4:23-24.
(**) 1 Pierre 2:5-9.
Mais il y a des choses pires encore ; les erreurs les plus graves se mêlent à ce culte de l’Église de Rome. La table de communion est devenue un autel. Le concile de Trente enseigne en effet que, dans la Cène ou la Messe, est offert un véritable sacrifice, non sanglant, il est vrai, mais un sacrifice vraiment propitiatoire, efficace pour les péchés non expiés des vivants et des morts. C’est Christ qui est offert, dit le concile, c’est la même victime que celle qui autrefois s’est offerte elle-même sur la croix, et qui est offerte maintenant par le ministère des prêtres. Par ce sacrifice propitiatoire renouvelé chaque jour dans l’Eucharistie, Dieu, selon l’Église de Rome, est apaisé et nous est rendu propice. On peut aisément voir que cet enseignement est contraire à l’Écriture. L’Esprit Saint, dans l’épître aux Hébreux, déclare que « l’offrande du corps de Jésus Christ » a été faite « une fois pour toutes » ; que Christ a offert « un seul sacrifice pour les péchés », et que, « par une seule offrande, il a rendu parfaits à perpétuité ceux qui sont sanctifiés », de sorte que Dieu ne se souviendra « plus jamais de leurs péchés ni de leurs iniquités » et que « là où il y a rémission de ces choses, il n’y a plus d’offrande pour le péché ». De plus, il nous est dit que Christ ne peut s’offrir plusieurs fois, parce qu’alors il devrait souffrir plusieurs fois, et enfin que, « sans effusion de sang, il n’y a point de rémission de péchés » (*). Un sacrifice non sanglant n’en est donc pas un, et Christ glorifié ne peut souffrir, ce qui est nécessaire pour un vrai sacrifice. Partout, dans ces chapitres 9 et 10 de l’épître aux Hébreux, il est insisté sur le fait d’un seul, unique sacrifice de Christ, pleinement suffisant pour ôter les péchés. Ainsi le sacrifice de la messe n’en est pas un, et les âmes qui s’appuient sur ce faux enseignement, sont trompées, et ne peuvent jamais jouir de la paix qui résulte de ce qu’en vertu du seul et unique sacrifice de Christ, Dieu ne se souvient plus jamais de nos péchés et de nos iniquités. Or, dit l’apôtre, « là où il y a rémission de ces choses, il n’y a plus d’offrande pour le péché » (**).
(*) Hébreux 10:10, 12, 14, 17, 18 ; 9:25-26, 22.
(**) Hébreux 10:17, 18.
Remarquez qu’il est dit que la messe est un sacrifice pour les vivants et pour les morts. L’Écriture ne nous enseigne nulle part que les péchés de ceux qui sont morts puissent être expiés. Elle nous dit simplement. « Après la mort, le jugement » (*), pour ceux qui n’ont pas cru ici-bas au Seigneur Jésus et à son unique sacrifice expiatoire. L’idée d’un sacrifice pour les morts se rattache à une autre erreur enseignée par l’Église romaine, celle du purgatoire. C’est un lieu qui n’est ni le ciel, ni l’enfer, mais où les âmes souffrent pour les péchés qui n’ont pas été expiés sur la terre, jusqu’à ce qu’elles en soient purifiées. L’Église romaine prétend que les messes dites pour ces âmes abrègent leurs tourments ! La parole de Dieu ne dit pas un mot de cela.
(*) Hébreux 9:27.
À cette erreur d’un sacrifice de Christ journalier et non sanglant, s’en joint une autre plus grave encore, celle de la transsubstantiation ou changement de substance. Suivant cette doctrine, quand le prêtre prononce les paroles de la consécration, le pain et le vin, tout en conservant leur apparence, sont réellement changés dans le corps et le sang du Seigneur Jésus Christ. Cette doctrine fut inventée au neuvième siècle (le plus ténébreux du Moyen Âge) par le moine Paschase Radbert. S’appuyant sur ces paroles : « Ceci est mon corps » (*), il disait : « Le pain et le vin, après avoir été consacrés, ne sont pas autre chose que la chair du Christ et son sang, la même chair qui est née de Marie et qui a souffert sur la croix ». Après une longue et vive opposition, le quatrième concile de Latran, en 1215, consacra cette doctrine en ces termes : « Le corps et le sang du Seigneur sont véritablement contenus dans le sacrement de l’autel sous la figure du pain et du vin, lorsque par la puissance de Dieu et par le moyen du prêtre officiant, le pain est changé dans le corps, et le vin dans le sang de Christ. Le changement opéré de cette manière est si réel et si complet, que les éléments (le pain et le vin) contiennent Christ tout entier — divinité, humanité, âme, corps et sang, avec toutes leurs parties constituantes ». Et le concile de Trente, dans le 16° siècle, a confirmé cette doctrine, et tout membre de l’Église de Rome doit la croire, sous peine d’anathème ! Le prêtre, à un certain moment élève l’hostie, et en vertu des paroles qu’il a prononcées, cette hostie est Dieu Lui-même. Il se prosterne en l’adorant, et tout le peuple suit son exemple. Un homme, et parfois un homme méchant, crée son Créateur ! expression blasphématoire et pourtant usitée, car l’hostie, dit l’Église de Rome, n’est plus du pain, mais Christ Lui-même. Ceux qui possèdent la parole de Dieu, savent, d’après elle, que Christ est maintenant dans la gloire, dans un corps glorifié ; il ne peut donc être en même temps ici-bas, âme, corps et sang, dans l’hostie. Son sang a été versé une fois pour toutes pour l’expiation des péchés, et ne peut être dans la coupe. Il faudrait donc qu’il y eût deux Christs. Dans la Cène, selon l’Écriture, on annonce la mort du Seigneur, on se souvient de la mort du Seigneur, mais supposer que l’on puisse mettre à mort un Christ glorifié est une chose horrible et contraire à toute vérité. C’est là une des plus fatales erreurs de l’Église de Rome, c’est une monstrueuse idolâtrie. On trompe le pauvre peuple en lui faisant croire qu’un morceau de pain est devenu Dieu et qu’il faut l’adorer.
(*) Ce qui veut dire, ceci représente mon corps, de même que, dans l’institution de la Pâque, l’agneau est appelé la Pâque de l’Éternel (Exode 12:11).
L’Église romaine a institué une fête que l’on nomme Fête-Dieu, ou du Saint Sacrement. Ce jour-là, dans une procession solennelle, on porte l’hostie consacrée dans un magnifique ostensoir. Tout le monde doit s’agenouiller sur son passage en signe d’adoration, car c’est Dieu qui est là, disent les prêtres. En certains pays, comme l’Espagne, le prêtre qui porte l’hostie à un mourant, est accompagné d’un homme qui durant tout le trajet sonne une clochette. Dès qu’elle se fait entendre, tous ceux à qui le son parvient doivent tomber à genoux et y rester jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus le percevoir. Le prêtre fait croire au peuple et dit au mourant que c’est le Dieu vivant qui est dans le ciboire (*) et que l’on transporte ainsi. Quelle triste aberration !
(*) Vase dans lequel on garde l’hostie.
Nous avons vu aussi que les simples fidèles communient avec le pain seulement. La coupe est réservée aux prêtres seuls. C’est encore une invention humaine dont la parole de Dieu ne dit rien. Au contraire, le Seigneur dit à ses disciples : « Buvez-en tous » ; et l’apôtre, s’adressant à toute l’assemblée à Corinthe, recommande que chacun « mange du pain et boive de la coupe » (*). Ce retranchement de la coupe, aux laïques se fait sous prétexte qu’il pourrait s’attacher à la barbe quelques gouttes du vin consacré ou que les malades pourraient en répandre, et que d’ailleurs l’hostie renferme la chair du Seigneur aussi bien que le sang. On dit aussi que le sang étant dans l’hostie, il n’est pas nécessaire que les laïques boivent la coupe. Mais alors pourquoi les prêtres la boivent-ils ? On voit clairement que cette coutume n’a été établie que pour marquer plus distinctement la supériorité des prêtres.
(*) Matthieu 26:27 ; 1 Corinthiens 11:28.
Nous nous sommes étendu un peu longuement sur ce sujet, parce que c’est un des points qui caractérisent le plus fortement l’Église de Rome ; la messe constitue le centre même de la religion catholique. Aller à la messe est ce qui distingue le vrai catholique romain ; mais rien ne fait mieux voir que la messe combien cette Église s’est écartée de la vérité.
6.3.4 - L’Extrême-Onction, l’Ordre et le Mariage
Il nous reste à voir les trois derniers sacrements de l’Église de Rome.
6.3.4.1 - L’extrême-onction
Le premier est ce que l’on nomme l’extrême-onction. On ne l’administre qu’aux malades que l’on estime être à la dernière extrémité, et comme après ce sacrement, il n’y en a plus d’autres, on lui donne ce nom d’extrême-onction. L’Église romaine enseigne qu’il a pour effet de laver les derniers restes du péché, afin que le malade en mourant aille droit au ciel, et aussi de le fortifier contre les angoisses de la mort. Si quelqu’un meurt en état de péché mortel sans avoir reçu ce sacrement, à défaut du sacrement de pénitence, il va en enfer.
Nous voyons encore par là quel empire l’Église romaine assume sur les âmes, car le prêtre seul peut administrer ce sacrement. Et remarquons aussi comme tout est calculé pour retenir les cœurs dans la crainte, et par conséquent quel Dieu terrible et sans compassion on leur présente. Voici en quoi consiste l’extrême-onction. Le prêtre, revêtu d’une étole violette, arrive auprès du mourant et lui présente le crucifix qu’il doit b..... avec respect. Après une série de prières et d’aspersions avec de l’eau bénite, et si possible après avoir entendu la confession du malade et lui avoir donné l’eucharistie (*), le prêtre procède à l’onction. Pour cela, avec son pouce trempé dans l’huile sainte, c’est-à-dire consacrée, il touche, en faisant le signe de la croix, les différentes parties du corps qui ont pu être les instruments de péché. Il commence par les yeux, en disant : « Que le Seigneur, en vertu de son onction sainte et par sa grande miséricorde, te pardonne tous les péchés que tu as commis par tes yeux ». Et il continue de même pour les autres organes des sens, les oreilles, le nez, la bouche et les mains, puis enfin la poitrine et les pieds. Suivent encore des prières et des signes de croix, et ensuite on brûle le linge ou les boules de coton qui ont servi à essuyer le pouce du prêtre. Le mourant peut alors s’en aller en toute sécurité ; le ciel lui est ouvert.
(*) On donne à l’eucharistie administrée aux derniers moments le nom de viatique. Ce mot vient du latin via, chemin, et se dit en général des provisions de route. Dans le langage de l’Église romaine, c’est la provision pour le dernier grand voyage, ce qui doit fortifier celui qui va le faire.
C’est dans le 12° siècle seulement que cette cérémonie, dernier acte de la vie d’un bon catholique romain, a été introduite. Les docteurs romains citent à l’appui de l’extrême-onction les passages suivants : « Et ils chassèrent beaucoup de démons, et oignirent d’huile beaucoup d’infirmes et les guérirent » (Marc 6:13) ; puis : « Quelqu’un d’entre vous est-il malade, qu’il appelle les anciens de l’assemblée, et qu’ils prient pour lui en l’oignant d’huile au nom du Seigneur ; et la prière de la foi sauvera le malade … et s’il a commis des péchés, il lui sera pardonné » (Jacques 5:14-15). Qui ne voit que ces passages n’ont aucun rapport avec l’extrême onction ? Celle-ci a pour objet le salut de l’âme, et nullement la guérison du corps, puisqu’on ne la donne qu’aux mourants pour leur ouvrir le ciel. Tandis que dans ces deux passages, il s’agit de la guérison du corps, soit par voie miraculeuse, ou en réponse à la prière de la foi, sans laquelle l’onction même n’aurait aucun effet. Et pour aller droit au ciel, un mourant a-t-il besoin d’autre chose que de croire au Seigneur Jésus ? L’Écriture nous dit : « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé », et : celui « qui croit au Fils a la vie éternelle ». « Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi » (Actes 16:31 ; Jean 3:36 ; Éphésiens 2:8). Où est-il question du ministère obligé d’un prêtre et de son action ? Nulle part dans la parole de Dieu. Celui qui croit en Jésus est lavé de tous ses péchés et propre pour paraître en la présence de Dieu. Il peut s’en aller en paix, car « absent du corps », il est « présent avec le Seigneur » (2 Corinthiens 5:8). Le brigand sur la croix eut-il besoin de l’extrême-onction pour être ce jour même « dans le paradis » avec Jésus ? Étienne, le premier martyr, qui remettait à Jésus son esprit, ne l’a pas reçue ; lui et tant d’autres qui sont morts dans la foi, ne seraient donc pas sauvés, tandis que des hommes qui jamais n’ont été convertis et dont les péchés n’ont pas été effacés, iraient au ciel en vertu de cette onction faite par un homme ! Ces ordonnances inventées par des hommes, d’une part ne sont propres qu’à jeter les âmes dans une crainte superstitieuse et sans fondement, et d’une autre donnent une sécurité illusoire à des personnes qui, toute leur vie, ne se sont pas souciées de Dieu.
6.3.4.2 - L’ordre, l’ordination
Après le sacrement de l’extrême-onction vient celui de l’ordre (*) conféré par la cérémonie de l’ordination : il confère au prêtre le caractère sacerdotal, c’est-à-dire le pouvoir de célébrer la messe et d’administrer tous les sacrements (sauf la confirmation et l’ordre réservés à l’évêque). Pour ordonner un prêtre, l’évêque lui impose les mains, l’oint de l’huile sainte et lui fait toucher les objets sacrés (calice et patère) lui permettant d’offrir le sacrifice de la messe. Le prêtre ainsi consacré a désormais la puissance de consacrer le vrai corps du Seigneur dans la Cène, c’est-à-dire, comme on l’a vu, d’opérer ce prétendu miracle qui transforme le pain et le vin dans le corps et le sang de Christ. Le caractère conféré par l’ordination est indélébile, c’est-à-dire ne peut être effacé, de sorte que celui qui abandonne la prêtrise est regardé comme un apostat. À cela l’Église romaine ajoute le célibat obligatoire pour les prêtres ; il leur est interdit de se marier.
(*) Ce sacrement est ainsi appelé parce qu’il établit un ordre dans la société chrétienne en séparant les clercs des laïques, et parce qu’il divise les clercs en plusieurs degrés formant une hiérarchie, un ordre (diaconat, prêtrise, épiscopat …)
Toutes ces choses n’ont aucun fondement dans l’Écriture et même y sont entièrement opposées. D’abord nulle part nous n’y voyons qu’il y ait une classe de sacrificateurs à part des autres chrétiens. Chez les Juifs, cela existait. Mais maintenant tous les vrais croyants sont sacrificateurs pour offrir à Dieu, non le corps de Jésus Christ qui a été offert une fois pour toutes sur la croix, mais des sacrifices de louanges et d’actions de grâces (1 Pierre 2:5 ; Hébreux 13:15 ; Apocalypse 1:6). Ensuite, nous ne voyons pas que ni les anciens ou surveillants (*) ni les diacres ou serviteurs, fussent oints. Les apôtres ou quelque envoyé d’un apôtre leur imposaient les mains et en même temps on priait le Seigneur (Actes 6:6 ; 14:23). Quant au célibat des prêtres, nous lisons que Pierre était marié, que Paul revendique pour lui et Barnabas le droit de l’être, et que Paul recommande que les surveillants ou anciens, ainsi que les serviteurs, soient maris d’une seule femme. De plus, le même apôtre, par le Saint Esprit, dit « qu’aux derniers temps quelques-uns apostasieront de la foi, s’attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons, disant des mensonges par hypocrisie, … défendant de se marier » (1 Corinthiens 9:5 ; 1 Timothée 3:2, 12 ; 4:1-3).
1. Les mots ancien et surveillant équivalent à ceux de prêtre et d’évêque. Prêtre vient d’un mot grec qui veut dire ancien, et évêque d’un mot qui signifie surveillant. La charge d’ancien ou de surveillant consistait à paître l’assemblée de Dieu, le troupeau du Seigneur (Actes 20:17, 28 ; 1 Pierre 5:2). Il y avait plusieurs anciens ou surveillants dans une assemblée. L’Écriture parle pas de diocèses, sur chacun desquels serait établi un évêque ou un archevêque ; elle ne mentionne pas des cardinaux. La parole de Dieu ne nous montre que deux charges dans l’Église ; les anciens ou surveillants, et les serviteurs on diacres (Philippiens 1:1 ; 1 Timothée 3:1-7 ; ce dernier passage donne le caractère que devaient posséder les surveillants et les serviteurs). Quant à toutes les autres charges, d’exorciste, de lecteur, de sous-diacre, etc., qui se trouvent dans l’Église romaine, l’Écriture n’en parle pas. Remarquons encore que Pierre, le premier pape, selon l’Église de Rome, se range lui-même simplement au nombre des anciens (1 Pierre 5:1).
Nous ne dirons rien du mariage, que Dieu a établi dès le commencement, sinon que la parole de Dieu ne le présente jamais comme un sacrement, bien qu’elle donne beaucoup de précieux enseignements aux maris et aux femmes.
De quels liens étroits l’Église de Rome enlace ceux qui sont placés ou se placent sous son influence ! Partout et en tout, elle mêle le prêtre à la vie des laïques, et par les sacrements, elle tend un piège sous les pas de chacun de ses membres. Car s’ils manquent d’y satisfaire, les voilà accusés de mépriser l’Église, d’être des hérétiques, et il fut un temps où, comme nous le verrons, une semblable accusation avait de terribles conséquences.
6.3.5 - Le culte de la Vierge
Après ce qui se rapporte aux sacrements, nous avons à voir d’autres doctrines funestes et contraires à l’Écriture que l’Église romaine impose aux âmes placées sous son joug. La première est le culte rendu à la Vierge Marie, aux saints et aux anges, chose complètement étrangère à la parole de Dieu. Ainsi s’est trouvée introduite une idolâtrie pire que celle du paganisme, dont elle est une imitation sous bien des rapports.
C’est vers le milieu du quatrième siècle, à une époque où la vraie piété avait beaucoup décliné pour faire place à nombre de pratiques superstitieuses, que l’on commença à vénérer la Vierge Marie d’une manière spéciale, comme le modèle des vierges, c’est-à-dire de ceux ou celles qui avaient fait vœu de célibat. Bientôt après, il devint habituel de lui donner le nom de mère de Dieu, ce qui donna naissance aux luttes du nestorianisme. Malgré la forte opposition qu’il rencontra d’abord, le culte de Marie s’établit et s’étendit peu à peu. Déjà au cinquième siècle, on pouvait voir dans toutes les Églises nombre de représentations de la Vierge tenant dans ses bras l’enfant Jésus. Le peuple ignorant, sorti des ténèbres du paganisme, peu et mal instruit des pures et saintes vérités des Écritures, amené à un christianisme de formes et de cérémonies, ayant un culte célébré avec une pompe empruntée au judaïsme et au paganisme, n’eut pas de peine à remplacer l’une ou l’autre des déesses qu’il adorait, par la Vierge Marie qu’on lui présentait toujours plus comme occupant une place élevée auprès de Dieu dans le ciel. Dans l’office ordinaire de la Vierge, se trouve une hymne commençant ainsi : « Salut, étoile de la mer, Mère auguste de Dieu et toujours Vierge, porte fortunée du ciel… affermissez-nous dans la paix, méritant ainsi mieux qu’Ève le nom de mère des vivants ». Ensuite : « Montrez que vous êtes notre mère, obtenez-nous le pardon de nos crimes ». On en vint, à la fin du sixième siècle, à adopter la légende de son Assomption, d’après laquelle, au moment de sa mort, Marie aurait été portée au ciel par des anges, ce qui a été récemment érigé en dogme (1954). L’Église romaine a consacré cette prétendue ascension ; dans l’office de la fête instituée pour la célébrer, on dit ces paroles : « Réjouissons-nous dans le Seigneur en célébrant le jour de fête en l’honneur de la bienheureuse Vierge Marie, de l’Assomption de laquelle les anges se réjouissent et louent le Fils de Dieu ». Et plus loin : « Marie est montée au ciel ; l’armée des anges se réjouit ». En même temps, l’Église romaine prenant des passages des Psaumes et des prophètes qui ont rapport à Israël et à Jérusalem, les applique à la Vierge qui n’est plus l’humble Marie que l’Écriture nous présente, mais qui est devenue une déesse que l’on honore comme « la reine du ciel », car tel est un des noms que lui donne l’Église romaine. Cela ne nous rappelle-t-il pas le culte que les Israélites, abandonnant le vrai Dieu, rendaient à la déesse Astarté, la reine des cieux ? L’Éternel le dit à Jérémie : « Ne vois-tu pas ce qu’ils font dans les villes de Juda, et dans les rues de Jérusalem ? Les fils ramassent le bois, et les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour faire des gâteaux à la reine des cieux ». Et ces malheureux Juifs, descendus en Égypte, persistant dans leur idolâtrie, disent au prophète : « Nous ne t’écouterons pas ; mais nous ferons certainement toute parole qui est sortie de notre bouche, en brûlant de l’encens à la reine des cieux » (Jérémie 7:17-20 ; 44:15-19). Et voilà une semblable idolâtrie transportée dans le christianisme, avec cette aggravation terrible du mal, qu’on l’associe aux saints noms du Père, du Fils et du Saint Esprit !
Marie devint toujours plus un objet direct de culte, sinon d’adoration (*), et le pape Urbain II, au concile de Clermont, en l’an 1095, confirma le service journalier établi pour honorer la Vierge, ainsi que les jours et les fêtes qui lui étaient spécialement réservés. Des églises lui furent dédiées sous le nom de « Notre Dame », et dans toutes les églises se trouve une chapelle qui lui est consacrée (**). À la doctrine de l’Assomption de la Vierge, on ajouta peu à peu celle de son « Immaculée conception », par où l’on entend qu’elle naquit sans péché, elle à qui l’ange dit : « Tu as trouvé grâce auprès de Dieu », et qui dit elle-même : « Mon esprit s’est réjoui en Dieu mon Sauveur » (Luc 1:30, 47). Si elle était sans péché, avait-elle besoin de trouver grâce et d’avoir en Dieu son Sauveur ? La doctrine de l’immaculée conception se trouve déjà en germe dès le huitième siècle, et se répandit bientôt dans l’Église, toutefois non sans lutte. Elle fut enfin définitivement confirmée par le pape Pie IX, en 1854, mais la fête en était depuis longtemps célébrée. Et c’est dans l’office de cette fête que sont appliquées à la Vierge les paroles d’Ésaïe 61:10, et celle de Proverbes 8:22-35, qui se rapportent au Seigneur Jésus Christ ! N’y a-t-il pas là quelque chose de blasphématoire ? C’est aussi dans le même office qu’on lit ces paroles : « Tu es toute belle, ô Marie, la tache originelle n’est pas en toi ». Et plus loin : « Aujourd’hui est sortie une branche des racines d’Isaï, aujourd’hui Marie a été conçue sans aucune tache de péché ». Vous remarquerez que les premières paroles se trouvent dans la prophétie d’Ésaïe relative au Seigneur Jésus, lorsqu’il vient régner pendant le millenium (Ésaïe 11:1). Et l’Église romaine les applique à la Vierge ! Puis elle dit encore : « Aujourd’hui est écrasée par elle la tête du serpent ancien », paroles qui se trouvent en Genèse 3:15, et se rapportent à Celui qui est la semence ou la postérité de la femme, c’est-à-dire Jésus, et non Marie. Combien il est coupable de se servir ainsi de la parole de Dieu, de la tordre pour établir une idolâtrie réelle !
(*) L’Église catholique se défend en effet d’adorer positivement la Vierge ou les saints, celles-ci ou celles-là étant des créatures. Elle distingue le culte de latrie (adoration) réservé à Dieu seul, du culte de dulie (hommage) rendu aux saints et aux anges. Mais l’équivoque est complète, et la contradiction devient évidente lorsque Marie est déclarée Reine du ciel et appelée « Mère de Dieu », une créature ne pouvant être la mère du Dieu créateur.
(**) Sur l’entrée d’une église à Lisbonne se trouvait gravée cette inscription « À la déesse Vierge de Lorette, des Italiens dévoués à sa divinité ont consacré cette Église ».
Que voit-on, en effet ? Dans toutes les églises du culte romain, dans les chapelles, comme aussi dans les maisons, se trouvent des représentations en statues, en tableaux, en gravures, de la Vierge et de l’enfant Jésus, devant lesquelles on se prosterne, on prie et l’on adore. Où trouve-t-on, dans les Écritures, une seule ligne pour justifier une telle chose ? Voici ce qu’elle dit : « Tu ne te feras point d’image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est dans les cieux en haut, et de ce qui est sur la terre en bas, et de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne t’inclineras point devant elles, et tu ne les serviras point » (Exode 20:4-5). Et l’apôtre Jean, à la fin de sa première épître, adresse aux chrétiens cette solennelle injonction : « Enfants, gardez-vous des idoles ». Chose frappante : dans l’ancienne Babylone, on adorait une mère déesse et son fils représenté dans des tableaux ou des statues, comme un petit enfant dans les bras de sa mère. C’est de là que le culte de la mère et de l’enfant se répandit partout, et est venu s’implanter dans l’Église catholique. Au Thibet et en Chine, les missionnaires jésuites furent surpris de trouver le pendant de la Madone romaine et de son enfant aussi dévotement adorés que dans la Rome papale. Shing Moo, la sainte mère, en Chine, était représentée avec un enfant dans ses bras et la tête entourée d’un nimbe ou auréole, absolument comme si c’eût été l’œuvre d’un artiste catholique romain. N’est-il pas profondément douloureux de voir que Satan, l’ennemi de Christ, a réussi à faire passer dans la chrétienté le culte rendu autrefois à Babylone à de fausses divinités ?
* * *
La place donnée à la Vierge Marie par l’Église romaine a amené d’autres erreurs d’une extrême gravité, car elles ne tendent à rien moins qu’à dépouiller le Seigneur d’une partie de ses glorieuses prérogatives. La parole de Dieu nous apprend qu’il n’y a qu’un « seul Médiateur entre Dieu et les hommes, l’homme Christ Jésus » (1 Timothée 2:5). Pour être ce Médiateur, le Fils éternel de Dieu est devenu un homme (Jean 1:14), et comme tel, il a été tenté comme nous en toutes choses, à part le péché (Hébreux 4:15 ; 2:18). Il a pris connaissance de nos douleurs, de nos langueurs, de nos peines, de nos infirmités, et y est entré dans un profond amour, une tendre compassion, une vraie sympathie ; un amour, une compassion, une sympathie divines en même temps qu’humaines (Matthieu 8:17). C’est ce que nous prouve toute sa vie sur la terre. Et maintenant qu’il est monté au ciel, il est le même ; son cœur n’a pas changé. Il sympathise avec nous dans nos infirmités ; il intercède sans cesse pour nous ; il est notre Avocat auprès du Père (Hébreux 4:15 ; 7:25 ; Romains 8:34 ; 1 Jean 2:1). Il nous invite à nous adresser nous-mêmes au Père, et le Père, en son nom, nous exauce (Jean 14: 13 ; 16:24, 26). Ainsi nous pouvons nous approcher de Dieu par Lui, entrer dans le sanctuaire même de Dieu, en vertu de son sacrifice, et venir directement avec confiance au trône de la grâce (Hébreux 7:25 ; 10:9 ; 4:16). Quel parfait et précieux Médiateur nous avons en Celui qui nous a aimés jusqu’à donner sa vie pour nous, qui nous aime et nous aimera toujours du même amour ! Quel besoin aurions-nous d’un autre, et qui saura mieux que Lui connaître tous nos besoins et pourra mieux y répondre ! Il est venu sur la terre pour cela. Il est notre salut, notre vie, notre paix.
Eh bien, l’Église romaine, dans son enseignement, n’a nullement tenu compte de ce que dit la parole de Dieu à cet égard. Non contente d’avoir donné à Marie la place que nous avons vue, elle en a fait une Médiatrice toute-puissante, et un Avocat dans le ciel ! Elle lui a assigné un titre et une fonction que l’Écriture n’attribue qu’à Christ. Elle a prétendu que Dieu était trop grand, et Jésus trop élevé, pour que nous approchions directement, soit du Père, soit du Fils, mais que Marie, par sa bonté, par sa douceur et sa tendresse, et à cause de l’amour que lui porte son Fils, est tout à fait propre à être Médiatrice et Avocat auprès de Lui. Le Fils, dit l’Église romaine, ne peut rien refuser à sa mère. Et elle oublie les paroles du Seigneur à Marie : « Qu’y a-t-il entre moi et toi, femme ? » (Jean 2:4). Un grand docteur de cette Église au 12° siècle, et qui sans nul doute a été un homme vraiment pieux, Saint Bernard, écrit : « Tu craignais de t’approcher du Père ; comme Adam, tu te cachais à sa voix ; il t’a donné Jésus pour Médiateur auprès de Lui. Mais peut-être es-tu effrayé de la majesté de ce Jésus, qui, bien qu’il se soit fait homme, est toujours Dieu. Il te faut auprès de Lui un avocat : recours à Marie ». Le pape Pie IX, en 1849, dans une encyclique (lettre circulaire adressée aux évêques), dit : « Vous savez bien, vénérables frères, que toute notre confiance est placée dans la très sainte Vierge, puisque Dieu a placé en Marie la plénitude de tout bien. S’il y a quelque espoir pour nous, quelque grâce, quelque salut, cela nous vient de Lui par elle ». N’est-il pas blasphématoire d’attribuer à une créature ce qui n’appartient qu’à Dieu et à son Fils ? (*)
(*) Plus encore, elle est maintenant expressément la co-rédemptrice : elle l’associe à l’œuvre du Rédempteur.
Écoutez encore ce qui est dit dans une des antiennes à la Vierge : « Salut, ô Reine, mère de miséricorde, douceur et espérance de notre vie, salut ! Nous crions à toi, nous fils d’Ève exilés, vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Toi, notre Avocat, tourne vers nous tes regards de miséricorde ». S’adresserait-on autrement à Dieu ou au Seigneur ? Sans aller plus loin, vous voyez dans quelle idolâtrie monstrueuse l’Église romaine entraîne ceux qui l’écoutent. Elle assimile la Vierge à la Sagesse éternelle de Proverbes 8, à l’Épouse du Cantique de Salomon. Elle lui dit : « Brisez les fers des coupables, donnez la lumière aux aveugles (*) … montrez que vous êtes notre mère ». Dans les litanies à la Vierge, elle la nomme « la porte du ciel », « le refuge des pécheurs », « l’étoile du matin » ; et que devient Christ, notre unique et précieux Sauveur, à qui seul l’Écriture attribue ces titres ? (**) Ces mêmes litanies s’adressent à la Vierge comme à la « Mère divine de la grâce », « la Mère du Créateur », « la source de notre joie », « l’arche de l’alliance », « la Reine de tous les saints », et en l’invoquant et demandant son intercession, elles l’associent au Père, au Fils, au Saint Esprit ! Croirait-on qu’un de leurs docteurs a été jusqu’à dire : « Toutes choses sont soumises à la Vierge, Dieu Lui-même », parce que, dit-il, « la mère a la prééminence sur le fils ». N’est-ce pas un blasphème horrible ? Combien sont à plaindre ceux que l’on conduit dans de telles voies ; on ne peut que désirer que Dieu les éclaire par sa parole, et que par elle, son Esprit les ramène et les garde dans la vérité, loin de ceux qui, « par de douces paroles et un beau langage, … séduisent les cœurs des simples » (Romains 16:18).
(*) Paroles analogues à celles que le Seigneur Jésus s’applique à Lui-même en Luc 4:19, où il dit : « L’Esprit du Seigneur est sur moi… Il m’a envoyé pour publier aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue ».
(**) Jean 10:9 ; Matthieu 11:28 ; Apocalypse 22:16.
Nous voyons la place prise par le culte de la Vierge dans l’Église romaine. C’est elle que l’on invoque, que l’on prie, à qui l’on s’attend, en qui l’on met toute confiance. Nous dirons encore quelques mots à ce sujet. Le Bréviaire est un livre de dévotion à l’usage des prêtres, qui, chaque jour, doivent en lire une partie, en public comme en particulier, quand l’heure en est venue. Il renferme des Psaumes pour les différentes heures du jour, des fragments des Écritures, des prières adaptées aux fêtes des saints, l’office de Marie, etc. Certainement il leur vaudrait mieux de lire journellement et uniquement toutes les Écritures inspirées de Dieu, propres pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, et rendre l’homme de Dieu accompli pour toute bonne œuvre ? (2 Timothée 3:16-17). C’est ce que faisait Timothée, qui n’avait pas besoin de Bréviaire, et ne savait rien du culte de Marie, qu’il eût sans doute rejeté avec horreur comme une idolâtrie des plus coupables.
Or, voici une des exhortations que renferme le Bréviaire : « Quand se lève la tempête des épreuves et que tu es jeté contre les rochers des afflictions, regarde en haut vers l’étoile, invoque Marie. Quand tu es ballotté çà et là, sur les vagues de l’orgueil, de l’ambition, de la passion et de l’envie, regarde vers l’étoile, invoque Marie. Quand la colère, ou la cupidité, ou les désirs de la chair, troublent ton âme, regarde vers Marie. Si tu es tourmenté en voyant la grandeur de tes péchés, et plein d’effroi à la pensée du jugement, si tu commences à t’enfoncer dans l’océan de la tristesse et l’abîme du doute, pense à Marie. Dans les dangers, les difficultés, les doutes, pense à Marie, invoque Marie ! » Que devient Christ, le divin et souverain Intercesseur, le grand Souverain sacrificateur de la vraie profession chrétienne, Celui qui sympathise à nos infirmités, qui nous appelle ses amis, qui est avec nous au milieu des tribulations que nous rencontrons dans le monde ? L’Église romaine le met pratiquement de côté et le remplace par une créature, bienheureuse et sans doute « bénie entre les femmes », mais dont la parole de Dieu ne parle que pour nous la montrer, sauvée par grâce, ignorante et faillible comme nous (*). Remarquons qu’après le premier chapitre des Actes, où elle est mentionnée comme se trouvant avec les disciples, Marie n’est plus jamais nommée dans la suite du Nouveau Testament. Il y a un seul Médiateur, Jésus, notre Avocat auprès du Père, notre Intercesseur tout puissant auprès de Dieu, et dont l’amour est immense et immuable. Il nous suffit. Dans les épreuves, les tentations, les difficultés et les dangers, c’est vers Lui, la vraie Étoile du matin, le vrai et seul refuge, qu’il faut regarder, Lui qu’il faut invoquer. Marie n’a rien fait pour nous, Lui a donné sa vie pour nous sauver.
(*) Qu’on lise les paroles de la Sainte Écriture : « Une femme éleva sa voix du milieu de la foule, et dit à Jésus : Bienheureux est le ventre qui t’a porté, et les mamelles que tu as tétées ! Et il dit : Mais plutôt, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent » (Luc 11:27-28). C’est ce que l’Église de Rome n’a point fait. Elle adore la Vierge et méconnait la parole de Dieu.
Une des formes superstitieuses qui se rattache au culte de Marie, est le Rosaire. On nomme ainsi un cordon terminé par une croix, et dans lequel sont enfilés des grains ou perles de deux différentes grosseurs. Il y a quinze dizaines des plus petits grains, et, devant chaque dizaine, se trouve un plus gros grain. Ces grains, que l’on fait passer entre les doigts, servent à compter le nombre de prières que l’on a récitées. Aux gros grains, on récite un Pater (la prière que le Seigneur enseigna à ses disciples), aux petits grains on récite un Ave Maria, qui est la salutation de l’ange à Marie. Les catholiques la rendent ainsi : « Je vous salue, Marie, pleine de grâces ; le Seigneur est avec vous ; vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni ». Si l’on compare ces paroles avec Luc 1:28 et 30, on voit tout de suite la différence entre la parole inspirée de Dieu et la version qu’en donne l’Église romaine. À cette première partie de l’Ave Maria, elle ajoute : « Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant, et à l’heure de la mort ». Or d’après l’Écriture, nous avons en Christ l’unique Sauveur des pécheurs ; en croyant en Lui nous possédons la vie éternelle, et ainsi nous sommes sauvés maintenant, et pour l’heure de notre mort, et pour l’éternité. Quelle différence entre la doctrine de Christ qui nous assure d’un salut parfait, actuel et éternel, et la doctrine de Rome qui laisse toujours dans le doute si l’on est sauvé. Elle veut que l’on ait recours à l’intercession d’une créature qui devait trouver grâce pour elle-même, et qui maintenant ne peut assurément rien pour nous, car, selon l’Écriture, Dieu ne lui a conféré aucune autorité, aucune puissance ! C’est le Seigneur Jésus à qui toute autorité a été donnée dans le ciel et sur la terre (Matthieu 28:18). C’est Lui qui tient les clefs de la mort et du hadès (*) (Apocalypse 1:18). C’est Lui qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul n’ouvrira (Apocalypse 3:7).
(*) Le hadès, c’est-à-dire le lieu où vont les âmes séparées du corps.
Le chapelet est un abrégé du Rosaire. Il ne contient que cinq dizaines d’Ave Maria séparées par un Pater. À quoi servent le Rosaire et le chapelet ? À compter le nombre de prières que l’on a récitées à la suite l’une de l’autre. Répéter ainsi, avec ou sans attention, 150 Ave et 15 Pater, ou 50 Ave et 5 Pater ; dire ou répéter plusieurs fois le Rosaire et le chapelet, constitue un acte méritoire aux yeux de Dieu, selon l’Église romaine. Le prêtre l’impose comme pénitence, pour expier des fautes. On récite le Rosaire ou le chapelet, pour abréger la durée des peines du purgatoire pour soi ou pour les autres. Nous ne trouvons rien de semblable dans l’Écriture ; ce sont des pratiques superstitieuses inventées par les hommes. Que dit le Seigneur ? « Quand vous priez, n’usez pas de vaines redites, comme ceux des nations, car ils s’imaginent qu’ils seront exaucés en parlant beaucoup. Ne leur ressemblez donc pas » (Matthieu 6:7-8). « Comme ceux des nations », dit Jésus. Cela ne rappelle-t-il pas les prêtres de Baal, qui, depuis le matin jusqu’à midi, répétaient « Ô Baal, réponds-nous ! » (1 Rois 18:26). Et l’on sait que de nos jours, les Bouddhistes ont eux aussi leurs chapelets et même leurs moulins à prières ! Les prêtres romains imposent ces répétitions de prières pour expier des fautes, et la parole de Dieu nous dit simplement : « Si nous confessons nos péchés, il (Dieu) est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité » (1 Jean 1:9). Et là il n’est question d’aucun rosaire, ni de répéter des prières. Nous venons à Dieu, nous Lui confessons (et non au prêtre) humblement nos péchés, et en vertu de l’œuvre parfaite de Christ, Dieu nous pardonne, et nous purifie. Quelle grâce précieuse !
Le Rosaire, comme nous le voyons, est consacré à la Vierge. L’Église romaine a institué une fête du très Saint Rosaire, comme elle dit, et c’est toujours la Vierge qui y est glorifiée. Dans le service de cette fête, voici ce que nous lisons : « Réjouissons-nous tous dans le Seigneur, nous qui célébrons ce jour de fête en l’honneur de la bienheureuse Vierge Marie », et ensuite : « Ô Dieu ! faites, nous vous en prions, qu’honorant dans ces mystères le Saint Rosaire de la bienheureuse Vierge Marie, nous imitions ce qu’ils renferment, et nous obtenions ce qu’ils promettent ». Honorer un chapelet de grains, y voir des mystères à imiter (et quels sont ces mystères !), associer les noms de Dieu et du Seigneur à l’idolâtrie envers une créature, n’est-ce pas une profanation ?
Il est bon de savoir ce qu’enseigne cette église dite apostolique qui prétend être la seule vraie, afin d’être en garde contre ses séductions. « Enfants, gardez-vous des idoles », disait l’apôtre Jean en terminant sa première épître (1 Jean 5:21). Déjà le mal commençait ; l’Église se détournait de Jésus Christ, le Dieu véritable et la vie éternelle (1 Jean 5:20), et l’Esprit Saint avertissait solennellement les chrétiens à l’égard de ce qui allait s’introduire dans l’Église et corrompre la vérité.
(*2) Psaume 32:5.
(*3) Voyez Psaume 32:3.
(*4) Jean 20:23.
(*5) Voyez ce que Pierre dit aux Juifs : Actes 2:38 ; 3:19 ; 5:31 ; voyez aussi ce que dit Paul : 13:38-41 ; 16:31 ; 28:23-28.
Dans les premiers temps de l’Église, on demandait que ceux qui avaient commis un grand péché en fissent une confession publique avant d’être de nouveau reçus dans la communion chrétienne. Le grand empereur Théodose fut obligé de s’humilier ainsi devant tout son peuple, à Milan. Peu à peu on en vint à se confesser aux prêtres, et en l’an 1215, le pape Innocent III établit la confession auriculaire comme obligatoire, et l’on dut se confesser pour pouvoir communier, pour être marié et pour recevoir les derniers sacrements avant de mourir. Les consciences étaient ainsi liées par la crainte que l’on avait d’être perdu, si l’on mourait sans absolution, car c’est ce que Rome enseigne, et le pouvoir des prêtres et par conséquent de Rome était fermement établi sur les âmes. Cette pratique d’invention humaine a donné lieu, on l’imagine sans peine, à toutes sortes d’abus et de désordres moraux.
6.3.3 - L’Eucharistie (la Cène), la Messe, le saint sacrement, la transubstantiation
Après le sacrement de pénitence, le concile de Trente place l’Eucharistie ou la Cène. Mais combien dans l’Église romaine, elle diffère du simple repas institué par le Seigneur en mémoire de sa mort ! La Cène est devenue la Messe (*). C’est le grand acte de culte de l’Église de Rome. Ce fut le pape Grégoire I, dit le Grand, qui établit le service de la messe dans ses traits principaux. Le concile de Trente lui donna la forme définitive qu’elle a maintenant dans toutes les Églises romaines. La Messe se divise en deux parties principales — la première, appelée autrefois messe des catéchumènes parce qu’à l’origine ceux-ci n’étaient admis qu’à cette première partie, est composée de prières, lectures de la Bible, cantiques, prédication, qui constituent une préparation ou introduction à la Messe — La deuxième partie, appelée autrefois la messe des fidèles, constitue le sacrifice proprement dit, et comprend l’offertoire, l’offrande à Dieu du pain (**) et du vin destinés à être consacrés de la Cène, la consécration où par les paroles de l’institution de la Cène prononcées par le prêtre s’accomplit, selon l’Église romaine, le mystère de la transsubstantiation dont nous parlerons plus loin, la communion prise par le prêtre avec le pain et la coupe, et avec le pain seulement, par les assistants qui l’ont demandée. La messe se termine par l’action de grâces, et l’assemblée est congédiée par ces mots : « Ite, missa est ».
(*) En rapport avec les mots qui terminent l’essentiel de la cérémonie : « Ite, missa est ecclesia », c’est-à-dire : « Allez, l’assemblée est congédiée ». De missa, on a fait messe.
(**) Le pain de la communion est une sorte d’oublie faite de farine et d’eau, sans levain, et sur laquelle est l’empreinte d’une croix. On lui donne le nom d’hostie ou sacrifice, nous verrons pourquoi. On la conserve dans l’ostensoir, vase plus ou moins richement orné, dans lequel on l’expose ou on la transporte. Il n’y a rien de semblable dans la parole de Dieu. Le pain que rompit le Seigneur Jésus, était celui dont on se servait à table.
Sans parler de tout ce qui accompagne la célébration de la messe, les ornements de l’autel, les cierges et l’encens, les vêtements des prêtres et de ceux qui l’assistent, choses qui rappellent les formes du judaïsme et même du paganisme, on voit aisément combien l’Église romaine s’est écartée du culte « en esprit et en vérité » dont parle le Seigneur (*), et l’a remplacé par des cérémonies arrêtées d’avance et des choses qui agissent sur les sens. C’est un culte charnel, inventé par l’homme, où rien n’est laissé à la libre action de l’Esprit Saint. De plus, le prêtre est là, ayant seul le droit d’officier, faisant partie d’une classe à part, tandis que, selon la parole de Dieu, tous les croyants sont une « sainte sacrificature » (**), chacun de ceux qui la composent ayant le privilège de rendre l’action de grâces à la table du Seigneur, sous la direction de l’Esprit Saint.
(*) Jean 4:23-24.
(**) 1 Pierre 2:5-9.
Mais il y a des choses pires encore ; les erreurs les plus graves se mêlent à ce culte de l’Église de Rome. La table de communion est devenue un autel. Le concile de Trente enseigne en effet que, dans la Cène ou la Messe, est offert un véritable sacrifice, non sanglant, il est vrai, mais un sacrifice vraiment propitiatoire, efficace pour les péchés non expiés des vivants et des morts. C’est Christ qui est offert, dit le concile, c’est la même victime que celle qui autrefois s’est offerte elle-même sur la croix, et qui est offerte maintenant par le ministère des prêtres. Par ce sacrifice propitiatoire renouvelé chaque jour dans l’Eucharistie, Dieu, selon l’Église de Rome, est apaisé et nous est rendu propice. On peut aisément voir que cet enseignement est contraire à l’Écriture. L’Esprit Saint, dans l’épître aux Hébreux, déclare que « l’offrande du corps de Jésus Christ » a été faite « une fois pour toutes » ; que Christ a offert « un seul sacrifice pour les péchés », et que, « par une seule offrande, il a rendu parfaits à perpétuité ceux qui sont sanctifiés », de sorte que Dieu ne se souviendra « plus jamais de leurs péchés ni de leurs iniquités » et que « là où il y a rémission de ces choses, il n’y a plus d’offrande pour le péché ». De plus, il nous est dit que Christ ne peut s’offrir plusieurs fois, parce qu’alors il devrait souffrir plusieurs fois, et enfin que, « sans effusion de sang, il n’y a point de rémission de péchés » (*). Un sacrifice non sanglant n’en est donc pas un, et Christ glorifié ne peut souffrir, ce qui est nécessaire pour un vrai sacrifice. Partout, dans ces chapitres 9 et 10 de l’épître aux Hébreux, il est insisté sur le fait d’un seul, unique sacrifice de Christ, pleinement suffisant pour ôter les péchés. Ainsi le sacrifice de la messe n’en est pas un, et les âmes qui s’appuient sur ce faux enseignement, sont trompées, et ne peuvent jamais jouir de la paix qui résulte de ce qu’en vertu du seul et unique sacrifice de Christ, Dieu ne se souvient plus jamais de nos péchés et de nos iniquités. Or, dit l’apôtre, « là où il y a rémission de ces choses, il n’y a plus d’offrande pour le péché » (**).
(*) Hébreux 10:10, 12, 14, 17, 18 ; 9:25-26, 22.
(**) Hébreux 10:17, 18.
Remarquez qu’il est dit que la messe est un sacrifice pour les vivants et pour les morts. L’Écriture ne nous enseigne nulle part que les péchés de ceux qui sont morts puissent être expiés. Elle nous dit simplement. « Après la mort, le jugement » (*), pour ceux qui n’ont pas cru ici-bas au Seigneur Jésus et à son unique sacrifice expiatoire. L’idée d’un sacrifice pour les morts se rattache à une autre erreur enseignée par l’Église romaine, celle du purgatoire. C’est un lieu qui n’est ni le ciel, ni l’enfer, mais où les âmes souffrent pour les péchés qui n’ont pas été expiés sur la terre, jusqu’à ce qu’elles en soient purifiées. L’Église romaine prétend que les messes dites pour ces âmes abrègent leurs tourments ! La parole de Dieu ne dit pas un mot de cela.
(*) Hébreux 9:27.
À cette erreur d’un sacrifice de Christ journalier et non sanglant, s’en joint une autre plus grave encore, celle de la transsubstantiation ou changement de substance. Suivant cette doctrine, quand le prêtre prononce les paroles de la consécration, le pain et le vin, tout en conservant leur apparence, sont réellement changés dans le corps et le sang du Seigneur Jésus Christ. Cette doctrine fut inventée au neuvième siècle (le plus ténébreux du Moyen Âge) par le moine Paschase Radbert. S’appuyant sur ces paroles : « Ceci est mon corps » (*), il disait : « Le pain et le vin, après avoir été consacrés, ne sont pas autre chose que la chair du Christ et son sang, la même chair qui est née de Marie et qui a souffert sur la croix ». Après une longue et vive opposition, le quatrième concile de Latran, en 1215, consacra cette doctrine en ces termes : « Le corps et le sang du Seigneur sont véritablement contenus dans le sacrement de l’autel sous la figure du pain et du vin, lorsque par la puissance de Dieu et par le moyen du prêtre officiant, le pain est changé dans le corps, et le vin dans le sang de Christ. Le changement opéré de cette manière est si réel et si complet, que les éléments (le pain et le vin) contiennent Christ tout entier — divinité, humanité, âme, corps et sang, avec toutes leurs parties constituantes ». Et le concile de Trente, dans le 16° siècle, a confirmé cette doctrine, et tout membre de l’Église de Rome doit la croire, sous peine d’anathème ! Le prêtre, à un certain moment élève l’hostie, et en vertu des paroles qu’il a prononcées, cette hostie est Dieu Lui-même. Il se prosterne en l’adorant, et tout le peuple suit son exemple. Un homme, et parfois un homme méchant, crée son Créateur ! expression blasphématoire et pourtant usitée, car l’hostie, dit l’Église de Rome, n’est plus du pain, mais Christ Lui-même. Ceux qui possèdent la parole de Dieu, savent, d’après elle, que Christ est maintenant dans la gloire, dans un corps glorifié ; il ne peut donc être en même temps ici-bas, âme, corps et sang, dans l’hostie. Son sang a été versé une fois pour toutes pour l’expiation des péchés, et ne peut être dans la coupe. Il faudrait donc qu’il y eût deux Christs. Dans la Cène, selon l’Écriture, on annonce la mort du Seigneur, on se souvient de la mort du Seigneur, mais supposer que l’on puisse mettre à mort un Christ glorifié est une chose horrible et contraire à toute vérité. C’est là une des plus fatales erreurs de l’Église de Rome, c’est une monstrueuse idolâtrie. On trompe le pauvre peuple en lui faisant croire qu’un morceau de pain est devenu Dieu et qu’il faut l’adorer.
(*) Ce qui veut dire, ceci représente mon corps, de même que, dans l’institution de la Pâque, l’agneau est appelé la Pâque de l’Éternel (Exode 12:11).
L’Église romaine a institué une fête que l’on nomme Fête-Dieu, ou du Saint Sacrement. Ce jour-là, dans une procession solennelle, on porte l’hostie consacrée dans un magnifique ostensoir. Tout le monde doit s’agenouiller sur son passage en signe d’adoration, car c’est Dieu qui est là, disent les prêtres. En certains pays, comme l’Espagne, le prêtre qui porte l’hostie à un mourant, est accompagné d’un homme qui durant tout le trajet sonne une clochette. Dès qu’elle se fait entendre, tous ceux à qui le son parvient doivent tomber à genoux et y rester jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus le percevoir. Le prêtre fait croire au peuple et dit au mourant que c’est le Dieu vivant qui est dans le ciboire (*) et que l’on transporte ainsi. Quelle triste aberration !
(*) Vase dans lequel on garde l’hostie.
Nous avons vu aussi que les simples fidèles communient avec le pain seulement. La coupe est réservée aux prêtres seuls. C’est encore une invention humaine dont la parole de Dieu ne dit rien. Au contraire, le Seigneur dit à ses disciples : « Buvez-en tous » ; et l’apôtre, s’adressant à toute l’assemblée à Corinthe, recommande que chacun « mange du pain et boive de la coupe » (*). Ce retranchement de la coupe, aux laïques se fait sous prétexte qu’il pourrait s’attacher à la barbe quelques gouttes du vin consacré ou que les malades pourraient en répandre, et que d’ailleurs l’hostie renferme la chair du Seigneur aussi bien que le sang. On dit aussi que le sang étant dans l’hostie, il n’est pas nécessaire que les laïques boivent la coupe. Mais alors pourquoi les prêtres la boivent-ils ? On voit clairement que cette coutume n’a été établie que pour marquer plus distinctement la supériorité des prêtres.
(*) Matthieu 26:27 ; 1 Corinthiens 11:28.
Nous nous sommes étendu un peu longuement sur ce sujet, parce que c’est un des points qui caractérisent le plus fortement l’Église de Rome ; la messe constitue le centre même de la religion catholique. Aller à la messe est ce qui distingue le vrai catholique romain ; mais rien ne fait mieux voir que la messe combien cette Église s’est écartée de la vérité.
6.3.4 - L’Extrême-Onction, l’Ordre et le Mariage
Il nous reste à voir les trois derniers sacrements de l’Église de Rome.
6.3.4.1 - L’extrême-onction
Le premier est ce que l’on nomme l’extrême-onction. On ne l’administre qu’aux malades que l’on estime être à la dernière extrémité, et comme après ce sacrement, il n’y en a plus d’autres, on lui donne ce nom d’extrême-onction. L’Église romaine enseigne qu’il a pour effet de laver les derniers restes du péché, afin que le malade en mourant aille droit au ciel, et aussi de le fortifier contre les angoisses de la mort. Si quelqu’un meurt en état de péché mortel sans avoir reçu ce sacrement, à défaut du sacrement de pénitence, il va en enfer.
Nous voyons encore par là quel empire l’Église romaine assume sur les âmes, car le prêtre seul peut administrer ce sacrement. Et remarquons aussi comme tout est calculé pour retenir les cœurs dans la crainte, et par conséquent quel Dieu terrible et sans compassion on leur présente. Voici en quoi consiste l’extrême-onction. Le prêtre, revêtu d’une étole violette, arrive auprès du mourant et lui présente le crucifix qu’il doit b..... avec respect. Après une série de prières et d’aspersions avec de l’eau bénite, et si possible après avoir entendu la confession du malade et lui avoir donné l’eucharistie (*), le prêtre procède à l’onction. Pour cela, avec son pouce trempé dans l’huile sainte, c’est-à-dire consacrée, il touche, en faisant le signe de la croix, les différentes parties du corps qui ont pu être les instruments de péché. Il commence par les yeux, en disant : « Que le Seigneur, en vertu de son onction sainte et par sa grande miséricorde, te pardonne tous les péchés que tu as commis par tes yeux ». Et il continue de même pour les autres organes des sens, les oreilles, le nez, la bouche et les mains, puis enfin la poitrine et les pieds. Suivent encore des prières et des signes de croix, et ensuite on brûle le linge ou les boules de coton qui ont servi à essuyer le pouce du prêtre. Le mourant peut alors s’en aller en toute sécurité ; le ciel lui est ouvert.
(*) On donne à l’eucharistie administrée aux derniers moments le nom de viatique. Ce mot vient du latin via, chemin, et se dit en général des provisions de route. Dans le langage de l’Église romaine, c’est la provision pour le dernier grand voyage, ce qui doit fortifier celui qui va le faire.
C’est dans le 12° siècle seulement que cette cérémonie, dernier acte de la vie d’un bon catholique romain, a été introduite. Les docteurs romains citent à l’appui de l’extrême-onction les passages suivants : « Et ils chassèrent beaucoup de démons, et oignirent d’huile beaucoup d’infirmes et les guérirent » (Marc 6:13) ; puis : « Quelqu’un d’entre vous est-il malade, qu’il appelle les anciens de l’assemblée, et qu’ils prient pour lui en l’oignant d’huile au nom du Seigneur ; et la prière de la foi sauvera le malade … et s’il a commis des péchés, il lui sera pardonné » (Jacques 5:14-15). Qui ne voit que ces passages n’ont aucun rapport avec l’extrême onction ? Celle-ci a pour objet le salut de l’âme, et nullement la guérison du corps, puisqu’on ne la donne qu’aux mourants pour leur ouvrir le ciel. Tandis que dans ces deux passages, il s’agit de la guérison du corps, soit par voie miraculeuse, ou en réponse à la prière de la foi, sans laquelle l’onction même n’aurait aucun effet. Et pour aller droit au ciel, un mourant a-t-il besoin d’autre chose que de croire au Seigneur Jésus ? L’Écriture nous dit : « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé », et : celui « qui croit au Fils a la vie éternelle ». « Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi » (Actes 16:31 ; Jean 3:36 ; Éphésiens 2:8). Où est-il question du ministère obligé d’un prêtre et de son action ? Nulle part dans la parole de Dieu. Celui qui croit en Jésus est lavé de tous ses péchés et propre pour paraître en la présence de Dieu. Il peut s’en aller en paix, car « absent du corps », il est « présent avec le Seigneur » (2 Corinthiens 5:8). Le brigand sur la croix eut-il besoin de l’extrême-onction pour être ce jour même « dans le paradis » avec Jésus ? Étienne, le premier martyr, qui remettait à Jésus son esprit, ne l’a pas reçue ; lui et tant d’autres qui sont morts dans la foi, ne seraient donc pas sauvés, tandis que des hommes qui jamais n’ont été convertis et dont les péchés n’ont pas été effacés, iraient au ciel en vertu de cette onction faite par un homme ! Ces ordonnances inventées par des hommes, d’une part ne sont propres qu’à jeter les âmes dans une crainte superstitieuse et sans fondement, et d’une autre donnent une sécurité illusoire à des personnes qui, toute leur vie, ne se sont pas souciées de Dieu.
6.3.4.2 - L’ordre, l’ordination
Après le sacrement de l’extrême-onction vient celui de l’ordre (*) conféré par la cérémonie de l’ordination : il confère au prêtre le caractère sacerdotal, c’est-à-dire le pouvoir de célébrer la messe et d’administrer tous les sacrements (sauf la confirmation et l’ordre réservés à l’évêque). Pour ordonner un prêtre, l’évêque lui impose les mains, l’oint de l’huile sainte et lui fait toucher les objets sacrés (calice et patère) lui permettant d’offrir le sacrifice de la messe. Le prêtre ainsi consacré a désormais la puissance de consacrer le vrai corps du Seigneur dans la Cène, c’est-à-dire, comme on l’a vu, d’opérer ce prétendu miracle qui transforme le pain et le vin dans le corps et le sang de Christ. Le caractère conféré par l’ordination est indélébile, c’est-à-dire ne peut être effacé, de sorte que celui qui abandonne la prêtrise est regardé comme un apostat. À cela l’Église romaine ajoute le célibat obligatoire pour les prêtres ; il leur est interdit de se marier.
(*) Ce sacrement est ainsi appelé parce qu’il établit un ordre dans la société chrétienne en séparant les clercs des laïques, et parce qu’il divise les clercs en plusieurs degrés formant une hiérarchie, un ordre (diaconat, prêtrise, épiscopat …)
Toutes ces choses n’ont aucun fondement dans l’Écriture et même y sont entièrement opposées. D’abord nulle part nous n’y voyons qu’il y ait une classe de sacrificateurs à part des autres chrétiens. Chez les Juifs, cela existait. Mais maintenant tous les vrais croyants sont sacrificateurs pour offrir à Dieu, non le corps de Jésus Christ qui a été offert une fois pour toutes sur la croix, mais des sacrifices de louanges et d’actions de grâces (1 Pierre 2:5 ; Hébreux 13:15 ; Apocalypse 1:6). Ensuite, nous ne voyons pas que ni les anciens ou surveillants (*) ni les diacres ou serviteurs, fussent oints. Les apôtres ou quelque envoyé d’un apôtre leur imposaient les mains et en même temps on priait le Seigneur (Actes 6:6 ; 14:23). Quant au célibat des prêtres, nous lisons que Pierre était marié, que Paul revendique pour lui et Barnabas le droit de l’être, et que Paul recommande que les surveillants ou anciens, ainsi que les serviteurs, soient maris d’une seule femme. De plus, le même apôtre, par le Saint Esprit, dit « qu’aux derniers temps quelques-uns apostasieront de la foi, s’attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons, disant des mensonges par hypocrisie, … défendant de se marier » (1 Corinthiens 9:5 ; 1 Timothée 3:2, 12 ; 4:1-3).
1. Les mots ancien et surveillant équivalent à ceux de prêtre et d’évêque. Prêtre vient d’un mot grec qui veut dire ancien, et évêque d’un mot qui signifie surveillant. La charge d’ancien ou de surveillant consistait à paître l’assemblée de Dieu, le troupeau du Seigneur (Actes 20:17, 28 ; 1 Pierre 5:2). Il y avait plusieurs anciens ou surveillants dans une assemblée. L’Écriture parle pas de diocèses, sur chacun desquels serait établi un évêque ou un archevêque ; elle ne mentionne pas des cardinaux. La parole de Dieu ne nous montre que deux charges dans l’Église ; les anciens ou surveillants, et les serviteurs on diacres (Philippiens 1:1 ; 1 Timothée 3:1-7 ; ce dernier passage donne le caractère que devaient posséder les surveillants et les serviteurs). Quant à toutes les autres charges, d’exorciste, de lecteur, de sous-diacre, etc., qui se trouvent dans l’Église romaine, l’Écriture n’en parle pas. Remarquons encore que Pierre, le premier pape, selon l’Église de Rome, se range lui-même simplement au nombre des anciens (1 Pierre 5:1).
Nous ne dirons rien du mariage, que Dieu a établi dès le commencement, sinon que la parole de Dieu ne le présente jamais comme un sacrement, bien qu’elle donne beaucoup de précieux enseignements aux maris et aux femmes.
De quels liens étroits l’Église de Rome enlace ceux qui sont placés ou se placent sous son influence ! Partout et en tout, elle mêle le prêtre à la vie des laïques, et par les sacrements, elle tend un piège sous les pas de chacun de ses membres. Car s’ils manquent d’y satisfaire, les voilà accusés de mépriser l’Église, d’être des hérétiques, et il fut un temps où, comme nous le verrons, une semblable accusation avait de terribles conséquences.
6.3.5 - Le culte de la Vierge
Après ce qui se rapporte aux sacrements, nous avons à voir d’autres doctrines funestes et contraires à l’Écriture que l’Église romaine impose aux âmes placées sous son joug. La première est le culte rendu à la Vierge Marie, aux saints et aux anges, chose complètement étrangère à la parole de Dieu. Ainsi s’est trouvée introduite une idolâtrie pire que celle du paganisme, dont elle est une imitation sous bien des rapports.
C’est vers le milieu du quatrième siècle, à une époque où la vraie piété avait beaucoup décliné pour faire place à nombre de pratiques superstitieuses, que l’on commença à vénérer la Vierge Marie d’une manière spéciale, comme le modèle des vierges, c’est-à-dire de ceux ou celles qui avaient fait vœu de célibat. Bientôt après, il devint habituel de lui donner le nom de mère de Dieu, ce qui donna naissance aux luttes du nestorianisme. Malgré la forte opposition qu’il rencontra d’abord, le culte de Marie s’établit et s’étendit peu à peu. Déjà au cinquième siècle, on pouvait voir dans toutes les Églises nombre de représentations de la Vierge tenant dans ses bras l’enfant Jésus. Le peuple ignorant, sorti des ténèbres du paganisme, peu et mal instruit des pures et saintes vérités des Écritures, amené à un christianisme de formes et de cérémonies, ayant un culte célébré avec une pompe empruntée au judaïsme et au paganisme, n’eut pas de peine à remplacer l’une ou l’autre des déesses qu’il adorait, par la Vierge Marie qu’on lui présentait toujours plus comme occupant une place élevée auprès de Dieu dans le ciel. Dans l’office ordinaire de la Vierge, se trouve une hymne commençant ainsi : « Salut, étoile de la mer, Mère auguste de Dieu et toujours Vierge, porte fortunée du ciel… affermissez-nous dans la paix, méritant ainsi mieux qu’Ève le nom de mère des vivants ». Ensuite : « Montrez que vous êtes notre mère, obtenez-nous le pardon de nos crimes ». On en vint, à la fin du sixième siècle, à adopter la légende de son Assomption, d’après laquelle, au moment de sa mort, Marie aurait été portée au ciel par des anges, ce qui a été récemment érigé en dogme (1954). L’Église romaine a consacré cette prétendue ascension ; dans l’office de la fête instituée pour la célébrer, on dit ces paroles : « Réjouissons-nous dans le Seigneur en célébrant le jour de fête en l’honneur de la bienheureuse Vierge Marie, de l’Assomption de laquelle les anges se réjouissent et louent le Fils de Dieu ». Et plus loin : « Marie est montée au ciel ; l’armée des anges se réjouit ». En même temps, l’Église romaine prenant des passages des Psaumes et des prophètes qui ont rapport à Israël et à Jérusalem, les applique à la Vierge qui n’est plus l’humble Marie que l’Écriture nous présente, mais qui est devenue une déesse que l’on honore comme « la reine du ciel », car tel est un des noms que lui donne l’Église romaine. Cela ne nous rappelle-t-il pas le culte que les Israélites, abandonnant le vrai Dieu, rendaient à la déesse Astarté, la reine des cieux ? L’Éternel le dit à Jérémie : « Ne vois-tu pas ce qu’ils font dans les villes de Juda, et dans les rues de Jérusalem ? Les fils ramassent le bois, et les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour faire des gâteaux à la reine des cieux ». Et ces malheureux Juifs, descendus en Égypte, persistant dans leur idolâtrie, disent au prophète : « Nous ne t’écouterons pas ; mais nous ferons certainement toute parole qui est sortie de notre bouche, en brûlant de l’encens à la reine des cieux » (Jérémie 7:17-20 ; 44:15-19). Et voilà une semblable idolâtrie transportée dans le christianisme, avec cette aggravation terrible du mal, qu’on l’associe aux saints noms du Père, du Fils et du Saint Esprit !
Marie devint toujours plus un objet direct de culte, sinon d’adoration (*), et le pape Urbain II, au concile de Clermont, en l’an 1095, confirma le service journalier établi pour honorer la Vierge, ainsi que les jours et les fêtes qui lui étaient spécialement réservés. Des églises lui furent dédiées sous le nom de « Notre Dame », et dans toutes les églises se trouve une chapelle qui lui est consacrée (**). À la doctrine de l’Assomption de la Vierge, on ajouta peu à peu celle de son « Immaculée conception », par où l’on entend qu’elle naquit sans péché, elle à qui l’ange dit : « Tu as trouvé grâce auprès de Dieu », et qui dit elle-même : « Mon esprit s’est réjoui en Dieu mon Sauveur » (Luc 1:30, 47). Si elle était sans péché, avait-elle besoin de trouver grâce et d’avoir en Dieu son Sauveur ? La doctrine de l’immaculée conception se trouve déjà en germe dès le huitième siècle, et se répandit bientôt dans l’Église, toutefois non sans lutte. Elle fut enfin définitivement confirmée par le pape Pie IX, en 1854, mais la fête en était depuis longtemps célébrée. Et c’est dans l’office de cette fête que sont appliquées à la Vierge les paroles d’Ésaïe 61:10, et celle de Proverbes 8:22-35, qui se rapportent au Seigneur Jésus Christ ! N’y a-t-il pas là quelque chose de blasphématoire ? C’est aussi dans le même office qu’on lit ces paroles : « Tu es toute belle, ô Marie, la tache originelle n’est pas en toi ». Et plus loin : « Aujourd’hui est sortie une branche des racines d’Isaï, aujourd’hui Marie a été conçue sans aucune tache de péché ». Vous remarquerez que les premières paroles se trouvent dans la prophétie d’Ésaïe relative au Seigneur Jésus, lorsqu’il vient régner pendant le millenium (Ésaïe 11:1). Et l’Église romaine les applique à la Vierge ! Puis elle dit encore : « Aujourd’hui est écrasée par elle la tête du serpent ancien », paroles qui se trouvent en Genèse 3:15, et se rapportent à Celui qui est la semence ou la postérité de la femme, c’est-à-dire Jésus, et non Marie. Combien il est coupable de se servir ainsi de la parole de Dieu, de la tordre pour établir une idolâtrie réelle !
(*) L’Église catholique se défend en effet d’adorer positivement la Vierge ou les saints, celles-ci ou celles-là étant des créatures. Elle distingue le culte de latrie (adoration) réservé à Dieu seul, du culte de dulie (hommage) rendu aux saints et aux anges. Mais l’équivoque est complète, et la contradiction devient évidente lorsque Marie est déclarée Reine du ciel et appelée « Mère de Dieu », une créature ne pouvant être la mère du Dieu créateur.
(**) Sur l’entrée d’une église à Lisbonne se trouvait gravée cette inscription « À la déesse Vierge de Lorette, des Italiens dévoués à sa divinité ont consacré cette Église ».
Que voit-on, en effet ? Dans toutes les églises du culte romain, dans les chapelles, comme aussi dans les maisons, se trouvent des représentations en statues, en tableaux, en gravures, de la Vierge et de l’enfant Jésus, devant lesquelles on se prosterne, on prie et l’on adore. Où trouve-t-on, dans les Écritures, une seule ligne pour justifier une telle chose ? Voici ce qu’elle dit : « Tu ne te feras point d’image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est dans les cieux en haut, et de ce qui est sur la terre en bas, et de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne t’inclineras point devant elles, et tu ne les serviras point » (Exode 20:4-5). Et l’apôtre Jean, à la fin de sa première épître, adresse aux chrétiens cette solennelle injonction : « Enfants, gardez-vous des idoles ». Chose frappante : dans l’ancienne Babylone, on adorait une mère déesse et son fils représenté dans des tableaux ou des statues, comme un petit enfant dans les bras de sa mère. C’est de là que le culte de la mère et de l’enfant se répandit partout, et est venu s’implanter dans l’Église catholique. Au Thibet et en Chine, les missionnaires jésuites furent surpris de trouver le pendant de la Madone romaine et de son enfant aussi dévotement adorés que dans la Rome papale. Shing Moo, la sainte mère, en Chine, était représentée avec un enfant dans ses bras et la tête entourée d’un nimbe ou auréole, absolument comme si c’eût été l’œuvre d’un artiste catholique romain. N’est-il pas profondément douloureux de voir que Satan, l’ennemi de Christ, a réussi à faire passer dans la chrétienté le culte rendu autrefois à Babylone à de fausses divinités ?
* * *
La place donnée à la Vierge Marie par l’Église romaine a amené d’autres erreurs d’une extrême gravité, car elles ne tendent à rien moins qu’à dépouiller le Seigneur d’une partie de ses glorieuses prérogatives. La parole de Dieu nous apprend qu’il n’y a qu’un « seul Médiateur entre Dieu et les hommes, l’homme Christ Jésus » (1 Timothée 2:5). Pour être ce Médiateur, le Fils éternel de Dieu est devenu un homme (Jean 1:14), et comme tel, il a été tenté comme nous en toutes choses, à part le péché (Hébreux 4:15 ; 2:18). Il a pris connaissance de nos douleurs, de nos langueurs, de nos peines, de nos infirmités, et y est entré dans un profond amour, une tendre compassion, une vraie sympathie ; un amour, une compassion, une sympathie divines en même temps qu’humaines (Matthieu 8:17). C’est ce que nous prouve toute sa vie sur la terre. Et maintenant qu’il est monté au ciel, il est le même ; son cœur n’a pas changé. Il sympathise avec nous dans nos infirmités ; il intercède sans cesse pour nous ; il est notre Avocat auprès du Père (Hébreux 4:15 ; 7:25 ; Romains 8:34 ; 1 Jean 2:1). Il nous invite à nous adresser nous-mêmes au Père, et le Père, en son nom, nous exauce (Jean 14: 13 ; 16:24, 26). Ainsi nous pouvons nous approcher de Dieu par Lui, entrer dans le sanctuaire même de Dieu, en vertu de son sacrifice, et venir directement avec confiance au trône de la grâce (Hébreux 7:25 ; 10:9 ; 4:16). Quel parfait et précieux Médiateur nous avons en Celui qui nous a aimés jusqu’à donner sa vie pour nous, qui nous aime et nous aimera toujours du même amour ! Quel besoin aurions-nous d’un autre, et qui saura mieux que Lui connaître tous nos besoins et pourra mieux y répondre ! Il est venu sur la terre pour cela. Il est notre salut, notre vie, notre paix.
Eh bien, l’Église romaine, dans son enseignement, n’a nullement tenu compte de ce que dit la parole de Dieu à cet égard. Non contente d’avoir donné à Marie la place que nous avons vue, elle en a fait une Médiatrice toute-puissante, et un Avocat dans le ciel ! Elle lui a assigné un titre et une fonction que l’Écriture n’attribue qu’à Christ. Elle a prétendu que Dieu était trop grand, et Jésus trop élevé, pour que nous approchions directement, soit du Père, soit du Fils, mais que Marie, par sa bonté, par sa douceur et sa tendresse, et à cause de l’amour que lui porte son Fils, est tout à fait propre à être Médiatrice et Avocat auprès de Lui. Le Fils, dit l’Église romaine, ne peut rien refuser à sa mère. Et elle oublie les paroles du Seigneur à Marie : « Qu’y a-t-il entre moi et toi, femme ? » (Jean 2:4). Un grand docteur de cette Église au 12° siècle, et qui sans nul doute a été un homme vraiment pieux, Saint Bernard, écrit : « Tu craignais de t’approcher du Père ; comme Adam, tu te cachais à sa voix ; il t’a donné Jésus pour Médiateur auprès de Lui. Mais peut-être es-tu effrayé de la majesté de ce Jésus, qui, bien qu’il se soit fait homme, est toujours Dieu. Il te faut auprès de Lui un avocat : recours à Marie ». Le pape Pie IX, en 1849, dans une encyclique (lettre circulaire adressée aux évêques), dit : « Vous savez bien, vénérables frères, que toute notre confiance est placée dans la très sainte Vierge, puisque Dieu a placé en Marie la plénitude de tout bien. S’il y a quelque espoir pour nous, quelque grâce, quelque salut, cela nous vient de Lui par elle ». N’est-il pas blasphématoire d’attribuer à une créature ce qui n’appartient qu’à Dieu et à son Fils ? (*)
(*) Plus encore, elle est maintenant expressément la co-rédemptrice : elle l’associe à l’œuvre du Rédempteur.
Écoutez encore ce qui est dit dans une des antiennes à la Vierge : « Salut, ô Reine, mère de miséricorde, douceur et espérance de notre vie, salut ! Nous crions à toi, nous fils d’Ève exilés, vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Toi, notre Avocat, tourne vers nous tes regards de miséricorde ». S’adresserait-on autrement à Dieu ou au Seigneur ? Sans aller plus loin, vous voyez dans quelle idolâtrie monstrueuse l’Église romaine entraîne ceux qui l’écoutent. Elle assimile la Vierge à la Sagesse éternelle de Proverbes 8, à l’Épouse du Cantique de Salomon. Elle lui dit : « Brisez les fers des coupables, donnez la lumière aux aveugles (*) … montrez que vous êtes notre mère ». Dans les litanies à la Vierge, elle la nomme « la porte du ciel », « le refuge des pécheurs », « l’étoile du matin » ; et que devient Christ, notre unique et précieux Sauveur, à qui seul l’Écriture attribue ces titres ? (**) Ces mêmes litanies s’adressent à la Vierge comme à la « Mère divine de la grâce », « la Mère du Créateur », « la source de notre joie », « l’arche de l’alliance », « la Reine de tous les saints », et en l’invoquant et demandant son intercession, elles l’associent au Père, au Fils, au Saint Esprit ! Croirait-on qu’un de leurs docteurs a été jusqu’à dire : « Toutes choses sont soumises à la Vierge, Dieu Lui-même », parce que, dit-il, « la mère a la prééminence sur le fils ». N’est-ce pas un blasphème horrible ? Combien sont à plaindre ceux que l’on conduit dans de telles voies ; on ne peut que désirer que Dieu les éclaire par sa parole, et que par elle, son Esprit les ramène et les garde dans la vérité, loin de ceux qui, « par de douces paroles et un beau langage, … séduisent les cœurs des simples » (Romains 16:18).
(*) Paroles analogues à celles que le Seigneur Jésus s’applique à Lui-même en Luc 4:19, où il dit : « L’Esprit du Seigneur est sur moi… Il m’a envoyé pour publier aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue ».
(**) Jean 10:9 ; Matthieu 11:28 ; Apocalypse 22:16.
Nous voyons la place prise par le culte de la Vierge dans l’Église romaine. C’est elle que l’on invoque, que l’on prie, à qui l’on s’attend, en qui l’on met toute confiance. Nous dirons encore quelques mots à ce sujet. Le Bréviaire est un livre de dévotion à l’usage des prêtres, qui, chaque jour, doivent en lire une partie, en public comme en particulier, quand l’heure en est venue. Il renferme des Psaumes pour les différentes heures du jour, des fragments des Écritures, des prières adaptées aux fêtes des saints, l’office de Marie, etc. Certainement il leur vaudrait mieux de lire journellement et uniquement toutes les Écritures inspirées de Dieu, propres pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, et rendre l’homme de Dieu accompli pour toute bonne œuvre ? (2 Timothée 3:16-17). C’est ce que faisait Timothée, qui n’avait pas besoin de Bréviaire, et ne savait rien du culte de Marie, qu’il eût sans doute rejeté avec horreur comme une idolâtrie des plus coupables.
Or, voici une des exhortations que renferme le Bréviaire : « Quand se lève la tempête des épreuves et que tu es jeté contre les rochers des afflictions, regarde en haut vers l’étoile, invoque Marie. Quand tu es ballotté çà et là, sur les vagues de l’orgueil, de l’ambition, de la passion et de l’envie, regarde vers l’étoile, invoque Marie. Quand la colère, ou la cupidité, ou les désirs de la chair, troublent ton âme, regarde vers Marie. Si tu es tourmenté en voyant la grandeur de tes péchés, et plein d’effroi à la pensée du jugement, si tu commences à t’enfoncer dans l’océan de la tristesse et l’abîme du doute, pense à Marie. Dans les dangers, les difficultés, les doutes, pense à Marie, invoque Marie ! » Que devient Christ, le divin et souverain Intercesseur, le grand Souverain sacrificateur de la vraie profession chrétienne, Celui qui sympathise à nos infirmités, qui nous appelle ses amis, qui est avec nous au milieu des tribulations que nous rencontrons dans le monde ? L’Église romaine le met pratiquement de côté et le remplace par une créature, bienheureuse et sans doute « bénie entre les femmes », mais dont la parole de Dieu ne parle que pour nous la montrer, sauvée par grâce, ignorante et faillible comme nous (*). Remarquons qu’après le premier chapitre des Actes, où elle est mentionnée comme se trouvant avec les disciples, Marie n’est plus jamais nommée dans la suite du Nouveau Testament. Il y a un seul Médiateur, Jésus, notre Avocat auprès du Père, notre Intercesseur tout puissant auprès de Dieu, et dont l’amour est immense et immuable. Il nous suffit. Dans les épreuves, les tentations, les difficultés et les dangers, c’est vers Lui, la vraie Étoile du matin, le vrai et seul refuge, qu’il faut regarder, Lui qu’il faut invoquer. Marie n’a rien fait pour nous, Lui a donné sa vie pour nous sauver.
(*) Qu’on lise les paroles de la Sainte Écriture : « Une femme éleva sa voix du milieu de la foule, et dit à Jésus : Bienheureux est le ventre qui t’a porté, et les mamelles que tu as tétées ! Et il dit : Mais plutôt, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent » (Luc 11:27-28). C’est ce que l’Église de Rome n’a point fait. Elle adore la Vierge et méconnait la parole de Dieu.
Une des formes superstitieuses qui se rattache au culte de Marie, est le Rosaire. On nomme ainsi un cordon terminé par une croix, et dans lequel sont enfilés des grains ou perles de deux différentes grosseurs. Il y a quinze dizaines des plus petits grains, et, devant chaque dizaine, se trouve un plus gros grain. Ces grains, que l’on fait passer entre les doigts, servent à compter le nombre de prières que l’on a récitées. Aux gros grains, on récite un Pater (la prière que le Seigneur enseigna à ses disciples), aux petits grains on récite un Ave Maria, qui est la salutation de l’ange à Marie. Les catholiques la rendent ainsi : « Je vous salue, Marie, pleine de grâces ; le Seigneur est avec vous ; vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni ». Si l’on compare ces paroles avec Luc 1:28 et 30, on voit tout de suite la différence entre la parole inspirée de Dieu et la version qu’en donne l’Église romaine. À cette première partie de l’Ave Maria, elle ajoute : « Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant, et à l’heure de la mort ». Or d’après l’Écriture, nous avons en Christ l’unique Sauveur des pécheurs ; en croyant en Lui nous possédons la vie éternelle, et ainsi nous sommes sauvés maintenant, et pour l’heure de notre mort, et pour l’éternité. Quelle différence entre la doctrine de Christ qui nous assure d’un salut parfait, actuel et éternel, et la doctrine de Rome qui laisse toujours dans le doute si l’on est sauvé. Elle veut que l’on ait recours à l’intercession d’une créature qui devait trouver grâce pour elle-même, et qui maintenant ne peut assurément rien pour nous, car, selon l’Écriture, Dieu ne lui a conféré aucune autorité, aucune puissance ! C’est le Seigneur Jésus à qui toute autorité a été donnée dans le ciel et sur la terre (Matthieu 28:18). C’est Lui qui tient les clefs de la mort et du hadès (*) (Apocalypse 1:18). C’est Lui qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul n’ouvrira (Apocalypse 3:7).
(*) Le hadès, c’est-à-dire le lieu où vont les âmes séparées du corps.
Le chapelet est un abrégé du Rosaire. Il ne contient que cinq dizaines d’Ave Maria séparées par un Pater. À quoi servent le Rosaire et le chapelet ? À compter le nombre de prières que l’on a récitées à la suite l’une de l’autre. Répéter ainsi, avec ou sans attention, 150 Ave et 15 Pater, ou 50 Ave et 5 Pater ; dire ou répéter plusieurs fois le Rosaire et le chapelet, constitue un acte méritoire aux yeux de Dieu, selon l’Église romaine. Le prêtre l’impose comme pénitence, pour expier des fautes. On récite le Rosaire ou le chapelet, pour abréger la durée des peines du purgatoire pour soi ou pour les autres. Nous ne trouvons rien de semblable dans l’Écriture ; ce sont des pratiques superstitieuses inventées par les hommes. Que dit le Seigneur ? « Quand vous priez, n’usez pas de vaines redites, comme ceux des nations, car ils s’imaginent qu’ils seront exaucés en parlant beaucoup. Ne leur ressemblez donc pas » (Matthieu 6:7-8). « Comme ceux des nations », dit Jésus. Cela ne rappelle-t-il pas les prêtres de Baal, qui, depuis le matin jusqu’à midi, répétaient « Ô Baal, réponds-nous ! » (1 Rois 18:26). Et l’on sait que de nos jours, les Bouddhistes ont eux aussi leurs chapelets et même leurs moulins à prières ! Les prêtres romains imposent ces répétitions de prières pour expier des fautes, et la parole de Dieu nous dit simplement : « Si nous confessons nos péchés, il (Dieu) est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité » (1 Jean 1:9). Et là il n’est question d’aucun rosaire, ni de répéter des prières. Nous venons à Dieu, nous Lui confessons (et non au prêtre) humblement nos péchés, et en vertu de l’œuvre parfaite de Christ, Dieu nous pardonne, et nous purifie. Quelle grâce précieuse !
Le Rosaire, comme nous le voyons, est consacré à la Vierge. L’Église romaine a institué une fête du très Saint Rosaire, comme elle dit, et c’est toujours la Vierge qui y est glorifiée. Dans le service de cette fête, voici ce que nous lisons : « Réjouissons-nous tous dans le Seigneur, nous qui célébrons ce jour de fête en l’honneur de la bienheureuse Vierge Marie », et ensuite : « Ô Dieu ! faites, nous vous en prions, qu’honorant dans ces mystères le Saint Rosaire de la bienheureuse Vierge Marie, nous imitions ce qu’ils renferment, et nous obtenions ce qu’ils promettent ». Honorer un chapelet de grains, y voir des mystères à imiter (et quels sont ces mystères !), associer les noms de Dieu et du Seigneur à l’idolâtrie envers une créature, n’est-ce pas une profanation ?
Il est bon de savoir ce qu’enseigne cette église dite apostolique qui prétend être la seule vraie, afin d’être en garde contre ses séductions. « Enfants, gardez-vous des idoles », disait l’apôtre Jean en terminant sa première épître (1 Jean 5:21). Déjà le mal commençait ; l’Église se détournait de Jésus Christ, le Dieu véritable et la vie éternelle (1 Jean 5:20), et l’Esprit Saint avertissait solennellement les chrétiens à l’égard de ce qui allait s’introduire dans l’Église et corrompre la vérité.
 Re: L’ÉGLISE : UNE ESQUISSE DE SON HISTOIRE PENDANT VINGT SIÈCLES
Re: L’ÉGLISE : UNE ESQUISSE DE SON HISTOIRE PENDANT VINGT SIÈCLES
6.3.6 - L’Invocation des saints
L’Église romaine ne s’est pas contentée d’établir Marie comme Reine du ciel, des anges, des patriarches, des prophètes et des saints, comme Avocat et Médiatrice souveraine auprès du Père et du Fils, elle a rempli le ciel d’une foule d’autres médiateurs. Ce sont des hommes qu’elle nomme les saints, qu’elle invoque et qu’elle prie, afin qu’ils intercèdent auprès de Dieu pour les hommes ; et elle a fait des anges mêmes, et particulièrement de l’archange Michel, des intercesseurs et des objets de culte.
L’invocation des saints a son origine dans la vénération dont, au commencement, on entourait la mémoire de ceux qui avaient rendu un fidèle témoignage pour Christ et qui avaient souffert pour son nom. Mais à mesure que l’ignorance des Écritures et des vérités qu’elles renferment, s’accentuait, et que la superstition prenait le dessus, de la vénération on passa à l’idée que ces saints qui, sur la terre, avaient eu par leurs prières une grande puissance auprès de Dieu (*), devaient l’avoir conservée après leur mort. On en fit donc des intercesseurs dans le ciel. On pensa qu’ayant été des êtres humains comme nous sur la terre, ils comprendraient mieux nos luttes, nos combats et nos peines, que l’on éprouverait moins de craintes et plus de hardiesse à s’approcher d’eux, et que d’ailleurs, à cause de leurs mérites, le Seigneur se laisserait plus aisément fléchir par eux.
(*) Cela est vrai ; la prière fervente du juste peut beaucoup ; mais c’est sur la terre (Jacques 5:15).
À la tête de ces saints se trouvent naturellement les apôtres, spécialement Pierre et Paul, mais surtout Pierre, que l’Église romaine considère comme le premier pape ; puis Jean Baptiste comme précurseur du Seigneur. Dans l’office de la fête de Jean Baptiste, l’Église romaine applique à ce saint les paroles d’Ésaïe qui annonce la venue du Sauveur (Ésaïe 49:1-6) (*), tordant ainsi les Écritures. Ensuite vient Joseph, l’époux de Marie, que l’on vénère comme le patron de l’église universelle, et auquel on applique les bénédictions appelées par le patriarche Jacob sur la tête de son fils Joseph (Genèse 49:22 26) (**), jouant ainsi sur la similitude des noms et induisant les âmes doublement en erreur. Après ceux-là viennent les martyrs, les Pères, les ermites comme saint Antoine par exemple, et ensuite une multitude de saints que nomment des légendes plus ou moins authentiques, quelques-uns n’ayant peut être jamais existé. Ces légendes sont remplies de soi-disant miracles opérés par les saints dont elles parlent. À cela, il faut ajouter les hommes et les femmes d’une époque plus récente, qui, ayant mené une vie pieuse et opéré, affirme-t-on, des miracles, ont été d’abord béatifiés, puis canonisés, c’est-à-dire déclarés saints par le pape, et placés dans le ciel comme des intercesseurs auxquels on peut s’adresser et que l’on peut prendre pour patrons.
(*) « Le Seigneur m’a appelé avant ma naissance ; il s’est souvenu de mon nom lorsque j’étais encore dans le sein de ma mère, etc ». Je cite d’après la version catholique.
(**) Entre autres celles-ci : « Ceux qui portaient des dards l’ont irrité, l’ont insulté, lui ont porté envie… Le Tout puissant te comblera de bénédictions… que ces bénédictions se répandent sur la tête de Joseph ». Sur la façade d’églises catholiques dédiées à saint Joseph, on lit : « Allez à Joseph », paroles que le Pharaon adressait aux Égyptiens, et que l’on détourne de leur vrai sens pour les appliquer à l’époux de Marie.
De bonne heure on plaça des édifices religieux, églises et chapelles, sous l’invocation de tel ou tel saint. On prétendit que des reliques de celui dont l’édifice portait le nom, se trouvaient là, souvent que son corps était sous le maître-autel, et que des miracles s’y opéraient, et cela amenait, dans ces lieux vénérés, une multitude de pèlerins qui s’y rendaient, soit pour être guéris, soit pour obtenir de l’intercession du saint quelque bénédiction, soit pour acquérir, en vertu de ces pèlerinages fatigants et coûteux, des mérites auprès de Dieu. Nécessairement ces pèlerinages étaient pour ceux qui desservaient les lieux de culte et pour les habitants des endroits où ils se trouvaient, une source de gains d’autant plus considérable que la réputation du saint était grande et les pèlerinages plus nombreux. De là des trafics honteux, et une rivalité entre les lieux de pèlerinage, une sorte de concurrence à qui aurait le plus de pèlerins. Ne croyons pas que, dans nos temps plus éclairés, ces superstitions aient cessé. Qui ne connaît les pèlerinages à Lourdes, provoqués par de prétendues apparitions de la Vierge à une jeune fille en 1858 ; à Einsiedeln, en Suisse, où l’on affirme avoir une image miraculeuse de la Vierge ; à Notre Dame de Lorette, en Italie, où l’on montre la maison de la Vierge et la chambre qu’elle occupait quand l’ange vint lui annoncer la naissance du Sauveur, le tout transporté par les anges à Lorette, petite ville des environs d’Ancône (*) ; à Saint-Jacques de Compostelle, en Espagne, le plus célèbre des lieux de pèlerinage après Rome et Jérusalem : on prétend que l’apôtre Jacques y fut enterré ! Que de choses l’ennemi du Seigneur et des âmes a mises au cœur des hommes pour les détourner de Christ, de son œuvre, et du culte en esprit et en vérité !
(*) Plus récemment, la Vierge, dite du Rosaire, serait apparue à de jeunes enfants à Fatima (Portugal), en 1917, d’où un autre pèlerinage de grand renom !
Les saints ne sont pas seulement des intercesseurs généraux, pour ainsi dire. Bien que chacun puisse s’adresser à eux, chaque bourg, chaque ville, chaque contrée, chaque royaume a son patron spécial, là où domine l’Église romaine. Bien plus, tout vrai catholique veut avoir pour patron le saint dont il porte le nom et l’on choisit souvent pour un des prénoms, celui dont la fête tombe sur le jour de naissance de la personne.
Les saints sont en si grand nombre qu’afin de n’en oublier aucun et afin d’obtenir de tous, connus ou inconnus, la faveur de leur intercession, l’Église romaine a institué une fête de tous les saints (le 1er novembre).
Au culte rendu aux saints, il faut ajouter l’invocation des anges. Les litanies des saints disent entre autres : saint Michel, saint Gabriel, saint Raphaël, saints anges et archanges, priez pour nous. De plus chaque personne (*) a son « bon ange », au dire de l’Église romaine. Ainsi, dans une prière que les fidèles sont invités à répéter, il est dit : « Ange du ciel, mon fidèle et véritable guide, obtenez-moi d’être si fidèle à vos instructions et de régler si bien tous mes pas, que je ne m’écarte en rien des commandements de mon Dieu ». Et quant au saint patron, voici la prière qu’on lui adresse : « Grand saint dont j’ai l’honneur de porter le nom, protégez-moi, priez pour moi, afin que je puisse servir Dieu comme vous sur la terre, et le glorifier éternellement avec vous dans le ciel ». La confession des péchés ne s’adresse pas à Dieu seulement, mais « à la bienheureuse Marie toujours Vierge, à saint Michel archange, à saint Jean Baptiste, aux apôtres saint Pierre et saint Paul, et à tous les saints », et on les supplie d’intercéder auprès du Seigneur Dieu pour le pardon des péchés.
(*) Les théologiens catholiques enseignent également qu’il y a un ange gardien non seulement pour tout individu, juste ou pécheur, mais encore pour chaque nation, chaque ville, chaque diocèse, chaque communauté. Saint Michel est l’ange gardien de toute l’Église, mais chaque église a aussi son ange gardien spécial.
Nous ne trouvons dans l’Écriture sainte aucun passage qui justifie ce culte rendu à des créatures. Le Seigneur nous dit bien, pour montrer l’intérêt que le Père prend aux petits enfants et les soins qu’il a pour eux, que leurs anges voient sans cesse sa face dans les cieux (Matthieu 18:10). Mais cela signifie-t-il qu’il faut invoquer ces anges ? Nullement. Les anges sont « des esprits administrateurs, envoyés pour servir en faveur de ceux qui vont hériter du salut » (Hébreux 1:14). Cela veut-il dire que nous devions nous adresser à eux ? Pas du tout ; au contraire, l’apôtre Paul dit, en parlant de certains docteurs, qui, déjà de son temps, induisaient les fidèles en erreur : « Que personne ne vous frustre du prix du combat, faisant sa volonté propre dans l’humilité et dans le culte des anges, s’ingérant dans les choses qu’il n’a pas vues » (Colossiens 2:18). C’était une fausse humilité qui prétendait n’oser pas s’approcher de Dieu, et s’adressait aux anges. Mais l’apôtre dit au contraire à ces hommes qu’ils sont enflés d’un vain orgueil et suivent leurs propres pensées, et qu’ils ne tiennent pas ferme le Chef, c’est-à-dire Christ (Colossiens 2:19). Nous avons tout en Christ, Christ suffit pleinement. Il nous a sauvés, par Lui nous nous approchons de Dieu ; nous n’avons besoin d’aucun autre. La Vierge Marie et les saints, les vrais saints qui sont délogés, sont dans le repos près de Lui, en attendant la résurrection. Ils n’ont et ne peuvent avoir cette toute-connaissance qui serait nécessaire pour entendre tous ceux qui les invoquent, et qui n’appartient qu’à Dieu, et par conséquent ils n’entendent aucune prière. Celles qu’on leur adresse ne sont qu’un vain son. Les anges sont occupés de leur service, comme nous le voyons dans l’Apocalypse, et quand Jean se prosterne et veut adorer l’ange qui lui avait montré les merveilleuses choses de Dieu, l’ange repousse cet hommage et lui dit : « Garde-toi de le faire ; je suis ton compagnon d’esclavage … rends hommage à Dieu » (Apocalypse 19:10 ; 22:8-9).
Et s’il s’agit des saints, rappelons-nous que, quand Corneille vient recevoir Pierre, et qu’il se jette à ses pieds pour lui rendre hommage, l’apôtre le relève en lui disant : « Lève-toi ; et moi aussi je suis un homme » (Actes 10:25-26). Cela ne suffit-il pas pour juger et condamner l’invocation des saints et des anges ? Assurément. À Dieu seul, et au Seigneur Jésus Christ, appartiennent la gloire, et l’honneur, et la force, et toute adoration.
6.3.7 - Les reliques et le culte des images
6.3.7.1 - Les reliques
Deux choses contraires à l’Écriture caractérisent encore l’Église de Rome. C’est d’abord le culte des reliques des saints, de la Vierge et même du Seigneur, et ensuite le culte des images.
Les reliques sont de prétendus restes, des ossements ou parties du corps de ceux que l’on révère, ou bien des objets qui leur ont appartenu ou qu’ils ont touchés. C’est vers le troisième siècle que l’on commença à entourer les restes des martyrs d’une vénération superstitieuse. Malgré l’opposition de quelques hommes pieux, le mal s’étendit rapidement. Vraies ou fausses, les reliques se multiplièrent. On leur attribua un pouvoir miraculeux, une vertu divine permanente. On prétendit que par elles les malades étaient guéris, les démons chassés, les morts ressuscités. Elles préservaient des dangers, faisaient gagner des batailles, et c’est sur elles que l’on prêtait les serments les plus inviolables. Pour affirmer leur puissance merveilleuse, on racontait toute espèce d’histoires souvent absurdes, en tout cas mensongères, et elles devinrent souvent l’objet d’un trafic scandaleux. Chaque église, chaque chapelle, chaque monastère, tenait à avoir ses reliques d’autant plus précieuses et renommées que de plus grands soi-disant miracles s’opéraient par elles. Les endroits où se trouvaient les plus célèbres reliques devenaient des buts de pèlerinage. Et les choses sont restées telles dans notre temps qu’on appelle un siècle de lumière. Rome présente à ses dévots pour être adorés, des objets dont l’origine est plus que douteuse — idolâtrie honteuse, reposant sur des fables, et qui ressemble à celle des prêtres de Bouddha qui eux aussi prétendent avoir des reliques de leur saint.
Je ne puis pas énumérer toutes les reliques que Rome vénère, ni les endroits où elles se trouvent. Ajouté aux légendes qui s’y rapportent, cela ferait un gros volume. Je citerai seulement trois des plus célèbres. La première est la sainte croix, celle sur laquelle le Sauveur a souffert. On prétend que l’impératrice Hélène, mère de l’empereur Constantin, voulant faire construire une église sur l’emplacement du sépulcre de Jésus, les ouvriers, en creusant la terre, découvrirent les trois croix où le Seigneur et les deux brigands avaient été attachés. Un miracle, dit-on, fit découvrir laquelle était celle de Jésus. La plus grande partie de la croix fut conservée à l’église du saint-sépulcre à Jérusalem, où, à ce que l’on dit, elle est encore, recouverte d’argent. Le reste fut coupé en morceaux et distribué comme reliques. Nombre d’endroits, églises ou autres, prétendent posséder un fragment de la vraie croix, mais si on les rassemblait, on en aurait la charge de dix hommes. Peuvent-ils être tous vrais, si même il y en a un seul qui le soit, car l’histoire de la découverte de la croix ne repose que sur des légendes ? Et alors, à quoi rend-on culte ? À des morceaux de bois, comme les païens à leurs fétiches. N’est-ce pas attristant de voir les âmes abusées par de telles choses au sein d’une église qui se dit chrétienne ? Dieu peut-il par là être honoré, et le Seigneur glorifié ?
Une autre relique célèbre est la tunique sans couture que portait le Seigneur. On l’appelle la sainte robe, et l’on raconte à son sujet les fables les plus absurdes. Elle ne fut découverte que dans le 12° siècle et donnée à l’archevêque de Trêves, ville où on la montre encore. Mais on prétend l’avoir aussi à Argenteuil en France, et au Latran à Rome, sans compter des morceaux que l’on en possède, dit-on, en divers endroits. Où est la vraie ? Ou plutôt, n’est-ce pas tout fausseté ? Et c’est ce que l’on fait adorer par de pauvres gens abusés. N’y a-t-il pas là un système de mensonges inventé par Satan pour égarer les âmes et les détourner de Christ sous une apparence de dévotion ? Les Bouddhistes ont aussi comme relique le vêtement de Bouddha renfermé dans une châsse. Et ce n’est pas la seule ressemblance que présente Rome papale avec le culte de Bouddha.
La troisième relique non moins fabuleuse, mais hautement vénérée, est le saint suaire. Une légende du Moyen Âge raconte qu’une femme de Jérusalem présenta à Jésus, lorsqu’on le conduisait au Calvaire, un mouchoir pour essuyer la sueur et le sang de son visage. Lorsque le Seigneur le lui rendit, sa face s’était imprimée sur le linge. Une autre légende rapporte la chose d’une manière toute différente. Ce serait le Seigneur lui-même qui aurait imprimé son visage sur un linge et l’aurait envoyé au roi Abgare qui désirait son portrait ! Ici encore on voit l’absurdité et la fausseté de la légende. Quoi qu’il en soit, ce que l’on nomme le saint suaire se trouve, chose étrange, à Saint-Pierre de Rome, à Turin, en Espagne, et en d’autres endroits. Où est le véritable, à supposer qu’il y en ait un seul ? Le saint suaire, un morceau de la vraie croix et la moitié de la lance qui perça le côté du Seigneur, sont les trois grandes reliques devant lesquelles, dans la semaine sainte, le pape et les cardinaux vont se prosterner solennellement, donnant ainsi l’exemple de l’idolâtrie au peuple qui se prosterne avec eux devant ces objets inanimés. Où trouvons-nous dans l’Écriture quoi que ce soit qui autorise un semblable culte ? Nulle part. Au contraire, tout culte rendu à un objet quelconque, de quelque manière que ce soit, y est formellement condamné. L’Écriture nous enseigne à adorer par l’Esprit Saint le Dieu vivant et vrai, le Père et le Fils dans le ciel, et à mettre notre confiance en Lui. Quant aux miracles opérés par les reliques, ce sont des mensonges ou des supercheries, ou, s’ils sont réels, ils sont dus à la puissance satanique. L’homme de péché qui doit venir, viendra « selon l’opération de Satan », avec « toute sorte de miracles et signes et prodiges, de mensonges ». Et le mystère d’iniquité opère déjà (*).
(*) 2 Thessaloniciens 2:9, 7.
6.3.7.2 - Les images
À côté du culte des reliques se place celui qui est rendu aux images. Nous le trouvons dans l’Église grecque comme dans l’Église romaine, avec cette différence que la première n’admet que les images peintes. Ce sont les icônes devant lesquelles, dans les chaumières, les maisons, les lieux publics, et dans les églises, brûlent des cierges et se prosterne le peuple.
L’Église romaine va plus loin. Les édifices consacrés à son culte sont remplis, non seulement de peintures, mais aussi de statues de la Vierge parées de riches vêtements, ainsi que l’enfant qu’elle porte, et de statues des saints et des anges. On y voit des crucifix, figures du Seigneur sur la croix ; on va même jusqu’à représenter dans des tableaux, sous une forme humaine, le Dieu invisible, le Père. Ces images se trouvent aussi dans les maisons des dévots catholiques et y sont vénérées ; dans les villes autrefois, il y en avait en quantité dans les rues, et l’on en trouve encore des vestiges. L’apôtre Paul ne serait-il pas indigné, plus encore qu’à Athènes, en voyant la chrétienté remplie d’idoles ? (Actes 17:16). Et n’est-il pas à regretter, pour le dire en passant, que des chrétiens qui condamnent l’idolâtrie romaine, ne soient pas plus soigneux d’en écarter toute trace sur eux et dans leurs maisons ?
C’est dans les églises surtout que s’étale le culte rendu aux images. Il n’en est guère qui n’ait une chapelle dédiée à la Vierge ; d’autres ont en outre des chapelles consacrées à tel ou tel saint. Là, indépendamment du maître-autel avec ses nombreux cierges et ses riches ornements, se trouvent, dans chaque chapelle, un autel pour dire la messe, des cierges, des tableaux et d’autres images, et devant ces images, on brûle de l’encens, et prêtres et laïques se prosternent, adorent et prient. Si mes lecteurs ont l’occasion de voir une représentation de l’intérieur d’un temple bouddhiste, ils seront frappés de la ressemblance qu’il présente avec une Église romaine. Ne peut-on pas dire, que ces lieux où l’on prétend servir le Dieu unique, sont de vrais temples d’idoles ? Idolâtrie d’autant plus affreuse que l’on fait de Christ une image taillée que l’on baise et que l’on adore, et que les autres images auxquelles on rend un culte, sont celles de Pierre, de Paul, et d’autres qui furent de fidèles serviteurs de Dieu à qui toute idolâtrie était en horreur ; et surtout idolâtrie condamnable au plus haut degré en ce qu’on se prosterne devant des représentations de Celui qui a dit : « Tu ne te feras point d’image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est dans les cieux en haut, ni de ce qui est sur la terre en bas, ni de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point » (*). On tombe ainsi dans le même péché qu’Israël quand il fit le veau d’or. L’Église romaine allègue qu’on n’adore pas les images, mais qu’en leur rendant un culte « relatif », on vénère ceux qu’elles représentent. C’est un subterfuge ; le passage que nous venons de lire est formel, et d’ailleurs le fait certain est que la masse des fidèles adore réellement l’image. Ajoutons à ce qui précède qu’un pouvoir miraculeux est attaché à certaines images, et que les b..... — en particulier b..... le crucifix — est considéré comme un acte méritoire. Nous l’avons vu en parlant de l’extrême-onction.
(*) Exode 20:4-5.
Le culte des images commença de bonne heure en Orient et se répandit ensuite en Occident. Ce ne fut pas sans opposition. En Orient, des empereurs voulurent l’extirper par la force. Il en résulta des luttes sanglantes, car le peuple défendait avec acharnement ces images si chères, auxquelles il attribuait des miracles. En effet, souvent en Occident, comme en Orient, dans des calamités ou des dangers publics, on portait, dans une procession solennelle, telle ou telle image pour obtenir la délivrance. Si l’ennemi s’éloignait des murs d’une ville assiégée, si une maladie contagieuse venait à cesser, c’était grâce à la vertu de l’image.
Après les luttes dont j’ai parlé, un concile fut convoqué à Nicée, en l’an 787. Il décréta que des images du Sauveur, de la Vierge, des anges, et des saints, en peinture ou en mosaïque, seraient placées dans les églises pour être baisées (*) et révérées en se prosternant devant elles, distinguant toutefois cette adoration de celle qui n’appartient qu’à la nature divine. « On doit, dit le concile, leur offrir de l’encens et des cierges, car l’honneur rendu à l’image passe à celui qu’elle représente ». Ensuite on déclara anathème celui qui ne révérerait pas les images et qui dirait qu’elles sont des idoles.
(*) Les adorateurs de Baal baisaient son image (1 Rois 19:18. Voyez aussi Osée 13:2).
L’Église romaine, comme l’Église grecque, reçut les décrets de ce concile. Plus tard, le concile de Trente, dans le 16° siècle, statua : « On doit avoir et conserver, principalement dans les églises, les images de Jésus Christ, de la Vierge, mère de Dieu, et des autres saints, et leur rendre l’honneur et la vénération qui leur sont dus, parce que cet honneur est rapporté aux originaux qu’elles représentent ».
Telle a été la ruse de Satan pour entraîner les âmes dans l’idolâtrie, malgré la parole de Dieu qui la proscrit formellement. « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange à des images taillées », dit l’Éternel (*). Et quand nous voyons ces statues devant lesquelles on se prosterne, qu’elles soient de pierre ou de bois, comment ne pas nous rappeler les paroles si fortes d’Ésaïe : « Qui a formé un dieu, ou fondu une image, qui n’est d’aucun profit ? »… Un homme prend un bois : d’une partie il fait du feu et s’en chauffe et fait cuire du pain ; et de l’autre il en fait un dieu, une image taillée, et se prosterne devant elle. Et le prophète ajoute : « Il se repaît de cendres ; un cœur abusé l’a détourné ; et il ne délivre pas son âme, et ne dit pas : N’ai-je pas un mensonge dans ma main droite ? » (**). Combien ces paroles sont applicables à ces nombreux pauvres abusés qui se prosternent devant les peintures et les statues de bois ou de pierre, et leur adressent leurs prières !
(*) Ésaïe 42:8.
(**) Ésaïe 44:10-20.
6.3.8 - Le Purgatoire
Une autre doctrine du catholicisme est le purgatoire. Qu’est-ce que le purgatoire ? C’est un lieu, dit l’Église romaine, où ceux qui sont morts en état de grâce, c’est-à-dire non coupables de péché mortel (*), sont purifiés par des châtiments et des souffrances temporaires, des fautes qui n’ont pas été suffisamment expiées ici-bas. Ces souffrances peuvent être allégées et leur temps abrégé, par les prières et les aumônes des parents et des amis du défunt, et surtout par des messes dites à son intention.
(*) L’Église romaine enseigne qu’il y a deux sortes de péchés : les péchés mortels qui font perdre la grâce de la justification, et les péchés véniels (de venia, pardon) qui ne font pas perdre la grâce. Si quelqu’un meurt en état de péché mortel, il va en enfer. Mais quelqu’un qui s’est rendu coupable d’un tel péché peut être pardonné et justifié par le sacrement de pénitence.
Bien que saint Augustin, à l’occasion de la mort de sa mère Monique, mentionne déjà les prières pour les morts, ce n’est qu’en l’an 600 que la doctrine du purgatoire fut reçue parmi les dogmes de l’Église de Rome et que le pape Grégoire le Grand la formula en ces termes : « Nous devons croire qu’il y a un feu qui purifie des petites fautes avant que le jour du jugement arrive ». Le célèbre concile de Trente a défini complètement cette doctrine et prononcé l’anathème sur ceux qui la nient. Voici ce qu’il dit : « Il y a un purgatoire, et les âmes qui y sont retenues prisonnières, sont secourues par les prières des croyants, mais surtout par le sacrifice acceptable de la messe ». Le concile ordonne à tous les évêques, de « s’appliquer avec zèle à ce que la sainte doctrine du purgatoire qui nous a été transmise par les vénérables pères de l’Église et par les saints conciles, soit crue, gardée, enseignée et prêchée partout parmi les fidèles de Christ… Les âmes des justes sont purifiées dans les flammes du purgatoire par un châtiment temporaire, afin que de cette manière leur soit accordée l’entrée dans leur patrie éternelle, où rien d’impur ne peut être admis… Le sacrifice de la messe est offert pour ceux qui se sont endormis en Christ, mais qui ne sont pas entièrement purifiés ».
Telle est la doctrine romaine du purgatoire. Elle n’a, pour s’appuyer, aucun passage de la parole de Dieu (*), et, de l’aveu même du concile, ne repose que sur l’autorité des pères et des conciles. Nous allons voir qu’elle est contraire aux enseignements de l’Écriture, et au témoignage qu’elle rend à l’amour de Dieu et à l’œuvre de Christ pour la justification du pécheur et le pardon des péchés.
(*) La seule référence faite par l’Église romaine est celle d’un livre apocryphe (2 Macchabées), c’est-à-dire ne figurant pas dans la Bible hébraïque.
Où se trouve le purgatoire, et quel genre de souffrances les âmes y endurent-elles ? Les docteurs romains ne le disent pas, et le concile de Trente interdit sur ce point les questions curieuses. Mais il parle du « feu du purgatoire », et l’Église romaine, pour apitoyer les vivants sur le sort des âmes qui s’y trouvent, tolère qu’on le représente dans des tableaux comme un lieu où les âmes sont horriblement tourmentées dans un feu ardent. Et jusqu’à quand les âmes restent-elles dans ce lieu de souffrances ? Jusqu’à ce qu’elles aient « payé le dernier quadrant » (Matthieu 5:26), disent les docteurs romains, car c’est ainsi qu’ils appliquent à faux ce texte. Ils veulent dire par là que les âmes subissent les peines du purgatoire jusqu’à ce qu’elles aient été entièrement purifiées et que la justice de Dieu ait été satisfaite. L’Église romaine dit bien que l’intensité des souffrances peut être adoucie et leur durée abrégée par certaines œuvres accomplies en leur faveur, mais est-on jamais sûr que le dernier quadrant est payé et que l’âme sort enfin du purgatoire pour entrer au ciel ? Non, jamais. Et ainsi les pauvres catholiques romains sont laissés dans une continuelle incertitude quant au sort de leurs parents ou amis décédés, quand bien même ceux-ci ont reçu l’extrême-onction (qui selon Rome, doit effacer les dernières traces de péché), et qu’eux ont prié et fait dire des messes. Et ceux qui croient cet enseignement, ne peuvent qu’être dans une erreur constante en pensant à la mort qui va les jeter dans les souffrances du purgatoire, malgré leur foi et leurs œuvres, et cela durant un temps indéterminé.
Mais Dieu soit béni, le purgatoire n’est qu’une invention de l’esprit humain et par conséquent un mensonge. Tout l’enseignement de l’Écriture est opposé à cette doctrine.
D’abord nous n’y voyons nulle part qu’il y ait à distinguer entre les péchés mortels et les péchés véniels. Tout péché est mortel, car la parole de Dieu dit : « Les gages du péché, c’est la mort » (Romains 6:23), et après la mort, le jugement (Hébreux 9:27). Mais il est ajouté : « Le don de grâce de Dieu, c’est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur ». Et Jésus nous dit : « Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle » (Jean 3:16).
Et ce n’est pas après la mort seulement que nous aurons la vie éternelle ; nous l’avons dès ici-bas lorsque nous croyons de cœur au Seigneur Jésus, car il est écrit : « Qui croit au Fils a (et non aura) la vie éternelle » (Jean 3:36). Nous lisons encore : « En ceci a été manifesté l’amour de Dieu pour nous, c’est que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui… Dieu… nous aima et… envoya son Fils pour être la propitiation pour nos péchés » (1 Jean 4:9-10). Puis : « Voyez de quel amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu… Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu » (1 Jean 3:1-2). En croyant au Seigneur Jésus, nous avons déjà maintenant la vie éternelle et sommes de bien-aimés enfants de Dieu ; Dieu veut-il mettre son enfant, pour qui il a donné son Fils, et qui possède la vie éternelle, dans une horrible prison et d’affreuses souffrances jusqu’à ce qu’il ait payé le dernier quadrant ? Est-ce là le grand amour dont il nous a aimés ? (Éphésiens 2:4).
Il est vrai que si l’enfant de Dieu vient à manquer, Dieu le discipline ici-bas, pour son profit, afin de le rendre participant de sa sainteté (Hébreux 12:7-10), et cette discipline peut aller jusqu’à la mort du corps (1 Jean 5:16 ; 1 Corinthiens 11:30). Dieu permet aussi que nous soyons éprouvés de différentes manières, afin de nous purifier des choses qui ne conviennent pas à notre caractère de chrétiens (1 Pierre 1:6-7). Mais nous ne voyons nulle part dans l’Écriture qu’après cette vie, le croyant ait encore à souffrir pour satisfaire Dieu qui a été pleinement satisfait par le sacrifice de Christ. S’il déloge, c’est pour être avec Christ (Philippiens 1:23) et non dans le purgatoire. Absent du corps, il est avec le Seigneur (2 Corinthiens 5:8). L’Écriture nous dit aussi que les croyants ont à rendre grâces « au Père qui nous a rendus capables de participer au lot des saints dans la lumière » et qui nous a introduits « dans le royaume du Fils de son amour », et cela dès ici-bas (Colossiens 1:12-14). Le croyant cesse-t-il de jouir de ces heureux privilèges quand il a quitté cette vie ? Le lot des saints dans la lumière peut-il jamais être un lieu de tourments, et le purgatoire et ses souffrances fait-il partie du royaume du Fils de l’amour divin ? Non.
L’Église romaine ne s’est pas contentée d’établir Marie comme Reine du ciel, des anges, des patriarches, des prophètes et des saints, comme Avocat et Médiatrice souveraine auprès du Père et du Fils, elle a rempli le ciel d’une foule d’autres médiateurs. Ce sont des hommes qu’elle nomme les saints, qu’elle invoque et qu’elle prie, afin qu’ils intercèdent auprès de Dieu pour les hommes ; et elle a fait des anges mêmes, et particulièrement de l’archange Michel, des intercesseurs et des objets de culte.
L’invocation des saints a son origine dans la vénération dont, au commencement, on entourait la mémoire de ceux qui avaient rendu un fidèle témoignage pour Christ et qui avaient souffert pour son nom. Mais à mesure que l’ignorance des Écritures et des vérités qu’elles renferment, s’accentuait, et que la superstition prenait le dessus, de la vénération on passa à l’idée que ces saints qui, sur la terre, avaient eu par leurs prières une grande puissance auprès de Dieu (*), devaient l’avoir conservée après leur mort. On en fit donc des intercesseurs dans le ciel. On pensa qu’ayant été des êtres humains comme nous sur la terre, ils comprendraient mieux nos luttes, nos combats et nos peines, que l’on éprouverait moins de craintes et plus de hardiesse à s’approcher d’eux, et que d’ailleurs, à cause de leurs mérites, le Seigneur se laisserait plus aisément fléchir par eux.
(*) Cela est vrai ; la prière fervente du juste peut beaucoup ; mais c’est sur la terre (Jacques 5:15).
À la tête de ces saints se trouvent naturellement les apôtres, spécialement Pierre et Paul, mais surtout Pierre, que l’Église romaine considère comme le premier pape ; puis Jean Baptiste comme précurseur du Seigneur. Dans l’office de la fête de Jean Baptiste, l’Église romaine applique à ce saint les paroles d’Ésaïe qui annonce la venue du Sauveur (Ésaïe 49:1-6) (*), tordant ainsi les Écritures. Ensuite vient Joseph, l’époux de Marie, que l’on vénère comme le patron de l’église universelle, et auquel on applique les bénédictions appelées par le patriarche Jacob sur la tête de son fils Joseph (Genèse 49:22 26) (**), jouant ainsi sur la similitude des noms et induisant les âmes doublement en erreur. Après ceux-là viennent les martyrs, les Pères, les ermites comme saint Antoine par exemple, et ensuite une multitude de saints que nomment des légendes plus ou moins authentiques, quelques-uns n’ayant peut être jamais existé. Ces légendes sont remplies de soi-disant miracles opérés par les saints dont elles parlent. À cela, il faut ajouter les hommes et les femmes d’une époque plus récente, qui, ayant mené une vie pieuse et opéré, affirme-t-on, des miracles, ont été d’abord béatifiés, puis canonisés, c’est-à-dire déclarés saints par le pape, et placés dans le ciel comme des intercesseurs auxquels on peut s’adresser et que l’on peut prendre pour patrons.
(*) « Le Seigneur m’a appelé avant ma naissance ; il s’est souvenu de mon nom lorsque j’étais encore dans le sein de ma mère, etc ». Je cite d’après la version catholique.
(**) Entre autres celles-ci : « Ceux qui portaient des dards l’ont irrité, l’ont insulté, lui ont porté envie… Le Tout puissant te comblera de bénédictions… que ces bénédictions se répandent sur la tête de Joseph ». Sur la façade d’églises catholiques dédiées à saint Joseph, on lit : « Allez à Joseph », paroles que le Pharaon adressait aux Égyptiens, et que l’on détourne de leur vrai sens pour les appliquer à l’époux de Marie.
De bonne heure on plaça des édifices religieux, églises et chapelles, sous l’invocation de tel ou tel saint. On prétendit que des reliques de celui dont l’édifice portait le nom, se trouvaient là, souvent que son corps était sous le maître-autel, et que des miracles s’y opéraient, et cela amenait, dans ces lieux vénérés, une multitude de pèlerins qui s’y rendaient, soit pour être guéris, soit pour obtenir de l’intercession du saint quelque bénédiction, soit pour acquérir, en vertu de ces pèlerinages fatigants et coûteux, des mérites auprès de Dieu. Nécessairement ces pèlerinages étaient pour ceux qui desservaient les lieux de culte et pour les habitants des endroits où ils se trouvaient, une source de gains d’autant plus considérable que la réputation du saint était grande et les pèlerinages plus nombreux. De là des trafics honteux, et une rivalité entre les lieux de pèlerinage, une sorte de concurrence à qui aurait le plus de pèlerins. Ne croyons pas que, dans nos temps plus éclairés, ces superstitions aient cessé. Qui ne connaît les pèlerinages à Lourdes, provoqués par de prétendues apparitions de la Vierge à une jeune fille en 1858 ; à Einsiedeln, en Suisse, où l’on affirme avoir une image miraculeuse de la Vierge ; à Notre Dame de Lorette, en Italie, où l’on montre la maison de la Vierge et la chambre qu’elle occupait quand l’ange vint lui annoncer la naissance du Sauveur, le tout transporté par les anges à Lorette, petite ville des environs d’Ancône (*) ; à Saint-Jacques de Compostelle, en Espagne, le plus célèbre des lieux de pèlerinage après Rome et Jérusalem : on prétend que l’apôtre Jacques y fut enterré ! Que de choses l’ennemi du Seigneur et des âmes a mises au cœur des hommes pour les détourner de Christ, de son œuvre, et du culte en esprit et en vérité !
(*) Plus récemment, la Vierge, dite du Rosaire, serait apparue à de jeunes enfants à Fatima (Portugal), en 1917, d’où un autre pèlerinage de grand renom !
Les saints ne sont pas seulement des intercesseurs généraux, pour ainsi dire. Bien que chacun puisse s’adresser à eux, chaque bourg, chaque ville, chaque contrée, chaque royaume a son patron spécial, là où domine l’Église romaine. Bien plus, tout vrai catholique veut avoir pour patron le saint dont il porte le nom et l’on choisit souvent pour un des prénoms, celui dont la fête tombe sur le jour de naissance de la personne.
Les saints sont en si grand nombre qu’afin de n’en oublier aucun et afin d’obtenir de tous, connus ou inconnus, la faveur de leur intercession, l’Église romaine a institué une fête de tous les saints (le 1er novembre).
Au culte rendu aux saints, il faut ajouter l’invocation des anges. Les litanies des saints disent entre autres : saint Michel, saint Gabriel, saint Raphaël, saints anges et archanges, priez pour nous. De plus chaque personne (*) a son « bon ange », au dire de l’Église romaine. Ainsi, dans une prière que les fidèles sont invités à répéter, il est dit : « Ange du ciel, mon fidèle et véritable guide, obtenez-moi d’être si fidèle à vos instructions et de régler si bien tous mes pas, que je ne m’écarte en rien des commandements de mon Dieu ». Et quant au saint patron, voici la prière qu’on lui adresse : « Grand saint dont j’ai l’honneur de porter le nom, protégez-moi, priez pour moi, afin que je puisse servir Dieu comme vous sur la terre, et le glorifier éternellement avec vous dans le ciel ». La confession des péchés ne s’adresse pas à Dieu seulement, mais « à la bienheureuse Marie toujours Vierge, à saint Michel archange, à saint Jean Baptiste, aux apôtres saint Pierre et saint Paul, et à tous les saints », et on les supplie d’intercéder auprès du Seigneur Dieu pour le pardon des péchés.
(*) Les théologiens catholiques enseignent également qu’il y a un ange gardien non seulement pour tout individu, juste ou pécheur, mais encore pour chaque nation, chaque ville, chaque diocèse, chaque communauté. Saint Michel est l’ange gardien de toute l’Église, mais chaque église a aussi son ange gardien spécial.
Nous ne trouvons dans l’Écriture sainte aucun passage qui justifie ce culte rendu à des créatures. Le Seigneur nous dit bien, pour montrer l’intérêt que le Père prend aux petits enfants et les soins qu’il a pour eux, que leurs anges voient sans cesse sa face dans les cieux (Matthieu 18:10). Mais cela signifie-t-il qu’il faut invoquer ces anges ? Nullement. Les anges sont « des esprits administrateurs, envoyés pour servir en faveur de ceux qui vont hériter du salut » (Hébreux 1:14). Cela veut-il dire que nous devions nous adresser à eux ? Pas du tout ; au contraire, l’apôtre Paul dit, en parlant de certains docteurs, qui, déjà de son temps, induisaient les fidèles en erreur : « Que personne ne vous frustre du prix du combat, faisant sa volonté propre dans l’humilité et dans le culte des anges, s’ingérant dans les choses qu’il n’a pas vues » (Colossiens 2:18). C’était une fausse humilité qui prétendait n’oser pas s’approcher de Dieu, et s’adressait aux anges. Mais l’apôtre dit au contraire à ces hommes qu’ils sont enflés d’un vain orgueil et suivent leurs propres pensées, et qu’ils ne tiennent pas ferme le Chef, c’est-à-dire Christ (Colossiens 2:19). Nous avons tout en Christ, Christ suffit pleinement. Il nous a sauvés, par Lui nous nous approchons de Dieu ; nous n’avons besoin d’aucun autre. La Vierge Marie et les saints, les vrais saints qui sont délogés, sont dans le repos près de Lui, en attendant la résurrection. Ils n’ont et ne peuvent avoir cette toute-connaissance qui serait nécessaire pour entendre tous ceux qui les invoquent, et qui n’appartient qu’à Dieu, et par conséquent ils n’entendent aucune prière. Celles qu’on leur adresse ne sont qu’un vain son. Les anges sont occupés de leur service, comme nous le voyons dans l’Apocalypse, et quand Jean se prosterne et veut adorer l’ange qui lui avait montré les merveilleuses choses de Dieu, l’ange repousse cet hommage et lui dit : « Garde-toi de le faire ; je suis ton compagnon d’esclavage … rends hommage à Dieu » (Apocalypse 19:10 ; 22:8-9).
Et s’il s’agit des saints, rappelons-nous que, quand Corneille vient recevoir Pierre, et qu’il se jette à ses pieds pour lui rendre hommage, l’apôtre le relève en lui disant : « Lève-toi ; et moi aussi je suis un homme » (Actes 10:25-26). Cela ne suffit-il pas pour juger et condamner l’invocation des saints et des anges ? Assurément. À Dieu seul, et au Seigneur Jésus Christ, appartiennent la gloire, et l’honneur, et la force, et toute adoration.
6.3.7 - Les reliques et le culte des images
6.3.7.1 - Les reliques
Deux choses contraires à l’Écriture caractérisent encore l’Église de Rome. C’est d’abord le culte des reliques des saints, de la Vierge et même du Seigneur, et ensuite le culte des images.
Les reliques sont de prétendus restes, des ossements ou parties du corps de ceux que l’on révère, ou bien des objets qui leur ont appartenu ou qu’ils ont touchés. C’est vers le troisième siècle que l’on commença à entourer les restes des martyrs d’une vénération superstitieuse. Malgré l’opposition de quelques hommes pieux, le mal s’étendit rapidement. Vraies ou fausses, les reliques se multiplièrent. On leur attribua un pouvoir miraculeux, une vertu divine permanente. On prétendit que par elles les malades étaient guéris, les démons chassés, les morts ressuscités. Elles préservaient des dangers, faisaient gagner des batailles, et c’est sur elles que l’on prêtait les serments les plus inviolables. Pour affirmer leur puissance merveilleuse, on racontait toute espèce d’histoires souvent absurdes, en tout cas mensongères, et elles devinrent souvent l’objet d’un trafic scandaleux. Chaque église, chaque chapelle, chaque monastère, tenait à avoir ses reliques d’autant plus précieuses et renommées que de plus grands soi-disant miracles s’opéraient par elles. Les endroits où se trouvaient les plus célèbres reliques devenaient des buts de pèlerinage. Et les choses sont restées telles dans notre temps qu’on appelle un siècle de lumière. Rome présente à ses dévots pour être adorés, des objets dont l’origine est plus que douteuse — idolâtrie honteuse, reposant sur des fables, et qui ressemble à celle des prêtres de Bouddha qui eux aussi prétendent avoir des reliques de leur saint.
Je ne puis pas énumérer toutes les reliques que Rome vénère, ni les endroits où elles se trouvent. Ajouté aux légendes qui s’y rapportent, cela ferait un gros volume. Je citerai seulement trois des plus célèbres. La première est la sainte croix, celle sur laquelle le Sauveur a souffert. On prétend que l’impératrice Hélène, mère de l’empereur Constantin, voulant faire construire une église sur l’emplacement du sépulcre de Jésus, les ouvriers, en creusant la terre, découvrirent les trois croix où le Seigneur et les deux brigands avaient été attachés. Un miracle, dit-on, fit découvrir laquelle était celle de Jésus. La plus grande partie de la croix fut conservée à l’église du saint-sépulcre à Jérusalem, où, à ce que l’on dit, elle est encore, recouverte d’argent. Le reste fut coupé en morceaux et distribué comme reliques. Nombre d’endroits, églises ou autres, prétendent posséder un fragment de la vraie croix, mais si on les rassemblait, on en aurait la charge de dix hommes. Peuvent-ils être tous vrais, si même il y en a un seul qui le soit, car l’histoire de la découverte de la croix ne repose que sur des légendes ? Et alors, à quoi rend-on culte ? À des morceaux de bois, comme les païens à leurs fétiches. N’est-ce pas attristant de voir les âmes abusées par de telles choses au sein d’une église qui se dit chrétienne ? Dieu peut-il par là être honoré, et le Seigneur glorifié ?
Une autre relique célèbre est la tunique sans couture que portait le Seigneur. On l’appelle la sainte robe, et l’on raconte à son sujet les fables les plus absurdes. Elle ne fut découverte que dans le 12° siècle et donnée à l’archevêque de Trêves, ville où on la montre encore. Mais on prétend l’avoir aussi à Argenteuil en France, et au Latran à Rome, sans compter des morceaux que l’on en possède, dit-on, en divers endroits. Où est la vraie ? Ou plutôt, n’est-ce pas tout fausseté ? Et c’est ce que l’on fait adorer par de pauvres gens abusés. N’y a-t-il pas là un système de mensonges inventé par Satan pour égarer les âmes et les détourner de Christ sous une apparence de dévotion ? Les Bouddhistes ont aussi comme relique le vêtement de Bouddha renfermé dans une châsse. Et ce n’est pas la seule ressemblance que présente Rome papale avec le culte de Bouddha.
La troisième relique non moins fabuleuse, mais hautement vénérée, est le saint suaire. Une légende du Moyen Âge raconte qu’une femme de Jérusalem présenta à Jésus, lorsqu’on le conduisait au Calvaire, un mouchoir pour essuyer la sueur et le sang de son visage. Lorsque le Seigneur le lui rendit, sa face s’était imprimée sur le linge. Une autre légende rapporte la chose d’une manière toute différente. Ce serait le Seigneur lui-même qui aurait imprimé son visage sur un linge et l’aurait envoyé au roi Abgare qui désirait son portrait ! Ici encore on voit l’absurdité et la fausseté de la légende. Quoi qu’il en soit, ce que l’on nomme le saint suaire se trouve, chose étrange, à Saint-Pierre de Rome, à Turin, en Espagne, et en d’autres endroits. Où est le véritable, à supposer qu’il y en ait un seul ? Le saint suaire, un morceau de la vraie croix et la moitié de la lance qui perça le côté du Seigneur, sont les trois grandes reliques devant lesquelles, dans la semaine sainte, le pape et les cardinaux vont se prosterner solennellement, donnant ainsi l’exemple de l’idolâtrie au peuple qui se prosterne avec eux devant ces objets inanimés. Où trouvons-nous dans l’Écriture quoi que ce soit qui autorise un semblable culte ? Nulle part. Au contraire, tout culte rendu à un objet quelconque, de quelque manière que ce soit, y est formellement condamné. L’Écriture nous enseigne à adorer par l’Esprit Saint le Dieu vivant et vrai, le Père et le Fils dans le ciel, et à mettre notre confiance en Lui. Quant aux miracles opérés par les reliques, ce sont des mensonges ou des supercheries, ou, s’ils sont réels, ils sont dus à la puissance satanique. L’homme de péché qui doit venir, viendra « selon l’opération de Satan », avec « toute sorte de miracles et signes et prodiges, de mensonges ». Et le mystère d’iniquité opère déjà (*).
(*) 2 Thessaloniciens 2:9, 7.
6.3.7.2 - Les images
À côté du culte des reliques se place celui qui est rendu aux images. Nous le trouvons dans l’Église grecque comme dans l’Église romaine, avec cette différence que la première n’admet que les images peintes. Ce sont les icônes devant lesquelles, dans les chaumières, les maisons, les lieux publics, et dans les églises, brûlent des cierges et se prosterne le peuple.
L’Église romaine va plus loin. Les édifices consacrés à son culte sont remplis, non seulement de peintures, mais aussi de statues de la Vierge parées de riches vêtements, ainsi que l’enfant qu’elle porte, et de statues des saints et des anges. On y voit des crucifix, figures du Seigneur sur la croix ; on va même jusqu’à représenter dans des tableaux, sous une forme humaine, le Dieu invisible, le Père. Ces images se trouvent aussi dans les maisons des dévots catholiques et y sont vénérées ; dans les villes autrefois, il y en avait en quantité dans les rues, et l’on en trouve encore des vestiges. L’apôtre Paul ne serait-il pas indigné, plus encore qu’à Athènes, en voyant la chrétienté remplie d’idoles ? (Actes 17:16). Et n’est-il pas à regretter, pour le dire en passant, que des chrétiens qui condamnent l’idolâtrie romaine, ne soient pas plus soigneux d’en écarter toute trace sur eux et dans leurs maisons ?
C’est dans les églises surtout que s’étale le culte rendu aux images. Il n’en est guère qui n’ait une chapelle dédiée à la Vierge ; d’autres ont en outre des chapelles consacrées à tel ou tel saint. Là, indépendamment du maître-autel avec ses nombreux cierges et ses riches ornements, se trouvent, dans chaque chapelle, un autel pour dire la messe, des cierges, des tableaux et d’autres images, et devant ces images, on brûle de l’encens, et prêtres et laïques se prosternent, adorent et prient. Si mes lecteurs ont l’occasion de voir une représentation de l’intérieur d’un temple bouddhiste, ils seront frappés de la ressemblance qu’il présente avec une Église romaine. Ne peut-on pas dire, que ces lieux où l’on prétend servir le Dieu unique, sont de vrais temples d’idoles ? Idolâtrie d’autant plus affreuse que l’on fait de Christ une image taillée que l’on baise et que l’on adore, et que les autres images auxquelles on rend un culte, sont celles de Pierre, de Paul, et d’autres qui furent de fidèles serviteurs de Dieu à qui toute idolâtrie était en horreur ; et surtout idolâtrie condamnable au plus haut degré en ce qu’on se prosterne devant des représentations de Celui qui a dit : « Tu ne te feras point d’image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est dans les cieux en haut, ni de ce qui est sur la terre en bas, ni de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point » (*). On tombe ainsi dans le même péché qu’Israël quand il fit le veau d’or. L’Église romaine allègue qu’on n’adore pas les images, mais qu’en leur rendant un culte « relatif », on vénère ceux qu’elles représentent. C’est un subterfuge ; le passage que nous venons de lire est formel, et d’ailleurs le fait certain est que la masse des fidèles adore réellement l’image. Ajoutons à ce qui précède qu’un pouvoir miraculeux est attaché à certaines images, et que les b..... — en particulier b..... le crucifix — est considéré comme un acte méritoire. Nous l’avons vu en parlant de l’extrême-onction.
(*) Exode 20:4-5.
Le culte des images commença de bonne heure en Orient et se répandit ensuite en Occident. Ce ne fut pas sans opposition. En Orient, des empereurs voulurent l’extirper par la force. Il en résulta des luttes sanglantes, car le peuple défendait avec acharnement ces images si chères, auxquelles il attribuait des miracles. En effet, souvent en Occident, comme en Orient, dans des calamités ou des dangers publics, on portait, dans une procession solennelle, telle ou telle image pour obtenir la délivrance. Si l’ennemi s’éloignait des murs d’une ville assiégée, si une maladie contagieuse venait à cesser, c’était grâce à la vertu de l’image.
Après les luttes dont j’ai parlé, un concile fut convoqué à Nicée, en l’an 787. Il décréta que des images du Sauveur, de la Vierge, des anges, et des saints, en peinture ou en mosaïque, seraient placées dans les églises pour être baisées (*) et révérées en se prosternant devant elles, distinguant toutefois cette adoration de celle qui n’appartient qu’à la nature divine. « On doit, dit le concile, leur offrir de l’encens et des cierges, car l’honneur rendu à l’image passe à celui qu’elle représente ». Ensuite on déclara anathème celui qui ne révérerait pas les images et qui dirait qu’elles sont des idoles.
(*) Les adorateurs de Baal baisaient son image (1 Rois 19:18. Voyez aussi Osée 13:2).
L’Église romaine, comme l’Église grecque, reçut les décrets de ce concile. Plus tard, le concile de Trente, dans le 16° siècle, statua : « On doit avoir et conserver, principalement dans les églises, les images de Jésus Christ, de la Vierge, mère de Dieu, et des autres saints, et leur rendre l’honneur et la vénération qui leur sont dus, parce que cet honneur est rapporté aux originaux qu’elles représentent ».
Telle a été la ruse de Satan pour entraîner les âmes dans l’idolâtrie, malgré la parole de Dieu qui la proscrit formellement. « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange à des images taillées », dit l’Éternel (*). Et quand nous voyons ces statues devant lesquelles on se prosterne, qu’elles soient de pierre ou de bois, comment ne pas nous rappeler les paroles si fortes d’Ésaïe : « Qui a formé un dieu, ou fondu une image, qui n’est d’aucun profit ? »… Un homme prend un bois : d’une partie il fait du feu et s’en chauffe et fait cuire du pain ; et de l’autre il en fait un dieu, une image taillée, et se prosterne devant elle. Et le prophète ajoute : « Il se repaît de cendres ; un cœur abusé l’a détourné ; et il ne délivre pas son âme, et ne dit pas : N’ai-je pas un mensonge dans ma main droite ? » (**). Combien ces paroles sont applicables à ces nombreux pauvres abusés qui se prosternent devant les peintures et les statues de bois ou de pierre, et leur adressent leurs prières !
(*) Ésaïe 42:8.
(**) Ésaïe 44:10-20.
6.3.8 - Le Purgatoire
Une autre doctrine du catholicisme est le purgatoire. Qu’est-ce que le purgatoire ? C’est un lieu, dit l’Église romaine, où ceux qui sont morts en état de grâce, c’est-à-dire non coupables de péché mortel (*), sont purifiés par des châtiments et des souffrances temporaires, des fautes qui n’ont pas été suffisamment expiées ici-bas. Ces souffrances peuvent être allégées et leur temps abrégé, par les prières et les aumônes des parents et des amis du défunt, et surtout par des messes dites à son intention.
(*) L’Église romaine enseigne qu’il y a deux sortes de péchés : les péchés mortels qui font perdre la grâce de la justification, et les péchés véniels (de venia, pardon) qui ne font pas perdre la grâce. Si quelqu’un meurt en état de péché mortel, il va en enfer. Mais quelqu’un qui s’est rendu coupable d’un tel péché peut être pardonné et justifié par le sacrement de pénitence.
Bien que saint Augustin, à l’occasion de la mort de sa mère Monique, mentionne déjà les prières pour les morts, ce n’est qu’en l’an 600 que la doctrine du purgatoire fut reçue parmi les dogmes de l’Église de Rome et que le pape Grégoire le Grand la formula en ces termes : « Nous devons croire qu’il y a un feu qui purifie des petites fautes avant que le jour du jugement arrive ». Le célèbre concile de Trente a défini complètement cette doctrine et prononcé l’anathème sur ceux qui la nient. Voici ce qu’il dit : « Il y a un purgatoire, et les âmes qui y sont retenues prisonnières, sont secourues par les prières des croyants, mais surtout par le sacrifice acceptable de la messe ». Le concile ordonne à tous les évêques, de « s’appliquer avec zèle à ce que la sainte doctrine du purgatoire qui nous a été transmise par les vénérables pères de l’Église et par les saints conciles, soit crue, gardée, enseignée et prêchée partout parmi les fidèles de Christ… Les âmes des justes sont purifiées dans les flammes du purgatoire par un châtiment temporaire, afin que de cette manière leur soit accordée l’entrée dans leur patrie éternelle, où rien d’impur ne peut être admis… Le sacrifice de la messe est offert pour ceux qui se sont endormis en Christ, mais qui ne sont pas entièrement purifiés ».
Telle est la doctrine romaine du purgatoire. Elle n’a, pour s’appuyer, aucun passage de la parole de Dieu (*), et, de l’aveu même du concile, ne repose que sur l’autorité des pères et des conciles. Nous allons voir qu’elle est contraire aux enseignements de l’Écriture, et au témoignage qu’elle rend à l’amour de Dieu et à l’œuvre de Christ pour la justification du pécheur et le pardon des péchés.
(*) La seule référence faite par l’Église romaine est celle d’un livre apocryphe (2 Macchabées), c’est-à-dire ne figurant pas dans la Bible hébraïque.
Où se trouve le purgatoire, et quel genre de souffrances les âmes y endurent-elles ? Les docteurs romains ne le disent pas, et le concile de Trente interdit sur ce point les questions curieuses. Mais il parle du « feu du purgatoire », et l’Église romaine, pour apitoyer les vivants sur le sort des âmes qui s’y trouvent, tolère qu’on le représente dans des tableaux comme un lieu où les âmes sont horriblement tourmentées dans un feu ardent. Et jusqu’à quand les âmes restent-elles dans ce lieu de souffrances ? Jusqu’à ce qu’elles aient « payé le dernier quadrant » (Matthieu 5:26), disent les docteurs romains, car c’est ainsi qu’ils appliquent à faux ce texte. Ils veulent dire par là que les âmes subissent les peines du purgatoire jusqu’à ce qu’elles aient été entièrement purifiées et que la justice de Dieu ait été satisfaite. L’Église romaine dit bien que l’intensité des souffrances peut être adoucie et leur durée abrégée par certaines œuvres accomplies en leur faveur, mais est-on jamais sûr que le dernier quadrant est payé et que l’âme sort enfin du purgatoire pour entrer au ciel ? Non, jamais. Et ainsi les pauvres catholiques romains sont laissés dans une continuelle incertitude quant au sort de leurs parents ou amis décédés, quand bien même ceux-ci ont reçu l’extrême-onction (qui selon Rome, doit effacer les dernières traces de péché), et qu’eux ont prié et fait dire des messes. Et ceux qui croient cet enseignement, ne peuvent qu’être dans une erreur constante en pensant à la mort qui va les jeter dans les souffrances du purgatoire, malgré leur foi et leurs œuvres, et cela durant un temps indéterminé.
Mais Dieu soit béni, le purgatoire n’est qu’une invention de l’esprit humain et par conséquent un mensonge. Tout l’enseignement de l’Écriture est opposé à cette doctrine.
D’abord nous n’y voyons nulle part qu’il y ait à distinguer entre les péchés mortels et les péchés véniels. Tout péché est mortel, car la parole de Dieu dit : « Les gages du péché, c’est la mort » (Romains 6:23), et après la mort, le jugement (Hébreux 9:27). Mais il est ajouté : « Le don de grâce de Dieu, c’est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur ». Et Jésus nous dit : « Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle » (Jean 3:16).
Et ce n’est pas après la mort seulement que nous aurons la vie éternelle ; nous l’avons dès ici-bas lorsque nous croyons de cœur au Seigneur Jésus, car il est écrit : « Qui croit au Fils a (et non aura) la vie éternelle » (Jean 3:36). Nous lisons encore : « En ceci a été manifesté l’amour de Dieu pour nous, c’est que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui… Dieu… nous aima et… envoya son Fils pour être la propitiation pour nos péchés » (1 Jean 4:9-10). Puis : « Voyez de quel amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu… Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu » (1 Jean 3:1-2). En croyant au Seigneur Jésus, nous avons déjà maintenant la vie éternelle et sommes de bien-aimés enfants de Dieu ; Dieu veut-il mettre son enfant, pour qui il a donné son Fils, et qui possède la vie éternelle, dans une horrible prison et d’affreuses souffrances jusqu’à ce qu’il ait payé le dernier quadrant ? Est-ce là le grand amour dont il nous a aimés ? (Éphésiens 2:4).
Il est vrai que si l’enfant de Dieu vient à manquer, Dieu le discipline ici-bas, pour son profit, afin de le rendre participant de sa sainteté (Hébreux 12:7-10), et cette discipline peut aller jusqu’à la mort du corps (1 Jean 5:16 ; 1 Corinthiens 11:30). Dieu permet aussi que nous soyons éprouvés de différentes manières, afin de nous purifier des choses qui ne conviennent pas à notre caractère de chrétiens (1 Pierre 1:6-7). Mais nous ne voyons nulle part dans l’Écriture qu’après cette vie, le croyant ait encore à souffrir pour satisfaire Dieu qui a été pleinement satisfait par le sacrifice de Christ. S’il déloge, c’est pour être avec Christ (Philippiens 1:23) et non dans le purgatoire. Absent du corps, il est avec le Seigneur (2 Corinthiens 5:8). L’Écriture nous dit aussi que les croyants ont à rendre grâces « au Père qui nous a rendus capables de participer au lot des saints dans la lumière » et qui nous a introduits « dans le royaume du Fils de son amour », et cela dès ici-bas (Colossiens 1:12-14). Le croyant cesse-t-il de jouir de ces heureux privilèges quand il a quitté cette vie ? Le lot des saints dans la lumière peut-il jamais être un lieu de tourments, et le purgatoire et ses souffrances fait-il partie du royaume du Fils de l’amour divin ? Non.
 Re: L’ÉGLISE : UNE ESQUISSE DE SON HISTOIRE PENDANT VINGT SIÈCLES
Re: L’ÉGLISE : UNE ESQUISSE DE SON HISTOIRE PENDANT VINGT SIÈCLES
La doctrine du purgatoire fait donc injure à l’amour parfait de Dieu, et méconnaît les dons de cet amour. La pensée du purgatoire tient les âmes dans une crainte perpétuelle. Or Dieu veut que, dans la connaissance et la jouissance de son amour, nous soyons sans crainte. « Il n’y a pas de crainte dans l’amour », dit l’apôtre Jean, « mais l’amour parfait chasse la crainte, car la crainte porte avec elle du tourment ; et celui qui craint n’est pas consommé dans l’amour » (1 Jean 4:18).
Cette doctrine est aussi contraire à ce que l’Écriture enseigne touchant l’œuvre parfaite de Christ accomplie sur la croix pour notre salut complet et actuel, pour l’entier pardon de tous nos péchés. La parole de Dieu nous dit que Christ a « offert un seul sacrifice pour les péchés », que nous sommes « sanctifiés par l’offrande du corps de Jésus Christ faite une fois pour toutes », que, « par une seule offrande, il a rendu parfaits à perpétuité ceux qui sont sanctifiés », et enfin que Dieu ne se souviendra plus jamais de leurs péchés ni de leurs iniquités » (Hébreux 10:10, 12, 14, 17). Si les croyants sont sanctifiés, rendus parfaits à perpétuité, et si Dieu ne se souvient plus de leurs péchés, qu’ont-ils encore besoin d’un purgatoire ? Dieu veut-il exiger le paiement de péchés dont il ne se souvient plus, qui sont entièrement effacés de devant ses yeux ? De plus, il est dit : « Le sang de Jésus Christ son Fils nous purifie de tout péché » (1 Jean 1:7). S’il faut encore aller dans le purgatoire, cette affirmation de l’Écriture n’est pas vraie : on fait Dieu menteur. Nous lisons aussi : Christ a été « offert une fois pour porter les péchés de plusieurs » (Hébreux 9:28), c’est-à-dire de ceux qui croient, et : « Il a porté nos péchés en son corps sur le bois » (1 Pierre 2:24). Mais si l’on doit souffrir dans le purgatoire, c’est donc que le Christ n’a pas porté tous les péchés, c’est-à-dire que son œuvre est imparfaite et incomplète ! N’est-ce pas un blasphème ? Le fait est que l’Église romaine veut toujours que l’homme ait une part à faire dans l’œuvre du salut, ici-bas ou dans l’autre vie.
Combien nous sommes heureux, de savoir avec une entière certitude que, si nous croyons de cœur au Seigneur Jésus, Dieu nous « a pardonné toutes nos fautes » (Colossiens 2:13), que nous sommes sauvés pleinement, vivifiés avec Christ, ressuscités avec Lui, assis en Lui dans les lieux célestes (Éphésiens 2:5-6) (*), que nous n’avons plus aucune condamnation à redouter (Romains 8:1), que nous sommes lavés, sanctifiés, justifiés, au nom du Seigneur Jésus et par l’Esprit de notre Dieu (1 Corinthiens 6:11), et enfin que, si nous passons par la mort, c’est le Seigneur, et non le purgatoire, qui reçoit notre esprit bienheureux (Actes 7:59).
(*) Telle est l’union intime du croyant avec Christ. Peut-on supposer qu’un homme qui est vivifié et ressuscité avec Christ, assis en Lui dans les lieux célestes, puisse en même temps être dans les souffrances du purgatoire ?
6.3.9 - Les Indulgences
Aux doctrines de la pénitence et du purgatoire se rattache celle des indulgences, entièrement étrangère aussi et contraire aux enseignements de l’Écriture sainte. Mais avant de voir ce que l’on entend par là, rappelons en quelques mots ce que la Parole de Dieu nous dit touchant le salut de notre âme. Elle nous apprend que nous sommes des pécheurs perdus, éloignés de Dieu et ses ennemis dans nos pensées et par nos mauvaises œuvres, privés du ciel et sujets à la condamnation éternelle (Colossiens 1:21 ; Romains 3:23 ; Jean 3:36). Elle nous dit que nous sommes morts dans nos fautes et dans nos péchés, sans force et incapables par nous-mêmes de revenir à Dieu, et qu’en nous il n’habite aucun bien (Éphésiens 2:1 ; Romains 5:6 ; 7:18). Et elle déclare de plus que personne ne sera justifié devant Dieu par des œuvres de loi, car la loi ne fait que manifester, par notre impuissance à l’observer, tout le mal qui est en nous (Romains 3:20).
Comment échapper à la juste condamnation prononcée contre nous ? Il n’y a qu’une unique ressource, nous dit la parole de Dieu. C’est la grâce divine : « Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu ; non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie » (Éphésiens 2:8-9). Le salut vient donc tout entier de Dieu, et il nous est accordé, sans aucun mérite de notre part, à cause de l’œuvre de Christ qui est mort pour nos fautes et a été ressuscité pour notre justification. Ce précieux Sauveur s’est chargé de nos péchés et les a expiés par son sacrifice parfait. C’est en vertu de ce sacrifice que Dieu nous pardonne et nous justifie, ainsi qu’il est écrit : « Étant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, lequel Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang » (Romains 3:24-25). Quelles œuvres pourrions-nous ajouter à l’œuvre parfaite de Christ qui a satisfait Dieu ? Gratuitement ne veut-il pas dire que l’on n’a rien à payer ? Et comment avoir part à la justification, à la rédemption, au salut ? Simplement par la foi, la foi sans aucune œuvre, la foi au sacrifice du Seigneur, la foi en l’efficacité du sang versé sur la croix pour ôter nos péchés. Telle est la voie simple du salut pour le pécheur coupable et perdu.
L’Église romaine enseigne autrement : selon elle, l’homme est capable de faire le bien par lui-même et par conséquent peut et doit accomplir des œuvres propres à lui assurer le salut. Et comme preuve que la foi seule sans les œuvres ne suffit pas au salut, ses docteurs objectent les paroles de Jacques : « La foi sans les œuvres est morte… » et « vous voyez qu’un homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement » (Jacques 2:17-26). Mais Dieu ne peut se contredire : les paroles de l’Esprit Saint données par l’apôtre Paul sont vraies, et celles données par Jacques sont vraies aussi, et les unes s’accordent parfaitement avec les autres. La foi est dans le cœur une puissance vivifiante et purifiante (Actes 15:9). Celui qui croit du cœur au Seigneur Jésus est régénéré, ou né de nouveau. L’Esprit Saint produit en lui une vie nouvelle, et il est rendu capable de faire des œuvres agréables à Dieu, tandis qu’auparavant les œuvres qu’il faisait étaient des œuvres mortes et nullement agréées de Dieu. Les œuvres que le chrétien accomplit sont le fruit et non le moyen du salut ; elles sont la manifestation extérieure de la foi intérieure, de la vie de Dieu dans l’âme. C’est ainsi que Jacques dit qu’un homme n’est pas justifié par la foi seule, mais aussi par les œuvres, parce que celles-ci sont la preuve de la réalité de la foi. Dans une horloge, le ressort qui est caché montre son existence par les mouvements du balancier que l’on voit.
Les œuvres ne nous sauvent donc pas, mais les bonnes œuvres que le chrétien accomplit sont le fruit la grâce et la preuve qu’il est sauvé, que la vie de Dieu est en lui. Nous avons encore sur ce sujet si important le passage suivant : « Quand la bonté de notre Dieu Sauveur et son amour envers les hommes sont apparus, il nous sauva, non sur le principe d’œuvres accomplies en justice, que nous, nous eussions faites, mais selon sa propre miséricorde, par le lavage de la régénération et le renouvellement de l’Esprit Saint, qu’il a répandu richement sur nous par Jésus Christ, notre Sauveur, afin que, ayant été justifiés par sa grâce, nous devinssions héritiers selon l’espérance de la vie éternelle » (Tite 3:4-7). Et ensuite l’apôtre ajoute : « Que ceux qui ont cru Dieu s’appliquent à être les premiers dans les bonnes œuvres » (verset 8). Remarquons encore que les œuvres que le chrétien accomplit, ne sont pas des œuvres qu’il invente ou qu’il choisit ; elles sont le fruit de l’Esprit et, dit l’apôtre, « nous sommes son ouvrage (l’ouvrage de Dieu), ayant été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l’avance, afin que nous marchions en elles » (Galates 5:22 ; Éphésiens 2:10).
Mais l’Église romaine s’est écartée de ce sain enseignement. Les œuvres qu’elle préconise sont des œuvres purement extérieures ; c’est l’observation des rites et cérémonies de l’église, des prières cent fois répétées, des jeûnes, des macérations pour dompter la chair, des pèlerinages en tels ou tels lieux réputés, la fondation d’églises, de chapelles ou de couvents, faire l’aumône, donner tous ses biens, faire vœu de pauvreté, entrer dans un couvent en renonçant au monde, porter un cilice et se flageller ; toutes ces choses et d’autres encore sont considérées comme des œuvres méritoires propres à acquérir des droits au ciel. Voyez, à propos de ces œuvres, ce que l’apôtre Paul dit en Colossiens 2:16-23.
Selon l’Église romaine, plus on accomplissait de ces œuvres que nous avons mentionnées, plus on était saint, plus on était propre pour le ciel, et l’on en vint à croire qu’il existait des personnes qui allaient en sainteté au-delà du nécessaire pour entrer dans le ciel. Comme si l’on pouvait être trop saint aux yeux de Dieu ! Combien cela est loin de ce que dit la parole de Dieu : « Que celui qui est saint soit sanctifié encore » (Apocalypse 22:11). Ce sont ces personnes-là que le pape canonise, c’est-à-dire déclare saintes, et place dans le ciel pour y être invoquées. Mais ce n’est pas tout. Ayant fait plus qu’il ne fallait pour être reçus dans le ciel, les saints ont laissé après eux un reste de mérites qui peuvent être appliqués à d’autres, dit l’Église de Rome. C’est ce qu’elle appelle des mérites surérogatoires, mot qui veut dire au-delà de ce que l’on peut exiger. Mais que dit le Seigneur Jésus ? : « Quand vous aurez fait toutes les choses qui vous ont été commandées, dites : Nous sommes des esclaves inutiles ; car ce que nous étions obligés de faire, nous l’avons fait » (Luc 17:10).
Au 13° siècle, un docteur de l’Église de Rome, nommé Alexandre de Hales, et surnommé le docteur irréfragable, c’est-à-dire qu’on ne peut contredire, inventa une nouvelle doctrine. Il dit que Christ avait fait bien plus qu’il n’était nécessaire pour le salut des hommes. Une seule goutte du sang qu’il a versé suffisait pour cela, et puisqu’il en a versé beaucoup, ajoutait ce docteur, il en reste pour l’Église un trésor de mérites que l’éternité ne saurait épuiser. C’est une doctrine qui n’a aucun fondement dans la parole de Dieu, et qui n’est que le produit des vains raisonnements et de la folle imagination de l’homme. Mais le pape Clément VII l’a déclarée article de foi, et l’Église romaine l’a acceptée comme telle. Ce trésor des mérites de Christ a été augmenté des mérites surérogatoires des saints, et la garde et l’administration en ont été confiées au pape, vicaire de Jésus Christ sur la terre, dit l’Église romaine.
Que faire de ces mérites ? Moyennant des sommes à payer ou certaines pratiques à accomplir, l’église les applique à chaque pécheur dans la mesure que ses péchés nécessitent, et c’est là ce que l’on nomme les indulgences. Les vivants peuvent aussi les acquérir pour abréger les peines temporelles, soit les châtiments dans ce monde, soit ce qu’endurent les âmes dans le purgatoire. N’est-il pas triste de voir les âmes abusées, trompées, par de semblables enseignements ? Peut-on croire que les mérites d’une créature comme nous puissent nous être appliqués pour l’expiation de nos fautes ? Peut-on supposer que d’une manière quelconque, on puisse acheter quelque chose des mérites de notre adorable Sauveur qui a offert une fois pour toutes le sacrifice qui expie tous nos péchés, et qui donne gratuitement le salut et la vie éternelle ? Et quelle prétention terrible de la part d’un homme de se dire le dispensateur de ce qui n’appartient qu’à Christ, de ce que Christ seul donne !
Les indulgences devinrent la source du trafic le plus honteux. Au moyen d’une somme d’argent payée à l’église, on était dispensé de la repentance et des peines de la pénitence. On pouvait ainsi sans remords se livrer au péché. On alla jusqu’à établir une taxe des indulgences, qui indiquait ce qu’il fallait donner pour se racheter de tel ou tel péché, même du plus grossier. On accordait aussi des indulgences à l’accomplissement de tels ou tels actes que l’on faisait considérer comme méritoires. Ainsi une indulgence plénière, c’est-à-dire le pardon de tous les péchés commis, même les crimes les plus grands, avait été promise par le pape Urbain II à tous ceux qui prendraient part à la croisade, c’est-à-dire à l’expédition guerrière destinée à reprendre Jérusalem des mains des Turcs. Une indulgence plénière applicable aux âmes du purgatoire, fut accordée par le pape Pie VII à ceux qui, après la confession et la communion, récitent à genoux devant un crucifix une certaine prière.
Pour faire profiter du trésor des indulgences le plus grand nombre possible de personnes, le pape Boniface VIII, en l’an 1300, publia une bulle annonçant à l’Église qu’un jubilé se célébrerait à Rome tous les cent ans, et qu’à tous ceux qui s’y rendraient, il serait accordé une indulgence plénière, l’absolution de tous leurs péchés. D’innombrables pèlerins se rendirent à Rome de toutes parts, non sans apporter à l’Église de riches offrandes. Cent ans, c’était bien long. On plaça donc les jubilés, d’abord à cinquante ans, puis à trente-trois ans, et enfin à vingt-cinq ans d’intervalle. Et comme un grand nombre ne pouvaient facilement aller à Rome, on transporta sur différentes places de la chrétienté le jubilé et ses indulgences.
Ce trafic des choses saintes arriva au comble le plus honteux à l’époque de la Réformation. Le pape Léon X, homme léger et dissolu, avait besoin d’argent pour satisfaire à ses goûts dispendieux et à ses plaisirs. Pour s’en procurer, sous prétexte de vouloir achever la basilique de Saint-Pierre à Rome et de faire la guerre aux Turcs, il donna un nouvel essor à la vente des indulgences, dont les principaux marchés furent établis en Allemagne et en Suisse. Les scandales qui en résultèrent, l’indignation qu’ils soulevèrent, la manière grossière et impie dont agissaient ceux qui étaient préposés à cette vente, furent une des causes de la Réformation. Nous en reparlerons plus tard.
De nos jours, l’Église romaine applique toujours les indulgences, bien qu’en ayant supprimé les abus les plus grossiers. Ainsi elle accorde des indulgences d’un certain nombre de jours ou d’années, à l’accomplissement de tels ou tels actes, par exemple à des pèlerinages, à des prières récitées devant certains autels, ou adressées à tel saint. Et ces indulgences sont appliquées soit à celui qui les acquiert ainsi pour lui épargner un certain temps de souffrances dans le purgatoire, soit à des personnes défuntes en faveur desquelles ces actes sont accomplis.
Nous avons ainsi vu l’ensemble de ce qui constitue le papisme, ce grand système de doctrines qui cache le vrai christianisme. Nous avons encore à considérer les moyens terribles inventés par l’Église romaine pour tenir les âmes sous sa domination.
6.3.10 - L’Inquisition
L’Inquisition était un tribunal ecclésiastique institué pour rechercher et punir les personnes coupables d’hérésie. Que faut-il entendre par ce mot ? Il signifie en réalité toute doctrine contraire à la parole de Dieu. Mais l’Église romaine appelle de ce nom ce qui est opposé à ses enseignements et à ses pratiques. Ainsi, si quelqu’un niait que le pape eût le pouvoir de pardonner les péchés, ou s’il ne croyait pas à la messe, ou, au purgatoire, ou s’il rejetait quelque autre des traditions de l’église, il était regardé comme un hérétique digne de châtiment.
Comment faut-il agir avec les hérétiques ? La parole de Dieu nous dit simplement qu’il faut les rejeter et n’avoir pas de communication avec eux (Tite 3:10 ; 2 Jean 10), et c’est ce que l’Église faisait au commencement. Mais quand elle se fut écartée de l’enseignement des Écritures, qu’elle y eut ajouté ses traditions et ses ordonnances, et qu’elle se fut érigée en dominatrice des consciences et des cœurs, elle en vint à dire qu’il fallait châtier les hérétiques qui ne voulaient pas renoncer à leurs erreurs, par la perte de leurs biens, par la prison, et enfin par le feu. Elle prétendait s’appuyer sur ce passage : « Contrains-les d’entrer ».
Déjà à la fin du 4° siècle, un nommé Priscillien, chef d’une secte qui portait son nom, fut mis à mort avec quelques-uns de ses disciples pour crime d’hérésie, par ordre de l’empereur Maxime (*). Son principal accusateur était un évêque du nom d’Ithacius. Ambroise de Milan et d’autres évêques jugèrent son action si indigne de sa charge, qu’il fut excommunié et mourut en exil. Ainsi à cette époque, sévir contre les hérétiques était désapprouvé par ce qu’il y avait de meilleur dans l’Église. Nous avons cependant vu, par exemple, dans l’histoire de Chrysostôme et d’autres, avec quelle rigueur on traitait ceux qui ne suivaient pas les opinions religieuses des empereurs.
(*) Priscillien était un véritable hérétique. Sa doctrine se rapprochait de celle des Manichéens ; mais ce n’était pas une raison pour le faire mourir.
Au 6° siècle, l’empereur Justinien édicta des pénalités contre les hérétiques, les Juifs et les apostats. Mais c’étaient des officiers civils qui poursuivaient les délinquants. Les cas d’hérésie étaient portés devant les tribunaux ordinaires. Plus tard les évêques furent investis du droit d’examiner ceux qui étaient accusés d’hérésie. S’ils ne renonçaient pas à leurs erreurs, vraies ou prétendues, ils étaient livrés au pouvoir civil pour être punis ; mais la poursuite des hérétiques ne se faisait pas d’une manière générale et l’on jugeait d’après les décisions des conciles.
Ce fut vers la fin du 12° siècle que des mesures rigoureuses et plus générales furent prises pour rechercher et punir ceux que l’Église de Rome appelait hérétiques, et ce fut à l’occasion de l’hérésie des Albigeois répandus en grand nombre dans le midi de la France et ailleurs. Nous en parlerons plus tard.
Le Saint-Siège, comme on appelle le siège épiscopal de Rome, sentait son autorité menacée par les progrès de cette hérésie. Aussi le pape Alexandre, en 1163, convoqua un concile à Tours. Voici une des décisions de cette assemblée : « À cause des hérésies existant à Toulouse et ailleurs, nous ordonnons aux évêques et à tous les prêtres du Seigneur demeurant dans ces lieux-là de veiller et sous peine d’anathème, de défendre que là où des partisans de ces hérésies sont connus, nul dans le pays n’ose leur donner asile, ni ne leur prête une aide quelconque. On ne doit avoir aucune relation avec ces personnes, ni pour vendre, ni pour acheter, afin que tout soulagement et toute marque d’humanité leur étant refusés, elles soient forcées d’abandonner l’erreur de leur vie. Et quiconque tentera de contrevenir à ce commandement, sera frappé d’anathème comme participant à leur iniquité. Quant aux hérétiques, s’ils sont pris, ils seront jetés en prison par les princes catholiques et privés de tous leurs biens ». Voilà comment parlaient les évêques de Jésus Christ chargés de paître les brebis ! Toute réunion, des hérétiques était strictement défendue. On remarquera que non seulement les hérétiques étaient punis par la prison, mais que leurs biens étaient confisqués. Une part allait aux princes, une autre à l’église, et cela devint, pour les hommes avides, un terrible stimulant à porter des accusations contre les personnes riches.
Le pape Innocent III (de 1198 à 1216) déploya le plus grand zèle pour extirper tout ce qui était tenu pour hérésie. Il convoqua, en 1215, le quatrième concile de Latran, où furent passés de nouveaux et rigoureux décrets contre ceux qui différaient, non seulement des conciles généraux, mais de l’Église de Rome. Les évêques devaient être les juges. Dans ce concile il fut décrété : « Les personnes notées seulement comme suspectes d’hérésie, à moins qu’elles n’aient pu se justifier elles-mêmes, seront frappées du glaive de l’anathème, et chacun devra les éviter. Si elles persistent pendant une année sous l’excommunication, elles seront condamnées comme hérétiques ». Ainsi se resserrait le filet destiné à prendre et à détruire les hérétiques. Bientôt le système prit sa forme définitive.
Au concile de Toulouse, en 1229, il fut décidé qu’une Inquisition permanente serait établie pour rechercher les hérétiques. Mais ce ne fut qu’en 1233, quand le pape Grégoire IX eut ôté aux évêques le pouvoir de punir ceux qui étaient coupables d’hérésie, et qu’il l’eut donné aux Dominicains, que l’Inquisition prit la forme d’un tribunal distinct. On le nomma le Saint-Office, et ses officiers furent appelés Inquisiteurs de la foi.
Avant d’aller plus loin, disons qui étaient les Dominicains. Un jeune prêtre espagnol, nommé Dominique de Guzman, né en 1170, se distinguait par son éloquence, sa piété, son ascétisme et son dévouement à la cause de l’Église romaine. En vue de la défendre contre les hérétiques, il fonda à Toulouse l’ordre des frères prêcheurs qui, d’après lui, furent nommés Dominicains. Bien que Dominique prétendît qu’il ne fallait employer contre les hérétiques d’autres armes que la prière, la persuasion et l’exemple, il accepta la charge d’inquisiteur, et comme tel persécuta les Albigeois avec la plus grande cruauté. Son emblème était un chien portant dans sa gueule une torche enflammée et brûlant le monde. Emblème frappant de ce qu’il fut car sa vie se passa à pourchasser les hérétiques et à les faire brûler. Il fut canonisé en 1234, et est ainsi un des saints que l’Église romaine invoque et prie ! L’apôtre Paul disait : « Je ne suis pas digne d’être appelé apôtre, parce que j’ai persécuté l’Église de Dieu ». Dominique, lui, a passé sa vie à persécuter des chrétiens, et à cause de cela l’Église de Rome a fait de lui un saint, et a inscrit son nom comme tel dans le calendrier. Mais à moins qu’avant sa mort il ne se soit repenti de ses cruautés et n’ait imploré le pardon de Christ — ce que nous ignorons — son nom ne saurait être inscrit parmi les saints de Dieu. Les Dominicains sont vêtus d’une robe blanche avec un capuchon noir. Ils s’engagent par serment à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour défendre l’église et le pape et pour détruire l’hérésie. Le pape leur donna son approbation et les nomma « les vraies lumières du monde », tristes et terribles lumières que celles que projetaient les bûchers qu’ils allumèrent pour consumer de soi-disant hérétiques !
Bien que, dans toutes les contrées de l’Europe occidentale, le fanatisme des prêtres ait fait brûler par le pouvoir civil ceux qu’ils disaient hérétiques, l’établissement de l’Inquisition rencontra une forte opposition dans plusieurs États. C’est en Espagne et au Portugal, ainsi que dans les contrées qui étaient soumises à ces royaumes, que le terrible tribunal fut érigé d’une manière permanente et fonctionna avec une rigueur cruelle durant près de six cents ans, n’ayant été aboli qu’au commencement du 19° siècle.
Nous dirons maintenant quelques mots sur l’organisation du Saint-Office et sur la manière dont il procédait. Dans chaque contrée où l’Inquisition était établie, il y avait un Inquisiteur général. C’était toujours quelque haut dignitaire ecclésiastique qui dépendait du pape seul. Ni roi, ni prince, ni gouverneur n’avait autorité sur lui. Il nommait d’autres inquisiteurs pour chaque province où leur œuvre devait être poursuivie. Au-dessous de ceux-ci il y avait de nombreux officiers, tous prêtres et généralement de l’ordre des Dominicains. C’étaient des conseillers, des secrétaires, des consulteurs, outre les alguazils qui étaient chargés d’exécuter les ordres de l’inquisition, et les familiers ou serviteurs.
Toute personne attachée à l’Inquisition était liée par le serment le plus solennel à garder le secret sur ce qui se passait dans ses murailles. Tout témoin appelé devant les inquisiteurs, ainsi que tout prisonnier, devait prêter le même serment de ne jamais révéler ce qu’il y avait vu et entendu.
Partout où l’on soupçonnait qu’il y avait des personnes entachées d’hérésie, on envoyait des espions pour tâcher de les découvrir. On corrompait les serviteurs pour qu’ils déposassent contre leurs maîtres ; on s’efforçait d’engager les amis à trahir ceux qui avaient confiance en eux ; on encourageait même les enfants à dénoncer leurs parents au Saint-Office.
Tout garçon de 14 ans et toute fille de 12 ans devaient jurer devant le prêtre, non seulement qu’ils abjuraient toute doctrine contraire à l’Église de Rome, mais qu’ils feraient tout ce qui serait en leur pouvoir pour poursuivre et dénoncer ceux qu’ils sauraient tenir ces doctrines. Deux fois par an, on lisait dans toutes les églises un mandement ordonnant au peuple d’informer les inquisiteurs dans les six jours, des hérétiques qu’ils connaîtraient. Sinon ils pouvaient eux-mêmes être poursuivis comme tels.
Toute personne soupçonnée d’hérésie, qu’elle fût riche ou pauvre, de haute naissance ou simple paysan, prêtre ou laïque, pouvait s’attendre de jour ou de nuit à entendre la voix des alguazils : « Ouvrez, au nom du Saint-Office », et être sommée de comparaître devant le redoutable tribunal avec bien peu ou point d’espoir de revoir sa demeure et sa famille.
Tenter de s’échapper était inutile, car on n’épargnait aucun moyen de saisir les fugitifs, et les agents de l’Inquisition étaient partout ; d’ailleurs la fuite était considérée comme un aveu de culpabilité. Résister n’était pas moins impossible, car l’Inquisition avait en main toute la force armée du royaume, et qui aurait osé aider quelqu’un contre les serviteurs des inquisiteurs ? C’était s’exposer au même châtiment que l’hérétique lui-même
Lorsqu’un prisonnier était traduit devant le tribunal, on ne lui disait jamais de quoi il était accusé, mais on lui ordonnait de confesser ses opinions hérétiques, même s’il ne les avait jamais émises de vive voix à personne et les avait gardées dans ses pensées. Pour l’amener à cette confession, on employait toutes sortes de moyens et de ruses. Ordinairement les juges prétendaient savoir tout ce qui le concernait, mais ils lui disaient que, s’il avouait, on userait d’indulgence envers lui. Quelquefois même on lui promettait le pardon s’il disait tout, promesse rarement, si même jamais tenue. Mentir dans l’intérêt de l’Église n’est pas un péché pour les agents de Rome.
Si la persuasion ne réussissait pas, on employait la torture. Même si le prisonnier avait confessé sa foi, il y était souvent appliqué, afin que les souffrances lui fissent dénoncer ceux qui avaient les mêmes croyances que lui. Les tortures étaient affreuses, trop affreuses pour être décrites. Les membres étaient disloqués, les parties délicates du corps brûlées, etc. Les souffrances que les païens faisaient endurer aux chrétiens des premiers temps, ne dépassaient pas celles que le Saint-Office infligeait à ceux qui comparaissaient devant lui. Le supplice se prolongeait jusqu’à ce que l’on eût obtenu les aveux désirés, où jusqu’au moment où l’on craignait pour la vie de la victime. Combien de fidèles témoins de Christ, hommes et femmes, en Espagne et en d’autres contrées soumises à la cruelle Rome, ont enduré ces souffrances avec une constance héroïque pour l’amour du Seigneur et de la vérité ! « Ils n’ont pas aimé leur vie, même jusqu’à la mort » (Apocalypse 12:11).
Si la torture n’avait pas amené le prisonnier à faire des aveux, on employait la ruse pour en tirer de lui. On plaçait dans la même cellule une personne soi-disant accusée aussi du crime d’hérésie. Celle-ci parlait contre l’Église et l’Inquisition, et cherchait ainsi à obtenir de l’accusé quelque réponse à ses suggestions. On bien quelqu’un venait le voir sous prétexte de lui apporter des consolations. Il affirmait au prisonnier que s’il voulait s’ouvrir à lui, le secret serait bien gardé et qu’il userait de toute son influence pour le faire relâcher. Si le prisonnier ajoutait foi à ces paroles perfides, c’était son arrêt de mort. C’était toujours le même système de mensonge.
Lorsqu’on n’avait pas trouvé contre l’accusé des preuves suffisantes pour le condamner à la mort, ou s’il reconnaissait avoir tenu des doctrines contraires à l’Église de Rome, mais qu’il s’en repentait, il était quelquefois pardonné. Mais sur 2000, avoue un historien papiste, à peine un ou deux furent entièrement absous. Jamais le pardon n’était accordé à ceux que le Seigneur avait employés comme serviteurs de sa Parole. D’ailleurs le pardon ne libérait pas les pénitents, comme on nommait ceux qui se repentaient. Ils subissaient un châtiment plus ou moins rigoureux, plus ou moins prolongé. Ils étaient souvent enfermés pour la vie, soit dans les prisons de l’Inquisition, soit, pour les femmes, dans des couvents. Parfois on les plongeait dans des cachots où jamais la lumière ne pénétrait, ou bien tels que le prisonnier ne pouvait s’y tenir ni debout, ni assis, ni couché.
Quant à ceux contre lesquels deux témoins pouvaient affirmer qu’ils leur avaient entendu proférer des paroles hérétiques, ou ceux qui confessaient tenir des doctrines estimées telles et ne voulaient pas les rétracter, leur punition était la mort par le feu. Mais les inquisiteurs et leurs serviteurs ne prononçaient, ni n’exécutaient eux-mêmes la sentence. Non ; l’Église de Rome a horreur du sang, dit-elle, et défend à ses prêtres de le verser. Quand donc le Saint-Office avait jugé qu’un homme était digne de mort, elle le livrait au bras séculier, c’est-à-dire aux magistrats civils, en recommandant avec hypocrisie de le traiter avec douceur et de ne pas toucher à sa vie. Mais ce n’était qu’une manière de parler, et les magistrats le savaient bien. Ils n’ignoraient pas qu’épargner quelqu’un que l’Inquisition avait condamné, c’était se rendre suspects eux-mêmes, et s’exposer à la vengeance du terrible tribunal. Au contraire, s’ils faisaient brûler le condamné, ils gagnaient l’approbation des prêtres et obtenaient du pape le pardon de leurs péchés. Trois années d’indulgences étaient accordées à tous ceux qui assistaient au supplice des hérétiques.
L’Inquisition avait d’abord sévi en France contre les Albigeois. Elle agit ensuite en Espagne contre les Juifs et les Maures. Les Juifs étaient fort nombreux en Espagne et, sous la domination tolérante des Maures, avaient acquis de grandes richesses. Sous prétexte que les Juifs pervertissaient les chrétiens et qu’ils avaient profané les saintes hosties, mais en réalité, pour s’emparer de leurs biens, le roi Ferdinand ordonna qu’ils se fissent chrétiens ou qu’ils quittassent le royaume. Plusieurs aimèrent mieux s’en aller et abandonner leurs maisons et leurs biens plutôt que de professer une religion qui, pour eux, était une idolâtrie. D’autres consentirent à être baptisés, mais ils haïssaient une religion qu’ils n’avaient embrassée que par crainte, et en secret ils continuaient à pratiquer leurs anciens rites. C’est contre eux que l’Inquisition usa de son pouvoir pour les rechercher et les punir. Des milliers furent brûlés ou subirent d’autres châtiments, et le roi et les inquisiteurs se partagèrent leurs richesses.
Les Maures étaient des Arabes mahométans qui, au 8° siècle, avaient envahi la plus grande partie de l’Espagne et y avaient fondé un royaume florissant. On montre encore des ruines, vestiges de leur ancienne splendeur. Peu à peu, les princes chrétiens qui s’étaient réfugiés dans les montagnes des Asturies, au nord du pays, reconquirent les provinces occupées par les Maures, et les refoulèrent en Afrique. Enfin, Grenade, leur ville capitale, fut prise en 1492 par le roi Ferdinand et sa femme Isabelle, et leur domination prit entièrement fin. Leur dernier roi, Boabdil, alla vivre à Alpujarra dans la retraite. Il avait été stipulé qu’il pourrait demeurer en Espagne et que ceux de ses anciens sujets qui resteraient dans le pays y auraient le libre exercice de leur religion. Au commencement, les Maures furent traités avec douceur. Un évêque, nommé Fray Hernando de Talavera, qui était un vrai chrétien, eut à cœur leur conversion, et renonçant à une situation qui lui valait plus de richesses, il accepta d’être archevêque de Grenade. Il avait compris que le seul moyen d’amener les Maures au christianisme était de leur faire connaître Christ ; il se mit à l’œuvre dans ce but et traduisit pour eux la Bible en arabe. Par son esprit de douceur et sa vie irréprochable, il gagna l’affection des Maures qui l’écoutaient volontiers. Mais cette manière de répandre l’Évangile ne convenait pas aux autres évêques et aux conseillers du roi et de la reine. Fray Hernando dut leur céder et se retirer ; on l’accusa même d’hérésie, mais il fut absous par le pape.
Sous la pression des prêtres qui leur persuadèrent qu’il fallait purger le sol espagnol de tout ce qui n’était pas chrétien, le roi et la reine, malgré les traités, obligèrent l’ancien roi à quitter l’Espagne, et les Maures furent mis dans l’alternative d’être bannis ou de se faire baptiser. Des milliers furent expulsés, et d’autres milliers, gagnés par l’appât de riches récompenses, se laissèrent baptiser. Mais que valaient de semblables conversions ? Le nom de Christ n’en restait pas moins haï par ces soi-disant convertis qui gardaient en secret leurs anciennes coutumes religieuses. Le Saint-Office trouvait là de nombreuses occasions de sévir, quand on lui dénonçait ceux qui secrètement pratiquaient des rites musulmans, et les biens des condamnés revenaient encore au roi et aux inquisiteurs. Quel christianisme que le leur ! Le Seigneur Jésus avait dit à ses disciples : « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre », et aussi : « Aimez vos ennemis ». Était-ce là ce que pratiquaient les membres du Saint-Office et ceux qui les assistaient ?
Mais, après les Juifs et les Maures, quand des âmes, lors de la Réformation, eurent été éclairées et converties au Seigneur par la parole de Dieu et les écrits des réformateurs, ce fut contre elles que l’Inquisition tourna tous ses efforts. En effet, c’était un danger mortel pour l’Église de Rome. Personne n’aurait songé à se faire Juif ou mahométan ; mais la parole de Dieu montrait les erreurs et les abus de l’Église de Rome, et, lorsqu’elle était saisie dans le cœur, elle séparait les âmes fidèles. C’est pourquoi l’Inquisition mit tout en œuvre, les prisons, le fer et le feu, pour étouffer la vérité, en accablant et détruisant ceux qui en étaient les témoins. Elle l’avait fait en des temps précédents et en d’autres contrées, chaque fois que la vérité avait éclairé des âmes et qu’elles l’avaient confessée ; mais c’est en Espagne et au Portugal que la persécution prit un caractère systématique. L’Inquisition n’a été abolie en Espagne que dans les premières années du 19° siècle, mais peut-on dire que l’esprit qui l’a inspirée a pris fin ? Dans le courant d’un siècle (le 16°), en Espagne seulement, sous six différents grands inquisiteurs, plus de 20000 personnes furent brûlées pour cause de religion, et plus de 225000 condamnées à différentes peines ! Et toutes ces cruautés accumulées s’accomplissaient au nom de Celui qui s’est donné Lui-même pour le salut des hommes, et qui disait à Jean et à Jacques demandant à faire descendre le feu du ciel sur des hommes qui ne recevaient pas leur Maître : « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés ! ».
Cette doctrine est aussi contraire à ce que l’Écriture enseigne touchant l’œuvre parfaite de Christ accomplie sur la croix pour notre salut complet et actuel, pour l’entier pardon de tous nos péchés. La parole de Dieu nous dit que Christ a « offert un seul sacrifice pour les péchés », que nous sommes « sanctifiés par l’offrande du corps de Jésus Christ faite une fois pour toutes », que, « par une seule offrande, il a rendu parfaits à perpétuité ceux qui sont sanctifiés », et enfin que Dieu ne se souviendra plus jamais de leurs péchés ni de leurs iniquités » (Hébreux 10:10, 12, 14, 17). Si les croyants sont sanctifiés, rendus parfaits à perpétuité, et si Dieu ne se souvient plus de leurs péchés, qu’ont-ils encore besoin d’un purgatoire ? Dieu veut-il exiger le paiement de péchés dont il ne se souvient plus, qui sont entièrement effacés de devant ses yeux ? De plus, il est dit : « Le sang de Jésus Christ son Fils nous purifie de tout péché » (1 Jean 1:7). S’il faut encore aller dans le purgatoire, cette affirmation de l’Écriture n’est pas vraie : on fait Dieu menteur. Nous lisons aussi : Christ a été « offert une fois pour porter les péchés de plusieurs » (Hébreux 9:28), c’est-à-dire de ceux qui croient, et : « Il a porté nos péchés en son corps sur le bois » (1 Pierre 2:24). Mais si l’on doit souffrir dans le purgatoire, c’est donc que le Christ n’a pas porté tous les péchés, c’est-à-dire que son œuvre est imparfaite et incomplète ! N’est-ce pas un blasphème ? Le fait est que l’Église romaine veut toujours que l’homme ait une part à faire dans l’œuvre du salut, ici-bas ou dans l’autre vie.
Combien nous sommes heureux, de savoir avec une entière certitude que, si nous croyons de cœur au Seigneur Jésus, Dieu nous « a pardonné toutes nos fautes » (Colossiens 2:13), que nous sommes sauvés pleinement, vivifiés avec Christ, ressuscités avec Lui, assis en Lui dans les lieux célestes (Éphésiens 2:5-6) (*), que nous n’avons plus aucune condamnation à redouter (Romains 8:1), que nous sommes lavés, sanctifiés, justifiés, au nom du Seigneur Jésus et par l’Esprit de notre Dieu (1 Corinthiens 6:11), et enfin que, si nous passons par la mort, c’est le Seigneur, et non le purgatoire, qui reçoit notre esprit bienheureux (Actes 7:59).
(*) Telle est l’union intime du croyant avec Christ. Peut-on supposer qu’un homme qui est vivifié et ressuscité avec Christ, assis en Lui dans les lieux célestes, puisse en même temps être dans les souffrances du purgatoire ?
6.3.9 - Les Indulgences
Aux doctrines de la pénitence et du purgatoire se rattache celle des indulgences, entièrement étrangère aussi et contraire aux enseignements de l’Écriture sainte. Mais avant de voir ce que l’on entend par là, rappelons en quelques mots ce que la Parole de Dieu nous dit touchant le salut de notre âme. Elle nous apprend que nous sommes des pécheurs perdus, éloignés de Dieu et ses ennemis dans nos pensées et par nos mauvaises œuvres, privés du ciel et sujets à la condamnation éternelle (Colossiens 1:21 ; Romains 3:23 ; Jean 3:36). Elle nous dit que nous sommes morts dans nos fautes et dans nos péchés, sans force et incapables par nous-mêmes de revenir à Dieu, et qu’en nous il n’habite aucun bien (Éphésiens 2:1 ; Romains 5:6 ; 7:18). Et elle déclare de plus que personne ne sera justifié devant Dieu par des œuvres de loi, car la loi ne fait que manifester, par notre impuissance à l’observer, tout le mal qui est en nous (Romains 3:20).
Comment échapper à la juste condamnation prononcée contre nous ? Il n’y a qu’une unique ressource, nous dit la parole de Dieu. C’est la grâce divine : « Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu ; non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie » (Éphésiens 2:8-9). Le salut vient donc tout entier de Dieu, et il nous est accordé, sans aucun mérite de notre part, à cause de l’œuvre de Christ qui est mort pour nos fautes et a été ressuscité pour notre justification. Ce précieux Sauveur s’est chargé de nos péchés et les a expiés par son sacrifice parfait. C’est en vertu de ce sacrifice que Dieu nous pardonne et nous justifie, ainsi qu’il est écrit : « Étant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, lequel Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang » (Romains 3:24-25). Quelles œuvres pourrions-nous ajouter à l’œuvre parfaite de Christ qui a satisfait Dieu ? Gratuitement ne veut-il pas dire que l’on n’a rien à payer ? Et comment avoir part à la justification, à la rédemption, au salut ? Simplement par la foi, la foi sans aucune œuvre, la foi au sacrifice du Seigneur, la foi en l’efficacité du sang versé sur la croix pour ôter nos péchés. Telle est la voie simple du salut pour le pécheur coupable et perdu.
L’Église romaine enseigne autrement : selon elle, l’homme est capable de faire le bien par lui-même et par conséquent peut et doit accomplir des œuvres propres à lui assurer le salut. Et comme preuve que la foi seule sans les œuvres ne suffit pas au salut, ses docteurs objectent les paroles de Jacques : « La foi sans les œuvres est morte… » et « vous voyez qu’un homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement » (Jacques 2:17-26). Mais Dieu ne peut se contredire : les paroles de l’Esprit Saint données par l’apôtre Paul sont vraies, et celles données par Jacques sont vraies aussi, et les unes s’accordent parfaitement avec les autres. La foi est dans le cœur une puissance vivifiante et purifiante (Actes 15:9). Celui qui croit du cœur au Seigneur Jésus est régénéré, ou né de nouveau. L’Esprit Saint produit en lui une vie nouvelle, et il est rendu capable de faire des œuvres agréables à Dieu, tandis qu’auparavant les œuvres qu’il faisait étaient des œuvres mortes et nullement agréées de Dieu. Les œuvres que le chrétien accomplit sont le fruit et non le moyen du salut ; elles sont la manifestation extérieure de la foi intérieure, de la vie de Dieu dans l’âme. C’est ainsi que Jacques dit qu’un homme n’est pas justifié par la foi seule, mais aussi par les œuvres, parce que celles-ci sont la preuve de la réalité de la foi. Dans une horloge, le ressort qui est caché montre son existence par les mouvements du balancier que l’on voit.
Les œuvres ne nous sauvent donc pas, mais les bonnes œuvres que le chrétien accomplit sont le fruit la grâce et la preuve qu’il est sauvé, que la vie de Dieu est en lui. Nous avons encore sur ce sujet si important le passage suivant : « Quand la bonté de notre Dieu Sauveur et son amour envers les hommes sont apparus, il nous sauva, non sur le principe d’œuvres accomplies en justice, que nous, nous eussions faites, mais selon sa propre miséricorde, par le lavage de la régénération et le renouvellement de l’Esprit Saint, qu’il a répandu richement sur nous par Jésus Christ, notre Sauveur, afin que, ayant été justifiés par sa grâce, nous devinssions héritiers selon l’espérance de la vie éternelle » (Tite 3:4-7). Et ensuite l’apôtre ajoute : « Que ceux qui ont cru Dieu s’appliquent à être les premiers dans les bonnes œuvres » (verset 8). Remarquons encore que les œuvres que le chrétien accomplit, ne sont pas des œuvres qu’il invente ou qu’il choisit ; elles sont le fruit de l’Esprit et, dit l’apôtre, « nous sommes son ouvrage (l’ouvrage de Dieu), ayant été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l’avance, afin que nous marchions en elles » (Galates 5:22 ; Éphésiens 2:10).
Mais l’Église romaine s’est écartée de ce sain enseignement. Les œuvres qu’elle préconise sont des œuvres purement extérieures ; c’est l’observation des rites et cérémonies de l’église, des prières cent fois répétées, des jeûnes, des macérations pour dompter la chair, des pèlerinages en tels ou tels lieux réputés, la fondation d’églises, de chapelles ou de couvents, faire l’aumône, donner tous ses biens, faire vœu de pauvreté, entrer dans un couvent en renonçant au monde, porter un cilice et se flageller ; toutes ces choses et d’autres encore sont considérées comme des œuvres méritoires propres à acquérir des droits au ciel. Voyez, à propos de ces œuvres, ce que l’apôtre Paul dit en Colossiens 2:16-23.
Selon l’Église romaine, plus on accomplissait de ces œuvres que nous avons mentionnées, plus on était saint, plus on était propre pour le ciel, et l’on en vint à croire qu’il existait des personnes qui allaient en sainteté au-delà du nécessaire pour entrer dans le ciel. Comme si l’on pouvait être trop saint aux yeux de Dieu ! Combien cela est loin de ce que dit la parole de Dieu : « Que celui qui est saint soit sanctifié encore » (Apocalypse 22:11). Ce sont ces personnes-là que le pape canonise, c’est-à-dire déclare saintes, et place dans le ciel pour y être invoquées. Mais ce n’est pas tout. Ayant fait plus qu’il ne fallait pour être reçus dans le ciel, les saints ont laissé après eux un reste de mérites qui peuvent être appliqués à d’autres, dit l’Église de Rome. C’est ce qu’elle appelle des mérites surérogatoires, mot qui veut dire au-delà de ce que l’on peut exiger. Mais que dit le Seigneur Jésus ? : « Quand vous aurez fait toutes les choses qui vous ont été commandées, dites : Nous sommes des esclaves inutiles ; car ce que nous étions obligés de faire, nous l’avons fait » (Luc 17:10).
Au 13° siècle, un docteur de l’Église de Rome, nommé Alexandre de Hales, et surnommé le docteur irréfragable, c’est-à-dire qu’on ne peut contredire, inventa une nouvelle doctrine. Il dit que Christ avait fait bien plus qu’il n’était nécessaire pour le salut des hommes. Une seule goutte du sang qu’il a versé suffisait pour cela, et puisqu’il en a versé beaucoup, ajoutait ce docteur, il en reste pour l’Église un trésor de mérites que l’éternité ne saurait épuiser. C’est une doctrine qui n’a aucun fondement dans la parole de Dieu, et qui n’est que le produit des vains raisonnements et de la folle imagination de l’homme. Mais le pape Clément VII l’a déclarée article de foi, et l’Église romaine l’a acceptée comme telle. Ce trésor des mérites de Christ a été augmenté des mérites surérogatoires des saints, et la garde et l’administration en ont été confiées au pape, vicaire de Jésus Christ sur la terre, dit l’Église romaine.
Que faire de ces mérites ? Moyennant des sommes à payer ou certaines pratiques à accomplir, l’église les applique à chaque pécheur dans la mesure que ses péchés nécessitent, et c’est là ce que l’on nomme les indulgences. Les vivants peuvent aussi les acquérir pour abréger les peines temporelles, soit les châtiments dans ce monde, soit ce qu’endurent les âmes dans le purgatoire. N’est-il pas triste de voir les âmes abusées, trompées, par de semblables enseignements ? Peut-on croire que les mérites d’une créature comme nous puissent nous être appliqués pour l’expiation de nos fautes ? Peut-on supposer que d’une manière quelconque, on puisse acheter quelque chose des mérites de notre adorable Sauveur qui a offert une fois pour toutes le sacrifice qui expie tous nos péchés, et qui donne gratuitement le salut et la vie éternelle ? Et quelle prétention terrible de la part d’un homme de se dire le dispensateur de ce qui n’appartient qu’à Christ, de ce que Christ seul donne !
Les indulgences devinrent la source du trafic le plus honteux. Au moyen d’une somme d’argent payée à l’église, on était dispensé de la repentance et des peines de la pénitence. On pouvait ainsi sans remords se livrer au péché. On alla jusqu’à établir une taxe des indulgences, qui indiquait ce qu’il fallait donner pour se racheter de tel ou tel péché, même du plus grossier. On accordait aussi des indulgences à l’accomplissement de tels ou tels actes que l’on faisait considérer comme méritoires. Ainsi une indulgence plénière, c’est-à-dire le pardon de tous les péchés commis, même les crimes les plus grands, avait été promise par le pape Urbain II à tous ceux qui prendraient part à la croisade, c’est-à-dire à l’expédition guerrière destinée à reprendre Jérusalem des mains des Turcs. Une indulgence plénière applicable aux âmes du purgatoire, fut accordée par le pape Pie VII à ceux qui, après la confession et la communion, récitent à genoux devant un crucifix une certaine prière.
Pour faire profiter du trésor des indulgences le plus grand nombre possible de personnes, le pape Boniface VIII, en l’an 1300, publia une bulle annonçant à l’Église qu’un jubilé se célébrerait à Rome tous les cent ans, et qu’à tous ceux qui s’y rendraient, il serait accordé une indulgence plénière, l’absolution de tous leurs péchés. D’innombrables pèlerins se rendirent à Rome de toutes parts, non sans apporter à l’Église de riches offrandes. Cent ans, c’était bien long. On plaça donc les jubilés, d’abord à cinquante ans, puis à trente-trois ans, et enfin à vingt-cinq ans d’intervalle. Et comme un grand nombre ne pouvaient facilement aller à Rome, on transporta sur différentes places de la chrétienté le jubilé et ses indulgences.
Ce trafic des choses saintes arriva au comble le plus honteux à l’époque de la Réformation. Le pape Léon X, homme léger et dissolu, avait besoin d’argent pour satisfaire à ses goûts dispendieux et à ses plaisirs. Pour s’en procurer, sous prétexte de vouloir achever la basilique de Saint-Pierre à Rome et de faire la guerre aux Turcs, il donna un nouvel essor à la vente des indulgences, dont les principaux marchés furent établis en Allemagne et en Suisse. Les scandales qui en résultèrent, l’indignation qu’ils soulevèrent, la manière grossière et impie dont agissaient ceux qui étaient préposés à cette vente, furent une des causes de la Réformation. Nous en reparlerons plus tard.
De nos jours, l’Église romaine applique toujours les indulgences, bien qu’en ayant supprimé les abus les plus grossiers. Ainsi elle accorde des indulgences d’un certain nombre de jours ou d’années, à l’accomplissement de tels ou tels actes, par exemple à des pèlerinages, à des prières récitées devant certains autels, ou adressées à tel saint. Et ces indulgences sont appliquées soit à celui qui les acquiert ainsi pour lui épargner un certain temps de souffrances dans le purgatoire, soit à des personnes défuntes en faveur desquelles ces actes sont accomplis.
Nous avons ainsi vu l’ensemble de ce qui constitue le papisme, ce grand système de doctrines qui cache le vrai christianisme. Nous avons encore à considérer les moyens terribles inventés par l’Église romaine pour tenir les âmes sous sa domination.
6.3.10 - L’Inquisition
L’Inquisition était un tribunal ecclésiastique institué pour rechercher et punir les personnes coupables d’hérésie. Que faut-il entendre par ce mot ? Il signifie en réalité toute doctrine contraire à la parole de Dieu. Mais l’Église romaine appelle de ce nom ce qui est opposé à ses enseignements et à ses pratiques. Ainsi, si quelqu’un niait que le pape eût le pouvoir de pardonner les péchés, ou s’il ne croyait pas à la messe, ou, au purgatoire, ou s’il rejetait quelque autre des traditions de l’église, il était regardé comme un hérétique digne de châtiment.
Comment faut-il agir avec les hérétiques ? La parole de Dieu nous dit simplement qu’il faut les rejeter et n’avoir pas de communication avec eux (Tite 3:10 ; 2 Jean 10), et c’est ce que l’Église faisait au commencement. Mais quand elle se fut écartée de l’enseignement des Écritures, qu’elle y eut ajouté ses traditions et ses ordonnances, et qu’elle se fut érigée en dominatrice des consciences et des cœurs, elle en vint à dire qu’il fallait châtier les hérétiques qui ne voulaient pas renoncer à leurs erreurs, par la perte de leurs biens, par la prison, et enfin par le feu. Elle prétendait s’appuyer sur ce passage : « Contrains-les d’entrer ».
Déjà à la fin du 4° siècle, un nommé Priscillien, chef d’une secte qui portait son nom, fut mis à mort avec quelques-uns de ses disciples pour crime d’hérésie, par ordre de l’empereur Maxime (*). Son principal accusateur était un évêque du nom d’Ithacius. Ambroise de Milan et d’autres évêques jugèrent son action si indigne de sa charge, qu’il fut excommunié et mourut en exil. Ainsi à cette époque, sévir contre les hérétiques était désapprouvé par ce qu’il y avait de meilleur dans l’Église. Nous avons cependant vu, par exemple, dans l’histoire de Chrysostôme et d’autres, avec quelle rigueur on traitait ceux qui ne suivaient pas les opinions religieuses des empereurs.
(*) Priscillien était un véritable hérétique. Sa doctrine se rapprochait de celle des Manichéens ; mais ce n’était pas une raison pour le faire mourir.
Au 6° siècle, l’empereur Justinien édicta des pénalités contre les hérétiques, les Juifs et les apostats. Mais c’étaient des officiers civils qui poursuivaient les délinquants. Les cas d’hérésie étaient portés devant les tribunaux ordinaires. Plus tard les évêques furent investis du droit d’examiner ceux qui étaient accusés d’hérésie. S’ils ne renonçaient pas à leurs erreurs, vraies ou prétendues, ils étaient livrés au pouvoir civil pour être punis ; mais la poursuite des hérétiques ne se faisait pas d’une manière générale et l’on jugeait d’après les décisions des conciles.
Ce fut vers la fin du 12° siècle que des mesures rigoureuses et plus générales furent prises pour rechercher et punir ceux que l’Église de Rome appelait hérétiques, et ce fut à l’occasion de l’hérésie des Albigeois répandus en grand nombre dans le midi de la France et ailleurs. Nous en parlerons plus tard.
Le Saint-Siège, comme on appelle le siège épiscopal de Rome, sentait son autorité menacée par les progrès de cette hérésie. Aussi le pape Alexandre, en 1163, convoqua un concile à Tours. Voici une des décisions de cette assemblée : « À cause des hérésies existant à Toulouse et ailleurs, nous ordonnons aux évêques et à tous les prêtres du Seigneur demeurant dans ces lieux-là de veiller et sous peine d’anathème, de défendre que là où des partisans de ces hérésies sont connus, nul dans le pays n’ose leur donner asile, ni ne leur prête une aide quelconque. On ne doit avoir aucune relation avec ces personnes, ni pour vendre, ni pour acheter, afin que tout soulagement et toute marque d’humanité leur étant refusés, elles soient forcées d’abandonner l’erreur de leur vie. Et quiconque tentera de contrevenir à ce commandement, sera frappé d’anathème comme participant à leur iniquité. Quant aux hérétiques, s’ils sont pris, ils seront jetés en prison par les princes catholiques et privés de tous leurs biens ». Voilà comment parlaient les évêques de Jésus Christ chargés de paître les brebis ! Toute réunion, des hérétiques était strictement défendue. On remarquera que non seulement les hérétiques étaient punis par la prison, mais que leurs biens étaient confisqués. Une part allait aux princes, une autre à l’église, et cela devint, pour les hommes avides, un terrible stimulant à porter des accusations contre les personnes riches.
Le pape Innocent III (de 1198 à 1216) déploya le plus grand zèle pour extirper tout ce qui était tenu pour hérésie. Il convoqua, en 1215, le quatrième concile de Latran, où furent passés de nouveaux et rigoureux décrets contre ceux qui différaient, non seulement des conciles généraux, mais de l’Église de Rome. Les évêques devaient être les juges. Dans ce concile il fut décrété : « Les personnes notées seulement comme suspectes d’hérésie, à moins qu’elles n’aient pu se justifier elles-mêmes, seront frappées du glaive de l’anathème, et chacun devra les éviter. Si elles persistent pendant une année sous l’excommunication, elles seront condamnées comme hérétiques ». Ainsi se resserrait le filet destiné à prendre et à détruire les hérétiques. Bientôt le système prit sa forme définitive.
Au concile de Toulouse, en 1229, il fut décidé qu’une Inquisition permanente serait établie pour rechercher les hérétiques. Mais ce ne fut qu’en 1233, quand le pape Grégoire IX eut ôté aux évêques le pouvoir de punir ceux qui étaient coupables d’hérésie, et qu’il l’eut donné aux Dominicains, que l’Inquisition prit la forme d’un tribunal distinct. On le nomma le Saint-Office, et ses officiers furent appelés Inquisiteurs de la foi.
Avant d’aller plus loin, disons qui étaient les Dominicains. Un jeune prêtre espagnol, nommé Dominique de Guzman, né en 1170, se distinguait par son éloquence, sa piété, son ascétisme et son dévouement à la cause de l’Église romaine. En vue de la défendre contre les hérétiques, il fonda à Toulouse l’ordre des frères prêcheurs qui, d’après lui, furent nommés Dominicains. Bien que Dominique prétendît qu’il ne fallait employer contre les hérétiques d’autres armes que la prière, la persuasion et l’exemple, il accepta la charge d’inquisiteur, et comme tel persécuta les Albigeois avec la plus grande cruauté. Son emblème était un chien portant dans sa gueule une torche enflammée et brûlant le monde. Emblème frappant de ce qu’il fut car sa vie se passa à pourchasser les hérétiques et à les faire brûler. Il fut canonisé en 1234, et est ainsi un des saints que l’Église romaine invoque et prie ! L’apôtre Paul disait : « Je ne suis pas digne d’être appelé apôtre, parce que j’ai persécuté l’Église de Dieu ». Dominique, lui, a passé sa vie à persécuter des chrétiens, et à cause de cela l’Église de Rome a fait de lui un saint, et a inscrit son nom comme tel dans le calendrier. Mais à moins qu’avant sa mort il ne se soit repenti de ses cruautés et n’ait imploré le pardon de Christ — ce que nous ignorons — son nom ne saurait être inscrit parmi les saints de Dieu. Les Dominicains sont vêtus d’une robe blanche avec un capuchon noir. Ils s’engagent par serment à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour défendre l’église et le pape et pour détruire l’hérésie. Le pape leur donna son approbation et les nomma « les vraies lumières du monde », tristes et terribles lumières que celles que projetaient les bûchers qu’ils allumèrent pour consumer de soi-disant hérétiques !
Bien que, dans toutes les contrées de l’Europe occidentale, le fanatisme des prêtres ait fait brûler par le pouvoir civil ceux qu’ils disaient hérétiques, l’établissement de l’Inquisition rencontra une forte opposition dans plusieurs États. C’est en Espagne et au Portugal, ainsi que dans les contrées qui étaient soumises à ces royaumes, que le terrible tribunal fut érigé d’une manière permanente et fonctionna avec une rigueur cruelle durant près de six cents ans, n’ayant été aboli qu’au commencement du 19° siècle.
Nous dirons maintenant quelques mots sur l’organisation du Saint-Office et sur la manière dont il procédait. Dans chaque contrée où l’Inquisition était établie, il y avait un Inquisiteur général. C’était toujours quelque haut dignitaire ecclésiastique qui dépendait du pape seul. Ni roi, ni prince, ni gouverneur n’avait autorité sur lui. Il nommait d’autres inquisiteurs pour chaque province où leur œuvre devait être poursuivie. Au-dessous de ceux-ci il y avait de nombreux officiers, tous prêtres et généralement de l’ordre des Dominicains. C’étaient des conseillers, des secrétaires, des consulteurs, outre les alguazils qui étaient chargés d’exécuter les ordres de l’inquisition, et les familiers ou serviteurs.
Toute personne attachée à l’Inquisition était liée par le serment le plus solennel à garder le secret sur ce qui se passait dans ses murailles. Tout témoin appelé devant les inquisiteurs, ainsi que tout prisonnier, devait prêter le même serment de ne jamais révéler ce qu’il y avait vu et entendu.
Partout où l’on soupçonnait qu’il y avait des personnes entachées d’hérésie, on envoyait des espions pour tâcher de les découvrir. On corrompait les serviteurs pour qu’ils déposassent contre leurs maîtres ; on s’efforçait d’engager les amis à trahir ceux qui avaient confiance en eux ; on encourageait même les enfants à dénoncer leurs parents au Saint-Office.
Tout garçon de 14 ans et toute fille de 12 ans devaient jurer devant le prêtre, non seulement qu’ils abjuraient toute doctrine contraire à l’Église de Rome, mais qu’ils feraient tout ce qui serait en leur pouvoir pour poursuivre et dénoncer ceux qu’ils sauraient tenir ces doctrines. Deux fois par an, on lisait dans toutes les églises un mandement ordonnant au peuple d’informer les inquisiteurs dans les six jours, des hérétiques qu’ils connaîtraient. Sinon ils pouvaient eux-mêmes être poursuivis comme tels.
Toute personne soupçonnée d’hérésie, qu’elle fût riche ou pauvre, de haute naissance ou simple paysan, prêtre ou laïque, pouvait s’attendre de jour ou de nuit à entendre la voix des alguazils : « Ouvrez, au nom du Saint-Office », et être sommée de comparaître devant le redoutable tribunal avec bien peu ou point d’espoir de revoir sa demeure et sa famille.
Tenter de s’échapper était inutile, car on n’épargnait aucun moyen de saisir les fugitifs, et les agents de l’Inquisition étaient partout ; d’ailleurs la fuite était considérée comme un aveu de culpabilité. Résister n’était pas moins impossible, car l’Inquisition avait en main toute la force armée du royaume, et qui aurait osé aider quelqu’un contre les serviteurs des inquisiteurs ? C’était s’exposer au même châtiment que l’hérétique lui-même
Lorsqu’un prisonnier était traduit devant le tribunal, on ne lui disait jamais de quoi il était accusé, mais on lui ordonnait de confesser ses opinions hérétiques, même s’il ne les avait jamais émises de vive voix à personne et les avait gardées dans ses pensées. Pour l’amener à cette confession, on employait toutes sortes de moyens et de ruses. Ordinairement les juges prétendaient savoir tout ce qui le concernait, mais ils lui disaient que, s’il avouait, on userait d’indulgence envers lui. Quelquefois même on lui promettait le pardon s’il disait tout, promesse rarement, si même jamais tenue. Mentir dans l’intérêt de l’Église n’est pas un péché pour les agents de Rome.
Si la persuasion ne réussissait pas, on employait la torture. Même si le prisonnier avait confessé sa foi, il y était souvent appliqué, afin que les souffrances lui fissent dénoncer ceux qui avaient les mêmes croyances que lui. Les tortures étaient affreuses, trop affreuses pour être décrites. Les membres étaient disloqués, les parties délicates du corps brûlées, etc. Les souffrances que les païens faisaient endurer aux chrétiens des premiers temps, ne dépassaient pas celles que le Saint-Office infligeait à ceux qui comparaissaient devant lui. Le supplice se prolongeait jusqu’à ce que l’on eût obtenu les aveux désirés, où jusqu’au moment où l’on craignait pour la vie de la victime. Combien de fidèles témoins de Christ, hommes et femmes, en Espagne et en d’autres contrées soumises à la cruelle Rome, ont enduré ces souffrances avec une constance héroïque pour l’amour du Seigneur et de la vérité ! « Ils n’ont pas aimé leur vie, même jusqu’à la mort » (Apocalypse 12:11).
Si la torture n’avait pas amené le prisonnier à faire des aveux, on employait la ruse pour en tirer de lui. On plaçait dans la même cellule une personne soi-disant accusée aussi du crime d’hérésie. Celle-ci parlait contre l’Église et l’Inquisition, et cherchait ainsi à obtenir de l’accusé quelque réponse à ses suggestions. On bien quelqu’un venait le voir sous prétexte de lui apporter des consolations. Il affirmait au prisonnier que s’il voulait s’ouvrir à lui, le secret serait bien gardé et qu’il userait de toute son influence pour le faire relâcher. Si le prisonnier ajoutait foi à ces paroles perfides, c’était son arrêt de mort. C’était toujours le même système de mensonge.
Lorsqu’on n’avait pas trouvé contre l’accusé des preuves suffisantes pour le condamner à la mort, ou s’il reconnaissait avoir tenu des doctrines contraires à l’Église de Rome, mais qu’il s’en repentait, il était quelquefois pardonné. Mais sur 2000, avoue un historien papiste, à peine un ou deux furent entièrement absous. Jamais le pardon n’était accordé à ceux que le Seigneur avait employés comme serviteurs de sa Parole. D’ailleurs le pardon ne libérait pas les pénitents, comme on nommait ceux qui se repentaient. Ils subissaient un châtiment plus ou moins rigoureux, plus ou moins prolongé. Ils étaient souvent enfermés pour la vie, soit dans les prisons de l’Inquisition, soit, pour les femmes, dans des couvents. Parfois on les plongeait dans des cachots où jamais la lumière ne pénétrait, ou bien tels que le prisonnier ne pouvait s’y tenir ni debout, ni assis, ni couché.
Quant à ceux contre lesquels deux témoins pouvaient affirmer qu’ils leur avaient entendu proférer des paroles hérétiques, ou ceux qui confessaient tenir des doctrines estimées telles et ne voulaient pas les rétracter, leur punition était la mort par le feu. Mais les inquisiteurs et leurs serviteurs ne prononçaient, ni n’exécutaient eux-mêmes la sentence. Non ; l’Église de Rome a horreur du sang, dit-elle, et défend à ses prêtres de le verser. Quand donc le Saint-Office avait jugé qu’un homme était digne de mort, elle le livrait au bras séculier, c’est-à-dire aux magistrats civils, en recommandant avec hypocrisie de le traiter avec douceur et de ne pas toucher à sa vie. Mais ce n’était qu’une manière de parler, et les magistrats le savaient bien. Ils n’ignoraient pas qu’épargner quelqu’un que l’Inquisition avait condamné, c’était se rendre suspects eux-mêmes, et s’exposer à la vengeance du terrible tribunal. Au contraire, s’ils faisaient brûler le condamné, ils gagnaient l’approbation des prêtres et obtenaient du pape le pardon de leurs péchés. Trois années d’indulgences étaient accordées à tous ceux qui assistaient au supplice des hérétiques.
L’Inquisition avait d’abord sévi en France contre les Albigeois. Elle agit ensuite en Espagne contre les Juifs et les Maures. Les Juifs étaient fort nombreux en Espagne et, sous la domination tolérante des Maures, avaient acquis de grandes richesses. Sous prétexte que les Juifs pervertissaient les chrétiens et qu’ils avaient profané les saintes hosties, mais en réalité, pour s’emparer de leurs biens, le roi Ferdinand ordonna qu’ils se fissent chrétiens ou qu’ils quittassent le royaume. Plusieurs aimèrent mieux s’en aller et abandonner leurs maisons et leurs biens plutôt que de professer une religion qui, pour eux, était une idolâtrie. D’autres consentirent à être baptisés, mais ils haïssaient une religion qu’ils n’avaient embrassée que par crainte, et en secret ils continuaient à pratiquer leurs anciens rites. C’est contre eux que l’Inquisition usa de son pouvoir pour les rechercher et les punir. Des milliers furent brûlés ou subirent d’autres châtiments, et le roi et les inquisiteurs se partagèrent leurs richesses.
Les Maures étaient des Arabes mahométans qui, au 8° siècle, avaient envahi la plus grande partie de l’Espagne et y avaient fondé un royaume florissant. On montre encore des ruines, vestiges de leur ancienne splendeur. Peu à peu, les princes chrétiens qui s’étaient réfugiés dans les montagnes des Asturies, au nord du pays, reconquirent les provinces occupées par les Maures, et les refoulèrent en Afrique. Enfin, Grenade, leur ville capitale, fut prise en 1492 par le roi Ferdinand et sa femme Isabelle, et leur domination prit entièrement fin. Leur dernier roi, Boabdil, alla vivre à Alpujarra dans la retraite. Il avait été stipulé qu’il pourrait demeurer en Espagne et que ceux de ses anciens sujets qui resteraient dans le pays y auraient le libre exercice de leur religion. Au commencement, les Maures furent traités avec douceur. Un évêque, nommé Fray Hernando de Talavera, qui était un vrai chrétien, eut à cœur leur conversion, et renonçant à une situation qui lui valait plus de richesses, il accepta d’être archevêque de Grenade. Il avait compris que le seul moyen d’amener les Maures au christianisme était de leur faire connaître Christ ; il se mit à l’œuvre dans ce but et traduisit pour eux la Bible en arabe. Par son esprit de douceur et sa vie irréprochable, il gagna l’affection des Maures qui l’écoutaient volontiers. Mais cette manière de répandre l’Évangile ne convenait pas aux autres évêques et aux conseillers du roi et de la reine. Fray Hernando dut leur céder et se retirer ; on l’accusa même d’hérésie, mais il fut absous par le pape.
Sous la pression des prêtres qui leur persuadèrent qu’il fallait purger le sol espagnol de tout ce qui n’était pas chrétien, le roi et la reine, malgré les traités, obligèrent l’ancien roi à quitter l’Espagne, et les Maures furent mis dans l’alternative d’être bannis ou de se faire baptiser. Des milliers furent expulsés, et d’autres milliers, gagnés par l’appât de riches récompenses, se laissèrent baptiser. Mais que valaient de semblables conversions ? Le nom de Christ n’en restait pas moins haï par ces soi-disant convertis qui gardaient en secret leurs anciennes coutumes religieuses. Le Saint-Office trouvait là de nombreuses occasions de sévir, quand on lui dénonçait ceux qui secrètement pratiquaient des rites musulmans, et les biens des condamnés revenaient encore au roi et aux inquisiteurs. Quel christianisme que le leur ! Le Seigneur Jésus avait dit à ses disciples : « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre », et aussi : « Aimez vos ennemis ». Était-ce là ce que pratiquaient les membres du Saint-Office et ceux qui les assistaient ?
Mais, après les Juifs et les Maures, quand des âmes, lors de la Réformation, eurent été éclairées et converties au Seigneur par la parole de Dieu et les écrits des réformateurs, ce fut contre elles que l’Inquisition tourna tous ses efforts. En effet, c’était un danger mortel pour l’Église de Rome. Personne n’aurait songé à se faire Juif ou mahométan ; mais la parole de Dieu montrait les erreurs et les abus de l’Église de Rome, et, lorsqu’elle était saisie dans le cœur, elle séparait les âmes fidèles. C’est pourquoi l’Inquisition mit tout en œuvre, les prisons, le fer et le feu, pour étouffer la vérité, en accablant et détruisant ceux qui en étaient les témoins. Elle l’avait fait en des temps précédents et en d’autres contrées, chaque fois que la vérité avait éclairé des âmes et qu’elles l’avaient confessée ; mais c’est en Espagne et au Portugal que la persécution prit un caractère systématique. L’Inquisition n’a été abolie en Espagne que dans les premières années du 19° siècle, mais peut-on dire que l’esprit qui l’a inspirée a pris fin ? Dans le courant d’un siècle (le 16°), en Espagne seulement, sous six différents grands inquisiteurs, plus de 20000 personnes furent brûlées pour cause de religion, et plus de 225000 condamnées à différentes peines ! Et toutes ces cruautés accumulées s’accomplissaient au nom de Celui qui s’est donné Lui-même pour le salut des hommes, et qui disait à Jean et à Jacques demandant à faire descendre le feu du ciel sur des hommes qui ne recevaient pas leur Maître : « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés ! ».
 Re: L’ÉGLISE : UNE ESQUISSE DE SON HISTOIRE PENDANT VINGT SIÈCLES
Re: L’ÉGLISE : UNE ESQUISSE DE SON HISTOIRE PENDANT VINGT SIÈCLES
7 - Les Témoins de la vérité pendant les siècles de ténèbres
7.1 - Les témoins de la vérité au Moyen Âge
Il était nécessaire de présenter les erreurs fatales qui caractérisent l’Église de Rome, parce que nous vivons au milieu d’elle, et qu’il importe pour nous de voir combien, tout en assumant le nom de chrétienne, elle s’est écartée des enseignements de Christ et des apôtres. Elle a annulé, par son idolâtrie, le culte qui ne doit être rendu qu’à Dieu et à son Fils, et a mis à la place du salut par la grâce de Dieu, le salut par des œuvres qui ne peuvent justifier le pécheur. Et il est non moins important d’être mis en garde contre elle, par le fait qu’elle a beaucoup d’attraits pour le cœur naturel par une apparence religieuse qui répond à certains besoins de l’âme, par son culte pompeux qui parle aux sens, et par une certaine piété et souvent un grand dévouement chez plusieurs de ses membres. Mais, dit l’apôtre, « la pensée de la chair est inimitié contre Dieu » (Rom. 8:7), et les ordonnances selon les enseignements et les commandements des hommes n’ont qu’une apparence de sagesse en dévotion volontaire et en humilité, en ce qu’elles n’épargnent pas le corps ; mais c’est pour la satisfaction de la chair (Colossiens 2:21-23). De plus, cette Église se présente comme revêtue d’une autorité qu’elle assume faussement, il est vrai, mais qui convient à la paresse de beaucoup d’âmes. Et c’est ainsi qu’elle « séduit, entraîne et égare ».
Nous n’avons parlé que très peu de cette autre grande fraction de la chrétienté qui s’appelle l’église orthodoxe grecque. Les patriarches (c’est-à-dire les principaux prélats) des églises de l’Orient, et spécialement celui de Constantinople, ne voulurent jamais reconnaître la suprématie du pape de Rome. De là vint une séparation qu’on appelle « le schisme oriental », et qui fut consommée en 1054. Au 19° siècle, la plus nombreuse partie de l’Église grecque se trouvait en Russie, soumise au tsar qui la gouvernait par un synode dont il nommait les membres. Mais l’Église grecque est aussi idolâtre que l’Église romaine. Si elle rejette les images sculptées, elle a ses icônes ou images peintes des saints, de la Vierge, du Seigneur, et même de Dieu le Père ! Elles sont répandues partout, depuis la hutte du pauvre paysan, jusqu’aux palais des grands, et malheur à qui ne les révère pas ! Les fausses doctrines de la transsubstantiation, des prières pour les morts et d’autres, existent là comme dans l’Église romaine, et là aussi c’est le clergé qui domine sur les consciences.
Il faut reconnaître que soit l’une, soit l’autre, de ces deux grandes églises rivales, envoyèrent des missionnaires dans les contrées encore païennes de l’Europe du centre et du nord, et en d’autres pays. C’étaient en général des moines, hommes pieux, dont on ne peut méconnaître le courage et le dévouement, et dont plusieurs aimaient vraiment le Seigneur. Nous avons mentionné quelques-uns d’entre eux. Le nom de Jésus Christ fut ainsi peu à peu porté chez tous les peuples de l’Europe qui ne le connaissaient pas encore. Mais Rome imposa aux nations qu’elle évangélisa ainsi, son autorité avec sa hiérarchie, ses formes religieuses et ses superstitions, et l’Église grecque ne fit pas autrement. De plus, on ne chercha pas la conversion du cœur chez ceux qu’on évangélisait. Ceux qui y consentaient étaient baptisés, et ils étaient chrétiens ! Souvent c’était par la force des armes qu’on forçait les peuples à se faire chrétiens par le baptême. D’autres fois, c’était le roi d’un pays qui, par politique, abandonnait le paganisme, et persuadait ou obligeait son peuple à le suivre. Les païens laissaient leurs idoles et leur culte pour d’autres idoles et d’autres cérémonies. L’Europe fut ainsi christianisée, c’est-à-dire devint chrétienne de nom. L’Église devint ce grand arbre dont parle le Seigneur en Matthieu 13, d’une grande apparence, mais abritant dans son opulent feuillage toutes sortes de choses mauvaises. Et c’est ce que nous voyons actuellement. Et dans ce monde ainsi christianisé, si quelqu’un veut être sauvé, il faut qu’il soit vraiment converti, tout comme s’il eût été païen, et qu’il quitte le chemin large de la simple profession chrétienne, pour entrer par la porte étroite du salut, la foi au Seigneur Jésus Christ.
Il faut encore dire qu’outre ces missionnaires dont nous parlions, il y eut dans l’Église romaine, durant les siècles d’obscurcissement du Moyen Âge, des hommes vraiment pieux. Nous en citerons deux des plus remarquables. L’un fut Anselme, qui vécut dans la seconde moitié du 11° siècle, et fut archevêque de Canterbury en Angleterre. Il écrivit, entre autres, un traité sur la Rédemption avec ce titre : « Pourquoi Dieu s’est-il fait homme ? ». Il y enseigne que le Fils de Dieu est devenu un homme, afin de souffrir à la place du pécheur pour satisfaire à la justice de Dieu. « Par sa mort », dit-il, « le Fils de Dieu offrit une satisfaction d’un prix infini, et par là même suffisante pour couvrir les péchés de toute l’humanité ». Et il exhortait les mourants à regarder uniquement aux mérites de Jésus Christ.
Le second de ces hommes distingués est Bernard de Clairvaux, ainsi nommé parce qu’il fut abbé du monastère de ce nom. Il vivait dans la première moitié du 12° siècle, et avait été élevé par une mère pieuse, dont les enseignements le gardèrent loin des plaisirs du monde. Dès l’âge de vingt-deux ans, il entra dans la vie monastique et devint bientôt célèbre par sa puissante éloquence et son activité infatigable. Il acquit ainsi une grande influence dans l’Église, parlant avec hardiesse aux grands de la terre comme aux petits. Il était d’ailleurs d’une charité inépuisable envers les pauvres. Il aimait la Bible et en faisait sa lecture favorite, et, pour lui, ni jeûnes, ni pénitences, ne sauvaient le pécheur, mais Christ seul. Il était aussi poète, et composa plusieurs hymnes latines. L’une d’elle en particulier nous montre l’amour qu’il avait pour Jésus. On l’a traduite, mais bien imparfaitement, en français ; en voici deux strophes :
Chef (*) couvert de blessures,
Tout meurtri, tout en sang,
Chef accablé d’injures,
D’opprobres, de tourments ;
Chef, des gloires divines
Autrefois couronné,
C’est maintenant d’épines
Que ton front est orné.
Ah ! pour ton agonie,
Pour tes grandes douleurs,
Je veux toute ma vie
Te bénir, mon Sauveur !
Ta grâce est éternelle,
Et rien, jusqu’à la fin,
Ne pourra, cœur fidèle,
Me ravir de ta main.
(*) Chef signifie ici tête
Mais avec leur piété, leur charité, leur dévouement, ces hommes, et d’autres tels qu’eux, ne soutenaient pas moins l’Église romaine, ses erreurs et ses superstitions. On se rappelle ce que saint Bernard disait relativement à la Vierge : « Si tu es effrayé de la majesté de Jésus, recours à Marie ! » Et il sévissait avec rigueur contre de prétendus hérétiques, car c’est ainsi qu’il nommait ceux qui, s’attachant à la parole de Dieu, se séparaient de Rome.
Il est vrai que bien des hommes pieux de l’Église romaine déploraient et dénonçaient les vices du clergé, des moines et des papes, et cherchaient à les réformer. Ils s’efforçaient de corriger les mœurs dissolues des moines en introduisant dans les couvents des règles sévères, et en fondant de nouveaux ordres. Mais ce n’était pas couper le mal à la racine. Les nouveaux ordres monacaux, tels que les franciscains et les dominicains, ne firent que fortifier, par l’appui qu’ils lui prêtèrent, l’autorité de l’Église de Rome, et, sous différents noms, les diverses congrégations, en une certaine mesure, dominèrent et dominent encore le chef même de l’église, le pape.
Dans ces ténèbres d’erreur et de superstition, et sous cette domination du clergé, que devenait la vérité de Dieu, qu’il avait donnée aux hommes ? Cette vérité ne peut jamais périr, et Dieu eut toujours des témoins pour la maintenir. Mais ce fut au milieu et au prix de beaucoup de souffrances, car l’Église romaine les poursuivait partout, ne pouvant supporter qu’on se dérobât à son autorité. Dans l’état de choses représenté par l’assemblée de Thyatire, ils étaient ceux dont le Seigneur reconnaissait les œuvres, la foi, l’amour, le service et la patience, le résidu qui ne suivait pas la doctrine de Jésabel et ne connaissait pas les profondeurs de Satan (Apocalypse 2:19, 24).
Il y avait bien, dans quelque cellule d’un couvent, un moine ou une nonne qui déplorait la corruption de l’église, et se réfugiait comme consolation auprès du Sauveur qu’il aimait. Tel, par exemple, ce pauvre chartreux qui écrit sa confession en ces termes. « Ô Dieu très charitable ! Je sais que je ne puis être sauvé et satisfaire ta justice autrement que par le mérite, la passion très innocente et la mort de ton Fils bien-aimé. — Pieux Jésus ! tout mon salut est dans tes mains. Tu ne peux détourner de moi les mains de ton amour, car elles m’ont créé, formé et racheté. Tu as inscrit mon nom d’un style de fer, avec une grande miséricorde et d’une manière ineffaçable, etc ». Et il ajouta : « Si je ne puis confesser ces choses de la langue, je les confesse du moins de la plume et du cœur ». Puis il plaça sa confession dans une boîte de bois qu’il renferma dans un trou fait à la muraille de sa cellule. Plusieurs siècles après, en 1776, on abattit un corps de logis qui avait fait partie de ce couvent, et on trouva la confession du frère Martin. Un autre adressait chaque jour au Seigneur cette prière : « Ô mon Seigneur Jésus Christ ! Je crois que tu es seul ma rédemption et ma justice ». N’est-il pas doux de penser que le Seigneur, dans ces temps ténébreux, avait des âmes cachées pour qui il était leur trésor ? Mais elles demeuraient silencieuses et soumises, et gardaient pour elles-mêmes la lumière intérieure qui illuminait et réjouissait leur cœur.
Mais il y eut d’autres fidèles qui ne craignirent pas de confesser hautement leur foi, rompant avec l’erreur et s’attachant uniquement à la parole de Dieu. Ils forment une ligne non interrompue de témoins jusqu’aux jours de la Réformation. C’est d’eux que nous avons à nous occuper maintenant.
7.2 - Les Pauliciens
Voici quelle fut l’origine de la secte à laquelle on donna ce nom. Vers l’an 660, vivait près de Samosate, ville sur l’Euphrate en Arménie, dans un bourg nommé Mananalis, un homme respectable du nom de Constantin. Les écrivains catholiques romains le représentent comme ayant adopté certaines doctrines manichéennes, mais d’autres disent qu’il appartenait à l’Église grecque. C’était au temps où les sectateurs de Mahomet s’étaient emparés de la Syrie. Un jour se présenta chez Constantin un diacre de l’église arménienne qui avait été fait prisonnier par les Sarrasins (*), mais qui avait réussi à recouvrer sa liberté. Constantin l’accueillit, le garda quelques jours chez lui, et le diacre, en le quittant, lui donna en retour de son hospitalité, deux manuscrits contenant l’un, les quatre évangiles, et l’autre, les quatorze épîtres de Paul. C’était pour ces temps où les manuscrits des Écritures étaient rares et chers, un riche et précieux présent. Par ce don nous pouvons juger de la nature des conversations que Constantin avait eues avec son hôte. Constantin lut et étudia les saints livres, et la lumière de la vérité pénétra dans son âme. Il brûla ses mauvais livres, et ne voulut plus en étudier d’autres que les évangiles et les épîtres. Ses principes religieux et sa vie tout entière furent changés. « De l’abondance du cœur la bouche parle » : Constantin commença à communiquer à d’autres ce que Dieu lui avait appris par sa Parole, et des disciples se réunirent autour de lui. Il avait vu dans les Actes et dans les Épîtres ce qu’étaient les églises au commencement, et il désirait y revenir. Par là il rejetait nécessairement et la hiérarchie qui dominait l’Église grecque aussi bien que la romaine (**), et les erreurs de ces deux églises, surtout l’adoration des saints et de la Vierge.
(*) Ce mot vient de Saraceni, tribu nomade de l’Arabie, une des premières à embrasser l’islam, et qui faisait la principale force des armées arabes musulmanes.
(**) À cette époque, du reste, le schisme entre l’Église grecque orthodoxe et l’Église romaine n’était pas consommé (il le sera seulement en 1054), mais les Églises avaient leur particularités, et ne supportaient pas l’autorité du pape romain.
Constantin alla se fixer à Cibossa, autre ville d’Arménie, et de là il travailla avec ses disciples à répandre les vérités que Dieu lui avait fait connaître. Ses ennemis l’ont accusé de rejeter l’Ancien Testament et certaines parties du Nouveau. Cette calomnie a eu sans doute son fondement dans le fait qu’il ne possédait, comme nous l’avons vu, qu’une partie du Nouveau Testament. Peut-être à cause de cela et de ses primitives croyances, se mêla-t-il quelques erreurs à son enseignement.
Constantin prit le nom de Silvain, le compagnon de Paul (1 Thessaloniciens 1:1), et ses disciples, associés à son œuvre, empruntèrent à leur tour de nouveaux noms aux autres compagnons de l’apôtre, tels que Timothée, Tite et Tychique. Ils prenaient ces noms, parce qu’ils s’attachaient à répandre la doctrine contenue dans les écrits de Paul, et c’est aussi probablement d’après lui qu’ils reçurent le nom de Pauliciens.
Silvain, comme nous l’avons dit, s’était établi à Cibossa. En y arrivant, il avait dit aux habitants : « Je suis Silvain et vous êtes les Macédoniens », faisant allusion aux travaux de Silvain (ou Silas), en Macédoine, à Philippes et à Thessalonique (Actes 15:40 ; 16:19, 25 ; 17:1-4, etc. ; 18:5). Pendant vingt sept ans, Silvain travailla avec un zèle infatigable à annoncer ce qu’il avait appris dans les Écritures. Un grand nombre de personnes, soit de l’Église grecque, soit des sectateurs de Zoroastre (*), furent converties par son moyen, et des congrégations furent établies en divers endroits tant par lui que par ses disciples.
(*) Zoroastre, fondateur ou réformateur de l’ancienne religion des Perses, que l’on nomme Mazdéisme. Elle enseigne la co-existence de deux principes éternels : l’un est Ormuzd, le bien, le vrai, la lumière, représenté par le soleil ; l’autre Ahriman, le mal et les ténèbres, en guerre avec Ormuzd qui finira par le vaincre. C’est au soleil comme représentant Ormuzd, que les sectateurs de Zoroastre rendaient leurs hommages. Partout ils élevaient des autels sur lesquels brûlait le feu sacré. Sous le nom de Guèbres ou de Parsis, se trouvent encore dans l’Inde un certain nombre d’adorateurs du soleil.
Les progrès de la nouvelle secte furent tels qu’elle attira sur elle l’attention des autorités ecclésiastiques, et ce fut sans doute le clergé qui porta la chose devant l’empereur. Celui-ci rendit en l’an 684 un édit contre Constantin et les assemblées pauliciennes. L’exécution en fut confiée à un officier de la cour nommé Siméon, qui reçut en même temps l’ordre de faire mettre à mort le chef de la secte, et de reléguer ses partisans dans des cloîtres et sous les soins du clergé, afin de les ramener dans le bon chemin. Arrivé à Cibossa, Siméon fit comparaître devant lui Constantin et un grand nombre de ses disciples. Puis il ordonna à ceux-ci, sous peine de la vie, de lapider leur maître. Mais tous, à l’exception d’un seul, nommé Justus, refusèrent d’obéir à cet ordre cruel, et laissèrent tomber les pierres dont on les avait armés. Ce Justus avait été adopté et élevé par Constantin, et l’ingrat, d’un coup de pierre, tua son bienfaiteur. Les autres furent mis à mort, mais Justus fut loué par les ennemis des Pauliciens comme un second David, parce que d’un seul coup de pierre, il avait abattu le nouveau Goliath, le géant hérétique.
Mais le Seigneur est au-dessus de tout ; il peut faire que la colère de l’homme tourne à sa louange (Psaume 76:10). Autrefois, après « Étienne eut été lapidé, le Seigneur suscita Paul qui avait été un témoin contre lui, et de même le supplice de Constantin et de ses amis fit naître en Siméon même un successeur à Constantin Silvain dans l’œuvre du Seigneur. La vue de la grâce divine qui avait soutenu les martyrs avait frappé Siméon. Il eut des entretiens avec quelques Pauliciens, et le résultat en fut pour lui la conviction qu’ils étaient dans le vrai chemin. Il retourna cependant à Constantinople où il resta encore trois ans, réfléchissant sérieusement sur ce qu’il avait vu et entendu, et, nous pouvons le supposer, demandant à Dieu de l’éclairer et le guider. Enfin, quittant la cour et abandonnant sa position et tous ses biens, il retourna en Arménie. Là il devint, sous le nom de Tite, le zélé successeur de Constantin Silvain. Les voies de Dieu ne sont-elles pas merveilleuses ?
Cinq ans après la mort de Constantin, Justus, son meurtrier, dans sa haine contre eux, se porta comme dénonciateur des Pauliciens. Il se rendit auprès de l’évêque de Colonia et lui dit que l’hérésie des Pauliciens s’était relevée et s’étendait de plus en plus. L’évêque envoya à l’empereur Justinien II un rapport sur ce qui lui avait été dit par Justus. Siméon, par ordre du cruel empereur, fut saisi avec un grand nombre de Pauliciens. Un immense bûcher fut dressé, et tous périrent dans les flammes. Nous voyons par là, que l’Église grecque ne se montrait pas moins impitoyable que l’Église romaine envers ceux qui condamnaient ses erreurs et se séparaient d’elle.
Mais le sang des martyrs sembla augmenter la force et le nombre des Pauliciens. D’autres apôtres et de nouvelles assemblées surgirent, pour ainsi dire, des cendres du bûcher où avaient péri Siméon et ses compagnons. La secte s’étendit dans toute l’Asie mineure, dans le Pont, dans une partie de l’Arménie et dans les contrées à l’ouest de l’Euphrate. Pendant de longues années, les Pauliciens endurèrent avec patience les persécutions que les gouverneurs civils, excités par le clergé, leur firent subir. Trois hommes d’entre eux qui avaient été pris avec Siméon avaient été épargnés et envoyés à Constantinople pour être interrogés. Ils réussirent à s’échapper et revinrent à Mananalis, où durant trente ans ils vécurent, avec d’autres Pauliciens, sous la protection des Sarrasins.
Vers l’an 777, Dieu suscita un nouvel aide aux Pauliciens dans la personne de Sergius. Avant de vous parler de ce serviteur de Dieu, je vous ferai remarquer que ce qui caractérisait les Pauliciens, c’était leur attachement aux Écritures. Leurs ennemis les accusaient de beaucoup d’erreurs condamnables, et il est possible que quelques-uns d’entre eux, de leurs docteurs surtout, n’en fussent pas exempts. Mais ils tenaient à la parole de Dieu, et c’était elle qui les soutenait et qui, par leur moyen, opérait des conversions. C’est ce que montre l’histoire de Sergius. Lorsqu’il était encore jeune, une femme âgée de la secte des Pauliciens lui donna une Bible. Il la lut et l’étudia soigneusement, fut converti, et, prenant le nom de Tychique, il se mit à enseigner. Nous voyons que, de même que Constantin, il fut amené à la foi par la simple lecture de la parole de Dieu. Et il en est souvent de même de nos jours.
Pendant trente-quatre ans, Sergius s’occupa à répandre les vérités qu’il avait apprises, dans toutes les villes et les provinces qu’il visitait, tout en travaillant de son métier de charpentier pour gagner sa vie. C’est ainsi que l’apôtre Paul travaillait aussi de son métier de faiseur de tentes (Actes 18:3), et pouvait dire : « Vous savez vous-mêmes que ces mains ont été employées pour mes besoins et pour les personnes qui étaient avec moi » (Actes 20:34). Sergius ne se contentait pas de prêcher. Il disait : « De l’Orient à l’Occident, du Nord au Midi, j’ai annoncé l’Évangile, en travaillant à genoux ». Il voulait dire avec beaucoup de prières. C’est ce que font les vrais serviteurs du Seigneur (voir Éphésiens 1:16 ; Philippiens 1:4 ; Colossiens 1:9 ; 4:12 ; etc.). Sergius était un homme doux, d’une piété intime et profonde. Sa prédication pratique et sa vie pure furent des moyens dans la main de Dieu pour gagner beaucoup d’âmes. Aussi de nouvelles persécutions eurent lieu. Beaucoup de Pauliciens s’enfuirent et Sergius avec eux. Ils trouvèrent un asile chez les Sarrasins, et Sergius mourut là en l’an 811.
Haïs de l’Église grecque, parce que, disaient leurs ennemis, ils reniaient la foi orthodoxe, qu’ils n’adoraient pas la Mère de Dieu, qu’ils n’admettaient pas que le pain de la Cène fût changé dans le corps de Christ, et qu’ils avaient abandonné l’Église d’Orient, les Pauliciens n’étaient pas moins haïs de l’Église romaine. Les succès qu’avait obtenus Sergius par ses travaux, le firent stigmatiser par Rome comme étant l’Antichrist annoncé, le chef de la grande apostasie.
La persécution contre les Pauliciens atteignit sa plus grande intensité sous la régence de la cruelle Théodora, mère de l’empereur Michel III (de 842 à 857). Elle était protectrice fanatique du culte des images, et résolut d’exterminer les Pauliciens « racines et branches », à moins qu’ils ne revinssent à la vraie foi, celle de l’Église grecque. Les écrivains, tant ecclésiastiques que profanes, rapportent qu’elle en fit périr au moins cent mille, qui furent décapités, crucifiés, pendus, brûlés ou noyés et leurs biens confisqués. Quand on compare ces sanglantes exécutions avec ce que nous avons dit de l’Inquisition, nous voyons que l’Église d’Orient n’a rien à envier à celle d’Occident. Les persécutions, d’ailleurs, reçurent l’approbation du pape Nicolas I, qui écrivit à Théodora pour la féliciter de son zèle à extirper l’hérésie.
Mais, chose triste à dire, une partie des Pauliciens, au lieu d’endurer patiemment la persécution, se souleva contre l’empire. Un officier impérial supérieur, nommé Karbéas, ayant appris que par l’ordre de Théodora, son père avait été mis à mort par la main du bourreau, se mit à la tête de cinq mille Pauliciens, et se rendit chez les Sarrasins où se trouvaient un grand nombre de leurs frères. Les Sarrasins, toujours en guerre avec l’empire grec, les accueillirent volontiers et leur donnèrent la ville de Téphrice où ils bâtirent une citadelle, et de là livrèrent de nombreux combats aux troupes de l’empereur. Cette guerre dura trente ans avec des alternatives de succès et de revers. Mais ce fut une faute. Dieu ne veut pas que les siens prennent les armes pour se défendre contre les persécuteurs. Le Seigneur a dit : « Tous ceux qui auront pris l’épée périront par l’épée » (Matthieu 26:52). Aussi ne poursuivrons-nous pas l’histoire de ces Pauliciens. Nous en suivrons d’autres qui, en plusieurs contrées, portèrent la lumière qu’ils avaient reçue. Il y en eut qui se répandirent en Arabie, où ils continuèrent à faire des prosélytes.
Mais ce qui est plus intéressant et plus important pour la suite de notre sujet, c’est de connaître l’influence que les Pauliciens eurent en Occident. Avant Théodora, il y avait eu, comme nous l’avons vu, des persécutions contre eux. L’empereur Constantin Copronyme, vers le milieu du 8° siècle, en avait transporté un grand nombre dans la Thrace, et leur avait assigné comme résidence la ville de Philippopolis, un des postes avancés de l’empire. C’est de là que leurs doctrines pénétrèrent et se répandirent en Europe. Ils semblent surtout avoir travaillé avec succès parmi les Bulgares, peuple barbare venu des rives de la Volga et qui s’était établi sur les bords du Danube. Les Bulgares furent convertis en partie au christianisme dans le 9° siècle ; d’autres s’étaient faits mahométans. C’est chez les premiers que les Pauliciens portèrent leur doctrine (*). Aussi un auteur romain, Pierre de Sicile, écrivit-il à l’archevêque de Bulgarie pour le mettre en garde contre la contagion des Pauliciens. Ils étaient donc partout un peuple méprisé et poursuivi, mais Dieu les gardait. Dans le 10° siècle, un autre empereur grec envoya de nouveau comme colons un grand nombre de Pauliciens dans les vallées de l’Hémus (nommé aujourd’hui les Balkans). De là, ils se répandirent peu à peu dans l’Europe occiden tale où leurs congrégations connues sous différents noms, furent haïes et persécutées par l’Église de Rome.
(*) Ils prirent le nom de Bogomiles (amis de Dieu).
7.3 - Les Témoins de la vérité en Occident
Nous avons vu comment, en Orient, les Pauliciens, s’appuyant sur les Écritures, rejetaient les superstitions et les rites de l’Église grecque, et enseignaient la voie du salut selon les lumières qu’ils avaient. Transportons-nous maintenant en Occident ; là aussi de nombreux témoins surent maintenir, au prix même de leur vie, ce qu’ils connaissaient de la vérité.
Comme nous l’avons vu, depuis que Constantin avait embrassé le christianisme, la mondanité et la corruption, des superstitions et des mauvaises doctrines s’étaient introduites dans l’Église, et en même temps la prétention de l’évêque de Rome et du clergé de dominer sur tous les laïques, et d’imposer des enseignements fondés sur des traditions, au lieu de s’en tenir à la parole de Dieu. Mais dès lors aussi, il y eut des fidèles qui ne voulurent pas abandonner les enseignements des apôtres, et qui à cause de cela eurent à souffrir des persécutions et la mort.
Ce ne furent pas seulement de simples chrétiens qui protestèrent ainsi contre Rome et ses abus. Au 5° siècle, un prêtre du midi de la France, nommé Vigilantius, s’élevait avec véhémence contre le culte des reliques, les pèlerinages, les prières adressées aux saints, les jeûnes et les mortifications, et aussi contre le célibat des prêtres. Au 9° siècle, Claude, évêque de Turin, protesta contre les mêmes erreurs. Il trouva les églises pleines d’images qu’il fit enlever et brûler, ainsi que les croix. Il disait au peuple qu’autant valait adorer Jupiter et Saturne, que les images et les statues de Pierre et de Paul. « Faut-il adorer la croix, ou la porter ? » disait-il. « Si l’on adore tout bois taillé en forme de croix, parce que Christ a été suspendu à la croix, pourquoi pas aussi les crèches, les langes, les bateaux, les ânes ? ». Et quant aux reliques, autant valait, disait-il, révérer un os de bête qu’un os de saint. Mais Claude ne se contentait pas de combattre les superstitions romaines. Versé dans les Écritures qu’il étudiait avec zèle, il maintenait que nous sommes sauvés par la foi seule, et que tous les autres apôtres étaient égaux à Pierre. Dans le même siècle, mais un peu plus tard, un moine saxon, nommé Gottschalk, rejetait la doctrine du salut par les œuvres et soutenait la vérité du salut gratuit par la foi, ainsi que d’autres doctrines scripturaires. Il fut condamné par un concile, battu de verges publiquement et jeté en prison. Il y mourut après dix-neuf ans de captivité.
Revenons aux chrétiens dont nous parlions d’abord. Nous ne pouvons pas tracer leur histoire dès les temps apostoliques, car elle ne nous a pas été conservée. Nous savons seulement que, malgré les persécutions, ils subsistèrent à travers les siècles dans beaucoup de contrées, connus sous différents noms tels que ceux de Cathares, ou purs, d’Albigeois, nom tiré de la ville d’Albi où ils étaient nombreux, de Vaudois, nom dont l’origine est incertaine, de pauvres de Lyon : nous verrons d’où vient cette dernière dénomination. Dès le milieu du 12° siècle, on trouve dans plusieurs parties du continent, en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, de petites congrégations composées en grande partie de pauvres artisans, distinctes de l’Église de Rome et qui possèdent les Saintes Écritures. Mais déjà dans le 11° siècle, on en trouve des traces. À cette époque, des missionnaires orientaux qualifiés de poblicans (corruption probablement de pauliciens) vinrent d’Italie en France, dans le Périgord et l’évêché de Limoges. Ils gagnèrent là un certain nombre de disciples, non seulement parmi les pauvres, mais aussi parmi les seigneurs. Ils cherchèrent ensuite à s’étendre en d’autres contrées. Ainsi, vers l’an 1022, arrivèrent à Orléans un paysan du Périgord et une femme italienne. Ils enseignèrent leurs vues et se firent un certain nombre d’adhérents parmi les gens du peuple ; ils persuadèrent même quelques nobles et plusieurs chanoines. Ils se réunissaient en secret et de nuit, crainte, sans doute des persécutions. Dans ces réunions, les Écritures étaient lues et expliquées. Les Poblicans enseignaient qu’elles restaient une lettre morte, si l’Esprit Saint ne venait illuminer le cœur. Ils disaient que le baptême n’a aucune valeur pour le salut, rejetaient l’invocation des saints, et la présence réelle de Christ dans l’eucharistie. On les signala comme hérétiques au roi de France Robert, surnommé le pieux, qui les fit examiner par l’archevêque de Sens. Ils furent condamnés à mort. Deux seulement se rétractèrent. Comme les autres, parmi lesquels se trouvaient dix chanoines et plusieurs religieuses, se rendaient au supplice, ils passèrent devant le roi et la reine Constance. Celle-ci, voyant parmi les condamnés son ancien confesseur, saisie de colère, le frappa avec une canne et lui creva un œil. Les martyrs, près de mourir, disaient : « Faites-nous ce que vous voudrez ; déjà nous voyons notre Roi qui est dans les cieux, nous tendre les mains pour nous conduire en triomphe ».
Plus tard, la persécution sévissant en France, un grand nombre se réfugièrent à Cologne. Mais là aussi, ils furent persécutés et plusieurs périrent par le feu. En 1163, un certain nombre furent saisis dans une grange où ils tenaient leur réunion, et furent condamnés à être brûlés. Du milieu des flammes, un de leurs chefs, nommé Arnold, imposa les mains à ses compagnons de souffrances en leur disant : « Frères, soyez constants dans votre foi, dès aujourd’hui vous serez réunis aux martyrs du Christ ». On raconte qu’il y avait parmi ces condamnés une jeune fille qui n’avait pas abjuré, mais que quelques personnes avaient sauvée, étant touchées de sa jeunesse et de sa beauté. Voyant les flammes dévorer les condamnés, elle s’écria : « Où est Arnold, mon maître vénéré ? ». Et comme on le lui montrait expirant, elle s’arracha des mains qui la retenaient, et se voilant le visage, elle s’élança au milieu des flammes. Cela était beau et touchant, humainement parlant, mais était-ce tout à fait selon Dieu ?
Ainsi partout l’Église de Rome poursuivait et mettait à mort comme hérétiques, ces humbles chrétiens qui s’attachaient à la parole de Dieu. Ils n’avaient sans doute pas les lumières que nous avons, et peut-être des erreurs se mêlaient-elles à leurs enseignements, mais ils protestaient contre l’idolâtrie de Rome et ses pratiques, et attendaient le salut de Christ seul. En 1212, cinq cents de ces croyants, hommes et femmes, furent saisis à Strasbourg. Parmi eux se trouvaient des nobles, des prêtres, des riches aussi bien que des pauvres. Ils déclarèrent que leurs frères étaient fort nombreux en Piémont, en France, tant au nord qu’au midi, à Naples, en Sicile, en Italie, en Flandre. Sur ces cinq cents prisonniers, quatre-vingts, dont douze prêtres et vingt-trois femmes, furent brûlés vifs. L’un d’eux, nommé Jean, s’adressa à la foule et termina par ces paroles : « Nous sommes tous des pécheurs, mais ce n’est pas pour fausse doctrine, ni pour mauvaise conduite, que nous sommes condamnés à mourir. Nous avons le pardon de nos péchés, mais ce n’est pas par le moyen des prêtres, ni grâce au mérite de nos œuvres ».
Il est hors de doute que parmi ceux qui se séparaient de l’Église de Rome, il y avait de vrais hérétiques, mais Rome mettait dans la même masse tous ceux qui ne se soumettaient pas à son autorité, et elle avait intérêt à confondre les vrais croyants avec les hérétiques, afin de pouvoir tous les condamner. Mais sans nous arrêter davantage sur les persécutions qu’eurent à souffrir ces témoins de Dieu, nous donnerons quelques détails sur eux (*). Comme nous l’avons vu, on les désignait sous différents noms, mais eux se disaient chrétiens, et entre eux ils se nommaient « frères ». Suivant les endroits, on les appelait frères apostoliques, frères suisses ou italiens. Un de leurs persécuteurs, Rainerio Sacchoni, leur rend un témoignage remarquable. Il les connaissait bien et son témoignage n’est pas suspect, car après avoir été avec eux, il était rentré dans l’Église de Rome, s’était fait dominicain et était devenu inquisiteur : « De toutes les sectes », dit-il, « il n’en est point d’aussi fatale à l’Église que les Léonistes (**), et cela pour trois raisons : d’abord, parce qu’ils datent d’un temps fort reculé, quelques-uns les faisant contemporains du pape Sylvestre (l’an 315). De plus, c’est la secte la plus nombreuse ; il y a à peine une contrée où ils ne se trouvent. Enfin, tandis que les autres sectes inspirent l’horreur par leurs blasphèmes contre Dieu, les Léonistes ont une grande apparence de piété et surtout ils mènent une vie honnête devant les hommes. Ils professent d’ailleurs toute la vérité quant à Dieu et toutes les doctrines contenues dans le symbole des apôtres. Mais en même temps ils abhorrent l’Église de Rome et les prêtres romains ». C’était là leur grand crime. On pouvait mener une vie mondaine et même dissolue ; pourvu que l’on restât soumis au pape, tout allait bien. La parole de l’apôtre se vérifiait : « Tous ceux aussi qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus, seront persécutés » (2 Timothée 3:12).
(*) Nous puisons quelques-uns de ces détails dans l’ouvrage de F. Bevan, intitulé : « Trois amis de Dieu ».
(**) Un des noms par lesquels on désignait ces chrétiens. Il vient probablement d’un certain Jean de Lyon, un des disciples de Valdo. Nous parlerons plus loin de ce dernier.
L’inquisiteur Rainerio Sacchoni continue à décrire ainsi les Vaudois, afin, dit-il, que chaque bon catholique puisse les reconnaître et se saisir d’eux : « Vous les reconnaîtrez à leur conduite et à leur langage. Ce sont des gens graves et modestes. Il n’y a ni luxe ni désordre dans leurs vêtements. Ils sont sûrs en affaires et évitent les faux serments et les tromperies. Ils ne recherchent point les richesses, mais se contentent du nécessaire. Ils sont chastes et tempérants, et fuient les tavernes et les lieux de divertissements. Ils s’abstiennent de la colère. Ils sont toujours à leur travail ou bien occupés à enseigner et à s’instruire mutuellement, ce qui fait qu’ils sont absents des prières et instructions de l’Église. On les reconnaît aussi à leur langage simple et sobre, exempt de paroles oiseuses. Ils ne se permettent ni conversations légères, ni mensonges, ni jurements ».
7.1 - Les témoins de la vérité au Moyen Âge
Il était nécessaire de présenter les erreurs fatales qui caractérisent l’Église de Rome, parce que nous vivons au milieu d’elle, et qu’il importe pour nous de voir combien, tout en assumant le nom de chrétienne, elle s’est écartée des enseignements de Christ et des apôtres. Elle a annulé, par son idolâtrie, le culte qui ne doit être rendu qu’à Dieu et à son Fils, et a mis à la place du salut par la grâce de Dieu, le salut par des œuvres qui ne peuvent justifier le pécheur. Et il est non moins important d’être mis en garde contre elle, par le fait qu’elle a beaucoup d’attraits pour le cœur naturel par une apparence religieuse qui répond à certains besoins de l’âme, par son culte pompeux qui parle aux sens, et par une certaine piété et souvent un grand dévouement chez plusieurs de ses membres. Mais, dit l’apôtre, « la pensée de la chair est inimitié contre Dieu » (Rom. 8:7), et les ordonnances selon les enseignements et les commandements des hommes n’ont qu’une apparence de sagesse en dévotion volontaire et en humilité, en ce qu’elles n’épargnent pas le corps ; mais c’est pour la satisfaction de la chair (Colossiens 2:21-23). De plus, cette Église se présente comme revêtue d’une autorité qu’elle assume faussement, il est vrai, mais qui convient à la paresse de beaucoup d’âmes. Et c’est ainsi qu’elle « séduit, entraîne et égare ».
Nous n’avons parlé que très peu de cette autre grande fraction de la chrétienté qui s’appelle l’église orthodoxe grecque. Les patriarches (c’est-à-dire les principaux prélats) des églises de l’Orient, et spécialement celui de Constantinople, ne voulurent jamais reconnaître la suprématie du pape de Rome. De là vint une séparation qu’on appelle « le schisme oriental », et qui fut consommée en 1054. Au 19° siècle, la plus nombreuse partie de l’Église grecque se trouvait en Russie, soumise au tsar qui la gouvernait par un synode dont il nommait les membres. Mais l’Église grecque est aussi idolâtre que l’Église romaine. Si elle rejette les images sculptées, elle a ses icônes ou images peintes des saints, de la Vierge, du Seigneur, et même de Dieu le Père ! Elles sont répandues partout, depuis la hutte du pauvre paysan, jusqu’aux palais des grands, et malheur à qui ne les révère pas ! Les fausses doctrines de la transsubstantiation, des prières pour les morts et d’autres, existent là comme dans l’Église romaine, et là aussi c’est le clergé qui domine sur les consciences.
Il faut reconnaître que soit l’une, soit l’autre, de ces deux grandes églises rivales, envoyèrent des missionnaires dans les contrées encore païennes de l’Europe du centre et du nord, et en d’autres pays. C’étaient en général des moines, hommes pieux, dont on ne peut méconnaître le courage et le dévouement, et dont plusieurs aimaient vraiment le Seigneur. Nous avons mentionné quelques-uns d’entre eux. Le nom de Jésus Christ fut ainsi peu à peu porté chez tous les peuples de l’Europe qui ne le connaissaient pas encore. Mais Rome imposa aux nations qu’elle évangélisa ainsi, son autorité avec sa hiérarchie, ses formes religieuses et ses superstitions, et l’Église grecque ne fit pas autrement. De plus, on ne chercha pas la conversion du cœur chez ceux qu’on évangélisait. Ceux qui y consentaient étaient baptisés, et ils étaient chrétiens ! Souvent c’était par la force des armes qu’on forçait les peuples à se faire chrétiens par le baptême. D’autres fois, c’était le roi d’un pays qui, par politique, abandonnait le paganisme, et persuadait ou obligeait son peuple à le suivre. Les païens laissaient leurs idoles et leur culte pour d’autres idoles et d’autres cérémonies. L’Europe fut ainsi christianisée, c’est-à-dire devint chrétienne de nom. L’Église devint ce grand arbre dont parle le Seigneur en Matthieu 13, d’une grande apparence, mais abritant dans son opulent feuillage toutes sortes de choses mauvaises. Et c’est ce que nous voyons actuellement. Et dans ce monde ainsi christianisé, si quelqu’un veut être sauvé, il faut qu’il soit vraiment converti, tout comme s’il eût été païen, et qu’il quitte le chemin large de la simple profession chrétienne, pour entrer par la porte étroite du salut, la foi au Seigneur Jésus Christ.
Il faut encore dire qu’outre ces missionnaires dont nous parlions, il y eut dans l’Église romaine, durant les siècles d’obscurcissement du Moyen Âge, des hommes vraiment pieux. Nous en citerons deux des plus remarquables. L’un fut Anselme, qui vécut dans la seconde moitié du 11° siècle, et fut archevêque de Canterbury en Angleterre. Il écrivit, entre autres, un traité sur la Rédemption avec ce titre : « Pourquoi Dieu s’est-il fait homme ? ». Il y enseigne que le Fils de Dieu est devenu un homme, afin de souffrir à la place du pécheur pour satisfaire à la justice de Dieu. « Par sa mort », dit-il, « le Fils de Dieu offrit une satisfaction d’un prix infini, et par là même suffisante pour couvrir les péchés de toute l’humanité ». Et il exhortait les mourants à regarder uniquement aux mérites de Jésus Christ.
Le second de ces hommes distingués est Bernard de Clairvaux, ainsi nommé parce qu’il fut abbé du monastère de ce nom. Il vivait dans la première moitié du 12° siècle, et avait été élevé par une mère pieuse, dont les enseignements le gardèrent loin des plaisirs du monde. Dès l’âge de vingt-deux ans, il entra dans la vie monastique et devint bientôt célèbre par sa puissante éloquence et son activité infatigable. Il acquit ainsi une grande influence dans l’Église, parlant avec hardiesse aux grands de la terre comme aux petits. Il était d’ailleurs d’une charité inépuisable envers les pauvres. Il aimait la Bible et en faisait sa lecture favorite, et, pour lui, ni jeûnes, ni pénitences, ne sauvaient le pécheur, mais Christ seul. Il était aussi poète, et composa plusieurs hymnes latines. L’une d’elle en particulier nous montre l’amour qu’il avait pour Jésus. On l’a traduite, mais bien imparfaitement, en français ; en voici deux strophes :
Chef (*) couvert de blessures,
Tout meurtri, tout en sang,
Chef accablé d’injures,
D’opprobres, de tourments ;
Chef, des gloires divines
Autrefois couronné,
C’est maintenant d’épines
Que ton front est orné.
Ah ! pour ton agonie,
Pour tes grandes douleurs,
Je veux toute ma vie
Te bénir, mon Sauveur !
Ta grâce est éternelle,
Et rien, jusqu’à la fin,
Ne pourra, cœur fidèle,
Me ravir de ta main.
(*) Chef signifie ici tête
Mais avec leur piété, leur charité, leur dévouement, ces hommes, et d’autres tels qu’eux, ne soutenaient pas moins l’Église romaine, ses erreurs et ses superstitions. On se rappelle ce que saint Bernard disait relativement à la Vierge : « Si tu es effrayé de la majesté de Jésus, recours à Marie ! » Et il sévissait avec rigueur contre de prétendus hérétiques, car c’est ainsi qu’il nommait ceux qui, s’attachant à la parole de Dieu, se séparaient de Rome.
Il est vrai que bien des hommes pieux de l’Église romaine déploraient et dénonçaient les vices du clergé, des moines et des papes, et cherchaient à les réformer. Ils s’efforçaient de corriger les mœurs dissolues des moines en introduisant dans les couvents des règles sévères, et en fondant de nouveaux ordres. Mais ce n’était pas couper le mal à la racine. Les nouveaux ordres monacaux, tels que les franciscains et les dominicains, ne firent que fortifier, par l’appui qu’ils lui prêtèrent, l’autorité de l’Église de Rome, et, sous différents noms, les diverses congrégations, en une certaine mesure, dominèrent et dominent encore le chef même de l’église, le pape.
Dans ces ténèbres d’erreur et de superstition, et sous cette domination du clergé, que devenait la vérité de Dieu, qu’il avait donnée aux hommes ? Cette vérité ne peut jamais périr, et Dieu eut toujours des témoins pour la maintenir. Mais ce fut au milieu et au prix de beaucoup de souffrances, car l’Église romaine les poursuivait partout, ne pouvant supporter qu’on se dérobât à son autorité. Dans l’état de choses représenté par l’assemblée de Thyatire, ils étaient ceux dont le Seigneur reconnaissait les œuvres, la foi, l’amour, le service et la patience, le résidu qui ne suivait pas la doctrine de Jésabel et ne connaissait pas les profondeurs de Satan (Apocalypse 2:19, 24).
Il y avait bien, dans quelque cellule d’un couvent, un moine ou une nonne qui déplorait la corruption de l’église, et se réfugiait comme consolation auprès du Sauveur qu’il aimait. Tel, par exemple, ce pauvre chartreux qui écrit sa confession en ces termes. « Ô Dieu très charitable ! Je sais que je ne puis être sauvé et satisfaire ta justice autrement que par le mérite, la passion très innocente et la mort de ton Fils bien-aimé. — Pieux Jésus ! tout mon salut est dans tes mains. Tu ne peux détourner de moi les mains de ton amour, car elles m’ont créé, formé et racheté. Tu as inscrit mon nom d’un style de fer, avec une grande miséricorde et d’une manière ineffaçable, etc ». Et il ajouta : « Si je ne puis confesser ces choses de la langue, je les confesse du moins de la plume et du cœur ». Puis il plaça sa confession dans une boîte de bois qu’il renferma dans un trou fait à la muraille de sa cellule. Plusieurs siècles après, en 1776, on abattit un corps de logis qui avait fait partie de ce couvent, et on trouva la confession du frère Martin. Un autre adressait chaque jour au Seigneur cette prière : « Ô mon Seigneur Jésus Christ ! Je crois que tu es seul ma rédemption et ma justice ». N’est-il pas doux de penser que le Seigneur, dans ces temps ténébreux, avait des âmes cachées pour qui il était leur trésor ? Mais elles demeuraient silencieuses et soumises, et gardaient pour elles-mêmes la lumière intérieure qui illuminait et réjouissait leur cœur.
Mais il y eut d’autres fidèles qui ne craignirent pas de confesser hautement leur foi, rompant avec l’erreur et s’attachant uniquement à la parole de Dieu. Ils forment une ligne non interrompue de témoins jusqu’aux jours de la Réformation. C’est d’eux que nous avons à nous occuper maintenant.
7.2 - Les Pauliciens
Voici quelle fut l’origine de la secte à laquelle on donna ce nom. Vers l’an 660, vivait près de Samosate, ville sur l’Euphrate en Arménie, dans un bourg nommé Mananalis, un homme respectable du nom de Constantin. Les écrivains catholiques romains le représentent comme ayant adopté certaines doctrines manichéennes, mais d’autres disent qu’il appartenait à l’Église grecque. C’était au temps où les sectateurs de Mahomet s’étaient emparés de la Syrie. Un jour se présenta chez Constantin un diacre de l’église arménienne qui avait été fait prisonnier par les Sarrasins (*), mais qui avait réussi à recouvrer sa liberté. Constantin l’accueillit, le garda quelques jours chez lui, et le diacre, en le quittant, lui donna en retour de son hospitalité, deux manuscrits contenant l’un, les quatre évangiles, et l’autre, les quatorze épîtres de Paul. C’était pour ces temps où les manuscrits des Écritures étaient rares et chers, un riche et précieux présent. Par ce don nous pouvons juger de la nature des conversations que Constantin avait eues avec son hôte. Constantin lut et étudia les saints livres, et la lumière de la vérité pénétra dans son âme. Il brûla ses mauvais livres, et ne voulut plus en étudier d’autres que les évangiles et les épîtres. Ses principes religieux et sa vie tout entière furent changés. « De l’abondance du cœur la bouche parle » : Constantin commença à communiquer à d’autres ce que Dieu lui avait appris par sa Parole, et des disciples se réunirent autour de lui. Il avait vu dans les Actes et dans les Épîtres ce qu’étaient les églises au commencement, et il désirait y revenir. Par là il rejetait nécessairement et la hiérarchie qui dominait l’Église grecque aussi bien que la romaine (**), et les erreurs de ces deux églises, surtout l’adoration des saints et de la Vierge.
(*) Ce mot vient de Saraceni, tribu nomade de l’Arabie, une des premières à embrasser l’islam, et qui faisait la principale force des armées arabes musulmanes.
(**) À cette époque, du reste, le schisme entre l’Église grecque orthodoxe et l’Église romaine n’était pas consommé (il le sera seulement en 1054), mais les Églises avaient leur particularités, et ne supportaient pas l’autorité du pape romain.
Constantin alla se fixer à Cibossa, autre ville d’Arménie, et de là il travailla avec ses disciples à répandre les vérités que Dieu lui avait fait connaître. Ses ennemis l’ont accusé de rejeter l’Ancien Testament et certaines parties du Nouveau. Cette calomnie a eu sans doute son fondement dans le fait qu’il ne possédait, comme nous l’avons vu, qu’une partie du Nouveau Testament. Peut-être à cause de cela et de ses primitives croyances, se mêla-t-il quelques erreurs à son enseignement.
Constantin prit le nom de Silvain, le compagnon de Paul (1 Thessaloniciens 1:1), et ses disciples, associés à son œuvre, empruntèrent à leur tour de nouveaux noms aux autres compagnons de l’apôtre, tels que Timothée, Tite et Tychique. Ils prenaient ces noms, parce qu’ils s’attachaient à répandre la doctrine contenue dans les écrits de Paul, et c’est aussi probablement d’après lui qu’ils reçurent le nom de Pauliciens.
Silvain, comme nous l’avons dit, s’était établi à Cibossa. En y arrivant, il avait dit aux habitants : « Je suis Silvain et vous êtes les Macédoniens », faisant allusion aux travaux de Silvain (ou Silas), en Macédoine, à Philippes et à Thessalonique (Actes 15:40 ; 16:19, 25 ; 17:1-4, etc. ; 18:5). Pendant vingt sept ans, Silvain travailla avec un zèle infatigable à annoncer ce qu’il avait appris dans les Écritures. Un grand nombre de personnes, soit de l’Église grecque, soit des sectateurs de Zoroastre (*), furent converties par son moyen, et des congrégations furent établies en divers endroits tant par lui que par ses disciples.
(*) Zoroastre, fondateur ou réformateur de l’ancienne religion des Perses, que l’on nomme Mazdéisme. Elle enseigne la co-existence de deux principes éternels : l’un est Ormuzd, le bien, le vrai, la lumière, représenté par le soleil ; l’autre Ahriman, le mal et les ténèbres, en guerre avec Ormuzd qui finira par le vaincre. C’est au soleil comme représentant Ormuzd, que les sectateurs de Zoroastre rendaient leurs hommages. Partout ils élevaient des autels sur lesquels brûlait le feu sacré. Sous le nom de Guèbres ou de Parsis, se trouvent encore dans l’Inde un certain nombre d’adorateurs du soleil.
Les progrès de la nouvelle secte furent tels qu’elle attira sur elle l’attention des autorités ecclésiastiques, et ce fut sans doute le clergé qui porta la chose devant l’empereur. Celui-ci rendit en l’an 684 un édit contre Constantin et les assemblées pauliciennes. L’exécution en fut confiée à un officier de la cour nommé Siméon, qui reçut en même temps l’ordre de faire mettre à mort le chef de la secte, et de reléguer ses partisans dans des cloîtres et sous les soins du clergé, afin de les ramener dans le bon chemin. Arrivé à Cibossa, Siméon fit comparaître devant lui Constantin et un grand nombre de ses disciples. Puis il ordonna à ceux-ci, sous peine de la vie, de lapider leur maître. Mais tous, à l’exception d’un seul, nommé Justus, refusèrent d’obéir à cet ordre cruel, et laissèrent tomber les pierres dont on les avait armés. Ce Justus avait été adopté et élevé par Constantin, et l’ingrat, d’un coup de pierre, tua son bienfaiteur. Les autres furent mis à mort, mais Justus fut loué par les ennemis des Pauliciens comme un second David, parce que d’un seul coup de pierre, il avait abattu le nouveau Goliath, le géant hérétique.
Mais le Seigneur est au-dessus de tout ; il peut faire que la colère de l’homme tourne à sa louange (Psaume 76:10). Autrefois, après « Étienne eut été lapidé, le Seigneur suscita Paul qui avait été un témoin contre lui, et de même le supplice de Constantin et de ses amis fit naître en Siméon même un successeur à Constantin Silvain dans l’œuvre du Seigneur. La vue de la grâce divine qui avait soutenu les martyrs avait frappé Siméon. Il eut des entretiens avec quelques Pauliciens, et le résultat en fut pour lui la conviction qu’ils étaient dans le vrai chemin. Il retourna cependant à Constantinople où il resta encore trois ans, réfléchissant sérieusement sur ce qu’il avait vu et entendu, et, nous pouvons le supposer, demandant à Dieu de l’éclairer et le guider. Enfin, quittant la cour et abandonnant sa position et tous ses biens, il retourna en Arménie. Là il devint, sous le nom de Tite, le zélé successeur de Constantin Silvain. Les voies de Dieu ne sont-elles pas merveilleuses ?
Cinq ans après la mort de Constantin, Justus, son meurtrier, dans sa haine contre eux, se porta comme dénonciateur des Pauliciens. Il se rendit auprès de l’évêque de Colonia et lui dit que l’hérésie des Pauliciens s’était relevée et s’étendait de plus en plus. L’évêque envoya à l’empereur Justinien II un rapport sur ce qui lui avait été dit par Justus. Siméon, par ordre du cruel empereur, fut saisi avec un grand nombre de Pauliciens. Un immense bûcher fut dressé, et tous périrent dans les flammes. Nous voyons par là, que l’Église grecque ne se montrait pas moins impitoyable que l’Église romaine envers ceux qui condamnaient ses erreurs et se séparaient d’elle.
Mais le sang des martyrs sembla augmenter la force et le nombre des Pauliciens. D’autres apôtres et de nouvelles assemblées surgirent, pour ainsi dire, des cendres du bûcher où avaient péri Siméon et ses compagnons. La secte s’étendit dans toute l’Asie mineure, dans le Pont, dans une partie de l’Arménie et dans les contrées à l’ouest de l’Euphrate. Pendant de longues années, les Pauliciens endurèrent avec patience les persécutions que les gouverneurs civils, excités par le clergé, leur firent subir. Trois hommes d’entre eux qui avaient été pris avec Siméon avaient été épargnés et envoyés à Constantinople pour être interrogés. Ils réussirent à s’échapper et revinrent à Mananalis, où durant trente ans ils vécurent, avec d’autres Pauliciens, sous la protection des Sarrasins.
Vers l’an 777, Dieu suscita un nouvel aide aux Pauliciens dans la personne de Sergius. Avant de vous parler de ce serviteur de Dieu, je vous ferai remarquer que ce qui caractérisait les Pauliciens, c’était leur attachement aux Écritures. Leurs ennemis les accusaient de beaucoup d’erreurs condamnables, et il est possible que quelques-uns d’entre eux, de leurs docteurs surtout, n’en fussent pas exempts. Mais ils tenaient à la parole de Dieu, et c’était elle qui les soutenait et qui, par leur moyen, opérait des conversions. C’est ce que montre l’histoire de Sergius. Lorsqu’il était encore jeune, une femme âgée de la secte des Pauliciens lui donna une Bible. Il la lut et l’étudia soigneusement, fut converti, et, prenant le nom de Tychique, il se mit à enseigner. Nous voyons que, de même que Constantin, il fut amené à la foi par la simple lecture de la parole de Dieu. Et il en est souvent de même de nos jours.
Pendant trente-quatre ans, Sergius s’occupa à répandre les vérités qu’il avait apprises, dans toutes les villes et les provinces qu’il visitait, tout en travaillant de son métier de charpentier pour gagner sa vie. C’est ainsi que l’apôtre Paul travaillait aussi de son métier de faiseur de tentes (Actes 18:3), et pouvait dire : « Vous savez vous-mêmes que ces mains ont été employées pour mes besoins et pour les personnes qui étaient avec moi » (Actes 20:34). Sergius ne se contentait pas de prêcher. Il disait : « De l’Orient à l’Occident, du Nord au Midi, j’ai annoncé l’Évangile, en travaillant à genoux ». Il voulait dire avec beaucoup de prières. C’est ce que font les vrais serviteurs du Seigneur (voir Éphésiens 1:16 ; Philippiens 1:4 ; Colossiens 1:9 ; 4:12 ; etc.). Sergius était un homme doux, d’une piété intime et profonde. Sa prédication pratique et sa vie pure furent des moyens dans la main de Dieu pour gagner beaucoup d’âmes. Aussi de nouvelles persécutions eurent lieu. Beaucoup de Pauliciens s’enfuirent et Sergius avec eux. Ils trouvèrent un asile chez les Sarrasins, et Sergius mourut là en l’an 811.
Haïs de l’Église grecque, parce que, disaient leurs ennemis, ils reniaient la foi orthodoxe, qu’ils n’adoraient pas la Mère de Dieu, qu’ils n’admettaient pas que le pain de la Cène fût changé dans le corps de Christ, et qu’ils avaient abandonné l’Église d’Orient, les Pauliciens n’étaient pas moins haïs de l’Église romaine. Les succès qu’avait obtenus Sergius par ses travaux, le firent stigmatiser par Rome comme étant l’Antichrist annoncé, le chef de la grande apostasie.
La persécution contre les Pauliciens atteignit sa plus grande intensité sous la régence de la cruelle Théodora, mère de l’empereur Michel III (de 842 à 857). Elle était protectrice fanatique du culte des images, et résolut d’exterminer les Pauliciens « racines et branches », à moins qu’ils ne revinssent à la vraie foi, celle de l’Église grecque. Les écrivains, tant ecclésiastiques que profanes, rapportent qu’elle en fit périr au moins cent mille, qui furent décapités, crucifiés, pendus, brûlés ou noyés et leurs biens confisqués. Quand on compare ces sanglantes exécutions avec ce que nous avons dit de l’Inquisition, nous voyons que l’Église d’Orient n’a rien à envier à celle d’Occident. Les persécutions, d’ailleurs, reçurent l’approbation du pape Nicolas I, qui écrivit à Théodora pour la féliciter de son zèle à extirper l’hérésie.
Mais, chose triste à dire, une partie des Pauliciens, au lieu d’endurer patiemment la persécution, se souleva contre l’empire. Un officier impérial supérieur, nommé Karbéas, ayant appris que par l’ordre de Théodora, son père avait été mis à mort par la main du bourreau, se mit à la tête de cinq mille Pauliciens, et se rendit chez les Sarrasins où se trouvaient un grand nombre de leurs frères. Les Sarrasins, toujours en guerre avec l’empire grec, les accueillirent volontiers et leur donnèrent la ville de Téphrice où ils bâtirent une citadelle, et de là livrèrent de nombreux combats aux troupes de l’empereur. Cette guerre dura trente ans avec des alternatives de succès et de revers. Mais ce fut une faute. Dieu ne veut pas que les siens prennent les armes pour se défendre contre les persécuteurs. Le Seigneur a dit : « Tous ceux qui auront pris l’épée périront par l’épée » (Matthieu 26:52). Aussi ne poursuivrons-nous pas l’histoire de ces Pauliciens. Nous en suivrons d’autres qui, en plusieurs contrées, portèrent la lumière qu’ils avaient reçue. Il y en eut qui se répandirent en Arabie, où ils continuèrent à faire des prosélytes.
Mais ce qui est plus intéressant et plus important pour la suite de notre sujet, c’est de connaître l’influence que les Pauliciens eurent en Occident. Avant Théodora, il y avait eu, comme nous l’avons vu, des persécutions contre eux. L’empereur Constantin Copronyme, vers le milieu du 8° siècle, en avait transporté un grand nombre dans la Thrace, et leur avait assigné comme résidence la ville de Philippopolis, un des postes avancés de l’empire. C’est de là que leurs doctrines pénétrèrent et se répandirent en Europe. Ils semblent surtout avoir travaillé avec succès parmi les Bulgares, peuple barbare venu des rives de la Volga et qui s’était établi sur les bords du Danube. Les Bulgares furent convertis en partie au christianisme dans le 9° siècle ; d’autres s’étaient faits mahométans. C’est chez les premiers que les Pauliciens portèrent leur doctrine (*). Aussi un auteur romain, Pierre de Sicile, écrivit-il à l’archevêque de Bulgarie pour le mettre en garde contre la contagion des Pauliciens. Ils étaient donc partout un peuple méprisé et poursuivi, mais Dieu les gardait. Dans le 10° siècle, un autre empereur grec envoya de nouveau comme colons un grand nombre de Pauliciens dans les vallées de l’Hémus (nommé aujourd’hui les Balkans). De là, ils se répandirent peu à peu dans l’Europe occiden tale où leurs congrégations connues sous différents noms, furent haïes et persécutées par l’Église de Rome.
(*) Ils prirent le nom de Bogomiles (amis de Dieu).
7.3 - Les Témoins de la vérité en Occident
Nous avons vu comment, en Orient, les Pauliciens, s’appuyant sur les Écritures, rejetaient les superstitions et les rites de l’Église grecque, et enseignaient la voie du salut selon les lumières qu’ils avaient. Transportons-nous maintenant en Occident ; là aussi de nombreux témoins surent maintenir, au prix même de leur vie, ce qu’ils connaissaient de la vérité.
Comme nous l’avons vu, depuis que Constantin avait embrassé le christianisme, la mondanité et la corruption, des superstitions et des mauvaises doctrines s’étaient introduites dans l’Église, et en même temps la prétention de l’évêque de Rome et du clergé de dominer sur tous les laïques, et d’imposer des enseignements fondés sur des traditions, au lieu de s’en tenir à la parole de Dieu. Mais dès lors aussi, il y eut des fidèles qui ne voulurent pas abandonner les enseignements des apôtres, et qui à cause de cela eurent à souffrir des persécutions et la mort.
Ce ne furent pas seulement de simples chrétiens qui protestèrent ainsi contre Rome et ses abus. Au 5° siècle, un prêtre du midi de la France, nommé Vigilantius, s’élevait avec véhémence contre le culte des reliques, les pèlerinages, les prières adressées aux saints, les jeûnes et les mortifications, et aussi contre le célibat des prêtres. Au 9° siècle, Claude, évêque de Turin, protesta contre les mêmes erreurs. Il trouva les églises pleines d’images qu’il fit enlever et brûler, ainsi que les croix. Il disait au peuple qu’autant valait adorer Jupiter et Saturne, que les images et les statues de Pierre et de Paul. « Faut-il adorer la croix, ou la porter ? » disait-il. « Si l’on adore tout bois taillé en forme de croix, parce que Christ a été suspendu à la croix, pourquoi pas aussi les crèches, les langes, les bateaux, les ânes ? ». Et quant aux reliques, autant valait, disait-il, révérer un os de bête qu’un os de saint. Mais Claude ne se contentait pas de combattre les superstitions romaines. Versé dans les Écritures qu’il étudiait avec zèle, il maintenait que nous sommes sauvés par la foi seule, et que tous les autres apôtres étaient égaux à Pierre. Dans le même siècle, mais un peu plus tard, un moine saxon, nommé Gottschalk, rejetait la doctrine du salut par les œuvres et soutenait la vérité du salut gratuit par la foi, ainsi que d’autres doctrines scripturaires. Il fut condamné par un concile, battu de verges publiquement et jeté en prison. Il y mourut après dix-neuf ans de captivité.
Revenons aux chrétiens dont nous parlions d’abord. Nous ne pouvons pas tracer leur histoire dès les temps apostoliques, car elle ne nous a pas été conservée. Nous savons seulement que, malgré les persécutions, ils subsistèrent à travers les siècles dans beaucoup de contrées, connus sous différents noms tels que ceux de Cathares, ou purs, d’Albigeois, nom tiré de la ville d’Albi où ils étaient nombreux, de Vaudois, nom dont l’origine est incertaine, de pauvres de Lyon : nous verrons d’où vient cette dernière dénomination. Dès le milieu du 12° siècle, on trouve dans plusieurs parties du continent, en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, de petites congrégations composées en grande partie de pauvres artisans, distinctes de l’Église de Rome et qui possèdent les Saintes Écritures. Mais déjà dans le 11° siècle, on en trouve des traces. À cette époque, des missionnaires orientaux qualifiés de poblicans (corruption probablement de pauliciens) vinrent d’Italie en France, dans le Périgord et l’évêché de Limoges. Ils gagnèrent là un certain nombre de disciples, non seulement parmi les pauvres, mais aussi parmi les seigneurs. Ils cherchèrent ensuite à s’étendre en d’autres contrées. Ainsi, vers l’an 1022, arrivèrent à Orléans un paysan du Périgord et une femme italienne. Ils enseignèrent leurs vues et se firent un certain nombre d’adhérents parmi les gens du peuple ; ils persuadèrent même quelques nobles et plusieurs chanoines. Ils se réunissaient en secret et de nuit, crainte, sans doute des persécutions. Dans ces réunions, les Écritures étaient lues et expliquées. Les Poblicans enseignaient qu’elles restaient une lettre morte, si l’Esprit Saint ne venait illuminer le cœur. Ils disaient que le baptême n’a aucune valeur pour le salut, rejetaient l’invocation des saints, et la présence réelle de Christ dans l’eucharistie. On les signala comme hérétiques au roi de France Robert, surnommé le pieux, qui les fit examiner par l’archevêque de Sens. Ils furent condamnés à mort. Deux seulement se rétractèrent. Comme les autres, parmi lesquels se trouvaient dix chanoines et plusieurs religieuses, se rendaient au supplice, ils passèrent devant le roi et la reine Constance. Celle-ci, voyant parmi les condamnés son ancien confesseur, saisie de colère, le frappa avec une canne et lui creva un œil. Les martyrs, près de mourir, disaient : « Faites-nous ce que vous voudrez ; déjà nous voyons notre Roi qui est dans les cieux, nous tendre les mains pour nous conduire en triomphe ».
Plus tard, la persécution sévissant en France, un grand nombre se réfugièrent à Cologne. Mais là aussi, ils furent persécutés et plusieurs périrent par le feu. En 1163, un certain nombre furent saisis dans une grange où ils tenaient leur réunion, et furent condamnés à être brûlés. Du milieu des flammes, un de leurs chefs, nommé Arnold, imposa les mains à ses compagnons de souffrances en leur disant : « Frères, soyez constants dans votre foi, dès aujourd’hui vous serez réunis aux martyrs du Christ ». On raconte qu’il y avait parmi ces condamnés une jeune fille qui n’avait pas abjuré, mais que quelques personnes avaient sauvée, étant touchées de sa jeunesse et de sa beauté. Voyant les flammes dévorer les condamnés, elle s’écria : « Où est Arnold, mon maître vénéré ? ». Et comme on le lui montrait expirant, elle s’arracha des mains qui la retenaient, et se voilant le visage, elle s’élança au milieu des flammes. Cela était beau et touchant, humainement parlant, mais était-ce tout à fait selon Dieu ?
Ainsi partout l’Église de Rome poursuivait et mettait à mort comme hérétiques, ces humbles chrétiens qui s’attachaient à la parole de Dieu. Ils n’avaient sans doute pas les lumières que nous avons, et peut-être des erreurs se mêlaient-elles à leurs enseignements, mais ils protestaient contre l’idolâtrie de Rome et ses pratiques, et attendaient le salut de Christ seul. En 1212, cinq cents de ces croyants, hommes et femmes, furent saisis à Strasbourg. Parmi eux se trouvaient des nobles, des prêtres, des riches aussi bien que des pauvres. Ils déclarèrent que leurs frères étaient fort nombreux en Piémont, en France, tant au nord qu’au midi, à Naples, en Sicile, en Italie, en Flandre. Sur ces cinq cents prisonniers, quatre-vingts, dont douze prêtres et vingt-trois femmes, furent brûlés vifs. L’un d’eux, nommé Jean, s’adressa à la foule et termina par ces paroles : « Nous sommes tous des pécheurs, mais ce n’est pas pour fausse doctrine, ni pour mauvaise conduite, que nous sommes condamnés à mourir. Nous avons le pardon de nos péchés, mais ce n’est pas par le moyen des prêtres, ni grâce au mérite de nos œuvres ».
Il est hors de doute que parmi ceux qui se séparaient de l’Église de Rome, il y avait de vrais hérétiques, mais Rome mettait dans la même masse tous ceux qui ne se soumettaient pas à son autorité, et elle avait intérêt à confondre les vrais croyants avec les hérétiques, afin de pouvoir tous les condamner. Mais sans nous arrêter davantage sur les persécutions qu’eurent à souffrir ces témoins de Dieu, nous donnerons quelques détails sur eux (*). Comme nous l’avons vu, on les désignait sous différents noms, mais eux se disaient chrétiens, et entre eux ils se nommaient « frères ». Suivant les endroits, on les appelait frères apostoliques, frères suisses ou italiens. Un de leurs persécuteurs, Rainerio Sacchoni, leur rend un témoignage remarquable. Il les connaissait bien et son témoignage n’est pas suspect, car après avoir été avec eux, il était rentré dans l’Église de Rome, s’était fait dominicain et était devenu inquisiteur : « De toutes les sectes », dit-il, « il n’en est point d’aussi fatale à l’Église que les Léonistes (**), et cela pour trois raisons : d’abord, parce qu’ils datent d’un temps fort reculé, quelques-uns les faisant contemporains du pape Sylvestre (l’an 315). De plus, c’est la secte la plus nombreuse ; il y a à peine une contrée où ils ne se trouvent. Enfin, tandis que les autres sectes inspirent l’horreur par leurs blasphèmes contre Dieu, les Léonistes ont une grande apparence de piété et surtout ils mènent une vie honnête devant les hommes. Ils professent d’ailleurs toute la vérité quant à Dieu et toutes les doctrines contenues dans le symbole des apôtres. Mais en même temps ils abhorrent l’Église de Rome et les prêtres romains ». C’était là leur grand crime. On pouvait mener une vie mondaine et même dissolue ; pourvu que l’on restât soumis au pape, tout allait bien. La parole de l’apôtre se vérifiait : « Tous ceux aussi qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus, seront persécutés » (2 Timothée 3:12).
(*) Nous puisons quelques-uns de ces détails dans l’ouvrage de F. Bevan, intitulé : « Trois amis de Dieu ».
(**) Un des noms par lesquels on désignait ces chrétiens. Il vient probablement d’un certain Jean de Lyon, un des disciples de Valdo. Nous parlerons plus loin de ce dernier.
L’inquisiteur Rainerio Sacchoni continue à décrire ainsi les Vaudois, afin, dit-il, que chaque bon catholique puisse les reconnaître et se saisir d’eux : « Vous les reconnaîtrez à leur conduite et à leur langage. Ce sont des gens graves et modestes. Il n’y a ni luxe ni désordre dans leurs vêtements. Ils sont sûrs en affaires et évitent les faux serments et les tromperies. Ils ne recherchent point les richesses, mais se contentent du nécessaire. Ils sont chastes et tempérants, et fuient les tavernes et les lieux de divertissements. Ils s’abstiennent de la colère. Ils sont toujours à leur travail ou bien occupés à enseigner et à s’instruire mutuellement, ce qui fait qu’ils sont absents des prières et instructions de l’Église. On les reconnaît aussi à leur langage simple et sobre, exempt de paroles oiseuses. Ils ne se permettent ni conversations légères, ni mensonges, ni jurements ».
 Re: L’ÉGLISE : UNE ESQUISSE DE SON HISTOIRE PENDANT VINGT SIÈCLES
Re: L’ÉGLISE : UNE ESQUISSE DE SON HISTOIRE PENDANT VINGT SIÈCLES
Voilà certes un beau témoignage. Plût à Dieu qu’on pût le rendre maintenant à tous ceux qui se disent chrétiens ! Pourquoi donc poursuivre les Vaudois comme des êtres malfaisants et les persécuter jusqu’à la mort ? Le même inquisiteur nous en donne les raisons et énumère ainsi les griefs de l’Église de Rome contre les Vaudois : « Ils prétendent être la vraie église et disent que celle de Rome est la femme impure d’Apocalypse 17. Ils nient qu’aucun vrai miracle ait jamais été opéré dans cette Église. Ils tiennent de nulle valeur les ordonnances que l’église a introduites depuis le temps des apôtres, et disent qu’il ne faut pas les observer. Ainsi ils rejettent les fêtes, les jeûnes, les ordres monastiques et les choses bénites de l’Église romaine. Ils s’élèvent contre la consécration des églises et des cimetières, comme étant des inventions des prêtres pour augmenter leurs gains. Quelques-uns d’entre eux disent que le baptême des enfants ne sert à rien, puisqu’ils ne peuvent pas croire. Ils rejettent le sacrement de confirmation, et, à sa place, ceux qui les enseignent imposent les mains aux disciples. Ils ne croient pas que le corps et le sang de Christ soient dans le sacrement de la Cène ; selon eux le pain est appelé figurément le corps de Christ. Ils disent que le prêtre, qui est un pécheur, ne peut lier ni délier personne, étant lié lui-même, et que tout laïque pieux et intelligent peut absoudre un autre et imposer des pénitences. Ils rejettent l’extrême onction, et disent qu’il n’y a point de purgatoire, et que les prières pour les morts ne servent à rien. Les offrandes pour les morts, ajoutent-ils, vont seulement au clergé. Ils se moquent des fêtes célébrées en l’honneur des saints, et travaillent aux jours fériés. Ils ne gardent ni le carême, ni les autres fêtes. Ils ne reçoivent pas l’Ancien Testament. Ils disent que ceux d’entre eux qui en sont capables doivent confier à leur mémoire les paroles des Écritures, afin de pouvoir enseigner les autres. Non seulement ce sont les hommes qui enseignent parmi eux, mais aussi les femmes — non en public toutefois, mais en particulier ». Enfin l’inquisiteur prétend qu’au lieu du mariage, ils pratiquaient l’impureté ; mais c’est sans doute parce qu’ils ne recouraient pas à un prêtre pour être mariés. Et quant à rejeter l’Ancien Testament, les propres documents des Vaudois prouvent le contraire. Il est probable aussi que la plupart ne possédaient que le Nouveau Testament en langue vulgaire, l’Ancien n’ayant pas été traduit. Il est vrai que certains hérétiques que l’on confondait volontiers avec eux, n’admettaient pas cette portion des Écritures comme venant de Dieu. Nous voyons donc que les choses que disaient les Vaudois, sont celles que toute personne soumise à la parole de Dieu affirme de nos jours contre l’Église de Rome. Mais leur grand crime était de juger que l’Église de Rome était impure et qu’il ne fallait pas écouter ses prêtres.
Parmi le peuple, les Vaudois passaient pour des espèces de sorciers qui se rassemblaient dans des caves obscures pour invoquer le diable qui venait au milieu d’eux sous une figure effrayante. On disait aussi que des démons leur apparaissaient sous forme de chats et de grenouilles ; mais le chroniqueur qui rapporte ces dires populaires, et qui était cependant leur ennemi, dit que ce sont des fables. « Ce qui les rend dangereux », ajoute-t-il, « c’est leur grande apparence de piété ».
Pour condamner, comme ils le faisaient, les enseignements et les prétentions de l’Église de Rome, les Vaudois s’appuyaient sur la Bible. C’est dans ce saint Livre également qu’ils puisaient leurs croyances. Ils professaient la nécessité de la nouvelle naissance, et la justification et le salut des pécheurs par la foi au Seigneur Jésus. Ils disaient aussi que la Bible est un livre fermé, si l’Esprit Saint n’illumine l’âme pour la faire comprendre. Leur attachement à la parole de Dieu était grand. Dès l’an 1203, plusieurs portions en avaient été traduites en langue vulgaire et répandues parmi le peuple. C’est ce qui donna lieu au décret du concile de Toulouse en 1229, défendant que ces écrits fussent mis entre les mains des laïques. Mais les Vaudois disaient que, pour comprendre la pensée du Seigneur, il fallait retourner à l’enseignement de Christ et de ses apôtres. C’était un des griefs de l’Église de Rome contre eux. « Ces hérétiques », dit un inquisiteur, « prétendent que les enseignements de Christ et de ses apôtres sont tout ce dont nous avons besoin pour le salut, sans les statuts de l’Église ». D’après leurs ennemis mêmes, l’étude de l’Écriture sainte était leur grande occupation. « Tous », dit un de leurs juges, « hommes et femmes, grands et petits, de jour et de nuit, ne font qu’étudier ou enseigner la Bible. L’ouvrier qui n’a pas de loisirs dans la journée, la lit de nuit, aussi négligent-ils leurs prières » (il veut dire la messe). Quel exemple pour nous ! Avons-nous cette soif salutaire de la divine Parole, nous chez qui elle est si abondamment répandue, qu’il n’est presque pas un enfant qui ne la possède ?
Les édits rendus contre eux par Rome et ses conciles n’empêchèrent pas les Vaudois de prescrire à toute personne âgée de vingt ans l’étude journalière de la Bible. Aussi partout dans l’Europe où ils étaient dispersés, leur foi et leurs enseignements étaient-ils les mêmes. Un de leurs ennemis qui, au 12° siècle, en avait vu quelques-uns dans les montagnes reculées où ils avaient cherché un refuge, dit ceci : « Ils sont vêtus de peaux de moutons, et ignorent l’usage du linge. Ils habitent, mêlés avec leur bétail, des huttes bâties en pierres de silex avec un toit plat recouvert de terre. Ils ont en outre deux grandes cavernes où ils se cachent quand ils sont poursuivis comme hérétiques. Mais pauvres comme ils le sont, ils se montrent contents, et bien qu’extérieurement rudes et sauvages, ils savent lire et écrire, et connaissent assez le français pour comprendre la Bible. On trouverait à peine parmi eux un jeune garçon qui ne pût rendre compte d’une manière intelligente de la foi qu’ils professent ».
Les Vaudois étaient remarquables par les portions étendues des Écritures qu’ils avaient apprises par cœur. Cela était bien nécessaire dans un temps où il fallait près d’une année pour copier un exemplaire de la Bible, et où un tel manuscrit était donc d’un prix très élevé. D’ailleurs les prêtres romains brûlaient toutes les portions des Écritures qui tombaient entre leurs mains, mais ils ne pouvaient pas toucher à ce qui était écrit dans la mémoire et dans le cœur. Les Vaudois du Piémont avaient des pasteurs nommés barbes, ce qui veut dire oncle, terme de respect et d’affection à la fois. La préparation des barbes au ministère de la Parole consistait à apprendre par cœur les évangiles de Matthieu et de Jean, toutes les épîtres, et la plus grande partie des Psaumes, des Proverbes et des prophètes. Des jeunes gens dans les vallées formaient des espèces de sociétés dont chaque membre devait apprendre par cœur un certain nombre de chapitres. Lorsqu’on s’assemblait pour le culte, souvent dans quelque coin écarté des montagnes, ces nouveaux Lévites, se tenant devant le pasteur, récitaient l’un après l’autre les chapitres du précieux volume. Qu’elle leur était chère cette Parole divine ! Ils payaient souvent de leur vie la gloire de la posséder et de la connaître ! L’inquisiteur Rainerio dit qu’il connaissait parmi eux un simple paysan qui pouvait réciter tout le livre de Job, et plusieurs qui savaient par cœur presque tout le Nouveau Testament. C’est cette connaissance des saintes lettres qui les rendait capables de résister à ceux qui voulaient les attirer dans l’Église romaine. Ils confondaient leurs ennemis. Un moine envoyé vers eux pour les convaincre de leurs erreurs, s’en retourna tout confus, disant que dans toute sa vie il n’avait appris autant des Écritures que dans les quelques jours qu’il avait passés avec ces hérétiques. Et les enfants étaient les dignes émules de leurs parents. Un des docteurs de la Sorbonne qui furent envoyés de Paris auprès des Vaudois, reconnaît qu’il avait plus appris et compris des doctrines du salut par les réponses des jeunes enfants, que dans toutes les disputes et discussions entre docteurs qu’il avait entendues. Jeunes lecteurs, êtes-vous comme ces enfants des Vaudois, connaissant dans votre intelligence et votre cœur les vérités du salut ? Bernard de Clairvaux, que l’on nomme saint Ber nard et qui avait combattu les Vaudois, dit aussi qu’ils défendaient leurs hérésies par les paroles de Christ et des apôtres.
Les Vaudois ne gardaient pas pour eux le trésor de la vérité que les Écritures leur avaient enseignée. Ils étaient infatigables dans leur zèle à la répandre. Et s’ils étaient persécutés et chassés dans d’autres contrées, ils y annonçaient la Parole, comme ceux de Jérusalem « dispersés par la tribulation … à l’occasion d’Étienne » (Actes 11:19-20). Leurs évangélistes qu’ils appelaient apôtres, c’est-à-dire envoyés, allaient ordinairement deux à deux, un vieillard et un jeune homme. Pour ne pas être reconnus, ils se déguisaient en colporteurs ou marchands ambulants portant des balles contenant de menus articles de toilettes, des voiles, des bagues, ou encore des couteaux, des épingles, des perles de verre. En échange, ils acceptaient des œufs, du fromage, des vêtements, car il leur était interdit de recevoir de l’argent. Arrivaient-ils chez un frère, ils étaient accueillis avec joie, et l’on s’empressait de leur donner l’hospitalité, car on pensait être agréable à Dieu en recevant ses messagers. Lisez sur ce sujet, Matthieu 10:40. Plusieurs de ces missionnaires étaient des étudiants en médecine ; en voyageant ils utilisaient leurs connaissances médicales. Mais leur grand but était le salut des pécheurs. Dans les châteaux comme dans les chaumières, aux riches et aux pauvres, partout où une porte leur était ouverte, ils annonçaient Jésus Christ.
Rainerio Sacchoni rapporte combien les Vaudois étaient ingénieux pour répandre leurs doctrines et nous dit comment ils procédaient. Ils se présentaient, par exemple, dans un château comme colporteurs, et montraient leurs marchandises au châtelain et à la châtelaine. « Messire », disaient-ils, « ne voudriez-vous pas acheter cette bague ou ce cachet ? Madame, qu’il vous plaise de jeter un coup d’œil sur ces mouchoirs, sur ces dentelles pour voiles. Je les vends bon marché ». Si après un achat, on demandait au marchand, s’il n’avait pas d’autres objets à offrir, il disait : « Oh ! oui ; j’ai des bijoux beaucoup plus précieux que ceux-ci, et je vous en ferai présent si vous me promettez de ne point me trahir ». La promesse étant donnée, il continuait : « J’ai une pierre précieuse venant de Dieu, un joyau d’un prix inestimable qui allume l’amour de Dieu dans le cœur de celui qui le possède. C’est la parole de Dieu par laquelle il communique aux hommes sa pensée ». Et alors le colporteur leur lisait ou leur récitait des portions des évangiles dont sa mémoire était bien fournie. S’il était encouragé à continuer, après avoir lu par exemple tout le premier chapitre de Luc, il répétait des passages tels que celui-ci : « Malheur à vous, car vous fermez le royaume des cieux aux hommes. Vous n’y entrez pas vous-mêmes, et vous ne leur permettez pas d’entrer. Malheur à vous qui dévorez les maisons des veuves, etc »., et il montrait que cela s’appliquait aux prêtres et aux moines. Souvent il laissait le manuscrit entre les mains de ses auditeurs. Mais le but de ces évangélistes était bien plus de faire connaître aux âmes l’amour de Dieu et de Christ et d’allumer cet amour dans les cœurs, que de parler contre le clergé.
Ceux qui, instruits par le Seigneur, avaient à cœur le bien de leurs frères, mais qui ne pouvaient pas voyager, écrivaient des lettres aux différentes assemblées, et les apôtres itinérants ou d’autres frères les portaient à leur destination. Il aurait été dangereux d’y mettre des adresses ; la suscription portait : « Aux frères chrétiens ». Les messagers savaient bien à qui les remettre. Partout où ils le pouvaient, les apôtres prêchaient, souvent en plein air. Les frères avaient aussi des réunions de prières et d’étude de la Parole, ainsi que des écoles pour les enfants. Ils avaient aussi tous l’habitude de rendre grâces avant les repas, et avaient un culte de famille. Les frères construisaient des asiles pour les pauvres et de modestes salles de prières attenantes, car ils n’estimaient pas qu’il fût nécessaire d’élever à grands frais de splendides églises pour y adorer Dieu. Ils savaient que le Seigneur Jésus se trouve là où deux trois sont réunis en son nom. Ils prenaient la cène en souvenir du Seigneur qui a donné sa vie pour nous, et pensaient que comme Christ nous a aimés, nous devons nous aimer les uns les autres.
En général, les Vaudois étaient haïs par le clergé romain et par ceux qui le suivaient aveuglément, il y avait cependant des catholiques qui, tout en restant attachés aux formes et aux cérémonies de l’Église, sympathisaient avec les frères et étaient en communion d’esprit avec eux. Une autre chose à remarquer, c’est que les frères et les évangélistes de ce temps-là n’avaient pas, sur plusieurs points de la parole de Dieu la lumière que nous avons, et qu’ainsi ils erraient en différentes choses ; mais ils aimaient le Seigneur, trouvaient leur bonheur dans la communion avec Dieu, et donnaient leur vie pour la vérité qu’ils connaissaient. Un homme que Dieu suscita, leur fut utile pour les éclairer : c’est Pierre Valdo, de Lyon, dont nous dirons quelques mots.
7.3.1 - Pierre Valdo
Pierre Valdo était un riche marchand de la ville de Lyon et vivait dans la seconde moitié du 12° siècle. Nous avons raconté comment l’Évangile avait été porté au IIe siècle dans cette grande cité et quelle cruelle persécution les fidèles y subirent. Dans la suite, de même que le reste de la chrétienté, l’Église de Lyon était tombée dans l’erreur et la superstition ; cependant des traditions évangéliques s’y étaient conservées, grâce au zèle et à la fidélité de quelques évêques qui avaient été à sa tête.
À l’époque où vivait Valdo, la masse du peuple était presque complètement ignorante, et les nobles, les plus illustres chevaliers même, ne savaient souvent ni lire, ni écrire. Avec le clergé, les marchands faisaient exception ; les nécessités de leur commerce exigeaient certaines connaissances. Pierre Valdo était donc lettré jusqu’à un certain point ; de plus, il était intelligent, de bonnes mœurs, pieux et bienfaisant, et honoré de tous. Quelques écrits des anciens pères de l’Église (*) étant tombés entre ses mains, il fut frappé de voir combien l’Église romaine s’était écartée du christianisme primitif. Le dogme de la transsubstantiation s’établissait alors, accompagné de l’adoration de l’hostie. Valdo ne put s’empêcher de voir dans l’un une chose contraire au simple bon sens, et dans l’autre une grossière idolâtrie. De plus, il avait remarqué que les Pères en appelaient constamment aux Écritures, les citant pour appuyer ce qu’ils enseignaient. Il conçut dès lors un grand désir de les connaître.
(*) Le lecteur se souvient que l’on nomme ainsi les hommes éminents par leur science et leur piété, tels que Justin, Irénée, Tertullien, Augustin, etc., qui enseignèrent dans l’Église par leurs prédications et leurs écrits. Mais ils étaient des hommes faillibles, errèrent sur plusieurs points et se contredirent souvent.
Jusque-là on ne peut pas dire que la conscience de Valdo eût été réveillée. Sans doute que, comme bon catholique, il comptait sur ses bonnes œuvres pour être sauvé. Mais Dieu lui adressa un sérieux et puissant appel. Un soir qu’il était à table quelques amis, l’un d’eux tomba mort subitement. Valdo fut saisi à la pensée de l’incertitude de la vie. Ne pouvait-il pas, lui aussi, être appelé tout à coup à paraître devant Dieu ? Était-il prêt à rencontrer la mort ? Que lui fallait-il faire pour être sauvé ? Dans son anxiété il consulta son confesseur, lui dit que le meilleur moyen pour assurer son salut était de faire ce que le Seigneur avait dit au jeune homme riche : « Vends tout ce que tu as, et donne aux pauvres ». Valdo n’hésita pas. Il donna à sa femme et à sa fille ce qui leur était nécessaire, paya ce qu’il devait, et distribua le reste. Cela était-il vraiment le remède pour apaiser la conscience et procurer la paix à l’âme ? Donner tous ses biens peut-il expier les péchés ? Non, assurément. Valdo le sentit et chercha dans les Écritures la réponse aux besoins de son âme. Mais à cette époque, la Bible n’avait pas été traduite dans les langues vulgaires de l’Europe occidentale. On n’en avait que la version latine appelée la Vulgate qui avait suffi aussi longtemps que l’empire romain avait subsisté et que le latin avait été la langue dominante en Occident. Valdo ne se découragea pas. Aidé par deux prêtres, il traduisit la Bible dans la langue courante, et là, dans la parole de Dieu, il apprit où se trouvait le salut, dans la foi au Seigneur Jésus, mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification.
Ayant ainsi trouvé la paix de son âme, il se sentit pressé d’annoncer à d’autres la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Comme nous l’avons dit, il distribuait ses biens aux pauvres ; mais en nourrissant leurs corps, il leur parlait des richesses impérissables de Christ. « Sa maison », dit un historien, « devint une florissante école et comme un hôpital public pour héberger et nourrir spécialement les pauvres qui venaient de dehors pour être instruits ».
À mesure que les Écritures devenaient plus familières à Valdo, il voyait plus clairement qu’elles condamnent bien des choses que l’Église de Rome enseigne, et qu’elles en renferment d’autres dont cette Église ne parle pas. Il avait donc deux choses à faire : premièrement, à apprendre et à faire connaître ce que l’Écriture enseigne, et secondement, à montrer que tout ce qui ne s’accorde pas avec elle est condamné. C’est ce qu’il faisait dans ses instructions à ceux qui venaient à lui, ou bien en allant de maison en maison pour annoncer la vérité. Il eut bientôt un grand nombre d’adhérents. Pour répandre la vérité qu’il avait apprise, il fit faire des copies des Écritures, et ayant formé un certain nombre de disciples, il les envoya deux à deux pour colporter et expliquer les saints écrits. Ils allaient donc prêchant l’Évangile dans les chemins et sur les places publiques, écoutés avec attention par les foules et gagnant des âmes.
Mais il n’était pas possible que ce mouvement demeurât caché au clergé qui ne pouvait non plus y être indifférent, puisque de fait Valdo et ses disciples condamnaient Rome, ses erreurs et les pratiques de ses prêtres. L’archevêque de Lyon leur enjoignit de ne plus se mêler de la lecture et de l’enseignement de la Bible, sous peine d’être excommuniés et poursuivis comme hérétiques. Mais ils répondirent par ces paroles de l’Écriture : « Le Seigneur a dit : Allez et instruisez toutes les nations », et : Il vaut mieux obéir à Dieu qu’aux hommes ». L’archevêque avait dit à Valdo : « Si tu enseignes encore, tu seras condamné et brûlé comme hérétique ». — « Comment tairais-je ce qui concerne le salut éternel des hommes ? » répondit avec hardiesse le pieux serviteur de Christ. L’archevêque irrité voulait le faire saisir, mais il craignit le peuple. Valdo d’ailleurs avait tant d’amis à Lyon, aussi bien parmi les riches que parmi les pauvres, tant d’âmes qui avaient été amenées au Sauveur par son moyen, qu’il put rester caché dans la ville pendant trois ans, enseignant, encourageant et fortifiant les fidèles.
Le pape Alexandre III apprit ce qui se passait à Lyon. Il excommunia Valdo et ordonna à l’archevêque de procéder avec la dernière rigueur contre lui et ses adhérents. Valdo se vit ainsi forcé de quitter Lyon avec un certain nombre de ses disciples, hommes et femmes, afin d’échapper aux persécutions. Dans la main de Dieu, ce fut un moyen de répandre au loin l’Évangile et la parole de Dieu dans toutes les contrées où ces fugitifs, qu’on appela « les pauvres de Lyon », portèrent leurs pas. Ils contribuèrent aussi à éclairer les nombreuses petites communautés qui n’acceptaient pas les erreurs de Rome, mais qui elles-mêmes n’étaient pas entièrement pures dans la foi. Elles étaient nombreuses et unies entre elles, puisque l’on dit qu’un de leurs membres pouvait voyager du sud de l’Italie au nord de l’Allemagne en logeant chaque soir chez un frère. En certaines contrées, comme aux environs de Trèves et dans le nord de l’Italie, ces communautés avaient des écoles publiques en plus grand nombre que les catholiques, et elles convoquaient les assemblées au son des cloches. Les persécutions exercées avec persévérance et cruauté par l’inquisition et le clergé eurent raison finalement de ces chrétiens qui refusaient de se soumettre à Rome ; il n’y eut que les vallées du Piémont où ils subsistèrent malgré tous les efforts de leurs ennemis, et où ils subirent les plus terribles persécutions, comme nous aurons l’occasion de le voir.
Pour revenir à Valdo, il se rendit, accompagné d’un grand nombre des siens, d’abord en Dauphiné dans les vallées de Freissinière, de Vallouise et de Valcluson, où se trouvaient d’anciennes communautés chrétiennes. De là plusieurs passèrent dans les vallées du Piémont où ils rencontrèrent les anciens Vaudois auxquels ils apportèrent leur traduction de la Bible. La persécution força Valdo à fuir de nouveau ; il alla en Picardie, puis en Allemagne et enfin en Bohême, travaillant toujours à l’œuvre du Seigneur. C’est dans cette dernière contrée qu’il termina paisiblement ses jours.
Quant aux disciples de Valdo, confondus sous le nom de Vaudois avec ceux que l’on nommait déjà ainsi, ils ne s’étaient pas, non plus que leur chef, séparés de l’Église. Ils réclamaient seulement l’autorisation de prêcher. Nécessairement Rome ne pouvait pas l’accorder. « Si nous le faisions », disait un prélat dans un concile, « on nous chasserait ». Malgré cela, ils continuèrent à évangéliser, et on les excommunia. Plusieurs se répandirent en Provence et en Espagne où ils eurent d’abord quelque succès, mais sous le règne d’Alphonse II, roi d’Aragon, ils furent aussi persécutés et chassés à l’instigation du clergé.
Pour terminer ce qui concerne les disciples de Valdo et les Vaudois, il faut ajouter qu’ils insistaient sur la doctrine capitale de l’Évangile, la justification par la foi, et qu’ils repoussaient toutes les cérémonies, les erreurs et les superstitions de l’Église romaine. Comme nous l’avons vu précédemment, ils étaient fermement attachés à la Bible, et se montraient recommandables par une vie pure qui contrastait avec celle que menait en général le clergé romain. N’est-ce pas une chose profondément intéressante de voir la puissance divine conserver, à travers les siècles et au milieu des efforts incessants d’adversaires acharnés, une lignée de témoins de la vérité évangélique, à part des souillures de la soi-disant vraie Église ? Ils formaient ce résidu dont parle le Seigneur dans sa lettre à Thyatire, et qui n’avait pas connu les profondeurs de Satan (Apocalypse 2:24).
7.3.2 - Les Albigeois — Pierre de Brueys et Henri de Lausanne
Comme nous l’avons vu, dès la fin du 10° siècle et le commencement du 11°, des missionnaires bulgares étaient venus dans la Haute Italie, puis étaient descendus jusqu’en Calabre. D’autres s’étaient dirigés vers la France, dans les Flandres et sur les bords du Rhin. Mais c’est surtout dans le sud-ouest de la France qu’ils gagnèrent le plus d’adhérents. L’avidité et la corruption du clergé qui attiraient sur lui le mépris et la haine du peuple, furent une des causes de leurs succès, et comme les nobles ne se pliaient qu’avec répugnance aux exigences et aux prétentions de domination des prêtres, les « sectaires » trouvaient près d’eux un appui.
On leur donnait, ou ils se donnaient à eux-mêmes, le nom de cathares, d’un mot grec qui veut dire pur. Ils se tenaient à part de l’Église de Rome et de ses cérémonies, niaient son autorité, enseignaient la simplicité apostolique, et rejetaient les doctrines des sacrements, du purgatoire, de la messe, etc. Quelques-uns d’entre leurs chefs, que l’on désignait sous le nom de bons hommes, semblent avoir tenu certaines graves erreurs manichéennes ; mais on ne les connaît guère que par les récits de leurs adversaires. Ce que l’on sait sûrement, c’est que leur vie austère et pure formait un contraste frappant avec celle des prêtres et des moines, et leur donnait un grand ascendant sur le peuple. Nous ne pouvons douter que parmi les cathares ne se trouvassent de vrais enfants de Dieu qui firent pour leur foi le sacrifice de leur vie. D’ailleurs nous avons vu que ceux des disciples de Valdo dispersés, qui vinrent parmi eux, leur apportèrent des lumières qui contribuèrent à épurer leurs croyances. Comme les cathares étaient surtout nombreux dans la ville d’Albi et la contrée environnante, on les désigna sous le nom d’Albigeois.
Avant de nous occuper plus spécialement des Albigeois, nous dirons quelques mots de deux hommes remarquables qui, dans la première moitié du 12° siècle, s’étaient mis en opposition avec l’Église de Rome, et vinrent prêcher dans les provinces méridionales de la France. C’étaient Pierre de Brueys et Henri de Lausanne.
Le premier était un prêtre qui, éclairé sans doute par les Écritures, commença vers l’an 1110 à s’élever contre la corruption de l’Église dominante et les vices du clergé. Son activité s’exerça surtout dans la Provence et le Languedoc. Il put, chose bien frappante, prêcher impunément durant l’espace de vingt ans. L’ennemi n’eut pas le pouvoir d’arrêter ce courageux témoin, jusqu’à ce qu’il eût achevé de rendre son témoignage. Pierre de Brueys disait que le baptême appliqué aux enfants ne les sauve pas ; il niait le mérite des œuvres pour le salut, et rejetait la transsubstantiation, les prières pour les morts, l’invocation des saints et le célibat des prêtres. Il combattait la suprématie de Rome et l’organisation ecclésiastique. « Ce sont les croyants », disait-il, « qui composent l’Église ». Il voulait dire que ce n’était pas le clergé, comme le prétend l’Église de Rome. Il prêchait la repentance et la réforme des mœurs, surtout celle des prêtres et des moines. Mais le zèle de Pierre de Brueys l’entraîna plus loin. Il aurait voulu qu’on démolît les églises, que l’on brûlât les croix et les objets d’un culte idolâtre. Il mit à exécution ce qu’il exhortait à faire, et à Saint-Gilles en Languedoc, il brûla un certain nombre de croix portant l’image de Christ (*). C’était trop. La multitude, excitée par les prêtres, se saisit de lui ; il fut traîné au bûcher et brûlé vif. C’était en l’année 1130. Mais les doctrines qu’il avait prêchées, ne pouvaient être si aisément extirpées. Il avait laissé des disciples, nommés d’après lui Pétrobusiens et que les flammes de son bûcher enhardirent plutôt qu’elles ne les découragèrent. Ils continuèrent à dévoiler hautement les misères de l’Église et du clergé.
(*) Des scènes analogues eurent lieu, en différents endroits, dans les premiers temps de la Réformation.
Henri de Lausanne fut un de ces courageux prédicateurs dont nous parlions. Il avait été moine à l’abbaye de Cluny. Dans la solitude du cloître, il s’était beaucoup occupé de l’étude du Nouveau Testament, et la parole infaillible de Dieu lui avait révélé la vraie nature du christianisme. Dès lors il brûla du désir de faire connaître aux autres la vérité telle qu’il l’avait puisée à sa divine source. Il commença à prêcher. Son apparence extérieure était bien propre à donner du poids et de l’autorité à sa parole. De haute taille, marchant nu-pieds, négligé sur sa personne, doué d’une voix puissante, jetant sur ses auditeurs des regards pleins de feu, précédé d’ailleurs partout où il allait par une grande réputation de science et de sainteté, tout en lui commandait l’attention de la multitude ; tandis que son éloquence entraînante, ses paroles profondes, son apparition extraordinaire frappaient d’effroi les prêtres, et lui attiraient l’approbation du peuple. Dans l’esprit de Jean le Baptiseur, il appelait les âmes à la repentance et exhortait le peuple à se tourner vers le Seigneur. En même temps il exposait les vices du clergé. Cela provoquait nécessairement l’opposition et la haine des prêtres et des moines, mais la multitude n’en était que plus fortement attirée vers lui. Les gens des basses classes aussi bien que les principaux bourgeois, tous se laissaient diriger par lui et le suivaient comme leur conducteur spirituel.
Pour autant que nous le savons, c’est à Lausanne qu’il commença sa mission, et de là lui vint son surnom. Il prêcha aussi la repentance dans la vallée du Léman, puis il se rendit au Mans, en France, vers l’an 1116. Il avait auparavant envoyé deux messages à Hildebert, évêque de cette ville, lequel l’accueillit favorablement. Henri fut encore mieux reçu par le peuple. Il exhortait, comme nous l’avons dit, à la repentance, et ainsi que Pierre de Brueys, il niait le mérite des œuvres pour le salut, s’élevait contre les superstitions romaines et la suprématie du pape. « Bientôt », dit un écrivain, « le résultat de sa prédication fut que les gens, comme enchaînés à sa personne, furent remplis de mépris et de haine envers le haut clergé, au point qu’ils ne voulurent plus avoir rien à faire avec lui. Ils ne suivaient plus les offices de l’Église romaine ; et même les prêtres se virent les objets de mauvais traitements de la part de la populace et durent recourir à la protection des magistrats ». Cela assurément était un mal, et nous aimons à penser qu’Henri n’approuvait pas ces excès. L’évêque Hildebert était allé à Rome ; à son retour le peuple du Mans refusa de recevoir sa bénédiction. Lorsque Hildebert s’aperçut de la grande influence qu’Henri exerçait dans son diocèse sur les jeunes prêtres et sur la multitude, au lieu de sévir contre lui il se contenta de lui assigner un autre champ de travail. L’évêque agit en cela en homme intelligent, et Dieu se servit de lui pour que son serviteur portât la lumière en d’autres endroits.
Henri s’éloigna tranquillement et alla rejoindre Pierre de Brueys en Provence. Là il poursuivit sa mission contre les abus et les erreurs de Rome d’une manière encore plus ouverte et plus décidée, s’attirant ainsi toute l’inimitié du clergé. La mort de Pierre de Brueys ne ralentit pas son zèle. Dieu lui accorda encore quelques années durant lesquelles il put poursuivre sans empêchement son œuvre. Mais enfin l’archevêque d’Arles le fit saisir, et le concile de Pise, en l’an 1134, le condamna à être enfermé en prison comme hérétique. Peu après cependant il fut relâché à condition d’aller dans une autre province. Henri se rendit en Languedoc, et là ses prédications eurent un effet si puissant que partout où il allait les églises se vidaient et que les ecclésiastiques étaient délaissés et même traités avec mépris.
Pour réprimer ce mouvement, le pape Eugène III, en 1147, envoya à Toulouse un légat. Celui-ci sentant toute la difficulté de sa mission, demanda à saint Bernard de Clairvaux de l’accompagner. Le vénérable abbé y consentit et annonça par écrit sa venue et le but de son voyage aux seigneurs du midi de la France : « Les églises », dit-il, « sont abandonnées ; le peuple est sans prêtres ; les prêtres sont sans honneur, et les chrétiens sans Christ. Les églises ne sont plus respectées comme des lieux consacrés ; les sacrements ne sont plus regardés comme saints ; les fêtes ne sont plus célébrées. Les hommes meurent dans leurs péchés — sans pénitence et sans viatique — et les âmes, sans y être préparées, entrent en présence du terrible tribunal. On refuse aux enfants le baptême, et ainsi ils sont exclus du salut ». On voit par ses paroles les progrès qu’avaient faits les doctrines antiromaines, et aussi quel était l’attachement de saint Bernard à la papauté dont il connaissait cependant tous les vices. Il parcourut les contrées troublées par ce que lui-même et les prêtres appelaient l’erreur ; il accomplit, prétendit-on, des miracles et purifia les églises souillées par l’hérésie. Le peuple crédule et entraîné par son éloquence, l’admira et un grand nombre retournèrent dans les églises abandonnées. Ainsi étant venu à Albi, où les disciples des cathares étaient plus nombreux, il prêcha dans l’église principale devant une grande multitude. Après son éloquente prédication, il dit : « Revenez, revenez à l’Église, et afin que nous sachions qui sont ceux qui se repentent, qu’ils lèvent la main au ciel ». Tous levèrent leur main droite. Il en fut de même à Toulouse. Mais là les tisserands et les principaux de la ville étaient seuls attachés aux doctrines cathares ; la masse du peuple y était étrangère. Une sentence fut rendue contre les hérétiques, et les seigneurs promirent de la faire exécuter. Quant à Henri il dut fuir. Poursuivi de lieu en lieu, il fut enfin saisi et incarcéré dans les cachots de l’archevêque de Toulouse. En 1148, la mort le délivra de ses persécuteurs et l’introduisit dans le repos éternel.
L’influence exercée par le zèle et l’éloquence de Bernard de Clairvaux fut de courte durée. Les doctrines cathares reprirent le dessus, épurées, comme nous l’avons dit, par l’action des Vaudois de Lyon, chassés par la persécution, et qui apportaient avec eux les Écritures. Pour combattre ce mouvement, une conférence fut convoquée en 1165 par l’évêque d’Albi. On y invita quelques « bonshommes », ou chefs des cathares. Après qu’on les eut interrogés, on les déclara hérétiques, mais on n’osa rien décréter contre eux. L’un d’entre eux rendit un témoignage remarquable de leur foi. Après avoir hardiment affirmé qu’il était prêt à prouver par le Nouveau Testament que les prêtres, leurs ennemis, au lieu d’être de bons pasteurs n’étaient que des mercenaires, il ajouta : « Écoutez, ô bonnes gens, écoutez cette profession de foi : Nous croyons à un seul Dieu, à son Fils Jésus Christ, à la communication du Saint Esprit aux apôtres, à la résurrection, à la nécessité du baptême et de l’eucharistie ».
Le pape Innocent III (de l’an 1198 à 1216), homme plein d’énergie, résolut d’en finir avec cette hérésie sans cesse renaissante et qui s’étendait toujours plus. Il envoya d’abord en Languedoc comme légats, l’inquisiteur Rainerio Sacchoni et un autre. Leur mission était de chercher à convertir les Cathares. Douze abbés de Cîteaux (*) les accompagnaient. Le pape chargea ensuite deux autres légats, dont l’un était Pierre de Castelnau, de poursuivre cette œuvre. Diégo, évêque d’Ossuna, et Dominique, son sous-prieur, le fondateur de l’ordre des Dominicains et de l’inquisition, se joignirent à eux. Dominique, voyant que ses efforts et ceux de ses compagnons étaient infructueux, leur conseilla d’aller nu-pieds, pauvrement vêtus, sans argent, imitant dans tout leur extérieur les « parfaits », ou chefs des cathares. Ils s’insinuaient ainsi auprès des soi-disant hérétiques, et tout en cherchant à les ramener dans l’Église romaine, ils s’informaient de leurs croyances et de tout ce dont plus tard ils pourraient se faire une arme contre eux. Leurs efforts furent sans résultat, et le pape vit qu’il fallait prendre d’autres mesures et se servir d’autres armes.
(*) Cîteaux est un village de la Côte-d’Or, près duquel était une abbaye de religieux nommés Cisterciens, du nom latin du village (Cistercium). Cet ordre de moines prit dans le Moyen Âge une très grande extension.
Les Albigeois croyant aux intentions pacifiques du pape, demandèrent une conférence publique. Pour gagner du temps, Innocent l’accorda. Les évêques et les moines acceptèrent le débat, et l’on se réunit à Montréal, près de Carcassone. Des arbitres furent nommés des deux parts. Les Albigeois avaient désigné un de leurs diacres, Arnaud Hot, pour soutenir leurs croyances par la parole de Dieu. Il entreprit de prouver :
1° Que la messe avec la transsubstantiation était d’invention humaine et non de l’ordonnance de Jésus Christ et des apôtres.
2° Que l’Église romaine n’était pas l’Épouse de Christ, mais plutôt une église de trouble, enivrée du sang des martyrs.
3° Que la police de l’Église romaine n’est ni bonne, ni sainte, ni établie par Jésus Christ.
On voit avec quelle hardiesse les Albigeois se présentaient devant leurs ennemis, et quelle confiance ils avaient dans la vérité des doctrines qu’ils soutenaient. La conférence dura quatre jours. Arnaud Hot provoqua l’admiration des assistants par son éloquence. Quant aux prêtres, ils ne purent prouver leurs thèses ni par Jésus Christ, ni par les apôtres. La question principale qui fut traitée était celle de l’eucharistie. Arnaud démontra sans peine que « selon la doctrine de la transsubstantiation, le pain n’existe plus, puis qu’il est changé dans le corps de Christ. La messe est donc sans le pain, et en conséquence n’est pas la Cène du Seigneur, où il y a du pain. Le prêtre rompt le corps, puisque l’hostie est devenue le corps de Christ ; il ne rompt donc pas le pain, et ainsi il ne fait pas ce qu’ont fait Jésus Christ et Paul ». Les légats, les évêques, les prêtres et les moines, pleins de honte et de déplaisir, ne voulurent pas en entendre davantage et se retirèrent.
Pendant ce temps, le pape avait envoyé dans toute l’Europe des prédicateurs chargés d’annoncer une croisade pour écraser l’hérésie dans le sud de la France. « Nous vous exhortons », disaient-ils, « à vous efforcer de détruire la méchante hérésie des Albigeois, et de les traiter avec plus de rigueur que les Sarrasins même. Poursuivez-les avec une main forte ; privez-les de leurs terres et de leurs possessions ; chassez-les et mettez des catholiques à leur place ». Tel était le langage de ceux qui se disaient les ministres de Jésus, de Celui qui ne voulait pas que ses disciples fissent descendre le feu du ciel sur ceux qui refusaient de le recevoir (Luc 9:51-56). À ceux qui s’engageaient à prendre les armes pendant quarante jours contre les hérétiques, on promettait la rémission de tous leurs péchés et le paradis. Cette prédication de sang fut entendue, comme nous le verrons.
Toulouse et son comté étaient un des principaux centres des Albigeois, et avaient alors pour seigneur Raymond, sixième comte de Toulouse. C’était un prince sage, humain et paisible. Bien que catholique, et regrettant que les Albigeois ne fussent pas attachés à l’Église romaine, il les tolérait et les protégeait, voyant en eux des sujets loyaux, fidèles, qui s’appliquaient au travail et contribuaient à la prospérité de la contrée. En 1207, le pape lui envoya, comme légat, Pierre de Castelnau pour le sommer d’exterminer par le fer et le feu ses sujets hérétiques, s’ils ne voulaient pas abjurer leurs erreurs et rentrer dans le giron de l’Église. Deux fois Raymond refusa et deux fois il fut excommunié par le légat, et son pays placé sous l’interdit. Le pape approuva les faits de son légat et écrivit à Raymond une lettre où ressort tout l’orgueil et l’arrogance de celui qui se nommait le serviteur des serviteurs du Seigneur, mais qui en même temps fut le premier à s’intituler « Vicaire de Dieu sur la terre ». « Homme pire que la peste », disait-il, « tyran ambitieux, cruel et horrible ! Quel orgueil s’est emparé de ton cœur et combien grande est ta folie, que tu troubles la paix de ton prochain, et que tu braves les saints commandements de Dieu, en protégeant les ennemis de la foi ! Si tu ne crains pas les flammes éternelles, tu dois redouter les châtiments temporels que tu as mérités par tant de méfaits. Car en vérité l’Église ne peut être en paix avec le chef d’aventuriers et de brigands, avec le protecteur des hérétiques, le contempteur des saints commandements, l’ami des Juifs et des usuriers, l’ennemi des prélats, et le persécuteur de Jésus Christ et de son Église. Le bras du Seigneur restera étendu contre toi jusqu’à ce que tu sois réduit en poussière. En vérité, il te fera sentir combien il est difficile d’échapper à la colère que tu as amassée sur ta tête ! »
Contre qui et pourquoi le pape lançait-il de si terribles menaces ? Contre un prince qui ne voulait pas servir de bourreau aux prêtres et verser le sang innocent de ses fidèles et laborieux sujets. Et cependant si grande était la puissance et l’autorité de ce chef de la chrétienté, et telle la crainte qu’inspiraient ses anathèmes, que Raymond s’inclina devant sa volonté. Il signa un écrit par lequel il s’engageait à détruire tous les hérétiques qui se trouvaient dans ses domaines. Mais il ne pressa la persécution qu’avec mollesse et hésitation. Le légat s’en aperçut, et brûlant d’indignation, il se répandit en invectives violentes contre le comte, le traitant de lâche et de parjure, et l’excommuniant de nouveau. Devant cette insolence, comment s’étonner que Raymond, profondément blessé, se soit laissé aller à la colère ? Dans un moment à déplorer, il se serait écrié, dit-on, que Pierre de Castelnau paierait de sa vie son impudence. Quoi qu’il en soit, un de ses chevaliers, jaloux de l’honneur de son seigneur, se rendit auprès du légat, et lui adressa des remontrances au sujet de sa conduite vis-à-vis de Raymond. Comme le légat lui répondait avec la même hauteur, le chevalier irrité le perça de son poignard et le blessa mortellement.
Le meurtre de Pierre de Castelnau fournit à Innocent III une occasion favorable pour faire sentir au comte Raymond le poids de sa colère. Pierre de Castelnau fut exalté comme martyr, Raymond fut déclaré coupable d’avoir été le premier auteur du crime, et mis au ban de l’Église. Les fidèles furent sommés de venir aider à sa destruction, et une croisade fut prêchée contre les Albigeois. « Debout ! soldats du Christ », écrivit Innocent III à Philippe Auguste, roi de France, « debout, roi très chrétien, écoute le cri du sang. Aide-nous à tirer vengeance de ces malfaiteurs ! Debout ! nobles et chevaliers de France ! Les riches campagnes du midi seront le prix de votre vaillance ! » La prédication de la croisade fut confiée aux Cisterciens sous la direction de leur fanatique abbé Arnoult, « homme », écrit un historien, « dont le cœur était renfermé sous la triple cuirasse de l’orgueil, de la cruauté et de la superstition ». Dominique, le fondateur de l’inquisition, lui fut adjoint. Toutes les indulgences promises à ceux qui prenaient la croix (*) pour la délivrance du saint sépulcre, furent assurées à ceux qui prendraient part à la croisade contre Raymond et les Albigeois. Les prêtres faisaient partout valoir cette occasion facile d’obtenir le pardon de tous les péchés et la vie éternelle.
(*) Ceux qui s’engageaient dans ces expéditions portaient une croix rouge sur l’épaule droite.
À l’appel du pape, une armée de 300000 hommes se rassembla sur les frontières des malheureuses provinces que gouvernaient Raymond et d’autres seigneurs. Trois corps de troupes furent formés. À la tête de chacun se trouvaient un archevêque, un évêque et un abbé. Le commandement en chef fut donné au fameux Simon de Montfort, homme vaillant, mais ambitieux, avide de possessions et d’honneurs, et entièrement dévoué au pape et à son Église.
Raymond, incapable de résister à des forces aussi considérables, se soumit aux exigences du pape. Celui-ci promit de lever l’interdit sous certaines conditions. Raymond devait se laver de toute participation au meurtre de Pierre de Castelnau ; livrer sept de ses meilleurs châteaux forts comme preuve de la réalité de sa repentance ; faire pénitence publique pour ses fautes passées, et enfin se joindre aux croisés contre ses propres sujets et en particulier contre son neveu Roger, comte de Béziers. Raymond se récria contre la rigueur de ces conditions, mais en vain ; elles devaient être exécutées à la lettre. Il subit la pénitence publique. Il reçut l’absolution dans l’église de Saint-Égidius, en présence de trois archevêques et de dix-neuf évêques. Ensuite on le conduisit à la cathédrale où Castelnau avait été enterré. Le dos nu, portant autour du cou une corde dont deux évêques tenaient les bouts, il arriva à la porte de l’église et là dut jurer sur l’hostie qu’il obéirait à la sainte Église romaine. Puis sur la tombe de Castelnau il s’agenouilla, et sur ses épaules nues tombèrent des coups de fouet avec une telle violence et qui le mirent dans un tel état que, lorsqu’il put échapper à ses bourreaux et aux regards de la foule qui contemplait l’incroyable humiliation de son souverain, il dut sortir par une porte de derrière. Telle était la douceur de l’Église romaine, cette sainte mère, comme elle s’appelle. Il restait à Raymond à accomplir la partie la plus douloureuse de sa pénitence, celle de prendre les armes contre ses sujets et son neveu.
L’armée des croisés se mit alors en mouvement excitée par les prêtres et les moines fanatiques. « En avant », disaient ceux-ci. « Mettez à mort les hérétiques ; dévastez tout, n’épargnez rien. La mesure de leur iniquité est comble et la bénédiction de l’Église repose sur vous ». Était-ce là l’esprit de Christ qui, lorsque ses disciples lui demandaient que le feu du ciel descendît sur ceux qui ne le recevaient pas, leur disait : « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Le fils de l’homme n’est pas venu pour détruire les vies des hommes, mais pour les sauver » ? L’armée se répandit comme un torrent sur les campagnes fertiles du Languedoc et mit tout à feu et à sang, dévastant, pillant et tuant ou brûlant les habitants sans défense.
Roger, comte de Béziers, neveu de Raymond, résolut de protéger ses sujets contre la violence des Croisés. Ses deux villes fortes étaient Béziers et Carcassonne. Bientôt parurent, sous les murs de la première de ces villes, ceux qui se nommaient « les défenseurs de la croix, les prêtres du Seigneur ». Raymond n’était resté que quelques jours avec eux ; il était allé à Rome s’humilier devant le pape. Roger se rendit d’abord auprès du légat du pape, lui disant qu’il y avait dans la ville plusieurs habitants fidèles à la foi catholique et qu’il le suppliait de ne pas faire périr les innocents avec les coupables. Il lui fut répondu que pour sauver la ville, les Albigeois devaient renoncer à leur foi et promettre qu’ils se soumettraient à l’Église romaine.
Cette réponse fut rapportée aux habitants, et les Albigeois furent pressés d’accepter les conditions proposées ; ainsi ils sauveraient eux-mêmes et les catholiques. C’était une pénible position pour les Albigeois, mais ils déclarèrent à leurs concitoyens qu’ils ne pouvaient renoncer à leur foi et qu’ils préféraient mourir. Ils laissaient aux catholiques et à Roger de faire pour eux-mêmes les meilleures conditions qu’ils pourraient.
Voyant qu’ils ne pouvaient ébranler la résolution des Albigeois, les catholiques eurent recours à leur évêque qui était auprès du légat. L’évêque supplia celui-ci de les épargner, en lui représentant qu’ils étaient toujours restés fidèles à l’Église, et qu’ils ne devaient pas être massacrés avec les Albigeois, et même que ceux-ci pourraient être gagnés par la bonté. La réponse du légat fut brève et sévère ; la ville devait se rendre, et à moins que tous ne confessassent leur péché et ne revinssent à l’Église, tous partageraient le même sort. Les Albigeois persistèrent dans leur résolution de ne point abandonner une foi qui leur avait acquis le royaume de Dieu et sa justice. Les habitants catholiques eux-mêmes, comprenant qu’il n’y avait rien à espérer, même pour eux, déclarèrent qu’ils aimaient mieux mourir que de livrer leur ville à l’ennemi. Quand le légat apprit cette réponse, il s’écria avec fureur : « Qu’il ne reste donc pas pierre sur pierre de cette ville ; que l’épée et le feu dévorent hommes, femmes et enfants ! ».
Après un siège de courte durée, la ville dut se rendre à discrétion, et la menace d’Arnoult fut exécutée de la manière la plus effroyable. On lui avait demandé comment distinguer les catholiques des Albigeois, afin d’épargner les premiers : « Tuez-les tous », répondit-il ; « le Seigneur connaît ceux qui sont siens ». Le massacre commença sans distinction de rang, d’âge ou de sexe. Les prêtres même et les religieux, reconnaissables les uns et les autres à leur costume, ne furent pas épargnés. Des femmes et des enfants s’étaient réfugiés dans les églises, pensant trouver un asile dans ces enceintes sacrées, mais en vain ; la main des serviteurs de la sainte Mère Église les y égorgeait. Personne n’échappa des 23000 habitants de Béziers ; puis la ville fut pillée et brûlée.
Parmi le peuple, les Vaudois passaient pour des espèces de sorciers qui se rassemblaient dans des caves obscures pour invoquer le diable qui venait au milieu d’eux sous une figure effrayante. On disait aussi que des démons leur apparaissaient sous forme de chats et de grenouilles ; mais le chroniqueur qui rapporte ces dires populaires, et qui était cependant leur ennemi, dit que ce sont des fables. « Ce qui les rend dangereux », ajoute-t-il, « c’est leur grande apparence de piété ».
Pour condamner, comme ils le faisaient, les enseignements et les prétentions de l’Église de Rome, les Vaudois s’appuyaient sur la Bible. C’est dans ce saint Livre également qu’ils puisaient leurs croyances. Ils professaient la nécessité de la nouvelle naissance, et la justification et le salut des pécheurs par la foi au Seigneur Jésus. Ils disaient aussi que la Bible est un livre fermé, si l’Esprit Saint n’illumine l’âme pour la faire comprendre. Leur attachement à la parole de Dieu était grand. Dès l’an 1203, plusieurs portions en avaient été traduites en langue vulgaire et répandues parmi le peuple. C’est ce qui donna lieu au décret du concile de Toulouse en 1229, défendant que ces écrits fussent mis entre les mains des laïques. Mais les Vaudois disaient que, pour comprendre la pensée du Seigneur, il fallait retourner à l’enseignement de Christ et de ses apôtres. C’était un des griefs de l’Église de Rome contre eux. « Ces hérétiques », dit un inquisiteur, « prétendent que les enseignements de Christ et de ses apôtres sont tout ce dont nous avons besoin pour le salut, sans les statuts de l’Église ». D’après leurs ennemis mêmes, l’étude de l’Écriture sainte était leur grande occupation. « Tous », dit un de leurs juges, « hommes et femmes, grands et petits, de jour et de nuit, ne font qu’étudier ou enseigner la Bible. L’ouvrier qui n’a pas de loisirs dans la journée, la lit de nuit, aussi négligent-ils leurs prières » (il veut dire la messe). Quel exemple pour nous ! Avons-nous cette soif salutaire de la divine Parole, nous chez qui elle est si abondamment répandue, qu’il n’est presque pas un enfant qui ne la possède ?
Les édits rendus contre eux par Rome et ses conciles n’empêchèrent pas les Vaudois de prescrire à toute personne âgée de vingt ans l’étude journalière de la Bible. Aussi partout dans l’Europe où ils étaient dispersés, leur foi et leurs enseignements étaient-ils les mêmes. Un de leurs ennemis qui, au 12° siècle, en avait vu quelques-uns dans les montagnes reculées où ils avaient cherché un refuge, dit ceci : « Ils sont vêtus de peaux de moutons, et ignorent l’usage du linge. Ils habitent, mêlés avec leur bétail, des huttes bâties en pierres de silex avec un toit plat recouvert de terre. Ils ont en outre deux grandes cavernes où ils se cachent quand ils sont poursuivis comme hérétiques. Mais pauvres comme ils le sont, ils se montrent contents, et bien qu’extérieurement rudes et sauvages, ils savent lire et écrire, et connaissent assez le français pour comprendre la Bible. On trouverait à peine parmi eux un jeune garçon qui ne pût rendre compte d’une manière intelligente de la foi qu’ils professent ».
Les Vaudois étaient remarquables par les portions étendues des Écritures qu’ils avaient apprises par cœur. Cela était bien nécessaire dans un temps où il fallait près d’une année pour copier un exemplaire de la Bible, et où un tel manuscrit était donc d’un prix très élevé. D’ailleurs les prêtres romains brûlaient toutes les portions des Écritures qui tombaient entre leurs mains, mais ils ne pouvaient pas toucher à ce qui était écrit dans la mémoire et dans le cœur. Les Vaudois du Piémont avaient des pasteurs nommés barbes, ce qui veut dire oncle, terme de respect et d’affection à la fois. La préparation des barbes au ministère de la Parole consistait à apprendre par cœur les évangiles de Matthieu et de Jean, toutes les épîtres, et la plus grande partie des Psaumes, des Proverbes et des prophètes. Des jeunes gens dans les vallées formaient des espèces de sociétés dont chaque membre devait apprendre par cœur un certain nombre de chapitres. Lorsqu’on s’assemblait pour le culte, souvent dans quelque coin écarté des montagnes, ces nouveaux Lévites, se tenant devant le pasteur, récitaient l’un après l’autre les chapitres du précieux volume. Qu’elle leur était chère cette Parole divine ! Ils payaient souvent de leur vie la gloire de la posséder et de la connaître ! L’inquisiteur Rainerio dit qu’il connaissait parmi eux un simple paysan qui pouvait réciter tout le livre de Job, et plusieurs qui savaient par cœur presque tout le Nouveau Testament. C’est cette connaissance des saintes lettres qui les rendait capables de résister à ceux qui voulaient les attirer dans l’Église romaine. Ils confondaient leurs ennemis. Un moine envoyé vers eux pour les convaincre de leurs erreurs, s’en retourna tout confus, disant que dans toute sa vie il n’avait appris autant des Écritures que dans les quelques jours qu’il avait passés avec ces hérétiques. Et les enfants étaient les dignes émules de leurs parents. Un des docteurs de la Sorbonne qui furent envoyés de Paris auprès des Vaudois, reconnaît qu’il avait plus appris et compris des doctrines du salut par les réponses des jeunes enfants, que dans toutes les disputes et discussions entre docteurs qu’il avait entendues. Jeunes lecteurs, êtes-vous comme ces enfants des Vaudois, connaissant dans votre intelligence et votre cœur les vérités du salut ? Bernard de Clairvaux, que l’on nomme saint Ber nard et qui avait combattu les Vaudois, dit aussi qu’ils défendaient leurs hérésies par les paroles de Christ et des apôtres.
Les Vaudois ne gardaient pas pour eux le trésor de la vérité que les Écritures leur avaient enseignée. Ils étaient infatigables dans leur zèle à la répandre. Et s’ils étaient persécutés et chassés dans d’autres contrées, ils y annonçaient la Parole, comme ceux de Jérusalem « dispersés par la tribulation … à l’occasion d’Étienne » (Actes 11:19-20). Leurs évangélistes qu’ils appelaient apôtres, c’est-à-dire envoyés, allaient ordinairement deux à deux, un vieillard et un jeune homme. Pour ne pas être reconnus, ils se déguisaient en colporteurs ou marchands ambulants portant des balles contenant de menus articles de toilettes, des voiles, des bagues, ou encore des couteaux, des épingles, des perles de verre. En échange, ils acceptaient des œufs, du fromage, des vêtements, car il leur était interdit de recevoir de l’argent. Arrivaient-ils chez un frère, ils étaient accueillis avec joie, et l’on s’empressait de leur donner l’hospitalité, car on pensait être agréable à Dieu en recevant ses messagers. Lisez sur ce sujet, Matthieu 10:40. Plusieurs de ces missionnaires étaient des étudiants en médecine ; en voyageant ils utilisaient leurs connaissances médicales. Mais leur grand but était le salut des pécheurs. Dans les châteaux comme dans les chaumières, aux riches et aux pauvres, partout où une porte leur était ouverte, ils annonçaient Jésus Christ.
Rainerio Sacchoni rapporte combien les Vaudois étaient ingénieux pour répandre leurs doctrines et nous dit comment ils procédaient. Ils se présentaient, par exemple, dans un château comme colporteurs, et montraient leurs marchandises au châtelain et à la châtelaine. « Messire », disaient-ils, « ne voudriez-vous pas acheter cette bague ou ce cachet ? Madame, qu’il vous plaise de jeter un coup d’œil sur ces mouchoirs, sur ces dentelles pour voiles. Je les vends bon marché ». Si après un achat, on demandait au marchand, s’il n’avait pas d’autres objets à offrir, il disait : « Oh ! oui ; j’ai des bijoux beaucoup plus précieux que ceux-ci, et je vous en ferai présent si vous me promettez de ne point me trahir ». La promesse étant donnée, il continuait : « J’ai une pierre précieuse venant de Dieu, un joyau d’un prix inestimable qui allume l’amour de Dieu dans le cœur de celui qui le possède. C’est la parole de Dieu par laquelle il communique aux hommes sa pensée ». Et alors le colporteur leur lisait ou leur récitait des portions des évangiles dont sa mémoire était bien fournie. S’il était encouragé à continuer, après avoir lu par exemple tout le premier chapitre de Luc, il répétait des passages tels que celui-ci : « Malheur à vous, car vous fermez le royaume des cieux aux hommes. Vous n’y entrez pas vous-mêmes, et vous ne leur permettez pas d’entrer. Malheur à vous qui dévorez les maisons des veuves, etc »., et il montrait que cela s’appliquait aux prêtres et aux moines. Souvent il laissait le manuscrit entre les mains de ses auditeurs. Mais le but de ces évangélistes était bien plus de faire connaître aux âmes l’amour de Dieu et de Christ et d’allumer cet amour dans les cœurs, que de parler contre le clergé.
Ceux qui, instruits par le Seigneur, avaient à cœur le bien de leurs frères, mais qui ne pouvaient pas voyager, écrivaient des lettres aux différentes assemblées, et les apôtres itinérants ou d’autres frères les portaient à leur destination. Il aurait été dangereux d’y mettre des adresses ; la suscription portait : « Aux frères chrétiens ». Les messagers savaient bien à qui les remettre. Partout où ils le pouvaient, les apôtres prêchaient, souvent en plein air. Les frères avaient aussi des réunions de prières et d’étude de la Parole, ainsi que des écoles pour les enfants. Ils avaient aussi tous l’habitude de rendre grâces avant les repas, et avaient un culte de famille. Les frères construisaient des asiles pour les pauvres et de modestes salles de prières attenantes, car ils n’estimaient pas qu’il fût nécessaire d’élever à grands frais de splendides églises pour y adorer Dieu. Ils savaient que le Seigneur Jésus se trouve là où deux trois sont réunis en son nom. Ils prenaient la cène en souvenir du Seigneur qui a donné sa vie pour nous, et pensaient que comme Christ nous a aimés, nous devons nous aimer les uns les autres.
En général, les Vaudois étaient haïs par le clergé romain et par ceux qui le suivaient aveuglément, il y avait cependant des catholiques qui, tout en restant attachés aux formes et aux cérémonies de l’Église, sympathisaient avec les frères et étaient en communion d’esprit avec eux. Une autre chose à remarquer, c’est que les frères et les évangélistes de ce temps-là n’avaient pas, sur plusieurs points de la parole de Dieu la lumière que nous avons, et qu’ainsi ils erraient en différentes choses ; mais ils aimaient le Seigneur, trouvaient leur bonheur dans la communion avec Dieu, et donnaient leur vie pour la vérité qu’ils connaissaient. Un homme que Dieu suscita, leur fut utile pour les éclairer : c’est Pierre Valdo, de Lyon, dont nous dirons quelques mots.
7.3.1 - Pierre Valdo
Pierre Valdo était un riche marchand de la ville de Lyon et vivait dans la seconde moitié du 12° siècle. Nous avons raconté comment l’Évangile avait été porté au IIe siècle dans cette grande cité et quelle cruelle persécution les fidèles y subirent. Dans la suite, de même que le reste de la chrétienté, l’Église de Lyon était tombée dans l’erreur et la superstition ; cependant des traditions évangéliques s’y étaient conservées, grâce au zèle et à la fidélité de quelques évêques qui avaient été à sa tête.
À l’époque où vivait Valdo, la masse du peuple était presque complètement ignorante, et les nobles, les plus illustres chevaliers même, ne savaient souvent ni lire, ni écrire. Avec le clergé, les marchands faisaient exception ; les nécessités de leur commerce exigeaient certaines connaissances. Pierre Valdo était donc lettré jusqu’à un certain point ; de plus, il était intelligent, de bonnes mœurs, pieux et bienfaisant, et honoré de tous. Quelques écrits des anciens pères de l’Église (*) étant tombés entre ses mains, il fut frappé de voir combien l’Église romaine s’était écartée du christianisme primitif. Le dogme de la transsubstantiation s’établissait alors, accompagné de l’adoration de l’hostie. Valdo ne put s’empêcher de voir dans l’un une chose contraire au simple bon sens, et dans l’autre une grossière idolâtrie. De plus, il avait remarqué que les Pères en appelaient constamment aux Écritures, les citant pour appuyer ce qu’ils enseignaient. Il conçut dès lors un grand désir de les connaître.
(*) Le lecteur se souvient que l’on nomme ainsi les hommes éminents par leur science et leur piété, tels que Justin, Irénée, Tertullien, Augustin, etc., qui enseignèrent dans l’Église par leurs prédications et leurs écrits. Mais ils étaient des hommes faillibles, errèrent sur plusieurs points et se contredirent souvent.
Jusque-là on ne peut pas dire que la conscience de Valdo eût été réveillée. Sans doute que, comme bon catholique, il comptait sur ses bonnes œuvres pour être sauvé. Mais Dieu lui adressa un sérieux et puissant appel. Un soir qu’il était à table quelques amis, l’un d’eux tomba mort subitement. Valdo fut saisi à la pensée de l’incertitude de la vie. Ne pouvait-il pas, lui aussi, être appelé tout à coup à paraître devant Dieu ? Était-il prêt à rencontrer la mort ? Que lui fallait-il faire pour être sauvé ? Dans son anxiété il consulta son confesseur, lui dit que le meilleur moyen pour assurer son salut était de faire ce que le Seigneur avait dit au jeune homme riche : « Vends tout ce que tu as, et donne aux pauvres ». Valdo n’hésita pas. Il donna à sa femme et à sa fille ce qui leur était nécessaire, paya ce qu’il devait, et distribua le reste. Cela était-il vraiment le remède pour apaiser la conscience et procurer la paix à l’âme ? Donner tous ses biens peut-il expier les péchés ? Non, assurément. Valdo le sentit et chercha dans les Écritures la réponse aux besoins de son âme. Mais à cette époque, la Bible n’avait pas été traduite dans les langues vulgaires de l’Europe occidentale. On n’en avait que la version latine appelée la Vulgate qui avait suffi aussi longtemps que l’empire romain avait subsisté et que le latin avait été la langue dominante en Occident. Valdo ne se découragea pas. Aidé par deux prêtres, il traduisit la Bible dans la langue courante, et là, dans la parole de Dieu, il apprit où se trouvait le salut, dans la foi au Seigneur Jésus, mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification.
Ayant ainsi trouvé la paix de son âme, il se sentit pressé d’annoncer à d’autres la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Comme nous l’avons dit, il distribuait ses biens aux pauvres ; mais en nourrissant leurs corps, il leur parlait des richesses impérissables de Christ. « Sa maison », dit un historien, « devint une florissante école et comme un hôpital public pour héberger et nourrir spécialement les pauvres qui venaient de dehors pour être instruits ».
À mesure que les Écritures devenaient plus familières à Valdo, il voyait plus clairement qu’elles condamnent bien des choses que l’Église de Rome enseigne, et qu’elles en renferment d’autres dont cette Église ne parle pas. Il avait donc deux choses à faire : premièrement, à apprendre et à faire connaître ce que l’Écriture enseigne, et secondement, à montrer que tout ce qui ne s’accorde pas avec elle est condamné. C’est ce qu’il faisait dans ses instructions à ceux qui venaient à lui, ou bien en allant de maison en maison pour annoncer la vérité. Il eut bientôt un grand nombre d’adhérents. Pour répandre la vérité qu’il avait apprise, il fit faire des copies des Écritures, et ayant formé un certain nombre de disciples, il les envoya deux à deux pour colporter et expliquer les saints écrits. Ils allaient donc prêchant l’Évangile dans les chemins et sur les places publiques, écoutés avec attention par les foules et gagnant des âmes.
Mais il n’était pas possible que ce mouvement demeurât caché au clergé qui ne pouvait non plus y être indifférent, puisque de fait Valdo et ses disciples condamnaient Rome, ses erreurs et les pratiques de ses prêtres. L’archevêque de Lyon leur enjoignit de ne plus se mêler de la lecture et de l’enseignement de la Bible, sous peine d’être excommuniés et poursuivis comme hérétiques. Mais ils répondirent par ces paroles de l’Écriture : « Le Seigneur a dit : Allez et instruisez toutes les nations », et : Il vaut mieux obéir à Dieu qu’aux hommes ». L’archevêque avait dit à Valdo : « Si tu enseignes encore, tu seras condamné et brûlé comme hérétique ». — « Comment tairais-je ce qui concerne le salut éternel des hommes ? » répondit avec hardiesse le pieux serviteur de Christ. L’archevêque irrité voulait le faire saisir, mais il craignit le peuple. Valdo d’ailleurs avait tant d’amis à Lyon, aussi bien parmi les riches que parmi les pauvres, tant d’âmes qui avaient été amenées au Sauveur par son moyen, qu’il put rester caché dans la ville pendant trois ans, enseignant, encourageant et fortifiant les fidèles.
Le pape Alexandre III apprit ce qui se passait à Lyon. Il excommunia Valdo et ordonna à l’archevêque de procéder avec la dernière rigueur contre lui et ses adhérents. Valdo se vit ainsi forcé de quitter Lyon avec un certain nombre de ses disciples, hommes et femmes, afin d’échapper aux persécutions. Dans la main de Dieu, ce fut un moyen de répandre au loin l’Évangile et la parole de Dieu dans toutes les contrées où ces fugitifs, qu’on appela « les pauvres de Lyon », portèrent leurs pas. Ils contribuèrent aussi à éclairer les nombreuses petites communautés qui n’acceptaient pas les erreurs de Rome, mais qui elles-mêmes n’étaient pas entièrement pures dans la foi. Elles étaient nombreuses et unies entre elles, puisque l’on dit qu’un de leurs membres pouvait voyager du sud de l’Italie au nord de l’Allemagne en logeant chaque soir chez un frère. En certaines contrées, comme aux environs de Trèves et dans le nord de l’Italie, ces communautés avaient des écoles publiques en plus grand nombre que les catholiques, et elles convoquaient les assemblées au son des cloches. Les persécutions exercées avec persévérance et cruauté par l’inquisition et le clergé eurent raison finalement de ces chrétiens qui refusaient de se soumettre à Rome ; il n’y eut que les vallées du Piémont où ils subsistèrent malgré tous les efforts de leurs ennemis, et où ils subirent les plus terribles persécutions, comme nous aurons l’occasion de le voir.
Pour revenir à Valdo, il se rendit, accompagné d’un grand nombre des siens, d’abord en Dauphiné dans les vallées de Freissinière, de Vallouise et de Valcluson, où se trouvaient d’anciennes communautés chrétiennes. De là plusieurs passèrent dans les vallées du Piémont où ils rencontrèrent les anciens Vaudois auxquels ils apportèrent leur traduction de la Bible. La persécution força Valdo à fuir de nouveau ; il alla en Picardie, puis en Allemagne et enfin en Bohême, travaillant toujours à l’œuvre du Seigneur. C’est dans cette dernière contrée qu’il termina paisiblement ses jours.
Quant aux disciples de Valdo, confondus sous le nom de Vaudois avec ceux que l’on nommait déjà ainsi, ils ne s’étaient pas, non plus que leur chef, séparés de l’Église. Ils réclamaient seulement l’autorisation de prêcher. Nécessairement Rome ne pouvait pas l’accorder. « Si nous le faisions », disait un prélat dans un concile, « on nous chasserait ». Malgré cela, ils continuèrent à évangéliser, et on les excommunia. Plusieurs se répandirent en Provence et en Espagne où ils eurent d’abord quelque succès, mais sous le règne d’Alphonse II, roi d’Aragon, ils furent aussi persécutés et chassés à l’instigation du clergé.
Pour terminer ce qui concerne les disciples de Valdo et les Vaudois, il faut ajouter qu’ils insistaient sur la doctrine capitale de l’Évangile, la justification par la foi, et qu’ils repoussaient toutes les cérémonies, les erreurs et les superstitions de l’Église romaine. Comme nous l’avons vu précédemment, ils étaient fermement attachés à la Bible, et se montraient recommandables par une vie pure qui contrastait avec celle que menait en général le clergé romain. N’est-ce pas une chose profondément intéressante de voir la puissance divine conserver, à travers les siècles et au milieu des efforts incessants d’adversaires acharnés, une lignée de témoins de la vérité évangélique, à part des souillures de la soi-disant vraie Église ? Ils formaient ce résidu dont parle le Seigneur dans sa lettre à Thyatire, et qui n’avait pas connu les profondeurs de Satan (Apocalypse 2:24).
7.3.2 - Les Albigeois — Pierre de Brueys et Henri de Lausanne
Comme nous l’avons vu, dès la fin du 10° siècle et le commencement du 11°, des missionnaires bulgares étaient venus dans la Haute Italie, puis étaient descendus jusqu’en Calabre. D’autres s’étaient dirigés vers la France, dans les Flandres et sur les bords du Rhin. Mais c’est surtout dans le sud-ouest de la France qu’ils gagnèrent le plus d’adhérents. L’avidité et la corruption du clergé qui attiraient sur lui le mépris et la haine du peuple, furent une des causes de leurs succès, et comme les nobles ne se pliaient qu’avec répugnance aux exigences et aux prétentions de domination des prêtres, les « sectaires » trouvaient près d’eux un appui.
On leur donnait, ou ils se donnaient à eux-mêmes, le nom de cathares, d’un mot grec qui veut dire pur. Ils se tenaient à part de l’Église de Rome et de ses cérémonies, niaient son autorité, enseignaient la simplicité apostolique, et rejetaient les doctrines des sacrements, du purgatoire, de la messe, etc. Quelques-uns d’entre leurs chefs, que l’on désignait sous le nom de bons hommes, semblent avoir tenu certaines graves erreurs manichéennes ; mais on ne les connaît guère que par les récits de leurs adversaires. Ce que l’on sait sûrement, c’est que leur vie austère et pure formait un contraste frappant avec celle des prêtres et des moines, et leur donnait un grand ascendant sur le peuple. Nous ne pouvons douter que parmi les cathares ne se trouvassent de vrais enfants de Dieu qui firent pour leur foi le sacrifice de leur vie. D’ailleurs nous avons vu que ceux des disciples de Valdo dispersés, qui vinrent parmi eux, leur apportèrent des lumières qui contribuèrent à épurer leurs croyances. Comme les cathares étaient surtout nombreux dans la ville d’Albi et la contrée environnante, on les désigna sous le nom d’Albigeois.
Avant de nous occuper plus spécialement des Albigeois, nous dirons quelques mots de deux hommes remarquables qui, dans la première moitié du 12° siècle, s’étaient mis en opposition avec l’Église de Rome, et vinrent prêcher dans les provinces méridionales de la France. C’étaient Pierre de Brueys et Henri de Lausanne.
Le premier était un prêtre qui, éclairé sans doute par les Écritures, commença vers l’an 1110 à s’élever contre la corruption de l’Église dominante et les vices du clergé. Son activité s’exerça surtout dans la Provence et le Languedoc. Il put, chose bien frappante, prêcher impunément durant l’espace de vingt ans. L’ennemi n’eut pas le pouvoir d’arrêter ce courageux témoin, jusqu’à ce qu’il eût achevé de rendre son témoignage. Pierre de Brueys disait que le baptême appliqué aux enfants ne les sauve pas ; il niait le mérite des œuvres pour le salut, et rejetait la transsubstantiation, les prières pour les morts, l’invocation des saints et le célibat des prêtres. Il combattait la suprématie de Rome et l’organisation ecclésiastique. « Ce sont les croyants », disait-il, « qui composent l’Église ». Il voulait dire que ce n’était pas le clergé, comme le prétend l’Église de Rome. Il prêchait la repentance et la réforme des mœurs, surtout celle des prêtres et des moines. Mais le zèle de Pierre de Brueys l’entraîna plus loin. Il aurait voulu qu’on démolît les églises, que l’on brûlât les croix et les objets d’un culte idolâtre. Il mit à exécution ce qu’il exhortait à faire, et à Saint-Gilles en Languedoc, il brûla un certain nombre de croix portant l’image de Christ (*). C’était trop. La multitude, excitée par les prêtres, se saisit de lui ; il fut traîné au bûcher et brûlé vif. C’était en l’année 1130. Mais les doctrines qu’il avait prêchées, ne pouvaient être si aisément extirpées. Il avait laissé des disciples, nommés d’après lui Pétrobusiens et que les flammes de son bûcher enhardirent plutôt qu’elles ne les découragèrent. Ils continuèrent à dévoiler hautement les misères de l’Église et du clergé.
(*) Des scènes analogues eurent lieu, en différents endroits, dans les premiers temps de la Réformation.
Henri de Lausanne fut un de ces courageux prédicateurs dont nous parlions. Il avait été moine à l’abbaye de Cluny. Dans la solitude du cloître, il s’était beaucoup occupé de l’étude du Nouveau Testament, et la parole infaillible de Dieu lui avait révélé la vraie nature du christianisme. Dès lors il brûla du désir de faire connaître aux autres la vérité telle qu’il l’avait puisée à sa divine source. Il commença à prêcher. Son apparence extérieure était bien propre à donner du poids et de l’autorité à sa parole. De haute taille, marchant nu-pieds, négligé sur sa personne, doué d’une voix puissante, jetant sur ses auditeurs des regards pleins de feu, précédé d’ailleurs partout où il allait par une grande réputation de science et de sainteté, tout en lui commandait l’attention de la multitude ; tandis que son éloquence entraînante, ses paroles profondes, son apparition extraordinaire frappaient d’effroi les prêtres, et lui attiraient l’approbation du peuple. Dans l’esprit de Jean le Baptiseur, il appelait les âmes à la repentance et exhortait le peuple à se tourner vers le Seigneur. En même temps il exposait les vices du clergé. Cela provoquait nécessairement l’opposition et la haine des prêtres et des moines, mais la multitude n’en était que plus fortement attirée vers lui. Les gens des basses classes aussi bien que les principaux bourgeois, tous se laissaient diriger par lui et le suivaient comme leur conducteur spirituel.
Pour autant que nous le savons, c’est à Lausanne qu’il commença sa mission, et de là lui vint son surnom. Il prêcha aussi la repentance dans la vallée du Léman, puis il se rendit au Mans, en France, vers l’an 1116. Il avait auparavant envoyé deux messages à Hildebert, évêque de cette ville, lequel l’accueillit favorablement. Henri fut encore mieux reçu par le peuple. Il exhortait, comme nous l’avons dit, à la repentance, et ainsi que Pierre de Brueys, il niait le mérite des œuvres pour le salut, s’élevait contre les superstitions romaines et la suprématie du pape. « Bientôt », dit un écrivain, « le résultat de sa prédication fut que les gens, comme enchaînés à sa personne, furent remplis de mépris et de haine envers le haut clergé, au point qu’ils ne voulurent plus avoir rien à faire avec lui. Ils ne suivaient plus les offices de l’Église romaine ; et même les prêtres se virent les objets de mauvais traitements de la part de la populace et durent recourir à la protection des magistrats ». Cela assurément était un mal, et nous aimons à penser qu’Henri n’approuvait pas ces excès. L’évêque Hildebert était allé à Rome ; à son retour le peuple du Mans refusa de recevoir sa bénédiction. Lorsque Hildebert s’aperçut de la grande influence qu’Henri exerçait dans son diocèse sur les jeunes prêtres et sur la multitude, au lieu de sévir contre lui il se contenta de lui assigner un autre champ de travail. L’évêque agit en cela en homme intelligent, et Dieu se servit de lui pour que son serviteur portât la lumière en d’autres endroits.
Henri s’éloigna tranquillement et alla rejoindre Pierre de Brueys en Provence. Là il poursuivit sa mission contre les abus et les erreurs de Rome d’une manière encore plus ouverte et plus décidée, s’attirant ainsi toute l’inimitié du clergé. La mort de Pierre de Brueys ne ralentit pas son zèle. Dieu lui accorda encore quelques années durant lesquelles il put poursuivre sans empêchement son œuvre. Mais enfin l’archevêque d’Arles le fit saisir, et le concile de Pise, en l’an 1134, le condamna à être enfermé en prison comme hérétique. Peu après cependant il fut relâché à condition d’aller dans une autre province. Henri se rendit en Languedoc, et là ses prédications eurent un effet si puissant que partout où il allait les églises se vidaient et que les ecclésiastiques étaient délaissés et même traités avec mépris.
Pour réprimer ce mouvement, le pape Eugène III, en 1147, envoya à Toulouse un légat. Celui-ci sentant toute la difficulté de sa mission, demanda à saint Bernard de Clairvaux de l’accompagner. Le vénérable abbé y consentit et annonça par écrit sa venue et le but de son voyage aux seigneurs du midi de la France : « Les églises », dit-il, « sont abandonnées ; le peuple est sans prêtres ; les prêtres sont sans honneur, et les chrétiens sans Christ. Les églises ne sont plus respectées comme des lieux consacrés ; les sacrements ne sont plus regardés comme saints ; les fêtes ne sont plus célébrées. Les hommes meurent dans leurs péchés — sans pénitence et sans viatique — et les âmes, sans y être préparées, entrent en présence du terrible tribunal. On refuse aux enfants le baptême, et ainsi ils sont exclus du salut ». On voit par ses paroles les progrès qu’avaient faits les doctrines antiromaines, et aussi quel était l’attachement de saint Bernard à la papauté dont il connaissait cependant tous les vices. Il parcourut les contrées troublées par ce que lui-même et les prêtres appelaient l’erreur ; il accomplit, prétendit-on, des miracles et purifia les églises souillées par l’hérésie. Le peuple crédule et entraîné par son éloquence, l’admira et un grand nombre retournèrent dans les églises abandonnées. Ainsi étant venu à Albi, où les disciples des cathares étaient plus nombreux, il prêcha dans l’église principale devant une grande multitude. Après son éloquente prédication, il dit : « Revenez, revenez à l’Église, et afin que nous sachions qui sont ceux qui se repentent, qu’ils lèvent la main au ciel ». Tous levèrent leur main droite. Il en fut de même à Toulouse. Mais là les tisserands et les principaux de la ville étaient seuls attachés aux doctrines cathares ; la masse du peuple y était étrangère. Une sentence fut rendue contre les hérétiques, et les seigneurs promirent de la faire exécuter. Quant à Henri il dut fuir. Poursuivi de lieu en lieu, il fut enfin saisi et incarcéré dans les cachots de l’archevêque de Toulouse. En 1148, la mort le délivra de ses persécuteurs et l’introduisit dans le repos éternel.
L’influence exercée par le zèle et l’éloquence de Bernard de Clairvaux fut de courte durée. Les doctrines cathares reprirent le dessus, épurées, comme nous l’avons dit, par l’action des Vaudois de Lyon, chassés par la persécution, et qui apportaient avec eux les Écritures. Pour combattre ce mouvement, une conférence fut convoquée en 1165 par l’évêque d’Albi. On y invita quelques « bonshommes », ou chefs des cathares. Après qu’on les eut interrogés, on les déclara hérétiques, mais on n’osa rien décréter contre eux. L’un d’entre eux rendit un témoignage remarquable de leur foi. Après avoir hardiment affirmé qu’il était prêt à prouver par le Nouveau Testament que les prêtres, leurs ennemis, au lieu d’être de bons pasteurs n’étaient que des mercenaires, il ajouta : « Écoutez, ô bonnes gens, écoutez cette profession de foi : Nous croyons à un seul Dieu, à son Fils Jésus Christ, à la communication du Saint Esprit aux apôtres, à la résurrection, à la nécessité du baptême et de l’eucharistie ».
Le pape Innocent III (de l’an 1198 à 1216), homme plein d’énergie, résolut d’en finir avec cette hérésie sans cesse renaissante et qui s’étendait toujours plus. Il envoya d’abord en Languedoc comme légats, l’inquisiteur Rainerio Sacchoni et un autre. Leur mission était de chercher à convertir les Cathares. Douze abbés de Cîteaux (*) les accompagnaient. Le pape chargea ensuite deux autres légats, dont l’un était Pierre de Castelnau, de poursuivre cette œuvre. Diégo, évêque d’Ossuna, et Dominique, son sous-prieur, le fondateur de l’ordre des Dominicains et de l’inquisition, se joignirent à eux. Dominique, voyant que ses efforts et ceux de ses compagnons étaient infructueux, leur conseilla d’aller nu-pieds, pauvrement vêtus, sans argent, imitant dans tout leur extérieur les « parfaits », ou chefs des cathares. Ils s’insinuaient ainsi auprès des soi-disant hérétiques, et tout en cherchant à les ramener dans l’Église romaine, ils s’informaient de leurs croyances et de tout ce dont plus tard ils pourraient se faire une arme contre eux. Leurs efforts furent sans résultat, et le pape vit qu’il fallait prendre d’autres mesures et se servir d’autres armes.
(*) Cîteaux est un village de la Côte-d’Or, près duquel était une abbaye de religieux nommés Cisterciens, du nom latin du village (Cistercium). Cet ordre de moines prit dans le Moyen Âge une très grande extension.
Les Albigeois croyant aux intentions pacifiques du pape, demandèrent une conférence publique. Pour gagner du temps, Innocent l’accorda. Les évêques et les moines acceptèrent le débat, et l’on se réunit à Montréal, près de Carcassone. Des arbitres furent nommés des deux parts. Les Albigeois avaient désigné un de leurs diacres, Arnaud Hot, pour soutenir leurs croyances par la parole de Dieu. Il entreprit de prouver :
1° Que la messe avec la transsubstantiation était d’invention humaine et non de l’ordonnance de Jésus Christ et des apôtres.
2° Que l’Église romaine n’était pas l’Épouse de Christ, mais plutôt une église de trouble, enivrée du sang des martyrs.
3° Que la police de l’Église romaine n’est ni bonne, ni sainte, ni établie par Jésus Christ.
On voit avec quelle hardiesse les Albigeois se présentaient devant leurs ennemis, et quelle confiance ils avaient dans la vérité des doctrines qu’ils soutenaient. La conférence dura quatre jours. Arnaud Hot provoqua l’admiration des assistants par son éloquence. Quant aux prêtres, ils ne purent prouver leurs thèses ni par Jésus Christ, ni par les apôtres. La question principale qui fut traitée était celle de l’eucharistie. Arnaud démontra sans peine que « selon la doctrine de la transsubstantiation, le pain n’existe plus, puis qu’il est changé dans le corps de Christ. La messe est donc sans le pain, et en conséquence n’est pas la Cène du Seigneur, où il y a du pain. Le prêtre rompt le corps, puisque l’hostie est devenue le corps de Christ ; il ne rompt donc pas le pain, et ainsi il ne fait pas ce qu’ont fait Jésus Christ et Paul ». Les légats, les évêques, les prêtres et les moines, pleins de honte et de déplaisir, ne voulurent pas en entendre davantage et se retirèrent.
Pendant ce temps, le pape avait envoyé dans toute l’Europe des prédicateurs chargés d’annoncer une croisade pour écraser l’hérésie dans le sud de la France. « Nous vous exhortons », disaient-ils, « à vous efforcer de détruire la méchante hérésie des Albigeois, et de les traiter avec plus de rigueur que les Sarrasins même. Poursuivez-les avec une main forte ; privez-les de leurs terres et de leurs possessions ; chassez-les et mettez des catholiques à leur place ». Tel était le langage de ceux qui se disaient les ministres de Jésus, de Celui qui ne voulait pas que ses disciples fissent descendre le feu du ciel sur ceux qui refusaient de le recevoir (Luc 9:51-56). À ceux qui s’engageaient à prendre les armes pendant quarante jours contre les hérétiques, on promettait la rémission de tous leurs péchés et le paradis. Cette prédication de sang fut entendue, comme nous le verrons.
Toulouse et son comté étaient un des principaux centres des Albigeois, et avaient alors pour seigneur Raymond, sixième comte de Toulouse. C’était un prince sage, humain et paisible. Bien que catholique, et regrettant que les Albigeois ne fussent pas attachés à l’Église romaine, il les tolérait et les protégeait, voyant en eux des sujets loyaux, fidèles, qui s’appliquaient au travail et contribuaient à la prospérité de la contrée. En 1207, le pape lui envoya, comme légat, Pierre de Castelnau pour le sommer d’exterminer par le fer et le feu ses sujets hérétiques, s’ils ne voulaient pas abjurer leurs erreurs et rentrer dans le giron de l’Église. Deux fois Raymond refusa et deux fois il fut excommunié par le légat, et son pays placé sous l’interdit. Le pape approuva les faits de son légat et écrivit à Raymond une lettre où ressort tout l’orgueil et l’arrogance de celui qui se nommait le serviteur des serviteurs du Seigneur, mais qui en même temps fut le premier à s’intituler « Vicaire de Dieu sur la terre ». « Homme pire que la peste », disait-il, « tyran ambitieux, cruel et horrible ! Quel orgueil s’est emparé de ton cœur et combien grande est ta folie, que tu troubles la paix de ton prochain, et que tu braves les saints commandements de Dieu, en protégeant les ennemis de la foi ! Si tu ne crains pas les flammes éternelles, tu dois redouter les châtiments temporels que tu as mérités par tant de méfaits. Car en vérité l’Église ne peut être en paix avec le chef d’aventuriers et de brigands, avec le protecteur des hérétiques, le contempteur des saints commandements, l’ami des Juifs et des usuriers, l’ennemi des prélats, et le persécuteur de Jésus Christ et de son Église. Le bras du Seigneur restera étendu contre toi jusqu’à ce que tu sois réduit en poussière. En vérité, il te fera sentir combien il est difficile d’échapper à la colère que tu as amassée sur ta tête ! »
Contre qui et pourquoi le pape lançait-il de si terribles menaces ? Contre un prince qui ne voulait pas servir de bourreau aux prêtres et verser le sang innocent de ses fidèles et laborieux sujets. Et cependant si grande était la puissance et l’autorité de ce chef de la chrétienté, et telle la crainte qu’inspiraient ses anathèmes, que Raymond s’inclina devant sa volonté. Il signa un écrit par lequel il s’engageait à détruire tous les hérétiques qui se trouvaient dans ses domaines. Mais il ne pressa la persécution qu’avec mollesse et hésitation. Le légat s’en aperçut, et brûlant d’indignation, il se répandit en invectives violentes contre le comte, le traitant de lâche et de parjure, et l’excommuniant de nouveau. Devant cette insolence, comment s’étonner que Raymond, profondément blessé, se soit laissé aller à la colère ? Dans un moment à déplorer, il se serait écrié, dit-on, que Pierre de Castelnau paierait de sa vie son impudence. Quoi qu’il en soit, un de ses chevaliers, jaloux de l’honneur de son seigneur, se rendit auprès du légat, et lui adressa des remontrances au sujet de sa conduite vis-à-vis de Raymond. Comme le légat lui répondait avec la même hauteur, le chevalier irrité le perça de son poignard et le blessa mortellement.
Le meurtre de Pierre de Castelnau fournit à Innocent III une occasion favorable pour faire sentir au comte Raymond le poids de sa colère. Pierre de Castelnau fut exalté comme martyr, Raymond fut déclaré coupable d’avoir été le premier auteur du crime, et mis au ban de l’Église. Les fidèles furent sommés de venir aider à sa destruction, et une croisade fut prêchée contre les Albigeois. « Debout ! soldats du Christ », écrivit Innocent III à Philippe Auguste, roi de France, « debout, roi très chrétien, écoute le cri du sang. Aide-nous à tirer vengeance de ces malfaiteurs ! Debout ! nobles et chevaliers de France ! Les riches campagnes du midi seront le prix de votre vaillance ! » La prédication de la croisade fut confiée aux Cisterciens sous la direction de leur fanatique abbé Arnoult, « homme », écrit un historien, « dont le cœur était renfermé sous la triple cuirasse de l’orgueil, de la cruauté et de la superstition ». Dominique, le fondateur de l’inquisition, lui fut adjoint. Toutes les indulgences promises à ceux qui prenaient la croix (*) pour la délivrance du saint sépulcre, furent assurées à ceux qui prendraient part à la croisade contre Raymond et les Albigeois. Les prêtres faisaient partout valoir cette occasion facile d’obtenir le pardon de tous les péchés et la vie éternelle.
(*) Ceux qui s’engageaient dans ces expéditions portaient une croix rouge sur l’épaule droite.
À l’appel du pape, une armée de 300000 hommes se rassembla sur les frontières des malheureuses provinces que gouvernaient Raymond et d’autres seigneurs. Trois corps de troupes furent formés. À la tête de chacun se trouvaient un archevêque, un évêque et un abbé. Le commandement en chef fut donné au fameux Simon de Montfort, homme vaillant, mais ambitieux, avide de possessions et d’honneurs, et entièrement dévoué au pape et à son Église.
Raymond, incapable de résister à des forces aussi considérables, se soumit aux exigences du pape. Celui-ci promit de lever l’interdit sous certaines conditions. Raymond devait se laver de toute participation au meurtre de Pierre de Castelnau ; livrer sept de ses meilleurs châteaux forts comme preuve de la réalité de sa repentance ; faire pénitence publique pour ses fautes passées, et enfin se joindre aux croisés contre ses propres sujets et en particulier contre son neveu Roger, comte de Béziers. Raymond se récria contre la rigueur de ces conditions, mais en vain ; elles devaient être exécutées à la lettre. Il subit la pénitence publique. Il reçut l’absolution dans l’église de Saint-Égidius, en présence de trois archevêques et de dix-neuf évêques. Ensuite on le conduisit à la cathédrale où Castelnau avait été enterré. Le dos nu, portant autour du cou une corde dont deux évêques tenaient les bouts, il arriva à la porte de l’église et là dut jurer sur l’hostie qu’il obéirait à la sainte Église romaine. Puis sur la tombe de Castelnau il s’agenouilla, et sur ses épaules nues tombèrent des coups de fouet avec une telle violence et qui le mirent dans un tel état que, lorsqu’il put échapper à ses bourreaux et aux regards de la foule qui contemplait l’incroyable humiliation de son souverain, il dut sortir par une porte de derrière. Telle était la douceur de l’Église romaine, cette sainte mère, comme elle s’appelle. Il restait à Raymond à accomplir la partie la plus douloureuse de sa pénitence, celle de prendre les armes contre ses sujets et son neveu.
L’armée des croisés se mit alors en mouvement excitée par les prêtres et les moines fanatiques. « En avant », disaient ceux-ci. « Mettez à mort les hérétiques ; dévastez tout, n’épargnez rien. La mesure de leur iniquité est comble et la bénédiction de l’Église repose sur vous ». Était-ce là l’esprit de Christ qui, lorsque ses disciples lui demandaient que le feu du ciel descendît sur ceux qui ne le recevaient pas, leur disait : « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Le fils de l’homme n’est pas venu pour détruire les vies des hommes, mais pour les sauver » ? L’armée se répandit comme un torrent sur les campagnes fertiles du Languedoc et mit tout à feu et à sang, dévastant, pillant et tuant ou brûlant les habitants sans défense.
Roger, comte de Béziers, neveu de Raymond, résolut de protéger ses sujets contre la violence des Croisés. Ses deux villes fortes étaient Béziers et Carcassonne. Bientôt parurent, sous les murs de la première de ces villes, ceux qui se nommaient « les défenseurs de la croix, les prêtres du Seigneur ». Raymond n’était resté que quelques jours avec eux ; il était allé à Rome s’humilier devant le pape. Roger se rendit d’abord auprès du légat du pape, lui disant qu’il y avait dans la ville plusieurs habitants fidèles à la foi catholique et qu’il le suppliait de ne pas faire périr les innocents avec les coupables. Il lui fut répondu que pour sauver la ville, les Albigeois devaient renoncer à leur foi et promettre qu’ils se soumettraient à l’Église romaine.
Cette réponse fut rapportée aux habitants, et les Albigeois furent pressés d’accepter les conditions proposées ; ainsi ils sauveraient eux-mêmes et les catholiques. C’était une pénible position pour les Albigeois, mais ils déclarèrent à leurs concitoyens qu’ils ne pouvaient renoncer à leur foi et qu’ils préféraient mourir. Ils laissaient aux catholiques et à Roger de faire pour eux-mêmes les meilleures conditions qu’ils pourraient.
Voyant qu’ils ne pouvaient ébranler la résolution des Albigeois, les catholiques eurent recours à leur évêque qui était auprès du légat. L’évêque supplia celui-ci de les épargner, en lui représentant qu’ils étaient toujours restés fidèles à l’Église, et qu’ils ne devaient pas être massacrés avec les Albigeois, et même que ceux-ci pourraient être gagnés par la bonté. La réponse du légat fut brève et sévère ; la ville devait se rendre, et à moins que tous ne confessassent leur péché et ne revinssent à l’Église, tous partageraient le même sort. Les Albigeois persistèrent dans leur résolution de ne point abandonner une foi qui leur avait acquis le royaume de Dieu et sa justice. Les habitants catholiques eux-mêmes, comprenant qu’il n’y avait rien à espérer, même pour eux, déclarèrent qu’ils aimaient mieux mourir que de livrer leur ville à l’ennemi. Quand le légat apprit cette réponse, il s’écria avec fureur : « Qu’il ne reste donc pas pierre sur pierre de cette ville ; que l’épée et le feu dévorent hommes, femmes et enfants ! ».
Après un siège de courte durée, la ville dut se rendre à discrétion, et la menace d’Arnoult fut exécutée de la manière la plus effroyable. On lui avait demandé comment distinguer les catholiques des Albigeois, afin d’épargner les premiers : « Tuez-les tous », répondit-il ; « le Seigneur connaît ceux qui sont siens ». Le massacre commença sans distinction de rang, d’âge ou de sexe. Les prêtres même et les religieux, reconnaissables les uns et les autres à leur costume, ne furent pas épargnés. Des femmes et des enfants s’étaient réfugiés dans les églises, pensant trouver un asile dans ces enceintes sacrées, mais en vain ; la main des serviteurs de la sainte Mère Église les y égorgeait. Personne n’échappa des 23000 habitants de Béziers ; puis la ville fut pillée et brûlée.
 Re: L’ÉGLISE : UNE ESQUISSE DE SON HISTOIRE PENDANT VINGT SIÈCLES
Re: L’ÉGLISE : UNE ESQUISSE DE SON HISTOIRE PENDANT VINGT SIÈCLES
Roger s’était retiré dans Carcassone, ville mieux fortifiée que Béziers. Les croisés l’y suivirent. Partout sur leur passage le pays restait dévasté, car frappés de terreur, les habitants de la campagne avaient fui abandonnant leurs maisons et leurs terres. Roger avait rassemblé les habitants de Carcassonne, catholiques et Albigeois. Il leur avait dit l’horrible massacre de Béziers qui avait eu lieu sans distinction de religion, et leur avait montré que les croisés, sous un voile religieux, n’avaient en vue que le pillage. Il enflamma ainsi leur courage, et tous se préparèrent à défendre leur ville. Maints assauts furent livrés par l’ennemi et toujours repoussés. Les croisés avaient éprouvé de grandes pertes, soit dans les combats, soit par suite de maladies amenées par la chaleur brûlante, par le manque d’eau et l’air empesté par la multitude des cadavres laissés sans sépulture. La disette de vivres se faisait aussi sentir parmi eux. Le terme de quarante jours pour lesquels ils s’étaient engagés, expirait pour un grand nombre, ils avaient gagné le pardon de leurs péchés, et des milliers avec leurs chefs, ne voulant rester sous aucune condition, regagnèrent leurs foyers.
Le légat alarmé, voyant que la ville ne serait pas réduite si aisément qu’il le pensait, eut recours à une ruse diabolique. Il persuada à l’un des officiers de l’armée d’essayer d’attirer le comte Roger hors de la ville, promettant à cet officier, outre les récompenses terrestres, celles qui lui seraient réservées dans le ciel, s’il réussissait. Il ne réussit que trop bien. Sous le prétexte de négociations de paix, et sur la promesse et le serment solennel de ramener Roger sain et sauf dans la ville, celui-ci se rendit auprès du légat avec quelques-uns de ses chevaliers. À peine avait-il commencé à présenter quelques propositions au légat et à parler en faveur des habitants de la ville, qu’Amoult se leva et déclara que les habitants feraient à leur bon plaisir, mais que Roger était prisonnier. En vain celui-ci protesta contre une telle perfidie ; n’était-ce pas sur la foi d’un serment solennel qu’il était venu ? Arnoult dit que l’on n’était pas tenu de garder la foi à un homme qui avait été infidèle à Dieu. En un clin d’œil Roger et ses compagnons furent chargés de chaînes, et bientôt on apprit que le noble comte était mort en prison, non sans de forts soupçons qu’il avait été empoisonné.
Les habitants de Carcassonne ayant appris le sort de leur jeune et courageux chef, perdirent tout espoir de défendre leur ville. Échapper semblait impossible, parce que l’ennemi les entourait de toutes parts. Le désespoir s’emparait d’eux, lorsque le bruit se répandit que quelques-uns des plus vieux habitants se souvenaient que quelque part dans la ville s’ouvrait un passage souterrain conduisant au château de Caberet, à une distance d’environ trois lieues ; mais personne n’en connaissait l’entrée. Excepté les hommes qui défendaient les remparts, tous se mirent à chercher diligemment, et enfin on entendit répéter : « L’entrée est trouvée ». Aussitôt on fit des préparatifs pour l’exode ; on rassembla des vivres pour plusieurs jours, mais sauf les quelques objets qu’ils pouvaient emporter avec eux, tout le reste devait être laissé. Mais cela valait infiniment mieux que de tomber entre les mains de meurtriers sans merci. Nous pouvons être sûrs que bien des actions de grâces montèrent à Dieu pour cette perspective de délivrance, et que bien des prières lui furent adressées pour que leur entreprise fût couronnée de succès.
Ce n’était pas moins très douloureux. « C’était une vue triste et affligeante », dit leur historien, « que ce départ accompagné de soupirs, de larmes et de lamentations, tandis qu’ils s’avançaient avec l’espoir incertain de sauver leurs vies par leur fuite ; les parents conduisant leurs jeunes enfants, et les plus robustes soutenant les vieillards décrépis. Et surtout combien il était navrant d’entendre les gémissements des femmes ! »
Dieu les protégea ; le jour suivant ils atteignirent sains et saufs le château, d’où ils se dispersèrent partout où Dieu leur ouvrit une porte de refuge. Au matin, l’armée assiégeante fut étonnée de n’entendre aucun bruit dans la ville. On craignit quelque stratagème, mais les murailles ayant été escaladées, un cri se fit entendre : « Les Albigeois ont fui ». Le butin, par l’ordre du légat, fut partagé entre les croisés, et les prêtres se vengèrent de la fuite des Albigeois en faisant brûler quatre cents habitants qui avaient été faits prisonniers !
Simon de Montfort avec son armée continua à s’avancer dans le pays. Il assiégea le château de Minerve, près de Saint-Pons. On disait de cette place que depuis trente ans aucune messe n’y avait été dite, preuve de l’extension des doctrines vaudoises. Raymond, comte de Termes, défendait la place, mais le manque d’eau l’obligea à se rendre. Le légat avait décidé de laisser la vie sauve aux catholiques et à ceux qui se convertiraient. Les chevaliers se récrièrent disant qu’ils étaient venus pour exterminer les hérétiques et non pour les absoudre. Le légat les rassura en disant : « Je les connais ; pas un ne se convertira ». En effet, Raymond étant exhorté à revenir à la foi catholique, refusa et fut jeté en prison, où bientôt il mourut. Sa femme, sa sœur, sa fille et d’autres femmes de qualité, repoussèrent les efforts faits pour les convertir, et furent brûlées ensemble. Restaient les habitants. Sommés de reconnaître le pape et l’Église romaine, ils s’écrièrent tous ensemble : « Nous ne voulons pas renoncer à notre foi, et nous rejetons la vôtre. Vous travaillez pour le néant ; ni mort, ni vie, ne nous fera abandonner notre croyance ». Sur cette réponse, le comte Simon et le légat firent allumer un grand feu où furent jetés cent quarante hommes et femmes. Un historien qui rapporte ce fait dit que « ce fut une chose merveilleuse de les voir monter au bûcher avec allégresse, et comme de vrais martyrs de Jésus Christ ».
En maints autres endroits, les Albigeois montrèrent la fermeté de leur foi, tandis que Montfort, son armée et les prêtres déployaient contre eux la cruauté la plus grande. Nous ne poursuivrons pas cette histoire de meurtre et de carnage. Qu’il suffise de dire que Montfort, ayant mis le siège devant Toulouse, y expia ses cruautés. Il fut frappé d’une pierre lancée par une machine, et mourut. Cela n’arrêta pas la persécution contre les Albigeois. Les inquisiteurs achevèrent l’œuvre de leur destruction. Il périt, dit-on, un million de victimes dans les provinces méridionales de la France. Un grand nombre d’Albigeois se réfugièrent dans les forêts et les montagnes ; d’autres passèrent dans les vallées des Alpes, en Italie et en Lombardie.
7.4 - Les Précurseurs de la Réformation
Comme nous l’avons vu, la main impitoyable de l’Église de Rome — cette sainte Mère, comme elle se nommait — s’appesantissait partout et sur tous ceux qui ne pliaient pas le genou devant elle, et qui rejetaient sa suprématie et ses doctrines antichrétiennes. « Hors d’elle, point de salut », affirmait-elle ; et ce salut n’était pas le salut par grâce, mais un salut acheté par des œuvres, dispensé par les prêtres, intermédiaires soi-disant entre Dieu et les hommes, dominant les consciences et assumant, pour maintenir leur prestige et leur autorité, la prétention blasphématoire de transformer, par des paroles consacrées, le pain et le vin de la Cène dans la personne de Christ, chair, sang, âme et divinité ! À la tête de ce système d’iniquité, qui enlaçait les âmes et les maintenait dans les ténèbres, le pape étendait sa domination non seulement sur le clergé, archevêques, évêques et prêtres, et sur les laïques, mais prétendait régenter les princes, les rois et les empereurs. La prison, le fer et le feu, avaient bientôt raison de ceux qui ne pliaient pas sous ce pouvoir redoutable, les hérétiques, comme Rome les nommait, et nomme tous ceux qui, s’attachant à la parole de Dieu, rejettent ses erreurs.
Toutefois, en dépit de toutes les rigueurs, de toutes les persécutions, il y eut toujours, comme nous l’avons vu, un témoignage pour la vérité, une lumière plus ou moins brillante au milieu des ténèbres, plus ou moins pure au sein de la corruption, des témoins fidèles, bravant tout pour Christ, et souffrant et mourant pour maintenir ce qu’ils avaient appris de cette parole de Dieu que le clergé cachait au peuple. C’était le petit résidu de Thyatire, protestant contre les abominations de Jésabel (Apocalypse 2:24).
Mais Dieu ne voulait pas que les ténèbres continuassent à peser sur le monde. Il allait susciter des hommes, ses serviteurs, qu’il soutiendrait par sa puissance contre Rome et les grands de la terre, qui remettraient en lumière pour tous sa Parole, la Bible, sur laquelle ils s’appuieraient, et qui annonceraient l’Évangile du salut par la foi en Jésus.
C’est le temps de cette œuvre puissante de l’Esprit de Dieu que l’on nomme la Réformation. Mais comme l’aube précède et annonce le jour, il y eut avant les grands réformateurs que Dieu suscita, tels que Luther, Calvin, et autres, les précurseurs qui préparèrent la voie. Parmi eux se trouvent surtout Wiclef en Angleterre et Jean Huss en Bohême. Nous dirons quelques mots de ce que Dieu opéra par leur moyen.
7.4.1 - Wiclef
Nous avons vu comment l’Église de Rome réussit à se soumettre peu à peu l’Angleterre. Elle y domina longtemps, non sans qu’il y eût des protestations contre sa suprématie, et des efforts faits contre l’autorité qu’elle s’attribuait même sur les rois. Plus d’un conflit eut lieu entre le pouvoir royal et la papauté ; le premier résistant à la prétention du pape d’être le suzerain du roi qui n’aurait été que son vassal ; mais l’Église n’avait rien perdu de son ascendant sur le peuple.
Avant que Wiclef parût sur la scène, il y avait eu en Angleterre des évêques même qui s’élevèrent contre la tyrannie de Rome. Parmi eux un des plus remarquables fut un évêque de la ville de Lincoln, Robert Grosse-Teste, qui vivait dans la première moitié du 13° siècle. Il était un homme pieux et énergique ; mais en même temps très humble. Il était savant et lisait les Écritures dans les langues originales. Il reconnaissait leur souveraine autorité et la mettait au-dessus de celle du pape. C’était dans le temps où le pape Innocent III venait de se proclamer « vicaire de Dieu sur la terre », que Grosse-Teste écrivait : « Suivre un pape rebelle à la volonté de Christ, c’est se séparer de Christ et de son corps, et s’il vient un temps où tous suivent un pontife égaré, ce sera la grande apostasie. Les vrais chrétiens refuseront alors d’obéir, et Rome sera la cause d’un grand schisme ». Ne semble-t-il pas annoncer la Réformation près de trois siècles à l’avance ?
Grosse-Teste désirait sérieusement la réforme des abus qu’il voyait dans l’Église, mais la tâche était trop grande ; pour réformer il aurait fallu se séparer, et le temps n’était pas venu. Deux grands ordres de moines mendiants venaient de se former, les Dominicains et les Franciscains. D’abord Grosse-Teste les avait favorisés, mais il vit bientôt quels abus il y avait parmi eux, et le besoin qu’ils avaient aussi de réformes. Il s’en occupa et les serra de près. Alors ils en appelèrent au pape. Celui-ci qui était alors à Lyon, obligea l’évêque à se présenter devant lui. Mais le pape, gagné par l’argent que les moines lui avaient donné, décida en leur faveur contre Grosse-Teste. En vain l’évêque rappela-t-il au pape ses lettres et ses promesses ; Innocent IV lui répondit : « Nous sommes disposés à les favoriser : ton œil est-il mauvais parce que je suis bon ? » (*). Combien cette citation profane de l’Écriture dut choquer le pieux évêque ! « Ô argent », dit-il en soupirant, « combien ton pouvoir est grand, surtout à la cour de Rome ! » N’est-il pas étrange que cette scène n’ait pas ouvert complètement les yeux de l’évêque sur l’apostasie de Rome ?
(*) Le pape s’appliquait le passage de Matthieu 20:15.
Peu de temps après, le pape envoya en Angleterre, pour remplir des places vacantes, des prêtres italiens qui ne savaient pas un mot d’anglais. En même temps il commanda à Grosse-Teste de donner à un jeune garçon, son neveu, un riche canonicat à la cathédrale de Lincoln. L’évêque refusa énergiquement, en disant : « Après le péché du diable, il n’y en a pas de plus opposé à l’Écriture que celui qui perd les âmes en leur donnant un ministère infidèle. Ce sont les mauvais pasteurs qui sont la cause de l’incrédulité, des hérésies et des désordres. Quand le premier des anges m’ordonnerait un tel péché, je devrais m’y refuser. Mon obéissance me défend d’obéir, c’est pourquoi je me rebelle ». Son obéissance à la parole de Dieu lui défendait d’obéir au pape. Ce fut le grand principe de la Réformation ; c’est celui qui doit nous guider — obéir à la parole de Dieu.
Le pape fut indigné. « Quel est ce vieux radoteur », dit-il, « qui ose juger mes actions ? Par saint Pierre et saint Paul, si ma générosité ne me retenait pas, je ferais de lui un exemple et un spectacle à toute l’humanité. Le roi d’Angleterre n’est-il pas mon vassal et mon esclave ? Et si je lui disais un mot, ne le jetterait-il pas en prison, chargé de honte et d’infamie ? ». Les cardinaux cherchèrent à l’apaiser. Ils lui firent remarquer que l’évêque était un saint homme et que sa lettre était vraie, et que le persécuter ferait appeler le mépris sur lui-même. Innocent ne les écouta pas, excommunia l’évêque et en nomma un autre à sa place. Mais comme les cardinaux le lui avaient dit, on ne tint nul compte de ses actes, et Grosse-Teste conserva son siège épiscopal jusqu’à sa mort en 1253.
Innocent voulut se venger sur les restes du pieux évêque et pensait à le faire exhumer, lorsqu’une nuit, raconte le chroniqueur Matthieu Pâris, Grosse-Teste lui apparut, s’approcha de son lit, le frappa de sa crosse, et lui dit d’une voix terrible et avec un regard menaçant : « Misérable ! le Seigneur ne permet pas que tu aies quelque pouvoir sur moi. Malheur à toi ! ». Le pape poussa un cri et resta à demi mort. Dès lors il n’eut plus une nuit tranquille, et mourut un an après Grosse-Teste, en faisant retentir son palais de ses gémissements.
Quelle manière d’agir, en vérité ! Traiter le roi d’Angleterre comme étant son vassal et son esclave ! Mais c’était depuis Grégoire VII la prétention des chefs de l’Église de Rome de dominer sur le pouvoir temporel. Quant à Grosse-Teste, sur son lit de mort, il déclarait encore qu’une « hérésie était une opinion conçue par des motifs charnels et contraire à l’Écriture, ouvertement enseignée et obstinément défendue », tandis que Rome traite d’hérésie tout ce qui est contraire à ses enseignements, quand bien même ceux-ci sont en opposition avec la parole de Dieu. Grosse-Teste fut une lumière dans ce temps de ténèbres. Son attachement à la parole de Dieu et son opposition à l’erreur furent remarquables ; il était capable de montrer à d’autres le chemin du salut, et bien que nous ignorions jusqu’où s’étendit son influence, sa trace ne fut certainement pas perdue pour les siècles suivants.
Dans la première moitié du 14° siècle vécut en Angleterre un autre pieux prélat, nommé Bradwardine. C’était un homme savant dans les sciences, particulièrement dans les mathématiques, mais il était aussi versé dans les Écritures. Il avait d’abord enseigné comme docteur à l’université d’Oxford, puis avait accompagné comme chapelain le roi d’Angleterre Édouard III, dans les guerres de celui-ci contre la France. Très humble et simple dans ses manières et dans sa vie, il avait d’abord été orgueilleux de sa science, et par elle éloigné de la croix de Christ. Il se confiait dans sa raison pour connaître la vérité, et pensait que l’homme, par sa propre force, pouvait faire quelque chose pour son salut. C’est ce que Pélage (*) autrefois avait enseigné, et sa doctrine, d’abord combattue, s’était glissée et prévalait dans l’Église romaine. Un jour qu’à genoux dans l’église, il écoutait la lecture des saintes Écritures, il fut frappé par ce passage : « Ce n’est pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde » (Romains 9:16). Le salut ne vient ni de la volonté, ni des efforts de l’homme, mais de la miséricorde de Dieu, de sa pure et souveraine grâce. Il ne voulut pas d’abord se soumettre à cette vérité qui humilie l’orgueil de l’homme en lui montrant qu’il ne peut rien et qu’il n’est rien. Mais il ne put pas résister à la puissance de la parole de Dieu, et il fut converti à la grande et précieuse doctrine de la grâce qui seule sauve le pécheur. Il se mit aussitôt à enseigner ce qu’il avait reçu. Il s’occupait peu des traditions des hommes, mais il était pénétré de l’Écriture et s’affligeait de voir l’Église romaine mettre à la place de la pure grâce de Dieu pour le salut les efforts et les œuvres de l’homme.
(*) Nous avons parlé de Pélage à propos d’Augustin. Il vivait à la fin du 4° et au commencement du 5° siècle.
« Comme autrefois quatre cent cinquante prophètes de Baal s’élevaient contre un seul prophète de Dieu », disait-il, « qu’ils sont nombreux ceux qui, aujourd’hui, combattent avec Pélage contre ta grâce gratuite ! Ils prétendent non recevoir gratuitement la grâce, mais l’acheter. La volonté de l’homme doit précéder, disent-ils, et la tienne doit suivre. La leur est la maîtresse, et la tienne la servante. Le monde presque entier marche dans l’erreur de Pélage. Lève-toi donc, Seigneur, et juge enfin ta cause ! » On voit que Bradwardine avait compris les paroles de l’apôtre Paul : « Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu » (Éphésiens 2:8) et encore : « Étant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus » (Romains 3:24). Le Seigneur devait se lever, en suscitant d’abord Wiclef et ses disciples, et plus tard Luther et les autres réformateurs, dont la doctrine fondamentale serait, d’après les Écritures, le salut gratuit par la grâce et non acheté par des œuvres. Quant au pieux Bradwardine, qui avait combattu pour cette précieuse vérité, il venait d’être nommé archevêque de Canterbury, lorsqu’il mourut en 1349.
Occupons-nous maintenant de Wiclef. Il était né en 1324, dans un village du comté d’York, nommé Wycliffe. C’est de là qu’il tira son nom. Il était Jean de Wycliffe. Il étudia à Oxford au collège de Merton, et avait pu y entendre les enseignements de Bradwardine et en profiter. Pendant qu’il était encore étudiant en 1345, une peste terrible ravagea l’Asie, l’Europe, et sévit aussi fortement en Angleterre. Ce jugement de Dieu saisit profondément Wiclef. Effrayé à la pensée de l’éternité, troublé dans son âme à la vue de ses péchés et dans l’attente du jugement, il demandait à Dieu ce qu’il fallait faire, et Dieu lui répondit par sa sainte Parole. Il trouva la paix, et ce qu’il avait appris, il résolut de le faire connaître à d’autres, mais il commença avec prudence.
En 1361, ayant été choisi comme chef ou directeur du collège de Balliol, il se mit à exposer plus énergiquement la parole de Dieu et les doctrines de la foi. Dans la semaine, il les expliquait et les démontrait aux étudiants, et le dimanche il les prêchait au peuple dans un langage simple. Sa piété et sa droiture, aussi bien que sa science, donnaient un grand poids à sa parole. Il accusait le clergé d’avoir mis de côté les saintes Écritures, et demandait que l’autorité de la parole de Dieu fût rétablie dans l’Église.
À cette époque aussi, Wiclef s’élevait avec force contre les différents ordres de moines mendiants (*) et surtout contre les franciscains, tout dévoués au pape. Il les représente s’efforçant, par des fraudes pieuses, d’accaparer les richesses du pays en dépouillant riches et pauvres. « Chaque année », disaient-ils, « saint François descend du ciel au purgatoire, et délivre les âmes de tous ceux qui ont été ensevelis sous l’habit de son ordre ». Évidemment pour obtenir une si grande faveur, il fallait payer. Nous avons là un exemple des mensonges qui se débitaient pour abuser de la crédulité du peuple. Ces moines, franciscains et autres, enlevaient les enfants à leurs parents et les enfermaient dans leurs cloîtres. Ils faisaient semblant d’être pauvres, et, la besace sur l’épaule, s’en allaient mendiant d’un air piteux, auprès des grands et des petits. Mais, en même temps, ils vivaient dans des demeures somptueuses où ils amassaient des richesses, se vêtant d’habits précieux, et passant leur temps dans des festins. Remplis d’orgueil, les moindres d’entre eux se tenaient pour des seigneurs et, s’il y en avait de plus instruits, ils s’estimaient autant que des rois. Tandis qu’ils se divertissaient et s’enivraient à leurs tables richement servies, ils envoyaient n’importe qui prêcher à leur place des fables et des légendes pour amuser et dépouiller le peuple. Si quelque seigneur parlait de donner ses aumônes aux pauvres et non aux moines, ceux-ci poussaient des cris contre une telle impiété et menaçaient le pays de toutes sortes de calamités. C’est Wiclef qui trace ainsi le tableau de la vie de ces moines mendiants et de la tyrannie qu’ils exerçaient sur la nation. Quoi d’étonnant à ce qu’il les stigmatisât et déclarât hautement leurs vices et les abus qu’ils se permettaient ! Ils entraînaient à leur perte les âmes que lui, éclairé par la parole de Dieu, désirait sauver.
(*) Les deux principaux ordres de moines mendiants étaient les franciscains et les dominicains. Le premier fut fondé par saint François d’Assise, appelé ainsi du nom de sa ville natale. Après une jeunesse dissipée, il fut saisi un jour en entendant lire ces paroles de Jésus au jeune homme riche : « Va, vends ce que tu as et donne aux pauvres ». François se voua à la pauvreté ; vêtu de haillons, mendiant pour vivre, il se mit à prêcher la pauvreté et la pénitence. Il avait de la piété, mais sans connaissance, et en même temps un esprit bizarre, rempli d’idées étranges. Il saluait les oiseaux et toutes les bêtes de la création comme des frères et des sœurs et leur adressait des discours. Son ascendant sur les foules était très grand, et ce qui l’augmentait encore, c’étaient les stigmates des cinq plaies de Jésus mort que l’on prétendait avoir été imprimées sur son corps par un séraphin. Tels sont les mensonges et les illusions dont Satan se sert pour séduire les âmes. Un grand nombre de disciples se rassemblèrent autour de François, et ils furent constitués en ordre par le pape Honorius III, en 1223. Ils devinrent la milice la plus dévouée aux papes. Mais ils ne gardèrent pas longtemps l’austérité recommandée par leur fondateur.
Nous avons parlé déjà de Dominique et des dominicains, agents principaux de l’inquisition.
En l’an 1365, Wiclef fut appelé à s’occuper d’un autre sujet. Le pape Urbain V réclama du roi Édouard III le paiement annuel de 1000 marcs que le roi Jean avait autrefois consenti à payer à Innocent III, comme tribut féodal, en se reconnaissant son vassal. Le pape sommait Édouard de le reconnaître comme souverain légitime de l’Angleterre, et, en cas de refus, le citerait à comparaître devant lui à Rome. Ces prétentions orgueilleuses soulevèrent une grande indignation en Angleterre.
Wiclef s’y opposa avec énergie et fit valoir tous les arguments qui militaient contre les exigences du pape. Il les fit connaître à plusieurs des membres du parlement qui s’était assemblé pour examiner cette affaire. Le parlement refusa de se rendre aux demandes du pape, et déclara qu’aucun prince n’avait le droit d’aliéner la souveraineté du royaume sans le consentement du peuple. Le pape vit qu’il était inutile d’insister, et s’efforça de conserver au moins son autorité spirituelle sur l’Angleterre. Une conférence se réunit à Bruges dans ce but. Wiclef y fut envoyé avec d’autres commissaires. Nous ne nous arrêterons pas sur ce qui fut traité dans cette conférence ; nous dirons seulement que ce séjour à l’étranger fut d’un grand profit à Wiclef. Ses yeux s’ouvrirent davantage à toute l’iniquité du système de la papauté, et il fut confirmé dans le jugement qu’il avait déjà porté sur elle.
À son retour en Angleterre, Wiclef fut nommé recteur de l’église de Lutterworth, et il se mit à prêcher avec hardiesse ses doctrines pour la réformation de l’Église. « L’Évangile », disait-il, « est l’unique source de la religion. Le pontife romain n’est qu’un coupeur de bourses. Loin d’avoir le droit de réprimander le monde entier, il peut être légitimement repris par ses inférieurs, et même par les laïques ». En appelant le pape un coupeur de bourses, il voulait dire qu’il cherchait à s’enrichir par toutes sortes de moyens, au détriment des princes et du peuple.
Le langage et les prédications de Wiclef alarmèrent le clergé et les partisans du pape. L’évêque de Londres, Courtenay, l’accusa d’hérésie, et Wiclef dut comparaître, en 1377, devant une assemblée du clergé, dans l’église de Saint-Paul. Un immense concours de peuple remplissait la cathédrale, foule composée en grande partie de fanatiques dévoués au pape. Wiclef s’avança entre le duc de Lancaster, régent du royaume et ami du réformateur, et Lord Percy, maréchal d’Angleterre. Ils eurent beaucoup de peine à se frayer un passage à travers cette foule animée de sentiments hostiles, et qui, si Wiclef eût été seul, lui aurait fait un mauvais parti. Enfin ils arrivèrent devant le clergé présidé par Courtenay. Celui-ci ne fut pas peu surpris de voir l’accusé se présenter sous la protection des deux plus puissants seigneurs du royaume. Il y eut entre l’évêque et les deux lords un échange de paroles aigres, et le duc de Lancaster, dans un moment d’irritation, dit à quelqu’un de sa suite : « Plutôt que de me soumettre à ce prêtre, je le tirerai par les cheveux à bas de sa chaire ». Mais ce propos fut entendu par d’autres, et un grand tumulte s’ensuivit. Les partisans de l’évêque se jetèrent sur les deux lords que leurs serviteurs et leurs amis défendirent ; à grand’peine purent-ils s’échapper. Wiclef était demeuré calme : on le renvoya en lui défendant de prêcher ses doctrines.
Mais il ne pouvait se taire. Il continua à prêcher et à dénoncer le mal de la papauté. En ce moment il y avait deux papes qui prétendaient chacun être le véritable chef de l’Église. Wiclef disait que les deux formaient un seul Antichrist. Il fut de nouveau cité devant l’évêque ; mais cette fois il vint seul, sans l’appui des grands seigneurs. On s’attendait à le voir dévoré, dit un historien, car il entrait dans la fosse aux lions. Mais comme autrefois Daniel et Paul, il fut délivré de la gueule du lion (*). À peine l’évêque avait-il commencé de procéder contre Wiclef, que sir Clifford entra et, de la part de la reine mère qui aimait Wiclef, défendit de continuer. Le clergé fut confondu ; il n’avait aucun pouvoir pour résister. Wiclef se retira en déposant une protestation : « J’ai le désir et l’intention », disait-il, « par la grâce de Dieu, d’être un vrai chrétien, et, aussi longtemps que je respirerai, de professer et de défendre la loi de Christ ».
(*) Daniel 6:20-22 ; 2 Timothée 4:17.
Dès lors Wiclef ne s’occupa plus autant de la politique que devait suivre l’Angleterre à l’égard du pape. Il se livra plus entièrement à l’œuvre de l’évangélisation dont la valeur s’accrut à ses yeux. Il désirait que l’Évangile fût annoncé jusque dans les moindres hameaux. Les moines parcouraient bien le pays en prêchant les absurdes légendes des saints, pourquoi ne répandrait-on pas partout l’Évangile ? Il s’adressa à ses disciples et leur dit : « Allez et prêchez ; c’est l’œuvre la plus sublime. Mais n’imitez pas les prêtres que l’on voit après le sermon assis dans les cabarets, à la table de jeu, ou perdant leur temps à la chasse. Quant à vous, après avoir prêché, visitez les malades, les vieillards, les pauvres, les aveugles et les infirmes, et secourez-les selon votre pouvoir ».
Les évangélistes de Wiclef, les pauvres prêtres, comme on les nommait, s’en allèrent donc, le bâton à la main, pieds nus, vêtus d’une robe d’étoffe grossière, vivant d’aumônes, et prêchant l’Évangile dans les champs, au bord des routes, dans les cimetières, près des villages, partout où ils trouvaient des auditeurs. Wiclef leur avait enseigné que le salut ne vient ni des anges, ni des saints, mais qu’il est en Christ seul. « Un ange », disait-il, « n’aurait pu faire propitiation pour l’homme, car la nature qui a péché n’est pas celle des anges. Le Médiateur devait être un homme ; mais tout homme étant redevable à Dieu de tout ce qu’il est capable de faire, il fallait que le Médiateur eût un mérite infini et fût en même temps Dieu ».
Le clergé régulier s’alarma et obtint une loi qui ordonnait à tout officier du roi de jeter en prison les prédicateurs. Aussi, dès que paraissait un pauvre prêtre pour prêcher, les moines qui se tenaient cachés pour l’épier, allaient chercher main-forte afin de l’arrêter. Mais souvent, aussitôt que les sergents s’approchaient, le peuple se serrait autour du prédicateur et formait une forte barrière pour empêcher qu’il fût molesté. Ainsi, par le moyen de ces prédicateurs dévoués, l’Évangile se répandait de plus en plus et atteignait jusqu’aux endroits les plus reculés du pays. Le jour à venir révélera seul les fruits de ces semailles de la parole de Dieu.
Outre son œuvre d’évangélisation, Wiclef s’acquittait à Oxford de ses fonctions de professeur. Mais il n’était pas d’une forte constitution ; ses travaux et les luttes qu’il avait soutenues l’avaient affaibli, et, en 1379, il tomba dangereusement malade. On ne s’attendait pas à ce qu’il se relevât, et le parti du pape jubilait. Mais pour que son triomphe fût complet, il fallait obtenir de Wiclef la rétractation de ce qu’il avait enseigné. Quatre représentants des quatre ordres religieux accompagnés de quatre aldermen (*), se rendirent auprès du mourant. « Vous avez la mort sur les lèvres », lui dirent-ils, « repentez-vous de vos fautes, et rétractez en notre présence tout ce que vous avez dit contre nous, à notre préjudice ». Wiclef resta calme et serein, et se tut pendant un moment. Les religieux étaient pleins d’espoir et attendaient sa rétractation.
(*) Charge qui répond à celle de conseillers municipaux.
Il demanda à son serviteur de le soulever sur son lit. Alors, rassemblant ses forces et fixant sur ses ennemis un regard perçant, il dit : « Je ne mourrai pas, mais je vivrai, et je déclarerai encore les turpitudes des moines ». Désappointés et confus, ses adversaires se retirèrent. Wiclef se rétablit, et vécut pour accomplir une œuvre plus grande que tout ce qu’il avait fait jusqu’alors.
L’œuvre que Wiclef avait à cœur d’accomplir, c’était de donner aux Anglais la Bible dans leur propre langue. Il y avait bien eu, avant lui, quelques traductions, en langue vulgaire, de diverses portions des Écritures, mais ces volumes restaient cachés dans les bibliothèques des couvents. Il s’ensuivait que, sauf le clergé et peut-être quelques personnes qui pouvaient lire le latin, personne ne possédait une Bible et ne savait de son contenu que ce que les prêtres en disaient. Et cependant depuis des siècles l’Angleterre professait le christianisme. Il est vrai, comme nous l’avons vu, que défense était faite au peuple d’avoir et de lire les saints écrits en langue vulgaire. Mais le temps était venu où, malgré cette défense, la Bible allait être répandue parmi tous, savants et ignorants.
Wiclef ignorait le grec et l’hébreu ; il fut donc obligé de faire sa traduction sur la version latine appelée la Vulgate, mais cela valait mieux que de n’avoir pas la Bible du tout. Il travailla laborieusement à cette œuvre durant dix années, aidé par quelques amis, et un an après la maladie dont nous avons parlé, en 1380, l’ouvrage fut terminé et publié sans notes, ni commentaires.
Quand nous disons publié, il faut comprendre que l’on en fit des copies pour les vendre. L’imprimerie n’avait pas encore été inventée, et l’on n’avait d’autre moyen d’avoir des exemplaires d’un ouvrage que le long et coûteux procédé de les écrire à la main. Les copistes se mirent diligemment à l’œuvre, et bientôt des portions du saint volume furent mises en vente. Elles furent rapidement écoulées, ainsi que des copies du volume entier. L’accueil que reçut l’œuvre de Wiclef dépassa son attente. C’était avec joie que nombre de personnes achetaient la parole de Dieu. Elles n’avaient jamais connu cette source de toute vérité, et maintenant elles pouvaient lire dans leur langue maternelle les merveilles de la révélation de Dieu donnée à l’homme. Une grande lumière, la lumière de Dieu, s’était levée dans les ténèbres de superstitions et d’erreurs qui couvraient le monde, et depuis lors, malgré les efforts de Satan et de ses agents pour l’éteindre, elle n’a pas cessé de briller dans ces contrées.
L’ennemi se montra bientôt. Dès que Wiclef eut publié sa traduction de la Bible, il fut assailli de tous côtés par les amis du pape. « C’est une hérésie », disaient les uns, « de faire parler la Sainte Écriture en anglais ». D’autres disaient : « Maître Wiclef, en traduisant l’Évangile en anglais, l’a rendu plus accessible et plus compréhensible aux laïques et même aux femmes qu’il ne l’avait été jusqu’ici aux clercs intelligents et lettrés » ; à quoi d’autres ajoutaient, en affectant de craindre que l’Évangile ne fût ainsi rendu méprisable : « La perle évangélique est foulée aux pieds par les pourceaux ». Quelques-uns se plaçaient sur un autre terrain et prétendaient mettre l’Église au-dessus des Écritures. « Puisque l’Église », disaient-ils, « a approuvé quatre évangiles, elle aurait pu tout aussi bien les rejeter et en admettre d’autres. L’Église sanctionne ou condamne ce qu’elle veut. Croyez l’Église plus que l’Évangile ». C’était là le grand point. L’Église de Rome voulait être l’autorité suprême. Mais ce n’est pas elle qui a donné les Écritures. C’est Dieu lui-même, et ce sont elles que nous devons croire.
Wiclef ne se laissait point émouvoir par les clameurs des prêtres et des moines. « Quand même le pape et tous les clercs disparaîtraient de la face de la terre », disait-il, « notre foi ne défaudrait pas, car elle est fondée sur Jésus seul, notre Maître et notre Dieu ». D’ailleurs il n’était pas sans encouragements. Une copie des évangiles avait pénétré jusque dans le palais, et Anne de Luxembourg, femme du roi Richard II, s’était mise à les lire diligemment. Elle les communiqua à Arondel, archevêque d’York, qui, frappé de voir une étrangère, une reine, lire des « livres aussi vertueux », il voulait dire excellents, se mit à les étudier, et blâma les prélats qui en négligeaient la lecture. À la Chambre des lords, une motion fut faite par les partisans des prêtres de saisir tous les exemplaires des Écritures et de les détruire. Mais le duc de Lancaster s’écria : « Sommes-nous donc la lie du genre humain que nous ne puissions pas posséder la loi de notre religion dans notre propre langue ? »
Cependant l’œuvre progressait. Wiclef lui-même fut amené à étudier plus profondément la Bible qu’il avait donnée au peuple. La doctrine de la messe, ce point fondamental de l’Église de Rome, attira son attention. C’était une des sources de gain pour le clergé et la base de son autorité sur le peuple. Faire descendre à sa parole Dieu du ciel dans l’hostie consacrée, à quelle hauteur cela élevait le prêtre ! Wiclef éclairé par la parole de Dieu, ne pouvait admettre qu’un homme eût le pouvoir de transformer un morceau de pain dans la chair, le sang et la divinité de Christ. « L’hostie consacrée que nous voyons sur l’autel », disait-il, « n’est pas Christ, ni une partie de Christ, mais elle est son signe efficace ». — « Comment peux-tu, ô prêtre, qui n’es qu’un homme, créer ton Créateur ? » ajoutait Wiclef. « Quoi ! la plante qui croît dans les champs, cet épi que tu cueilles aujourd’hui, demain sera Dieu ! Ne pouvant faire les œuvres de Jésus, tu veux faire Celui qui a accompli les œuvres ! »
L’attaque de Wiclef contre la doctrine de la transsubstantiation effraya ses amis. Le duc de Lancaster qui jusqu’alors l’avait soutenu, cessa de le défendre, après l’avoir exhorté, supplié, et même lui avoir ordonné de se taire sur ce sujet. Mais Wiclef ne pouvait cacher la lumière qu’il avait reçue de Dieu. Ses ennemis trouvèrent là une bonne occasion pour chercher à le perdre.
Courtenay avait été promu à l’archevêché de Canterbury. Il se hâta de convoquer un synode dans le but de condamner Wiclef. On se réunit en mai 1382, et l’on allait procéder à la condamnation de celui qu’on tenait pour hérétique, lorsqu’un violent tremblement de terre se fit sentir à Londres et dans une partie de l’Angleterre. Les prélats effrayés crurent voir dans ce phénomène une marque de la désapprobation de Dieu, et hésitaient à prononcer la sentence. Mais l’habile archevêque sut se faire de l’événement une arme en sa faveur. « Ne savez-vous pas », dit-il, « que les vapeurs nuisibles qui prennent feu dans le sein de la terre et produisent ces phénomènes qui vous effrayent, perdent leur force lorsqu’elles s’échappent ? De la même manière, en rejetant l’hérétique de notre communion, nous mettrons fin aux convulsions de l’Église ». Rassurés, les évêques prononcèrent la condamnation de Wiclef, après avoir entendu la lecture de dix propositions qu’on disait être de lui et qui furent déclarées hérétiques.
L’archevêque pressa le roi d’approuver la décision du synode. « Si nous permettons à cet hérétique de faire continuellement appel aux passions du peuple » (*), dit-il au roi, « notre destruction est inévitable. Il faut réduire au silence ces Lollards (**), ces chanteurs de psaumes ». Le roi donna des ordres pour que l’on jetât dans les prisons de l’état ceux qui soutiendraient les propositions condamnées. Un à un, ses amis les plus dévoués abandonnaient Wiclef mais il ne perdit pas courage. Il se consola en disant : « La doctrine de l’Évangile ne périra jamais ». Wiclef aurait dû en rester là, et continuer paisiblement son œuvre, mais il crut devoir en appeler à la Chambre des communes et présenta une pétition où il disait entre autres : « Puisque Jésus Christ a répandu son sang pour affranchir l’Église, je demande son affranchissement. Je demande que chacun puisse sortir de ces sombres murailles, où règne une loi tyrannique, et embrasser une vie simple et paisible sous la voûte du ciel. Je demande que les pauvres habitants de nos villes et de nos campagnes ne soient pas contraints de fournir à un prêtre mondain, souvent vicieux et hérétique, de quoi satisfaire son ostentation, sa gourmandise et son impudicité ; de quoi acheter un beau cheval, des selles magnifiques, des brides avec des clochettes retentissantes, de riches vêtements, des fourrures précieuses, tandis que le pauvre peuple voit ses veuves, ses femmes et ses enfants mourir de faim ». Nous voyons par ces lignes quels abus criants étaient tolérés et quel joug pesait alors sur le peuple. La Chambre des Communes vit que son autorité avait été méconnue, puisque les ordres du roi n’avaient pas reçu son assentiment, et elle ordonna le rappel.
(*) Il y avait eu à cette époque un soulèvement des paysans, et on l’attribuait à tort aux prédications de Wiclef.
(**) Probablement de lollen, chanter. On donnait ce nom à ceux qui s’opposaient à Rome, et plus spécialement aux disciples de Wiclef.
Courtenay fut déconcerté, mais, déterminé à ne pas laisser échapper Wiclef, il se rendit à Oxford, rassembla les chefs de l’église, et somma Wiclef de paraître devant lui, en ayant soin de laisser les portes ouvertes aux laïques et aux étudiants, afin que l’humiliation du vieux champion de la vérité fût complète et publique. Wiclef était affaibli par l’âge et ses nombreux travaux ; mais il avait une âme forte dans un corps chétif, et n’avait jamais craint de paraître devant un homme. Il se rendit à la sommation. Mais l’affaire se termina d’une manière à laquelle Courtenay était loin de s’attendre. Arrêtant sur l’archevêque ce regard perçant et assuré qui avait autrefois fait fuir les moines, il accusa le clergé catholique romain d’être semblable aux prêtres de Baal et lui reprocha de répandre l’erreur et de fermer les yeux au mal, afin de vendre ses messes et de remplir sa bourse. Puis en terminant, il s’écria : « La vérité vaincra », et il se retira sans qu’aucun de ses ennemis osât dire un mot ou l’arrêter. Il se retira à Lutterworth.
Wiclef n’était pas encore à l’abri des attaques de ses ennemis. Il vivait paisiblement au milieu de ses paroissiens et de ses livres, étudiant la vérité et l’annonçant autour de lui, lorsqu’il reçut du pape un bref (*) le sommant de paraître devant lui à Rome. Cette sommation lui serait sans doute arrivée plus tôt s’il n’y avait eu en ce temps-là deux papes rivaux, trop occupés à s’insulter et à se maudire l’un l’autre, pour avoir le temps de penser à un aussi chétif personnage que Wiclef. L’Écosse, la France et d’autres pays, reconnaissaient le pape Clément VII, tandis que l’Angleterre, l’Italie et d’autres États, tenaient pour le pape Urbain VI. Comme celui-ci avait en Angleterre un grand nombre de chauds partisans, ils insistaient, auprès de lui sur le danger que les doctrines de Wiclef faisaient courir à la cause de l’Église romaine, de là le bref du pape.
(*) Nom donné aux communications papales.
Wiclef crut que ses infirmités croissantes suffisaient pour le justifier de ne pas se rendre à l’appel du pape, mais il résolut de lui écrire et de lui faire connaître quel est le véritable Chef de l’Église. Dans sa lettre, en premier lieu, il exalte l’Évangile, puis il déclare que le pape lui-même est tenu d’y obéir : « Je crois », dit-il, « que l’Évangile de Christ est le corps complet de la révélation de Dieu. Je crois que Christ qui nous l’a donné est Lui-même vrai Dieu et vrai homme, et qu’ainsi cette révélation est au dessus de tout. Je crois que l’évêque de Rome est obligé plus que tout autre à s’y soumettre, car la grandeur parmi les disciples de Christ ne consiste pas en dignités et en honneurs mondains, mais à suivre de près et fidèlement le Christ dans sa vie et dans ses actes. De là je conclus que nul homme fidèle ne doit suivre le pape ni aucun des hommes saints, si ce n’est quand ils suivent Jésus Christ. Il faut qu’à l’exemple de Christ, le pape remette à l’État ses pouvoirs temporels, et engage son clergé à faire de même ».
Urbain VI était trop occupé de sa lutte avec Clément pour se mettre davantage en peine de Wiclef, de sorte que celui-ci put continuer ses travaux sans être molesté. C’est alors qu’il écrivit son « trialogue ». Ce sont des entretiens entre trois personnages symboliques, la vérité, le mensonge et l’intelligence. Le premier propose des questions, le second fait des objections et le troisième établit la saine doctrine. Une des grandes vérités que Wiclef affirme est l’autorité suprême des Écritures. « L’Église est tombée », dit l’un des interlocuteurs, « parce qu’elle a abandonné l’Évangile et lui a préféré les lois du pape. Quand il y aurait cent papes à la fois dans le monde, et que tous les moines de la terre fussent transformés en autant de cardinaux, il ne faudrait leur accorder aucune confiance en matière de foi, s’ils ne s’appuient pas sur les saintes Écritures ».
Voici encore quelques-unes des conclusions de Wiclef : « L’autorité des saintes Écritures, qui sont la loi du Christ, surpasse infiniment celle de toute autre écriture ».
« L’Écriture est la règle de la vérité, et doit être la règle de la réforme. Il faut rejeter toute doctrine et tout précepte qui ne reposent pas sur cette base ».
« Croire que l’homme peut quelque chose dans l’œuvre de la régénération est la grande hérésie de Rome, et de cette erreur est venue la ruine de l’Église ».
« La conversion procède de la grâce de Dieu seule ; le système qui l’attribue en partie à l’homme et en partie à Dieu est pire que celui de Pélage ».
« Christ est tout dans le christianisme ; quiconque abandonne cette source toujours prête à communiquer la vie, et se tourne vers les eaux troubles et croupissantes, est un insensé ».
« La foi est un don de Dieu ; elle exclut tout mérite, et doit bannir de l’âme toute crainte ».
« La seule chose nécessaire dans la vie chrétienne et dans la cène, n’est pas un vain formalisme et des rites superstitieux, mais la communion avec Christ selon la puissance de la vie spirituelle ».
« Le peuple chrétien doit se soumettre non à la parole d’un prêtre, mais à la parole de Dieu ».
« La vraie Église est l’Assemblée des justes, pour lesquels Christ a répandu son sang ».
« Tant que Christ est dans le ciel, l’Église a en Lui le meilleur pape. Il est possible qu’un pape soit condamné au dernier jour pour ses péchés ».
Telles sont les vérités que Wiclef, enseigné par le Saint Esprit, tira des Écritures. Il n’eut pas d’autre maître. Il passa tranquillement ses derniers jours. Menacé comme il l’était de toutes parts, il pouvait bien s’attendre à mourir comme martyr. « Annoncez », disait-il, « la parole de Christ à d’orgueilleux prélats, et le martyre ne vous manquera pas. Quoi ! vivre et me taire ? Jamais ! Que le coup tombe, je l’attends ». Mais Dieu lui donna de mourir en paix. Le 29 décembre 1384, il était dans la chapelle de Lutterworth debout devant l’autel, au milieu de ses paroissiens. Au moment où il élevait le pain de la cène, il tomba frappé de paralysie. Transporté dans sa demeure, il vécut encore quarante-huit heures et rendit l’esprit le dernier jour de l’année.
Ainsi passa celui à qui Dieu avait permis d’accomplir une grande œuvre en Angleterre, celle de donner la Bible au peuple, d’envoyer prêcher l’Évangile et de dénoncer les erreurs de Rome. Depuis ce moment la lumière divine ne s’éteignit plus dans ce pays, et elle se répandit dans d’autres contrées. Ceux qui suivirent sa doctrine furent nommés Wiclefites, ou plus communément Lollards. Rome les poursuivait de sa haine, et plusieurs subirent le martyre. Etre un disciple de Wiclef, adhérer à ses enseignements, suffisait pour être déclaré hérétique et poursuivi comme tel par l’Église de Rome. Celle-ci manifesta combien elle avait senti l’attaque dirigée contre elle par l’œuvre de Wiclef. N’ayant pu atteindre le réformateur durant sa vie, elle se vengea sur lui après sa mort. Le concile de Constance tenu en 1415, ordonna que ses restes fussent brûlés. La sentence fut exécutée en 1428, et les cendres furent jetées dans un ruisseau voisin. Mais la vérité que Wiclef avait mise en lumière ne pouvait être brûlée. Elle était semée dans les cœurs et portait du fruit pour la vie éternelle.
Peu avant sa fin, Wiclef prononça ces paroles remarquables : « Quelques frères (des moines) que Dieu daignera enseigner, ayant abandonné leur infidélité, reviendront librement à la primitive religion du Christ, et alors édifieront l’Église comme Paul ». Ne semble-t-il pas avoir annoncé d’avance le réformateur Luther ?
Le légat alarmé, voyant que la ville ne serait pas réduite si aisément qu’il le pensait, eut recours à une ruse diabolique. Il persuada à l’un des officiers de l’armée d’essayer d’attirer le comte Roger hors de la ville, promettant à cet officier, outre les récompenses terrestres, celles qui lui seraient réservées dans le ciel, s’il réussissait. Il ne réussit que trop bien. Sous le prétexte de négociations de paix, et sur la promesse et le serment solennel de ramener Roger sain et sauf dans la ville, celui-ci se rendit auprès du légat avec quelques-uns de ses chevaliers. À peine avait-il commencé à présenter quelques propositions au légat et à parler en faveur des habitants de la ville, qu’Amoult se leva et déclara que les habitants feraient à leur bon plaisir, mais que Roger était prisonnier. En vain celui-ci protesta contre une telle perfidie ; n’était-ce pas sur la foi d’un serment solennel qu’il était venu ? Arnoult dit que l’on n’était pas tenu de garder la foi à un homme qui avait été infidèle à Dieu. En un clin d’œil Roger et ses compagnons furent chargés de chaînes, et bientôt on apprit que le noble comte était mort en prison, non sans de forts soupçons qu’il avait été empoisonné.
Les habitants de Carcassonne ayant appris le sort de leur jeune et courageux chef, perdirent tout espoir de défendre leur ville. Échapper semblait impossible, parce que l’ennemi les entourait de toutes parts. Le désespoir s’emparait d’eux, lorsque le bruit se répandit que quelques-uns des plus vieux habitants se souvenaient que quelque part dans la ville s’ouvrait un passage souterrain conduisant au château de Caberet, à une distance d’environ trois lieues ; mais personne n’en connaissait l’entrée. Excepté les hommes qui défendaient les remparts, tous se mirent à chercher diligemment, et enfin on entendit répéter : « L’entrée est trouvée ». Aussitôt on fit des préparatifs pour l’exode ; on rassembla des vivres pour plusieurs jours, mais sauf les quelques objets qu’ils pouvaient emporter avec eux, tout le reste devait être laissé. Mais cela valait infiniment mieux que de tomber entre les mains de meurtriers sans merci. Nous pouvons être sûrs que bien des actions de grâces montèrent à Dieu pour cette perspective de délivrance, et que bien des prières lui furent adressées pour que leur entreprise fût couronnée de succès.
Ce n’était pas moins très douloureux. « C’était une vue triste et affligeante », dit leur historien, « que ce départ accompagné de soupirs, de larmes et de lamentations, tandis qu’ils s’avançaient avec l’espoir incertain de sauver leurs vies par leur fuite ; les parents conduisant leurs jeunes enfants, et les plus robustes soutenant les vieillards décrépis. Et surtout combien il était navrant d’entendre les gémissements des femmes ! »
Dieu les protégea ; le jour suivant ils atteignirent sains et saufs le château, d’où ils se dispersèrent partout où Dieu leur ouvrit une porte de refuge. Au matin, l’armée assiégeante fut étonnée de n’entendre aucun bruit dans la ville. On craignit quelque stratagème, mais les murailles ayant été escaladées, un cri se fit entendre : « Les Albigeois ont fui ». Le butin, par l’ordre du légat, fut partagé entre les croisés, et les prêtres se vengèrent de la fuite des Albigeois en faisant brûler quatre cents habitants qui avaient été faits prisonniers !
Simon de Montfort avec son armée continua à s’avancer dans le pays. Il assiégea le château de Minerve, près de Saint-Pons. On disait de cette place que depuis trente ans aucune messe n’y avait été dite, preuve de l’extension des doctrines vaudoises. Raymond, comte de Termes, défendait la place, mais le manque d’eau l’obligea à se rendre. Le légat avait décidé de laisser la vie sauve aux catholiques et à ceux qui se convertiraient. Les chevaliers se récrièrent disant qu’ils étaient venus pour exterminer les hérétiques et non pour les absoudre. Le légat les rassura en disant : « Je les connais ; pas un ne se convertira ». En effet, Raymond étant exhorté à revenir à la foi catholique, refusa et fut jeté en prison, où bientôt il mourut. Sa femme, sa sœur, sa fille et d’autres femmes de qualité, repoussèrent les efforts faits pour les convertir, et furent brûlées ensemble. Restaient les habitants. Sommés de reconnaître le pape et l’Église romaine, ils s’écrièrent tous ensemble : « Nous ne voulons pas renoncer à notre foi, et nous rejetons la vôtre. Vous travaillez pour le néant ; ni mort, ni vie, ne nous fera abandonner notre croyance ». Sur cette réponse, le comte Simon et le légat firent allumer un grand feu où furent jetés cent quarante hommes et femmes. Un historien qui rapporte ce fait dit que « ce fut une chose merveilleuse de les voir monter au bûcher avec allégresse, et comme de vrais martyrs de Jésus Christ ».
En maints autres endroits, les Albigeois montrèrent la fermeté de leur foi, tandis que Montfort, son armée et les prêtres déployaient contre eux la cruauté la plus grande. Nous ne poursuivrons pas cette histoire de meurtre et de carnage. Qu’il suffise de dire que Montfort, ayant mis le siège devant Toulouse, y expia ses cruautés. Il fut frappé d’une pierre lancée par une machine, et mourut. Cela n’arrêta pas la persécution contre les Albigeois. Les inquisiteurs achevèrent l’œuvre de leur destruction. Il périt, dit-on, un million de victimes dans les provinces méridionales de la France. Un grand nombre d’Albigeois se réfugièrent dans les forêts et les montagnes ; d’autres passèrent dans les vallées des Alpes, en Italie et en Lombardie.
7.4 - Les Précurseurs de la Réformation
Comme nous l’avons vu, la main impitoyable de l’Église de Rome — cette sainte Mère, comme elle se nommait — s’appesantissait partout et sur tous ceux qui ne pliaient pas le genou devant elle, et qui rejetaient sa suprématie et ses doctrines antichrétiennes. « Hors d’elle, point de salut », affirmait-elle ; et ce salut n’était pas le salut par grâce, mais un salut acheté par des œuvres, dispensé par les prêtres, intermédiaires soi-disant entre Dieu et les hommes, dominant les consciences et assumant, pour maintenir leur prestige et leur autorité, la prétention blasphématoire de transformer, par des paroles consacrées, le pain et le vin de la Cène dans la personne de Christ, chair, sang, âme et divinité ! À la tête de ce système d’iniquité, qui enlaçait les âmes et les maintenait dans les ténèbres, le pape étendait sa domination non seulement sur le clergé, archevêques, évêques et prêtres, et sur les laïques, mais prétendait régenter les princes, les rois et les empereurs. La prison, le fer et le feu, avaient bientôt raison de ceux qui ne pliaient pas sous ce pouvoir redoutable, les hérétiques, comme Rome les nommait, et nomme tous ceux qui, s’attachant à la parole de Dieu, rejettent ses erreurs.
Toutefois, en dépit de toutes les rigueurs, de toutes les persécutions, il y eut toujours, comme nous l’avons vu, un témoignage pour la vérité, une lumière plus ou moins brillante au milieu des ténèbres, plus ou moins pure au sein de la corruption, des témoins fidèles, bravant tout pour Christ, et souffrant et mourant pour maintenir ce qu’ils avaient appris de cette parole de Dieu que le clergé cachait au peuple. C’était le petit résidu de Thyatire, protestant contre les abominations de Jésabel (Apocalypse 2:24).
Mais Dieu ne voulait pas que les ténèbres continuassent à peser sur le monde. Il allait susciter des hommes, ses serviteurs, qu’il soutiendrait par sa puissance contre Rome et les grands de la terre, qui remettraient en lumière pour tous sa Parole, la Bible, sur laquelle ils s’appuieraient, et qui annonceraient l’Évangile du salut par la foi en Jésus.
C’est le temps de cette œuvre puissante de l’Esprit de Dieu que l’on nomme la Réformation. Mais comme l’aube précède et annonce le jour, il y eut avant les grands réformateurs que Dieu suscita, tels que Luther, Calvin, et autres, les précurseurs qui préparèrent la voie. Parmi eux se trouvent surtout Wiclef en Angleterre et Jean Huss en Bohême. Nous dirons quelques mots de ce que Dieu opéra par leur moyen.
7.4.1 - Wiclef
Nous avons vu comment l’Église de Rome réussit à se soumettre peu à peu l’Angleterre. Elle y domina longtemps, non sans qu’il y eût des protestations contre sa suprématie, et des efforts faits contre l’autorité qu’elle s’attribuait même sur les rois. Plus d’un conflit eut lieu entre le pouvoir royal et la papauté ; le premier résistant à la prétention du pape d’être le suzerain du roi qui n’aurait été que son vassal ; mais l’Église n’avait rien perdu de son ascendant sur le peuple.
Avant que Wiclef parût sur la scène, il y avait eu en Angleterre des évêques même qui s’élevèrent contre la tyrannie de Rome. Parmi eux un des plus remarquables fut un évêque de la ville de Lincoln, Robert Grosse-Teste, qui vivait dans la première moitié du 13° siècle. Il était un homme pieux et énergique ; mais en même temps très humble. Il était savant et lisait les Écritures dans les langues originales. Il reconnaissait leur souveraine autorité et la mettait au-dessus de celle du pape. C’était dans le temps où le pape Innocent III venait de se proclamer « vicaire de Dieu sur la terre », que Grosse-Teste écrivait : « Suivre un pape rebelle à la volonté de Christ, c’est se séparer de Christ et de son corps, et s’il vient un temps où tous suivent un pontife égaré, ce sera la grande apostasie. Les vrais chrétiens refuseront alors d’obéir, et Rome sera la cause d’un grand schisme ». Ne semble-t-il pas annoncer la Réformation près de trois siècles à l’avance ?
Grosse-Teste désirait sérieusement la réforme des abus qu’il voyait dans l’Église, mais la tâche était trop grande ; pour réformer il aurait fallu se séparer, et le temps n’était pas venu. Deux grands ordres de moines mendiants venaient de se former, les Dominicains et les Franciscains. D’abord Grosse-Teste les avait favorisés, mais il vit bientôt quels abus il y avait parmi eux, et le besoin qu’ils avaient aussi de réformes. Il s’en occupa et les serra de près. Alors ils en appelèrent au pape. Celui-ci qui était alors à Lyon, obligea l’évêque à se présenter devant lui. Mais le pape, gagné par l’argent que les moines lui avaient donné, décida en leur faveur contre Grosse-Teste. En vain l’évêque rappela-t-il au pape ses lettres et ses promesses ; Innocent IV lui répondit : « Nous sommes disposés à les favoriser : ton œil est-il mauvais parce que je suis bon ? » (*). Combien cette citation profane de l’Écriture dut choquer le pieux évêque ! « Ô argent », dit-il en soupirant, « combien ton pouvoir est grand, surtout à la cour de Rome ! » N’est-il pas étrange que cette scène n’ait pas ouvert complètement les yeux de l’évêque sur l’apostasie de Rome ?
(*) Le pape s’appliquait le passage de Matthieu 20:15.
Peu de temps après, le pape envoya en Angleterre, pour remplir des places vacantes, des prêtres italiens qui ne savaient pas un mot d’anglais. En même temps il commanda à Grosse-Teste de donner à un jeune garçon, son neveu, un riche canonicat à la cathédrale de Lincoln. L’évêque refusa énergiquement, en disant : « Après le péché du diable, il n’y en a pas de plus opposé à l’Écriture que celui qui perd les âmes en leur donnant un ministère infidèle. Ce sont les mauvais pasteurs qui sont la cause de l’incrédulité, des hérésies et des désordres. Quand le premier des anges m’ordonnerait un tel péché, je devrais m’y refuser. Mon obéissance me défend d’obéir, c’est pourquoi je me rebelle ». Son obéissance à la parole de Dieu lui défendait d’obéir au pape. Ce fut le grand principe de la Réformation ; c’est celui qui doit nous guider — obéir à la parole de Dieu.
Le pape fut indigné. « Quel est ce vieux radoteur », dit-il, « qui ose juger mes actions ? Par saint Pierre et saint Paul, si ma générosité ne me retenait pas, je ferais de lui un exemple et un spectacle à toute l’humanité. Le roi d’Angleterre n’est-il pas mon vassal et mon esclave ? Et si je lui disais un mot, ne le jetterait-il pas en prison, chargé de honte et d’infamie ? ». Les cardinaux cherchèrent à l’apaiser. Ils lui firent remarquer que l’évêque était un saint homme et que sa lettre était vraie, et que le persécuter ferait appeler le mépris sur lui-même. Innocent ne les écouta pas, excommunia l’évêque et en nomma un autre à sa place. Mais comme les cardinaux le lui avaient dit, on ne tint nul compte de ses actes, et Grosse-Teste conserva son siège épiscopal jusqu’à sa mort en 1253.
Innocent voulut se venger sur les restes du pieux évêque et pensait à le faire exhumer, lorsqu’une nuit, raconte le chroniqueur Matthieu Pâris, Grosse-Teste lui apparut, s’approcha de son lit, le frappa de sa crosse, et lui dit d’une voix terrible et avec un regard menaçant : « Misérable ! le Seigneur ne permet pas que tu aies quelque pouvoir sur moi. Malheur à toi ! ». Le pape poussa un cri et resta à demi mort. Dès lors il n’eut plus une nuit tranquille, et mourut un an après Grosse-Teste, en faisant retentir son palais de ses gémissements.
Quelle manière d’agir, en vérité ! Traiter le roi d’Angleterre comme étant son vassal et son esclave ! Mais c’était depuis Grégoire VII la prétention des chefs de l’Église de Rome de dominer sur le pouvoir temporel. Quant à Grosse-Teste, sur son lit de mort, il déclarait encore qu’une « hérésie était une opinion conçue par des motifs charnels et contraire à l’Écriture, ouvertement enseignée et obstinément défendue », tandis que Rome traite d’hérésie tout ce qui est contraire à ses enseignements, quand bien même ceux-ci sont en opposition avec la parole de Dieu. Grosse-Teste fut une lumière dans ce temps de ténèbres. Son attachement à la parole de Dieu et son opposition à l’erreur furent remarquables ; il était capable de montrer à d’autres le chemin du salut, et bien que nous ignorions jusqu’où s’étendit son influence, sa trace ne fut certainement pas perdue pour les siècles suivants.
Dans la première moitié du 14° siècle vécut en Angleterre un autre pieux prélat, nommé Bradwardine. C’était un homme savant dans les sciences, particulièrement dans les mathématiques, mais il était aussi versé dans les Écritures. Il avait d’abord enseigné comme docteur à l’université d’Oxford, puis avait accompagné comme chapelain le roi d’Angleterre Édouard III, dans les guerres de celui-ci contre la France. Très humble et simple dans ses manières et dans sa vie, il avait d’abord été orgueilleux de sa science, et par elle éloigné de la croix de Christ. Il se confiait dans sa raison pour connaître la vérité, et pensait que l’homme, par sa propre force, pouvait faire quelque chose pour son salut. C’est ce que Pélage (*) autrefois avait enseigné, et sa doctrine, d’abord combattue, s’était glissée et prévalait dans l’Église romaine. Un jour qu’à genoux dans l’église, il écoutait la lecture des saintes Écritures, il fut frappé par ce passage : « Ce n’est pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde » (Romains 9:16). Le salut ne vient ni de la volonté, ni des efforts de l’homme, mais de la miséricorde de Dieu, de sa pure et souveraine grâce. Il ne voulut pas d’abord se soumettre à cette vérité qui humilie l’orgueil de l’homme en lui montrant qu’il ne peut rien et qu’il n’est rien. Mais il ne put pas résister à la puissance de la parole de Dieu, et il fut converti à la grande et précieuse doctrine de la grâce qui seule sauve le pécheur. Il se mit aussitôt à enseigner ce qu’il avait reçu. Il s’occupait peu des traditions des hommes, mais il était pénétré de l’Écriture et s’affligeait de voir l’Église romaine mettre à la place de la pure grâce de Dieu pour le salut les efforts et les œuvres de l’homme.
(*) Nous avons parlé de Pélage à propos d’Augustin. Il vivait à la fin du 4° et au commencement du 5° siècle.
« Comme autrefois quatre cent cinquante prophètes de Baal s’élevaient contre un seul prophète de Dieu », disait-il, « qu’ils sont nombreux ceux qui, aujourd’hui, combattent avec Pélage contre ta grâce gratuite ! Ils prétendent non recevoir gratuitement la grâce, mais l’acheter. La volonté de l’homme doit précéder, disent-ils, et la tienne doit suivre. La leur est la maîtresse, et la tienne la servante. Le monde presque entier marche dans l’erreur de Pélage. Lève-toi donc, Seigneur, et juge enfin ta cause ! » On voit que Bradwardine avait compris les paroles de l’apôtre Paul : « Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu » (Éphésiens 2:8) et encore : « Étant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus » (Romains 3:24). Le Seigneur devait se lever, en suscitant d’abord Wiclef et ses disciples, et plus tard Luther et les autres réformateurs, dont la doctrine fondamentale serait, d’après les Écritures, le salut gratuit par la grâce et non acheté par des œuvres. Quant au pieux Bradwardine, qui avait combattu pour cette précieuse vérité, il venait d’être nommé archevêque de Canterbury, lorsqu’il mourut en 1349.
Occupons-nous maintenant de Wiclef. Il était né en 1324, dans un village du comté d’York, nommé Wycliffe. C’est de là qu’il tira son nom. Il était Jean de Wycliffe. Il étudia à Oxford au collège de Merton, et avait pu y entendre les enseignements de Bradwardine et en profiter. Pendant qu’il était encore étudiant en 1345, une peste terrible ravagea l’Asie, l’Europe, et sévit aussi fortement en Angleterre. Ce jugement de Dieu saisit profondément Wiclef. Effrayé à la pensée de l’éternité, troublé dans son âme à la vue de ses péchés et dans l’attente du jugement, il demandait à Dieu ce qu’il fallait faire, et Dieu lui répondit par sa sainte Parole. Il trouva la paix, et ce qu’il avait appris, il résolut de le faire connaître à d’autres, mais il commença avec prudence.
En 1361, ayant été choisi comme chef ou directeur du collège de Balliol, il se mit à exposer plus énergiquement la parole de Dieu et les doctrines de la foi. Dans la semaine, il les expliquait et les démontrait aux étudiants, et le dimanche il les prêchait au peuple dans un langage simple. Sa piété et sa droiture, aussi bien que sa science, donnaient un grand poids à sa parole. Il accusait le clergé d’avoir mis de côté les saintes Écritures, et demandait que l’autorité de la parole de Dieu fût rétablie dans l’Église.
À cette époque aussi, Wiclef s’élevait avec force contre les différents ordres de moines mendiants (*) et surtout contre les franciscains, tout dévoués au pape. Il les représente s’efforçant, par des fraudes pieuses, d’accaparer les richesses du pays en dépouillant riches et pauvres. « Chaque année », disaient-ils, « saint François descend du ciel au purgatoire, et délivre les âmes de tous ceux qui ont été ensevelis sous l’habit de son ordre ». Évidemment pour obtenir une si grande faveur, il fallait payer. Nous avons là un exemple des mensonges qui se débitaient pour abuser de la crédulité du peuple. Ces moines, franciscains et autres, enlevaient les enfants à leurs parents et les enfermaient dans leurs cloîtres. Ils faisaient semblant d’être pauvres, et, la besace sur l’épaule, s’en allaient mendiant d’un air piteux, auprès des grands et des petits. Mais, en même temps, ils vivaient dans des demeures somptueuses où ils amassaient des richesses, se vêtant d’habits précieux, et passant leur temps dans des festins. Remplis d’orgueil, les moindres d’entre eux se tenaient pour des seigneurs et, s’il y en avait de plus instruits, ils s’estimaient autant que des rois. Tandis qu’ils se divertissaient et s’enivraient à leurs tables richement servies, ils envoyaient n’importe qui prêcher à leur place des fables et des légendes pour amuser et dépouiller le peuple. Si quelque seigneur parlait de donner ses aumônes aux pauvres et non aux moines, ceux-ci poussaient des cris contre une telle impiété et menaçaient le pays de toutes sortes de calamités. C’est Wiclef qui trace ainsi le tableau de la vie de ces moines mendiants et de la tyrannie qu’ils exerçaient sur la nation. Quoi d’étonnant à ce qu’il les stigmatisât et déclarât hautement leurs vices et les abus qu’ils se permettaient ! Ils entraînaient à leur perte les âmes que lui, éclairé par la parole de Dieu, désirait sauver.
(*) Les deux principaux ordres de moines mendiants étaient les franciscains et les dominicains. Le premier fut fondé par saint François d’Assise, appelé ainsi du nom de sa ville natale. Après une jeunesse dissipée, il fut saisi un jour en entendant lire ces paroles de Jésus au jeune homme riche : « Va, vends ce que tu as et donne aux pauvres ». François se voua à la pauvreté ; vêtu de haillons, mendiant pour vivre, il se mit à prêcher la pauvreté et la pénitence. Il avait de la piété, mais sans connaissance, et en même temps un esprit bizarre, rempli d’idées étranges. Il saluait les oiseaux et toutes les bêtes de la création comme des frères et des sœurs et leur adressait des discours. Son ascendant sur les foules était très grand, et ce qui l’augmentait encore, c’étaient les stigmates des cinq plaies de Jésus mort que l’on prétendait avoir été imprimées sur son corps par un séraphin. Tels sont les mensonges et les illusions dont Satan se sert pour séduire les âmes. Un grand nombre de disciples se rassemblèrent autour de François, et ils furent constitués en ordre par le pape Honorius III, en 1223. Ils devinrent la milice la plus dévouée aux papes. Mais ils ne gardèrent pas longtemps l’austérité recommandée par leur fondateur.
Nous avons parlé déjà de Dominique et des dominicains, agents principaux de l’inquisition.
En l’an 1365, Wiclef fut appelé à s’occuper d’un autre sujet. Le pape Urbain V réclama du roi Édouard III le paiement annuel de 1000 marcs que le roi Jean avait autrefois consenti à payer à Innocent III, comme tribut féodal, en se reconnaissant son vassal. Le pape sommait Édouard de le reconnaître comme souverain légitime de l’Angleterre, et, en cas de refus, le citerait à comparaître devant lui à Rome. Ces prétentions orgueilleuses soulevèrent une grande indignation en Angleterre.
Wiclef s’y opposa avec énergie et fit valoir tous les arguments qui militaient contre les exigences du pape. Il les fit connaître à plusieurs des membres du parlement qui s’était assemblé pour examiner cette affaire. Le parlement refusa de se rendre aux demandes du pape, et déclara qu’aucun prince n’avait le droit d’aliéner la souveraineté du royaume sans le consentement du peuple. Le pape vit qu’il était inutile d’insister, et s’efforça de conserver au moins son autorité spirituelle sur l’Angleterre. Une conférence se réunit à Bruges dans ce but. Wiclef y fut envoyé avec d’autres commissaires. Nous ne nous arrêterons pas sur ce qui fut traité dans cette conférence ; nous dirons seulement que ce séjour à l’étranger fut d’un grand profit à Wiclef. Ses yeux s’ouvrirent davantage à toute l’iniquité du système de la papauté, et il fut confirmé dans le jugement qu’il avait déjà porté sur elle.
À son retour en Angleterre, Wiclef fut nommé recteur de l’église de Lutterworth, et il se mit à prêcher avec hardiesse ses doctrines pour la réformation de l’Église. « L’Évangile », disait-il, « est l’unique source de la religion. Le pontife romain n’est qu’un coupeur de bourses. Loin d’avoir le droit de réprimander le monde entier, il peut être légitimement repris par ses inférieurs, et même par les laïques ». En appelant le pape un coupeur de bourses, il voulait dire qu’il cherchait à s’enrichir par toutes sortes de moyens, au détriment des princes et du peuple.
Le langage et les prédications de Wiclef alarmèrent le clergé et les partisans du pape. L’évêque de Londres, Courtenay, l’accusa d’hérésie, et Wiclef dut comparaître, en 1377, devant une assemblée du clergé, dans l’église de Saint-Paul. Un immense concours de peuple remplissait la cathédrale, foule composée en grande partie de fanatiques dévoués au pape. Wiclef s’avança entre le duc de Lancaster, régent du royaume et ami du réformateur, et Lord Percy, maréchal d’Angleterre. Ils eurent beaucoup de peine à se frayer un passage à travers cette foule animée de sentiments hostiles, et qui, si Wiclef eût été seul, lui aurait fait un mauvais parti. Enfin ils arrivèrent devant le clergé présidé par Courtenay. Celui-ci ne fut pas peu surpris de voir l’accusé se présenter sous la protection des deux plus puissants seigneurs du royaume. Il y eut entre l’évêque et les deux lords un échange de paroles aigres, et le duc de Lancaster, dans un moment d’irritation, dit à quelqu’un de sa suite : « Plutôt que de me soumettre à ce prêtre, je le tirerai par les cheveux à bas de sa chaire ». Mais ce propos fut entendu par d’autres, et un grand tumulte s’ensuivit. Les partisans de l’évêque se jetèrent sur les deux lords que leurs serviteurs et leurs amis défendirent ; à grand’peine purent-ils s’échapper. Wiclef était demeuré calme : on le renvoya en lui défendant de prêcher ses doctrines.
Mais il ne pouvait se taire. Il continua à prêcher et à dénoncer le mal de la papauté. En ce moment il y avait deux papes qui prétendaient chacun être le véritable chef de l’Église. Wiclef disait que les deux formaient un seul Antichrist. Il fut de nouveau cité devant l’évêque ; mais cette fois il vint seul, sans l’appui des grands seigneurs. On s’attendait à le voir dévoré, dit un historien, car il entrait dans la fosse aux lions. Mais comme autrefois Daniel et Paul, il fut délivré de la gueule du lion (*). À peine l’évêque avait-il commencé de procéder contre Wiclef, que sir Clifford entra et, de la part de la reine mère qui aimait Wiclef, défendit de continuer. Le clergé fut confondu ; il n’avait aucun pouvoir pour résister. Wiclef se retira en déposant une protestation : « J’ai le désir et l’intention », disait-il, « par la grâce de Dieu, d’être un vrai chrétien, et, aussi longtemps que je respirerai, de professer et de défendre la loi de Christ ».
(*) Daniel 6:20-22 ; 2 Timothée 4:17.
Dès lors Wiclef ne s’occupa plus autant de la politique que devait suivre l’Angleterre à l’égard du pape. Il se livra plus entièrement à l’œuvre de l’évangélisation dont la valeur s’accrut à ses yeux. Il désirait que l’Évangile fût annoncé jusque dans les moindres hameaux. Les moines parcouraient bien le pays en prêchant les absurdes légendes des saints, pourquoi ne répandrait-on pas partout l’Évangile ? Il s’adressa à ses disciples et leur dit : « Allez et prêchez ; c’est l’œuvre la plus sublime. Mais n’imitez pas les prêtres que l’on voit après le sermon assis dans les cabarets, à la table de jeu, ou perdant leur temps à la chasse. Quant à vous, après avoir prêché, visitez les malades, les vieillards, les pauvres, les aveugles et les infirmes, et secourez-les selon votre pouvoir ».
Les évangélistes de Wiclef, les pauvres prêtres, comme on les nommait, s’en allèrent donc, le bâton à la main, pieds nus, vêtus d’une robe d’étoffe grossière, vivant d’aumônes, et prêchant l’Évangile dans les champs, au bord des routes, dans les cimetières, près des villages, partout où ils trouvaient des auditeurs. Wiclef leur avait enseigné que le salut ne vient ni des anges, ni des saints, mais qu’il est en Christ seul. « Un ange », disait-il, « n’aurait pu faire propitiation pour l’homme, car la nature qui a péché n’est pas celle des anges. Le Médiateur devait être un homme ; mais tout homme étant redevable à Dieu de tout ce qu’il est capable de faire, il fallait que le Médiateur eût un mérite infini et fût en même temps Dieu ».
Le clergé régulier s’alarma et obtint une loi qui ordonnait à tout officier du roi de jeter en prison les prédicateurs. Aussi, dès que paraissait un pauvre prêtre pour prêcher, les moines qui se tenaient cachés pour l’épier, allaient chercher main-forte afin de l’arrêter. Mais souvent, aussitôt que les sergents s’approchaient, le peuple se serrait autour du prédicateur et formait une forte barrière pour empêcher qu’il fût molesté. Ainsi, par le moyen de ces prédicateurs dévoués, l’Évangile se répandait de plus en plus et atteignait jusqu’aux endroits les plus reculés du pays. Le jour à venir révélera seul les fruits de ces semailles de la parole de Dieu.
Outre son œuvre d’évangélisation, Wiclef s’acquittait à Oxford de ses fonctions de professeur. Mais il n’était pas d’une forte constitution ; ses travaux et les luttes qu’il avait soutenues l’avaient affaibli, et, en 1379, il tomba dangereusement malade. On ne s’attendait pas à ce qu’il se relevât, et le parti du pape jubilait. Mais pour que son triomphe fût complet, il fallait obtenir de Wiclef la rétractation de ce qu’il avait enseigné. Quatre représentants des quatre ordres religieux accompagnés de quatre aldermen (*), se rendirent auprès du mourant. « Vous avez la mort sur les lèvres », lui dirent-ils, « repentez-vous de vos fautes, et rétractez en notre présence tout ce que vous avez dit contre nous, à notre préjudice ». Wiclef resta calme et serein, et se tut pendant un moment. Les religieux étaient pleins d’espoir et attendaient sa rétractation.
(*) Charge qui répond à celle de conseillers municipaux.
Il demanda à son serviteur de le soulever sur son lit. Alors, rassemblant ses forces et fixant sur ses ennemis un regard perçant, il dit : « Je ne mourrai pas, mais je vivrai, et je déclarerai encore les turpitudes des moines ». Désappointés et confus, ses adversaires se retirèrent. Wiclef se rétablit, et vécut pour accomplir une œuvre plus grande que tout ce qu’il avait fait jusqu’alors.
L’œuvre que Wiclef avait à cœur d’accomplir, c’était de donner aux Anglais la Bible dans leur propre langue. Il y avait bien eu, avant lui, quelques traductions, en langue vulgaire, de diverses portions des Écritures, mais ces volumes restaient cachés dans les bibliothèques des couvents. Il s’ensuivait que, sauf le clergé et peut-être quelques personnes qui pouvaient lire le latin, personne ne possédait une Bible et ne savait de son contenu que ce que les prêtres en disaient. Et cependant depuis des siècles l’Angleterre professait le christianisme. Il est vrai, comme nous l’avons vu, que défense était faite au peuple d’avoir et de lire les saints écrits en langue vulgaire. Mais le temps était venu où, malgré cette défense, la Bible allait être répandue parmi tous, savants et ignorants.
Wiclef ignorait le grec et l’hébreu ; il fut donc obligé de faire sa traduction sur la version latine appelée la Vulgate, mais cela valait mieux que de n’avoir pas la Bible du tout. Il travailla laborieusement à cette œuvre durant dix années, aidé par quelques amis, et un an après la maladie dont nous avons parlé, en 1380, l’ouvrage fut terminé et publié sans notes, ni commentaires.
Quand nous disons publié, il faut comprendre que l’on en fit des copies pour les vendre. L’imprimerie n’avait pas encore été inventée, et l’on n’avait d’autre moyen d’avoir des exemplaires d’un ouvrage que le long et coûteux procédé de les écrire à la main. Les copistes se mirent diligemment à l’œuvre, et bientôt des portions du saint volume furent mises en vente. Elles furent rapidement écoulées, ainsi que des copies du volume entier. L’accueil que reçut l’œuvre de Wiclef dépassa son attente. C’était avec joie que nombre de personnes achetaient la parole de Dieu. Elles n’avaient jamais connu cette source de toute vérité, et maintenant elles pouvaient lire dans leur langue maternelle les merveilles de la révélation de Dieu donnée à l’homme. Une grande lumière, la lumière de Dieu, s’était levée dans les ténèbres de superstitions et d’erreurs qui couvraient le monde, et depuis lors, malgré les efforts de Satan et de ses agents pour l’éteindre, elle n’a pas cessé de briller dans ces contrées.
L’ennemi se montra bientôt. Dès que Wiclef eut publié sa traduction de la Bible, il fut assailli de tous côtés par les amis du pape. « C’est une hérésie », disaient les uns, « de faire parler la Sainte Écriture en anglais ». D’autres disaient : « Maître Wiclef, en traduisant l’Évangile en anglais, l’a rendu plus accessible et plus compréhensible aux laïques et même aux femmes qu’il ne l’avait été jusqu’ici aux clercs intelligents et lettrés » ; à quoi d’autres ajoutaient, en affectant de craindre que l’Évangile ne fût ainsi rendu méprisable : « La perle évangélique est foulée aux pieds par les pourceaux ». Quelques-uns se plaçaient sur un autre terrain et prétendaient mettre l’Église au-dessus des Écritures. « Puisque l’Église », disaient-ils, « a approuvé quatre évangiles, elle aurait pu tout aussi bien les rejeter et en admettre d’autres. L’Église sanctionne ou condamne ce qu’elle veut. Croyez l’Église plus que l’Évangile ». C’était là le grand point. L’Église de Rome voulait être l’autorité suprême. Mais ce n’est pas elle qui a donné les Écritures. C’est Dieu lui-même, et ce sont elles que nous devons croire.
Wiclef ne se laissait point émouvoir par les clameurs des prêtres et des moines. « Quand même le pape et tous les clercs disparaîtraient de la face de la terre », disait-il, « notre foi ne défaudrait pas, car elle est fondée sur Jésus seul, notre Maître et notre Dieu ». D’ailleurs il n’était pas sans encouragements. Une copie des évangiles avait pénétré jusque dans le palais, et Anne de Luxembourg, femme du roi Richard II, s’était mise à les lire diligemment. Elle les communiqua à Arondel, archevêque d’York, qui, frappé de voir une étrangère, une reine, lire des « livres aussi vertueux », il voulait dire excellents, se mit à les étudier, et blâma les prélats qui en négligeaient la lecture. À la Chambre des lords, une motion fut faite par les partisans des prêtres de saisir tous les exemplaires des Écritures et de les détruire. Mais le duc de Lancaster s’écria : « Sommes-nous donc la lie du genre humain que nous ne puissions pas posséder la loi de notre religion dans notre propre langue ? »
Cependant l’œuvre progressait. Wiclef lui-même fut amené à étudier plus profondément la Bible qu’il avait donnée au peuple. La doctrine de la messe, ce point fondamental de l’Église de Rome, attira son attention. C’était une des sources de gain pour le clergé et la base de son autorité sur le peuple. Faire descendre à sa parole Dieu du ciel dans l’hostie consacrée, à quelle hauteur cela élevait le prêtre ! Wiclef éclairé par la parole de Dieu, ne pouvait admettre qu’un homme eût le pouvoir de transformer un morceau de pain dans la chair, le sang et la divinité de Christ. « L’hostie consacrée que nous voyons sur l’autel », disait-il, « n’est pas Christ, ni une partie de Christ, mais elle est son signe efficace ». — « Comment peux-tu, ô prêtre, qui n’es qu’un homme, créer ton Créateur ? » ajoutait Wiclef. « Quoi ! la plante qui croît dans les champs, cet épi que tu cueilles aujourd’hui, demain sera Dieu ! Ne pouvant faire les œuvres de Jésus, tu veux faire Celui qui a accompli les œuvres ! »
L’attaque de Wiclef contre la doctrine de la transsubstantiation effraya ses amis. Le duc de Lancaster qui jusqu’alors l’avait soutenu, cessa de le défendre, après l’avoir exhorté, supplié, et même lui avoir ordonné de se taire sur ce sujet. Mais Wiclef ne pouvait cacher la lumière qu’il avait reçue de Dieu. Ses ennemis trouvèrent là une bonne occasion pour chercher à le perdre.
Courtenay avait été promu à l’archevêché de Canterbury. Il se hâta de convoquer un synode dans le but de condamner Wiclef. On se réunit en mai 1382, et l’on allait procéder à la condamnation de celui qu’on tenait pour hérétique, lorsqu’un violent tremblement de terre se fit sentir à Londres et dans une partie de l’Angleterre. Les prélats effrayés crurent voir dans ce phénomène une marque de la désapprobation de Dieu, et hésitaient à prononcer la sentence. Mais l’habile archevêque sut se faire de l’événement une arme en sa faveur. « Ne savez-vous pas », dit-il, « que les vapeurs nuisibles qui prennent feu dans le sein de la terre et produisent ces phénomènes qui vous effrayent, perdent leur force lorsqu’elles s’échappent ? De la même manière, en rejetant l’hérétique de notre communion, nous mettrons fin aux convulsions de l’Église ». Rassurés, les évêques prononcèrent la condamnation de Wiclef, après avoir entendu la lecture de dix propositions qu’on disait être de lui et qui furent déclarées hérétiques.
L’archevêque pressa le roi d’approuver la décision du synode. « Si nous permettons à cet hérétique de faire continuellement appel aux passions du peuple » (*), dit-il au roi, « notre destruction est inévitable. Il faut réduire au silence ces Lollards (**), ces chanteurs de psaumes ». Le roi donna des ordres pour que l’on jetât dans les prisons de l’état ceux qui soutiendraient les propositions condamnées. Un à un, ses amis les plus dévoués abandonnaient Wiclef mais il ne perdit pas courage. Il se consola en disant : « La doctrine de l’Évangile ne périra jamais ». Wiclef aurait dû en rester là, et continuer paisiblement son œuvre, mais il crut devoir en appeler à la Chambre des communes et présenta une pétition où il disait entre autres : « Puisque Jésus Christ a répandu son sang pour affranchir l’Église, je demande son affranchissement. Je demande que chacun puisse sortir de ces sombres murailles, où règne une loi tyrannique, et embrasser une vie simple et paisible sous la voûte du ciel. Je demande que les pauvres habitants de nos villes et de nos campagnes ne soient pas contraints de fournir à un prêtre mondain, souvent vicieux et hérétique, de quoi satisfaire son ostentation, sa gourmandise et son impudicité ; de quoi acheter un beau cheval, des selles magnifiques, des brides avec des clochettes retentissantes, de riches vêtements, des fourrures précieuses, tandis que le pauvre peuple voit ses veuves, ses femmes et ses enfants mourir de faim ». Nous voyons par ces lignes quels abus criants étaient tolérés et quel joug pesait alors sur le peuple. La Chambre des Communes vit que son autorité avait été méconnue, puisque les ordres du roi n’avaient pas reçu son assentiment, et elle ordonna le rappel.
(*) Il y avait eu à cette époque un soulèvement des paysans, et on l’attribuait à tort aux prédications de Wiclef.
(**) Probablement de lollen, chanter. On donnait ce nom à ceux qui s’opposaient à Rome, et plus spécialement aux disciples de Wiclef.
Courtenay fut déconcerté, mais, déterminé à ne pas laisser échapper Wiclef, il se rendit à Oxford, rassembla les chefs de l’église, et somma Wiclef de paraître devant lui, en ayant soin de laisser les portes ouvertes aux laïques et aux étudiants, afin que l’humiliation du vieux champion de la vérité fût complète et publique. Wiclef était affaibli par l’âge et ses nombreux travaux ; mais il avait une âme forte dans un corps chétif, et n’avait jamais craint de paraître devant un homme. Il se rendit à la sommation. Mais l’affaire se termina d’une manière à laquelle Courtenay était loin de s’attendre. Arrêtant sur l’archevêque ce regard perçant et assuré qui avait autrefois fait fuir les moines, il accusa le clergé catholique romain d’être semblable aux prêtres de Baal et lui reprocha de répandre l’erreur et de fermer les yeux au mal, afin de vendre ses messes et de remplir sa bourse. Puis en terminant, il s’écria : « La vérité vaincra », et il se retira sans qu’aucun de ses ennemis osât dire un mot ou l’arrêter. Il se retira à Lutterworth.
Wiclef n’était pas encore à l’abri des attaques de ses ennemis. Il vivait paisiblement au milieu de ses paroissiens et de ses livres, étudiant la vérité et l’annonçant autour de lui, lorsqu’il reçut du pape un bref (*) le sommant de paraître devant lui à Rome. Cette sommation lui serait sans doute arrivée plus tôt s’il n’y avait eu en ce temps-là deux papes rivaux, trop occupés à s’insulter et à se maudire l’un l’autre, pour avoir le temps de penser à un aussi chétif personnage que Wiclef. L’Écosse, la France et d’autres pays, reconnaissaient le pape Clément VII, tandis que l’Angleterre, l’Italie et d’autres États, tenaient pour le pape Urbain VI. Comme celui-ci avait en Angleterre un grand nombre de chauds partisans, ils insistaient, auprès de lui sur le danger que les doctrines de Wiclef faisaient courir à la cause de l’Église romaine, de là le bref du pape.
(*) Nom donné aux communications papales.
Wiclef crut que ses infirmités croissantes suffisaient pour le justifier de ne pas se rendre à l’appel du pape, mais il résolut de lui écrire et de lui faire connaître quel est le véritable Chef de l’Église. Dans sa lettre, en premier lieu, il exalte l’Évangile, puis il déclare que le pape lui-même est tenu d’y obéir : « Je crois », dit-il, « que l’Évangile de Christ est le corps complet de la révélation de Dieu. Je crois que Christ qui nous l’a donné est Lui-même vrai Dieu et vrai homme, et qu’ainsi cette révélation est au dessus de tout. Je crois que l’évêque de Rome est obligé plus que tout autre à s’y soumettre, car la grandeur parmi les disciples de Christ ne consiste pas en dignités et en honneurs mondains, mais à suivre de près et fidèlement le Christ dans sa vie et dans ses actes. De là je conclus que nul homme fidèle ne doit suivre le pape ni aucun des hommes saints, si ce n’est quand ils suivent Jésus Christ. Il faut qu’à l’exemple de Christ, le pape remette à l’État ses pouvoirs temporels, et engage son clergé à faire de même ».
Urbain VI était trop occupé de sa lutte avec Clément pour se mettre davantage en peine de Wiclef, de sorte que celui-ci put continuer ses travaux sans être molesté. C’est alors qu’il écrivit son « trialogue ». Ce sont des entretiens entre trois personnages symboliques, la vérité, le mensonge et l’intelligence. Le premier propose des questions, le second fait des objections et le troisième établit la saine doctrine. Une des grandes vérités que Wiclef affirme est l’autorité suprême des Écritures. « L’Église est tombée », dit l’un des interlocuteurs, « parce qu’elle a abandonné l’Évangile et lui a préféré les lois du pape. Quand il y aurait cent papes à la fois dans le monde, et que tous les moines de la terre fussent transformés en autant de cardinaux, il ne faudrait leur accorder aucune confiance en matière de foi, s’ils ne s’appuient pas sur les saintes Écritures ».
Voici encore quelques-unes des conclusions de Wiclef : « L’autorité des saintes Écritures, qui sont la loi du Christ, surpasse infiniment celle de toute autre écriture ».
« L’Écriture est la règle de la vérité, et doit être la règle de la réforme. Il faut rejeter toute doctrine et tout précepte qui ne reposent pas sur cette base ».
« Croire que l’homme peut quelque chose dans l’œuvre de la régénération est la grande hérésie de Rome, et de cette erreur est venue la ruine de l’Église ».
« La conversion procède de la grâce de Dieu seule ; le système qui l’attribue en partie à l’homme et en partie à Dieu est pire que celui de Pélage ».
« Christ est tout dans le christianisme ; quiconque abandonne cette source toujours prête à communiquer la vie, et se tourne vers les eaux troubles et croupissantes, est un insensé ».
« La foi est un don de Dieu ; elle exclut tout mérite, et doit bannir de l’âme toute crainte ».
« La seule chose nécessaire dans la vie chrétienne et dans la cène, n’est pas un vain formalisme et des rites superstitieux, mais la communion avec Christ selon la puissance de la vie spirituelle ».
« Le peuple chrétien doit se soumettre non à la parole d’un prêtre, mais à la parole de Dieu ».
« La vraie Église est l’Assemblée des justes, pour lesquels Christ a répandu son sang ».
« Tant que Christ est dans le ciel, l’Église a en Lui le meilleur pape. Il est possible qu’un pape soit condamné au dernier jour pour ses péchés ».
Telles sont les vérités que Wiclef, enseigné par le Saint Esprit, tira des Écritures. Il n’eut pas d’autre maître. Il passa tranquillement ses derniers jours. Menacé comme il l’était de toutes parts, il pouvait bien s’attendre à mourir comme martyr. « Annoncez », disait-il, « la parole de Christ à d’orgueilleux prélats, et le martyre ne vous manquera pas. Quoi ! vivre et me taire ? Jamais ! Que le coup tombe, je l’attends ». Mais Dieu lui donna de mourir en paix. Le 29 décembre 1384, il était dans la chapelle de Lutterworth debout devant l’autel, au milieu de ses paroissiens. Au moment où il élevait le pain de la cène, il tomba frappé de paralysie. Transporté dans sa demeure, il vécut encore quarante-huit heures et rendit l’esprit le dernier jour de l’année.
Ainsi passa celui à qui Dieu avait permis d’accomplir une grande œuvre en Angleterre, celle de donner la Bible au peuple, d’envoyer prêcher l’Évangile et de dénoncer les erreurs de Rome. Depuis ce moment la lumière divine ne s’éteignit plus dans ce pays, et elle se répandit dans d’autres contrées. Ceux qui suivirent sa doctrine furent nommés Wiclefites, ou plus communément Lollards. Rome les poursuivait de sa haine, et plusieurs subirent le martyre. Etre un disciple de Wiclef, adhérer à ses enseignements, suffisait pour être déclaré hérétique et poursuivi comme tel par l’Église de Rome. Celle-ci manifesta combien elle avait senti l’attaque dirigée contre elle par l’œuvre de Wiclef. N’ayant pu atteindre le réformateur durant sa vie, elle se vengea sur lui après sa mort. Le concile de Constance tenu en 1415, ordonna que ses restes fussent brûlés. La sentence fut exécutée en 1428, et les cendres furent jetées dans un ruisseau voisin. Mais la vérité que Wiclef avait mise en lumière ne pouvait être brûlée. Elle était semée dans les cœurs et portait du fruit pour la vie éternelle.
Peu avant sa fin, Wiclef prononça ces paroles remarquables : « Quelques frères (des moines) que Dieu daignera enseigner, ayant abandonné leur infidélité, reviendront librement à la primitive religion du Christ, et alors édifieront l’Église comme Paul ». Ne semble-t-il pas avoir annoncé d’avance le réformateur Luther ?
 Re: L’ÉGLISE : UNE ESQUISSE DE SON HISTOIRE PENDANT VINGT SIÈCLES
Re: L’ÉGLISE : UNE ESQUISSE DE SON HISTOIRE PENDANT VINGT SIÈCLES
7.4.2 - Les Lollards
La mort de Wiclef n’arrêta pas le zèle de ses disciples. La puissance de la doctrine qu’il avait enseignée se montra dans le nombre de ceux qui la reçurent. L’Angleterre, à un certain moment, sembla tout entière gagnée aux vues du réformateur. On trouvait partout des « Lollards », comme on les appelait ; dans les chaumières des paysans, comme dans les châteaux des nobles. Ils se sentaient tellement appuyés par le sentiment presque général de la nation qu’en l’année 1395, ils adressèrent une requête au parlement demandant qu’on abolît le célibat des prêtres, la transsubstantiation, les prières pour les morts, les offrandes faites aux images, la confession et plusieurs abus de l’Église romaine. Ils affichèrent leurs conclusions aux portes de Saint-Paul et de Westminster.
Le clergé romain s’émut de cette hardiesse. Arondel, archevêque d’York, et Braybrocke, évêque de Londres, demandèrent au roi Richard II d’intervenir. Celui-ci défendit au Parlement de discuter la requête des Wiclefites, et menaça de mort les principaux d’entre eux, s’ils persistaient à soutenir ces détestables doctrines. Peu de temps après, Richard fut détrôné par son cousin le duc de Lancaster et mourut en prison. Le duc de Lancaster monta sur le trône sous le nom de Henri IV. C’est lui dont le père avait été l’ami et le protecteur de Wiclef, et les Lollards espérèrent que le nouveau roi leur serait favorable. Ils furent cruellement déçus. Arondel, qui avait aidé Henri IV à s’emparer du trône, lui avait dit en le couronnant : « Pour consolider votre trône, gagnez le clergé et abandonnez les Lollards ». Le roi répondit : « Je serai le protecteur de l’Église ». Il le fit bientôt voir.
Jusqu’au commencement du quinzième siècle, il n’y avait eu en Angleterre aucune loi qui condamnât les hérétiques à être brûlés. Partout ailleurs le pouvoir civil avait abandonné sur ce point son droit au pouvoir spirituel, c’est-à-dire au clergé. Afin de prouver à l’archevêque sa sincérité, le roi rendit un édit ordonnant que tout hérétique impénitent serait brûlé vif pour épouvanter les autres. En même temps, les prêtres firent courir et répandirent partout des bruits de complots et de desseins dangereux formés par les Lollards. Le Parlement confirma l’édit en l’an 1400. Brûler les hérétiques devint ainsi chose légale en Angleterre. L’édit portait que la sentence serait exécutée « publiquement, en un lieu élevé, aux yeux du peuple ». Dès que le primat (*) et les évêques eurent ainsi liberté d’agir, ils se mirent activement à poursuivre leur œuvre de ténèbres.
(*) L’archevêque d’York était le premier et au-dessus de tous les prélats du royaume. De là son titre de primat.
Leur première victime fut un ministre pieux de Londres. Il enseignait ouvertement les doctrines prêchées par Wiclef, et avait osé dire : « Au lieu d’adorer la croix sur laquelle Christ a souffert, j’adore Christ qui a souffert sur elle ». Il avait comparu à Newbury. Là, par crainte des souffrances qu’il aurait à endurer, il s’était d’abord rétracté. Mis en liberté, il était retourné à Londres. Peu après il reprit courage, une nouvelle force lui fut donnée, et il se remit à annoncer ouvertement l’Évangile, et à protester contre les erreurs de Rome. Il fut de nouveau saisi, jeté en prison, et condamné au bûcher comme hérétique relaps. On le traîna à Saint-Paul ; là il fut dégradé de la prêtrise, puis l’archevêque le remit à la bonté du grand maréchal du royaume, car il est défendu à l’Église de verser le sang. La bonté du grand maréchal ne lui manqua pas ; il fut brûlé, et glorifia Christ dans sa mort. Quelle hypocrisie des chefs religieux ! Croyaient-ils vraiment disculper l’Église de verser le sang tout en le faisant répandre par la main de ceux qu’elle s’assujettissait ?
Le second martyr était un simple artisan, nomme John Badby. Il était accusé d’avoir nié la transsubstantiation. Il fut conduit à Londres pour y être jugé. Outre les deux archevêques d’York et de Canterbury, il y avait comme juges plusieurs évêques et le duc d’York, chancelier du royaume. Arondel se donna beaucoup de peine pour convaincre Badby que le pain consacré devenait véritablement le corps de Christ. Les réponses de l’accusé furent claires et simples, et montrèrent un grand courage et une fermeté inébranlable. « Si réellement », dit-il « chaque hostie, après que le prêtre l’a consacrée, est le corps du Seigneur, il y a donc plus de 20000 dieux en Angleterre. Je crois en un seul Dieu tout puissant ».
Badby ne voulant pas se rétracter, fut condamné à être brûlé. Au moment où le bourreau mettait le feu au bûcher, le prince de Galles, héritier de la couronne, vint à passer. Peut-être n’était-ce pas sans l’intention de voir ce spectacle extraordinaire. Quoi qu’il en soit, il fut frappé de voir le martyr paisible et tout à fait impassible, attaché au poteau, tandis que le bourreau attisait le feu. Les flammes s’approchaient du prétendu hérétique, déjà elles avaient atteint ses pieds, et l’on entendit le mot « grâce » sortir de ses lèvres. Le prince, supposant qu’il implorait la grâce de la part de son juge, ordonna d’écarter le feu. « Veux-tu abandonner ton hérésie », demanda-t-il, « et te soumettre à la foi de la sainte mère Église ? Si tu le fais, tu auras une pension annuelle sur la cassette royale ». Mais Badby resta inébranlable. Il n’avait pas fait appel à la grâce des hommes, mais s’était recommandé à la grâce de Dieu. Irrité par la constance de ce chrétien, le prince commanda qu’il fût rejeté dans les flammes, et le courageux martyr y trouva bientôt la fin de ses souffrances.
Encouragé par l’appui que le roi lui prêtait, le clergé rédigea une suite d’articles que l’on nomme la constitution d’Arondel. Ils défendaient, sous les peines les plus sévères, la lecture de la Bible et des livres de Wiclef, et appelaient le pape non un simple homme, mais un vrai Dieu sur la terre. La persécution sévit alors dans toute l’Angleterre. Il y avait dans le palais archiépiscopal une prison que l’on nommait la tour des Lollards. Elle fut bientôt remplie de prétendus hérétiques. Un grand nombre de ces martyrs souffrirent la torture destinée à leur faire abjurer leur foi, avant d’être livrés à une mort cruelle. Plusieurs gravèrent sur les murailles de leur prison l’expression de leurs douleurs et de l’espérance qui les soutenait. On y lit encore ces mots tracés par l’un d’eux : « Jésus, amor meus » (Jésus, mon amour) ; témoignage touchant de la foi qui l’animait, rendu à l’objet suprême de ses affections.
Le roi Henri V avait succédé à son père. C’est lui qui avait été témoin du supplice de Badby, mais la constance jusqu’à la mort du martyr n’avait eu aucun effet sur son cœur. La persécution continua à sévir contre les Lollards. Ce ne fut pas seulement contre les petits, mais des personnes d’un rang élevé furent aussi frappées. Parmi elles, l’une des plus illustres fut sir John Oldcastle qui, par son mariage avec Lady Cobham, était devenu Lord Cobham. Il avait été un vaillant guerrier, s’était distingué dans maints combats, et avait été un favori du roi Henri IV. Il avait aussi suivi le prince de Galles dans sa vie de dissipation et de péché. Mais la grâce de Dieu l’avait saisi, nous ignorons à quelle époque de sa vie. Nous savons seulement qu’il devint l’ami et le disciple de Wiclef, et fut zélé pour répandre les doctrines que celui-ci enseignait. Après la mort de Wiclef, il resta dévoué aux Lollards. De même qu’il avait servi son roi par son courage dans les combats, de même il se montra plein de hardiesse pour le service de Christ et de ses disciples. En tant que lord, il avait un siège au Parlement. Là il ne cacha point sa foi et son opposition à Rome ; il alla même jusqu’à dire : « Il serait bon pour l’Angleterre que la juridiction du pape s’arrêtât à Calais, et ne passât pas la mer ». Paroles bien hardies à prononcer dans un tel lieu et dans un tel temps.
Cobham faisait faire de nombreuses copies des écrits de Wiclef, et les remettait aux « pauvres prêtres » qu’il recevait dans son château, afin qu’ils les répandissent partout où ils iraient prêcher l’Évangile. Lui-même assistait à leurs prédications, revêtu de son armure, la main sur son épée, et prêt à les défendre contre quiconque viendrait les troubler. Tant que le roi Henri IV vécut, il ne permit pas aux prélats de s’attaquer à son ancien favori. Il en fut autrement après sa mort.
Henri V, qui, avant d’être roi, avait mené une folle vie de dissipation et de péché, devint, en montant sur le trône, zélé pour l’Église. Arondel et les évêques auraient bien voulu emprisonner ou brûler tous les prédicateurs, mais ils pensèrent qu’ils arriveraient plus aisément à leurs fins en faisant taire ou jeter en prison, sinon mettre à mort, leur protecteur, lord Cobham. Ils virent le moment propice. Ils accusèrent Cobham de tenir et de répandre plusieurs hérésies, et demandèrent au roi de le faire comparaître devant lui. Le roi leur répondit qu’il essayerait de persuader Cobham de renoncer à ses nouvelles opinions. Il le fit donc venir et l’exhorta à se soumettre à la sainte Mère l’Église. Cobham répondit : « Je suis toujours prêt, très excellent prince, à vous obéir, d’autant plus que je vous reconnais pour un roi chrétien et un ministre de Dieu. Après Dieu, je vous dois une entière obéissance et je m’y soumets. Mais pour ce qui est du pape et de son clergé, je ne leur dois en vérité ni hommage, ni service, parce que je sais par les Écritures que le pape est le grand Antichrist, l’adversaire déclaré de Dieu, et l’abomination placée dans le lieu saint » (*).
(*) En réalité, si l’esprit de l’Antichrist est bien là à l’œuvre, depuis le temps des apôtres, l’Antichrist est un personnage encore futur.
Ce discours hardi déplut au roi ; il ne voulut plus intervenir en faveur de son ancien ami, et les évêques purent agir à leur guise. Arondel somma Cobham de comparaître devant lui le 2 septembre, afin de répondre aux accusations d’hérésie portées contre lui. Agissant d’après sa déclaration qu’il ne devait ni hommage, ni service, au pape et à ses subordonnés, il ne tint aucun compte de la citation de l’orgueilleux prélat. Arondel la fit afficher aux portes du château de Cowling qu’habitait Cobham, et à celles de la cathédrale de Rochester. Les amis et les vassaux de Cobham les déchirèrent aussitôt. Arondel avait une autre arme ; il excommunia le courageux gentilhomme. Ceux qui savaient ce que comportait la grande excommunication pouvaient bien être effrayés de l’acte audacieux du fier champion de Rome.
Sans se laisser abattre, ni décourager, lord Cobham écrivit une confession de sa foi sur le modèle de ce que l’on nomme le symbole des apôtres, mais exprimée essentiellement en paroles de l’Écriture sainte. Il la porta au roi, le suppliant de l’examiner. Henri ne voulut pas même la regarder. « Je ne recevrai pas cet écrit », dit-il, « remettez-le à vos juges ». Ces juges, c’étaient l’archevêque et ceux qui l’assistaient. Le roi, poussé par eux, envoya un de ses officiers pour se saisir du vieux guerrier. Si c’eût été un envoyé du clergé la question se serait décidée par les armes, selon la coutume de ces temps ; mais la sommation venait du roi, à qui Cobham se sentait tenu d’obéir. Il suivit l’officier et fut incarcéré à la Tour de Londres. Le 23 septembre, il fut amené dans l’église de Saint-Paul devant l’archevêque et les évêques de Londres et de Winchester, et d’autres ecclésiastiques. L’archevêque lui offrit l’absolution, s’il voulait se soumettre et confesser ses erreurs. Cobham répliqua en lisant un exposé de sa foi dont il présenta une copie à Arondel. Mais celui-ci avec irritation s’écria : « Il faut croire ce que la sainte Église de Rome enseigne, sans exiger l’autorité de Christ ». — « Croyez, croyez ! » lui criaient les prêtres ». — « Je suis prêt », dit Cobham, « à croire tout ce que Dieu veut que je croie ; mais je ne croirai jamais que le pape ait le droit d’enseigner ce qui est en opposition avec les Saintes Écritures ».
Il fut reconduit à la Tour, et la cour s’ajourna au lundi suivant. Cette fois, elle se réunit dans le couvent des Dominicains. Une foule de prêtres, de moines, de chanoines, d’ecclésiastiques, de vendeurs d’indulgences, s’y trouvait rassemblée et accueillit le prisonnier par un torrent d’injures. On lui offrit de nouveau l’absolution, à condition qu’il s’humiliât et confessât ses hérésies. « Non, vraiment », répondit-il ; « car je ne vous ai jamais offensés ». Puis accusant avec véhémence le pape et les princes de l’Église, il s’écria : « Votre domination est le poison de l’Église ! » — « Qu’entendez-vous par ce poison ? » demanda Arondel. — « Vos possessions et vos honneurs… Considérez ceci, vous tous qui êtes présents ici. Christ était doux et miséricordieux ; le pape est un tyran et un orgueilleux. Rome est le nid de l’Antichrist, et de ce nid sortent ses enfants ».
Alors eut lieu une scène étrange et des plus touchantes. Cobham ayant recouvré son calme, se jeta à genoux sur les dalles, et levant ses mains vers le ciel, il dit : « Je me confesse à Toi, ô mon Dieu, Dieu vivant et éternel ! Je reconnais que, dans ma fragile jeunesse, je t’ai très gravement offensé par l’orgueil, la colère, l’intempérance et l’impureté. Dans ma colère, j’ai blessé plusieurs hommes, et j’ai commis beaucoup d’horribles péchés. C’est pourquoi, ô Seigneur ! j’implore ta miséricorde ». Puis se relevant, le visage baigné de larmes, il se tourna vers les assistants et dit : « Ainsi, bonnes gens, pour avoir violé la loi de Dieu, ces hommes ne m’ont jamais maudit ; mais maintenant à cause de leurs propres lois et de leurs traditions, ils me traitent, et d’autres avec moi, de la manière la plus cruelle ».
Lorsque la cour se fut remise de l’émotion causée par cette scène, elle examina le noble témoin de Christ touchant sa foi et sur les quatre points qui formaient le fond de l’accusation portée contre lui. Le premier concernait la présence réelle de Christ dans l’eucharistie. Cobham s’en tint aux Écritures, tandis que ses adversaires en appelaient aux décisions de l’Église.
« Que pensez-vous de la sainte Église ? » lui demanda Arondel.
« La sainte Église », répliqua Cobham, « est l’ensemble de tous ceux qui seront sauvés et dont Christ est le Chef ».
« Que dites-vous du pape ? » demanda un des docteurs.
« Lui et vous tous ensemble », répondit Cobham, « vous composez le grand Antichrist. Le pape est la tête ; vous, les évêques, les prêtres et les prélats et les moines, vous formez le corps, et les moines mendiants sont la queue, car ils cachent par leurs sophismes la méchanceté de tous ».
L’évêque de Londres dit : « Vous savez bien que Christ est mort sur une croix matérielle ».
« Oui », dit Cobham, « et je sais aussi que notre salut n’est pas venu par cette croix matérielle, mais par Celui-là seul qui est mort sur cette croix. Et je sais que le bienheureux saint Paul ne se glorifiait en aucune autre croix que dans les souffrances et la mort de Christ ».
L’habile primat espérait encore arriver à convaincre par ses sophismes et ceux des prêtres le vieux chevalier ; mais tous ses efforts furent vains. « Je ne puis croire autrement que ce que j’ai dit ; faites de moi ce que vous voudrez », dit Cobham.
Comme la nuit approchait, l’archevêque se leva et dit que l’accusé devait se soumettre à l’Église, ou que la loi aurait son cours. Le visage tout en larmes, Cobham dit encore : « Je ne puis autrement. Je ne désire pas votre absolution. C’est du pardon de Dieu que j’ai besoin ».
Alors tous se levèrent et se découvrirent, et le primat lut à haute voix la sentence de mort. Lorsqu’il eut terminé, le courageux chevalier dit : « C’est bien ; vous pouvez tuer mon corps, mais vous n’avez aucun pouvoir sur mon âme. J’en appelle à la grâce de mon Dieu éternel ». Il s’agenouilla encore une fois et pria pour ses ennemis. Il fut condamné à être brûlé comme hérétique, et ramené à la Tour. Cinquante jours de délai furent accordés avant l’exécution du jugement. Dans l’intervalle ses ennemis ne restèrent pas inactifs. Les lois iniques de l’Église et de l’État avaient mis leurs victimes entre leurs mains, que pouvaient-ils désirer de plus ? Ils tenaient à leur faire abjurer leurs soi-disant erreurs. Mais comme Cobham ne le voulait ni ne le pouvait, ils le firent pour lui, et par une fausseté aussi méchante qu’abominable, ils prétendirent qu’il avait rétracté ses hérésies et rendu hommage à Jean XXIII, l’un des trois papes rivaux, et un homme exécrable s’il en fût. Mais peu de personnes crurent à leur mensonge.
Cependant, avec l’aide de quelques amis et la connivence du gouverneur de la Tour, Cobham réussit à s’échapper et se réfugia dans le pays de Galles. Les Lollards n’avaient nullement été découragés par la captivité de Cobham. Ils avaient continué à répandre leurs doctrines avec le plus grand zèle. Mais les prêtres exaspérés, voulant arrêter leurs progrès et mettre un terme à « la contagion de leur enseignement », comme ils disaient, firent courir le bruit de complots et d’un soulèvement général des Lollards. « Lord Cobham », disaient-ils, « est leur chef, et leur but est de détrôner le roi, de tuer la famille royale, de renverser le gouvernement de détruire toutes les cathédrales et de confisquer les biens de l’Église ».
Le roi s’émut à la pensée du danger prétendu qu’il courait, et rendit des lois encore plus sévères contre les malheureux confesseurs de Christ. Une grande réunion de prédication devait avoir lieu hors des portes de Londres. On la signala au roi comme un commencement d’exécution du complot. Il sortit en personne à la tête d’une armée contre cette foule désarmée d’hommes, de femmes et d’enfants, qui n’offrirent aucune résistance. Plusieurs furent taillés en pièces, d’autres furent faits prisonniers ; parmi eux sir Roger Ashton, un des fidèles compagnons de Wiclef, et vingt-huit autres qui furent exécutés comme traîtres. Quant à Cobham, on offrit mille marcs de récompense à qui le livrerait, vivant ou mort. Mais il était si grandement estimé que personne, durant les quatre années qu’il erra de lieu en lieu, ne mit les mains sur lui. À la fin, il fut trahi par Lord Pewis qui obtint le prix du sang du noble martyr.
On le ramena à la Tour, et il fut appelé à comparaître devant les Lords qui le condamnèrent à une mort cruelle comme coupable de trahison et d’hérésie. Il devait être brûlé à petit feu.
Le jour de l’exécution arriva. On le fit sortir de prison les mains liées derrière le dos. Une sainte joie brillait sur son visage. La sentence fut exécutée, accompagnée de toutes les marques possibles d’ignominie. On plaça sur une claie l’ancien favori du roi Henri IV, et on le traîna à travers les rues jusqu’à Saint-Gilles. Beaucoup de personnes de qualité se trouvaient là comme spectateurs, ainsi qu’une foule du peuple. Arrivé au lieu du supplice, Cobham s’agenouilla et pria encore pour ses persécuteurs. Puis il se tourna vers la foule et l’exhorta sérieusement à suivre les enseignements de la sainte parole de Dieu, et à se garder de ces faux docteurs dont la vie et la conduite étaient en si complète opposition avec Christ et son esprit.
Comme on lui offrait l’assistance d’un prêtre, il la refusa en disant : « C’est à Dieu seul, qui est présent maintenant comme toujours, que je veux confesser mes péchés ; c’est à Lui que je veux en demander le pardon ». Beaucoup des assistants fondaient en larmes, et prièrent avec lui et pour lui. En vain les prêtres affirmaient qu’il souffrait comme hérétique et ennemi de Dieu. Le peuple croyait Cobham plus que les prêtres.
Par un raffinement de cruauté, on l’avait suspendu par des chaînes attachées autour de son corps, au-dessus d’un feu qui brûlait lentement, afin que le supplice durât plus longtemps. « Rendez grâces à Dieu », furent les dernières paroles que l’on pût entendre sortir de la bouche du martyr dans ses souffrances indicibles. Enfin la mort y mit un terme, et l’esprit bienheureux du fidèle témoin alla près du Seigneur, en attendant le moment de la glorieuse résurrection.
« Ainsi », dit un chroniqueur, « est allé reposer le vaillant chevalier sir John Oldcastle, sous l’autel de Dieu, qui est Jésus Christ, avec la sainte compagnie de ceux qui, dans le royaume de patience, ont souffert une grande tribulation et la mort pour sa parole et son témoignage. Ils attendent auprès de Lui que leur nombre soit complet et la pleine rédemption des élus ».
Depuis ce temps les prisons de Londres regorgèrent de Wiclefites, qui furent livrés sans défense à la haine de leurs ennemis. « Qu’ils soient pendus pour offense au roi, et brûlés pour offense à Dieu », disaient les prêtres de Rome. Ceux qui échappaient à la prison et à la mort, étaient forcés de se réunir en secret. Mais Dieu se servit de cette victoire apparente de l’ennemi pour affaiblir dans les esprits d’un grand nombre la puissance et l’influence de la papauté, et pour frayer ainsi la voie à la Réformation dans le siècle suivant. La piété, la patience et la fermeté inébranlable des témoins de Jésus, faisaient une impression profonde sur les cœurs de plusieurs, tandis que la rage de persécution y semaient le mécontentement et le doute.
Henri Chicheley qui succéda à Arondel comme archevêque de Canterbury, le dépassa en zèle pour l’extermination des Lollards. Arondel semble avoir été frappé par un jugement de Dieu. Peu de temps après avoir prononcé la sentence de mort de Lord Cobham, il fut atteint d’une maladie incurable de la gorge qui le conduisit en peu de temps au tombeau.
Nous verrons plus loin comment d’autres témoins de Christ en Angleterre souffrirent pour son nom.
7.4.3 - Jean Huss
C’est en Bohême que fut suscité, après la mort de Wiclef, celui qui, avec ce dernier, fut un des principaux précurseurs de la Réformation. La Bohême est en grande partie habitée par une population de race slave. Le christianisme y fut introduit dans le 11° siècle, à l’époque des guerres de Charlemagne. C’est vers les années 820 à 826, que le moine Urolf évangélisa la partie est de la Bohême, nommée Moravie, et qui, à cette époque, était un royaume gouverné par ses propres princes, mais plus ou moins sous l’influence des princes allemands voisins. L’Église romaine y prédominait alors ; le culte se célébrait en langue latine, et la religion ne consistait guère qu’en formes et en cérémonies qui laissaient le peuple dans l’ignorance des vérités de l’Écriture. En 863, les princes moraves Rastislav, Svatopluk et Kotzel, voulant à la fois s’affranchir de la tutelle des princes allemands et du joug de Rome, envoyèrent à l’empereur grec de Constantinople des messagers pour lui dire : « Notre peuple est baptisé, mais nous n’avons pas de docteurs pour nous instruire et pour traduire les Saintes Écritures dans notre langue. Envoyez-nous quelqu’un qui nous explique les Écritures ».
Il y avait alors deux frères, nés dans le premier quart du 9° siècle, nommés Méthodius et Constantin. Ce dernier, à la fin de sa vie, prit le nom de Cyrille. Ils étaient fils d’un homme riche et considéré, peut-être d’origine slave. Il leur avait fait donner une éducation soignée, et ils avaient acquis la connaissance de plusieurs langues, entre autres de la langue slave. Constantin, le plus jeune, remarquable par sa science, se voua à l’état ecclésiastique. Méthodius fut d’abord un homme du monde. Il avait servi dans l’armée, et l’empereur lui avait confié l’administration d’une principauté slave. Mais après quelques années, Méthodius abandonna le monde, se fit moine et se retira dans un couvent où son frère vint le rejoindre. Mais ce n’était pas pour rester inactifs. Les missionnaires de ces temps-là, soit dans l’église latine, soit dans l’Église grecque, sortaient tous des couvents, et portaient le christianisme chez les nations encore païennes du nord et de l’est de l’Europe. Constantin avait commencé une mission chez les Bulgares, et vers l’an 860, les deux frères furent envoyés par l’empereur grec Michel, sur la demande du prince des Khazares, vers ce peuple qui habitait la Crimée et les bords du Don, pour l’instruire et le convertir.
C’est après cette mission que, pour répondre au désir des princes moraves, l’empereur leur envoya Méthodius et Constantin. Les deux frères furent bien accueillis par le prince et son peuple à Velegrad, maintenant Olmütz, ou Olomouc, en Moravie. Dès qu’ils furent arrivés, ils se mirent à prêcher l’Évangile dans la langue slave commune à la Bohême et à la Moravie, et à instruire la jeunesse. Le culte divin fut aussi célébré dans la langue vulgaire. Le zèle et la piété des missionnaires amenèrent, par la grâce de Dieu, beaucoup de conversions ; des églises et des écoles s’élevèrent de toutes parts. Méthodius et Constantin perfectionnèrent l’alphabet et l’écriture slaves, et complétèrent la version de la Bible dont ils avaient déjà traduit quelques portions longtemps auparavant.
Ils poursuivirent leurs travaux en Moravie et dans le reste de la Bohême, malgré l’opposition des prêtres romains. Ceux-ci, chose étrange à dire, n’admettaient pas qu’on pût louer Dieu en d’autres langues que l’hébreu, le grec et le latin. Or Méthodius et Constantin, sans se détacher de l’Église romaine qui, alors, était encore unie à l’Église orientale grecque, étaient avant tout préoccupés du désir d’amener des âmes à Christ. Ils croyaient avec raison que le peuple ne pouvait être édifié et consolé que dans sa langue maternelle, et à cause de cela, ils tenaient à se servir, dans le culte, de la liturgie en langue slave.
Leurs différends avec les prêtres romains les amenèrent à entreprendre un voyage à Rome pour exposer leurs vues au pape Adrien II. Celui-ci les reçut avec cordialité et les approuva. Il rétablit même en faveur de Méthodius, l’évêché de Pannonie dont le siège était à Blatno, maintenant Mosaburg, près du lac Balaton. De là, Méthodius évangélisa jusqu’en Croatie où la liturgie slave s’est conservée jusqu’à ce jour. Quant à Constantin, épuisé par ses travaux, il mourut à Rome en 869, dans un couvent où il s’était retiré, et où il avait pris le nom de Cyrille.
Méthodius ne jouit pas en paix de la position et des privilèges que le pape lui avait accordés. Il fut accusé par les archevêques et les prêtres allemands d’avoir porté atteinte aux droits de l’évêque de Salzburg sur la Pannonie, et subit un emprisonnement de trois années. Mais la Moravie étant tombée sous la domination de Svatopluk, il put se rendre de nouveau à Rome en 881, se justifia devant le pape, et reçut de celui-ci plein pouvoir pour continuer ses travaux. Il mourut à Olmütz en 885, après une vie consacrée d’une manière infatigable au service de Dieu.
Après sa mort, le parti allemand reprit le dessus et chassa les prêtres slaves. Le rituel latin s’introduisit de nouveau graduellement, et les deux pays, la Bohême et la Moravie, tombèrent de plus en plus sous la domination du pontife romain. En 967, le pape Jean XIII y rétablit la hiérarchie romaine et tous les abus de son église. En 1079, le pape Grégoire VII défendit l’usage de la liturgie orientale, c’est-à-dire de l’Église grecque, définitivement séparée de l’Église romaine, et la célébration du culte en langue vulgaire. Depuis ce temps, le Romanisme prévalut, et tout ce qui ressemblait à une religion vitale et scripturaire disparut à peu près. On ne peut cependant douter qu’au milieu de beaucoup de ténèbres, d’erreurs et de superstitions, Dieu n’eût dans ces pays un résidu fidèle qui recevait la vérité et retenait la foi de l’Évangile. Cela doit avoir été le cas, car en quelques endroits la langue vulgaire ne cessa pas d’être employée dans le culte public, et la Cène d’être donnée sous les deux espèces. Quelques-uns des puissants seigneurs étaient aussi favorables à l’Évangile et protégeaient leurs frères pauvres, comme aussi les Vaudois qui, exilés de leurs vallées natales, s’étaient réfugiés en Bohême, et contribuaient à y répandre la précieuse semence de la parole de Dieu.
Ce que nous venons d’exposer nous aidera à comprendre l’histoire de Huss.
Nous avons déjà fait allusion au triste état dans lequel se trouvait la chrétienté en Occident à la fin du 14° et au commencement du 15° siècle. Nous en dirons encore quelques mots avant de nous occuper de Jean Huss qui vécut à cette époque.
Au commencement du 15° siècle, l’Église catholique romaine, en dépit de l’unité dont elle se vante, avait à sa tête deux papes opposés l’un à l’autre. Benoît XIII avait sa résidence à Avignon, et Grégoire XII, à Rome. Cet état de choses durait depuis l’époque où Philippe le Bel, roi de France, après avoir humilié la papauté dans la personne de Boniface VIII, avait obligé le pape Clément V à transférer à Avignon le siège pontifical, afin que les papes demeurassent sous la puissance des rois de France. Mais un certain temps après, sous l’influence de l’empereur allemand, les Romains élirent un autre pape, celui d’Avignon refusant de retourner à Rome. Soit le pape d’Avignon, soit celui de Rome, prétendaient être les vicaires de Christ sur la terre, et s’accusaient l’un l’autre devant le monde entier d’hypocrisie, de parjures, et des desseins secrets les plus honteux. Ces princes de l’Église, Benoît XIII et Grégoire XII, bien qu’étant des vieillards d’environ soixante-dix ans, avaient une conduite telle que l’Europe entière en était scandalisée. Que faire pour guérir les plaies de l’Église et rétablir l’unité brisée ? Les deux papes promettaient bien et juraient même d’abdiquer leur dignité, si les intérêts de l’Église le réclamaient ; mais ils trouvaient bientôt un prétexte pour manquer à leur parole.
Alors les cardinaux des deux partis se réunirent à Livourne, afin de se consulter sur les moyens de mettre un terme à ce schisme affligeant. Ils arrivèrent à la conclusion que, dans les circonstances présentes, ils avaient le droit de convoquer un concile qui déciderait entre les deux prétendants au siège de Pierre et rétablirait ainsi l’unité de l’Église. La ville de Pise en Italie fut choisie pour le lieu où le concile se réunirait. Bien que ce fût une chose inusitée qu’un concile fût convoqué sans l’approbation du pape ou de l’empereur, toute l’Église approuva la mesure que les cardinaux avaient prise. Les papes furent ainsi privés de leur plus haut privilège, et appelés à répondre devant un nouveau tribunal ; mais ils avaient tellement perdu l’estime de la chrétienté, que tout le monde applaudit à la résolution des cardinaux.
Le concile s’ouvrit le 25 mars 1409 et fut un des plus remarquables que mentionne l’histoire de la chrétienté, soit par le nombre, soit par la qualité de ceux qui y assistèrent. On y comptait vingt-deux cardinaux, quatre patriarches latins, douze archevêques et quatorze représentants d’archevêques, quatre-vingts évêques et cent deux représentants, quatre-vingt-sept abbés et deux cents représentants, un grand nombre de prieurs, le grand maître des chevaliers de Rhodes et seize commandeurs du même ordre, des députations de toutes les universités, plus de trois cents docteurs en théologie, et des envoyés des rois et princes de l’Europe. Que ne devait pas accomplir une assemblée si respectable ? Les séances durèrent du mois de mars jusqu’à la fin du mois d’août. Après beaucoup de délibérations, les deux papes furent jugés à l’unanimité. Le 5 juin, la sentence fut rendue. Tous deux furent déclarés hérétiques, parjures, opiniâtres, incapables d’exercer l’autorité suprême et illimitée du pouvoir papal, et même indignes d’occuper aucune dignité. Le siège de Pierre fut déclaré vacant, et il s’agit alors de choisir un nouveau pape, chose plus difficile que de déposer les deux autres. Les vingt-quatre cardinaux chargés de faire ce choix, portèrent leurs suffrages sur Pierre de Candia, cardinal de Milan, qui fut élu sous le nom d’Alexandre V. Mais les deux papes d’Avignon et de Rome rejetèrent la décision du concile et continuèrent à exercer leurs fonctions comme papes légitimes, lançant l’un et l’autre leurs malédictions et leurs excommunications contre le concile et le nouveau pape leur rival. Il y eut donc trois papes. Le concile, loin de guérir le schisme, l’avait agrandi. Où était l’unité de l’Église romaine ? Où la succession apostolique, fondement de cette unité ? Alexandre V ne vécut qu’un an après son élection. À sa place on nomma Jean XXIII, homme, de l’aveu des écrivains les plus sérieux, sans principes, sans mœurs, et sans aucune crainte de Dieu.
Les difficultés furent plus grandes que jamais. Qu’y avait-il à faire ? pouvait-on encore se demander. La papauté semblait en danger de sombrer. Le pape lui-même était insuffisant pour rétablir la paix dans l’Église. L’empereur allemand Sigismond résolut d’intervenir, montrant ainsi pour le bien de l’Église plus d’intérêt que les papes. D’accord avec le roi de France et d’autres souverains, il engagea Jean XXIII à convoquer un concile général de toute l’Église, afin de mettre un terme aux luttes funestes qui l’agitaient.
La ville impériale de Constance fut choisie pour recevoir dans ses murs l’auguste assemblée. L’afflux de personnes de toutes conditions, attirées dans la ville pour cette occasion, était si grand, qu’on compte que le nombre de chevaux qui amenèrent les assistants était de trente mille. Outre les nombreux dignitaires de l’Église, plus de cent princes, cent huit comtes, deux cents barons et vingt sept chevaliers s’étaient rendus à l’invitation du pape. Des tournois, des fêtes, des plaisirs de toutes sortes se succédaient pour délasser les membres du concile de leurs occupations spirituelles. Cinq cents chanteurs avaient été rassemblés, prêts à charmer les heures de loisir des saints prélats et des gentilshommes, et à restaurer leurs esprits. Tous ces princes de l’Église, tous ces ecclésiastiques et ces grands de la terre étaient réunis afin de se consulter pour la guérison de la plaie mortelle de la papauté, mais à part quelques exceptions, l’histoire nous rapporte quelle fut la conduite abominable, l’impiété, la honteuse hypocrisie de ces soi-disant saints prêtres, et les faits scandaleux dont la ville de Constance fut témoin durant les trois ans et demi que dura le concile commencé le 5 novembre 1414, sans parler de l’impie mise à mort des deux témoins de Christ, Jean Huss et Jérôme de Prague.
Le but du concile de Constance était double : en premier lieu, il s’agissait de mettre un terme au schisme, et secondement, de réprimer ce que l’on nommait les hérésies de Wiclef et de Huss. On se proposait bien aussi de réformer certains abus dans l’Église, mais il semble qu’à cet égard les choses restèrent dans le même état. Quant au premier point, après avoir établi qu’un pape est assujetti au jugement d’un concile général de l’Église, le pape Jean XXIII fut déposé à cause de sa vie immorale et de son parjure vis-à-vis de l’empereur. Grégoire et Benoît subirent le même sort et s’y résignèrent. À leur place, on élut Othon di Colonna, sous le nom de Martin V. Nous avons donné ces détails pour montrer ce qu’était alors celle qui s’appelle la sainte Église catholique.
Pour ce qui regarde les soi-disant hérésies abhorrées de Wiclef et de Huss, nous verrons comment le concile agit pour les réprimer.
Remarquons seulement ici combien, au point de vue de l’Église romaine, le danger était grand. Les précieuses vérités de l’Évangile, en dépit des tortures et des bûchers de Rome, avaient jeté de profondes racines dans des milliers et des centaines de milliers de cœurs, et s’étaient répandues dans presque tous les pays de l’Europe. En l’an 1416, à ce même concile de Constance, un an avant le martyre de Cobham et trente-six ans après que Wiclef eut traduit la Bible, l’archevêque de Lodi déclarait que les hérésies de Wiclef et de Huss avaient trouvé de zélés partisans presque partout en Angleterre, en France, en Italie, en Hongrie, en Russie, en Lithuanie, en Pologne, en Allemagne, et dans toute la Bohême. Ainsi, un ennemi déclaré rendait, sans le savoir ou sans y penser, témoignage à la puissance merveilleuse de la parole de Dieu. L’homme ne peut rien contre la vérité.
Indépendamment des semences de vérité qui étaient restées cachées en Bohême, comme nous l’avons fait remarquer, une circonstance spéciale contribua à réveiller les esprits et à préparer la voie à la réception de l’Évangile. En 1382, deux ans avant la mort de Wiclef, la princesse Anne de Luxembourg, avait épousé Richard II, roi d’Angleterre. Anne était une femme pieuse qui aimait et sondait les Écritures. Son mariage établit entre les deux pays des relations étroites dans un temps où les enseignements de Wiclef se répandaient avec une rapidité extraordinaire. Des hommes savants de Bohême, entre autres Jérôme de Prague, allèrent à l’Université d’Oxford, et à leur retour dans leur pays y rapportèrent plusieurs des écrits de Wiclef que l’on traduisit en latin et en langue bohème. Ce qui valait davantage, plusieurs avaient reçu dans leur cœur les vérités enseignées par le réformateur. D’un autre côté, des étudiants anglais se rendirent aussi à l’Université de Prague et apportèrent avec eux les livres de Wiclef. La reine Anne elle-même favorisait ce mouvement religieux. Après sa mort, qui eut lieu en 1394, plusieurs des personnes qui l’avaient suivie revinrent en Bohême, et contribuèrent aussi à répandre les doctrines évangéliques. Elles pénétrèrent ainsi jusque parmi les membres de l’Université qui se mirent à lire et à examiner les livres qui les renfermaient. Du nombre de ces docteurs se trouvait Jean Huss, dont nous allons maintenant nous occuper.
Jean Huss naquit le 6 juillet 1369 (d’autres disent en 1373), dans la petite ville de Hussinetz, d’où il tira son nom, située au sud de la Bohême près des frontières de la Bavière. Ses parents étaient d’humble extraction, comme le furent ceux de Luther. Ils purent cependant l’envoyer faire ses études à l’Université de Prague. On raconte que lorsque sa mère le conduisait à l’Université (son père étant déjà mort), elle apportait au recteur un présent qu’elle perdit dans le voyage. Très affligée de cette perte, elle se mit à genoux à côté de son fils, le recommanda au Tout-Puissant et invoqua sur lui sa bénédiction. Sa prière fut exaucée, mais elle ne vécut pas assez longtemps pour voir combien richement Dieu lui répondit.
La carrière universitaire de Huss fut brillante. Il se distingua de bonne heure par une grande intelligence et en même temps par sa modestie, sa fermeté et sa conduite irréprochable. Il était d’un abord doux et affable et gagnait les cœurs de tous ceux qui s’approchaient de lui. Pendant ses années d’étude, il se montra très attaché à la papauté ; il était un fils dévoué de l’Église de Rome et avait une foi entière dans la vertu des sacrements. Ainsi à l’époque du jubilé de Prague en 1393, il donna ses dernières pièces de monnaie au confesseur de l’église de Saint-Pierre. Comme les écrits de Wiclef étaient déjà répandus en Bohême, Huss, comme nous l’avons dit, en eut connaissance ; mais il ne lut d’abord que ses œuvres philosophiques qu’il étudia soigneusement.
Huss était entré dans les ordres, et se fit distinguer bientôt par ses remarquables capacités. Il fut revêtu successivement des grades universitaires : maître es arts, professeur à l’Université et enfin doyen de la faculté de philosophie. Sa renommée étant parvenue jusqu’à la cour du roi Wenceslas, la reine Sophie de Bavière le choisit pour son chapelain.
Jusqu’alors rien n’annonçait en Huss un réformateur, bien que sans doute il vît les abus de l’Église romaine et la corruption, non seulement des nobles et du peuple, mais aussi du clergé. Mais en 1402, il fut nommé prédicateur de la chapelle de Bethléem. C’était un édifice pouvant contenir 3000 personnes, élevé en 1392 par un riche citoyen de Prague, agréé par le roi et l’archevêque, et destiné uniquement par le fondateur à la prédication en langue bohème. Il disait : « Lorsque Christ apparut à ses disciples après sa résurrection, il leur donna commission de prêcher la parole de Dieu, de manière à conserver constamment sa mémoire vivante dans le monde ». Dès le moment où Huss commença à prêcher dans la chapelle de Bethléem, et qu’il eut à sonder davantage la parole de Dieu, un grand changement semble s’être opéré en lui, graduellement toutefois. On peut dire qu’il fut alors converti à Dieu. En même temps, Dieu appliquait la vérité à l’âme de ses auditeurs.
Selon un écrivain contemporain, la condition morale des habitants de Prague à cette époque, était la plus basse possible. « Le roi », dit-il, « les nobles, les prélats, le clergé, les citoyens, s’abandonnaient sans contrainte à l’avarice, à l’orgueil, à l’ivrognerie, à la débauche et à tous les vices. Au milieu de cette corruption Huss se leva, réveillant les consciences par sa parole. C’était tantôt contre les prélats, tantôt contre les nobles, puis contre le clergé inférieur, qu’il dirigeait ses coups ». Ainsi Dieu s’était suscité un champion pour combattre le mal et l’erreur. C’est alors aussi que Huss lut les écrits théologiques de Wiclef et qu’il les étudia sérieusement, admirant la piété de l’auteur et d’accord avec lui dans les réformes que celui-ci demandait. « Je suis attiré par ses écrits », disait-il, « car il s’y efforce avec énergie à ramener tous les hommes à la loi du Christ, et spécialement le clergé, invitant ce dernier à renoncer à la pompe mondaine et à vivre comme les apôtres et selon l’exemple de Christ ».
Huss était appelé à prêcher fréquemment dans la chapelle de Bethléem. Aux nombreux jours de fête de l’Église, il le faisait souvent deux fois dans la même journée, et toujours en langue vulgaire. Il devait ainsi étudier de plus près la parole de Dieu et creuser toujours plus profondément dans la mine inépuisable des vérités qu’elle renferme ; de cette manière il en acquérait une conception de plus en plus claire et croissait rapidement dans la connaissance des choses divines, en s’imprégnant de l’esprit de la Parole infaillible. Ce qu’il recevait ainsi intérieurement par la Parole et l’Esprit de Dieu, il le répandait au-dehors dans ses prédications qui exerçaient une puissante action sur ses auditeurs. Plusieurs étaient saisis par la vérité, d’autres s’y opposaient, ainsi qu’à celui qui l’annonçait. Mais Huss trouva dans l’archevêque et dans la reine des protecteurs, de sorte qu’en dépit de l’opposition de ses ennemis, il put continuer à prêcher, proclamant les vérités de la Sainte Écriture, et en appelant constamment à elle pour justifier ce qu’il disait. Autour de lui se formait et s’accroissait toute une communauté d’âmes pieuses qui avaient soif des eaux vives de la grâce et faim du pain de vie, qui est Christ. Huss était un vrai pasteur d’âmes, surtout pour les gens des classes les plus humbles qui venaient à lui avec une conscience troublée que l’absolution du prêtre ne soulageait pas. Il n’avait pas conscience du mouvement qui commençait par son moyen, et ignorait où il serait conduit. Il était entré, sans en avoir l’idée, dans la voie de la Réformation que Dieu opéra plus tard.
Un événement vint, vers ce temps-là, jeter dans les esprits à Prague des pensées propres à ébranler la foi en l’autorité du pape. Dans cette ville arrivèrent deux gradués d’Oxford, disciples de Wiclef, nommés James et Conrad de Canterbury. Ils tinrent des disputes publiques sur la doctrine de la primauté du pape. Les choses n’étaient guère mûres pour une tentative aussi hardie, et les autorités de la ville leur enjoignirent le silence. Mais ils savaient peindre aussi bien que parler, et leurs pinceaux se montrèrent pleins d’éloquence. Avec l’assentiment de leur hôte, ils peignirent dans le vestibule de la maison, d’un côté l’entrée du Seigneur à Jérusalem, « débonnaire et monté sur le poulain d’une ânesse », et de l’autre la magnificence plus que royale d’un cortège pontifical. On y voyait le pape portant la triple couronne, couvert de vêtements resplendissants d’or et brillants de pierres précieuses, monté sur un cheval richement caparaçonné, précédé de trompettes proclamant sa venue, et suivi d’un cortège nombreux de cardinaux et d’évêques splendidement vêtus.
Ces peintures parlaient aussi haut que des discours, et le contraste qu’elles présentaient frappait chaque spectateur. Toute la ville fut émue ; une grande excitation fut produite, et les visiteurs anglais trouvèrent prudent de s’éloigner. Mais ils avaient fait naître des pensées qu’aucune autorité n’avait le pouvoir d’étouffer. On peut cependant se demander si les consciences et les cœurs étaient atteints par de semblables attaques contre l’erreur et les abus, et si la prédication pure et simple de la vérité comme elle est en Jésus, n’était pas bien préférable pour atteindre ce but et détacher les âmes d’un système antichrétien en les amenant à jouir du salut et de la paix.
Huss fut un de ceux qui vinrent voir les peintures des deux Anglais. Il s’en retourna tranquillement et se mit à étudier de plus près les écrits de Wiclef. Il fut d’abord effrayé des choses hardies qui étaient présentées contre les superstitions, les abus et les mensonges de l’Église de Rome, mais il fut enfin convaincu.
Dieu avait donné à Huss pour le soutenir au milieu des luttes que bientôt il eut à rencontrer, un ami fidèle dans la personne de Jérôme de Faulfisch, plus connu sous le nom de Jérôme de Prague. Il était, comme nous l’avons dit, un des étudiants de Bohême qui étaient allés à Oxford, et là il avait été converti aux vérités de l’Évangile exposées par Wiclef. De retour dans son pays natal, il avait répandu les écrits du réformateur anglais, et, dans des discussions publiques, il avait soutenu les doctrines de la foi selon l’Écriture. Bientôt l’université de Prague fut partagée en deux camps ; les uns tenant pour les principes de Wiclef, les autres s’y opposant. L’attention des chefs de l’université fut éveillée, et en mai 1403, une réunion eut lieu pour examiner quarante-cinq propositions tirées, disait-on, des écrits de Wiclef. L’université était partagée en nations Bohême, Bavière, Saxe et Pologne chacune ayant une voix quand on votait sur quelque sujet. La Bavière, la Saxe et la moitié de la Pologne étant de langue allemande, pouvaient toujours avoir la majorité sur les Bohémiens. Dans le cas présent, le parti allemand l’emporta pour condamner les propositions de Wiclef, auxquelles plusieurs de ceux de Bohême étaient favorables. Il fut défendu sous peine du feu de les répandre et de les professer. Huss se contenta de nier que ces propositions se trouvassent dans Wiclef. Jusqu’alors Huss avait surtout attaqué dans ses prédications les désordres dans les mœurs de la cour, du peuple et du clergé, et insisté sur une réforme nécessaire à cet égard, en prêchant en même temps toujours plus clairement le salut gratuit par Jésus Christ.
Ce qui contribua surtout à ouvrir les yeux de Huss sur les impostures de Rome, fut le soi-disant miracle de Wilsnack. Dans cet endroit, situé en Prusse, dans la province de Brandebourg, se trouvaient les restes d’un ancien autel faisant partie d’une église détruite autrefois, sans doute dans quelque guerre. Vers l’an 1403, dans cet autel on découvrit trois des hosties qui servent à célébrer l’eucharistie dans l’Église romaine. Quand on les trouva elles étaient d’une couleur rougeâtre. Or nous savons que les catholiques romains disent que quand les hosties ont été consacrées par le prêtre, elles sont changées dans le corps et le sang du Seigneur, et qu’ainsi le corps et le sang du Seigneur sont dans l’hostie. Quand donc on vit ces hosties rouges, on crut que le sang de Christ était devenu visible, que les hosties étaient teintes du même sang qui coulait dans les veines du Seigneur quand il était sur la terre. Le bruit de ce fait se répandit. On dit que c’était un miracle que chacun pouvait venir contempler, et les foules accoururent. Le clergé de l’endroit encouragea la croyance à ce soi-disant miracle. Il y trouvait son profit, car Wilsnack devint un « lieu saint », où de toutes parts, de la Suède, de Norvège, de Hongrie, de Pologne et de toute la Bohême, on venait en pèlerinage avec de riches offrandes. Des miracles, disait-on, s’accomplissaient près de l’autel par la vertu des saintes hosties. Un fait montrera jusqu’où allait l’imposture de certains. Un citoyen de Prague qui avait une main estropiée, s’était fait faire une main en argent et l’avait suspendue dans l’église comme offrande votive en l’honneur des hosties sanglantes, ainsi qu’on les appelait. Il était resté quelques jours dans l’endroit, très probablement inconnu des prêtres, et en réalité pour mettre à l’épreuve leur honnêteté. Mais un jour il fut surpris d’apprendre que l’un d’entre eux avait déclaré publiquement que cette main en argent avait été offerte comme mémorial de la guérison miraculeuse de la main malade du donateur. Le pauvre homme ne put supporter cette fausseté ; il étendit devant tous sa main aussi malade que jamais, au grand déshonneur du prêtre, mais par là éclairé lui-même ainsi que plusieurs autres.
Les foules ne cessaient cependant pas d’accourir et de se prosterner autour des hosties sanglantes. L’archevêque de Prague Zbynek, qui au moins était un honnête homme, avait des doutes quant aux hosties et aux miracles qui s’opéraient dans ce lieu. Il nomma, pour examiner l’affaire, trois commissaires dont l’un était Huss. Après une minutieuse investigation, ils rapportèrent que les miracles n’avaient rien de réel, et que les hosties n’étaient pas teintes de sang. Elles ne devaient leur apparence rougeâtre qu’à la moisissure provenant de l’humidité où elles avaient été exposées. L’archevêque défendit dans tout son diocèse les pèlerinages à Wilsnack.
Jusqu’alors l’archevêque et Huss avaient été en bons termes, mais cette entente ne dura pas. Bien que Zbynek eût déclaré en 1405, qu’il n’y avait point d’hérésie en Bohême, quelques membres du clergé avaient été accusés d’être favorables aux principes de Wiclef, et l’archevêque les avait sommés de répondre à l’accusation. L’un d’entre eux, Nicolas de Welenowitz, fut jeté en prison, puis, ayant été relâché, il fut banni du diocèse. Huss prit en mains sa cause et écrivit à l’archevêque une lettre où il blâmait sa conduite. « Comment ! » disait-il, « des hommes souillés de sang, coupables de toutes sortes de crimes, marchent dans les rues avec impunité, tandis que d’humbles prêtres, qui font tous leurs efforts pour combattre et détruire le péché, qui accomplissent leurs devoirs sous votre direction ecclésiastique, qui, pleins de bonté, fuyant l’avarice, s’adonnent gratuitement au service de Dieu et à la proclamation de sa Parole, sont jetés dans les cachots comme hérétiques, et doivent subir l’exil pour avoir prêché l’Évangile ! » Un langage aussi courageux ne pouvait manquer de faire de l’archevêque Zbynek un ennemi de Huss et fournissait un prétexte pour accuser celui-ci d’être un partisan de Wiclef.
La lutte entre les partis qui existaient dans l’université de Prague n’avait point cessé. Le roi Wenceslas l’aggrava en rendant un édit qui donnait trois votes aux Bohémiens et un seul aux étrangers. Les Allemands résolurent, si le roi maintenait son édit, de quitter Prague. Le roi refusant de revenir sur ce qu’il avait décidé, un grand nombre de professeurs et d’étudiants se retirèrent. Cela amena la fondation de l’université de Leipzig. Huss qui avait approuvé la décision du roi, fut nommé recteur de l’université de Prague. Ce fut un grief de plus contre lui de la part de l’archevêque qui, par le départ des Allemands, voyait se fortifier le parti de la réforme. D’un autre côté, ceux qui avaient quitté Prague répandaient partout que Huss était entaché d’hérésie.
Comme nous l’avons vu, le concile de Pise avait déposé les deux papes Grégoire XII et Benoît XIII, et avait élu Alexandre V. L’archevêque de Prague qui d’abord avait tenu pour Grégoire XII, reconnut le nouveau pape et obtint de lui une bulle contre tous ceux qui, en Bohême, soutenaient les doctrines de Wiclef. De plus, la bulle défendait toute prédication dans les chapelles privées et condamnait au feu les écrits de Wiclef. C’était évidemment contre Huss que le coup était dirigé. Sur ces entrefaites, Alexandre V mourut, empoisonné, dit-on, par son ami Balthasar Cossa, qui lui succéda sous le nom de Jean XXIII. Huss fit vainement appel au nouveau pape, et l’archevêque résolut d’en finir et de mettre à exécution la bulle d’Alexandre V.
Il commença par ordonner que tous les écrits de Wiclef lui fussent livrés dans un délai de six jours pour être examinés. Mais sans l’avoir fait, il déclara son intention de les brûler et, le 16 juillet 1410, malgré l’opposition de l’université et sous prétexte que le roi n’avait pas défendu leur destruction, il fit brûler devant son palais environ deux cents volumes des écrits de Wiclef et d’autres réformateurs. C’étaient des manuscrits de prix, ornés de belles enluminures, et avec des couvertures très riches. Cette exécution causa une grande indignation, et plusieurs en prirent l’occasion pour tourner l’archevêque en ridicule. Il était fort ignorant et dut apprendre à lire, dit-on, lorsqu’il entra en charge. On fit des chansons qui couraient dans les rues de Prague :
Notre archevêque doit apprendre
Son A, B, C,
Afin qu’il puisse au moins comprendre
Ce qu’il a brûlé.
Le roi défendit sous peine de mort de les chanter. Huss n’était pour rien en cela ; il se contenta de dire : « C’est une pauvre chose de brûler des livres. Cela n’a jamais ôté un seul péché du cœur des hommes. Si celui qui a condamné ces livres ne peut rien prouver contre eux, il a seulement détruit quelques vérités, plusieurs belles pensées, et cela n’a servi qu’à multiplier parmi le peuple les troubles, les inimitiés, les soupçons et les meurtres ». En effet, chose triste à dire, le sang avait coulé dans ces dissensions.
Quant à la défense de prêcher dans la chapelle de Bethléem, Huss ne pensait pas devoir obéir. Il estimait qu’il était protégé par l’acte de fondation de la chapelle, mais surtout il pensait qu’il devait obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. Il disait : « Quelle autorité se trouve-t-il dans les saints écrits, ou sur quel fondement raisonnable peut-on se baser, pour défendre de prêcher dans un lieu si public et si convenable dans ce but, au milieu de la grande ville de Prague ? Au fond de tout cela il n’y a autre chose que la jalousie de l’Antichrist ». Huss comprenait et affirmait que l’appel divin à prêcher l’Évangile avait une autorité supérieure à n’importe quel appel de la part de l’homme. « Où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté ». Il continua donc ses prédications en laissant à Dieu les résultats.
Huss aurait désiré réformer les abus de l’Église de Rome à laquelle il était attaché et dont il ne se sépara jamais ouvertement ; mais comment faire au milieu de la confusion et des luttes qui régnaient dans l’Église ? Il avait à peser tout en présence de Dieu, et devait arriver, fortifié par Dieu, à prendre une résolution quant à ce qu’il avait à faire. Obéirait-il à Dieu pour autant qu’il avait compris sa volonté, et irait-il contre le courant, ou bien se laisserait-il aller avec le courant en évitant le mal autant qu’il le pourrait ?
Écoutons la conclusion à laquelle il arriva : « Afin de ne pas me rendre coupable par mon silence, abandonnant la vérité pour un morceau de pain ou par crainte des hommes, je déclare que mon dessein est de défendre même jusqu’à la mort la vérité que Dieu m’a rendu capable de connaître, et spécialement la vérité des saintes Écritures, puisque je sais que la vérité demeure, qu’elle est puissante à jamais, qu’elle subsiste éternellement, et qu’avec elle il n’y a point d’acception de personnes ». Noble résolution ! Au milieu des ténèbres qui alors couvraient l’Église, être déterminé à rester du côté de la lumière qui l’amènerait en collision avec les ténèbres et les puissances des ténèbres, c’était un vrai courage. Dieu seul pouvait l’inspirer à son fidèle témoin.
Nous avons vu que Huss en avait appelé au pape ; l’archevêque avait fait de même et fut écouté par le pape qui nomma le cardinal Othon di Colonna pour examiner le cas de Huss. Le cardinal somma Huss de comparaître à Bologne où se trouvait alors le pape. Là, le réformateur ne pouvait s’attendre qu’à une condamnation. La reine Sophie prit en main la cause de son confesseur, et le roi écrivit au pape et au cardinal en faveur de Huss, exprimant aussi sa volonté « que la chapelle de Bethléem à qui, disait-il, pour la gloire de Dieu et le salut du peuple, nous avons accordé des franchises pour la prédication de l’Évangile, subsiste, et soit confirmée dans ses privilèges… et que notre loyal, dévoué et bien-aimé Huss soit établi sur cette chapelle, et prêche en paix la parole de Dieu ». Le roi demanda aussi que Huss fût excusé de ne pas se rendre à Bologne.
Sur ces entrefaites, Colonna avait prononcé l’excommunication contre Huss pour n’avoir pas obéi à sa sommation, mais le pape, se rendant à la lettre du roi, ôta l’affaire à Colonna et nomma un autre commissaire. Cependant l’archevêque fit tous ses efforts pour persuader au pape de faire comparaître Huss devant lui, et lui envoya, ainsi qu’aux cardinaux, de riches présents. Le pape nomma alors le cardinal Brancas qui, sans l’avoir entendu, déclara Huss hérésiarque, c’est-à-dire chef d’hérétiques, et plaça sous l’interdit la ville de Prague où Huss résidait. L’archevêque triomphait, et, par ses ordres, le clergé se mit à fermer les églises (*). Mais ici encore le roi intervint et confisqua les biens du clergé qui voulait maintenir l’interdit. Le peuple aussi se souleva contre les prêtres.
(*) Dans toute ville placée sous l’interdit aucun service religieux ne pouvait être célébré.
Huss cependant, profitant de ce conflit, continua tranquillement son œuvre, laissant le roi s’arranger avec l’archevêque et le cardinal. Combien tout cela est remarquable et comme l’on peut y voir la main de Dieu qui s’étendait sur son serviteur pour le garder en se servant des passions des hommes. Car le roi au fond ne se souciait pas de la vérité, et était en réalité un très méchant homme, que ses sujets emprisonnèrent deux fois pour ses crimes. Le roi et l’archevêque en vinrent à un compromis. L’archevêque leva l’interdit et écrivit au pape qu’il n’y avait point d’hérésie en Bohême, et de son côté, le roi fit relâcher les ecclésiastiques qu’il gardait en prison et leur rendit leurs biens. La paix fut ainsi rétablie en quelque mesure. L’archevêque Zbynek quitta la Bohême en septembre 1411, et mourut peu de temps après.
Le pape Jean XXIII (*) avait envoyé en Bohême un légat pour recruter des partisans contre ses adversaires. Le légat demanda au nouvel archevêque Albic de faire comparaître Huss devant lui. Il demanda tout d’abord au réformateur s’il voulait obéir aux commandements apostoliques. « Certainement », dit Huss, « et de tout mon cœur ». Le légat, se tournant vers l’archevêque, lui dit : « Vous le voyez : le maître est tout prêt à obéir aux commandements apostoliques ». Mais Huss s’apercevant qu’on l’avait mal compris, dit : « Entendez-moi bien, monseigneur. J’ai dit que j’étais prêt à obéir de tout mon cœur aux commandements apostoliques ; mais j’appelle ainsi les doctrines des apôtres de Christ, et pour autant que les commandements du pape s’accordent avec elles, je m’y soumettrai très volontiers. Mais si je vois en eux quelque chose qui s’écarte de l’enseignement des apôtres, je ne leur obéirai pas, dussé-je voir le bûcher dressé devant moi ». Le légat n’insista pas ; il avait d’autres affaires et Huss échappa pour le moment.
(*) Voir plus haut. Ce Jean XXIII est considéré aujourd’hui comme illégitime — un antipape.
La mort de Wiclef n’arrêta pas le zèle de ses disciples. La puissance de la doctrine qu’il avait enseignée se montra dans le nombre de ceux qui la reçurent. L’Angleterre, à un certain moment, sembla tout entière gagnée aux vues du réformateur. On trouvait partout des « Lollards », comme on les appelait ; dans les chaumières des paysans, comme dans les châteaux des nobles. Ils se sentaient tellement appuyés par le sentiment presque général de la nation qu’en l’année 1395, ils adressèrent une requête au parlement demandant qu’on abolît le célibat des prêtres, la transsubstantiation, les prières pour les morts, les offrandes faites aux images, la confession et plusieurs abus de l’Église romaine. Ils affichèrent leurs conclusions aux portes de Saint-Paul et de Westminster.
Le clergé romain s’émut de cette hardiesse. Arondel, archevêque d’York, et Braybrocke, évêque de Londres, demandèrent au roi Richard II d’intervenir. Celui-ci défendit au Parlement de discuter la requête des Wiclefites, et menaça de mort les principaux d’entre eux, s’ils persistaient à soutenir ces détestables doctrines. Peu de temps après, Richard fut détrôné par son cousin le duc de Lancaster et mourut en prison. Le duc de Lancaster monta sur le trône sous le nom de Henri IV. C’est lui dont le père avait été l’ami et le protecteur de Wiclef, et les Lollards espérèrent que le nouveau roi leur serait favorable. Ils furent cruellement déçus. Arondel, qui avait aidé Henri IV à s’emparer du trône, lui avait dit en le couronnant : « Pour consolider votre trône, gagnez le clergé et abandonnez les Lollards ». Le roi répondit : « Je serai le protecteur de l’Église ». Il le fit bientôt voir.
Jusqu’au commencement du quinzième siècle, il n’y avait eu en Angleterre aucune loi qui condamnât les hérétiques à être brûlés. Partout ailleurs le pouvoir civil avait abandonné sur ce point son droit au pouvoir spirituel, c’est-à-dire au clergé. Afin de prouver à l’archevêque sa sincérité, le roi rendit un édit ordonnant que tout hérétique impénitent serait brûlé vif pour épouvanter les autres. En même temps, les prêtres firent courir et répandirent partout des bruits de complots et de desseins dangereux formés par les Lollards. Le Parlement confirma l’édit en l’an 1400. Brûler les hérétiques devint ainsi chose légale en Angleterre. L’édit portait que la sentence serait exécutée « publiquement, en un lieu élevé, aux yeux du peuple ». Dès que le primat (*) et les évêques eurent ainsi liberté d’agir, ils se mirent activement à poursuivre leur œuvre de ténèbres.
(*) L’archevêque d’York était le premier et au-dessus de tous les prélats du royaume. De là son titre de primat.
Leur première victime fut un ministre pieux de Londres. Il enseignait ouvertement les doctrines prêchées par Wiclef, et avait osé dire : « Au lieu d’adorer la croix sur laquelle Christ a souffert, j’adore Christ qui a souffert sur elle ». Il avait comparu à Newbury. Là, par crainte des souffrances qu’il aurait à endurer, il s’était d’abord rétracté. Mis en liberté, il était retourné à Londres. Peu après il reprit courage, une nouvelle force lui fut donnée, et il se remit à annoncer ouvertement l’Évangile, et à protester contre les erreurs de Rome. Il fut de nouveau saisi, jeté en prison, et condamné au bûcher comme hérétique relaps. On le traîna à Saint-Paul ; là il fut dégradé de la prêtrise, puis l’archevêque le remit à la bonté du grand maréchal du royaume, car il est défendu à l’Église de verser le sang. La bonté du grand maréchal ne lui manqua pas ; il fut brûlé, et glorifia Christ dans sa mort. Quelle hypocrisie des chefs religieux ! Croyaient-ils vraiment disculper l’Église de verser le sang tout en le faisant répandre par la main de ceux qu’elle s’assujettissait ?
Le second martyr était un simple artisan, nomme John Badby. Il était accusé d’avoir nié la transsubstantiation. Il fut conduit à Londres pour y être jugé. Outre les deux archevêques d’York et de Canterbury, il y avait comme juges plusieurs évêques et le duc d’York, chancelier du royaume. Arondel se donna beaucoup de peine pour convaincre Badby que le pain consacré devenait véritablement le corps de Christ. Les réponses de l’accusé furent claires et simples, et montrèrent un grand courage et une fermeté inébranlable. « Si réellement », dit-il « chaque hostie, après que le prêtre l’a consacrée, est le corps du Seigneur, il y a donc plus de 20000 dieux en Angleterre. Je crois en un seul Dieu tout puissant ».
Badby ne voulant pas se rétracter, fut condamné à être brûlé. Au moment où le bourreau mettait le feu au bûcher, le prince de Galles, héritier de la couronne, vint à passer. Peut-être n’était-ce pas sans l’intention de voir ce spectacle extraordinaire. Quoi qu’il en soit, il fut frappé de voir le martyr paisible et tout à fait impassible, attaché au poteau, tandis que le bourreau attisait le feu. Les flammes s’approchaient du prétendu hérétique, déjà elles avaient atteint ses pieds, et l’on entendit le mot « grâce » sortir de ses lèvres. Le prince, supposant qu’il implorait la grâce de la part de son juge, ordonna d’écarter le feu. « Veux-tu abandonner ton hérésie », demanda-t-il, « et te soumettre à la foi de la sainte mère Église ? Si tu le fais, tu auras une pension annuelle sur la cassette royale ». Mais Badby resta inébranlable. Il n’avait pas fait appel à la grâce des hommes, mais s’était recommandé à la grâce de Dieu. Irrité par la constance de ce chrétien, le prince commanda qu’il fût rejeté dans les flammes, et le courageux martyr y trouva bientôt la fin de ses souffrances.
Encouragé par l’appui que le roi lui prêtait, le clergé rédigea une suite d’articles que l’on nomme la constitution d’Arondel. Ils défendaient, sous les peines les plus sévères, la lecture de la Bible et des livres de Wiclef, et appelaient le pape non un simple homme, mais un vrai Dieu sur la terre. La persécution sévit alors dans toute l’Angleterre. Il y avait dans le palais archiépiscopal une prison que l’on nommait la tour des Lollards. Elle fut bientôt remplie de prétendus hérétiques. Un grand nombre de ces martyrs souffrirent la torture destinée à leur faire abjurer leur foi, avant d’être livrés à une mort cruelle. Plusieurs gravèrent sur les murailles de leur prison l’expression de leurs douleurs et de l’espérance qui les soutenait. On y lit encore ces mots tracés par l’un d’eux : « Jésus, amor meus » (Jésus, mon amour) ; témoignage touchant de la foi qui l’animait, rendu à l’objet suprême de ses affections.
Le roi Henri V avait succédé à son père. C’est lui qui avait été témoin du supplice de Badby, mais la constance jusqu’à la mort du martyr n’avait eu aucun effet sur son cœur. La persécution continua à sévir contre les Lollards. Ce ne fut pas seulement contre les petits, mais des personnes d’un rang élevé furent aussi frappées. Parmi elles, l’une des plus illustres fut sir John Oldcastle qui, par son mariage avec Lady Cobham, était devenu Lord Cobham. Il avait été un vaillant guerrier, s’était distingué dans maints combats, et avait été un favori du roi Henri IV. Il avait aussi suivi le prince de Galles dans sa vie de dissipation et de péché. Mais la grâce de Dieu l’avait saisi, nous ignorons à quelle époque de sa vie. Nous savons seulement qu’il devint l’ami et le disciple de Wiclef, et fut zélé pour répandre les doctrines que celui-ci enseignait. Après la mort de Wiclef, il resta dévoué aux Lollards. De même qu’il avait servi son roi par son courage dans les combats, de même il se montra plein de hardiesse pour le service de Christ et de ses disciples. En tant que lord, il avait un siège au Parlement. Là il ne cacha point sa foi et son opposition à Rome ; il alla même jusqu’à dire : « Il serait bon pour l’Angleterre que la juridiction du pape s’arrêtât à Calais, et ne passât pas la mer ». Paroles bien hardies à prononcer dans un tel lieu et dans un tel temps.
Cobham faisait faire de nombreuses copies des écrits de Wiclef, et les remettait aux « pauvres prêtres » qu’il recevait dans son château, afin qu’ils les répandissent partout où ils iraient prêcher l’Évangile. Lui-même assistait à leurs prédications, revêtu de son armure, la main sur son épée, et prêt à les défendre contre quiconque viendrait les troubler. Tant que le roi Henri IV vécut, il ne permit pas aux prélats de s’attaquer à son ancien favori. Il en fut autrement après sa mort.
Henri V, qui, avant d’être roi, avait mené une folle vie de dissipation et de péché, devint, en montant sur le trône, zélé pour l’Église. Arondel et les évêques auraient bien voulu emprisonner ou brûler tous les prédicateurs, mais ils pensèrent qu’ils arriveraient plus aisément à leurs fins en faisant taire ou jeter en prison, sinon mettre à mort, leur protecteur, lord Cobham. Ils virent le moment propice. Ils accusèrent Cobham de tenir et de répandre plusieurs hérésies, et demandèrent au roi de le faire comparaître devant lui. Le roi leur répondit qu’il essayerait de persuader Cobham de renoncer à ses nouvelles opinions. Il le fit donc venir et l’exhorta à se soumettre à la sainte Mère l’Église. Cobham répondit : « Je suis toujours prêt, très excellent prince, à vous obéir, d’autant plus que je vous reconnais pour un roi chrétien et un ministre de Dieu. Après Dieu, je vous dois une entière obéissance et je m’y soumets. Mais pour ce qui est du pape et de son clergé, je ne leur dois en vérité ni hommage, ni service, parce que je sais par les Écritures que le pape est le grand Antichrist, l’adversaire déclaré de Dieu, et l’abomination placée dans le lieu saint » (*).
(*) En réalité, si l’esprit de l’Antichrist est bien là à l’œuvre, depuis le temps des apôtres, l’Antichrist est un personnage encore futur.
Ce discours hardi déplut au roi ; il ne voulut plus intervenir en faveur de son ancien ami, et les évêques purent agir à leur guise. Arondel somma Cobham de comparaître devant lui le 2 septembre, afin de répondre aux accusations d’hérésie portées contre lui. Agissant d’après sa déclaration qu’il ne devait ni hommage, ni service, au pape et à ses subordonnés, il ne tint aucun compte de la citation de l’orgueilleux prélat. Arondel la fit afficher aux portes du château de Cowling qu’habitait Cobham, et à celles de la cathédrale de Rochester. Les amis et les vassaux de Cobham les déchirèrent aussitôt. Arondel avait une autre arme ; il excommunia le courageux gentilhomme. Ceux qui savaient ce que comportait la grande excommunication pouvaient bien être effrayés de l’acte audacieux du fier champion de Rome.
Sans se laisser abattre, ni décourager, lord Cobham écrivit une confession de sa foi sur le modèle de ce que l’on nomme le symbole des apôtres, mais exprimée essentiellement en paroles de l’Écriture sainte. Il la porta au roi, le suppliant de l’examiner. Henri ne voulut pas même la regarder. « Je ne recevrai pas cet écrit », dit-il, « remettez-le à vos juges ». Ces juges, c’étaient l’archevêque et ceux qui l’assistaient. Le roi, poussé par eux, envoya un de ses officiers pour se saisir du vieux guerrier. Si c’eût été un envoyé du clergé la question se serait décidée par les armes, selon la coutume de ces temps ; mais la sommation venait du roi, à qui Cobham se sentait tenu d’obéir. Il suivit l’officier et fut incarcéré à la Tour de Londres. Le 23 septembre, il fut amené dans l’église de Saint-Paul devant l’archevêque et les évêques de Londres et de Winchester, et d’autres ecclésiastiques. L’archevêque lui offrit l’absolution, s’il voulait se soumettre et confesser ses erreurs. Cobham répliqua en lisant un exposé de sa foi dont il présenta une copie à Arondel. Mais celui-ci avec irritation s’écria : « Il faut croire ce que la sainte Église de Rome enseigne, sans exiger l’autorité de Christ ». — « Croyez, croyez ! » lui criaient les prêtres ». — « Je suis prêt », dit Cobham, « à croire tout ce que Dieu veut que je croie ; mais je ne croirai jamais que le pape ait le droit d’enseigner ce qui est en opposition avec les Saintes Écritures ».
Il fut reconduit à la Tour, et la cour s’ajourna au lundi suivant. Cette fois, elle se réunit dans le couvent des Dominicains. Une foule de prêtres, de moines, de chanoines, d’ecclésiastiques, de vendeurs d’indulgences, s’y trouvait rassemblée et accueillit le prisonnier par un torrent d’injures. On lui offrit de nouveau l’absolution, à condition qu’il s’humiliât et confessât ses hérésies. « Non, vraiment », répondit-il ; « car je ne vous ai jamais offensés ». Puis accusant avec véhémence le pape et les princes de l’Église, il s’écria : « Votre domination est le poison de l’Église ! » — « Qu’entendez-vous par ce poison ? » demanda Arondel. — « Vos possessions et vos honneurs… Considérez ceci, vous tous qui êtes présents ici. Christ était doux et miséricordieux ; le pape est un tyran et un orgueilleux. Rome est le nid de l’Antichrist, et de ce nid sortent ses enfants ».
Alors eut lieu une scène étrange et des plus touchantes. Cobham ayant recouvré son calme, se jeta à genoux sur les dalles, et levant ses mains vers le ciel, il dit : « Je me confesse à Toi, ô mon Dieu, Dieu vivant et éternel ! Je reconnais que, dans ma fragile jeunesse, je t’ai très gravement offensé par l’orgueil, la colère, l’intempérance et l’impureté. Dans ma colère, j’ai blessé plusieurs hommes, et j’ai commis beaucoup d’horribles péchés. C’est pourquoi, ô Seigneur ! j’implore ta miséricorde ». Puis se relevant, le visage baigné de larmes, il se tourna vers les assistants et dit : « Ainsi, bonnes gens, pour avoir violé la loi de Dieu, ces hommes ne m’ont jamais maudit ; mais maintenant à cause de leurs propres lois et de leurs traditions, ils me traitent, et d’autres avec moi, de la manière la plus cruelle ».
Lorsque la cour se fut remise de l’émotion causée par cette scène, elle examina le noble témoin de Christ touchant sa foi et sur les quatre points qui formaient le fond de l’accusation portée contre lui. Le premier concernait la présence réelle de Christ dans l’eucharistie. Cobham s’en tint aux Écritures, tandis que ses adversaires en appelaient aux décisions de l’Église.
« Que pensez-vous de la sainte Église ? » lui demanda Arondel.
« La sainte Église », répliqua Cobham, « est l’ensemble de tous ceux qui seront sauvés et dont Christ est le Chef ».
« Que dites-vous du pape ? » demanda un des docteurs.
« Lui et vous tous ensemble », répondit Cobham, « vous composez le grand Antichrist. Le pape est la tête ; vous, les évêques, les prêtres et les prélats et les moines, vous formez le corps, et les moines mendiants sont la queue, car ils cachent par leurs sophismes la méchanceté de tous ».
L’évêque de Londres dit : « Vous savez bien que Christ est mort sur une croix matérielle ».
« Oui », dit Cobham, « et je sais aussi que notre salut n’est pas venu par cette croix matérielle, mais par Celui-là seul qui est mort sur cette croix. Et je sais que le bienheureux saint Paul ne se glorifiait en aucune autre croix que dans les souffrances et la mort de Christ ».
L’habile primat espérait encore arriver à convaincre par ses sophismes et ceux des prêtres le vieux chevalier ; mais tous ses efforts furent vains. « Je ne puis croire autrement que ce que j’ai dit ; faites de moi ce que vous voudrez », dit Cobham.
Comme la nuit approchait, l’archevêque se leva et dit que l’accusé devait se soumettre à l’Église, ou que la loi aurait son cours. Le visage tout en larmes, Cobham dit encore : « Je ne puis autrement. Je ne désire pas votre absolution. C’est du pardon de Dieu que j’ai besoin ».
Alors tous se levèrent et se découvrirent, et le primat lut à haute voix la sentence de mort. Lorsqu’il eut terminé, le courageux chevalier dit : « C’est bien ; vous pouvez tuer mon corps, mais vous n’avez aucun pouvoir sur mon âme. J’en appelle à la grâce de mon Dieu éternel ». Il s’agenouilla encore une fois et pria pour ses ennemis. Il fut condamné à être brûlé comme hérétique, et ramené à la Tour. Cinquante jours de délai furent accordés avant l’exécution du jugement. Dans l’intervalle ses ennemis ne restèrent pas inactifs. Les lois iniques de l’Église et de l’État avaient mis leurs victimes entre leurs mains, que pouvaient-ils désirer de plus ? Ils tenaient à leur faire abjurer leurs soi-disant erreurs. Mais comme Cobham ne le voulait ni ne le pouvait, ils le firent pour lui, et par une fausseté aussi méchante qu’abominable, ils prétendirent qu’il avait rétracté ses hérésies et rendu hommage à Jean XXIII, l’un des trois papes rivaux, et un homme exécrable s’il en fût. Mais peu de personnes crurent à leur mensonge.
Cependant, avec l’aide de quelques amis et la connivence du gouverneur de la Tour, Cobham réussit à s’échapper et se réfugia dans le pays de Galles. Les Lollards n’avaient nullement été découragés par la captivité de Cobham. Ils avaient continué à répandre leurs doctrines avec le plus grand zèle. Mais les prêtres exaspérés, voulant arrêter leurs progrès et mettre un terme à « la contagion de leur enseignement », comme ils disaient, firent courir le bruit de complots et d’un soulèvement général des Lollards. « Lord Cobham », disaient-ils, « est leur chef, et leur but est de détrôner le roi, de tuer la famille royale, de renverser le gouvernement de détruire toutes les cathédrales et de confisquer les biens de l’Église ».
Le roi s’émut à la pensée du danger prétendu qu’il courait, et rendit des lois encore plus sévères contre les malheureux confesseurs de Christ. Une grande réunion de prédication devait avoir lieu hors des portes de Londres. On la signala au roi comme un commencement d’exécution du complot. Il sortit en personne à la tête d’une armée contre cette foule désarmée d’hommes, de femmes et d’enfants, qui n’offrirent aucune résistance. Plusieurs furent taillés en pièces, d’autres furent faits prisonniers ; parmi eux sir Roger Ashton, un des fidèles compagnons de Wiclef, et vingt-huit autres qui furent exécutés comme traîtres. Quant à Cobham, on offrit mille marcs de récompense à qui le livrerait, vivant ou mort. Mais il était si grandement estimé que personne, durant les quatre années qu’il erra de lieu en lieu, ne mit les mains sur lui. À la fin, il fut trahi par Lord Pewis qui obtint le prix du sang du noble martyr.
On le ramena à la Tour, et il fut appelé à comparaître devant les Lords qui le condamnèrent à une mort cruelle comme coupable de trahison et d’hérésie. Il devait être brûlé à petit feu.
Le jour de l’exécution arriva. On le fit sortir de prison les mains liées derrière le dos. Une sainte joie brillait sur son visage. La sentence fut exécutée, accompagnée de toutes les marques possibles d’ignominie. On plaça sur une claie l’ancien favori du roi Henri IV, et on le traîna à travers les rues jusqu’à Saint-Gilles. Beaucoup de personnes de qualité se trouvaient là comme spectateurs, ainsi qu’une foule du peuple. Arrivé au lieu du supplice, Cobham s’agenouilla et pria encore pour ses persécuteurs. Puis il se tourna vers la foule et l’exhorta sérieusement à suivre les enseignements de la sainte parole de Dieu, et à se garder de ces faux docteurs dont la vie et la conduite étaient en si complète opposition avec Christ et son esprit.
Comme on lui offrait l’assistance d’un prêtre, il la refusa en disant : « C’est à Dieu seul, qui est présent maintenant comme toujours, que je veux confesser mes péchés ; c’est à Lui que je veux en demander le pardon ». Beaucoup des assistants fondaient en larmes, et prièrent avec lui et pour lui. En vain les prêtres affirmaient qu’il souffrait comme hérétique et ennemi de Dieu. Le peuple croyait Cobham plus que les prêtres.
Par un raffinement de cruauté, on l’avait suspendu par des chaînes attachées autour de son corps, au-dessus d’un feu qui brûlait lentement, afin que le supplice durât plus longtemps. « Rendez grâces à Dieu », furent les dernières paroles que l’on pût entendre sortir de la bouche du martyr dans ses souffrances indicibles. Enfin la mort y mit un terme, et l’esprit bienheureux du fidèle témoin alla près du Seigneur, en attendant le moment de la glorieuse résurrection.
« Ainsi », dit un chroniqueur, « est allé reposer le vaillant chevalier sir John Oldcastle, sous l’autel de Dieu, qui est Jésus Christ, avec la sainte compagnie de ceux qui, dans le royaume de patience, ont souffert une grande tribulation et la mort pour sa parole et son témoignage. Ils attendent auprès de Lui que leur nombre soit complet et la pleine rédemption des élus ».
Depuis ce temps les prisons de Londres regorgèrent de Wiclefites, qui furent livrés sans défense à la haine de leurs ennemis. « Qu’ils soient pendus pour offense au roi, et brûlés pour offense à Dieu », disaient les prêtres de Rome. Ceux qui échappaient à la prison et à la mort, étaient forcés de se réunir en secret. Mais Dieu se servit de cette victoire apparente de l’ennemi pour affaiblir dans les esprits d’un grand nombre la puissance et l’influence de la papauté, et pour frayer ainsi la voie à la Réformation dans le siècle suivant. La piété, la patience et la fermeté inébranlable des témoins de Jésus, faisaient une impression profonde sur les cœurs de plusieurs, tandis que la rage de persécution y semaient le mécontentement et le doute.
Henri Chicheley qui succéda à Arondel comme archevêque de Canterbury, le dépassa en zèle pour l’extermination des Lollards. Arondel semble avoir été frappé par un jugement de Dieu. Peu de temps après avoir prononcé la sentence de mort de Lord Cobham, il fut atteint d’une maladie incurable de la gorge qui le conduisit en peu de temps au tombeau.
Nous verrons plus loin comment d’autres témoins de Christ en Angleterre souffrirent pour son nom.
7.4.3 - Jean Huss
C’est en Bohême que fut suscité, après la mort de Wiclef, celui qui, avec ce dernier, fut un des principaux précurseurs de la Réformation. La Bohême est en grande partie habitée par une population de race slave. Le christianisme y fut introduit dans le 11° siècle, à l’époque des guerres de Charlemagne. C’est vers les années 820 à 826, que le moine Urolf évangélisa la partie est de la Bohême, nommée Moravie, et qui, à cette époque, était un royaume gouverné par ses propres princes, mais plus ou moins sous l’influence des princes allemands voisins. L’Église romaine y prédominait alors ; le culte se célébrait en langue latine, et la religion ne consistait guère qu’en formes et en cérémonies qui laissaient le peuple dans l’ignorance des vérités de l’Écriture. En 863, les princes moraves Rastislav, Svatopluk et Kotzel, voulant à la fois s’affranchir de la tutelle des princes allemands et du joug de Rome, envoyèrent à l’empereur grec de Constantinople des messagers pour lui dire : « Notre peuple est baptisé, mais nous n’avons pas de docteurs pour nous instruire et pour traduire les Saintes Écritures dans notre langue. Envoyez-nous quelqu’un qui nous explique les Écritures ».
Il y avait alors deux frères, nés dans le premier quart du 9° siècle, nommés Méthodius et Constantin. Ce dernier, à la fin de sa vie, prit le nom de Cyrille. Ils étaient fils d’un homme riche et considéré, peut-être d’origine slave. Il leur avait fait donner une éducation soignée, et ils avaient acquis la connaissance de plusieurs langues, entre autres de la langue slave. Constantin, le plus jeune, remarquable par sa science, se voua à l’état ecclésiastique. Méthodius fut d’abord un homme du monde. Il avait servi dans l’armée, et l’empereur lui avait confié l’administration d’une principauté slave. Mais après quelques années, Méthodius abandonna le monde, se fit moine et se retira dans un couvent où son frère vint le rejoindre. Mais ce n’était pas pour rester inactifs. Les missionnaires de ces temps-là, soit dans l’église latine, soit dans l’Église grecque, sortaient tous des couvents, et portaient le christianisme chez les nations encore païennes du nord et de l’est de l’Europe. Constantin avait commencé une mission chez les Bulgares, et vers l’an 860, les deux frères furent envoyés par l’empereur grec Michel, sur la demande du prince des Khazares, vers ce peuple qui habitait la Crimée et les bords du Don, pour l’instruire et le convertir.
C’est après cette mission que, pour répondre au désir des princes moraves, l’empereur leur envoya Méthodius et Constantin. Les deux frères furent bien accueillis par le prince et son peuple à Velegrad, maintenant Olmütz, ou Olomouc, en Moravie. Dès qu’ils furent arrivés, ils se mirent à prêcher l’Évangile dans la langue slave commune à la Bohême et à la Moravie, et à instruire la jeunesse. Le culte divin fut aussi célébré dans la langue vulgaire. Le zèle et la piété des missionnaires amenèrent, par la grâce de Dieu, beaucoup de conversions ; des églises et des écoles s’élevèrent de toutes parts. Méthodius et Constantin perfectionnèrent l’alphabet et l’écriture slaves, et complétèrent la version de la Bible dont ils avaient déjà traduit quelques portions longtemps auparavant.
Ils poursuivirent leurs travaux en Moravie et dans le reste de la Bohême, malgré l’opposition des prêtres romains. Ceux-ci, chose étrange à dire, n’admettaient pas qu’on pût louer Dieu en d’autres langues que l’hébreu, le grec et le latin. Or Méthodius et Constantin, sans se détacher de l’Église romaine qui, alors, était encore unie à l’Église orientale grecque, étaient avant tout préoccupés du désir d’amener des âmes à Christ. Ils croyaient avec raison que le peuple ne pouvait être édifié et consolé que dans sa langue maternelle, et à cause de cela, ils tenaient à se servir, dans le culte, de la liturgie en langue slave.
Leurs différends avec les prêtres romains les amenèrent à entreprendre un voyage à Rome pour exposer leurs vues au pape Adrien II. Celui-ci les reçut avec cordialité et les approuva. Il rétablit même en faveur de Méthodius, l’évêché de Pannonie dont le siège était à Blatno, maintenant Mosaburg, près du lac Balaton. De là, Méthodius évangélisa jusqu’en Croatie où la liturgie slave s’est conservée jusqu’à ce jour. Quant à Constantin, épuisé par ses travaux, il mourut à Rome en 869, dans un couvent où il s’était retiré, et où il avait pris le nom de Cyrille.
Méthodius ne jouit pas en paix de la position et des privilèges que le pape lui avait accordés. Il fut accusé par les archevêques et les prêtres allemands d’avoir porté atteinte aux droits de l’évêque de Salzburg sur la Pannonie, et subit un emprisonnement de trois années. Mais la Moravie étant tombée sous la domination de Svatopluk, il put se rendre de nouveau à Rome en 881, se justifia devant le pape, et reçut de celui-ci plein pouvoir pour continuer ses travaux. Il mourut à Olmütz en 885, après une vie consacrée d’une manière infatigable au service de Dieu.
Après sa mort, le parti allemand reprit le dessus et chassa les prêtres slaves. Le rituel latin s’introduisit de nouveau graduellement, et les deux pays, la Bohême et la Moravie, tombèrent de plus en plus sous la domination du pontife romain. En 967, le pape Jean XIII y rétablit la hiérarchie romaine et tous les abus de son église. En 1079, le pape Grégoire VII défendit l’usage de la liturgie orientale, c’est-à-dire de l’Église grecque, définitivement séparée de l’Église romaine, et la célébration du culte en langue vulgaire. Depuis ce temps, le Romanisme prévalut, et tout ce qui ressemblait à une religion vitale et scripturaire disparut à peu près. On ne peut cependant douter qu’au milieu de beaucoup de ténèbres, d’erreurs et de superstitions, Dieu n’eût dans ces pays un résidu fidèle qui recevait la vérité et retenait la foi de l’Évangile. Cela doit avoir été le cas, car en quelques endroits la langue vulgaire ne cessa pas d’être employée dans le culte public, et la Cène d’être donnée sous les deux espèces. Quelques-uns des puissants seigneurs étaient aussi favorables à l’Évangile et protégeaient leurs frères pauvres, comme aussi les Vaudois qui, exilés de leurs vallées natales, s’étaient réfugiés en Bohême, et contribuaient à y répandre la précieuse semence de la parole de Dieu.
Ce que nous venons d’exposer nous aidera à comprendre l’histoire de Huss.
Nous avons déjà fait allusion au triste état dans lequel se trouvait la chrétienté en Occident à la fin du 14° et au commencement du 15° siècle. Nous en dirons encore quelques mots avant de nous occuper de Jean Huss qui vécut à cette époque.
Au commencement du 15° siècle, l’Église catholique romaine, en dépit de l’unité dont elle se vante, avait à sa tête deux papes opposés l’un à l’autre. Benoît XIII avait sa résidence à Avignon, et Grégoire XII, à Rome. Cet état de choses durait depuis l’époque où Philippe le Bel, roi de France, après avoir humilié la papauté dans la personne de Boniface VIII, avait obligé le pape Clément V à transférer à Avignon le siège pontifical, afin que les papes demeurassent sous la puissance des rois de France. Mais un certain temps après, sous l’influence de l’empereur allemand, les Romains élirent un autre pape, celui d’Avignon refusant de retourner à Rome. Soit le pape d’Avignon, soit celui de Rome, prétendaient être les vicaires de Christ sur la terre, et s’accusaient l’un l’autre devant le monde entier d’hypocrisie, de parjures, et des desseins secrets les plus honteux. Ces princes de l’Église, Benoît XIII et Grégoire XII, bien qu’étant des vieillards d’environ soixante-dix ans, avaient une conduite telle que l’Europe entière en était scandalisée. Que faire pour guérir les plaies de l’Église et rétablir l’unité brisée ? Les deux papes promettaient bien et juraient même d’abdiquer leur dignité, si les intérêts de l’Église le réclamaient ; mais ils trouvaient bientôt un prétexte pour manquer à leur parole.
Alors les cardinaux des deux partis se réunirent à Livourne, afin de se consulter sur les moyens de mettre un terme à ce schisme affligeant. Ils arrivèrent à la conclusion que, dans les circonstances présentes, ils avaient le droit de convoquer un concile qui déciderait entre les deux prétendants au siège de Pierre et rétablirait ainsi l’unité de l’Église. La ville de Pise en Italie fut choisie pour le lieu où le concile se réunirait. Bien que ce fût une chose inusitée qu’un concile fût convoqué sans l’approbation du pape ou de l’empereur, toute l’Église approuva la mesure que les cardinaux avaient prise. Les papes furent ainsi privés de leur plus haut privilège, et appelés à répondre devant un nouveau tribunal ; mais ils avaient tellement perdu l’estime de la chrétienté, que tout le monde applaudit à la résolution des cardinaux.
Le concile s’ouvrit le 25 mars 1409 et fut un des plus remarquables que mentionne l’histoire de la chrétienté, soit par le nombre, soit par la qualité de ceux qui y assistèrent. On y comptait vingt-deux cardinaux, quatre patriarches latins, douze archevêques et quatorze représentants d’archevêques, quatre-vingts évêques et cent deux représentants, quatre-vingt-sept abbés et deux cents représentants, un grand nombre de prieurs, le grand maître des chevaliers de Rhodes et seize commandeurs du même ordre, des députations de toutes les universités, plus de trois cents docteurs en théologie, et des envoyés des rois et princes de l’Europe. Que ne devait pas accomplir une assemblée si respectable ? Les séances durèrent du mois de mars jusqu’à la fin du mois d’août. Après beaucoup de délibérations, les deux papes furent jugés à l’unanimité. Le 5 juin, la sentence fut rendue. Tous deux furent déclarés hérétiques, parjures, opiniâtres, incapables d’exercer l’autorité suprême et illimitée du pouvoir papal, et même indignes d’occuper aucune dignité. Le siège de Pierre fut déclaré vacant, et il s’agit alors de choisir un nouveau pape, chose plus difficile que de déposer les deux autres. Les vingt-quatre cardinaux chargés de faire ce choix, portèrent leurs suffrages sur Pierre de Candia, cardinal de Milan, qui fut élu sous le nom d’Alexandre V. Mais les deux papes d’Avignon et de Rome rejetèrent la décision du concile et continuèrent à exercer leurs fonctions comme papes légitimes, lançant l’un et l’autre leurs malédictions et leurs excommunications contre le concile et le nouveau pape leur rival. Il y eut donc trois papes. Le concile, loin de guérir le schisme, l’avait agrandi. Où était l’unité de l’Église romaine ? Où la succession apostolique, fondement de cette unité ? Alexandre V ne vécut qu’un an après son élection. À sa place on nomma Jean XXIII, homme, de l’aveu des écrivains les plus sérieux, sans principes, sans mœurs, et sans aucune crainte de Dieu.
Les difficultés furent plus grandes que jamais. Qu’y avait-il à faire ? pouvait-on encore se demander. La papauté semblait en danger de sombrer. Le pape lui-même était insuffisant pour rétablir la paix dans l’Église. L’empereur allemand Sigismond résolut d’intervenir, montrant ainsi pour le bien de l’Église plus d’intérêt que les papes. D’accord avec le roi de France et d’autres souverains, il engagea Jean XXIII à convoquer un concile général de toute l’Église, afin de mettre un terme aux luttes funestes qui l’agitaient.
La ville impériale de Constance fut choisie pour recevoir dans ses murs l’auguste assemblée. L’afflux de personnes de toutes conditions, attirées dans la ville pour cette occasion, était si grand, qu’on compte que le nombre de chevaux qui amenèrent les assistants était de trente mille. Outre les nombreux dignitaires de l’Église, plus de cent princes, cent huit comtes, deux cents barons et vingt sept chevaliers s’étaient rendus à l’invitation du pape. Des tournois, des fêtes, des plaisirs de toutes sortes se succédaient pour délasser les membres du concile de leurs occupations spirituelles. Cinq cents chanteurs avaient été rassemblés, prêts à charmer les heures de loisir des saints prélats et des gentilshommes, et à restaurer leurs esprits. Tous ces princes de l’Église, tous ces ecclésiastiques et ces grands de la terre étaient réunis afin de se consulter pour la guérison de la plaie mortelle de la papauté, mais à part quelques exceptions, l’histoire nous rapporte quelle fut la conduite abominable, l’impiété, la honteuse hypocrisie de ces soi-disant saints prêtres, et les faits scandaleux dont la ville de Constance fut témoin durant les trois ans et demi que dura le concile commencé le 5 novembre 1414, sans parler de l’impie mise à mort des deux témoins de Christ, Jean Huss et Jérôme de Prague.
Le but du concile de Constance était double : en premier lieu, il s’agissait de mettre un terme au schisme, et secondement, de réprimer ce que l’on nommait les hérésies de Wiclef et de Huss. On se proposait bien aussi de réformer certains abus dans l’Église, mais il semble qu’à cet égard les choses restèrent dans le même état. Quant au premier point, après avoir établi qu’un pape est assujetti au jugement d’un concile général de l’Église, le pape Jean XXIII fut déposé à cause de sa vie immorale et de son parjure vis-à-vis de l’empereur. Grégoire et Benoît subirent le même sort et s’y résignèrent. À leur place, on élut Othon di Colonna, sous le nom de Martin V. Nous avons donné ces détails pour montrer ce qu’était alors celle qui s’appelle la sainte Église catholique.
Pour ce qui regarde les soi-disant hérésies abhorrées de Wiclef et de Huss, nous verrons comment le concile agit pour les réprimer.
Remarquons seulement ici combien, au point de vue de l’Église romaine, le danger était grand. Les précieuses vérités de l’Évangile, en dépit des tortures et des bûchers de Rome, avaient jeté de profondes racines dans des milliers et des centaines de milliers de cœurs, et s’étaient répandues dans presque tous les pays de l’Europe. En l’an 1416, à ce même concile de Constance, un an avant le martyre de Cobham et trente-six ans après que Wiclef eut traduit la Bible, l’archevêque de Lodi déclarait que les hérésies de Wiclef et de Huss avaient trouvé de zélés partisans presque partout en Angleterre, en France, en Italie, en Hongrie, en Russie, en Lithuanie, en Pologne, en Allemagne, et dans toute la Bohême. Ainsi, un ennemi déclaré rendait, sans le savoir ou sans y penser, témoignage à la puissance merveilleuse de la parole de Dieu. L’homme ne peut rien contre la vérité.
Indépendamment des semences de vérité qui étaient restées cachées en Bohême, comme nous l’avons fait remarquer, une circonstance spéciale contribua à réveiller les esprits et à préparer la voie à la réception de l’Évangile. En 1382, deux ans avant la mort de Wiclef, la princesse Anne de Luxembourg, avait épousé Richard II, roi d’Angleterre. Anne était une femme pieuse qui aimait et sondait les Écritures. Son mariage établit entre les deux pays des relations étroites dans un temps où les enseignements de Wiclef se répandaient avec une rapidité extraordinaire. Des hommes savants de Bohême, entre autres Jérôme de Prague, allèrent à l’Université d’Oxford, et à leur retour dans leur pays y rapportèrent plusieurs des écrits de Wiclef que l’on traduisit en latin et en langue bohème. Ce qui valait davantage, plusieurs avaient reçu dans leur cœur les vérités enseignées par le réformateur. D’un autre côté, des étudiants anglais se rendirent aussi à l’Université de Prague et apportèrent avec eux les livres de Wiclef. La reine Anne elle-même favorisait ce mouvement religieux. Après sa mort, qui eut lieu en 1394, plusieurs des personnes qui l’avaient suivie revinrent en Bohême, et contribuèrent aussi à répandre les doctrines évangéliques. Elles pénétrèrent ainsi jusque parmi les membres de l’Université qui se mirent à lire et à examiner les livres qui les renfermaient. Du nombre de ces docteurs se trouvait Jean Huss, dont nous allons maintenant nous occuper.
Jean Huss naquit le 6 juillet 1369 (d’autres disent en 1373), dans la petite ville de Hussinetz, d’où il tira son nom, située au sud de la Bohême près des frontières de la Bavière. Ses parents étaient d’humble extraction, comme le furent ceux de Luther. Ils purent cependant l’envoyer faire ses études à l’Université de Prague. On raconte que lorsque sa mère le conduisait à l’Université (son père étant déjà mort), elle apportait au recteur un présent qu’elle perdit dans le voyage. Très affligée de cette perte, elle se mit à genoux à côté de son fils, le recommanda au Tout-Puissant et invoqua sur lui sa bénédiction. Sa prière fut exaucée, mais elle ne vécut pas assez longtemps pour voir combien richement Dieu lui répondit.
La carrière universitaire de Huss fut brillante. Il se distingua de bonne heure par une grande intelligence et en même temps par sa modestie, sa fermeté et sa conduite irréprochable. Il était d’un abord doux et affable et gagnait les cœurs de tous ceux qui s’approchaient de lui. Pendant ses années d’étude, il se montra très attaché à la papauté ; il était un fils dévoué de l’Église de Rome et avait une foi entière dans la vertu des sacrements. Ainsi à l’époque du jubilé de Prague en 1393, il donna ses dernières pièces de monnaie au confesseur de l’église de Saint-Pierre. Comme les écrits de Wiclef étaient déjà répandus en Bohême, Huss, comme nous l’avons dit, en eut connaissance ; mais il ne lut d’abord que ses œuvres philosophiques qu’il étudia soigneusement.
Huss était entré dans les ordres, et se fit distinguer bientôt par ses remarquables capacités. Il fut revêtu successivement des grades universitaires : maître es arts, professeur à l’Université et enfin doyen de la faculté de philosophie. Sa renommée étant parvenue jusqu’à la cour du roi Wenceslas, la reine Sophie de Bavière le choisit pour son chapelain.
Jusqu’alors rien n’annonçait en Huss un réformateur, bien que sans doute il vît les abus de l’Église romaine et la corruption, non seulement des nobles et du peuple, mais aussi du clergé. Mais en 1402, il fut nommé prédicateur de la chapelle de Bethléem. C’était un édifice pouvant contenir 3000 personnes, élevé en 1392 par un riche citoyen de Prague, agréé par le roi et l’archevêque, et destiné uniquement par le fondateur à la prédication en langue bohème. Il disait : « Lorsque Christ apparut à ses disciples après sa résurrection, il leur donna commission de prêcher la parole de Dieu, de manière à conserver constamment sa mémoire vivante dans le monde ». Dès le moment où Huss commença à prêcher dans la chapelle de Bethléem, et qu’il eut à sonder davantage la parole de Dieu, un grand changement semble s’être opéré en lui, graduellement toutefois. On peut dire qu’il fut alors converti à Dieu. En même temps, Dieu appliquait la vérité à l’âme de ses auditeurs.
Selon un écrivain contemporain, la condition morale des habitants de Prague à cette époque, était la plus basse possible. « Le roi », dit-il, « les nobles, les prélats, le clergé, les citoyens, s’abandonnaient sans contrainte à l’avarice, à l’orgueil, à l’ivrognerie, à la débauche et à tous les vices. Au milieu de cette corruption Huss se leva, réveillant les consciences par sa parole. C’était tantôt contre les prélats, tantôt contre les nobles, puis contre le clergé inférieur, qu’il dirigeait ses coups ». Ainsi Dieu s’était suscité un champion pour combattre le mal et l’erreur. C’est alors aussi que Huss lut les écrits théologiques de Wiclef et qu’il les étudia sérieusement, admirant la piété de l’auteur et d’accord avec lui dans les réformes que celui-ci demandait. « Je suis attiré par ses écrits », disait-il, « car il s’y efforce avec énergie à ramener tous les hommes à la loi du Christ, et spécialement le clergé, invitant ce dernier à renoncer à la pompe mondaine et à vivre comme les apôtres et selon l’exemple de Christ ».
Huss était appelé à prêcher fréquemment dans la chapelle de Bethléem. Aux nombreux jours de fête de l’Église, il le faisait souvent deux fois dans la même journée, et toujours en langue vulgaire. Il devait ainsi étudier de plus près la parole de Dieu et creuser toujours plus profondément dans la mine inépuisable des vérités qu’elle renferme ; de cette manière il en acquérait une conception de plus en plus claire et croissait rapidement dans la connaissance des choses divines, en s’imprégnant de l’esprit de la Parole infaillible. Ce qu’il recevait ainsi intérieurement par la Parole et l’Esprit de Dieu, il le répandait au-dehors dans ses prédications qui exerçaient une puissante action sur ses auditeurs. Plusieurs étaient saisis par la vérité, d’autres s’y opposaient, ainsi qu’à celui qui l’annonçait. Mais Huss trouva dans l’archevêque et dans la reine des protecteurs, de sorte qu’en dépit de l’opposition de ses ennemis, il put continuer à prêcher, proclamant les vérités de la Sainte Écriture, et en appelant constamment à elle pour justifier ce qu’il disait. Autour de lui se formait et s’accroissait toute une communauté d’âmes pieuses qui avaient soif des eaux vives de la grâce et faim du pain de vie, qui est Christ. Huss était un vrai pasteur d’âmes, surtout pour les gens des classes les plus humbles qui venaient à lui avec une conscience troublée que l’absolution du prêtre ne soulageait pas. Il n’avait pas conscience du mouvement qui commençait par son moyen, et ignorait où il serait conduit. Il était entré, sans en avoir l’idée, dans la voie de la Réformation que Dieu opéra plus tard.
Un événement vint, vers ce temps-là, jeter dans les esprits à Prague des pensées propres à ébranler la foi en l’autorité du pape. Dans cette ville arrivèrent deux gradués d’Oxford, disciples de Wiclef, nommés James et Conrad de Canterbury. Ils tinrent des disputes publiques sur la doctrine de la primauté du pape. Les choses n’étaient guère mûres pour une tentative aussi hardie, et les autorités de la ville leur enjoignirent le silence. Mais ils savaient peindre aussi bien que parler, et leurs pinceaux se montrèrent pleins d’éloquence. Avec l’assentiment de leur hôte, ils peignirent dans le vestibule de la maison, d’un côté l’entrée du Seigneur à Jérusalem, « débonnaire et monté sur le poulain d’une ânesse », et de l’autre la magnificence plus que royale d’un cortège pontifical. On y voyait le pape portant la triple couronne, couvert de vêtements resplendissants d’or et brillants de pierres précieuses, monté sur un cheval richement caparaçonné, précédé de trompettes proclamant sa venue, et suivi d’un cortège nombreux de cardinaux et d’évêques splendidement vêtus.
Ces peintures parlaient aussi haut que des discours, et le contraste qu’elles présentaient frappait chaque spectateur. Toute la ville fut émue ; une grande excitation fut produite, et les visiteurs anglais trouvèrent prudent de s’éloigner. Mais ils avaient fait naître des pensées qu’aucune autorité n’avait le pouvoir d’étouffer. On peut cependant se demander si les consciences et les cœurs étaient atteints par de semblables attaques contre l’erreur et les abus, et si la prédication pure et simple de la vérité comme elle est en Jésus, n’était pas bien préférable pour atteindre ce but et détacher les âmes d’un système antichrétien en les amenant à jouir du salut et de la paix.
Huss fut un de ceux qui vinrent voir les peintures des deux Anglais. Il s’en retourna tranquillement et se mit à étudier de plus près les écrits de Wiclef. Il fut d’abord effrayé des choses hardies qui étaient présentées contre les superstitions, les abus et les mensonges de l’Église de Rome, mais il fut enfin convaincu.
Dieu avait donné à Huss pour le soutenir au milieu des luttes que bientôt il eut à rencontrer, un ami fidèle dans la personne de Jérôme de Faulfisch, plus connu sous le nom de Jérôme de Prague. Il était, comme nous l’avons dit, un des étudiants de Bohême qui étaient allés à Oxford, et là il avait été converti aux vérités de l’Évangile exposées par Wiclef. De retour dans son pays natal, il avait répandu les écrits du réformateur anglais, et, dans des discussions publiques, il avait soutenu les doctrines de la foi selon l’Écriture. Bientôt l’université de Prague fut partagée en deux camps ; les uns tenant pour les principes de Wiclef, les autres s’y opposant. L’attention des chefs de l’université fut éveillée, et en mai 1403, une réunion eut lieu pour examiner quarante-cinq propositions tirées, disait-on, des écrits de Wiclef. L’université était partagée en nations Bohême, Bavière, Saxe et Pologne chacune ayant une voix quand on votait sur quelque sujet. La Bavière, la Saxe et la moitié de la Pologne étant de langue allemande, pouvaient toujours avoir la majorité sur les Bohémiens. Dans le cas présent, le parti allemand l’emporta pour condamner les propositions de Wiclef, auxquelles plusieurs de ceux de Bohême étaient favorables. Il fut défendu sous peine du feu de les répandre et de les professer. Huss se contenta de nier que ces propositions se trouvassent dans Wiclef. Jusqu’alors Huss avait surtout attaqué dans ses prédications les désordres dans les mœurs de la cour, du peuple et du clergé, et insisté sur une réforme nécessaire à cet égard, en prêchant en même temps toujours plus clairement le salut gratuit par Jésus Christ.
Ce qui contribua surtout à ouvrir les yeux de Huss sur les impostures de Rome, fut le soi-disant miracle de Wilsnack. Dans cet endroit, situé en Prusse, dans la province de Brandebourg, se trouvaient les restes d’un ancien autel faisant partie d’une église détruite autrefois, sans doute dans quelque guerre. Vers l’an 1403, dans cet autel on découvrit trois des hosties qui servent à célébrer l’eucharistie dans l’Église romaine. Quand on les trouva elles étaient d’une couleur rougeâtre. Or nous savons que les catholiques romains disent que quand les hosties ont été consacrées par le prêtre, elles sont changées dans le corps et le sang du Seigneur, et qu’ainsi le corps et le sang du Seigneur sont dans l’hostie. Quand donc on vit ces hosties rouges, on crut que le sang de Christ était devenu visible, que les hosties étaient teintes du même sang qui coulait dans les veines du Seigneur quand il était sur la terre. Le bruit de ce fait se répandit. On dit que c’était un miracle que chacun pouvait venir contempler, et les foules accoururent. Le clergé de l’endroit encouragea la croyance à ce soi-disant miracle. Il y trouvait son profit, car Wilsnack devint un « lieu saint », où de toutes parts, de la Suède, de Norvège, de Hongrie, de Pologne et de toute la Bohême, on venait en pèlerinage avec de riches offrandes. Des miracles, disait-on, s’accomplissaient près de l’autel par la vertu des saintes hosties. Un fait montrera jusqu’où allait l’imposture de certains. Un citoyen de Prague qui avait une main estropiée, s’était fait faire une main en argent et l’avait suspendue dans l’église comme offrande votive en l’honneur des hosties sanglantes, ainsi qu’on les appelait. Il était resté quelques jours dans l’endroit, très probablement inconnu des prêtres, et en réalité pour mettre à l’épreuve leur honnêteté. Mais un jour il fut surpris d’apprendre que l’un d’entre eux avait déclaré publiquement que cette main en argent avait été offerte comme mémorial de la guérison miraculeuse de la main malade du donateur. Le pauvre homme ne put supporter cette fausseté ; il étendit devant tous sa main aussi malade que jamais, au grand déshonneur du prêtre, mais par là éclairé lui-même ainsi que plusieurs autres.
Les foules ne cessaient cependant pas d’accourir et de se prosterner autour des hosties sanglantes. L’archevêque de Prague Zbynek, qui au moins était un honnête homme, avait des doutes quant aux hosties et aux miracles qui s’opéraient dans ce lieu. Il nomma, pour examiner l’affaire, trois commissaires dont l’un était Huss. Après une minutieuse investigation, ils rapportèrent que les miracles n’avaient rien de réel, et que les hosties n’étaient pas teintes de sang. Elles ne devaient leur apparence rougeâtre qu’à la moisissure provenant de l’humidité où elles avaient été exposées. L’archevêque défendit dans tout son diocèse les pèlerinages à Wilsnack.
Jusqu’alors l’archevêque et Huss avaient été en bons termes, mais cette entente ne dura pas. Bien que Zbynek eût déclaré en 1405, qu’il n’y avait point d’hérésie en Bohême, quelques membres du clergé avaient été accusés d’être favorables aux principes de Wiclef, et l’archevêque les avait sommés de répondre à l’accusation. L’un d’entre eux, Nicolas de Welenowitz, fut jeté en prison, puis, ayant été relâché, il fut banni du diocèse. Huss prit en mains sa cause et écrivit à l’archevêque une lettre où il blâmait sa conduite. « Comment ! » disait-il, « des hommes souillés de sang, coupables de toutes sortes de crimes, marchent dans les rues avec impunité, tandis que d’humbles prêtres, qui font tous leurs efforts pour combattre et détruire le péché, qui accomplissent leurs devoirs sous votre direction ecclésiastique, qui, pleins de bonté, fuyant l’avarice, s’adonnent gratuitement au service de Dieu et à la proclamation de sa Parole, sont jetés dans les cachots comme hérétiques, et doivent subir l’exil pour avoir prêché l’Évangile ! » Un langage aussi courageux ne pouvait manquer de faire de l’archevêque Zbynek un ennemi de Huss et fournissait un prétexte pour accuser celui-ci d’être un partisan de Wiclef.
La lutte entre les partis qui existaient dans l’université de Prague n’avait point cessé. Le roi Wenceslas l’aggrava en rendant un édit qui donnait trois votes aux Bohémiens et un seul aux étrangers. Les Allemands résolurent, si le roi maintenait son édit, de quitter Prague. Le roi refusant de revenir sur ce qu’il avait décidé, un grand nombre de professeurs et d’étudiants se retirèrent. Cela amena la fondation de l’université de Leipzig. Huss qui avait approuvé la décision du roi, fut nommé recteur de l’université de Prague. Ce fut un grief de plus contre lui de la part de l’archevêque qui, par le départ des Allemands, voyait se fortifier le parti de la réforme. D’un autre côté, ceux qui avaient quitté Prague répandaient partout que Huss était entaché d’hérésie.
Comme nous l’avons vu, le concile de Pise avait déposé les deux papes Grégoire XII et Benoît XIII, et avait élu Alexandre V. L’archevêque de Prague qui d’abord avait tenu pour Grégoire XII, reconnut le nouveau pape et obtint de lui une bulle contre tous ceux qui, en Bohême, soutenaient les doctrines de Wiclef. De plus, la bulle défendait toute prédication dans les chapelles privées et condamnait au feu les écrits de Wiclef. C’était évidemment contre Huss que le coup était dirigé. Sur ces entrefaites, Alexandre V mourut, empoisonné, dit-on, par son ami Balthasar Cossa, qui lui succéda sous le nom de Jean XXIII. Huss fit vainement appel au nouveau pape, et l’archevêque résolut d’en finir et de mettre à exécution la bulle d’Alexandre V.
Il commença par ordonner que tous les écrits de Wiclef lui fussent livrés dans un délai de six jours pour être examinés. Mais sans l’avoir fait, il déclara son intention de les brûler et, le 16 juillet 1410, malgré l’opposition de l’université et sous prétexte que le roi n’avait pas défendu leur destruction, il fit brûler devant son palais environ deux cents volumes des écrits de Wiclef et d’autres réformateurs. C’étaient des manuscrits de prix, ornés de belles enluminures, et avec des couvertures très riches. Cette exécution causa une grande indignation, et plusieurs en prirent l’occasion pour tourner l’archevêque en ridicule. Il était fort ignorant et dut apprendre à lire, dit-on, lorsqu’il entra en charge. On fit des chansons qui couraient dans les rues de Prague :
Notre archevêque doit apprendre
Son A, B, C,
Afin qu’il puisse au moins comprendre
Ce qu’il a brûlé.
Le roi défendit sous peine de mort de les chanter. Huss n’était pour rien en cela ; il se contenta de dire : « C’est une pauvre chose de brûler des livres. Cela n’a jamais ôté un seul péché du cœur des hommes. Si celui qui a condamné ces livres ne peut rien prouver contre eux, il a seulement détruit quelques vérités, plusieurs belles pensées, et cela n’a servi qu’à multiplier parmi le peuple les troubles, les inimitiés, les soupçons et les meurtres ». En effet, chose triste à dire, le sang avait coulé dans ces dissensions.
Quant à la défense de prêcher dans la chapelle de Bethléem, Huss ne pensait pas devoir obéir. Il estimait qu’il était protégé par l’acte de fondation de la chapelle, mais surtout il pensait qu’il devait obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. Il disait : « Quelle autorité se trouve-t-il dans les saints écrits, ou sur quel fondement raisonnable peut-on se baser, pour défendre de prêcher dans un lieu si public et si convenable dans ce but, au milieu de la grande ville de Prague ? Au fond de tout cela il n’y a autre chose que la jalousie de l’Antichrist ». Huss comprenait et affirmait que l’appel divin à prêcher l’Évangile avait une autorité supérieure à n’importe quel appel de la part de l’homme. « Où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté ». Il continua donc ses prédications en laissant à Dieu les résultats.
Huss aurait désiré réformer les abus de l’Église de Rome à laquelle il était attaché et dont il ne se sépara jamais ouvertement ; mais comment faire au milieu de la confusion et des luttes qui régnaient dans l’Église ? Il avait à peser tout en présence de Dieu, et devait arriver, fortifié par Dieu, à prendre une résolution quant à ce qu’il avait à faire. Obéirait-il à Dieu pour autant qu’il avait compris sa volonté, et irait-il contre le courant, ou bien se laisserait-il aller avec le courant en évitant le mal autant qu’il le pourrait ?
Écoutons la conclusion à laquelle il arriva : « Afin de ne pas me rendre coupable par mon silence, abandonnant la vérité pour un morceau de pain ou par crainte des hommes, je déclare que mon dessein est de défendre même jusqu’à la mort la vérité que Dieu m’a rendu capable de connaître, et spécialement la vérité des saintes Écritures, puisque je sais que la vérité demeure, qu’elle est puissante à jamais, qu’elle subsiste éternellement, et qu’avec elle il n’y a point d’acception de personnes ». Noble résolution ! Au milieu des ténèbres qui alors couvraient l’Église, être déterminé à rester du côté de la lumière qui l’amènerait en collision avec les ténèbres et les puissances des ténèbres, c’était un vrai courage. Dieu seul pouvait l’inspirer à son fidèle témoin.
Nous avons vu que Huss en avait appelé au pape ; l’archevêque avait fait de même et fut écouté par le pape qui nomma le cardinal Othon di Colonna pour examiner le cas de Huss. Le cardinal somma Huss de comparaître à Bologne où se trouvait alors le pape. Là, le réformateur ne pouvait s’attendre qu’à une condamnation. La reine Sophie prit en main la cause de son confesseur, et le roi écrivit au pape et au cardinal en faveur de Huss, exprimant aussi sa volonté « que la chapelle de Bethléem à qui, disait-il, pour la gloire de Dieu et le salut du peuple, nous avons accordé des franchises pour la prédication de l’Évangile, subsiste, et soit confirmée dans ses privilèges… et que notre loyal, dévoué et bien-aimé Huss soit établi sur cette chapelle, et prêche en paix la parole de Dieu ». Le roi demanda aussi que Huss fût excusé de ne pas se rendre à Bologne.
Sur ces entrefaites, Colonna avait prononcé l’excommunication contre Huss pour n’avoir pas obéi à sa sommation, mais le pape, se rendant à la lettre du roi, ôta l’affaire à Colonna et nomma un autre commissaire. Cependant l’archevêque fit tous ses efforts pour persuader au pape de faire comparaître Huss devant lui, et lui envoya, ainsi qu’aux cardinaux, de riches présents. Le pape nomma alors le cardinal Brancas qui, sans l’avoir entendu, déclara Huss hérésiarque, c’est-à-dire chef d’hérétiques, et plaça sous l’interdit la ville de Prague où Huss résidait. L’archevêque triomphait, et, par ses ordres, le clergé se mit à fermer les églises (*). Mais ici encore le roi intervint et confisqua les biens du clergé qui voulait maintenir l’interdit. Le peuple aussi se souleva contre les prêtres.
(*) Dans toute ville placée sous l’interdit aucun service religieux ne pouvait être célébré.
Huss cependant, profitant de ce conflit, continua tranquillement son œuvre, laissant le roi s’arranger avec l’archevêque et le cardinal. Combien tout cela est remarquable et comme l’on peut y voir la main de Dieu qui s’étendait sur son serviteur pour le garder en se servant des passions des hommes. Car le roi au fond ne se souciait pas de la vérité, et était en réalité un très méchant homme, que ses sujets emprisonnèrent deux fois pour ses crimes. Le roi et l’archevêque en vinrent à un compromis. L’archevêque leva l’interdit et écrivit au pape qu’il n’y avait point d’hérésie en Bohême, et de son côté, le roi fit relâcher les ecclésiastiques qu’il gardait en prison et leur rendit leurs biens. La paix fut ainsi rétablie en quelque mesure. L’archevêque Zbynek quitta la Bohême en septembre 1411, et mourut peu de temps après.
Le pape Jean XXIII (*) avait envoyé en Bohême un légat pour recruter des partisans contre ses adversaires. Le légat demanda au nouvel archevêque Albic de faire comparaître Huss devant lui. Il demanda tout d’abord au réformateur s’il voulait obéir aux commandements apostoliques. « Certainement », dit Huss, « et de tout mon cœur ». Le légat, se tournant vers l’archevêque, lui dit : « Vous le voyez : le maître est tout prêt à obéir aux commandements apostoliques ». Mais Huss s’apercevant qu’on l’avait mal compris, dit : « Entendez-moi bien, monseigneur. J’ai dit que j’étais prêt à obéir de tout mon cœur aux commandements apostoliques ; mais j’appelle ainsi les doctrines des apôtres de Christ, et pour autant que les commandements du pape s’accordent avec elles, je m’y soumettrai très volontiers. Mais si je vois en eux quelque chose qui s’écarte de l’enseignement des apôtres, je ne leur obéirai pas, dussé-je voir le bûcher dressé devant moi ». Le légat n’insista pas ; il avait d’autres affaires et Huss échappa pour le moment.
(*) Voir plus haut. Ce Jean XXIII est considéré aujourd’hui comme illégitime — un antipape.
Page 3 sur 6 •  1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5, 6 
 Sujets similaires
Sujets similaires» HISTOIRE DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE
» L'histoire et la croyance de l'église de Scientologie
» L'HISTOIRE DE L'EGLISE UNIVERSELLE DU ROYAUME DE DIEU DANS LE MONDE ET SON ARRIVÉE EN CÔTE D'IVOIRE
» La réincarnation
» Jézabel = l'église catholique romaine, NON, Jésabel symbolise l'influence féminine dans la vraie église
» L'histoire et la croyance de l'église de Scientologie
» L'HISTOIRE DE L'EGLISE UNIVERSELLE DU ROYAUME DE DIEU DANS LE MONDE ET SON ARRIVÉE EN CÔTE D'IVOIRE
» La réincarnation
» Jézabel = l'église catholique romaine, NON, Jésabel symbolise l'influence féminine dans la vraie église
Forum Religion : Le Forum des Religions Pluriel :: ○ Enseignement :: Chrétienté :: L'Église Catholique
Page 3 sur 6
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum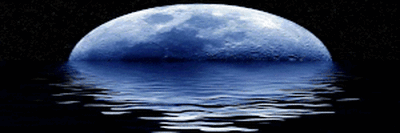
 S'enregistrer
S'enregistrer

