Sexe et Religion
2 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2 
 Sexe et Religion
Sexe et Religion
Sexe et Religion
Taoïsme
[ltr]Jouissance, volupté et longévité[/ltr]
La gestion de la sexualité dans le taoïsme passe par une régulation des forces yin et yang entre partenaires masculin et féminin. Son but : favoriser l’équilibre interne de chacun, afin de régénérer sa vitalité.
Depuis l’Antiquité, deux sources nourrissent la Chine sédentaire : le confucianisme et le taoïsme. Le premier considère la vie en société comme essentielle et place la vertu d’humanité au sommet de ses préoccupations ; le second, plus intime, se donne la joie de vivre le plus possible comme objectif primordial. À la base de ces deux enseignements, se trouve l’idée qu’à chaque être vivant est attribué à sa naissance un lot, une durée de vie. Cette sorte de capital « énergétique » se manifeste extérieurement par une place dans sa famille et dans la société ; et intérieurement par une incarnation physique, une santé spécifique.
Un exercice sérieux, total
Si le confucianisme va se porter sur la gestion sociale de ce capital de départ, le taoïsme lui va chercher à le développer au niveau personnel. C’est pourquoi tous les arts physiques chinois se sont épanouis sous son obédience. Tous, en effet, ont le même objectif : yang sheng ; littéralement, « nourrir le vivre », qui ne connaît ni début ni fin, un trésor dont chacun des 10 000 êtres vivants porte une parcelle en lui. Seul l’être humain, qu’aucune destinée religieuse ne différencie des autres créatures vivantes, a une particularité spécifique : la conscience qu’il a de cette réalité, et donc la possibilité d’agir sur ce capital reçu à la naissance, en le diminuant par une conduite dissolue ou en le renforçant par une conduite appropriée. C’est dans ce cadre que se construit la vision taoïste de la sexualité.
Tout ce qui existe résulte d’un entrecroisement du yin et du yang - ces composants déterminent pour chaque être des propensions spécifiques. L’éclair, par exemple, violent et intense, est bien plus chargé de yang que la montagne ; il lui manque la durable stabilité. La montagne, de son côté, a besoin de la pluie féconde que l’éclair déclenche pour se couvrir de verdure. Il en est de même pour les humains en général, et pour leur comportement sexuel en particulier. La manifestation masculine de la sexualité sera plus yang, extérieure, rapide, superficielle ; et sa forme féminine plus yin, intérieure, lente et profonde. Mais le yin et le yang ne sont pas l’homme et la femme, ce ne sont que des essences, des fluides dont chaque sexe est porteur. C’est pourquoi leur réunion est favorable à cet échange, mais à la double condition que cet échange se produise et qu’alors il soit régulé. La sexualité devient un exercice sérieux, total, mobilisant tout ce que nous sommes pour une régulation et une augmentation de la vitalité.
Pour cela, la jouissance de chacun des partenaires est essentielle. Mais pour qu’elle ait lieu, il faut que soit prise en compte la différence avec laquelle chacun y parvient. La jouissance masculine est yang, simple, directe, « mécanique » ; la jouissance féminine est yin, plus profonde, plus mystérieuse. Le premier enseignement de la sexualité taoïste est que l’homme doit provoquer la jouissance de sa partenaire s’il veut bénéficier des bienfaits du « Tao de l’art d’aimer ».
Stratégies et bienfaits
On comprend mieux alors pourquoi les enseignements de la sexualité taoïste s’adressent majoritairement aux hommes : parce que la régulation de la sexualité est un domaine où les hommes ont beaucoup plus à apprendre que les femmes. Cela ne tient à aucun primat du yang, mais simplement à la conjonction de deux faits : tous les êtres vivants, qu’ils soient hommes ou femmes, parce qu’ils sont vivants, chauds, mobiles, sont naturellement du côté du yang et, pour des raisons bien plus culturelles que naturelles, les hommes sont plus réceptifs aux conduites yang et les femmes aux conduites yin. La sagesse chinoise en a tiré une conclusion efficace, trop souvent négligée tant par les Occidentaux que par les Chinois : la stratégie yang, naturelle chez tous les vivants, n’a pas besoin d’être cultivée. C’est la stratégie yin, moins « évidente » mais plus efficace, qui doit être mise en œuvre résolument, car elle est source de multiples bienfaits.
La « voie de la souplesse »
Cette prise de position, qui est également à la base du judo - dit la « voie de la souplesse » ou la « voie du yin » -, fonde la gestion taoïste de la sexualité, dans une optique de régénération de la vitalité. Celle-ci est exposée dans le Su Nu Jing, littéralement le Classique de la fille de candeur. Cet ouvrage fondateur se présente sous la forme d’un dialogue entre Huang Di, l’Empereur jaune - personnage mythologique à l’origine de la nation chinoise et au cœur de la tradition taoïste - avec Su Nu, littéralement la « fille de candeur », son instructrice dans l’art d’utiliser la sexualité bien tempérée pour atteindre la longévité. De ce vieux classique, Jolan Chang, un taoïste chinois, a tiré une adaptation moderne : Le Tao de l’art d’aimer (Calmann-Lévy, 1994), un ouvrage que tout homme découvre toujours trop tard et qui devrait être glissé sur la table de nuit des jeunes adolescents, afin de découvrir la sexualité sous un jour moins angoissant. Son idée de base est la dissociation entre jouissance et éjaculation : pour que l’échange des essences yin et yang se fasse, l’orgasme des deux partenaires est nécessaire ; mais pour qu’il soit énergétiquement vivifiant, il faut qu’ils y parviennent sans qu’il y ait éjaculation.
Une « habitude néfaste »
La femme doit pour cela développer en elle sa composante yang pour émettre son essence yin vers l’homme qui, de son côté, doit privilégier sa composante yin pour la recevoir. Chacun a besoin de la jouissance de l’autre pour augmenter son harmonie interne. Jolan Chang le spécifie bien : « C’est par habitude que nous qualifions l’éjaculation de point suprême du plaisir masculin, habitude néfaste, dans laquelle les puritanismes ont enraciné le sentiment tragique qui encombre la sexualité occidentale. à la “petite mort”, le taoïsme oppose la grande vie cosmique que la maîtrise de l’éjaculation permet à chacun d’approcher. On lit en effet dans le Su Nu Jing : “On croit en général que l’homme tire un grand plaisir de l’éjaculation. Mais lorsqu’il apprendra l’art taoïste d’aimer, il éjaculera de moins en moins. Son plaisir n’en diminuera-t-il pas ?” À quoi son interlocuteur répond : “Absolument pas. Après l’éjaculation, l’homme est fatigué, ses oreilles bourdonnent, ses yeux sont alourdis et il aspire au sommeil. Il a soif et ses membres sont inertes et ankylosés. Pendant l’éjaculation, il éprouve un bref instant de joie, mais il en résulte ensuite de longues heures de lassitude. Ce n’est pas vraiment de la volupté. Si au contraire, l’homme réduit et contrôle son éjaculation, son corps en sera fortifié, son esprit s’en trouvera ragaillardi, son ouïe plus fine et sa vue plus perçante. En maîtrisant la sensation que lui procure l’éjaculation, l’amour qu’il éprouve pour la femme grandit. C’est comme s’il ne pouvait la posséder en suffisance. Comment peut-on dire que ceci n’est pas une infinie volupté ?” »
 Re: Sexe et Religion
Re: Sexe et Religion
Antiquité
[ltr]Quand la prostitution était sacrée[/ltr]
Dans les civilisations antiques, plaisir sexuel et sentiment religieux vont souvent de pair : les textes anciens évoquent les hiéroglyphes, des femmes aux mœurs libres œuvrant dans les temples. Une tradition condamnée par la Bible hébraïque.
Quelle ne fut pas la surprise des Anglais, au XVIIIe siècle, lorsqu'ils découvrirent l'existence, dans les temples hindous de l'Inde, d'une prostitution à caractère sacré : les servantes des dieux (dévadâsî) appartenaient à un époux divin qu'elles étaient tenues de divertir par leurs talents artistiques (chants, danses) et, pour que la jouissance soit parfaite, de combler charnellement. Mais leur divin mari étant par nature absent, c'était à ses invités qu'elles devaient offrir un avant-goût des plaisirs qui les attendaient dans l'au-delà, après la mort. Cette pratique perdura jusqu'à la fin du XIXe siècle. Non-exclusive au monde indien, on la trouve mentionnée dès la plus Haute-Antiquité dans d'autres civilisations, et en particulier dans le Proche-Orient ancien, où elle semble trouver sa lointaine origine.
C'est ainsi qu'Hérodote, au Ve siècle avant notre ère, évoque dans son Enquête (I, 199), « la plus honteuse coutume des Babyloniens. Il faut que chaque femme du pays, une fois dans sa vie, s'unisse à un homme étranger dans le temple d'Aphrodite (...). Lorsqu'une femme est assise là, elle doit attendre pour retourner chez elle qu'un étranger lui ait jetée de l'argent sur les genoux et se soit uni à elle à l'intérieur du temple (...). Lorsqu'elle s'est unie à l'homme, elle a acquitté son devoir à l'égard de la déesse et peut revenir chez elle ». Si cette coutume - dont l'historien grec a toutefois largement exagéré l'importance - est « honteuse » à ses yeux, c'est peut-être qu'il en ignorait les tenants et les aboutissants.
L'art de l'amour charnel
En effet, pour les Mésopotamiens - qui occupaient l'Irak actuel et dont la culture a rayonné dans tout le Proche-Orient antique, en particulier grâce à l'aura de la mythique Babylone -, rien de plus naturel que la sexualité, sur laquelle ils portaient un regard décomplexé, pour ne pas dire laudatif. Dans la célèbre Épopée de Gilgamesh, n'est-ce pas une prostituée, bien nommée Lajoyeuse (1), qui va civiliser l'un des protagonistes, le faisant passer de l'état de bête à celui d'homme par son art de l'amour ? Et puisque les Mésopotamiens ne concevaient pas leurs dieux autrement que comme des hommes « au superlatif », selon l'historien Jean Bottéro, ils les imaginaient très spontanément s'adonnant à une sexualité pas toujours sage...
La mythologie des Sumériens, qui furent parmi les premiers habitants de la Mésopotamie, relate notamment que le dieu Enlil, l'une des divinités suprêmes du panthéon, poursuivit de ses assiduités la jeune déesse Ninlil, la viola et la mit enceinte. Puni par l'assemblée des dieux, Enlil ne se priva pourtant pas de recommencer. Et que penser des amours de la déesse Inanna - plus tard appelée Ishtar puis rattachée à cette Aphrodite mentionnée par Hérodote ? Divinité féminine la plus importante en Mésopotamie, elle règne sur l'amour - mais que l'on se garde d'imaginer là un sentiment platonique : c'est bien l'amour physique, éminemment charnel et passionnel qu'elle régente. Elle-même est une déesse torride, insatiable dans ses ébats, n'hésitant pas à harceler sexuellement mortels et immortels, au travers de propos pour le moins explicites : « Quant à moi, à ma vulve, tertre rebondi, moi, jouvencelle, qui me labourera ? Ma vulve, ce terrain humide que je suis, moi, reine, qui y mettra ses bœufs (de labour) ? (...) Laboure-moi donc la vulve, ô homme de mon cœur ! »
Il n'est pas étonnant, dès lors, de relever l'existence de prières adressées par des hommes ou des femmes à la sensuelle déesse, dans le but de parvenir à leurs fins. Savoureuses par leur langage cru, elles montrent aussi qu'à cette époque, plaisir sexuel et sentiment religieux n'avaient rien d'antinomique : « Prends-moi ! N'aie pas peur ! Bande sans crainte ! Par ordre d'Ishtar, de Shamash, d'Ea et d'Asalluhi [d'autres dieux du panthéon] ! Cette recette n'est pas de moi : c'est celle-là même d'Ishtar, déesse de l'amour ! On recueillera quelques poils arrachés à un bouc en rut, un peu de son sperme (...) ; on amalgamera le tout ensemble pour le fixer aux lombes de l'amant, après avoir récité sept fois, par-dessus, la susdite prière. »Des multiples histoires d'amour d'Ishtar, la littérature mésopotamienne a surtout retenu celle qu'elle vécut avec Dumuzi (nommé Tammuz aux époques plus tardives), héros qui accéda au rang divin. Les textes révèlent une jeune déesse totalement subjuguée par son amant, constamment dans l'attente de l'étreinte ardente qui les unira.
Mariage sacré et fertilité
Cette folle passion a inspiré un rite religieux particulièrement important aux IIIe et IIe millénaires avant notre ère : le mariage sacré, dit hiérogamie. Censé mimer les amours d'Ishtar et de Dumuzi, il avait apparemment lieu - du moins aux époques les plus anciennes - lors de la fête du Nouvel An : le roi avait alors pour mission d'épouser la belle Inanna-Ishtar, incarnée ici-bas par sa représentante humaine. Les épousailles se concrétisaient par une véritable union sexuelle, célébrée ensuite dans la liesse populaire par un banquet, de la musique et des chants. La rencontre charnelle entre le roi et la déesse de l'amour était censée apporter fertilité au peuple et au pays. S'il était gage de récoltes abondantes, le mariage sacré témoignait aussi de l'approbation du pouvoir du roi par les dieux, ce que confirme un poème, La Bénédiction de Shulgi, un souverain de la fin du IIIe millénaire : « Lorsque le seigneur, le pasteur Dumuzi, couché près de [moi], la sainte Inanna, aura pétri mon sein laiteux et succulent, lorsqu'il aura porté la main sur ma sainte vulve (...). Lorsque, pareil à son bateau élancé, il y aura porté la vie, lorsqu'il m'aura caressée sur le lit : alors, je le caresserai et lui décréterai une destinée heureuse ! »
Une infidélité au Dieu d'Israël
On peut se demander qui, au moment de la cérémonie, assumait le rôle d'Ishtar. D'aucuns estiment qu'il s'agissait de la reine ; mais d'autres historiens penchent plutôt en faveur d'une prostituée sacrée, la hiérodule. Plusieurs documents font allusion à des pratiques sexuelles dans les temples - notamment un qui mentionne une prêtresse pratiquant la s........ pour éviter de tomber enceinte - et le vocabulaire relatif à la prostitution, cité dans Le Code de lois du roi Hammourabi de Babylone (XVIIIe siècle avant notre ère), est très riche : le terme kulmashitu ou qadishtu, en particulier, semble faire référence à des femmes aux mœurs libres œuvrant dans des temples.
Plus tard, la Bible, qui a pris naissance sur ces terres baignées de l'antique culture babylonienne, évoquera à son tour le phénomène de la prostitution sacrée. Ainsi, en Deutéronome 23, 18 : « Il n'y aura pas de prostituée sacrée parmi les filles d'Israël, ni de prostitué sacré parmi les fils d'Israël », ou en 2 Rois 23, 7, qui raconte comment le roi Josias « démolit les maisons des prostitués sacrés, qui étaient dans le temple de Yahvé et où les femmes tissaient des voiles pour Ashéra [une déesse] ». Faisant référence aux prostituées du temple de Samarie, Michée (2, 7) promet la colère de Yahvé. Mais la femme d'Osée est cependant une prostituée des cultes cananéens de fécondité, que le prophète a épousée sur ordre de Yahvé, car, dit-il,« le pays ne fait que se prostituer en se détournant de [moi] » (Osée 1, 2). La métaphore est ici particulièrement claire : la prostitution est assimilée à l'infidélité pure et simple envers le Dieu d'Israël. L'anathème le plus fort est jeté sur cette pratique.
La rédemption salvatrice
Et pourtant... Ne peut-on pas trouver, dans Le Cantique des Cantiques, d'étranges résonances entre ce magnifique chant d'amour et ceux qui sont entonnés par les hiérodules lors du mariage sacré : « Embrasse-moi à pleine bouche : tes caresses sont bien meilleures que le vin, (...) ta personne est un parfum qui embaume : les jeunes femmes sont folles de toi ! Entraîne-moi à ta suite : courons ! Le roi m'a introduite en sa chambre : folâtrons, jouissons de toi ! Ah, que l'on a raison de t'aimer ! » (1, 2-4) ? Il est vrai que l'exégèse biblique a interprété ce poème comme une métaphore de l'amour de Dieu envers son peuple. Un amour indéfectible, si l'on en croit le Nouveau Testament : né d'une vierge, Jésus aurait pu éprouver un mépris total envers les femmes faisant commerce de leur corps. Mais d'expliquer au contraire que « les publicains et les prostituées arrivent avant vous [les pharisiens qui observent scrupuleusement la Loi] au Royaume de Dieu » (Matthieu, 21, 31). Pécheresse suprême, la femme de mauvaise vie peut, à condition de se repentir, faire partie des élus. C'est d'ailleurs à Marie-Madeleine, prostituée consolée par sa foi, que Jésus ressuscité apparaît en premier lieu. La Madeleine et le Christ, ou l'ultime association entre la prostitution et le sacré ?
(1) Les traductions des langues de la Mésopotamie (sumérien et akkadien), des textes mythologiques et du Cantique des Cantiques sont empruntées à Jean Bottéro.
[ltr]Quand la prostitution était sacrée[/ltr]
Dans les civilisations antiques, plaisir sexuel et sentiment religieux vont souvent de pair : les textes anciens évoquent les hiéroglyphes, des femmes aux mœurs libres œuvrant dans les temples. Une tradition condamnée par la Bible hébraïque.
Quelle ne fut pas la surprise des Anglais, au XVIIIe siècle, lorsqu'ils découvrirent l'existence, dans les temples hindous de l'Inde, d'une prostitution à caractère sacré : les servantes des dieux (dévadâsî) appartenaient à un époux divin qu'elles étaient tenues de divertir par leurs talents artistiques (chants, danses) et, pour que la jouissance soit parfaite, de combler charnellement. Mais leur divin mari étant par nature absent, c'était à ses invités qu'elles devaient offrir un avant-goût des plaisirs qui les attendaient dans l'au-delà, après la mort. Cette pratique perdura jusqu'à la fin du XIXe siècle. Non-exclusive au monde indien, on la trouve mentionnée dès la plus Haute-Antiquité dans d'autres civilisations, et en particulier dans le Proche-Orient ancien, où elle semble trouver sa lointaine origine.
C'est ainsi qu'Hérodote, au Ve siècle avant notre ère, évoque dans son Enquête (I, 199), « la plus honteuse coutume des Babyloniens. Il faut que chaque femme du pays, une fois dans sa vie, s'unisse à un homme étranger dans le temple d'Aphrodite (...). Lorsqu'une femme est assise là, elle doit attendre pour retourner chez elle qu'un étranger lui ait jetée de l'argent sur les genoux et se soit uni à elle à l'intérieur du temple (...). Lorsqu'elle s'est unie à l'homme, elle a acquitté son devoir à l'égard de la déesse et peut revenir chez elle ». Si cette coutume - dont l'historien grec a toutefois largement exagéré l'importance - est « honteuse » à ses yeux, c'est peut-être qu'il en ignorait les tenants et les aboutissants.
L'art de l'amour charnel
En effet, pour les Mésopotamiens - qui occupaient l'Irak actuel et dont la culture a rayonné dans tout le Proche-Orient antique, en particulier grâce à l'aura de la mythique Babylone -, rien de plus naturel que la sexualité, sur laquelle ils portaient un regard décomplexé, pour ne pas dire laudatif. Dans la célèbre Épopée de Gilgamesh, n'est-ce pas une prostituée, bien nommée Lajoyeuse (1), qui va civiliser l'un des protagonistes, le faisant passer de l'état de bête à celui d'homme par son art de l'amour ? Et puisque les Mésopotamiens ne concevaient pas leurs dieux autrement que comme des hommes « au superlatif », selon l'historien Jean Bottéro, ils les imaginaient très spontanément s'adonnant à une sexualité pas toujours sage...
La mythologie des Sumériens, qui furent parmi les premiers habitants de la Mésopotamie, relate notamment que le dieu Enlil, l'une des divinités suprêmes du panthéon, poursuivit de ses assiduités la jeune déesse Ninlil, la viola et la mit enceinte. Puni par l'assemblée des dieux, Enlil ne se priva pourtant pas de recommencer. Et que penser des amours de la déesse Inanna - plus tard appelée Ishtar puis rattachée à cette Aphrodite mentionnée par Hérodote ? Divinité féminine la plus importante en Mésopotamie, elle règne sur l'amour - mais que l'on se garde d'imaginer là un sentiment platonique : c'est bien l'amour physique, éminemment charnel et passionnel qu'elle régente. Elle-même est une déesse torride, insatiable dans ses ébats, n'hésitant pas à harceler sexuellement mortels et immortels, au travers de propos pour le moins explicites : « Quant à moi, à ma vulve, tertre rebondi, moi, jouvencelle, qui me labourera ? Ma vulve, ce terrain humide que je suis, moi, reine, qui y mettra ses bœufs (de labour) ? (...) Laboure-moi donc la vulve, ô homme de mon cœur ! »
Il n'est pas étonnant, dès lors, de relever l'existence de prières adressées par des hommes ou des femmes à la sensuelle déesse, dans le but de parvenir à leurs fins. Savoureuses par leur langage cru, elles montrent aussi qu'à cette époque, plaisir sexuel et sentiment religieux n'avaient rien d'antinomique : « Prends-moi ! N'aie pas peur ! Bande sans crainte ! Par ordre d'Ishtar, de Shamash, d'Ea et d'Asalluhi [d'autres dieux du panthéon] ! Cette recette n'est pas de moi : c'est celle-là même d'Ishtar, déesse de l'amour ! On recueillera quelques poils arrachés à un bouc en rut, un peu de son sperme (...) ; on amalgamera le tout ensemble pour le fixer aux lombes de l'amant, après avoir récité sept fois, par-dessus, la susdite prière. »Des multiples histoires d'amour d'Ishtar, la littérature mésopotamienne a surtout retenu celle qu'elle vécut avec Dumuzi (nommé Tammuz aux époques plus tardives), héros qui accéda au rang divin. Les textes révèlent une jeune déesse totalement subjuguée par son amant, constamment dans l'attente de l'étreinte ardente qui les unira.
Mariage sacré et fertilité
Cette folle passion a inspiré un rite religieux particulièrement important aux IIIe et IIe millénaires avant notre ère : le mariage sacré, dit hiérogamie. Censé mimer les amours d'Ishtar et de Dumuzi, il avait apparemment lieu - du moins aux époques les plus anciennes - lors de la fête du Nouvel An : le roi avait alors pour mission d'épouser la belle Inanna-Ishtar, incarnée ici-bas par sa représentante humaine. Les épousailles se concrétisaient par une véritable union sexuelle, célébrée ensuite dans la liesse populaire par un banquet, de la musique et des chants. La rencontre charnelle entre le roi et la déesse de l'amour était censée apporter fertilité au peuple et au pays. S'il était gage de récoltes abondantes, le mariage sacré témoignait aussi de l'approbation du pouvoir du roi par les dieux, ce que confirme un poème, La Bénédiction de Shulgi, un souverain de la fin du IIIe millénaire : « Lorsque le seigneur, le pasteur Dumuzi, couché près de [moi], la sainte Inanna, aura pétri mon sein laiteux et succulent, lorsqu'il aura porté la main sur ma sainte vulve (...). Lorsque, pareil à son bateau élancé, il y aura porté la vie, lorsqu'il m'aura caressée sur le lit : alors, je le caresserai et lui décréterai une destinée heureuse ! »
Une infidélité au Dieu d'Israël
On peut se demander qui, au moment de la cérémonie, assumait le rôle d'Ishtar. D'aucuns estiment qu'il s'agissait de la reine ; mais d'autres historiens penchent plutôt en faveur d'une prostituée sacrée, la hiérodule. Plusieurs documents font allusion à des pratiques sexuelles dans les temples - notamment un qui mentionne une prêtresse pratiquant la s........ pour éviter de tomber enceinte - et le vocabulaire relatif à la prostitution, cité dans Le Code de lois du roi Hammourabi de Babylone (XVIIIe siècle avant notre ère), est très riche : le terme kulmashitu ou qadishtu, en particulier, semble faire référence à des femmes aux mœurs libres œuvrant dans des temples.
Plus tard, la Bible, qui a pris naissance sur ces terres baignées de l'antique culture babylonienne, évoquera à son tour le phénomène de la prostitution sacrée. Ainsi, en Deutéronome 23, 18 : « Il n'y aura pas de prostituée sacrée parmi les filles d'Israël, ni de prostitué sacré parmi les fils d'Israël », ou en 2 Rois 23, 7, qui raconte comment le roi Josias « démolit les maisons des prostitués sacrés, qui étaient dans le temple de Yahvé et où les femmes tissaient des voiles pour Ashéra [une déesse] ». Faisant référence aux prostituées du temple de Samarie, Michée (2, 7) promet la colère de Yahvé. Mais la femme d'Osée est cependant une prostituée des cultes cananéens de fécondité, que le prophète a épousée sur ordre de Yahvé, car, dit-il,« le pays ne fait que se prostituer en se détournant de [moi] » (Osée 1, 2). La métaphore est ici particulièrement claire : la prostitution est assimilée à l'infidélité pure et simple envers le Dieu d'Israël. L'anathème le plus fort est jeté sur cette pratique.
La rédemption salvatrice
Et pourtant... Ne peut-on pas trouver, dans Le Cantique des Cantiques, d'étranges résonances entre ce magnifique chant d'amour et ceux qui sont entonnés par les hiérodules lors du mariage sacré : « Embrasse-moi à pleine bouche : tes caresses sont bien meilleures que le vin, (...) ta personne est un parfum qui embaume : les jeunes femmes sont folles de toi ! Entraîne-moi à ta suite : courons ! Le roi m'a introduite en sa chambre : folâtrons, jouissons de toi ! Ah, que l'on a raison de t'aimer ! » (1, 2-4) ? Il est vrai que l'exégèse biblique a interprété ce poème comme une métaphore de l'amour de Dieu envers son peuple. Un amour indéfectible, si l'on en croit le Nouveau Testament : né d'une vierge, Jésus aurait pu éprouver un mépris total envers les femmes faisant commerce de leur corps. Mais d'expliquer au contraire que « les publicains et les prostituées arrivent avant vous [les pharisiens qui observent scrupuleusement la Loi] au Royaume de Dieu » (Matthieu, 21, 31). Pécheresse suprême, la femme de mauvaise vie peut, à condition de se repentir, faire partie des élus. C'est d'ailleurs à Marie-Madeleine, prostituée consolée par sa foi, que Jésus ressuscité apparaît en premier lieu. La Madeleine et le Christ, ou l'ultime association entre la prostitution et le sacré ?
(1) Les traductions des langues de la Mésopotamie (sumérien et akkadien), des textes mythologiques et du Cantique des Cantiques sont empruntées à Jean Bottéro.
 Re: Sexe et Religion
Re: Sexe et Religion
Le sexe et les religions
[ltr]L'obsession de la virginité[/ltr]
Dans les traditions religieuses, des déesses mères à Marie, la femme sacrée est vouée à une virginité éternelle. Aujourd'hui, si toutes les religions prescrivent la chasteté pré-maritale, c'est chez les musulmans et les évangélistes que cette quête de pureté est la plus exaltée.
Aussi loin que l'on remonte dans le temps, les déesses vierges ont toujours existé. C'est sous cet aspect que, de l'Inde à la Méditerranée, incarnant toutes les formes de fécondité, elles acquirent une influence dominante. Lorsque s'affirma le rôle du mâle dans la génération, des époux leur furent adjoints, mais qui n'étaient que leurs serviteurs. Régnant sur la nature entière, ces déesses conservèrent leur aspect à la fois maternel et virginal. Ainsi, Ishtar, Astarté et Anat, divinités de la fertilité et de l'amour du Proche-Orient sont-elles qualifiées de vierges, bien que ces Grandes Mères (Magna Mater) aient toutes des amants et un ou plusieurs fils. Dans ce cas précis, « être vierge » n'est pas synonyme de chasteté, mais désigne une femme qui n'est pas mariée ; être vierge dans le monde ancien se rapporte donc à une qualité. Mais pas seulement : c'est aussi une attitude psychologique et un état subjectif. Ainsi, en dépit d'une sexualité vivante et plurielle et de grossesses successives, ces déesses demeurent-elles vierges. Inscrites dans un système matriarcal, elles sont avant tout maîtresses d'elles-mêmes, donc libres de refuser ou d'accepter les demandes des hommes. Un aspect singulier, très éloigné de la tradition chrétienne, qui a pourtant survécu occasionnellement : Élisabeth Ière, surnommée la « reine vierge », collectionna les favoris. Mais l'acception du terme laisse entendre, ici, qu'aucun homme jamais ne la posséda (ou ne la déposséda d'elle-même).
Un pouvoir quasi magique
Pour Esther Harding, psychologue jungienne, la déesse mère vierge « est une par essence, elle n'est pas la simple réplique féminine d'un dieu mâle, elle possède son caractère propre, elle est l'ancienne et l'éternelle, la mère de Dieu ; le dieu qui lui est associé est son fils, elle le précède nécessairement. Elle possède sa divinité de plein droit ». Ainsi, Neith l'Égyptienne, créatrice de sa propre existence, qui se suffit à elle-même et qui engendre le dieu soleil Rê, sans partenaire mâle.
On retrouve cet état virginal dans les divinités et figures mythologiques guerrières (ou chasseresses) de l'Antiquité, comme Artémis, vouée à une virginité éternelle - elle rejette quant à elle tout contact amoureux -, Hippolythe, la reine des Amazones, Athéna ou encore Neith, armée de son bouclier et de ses flèches. La chasteté sacrée est ici le symbole de leur autonomie, elle n'a pas de connotation morale. Si ces déesses repoussent les hommes, c'est aussi pour conserver leur puissance extérieure et intérieure. Car la virginité présente un autre avantage pour le monde classique - dont héritera la chrétienté : elle confère un pouvoir quasi magique, celui de la force et de la pureté rituelle. Voilà pourquoi Héra, épouse de Zeus, mère de famille et divinité protectrice des femmes, se baignait chaque année dans la fontaine de Kanathos, afin de retrouver son pucelage.
« Une chapelle consacrée »
Dans le christianisme, Marie réunit tous les rôles attribués dans l'Antiquité aux déesses : mère, vierge, guerrière dominant les plantes et les animaux. Mais elle seule possède une virginité perpétuelle, et une impeccabilité absolue. En effet, pour les Pères de l'Église, la femme est la cause de la Chute, la tentatrice, que l'on range aux côtés de Satan. D'où l'impératif des premiers siècles de la chrétienté d'exempter la mère du Christ d'une sexualité abhorrée et d'affirmer sa pureté virginale. Le fils du Père ne peut être né que d'une matrice pure. Intacte, Marie est garante de la divinité de son fils et sa maternité virginale, la condition implicite de l'établissement du dogme.
Marie apparaît aussi comme la seconde ou nouvelle Ève, la mère du nouvel Adam dont le sacrifice rachète l'humanité déchue. Elle-même répare la désobéissance d'Ève et « libère ainsi par sa foi tout ce que son prototype avait tenu prisonnier », explique l'anthropologue des religions Edwin Oliver James. En 431, au concile d'Éphèse, où la Sainte Vierge est reconnue à la fois mère du Christ et Théotokos, mère de Dieu (c'est-à-dire mère à la fois de l'homme et du verbe de Dieu incarné), elle est proclamée « innocente et sans péché, inviolée, sans tache, qui a fleuri comme un lis parmi les épines... ignorante des mauvais penchants d'Ève ». Co-redemptrice, sa préservation de la souillure du péché originel est directement corrélée à la perfection inhérente à la personne du Christ. « Ô Marie, écrit saint Cyrille d'Alexandrie, véritable trésor de tout l'univers, couronne de la virginité... temple incorruptible. »
L'Église déclare définitivement sa virginité perpétuelle, qui a fait l'objet de débats théologiques, ante partum, in partu et post partum - avant, pendant et après - la naissance du Sauveur. C'est ainsi que le corps de la Vierge Marie devient, selon le philosophe Michel Cazenave, « temple de Dieu, une chapelle consacrée, une couche sanctifiée, et ses entrailles le trône où Jésus peut siéger ». Et la virginité chrétienne va prendre une dimension mystique, quasi prophétique : on vérifiera à plusieurs reprises l'hymen de Jeanne d'Arc, Dieu ne pouvant inspirer et parler qu'à une « pucelle ». Cette intégrité physique et spirituelle lui confèrera cette même puissance qui animait les guerrières antiques. Et le respect fidèle des troupes dont elle prendra la tête.
L'opprobre familial
Se « refaire une virginité » : c'est au sens propre que certaines communautés entendent aujourd'hui cette injonction. Par peur des représailles et de l'opprobre familial, des centaines de jeunes filles musulmanes se rendent chaque année dans les hôpitaux pour une réfection de l'hymen. Grâce à cette opération, le drap sera bien taché de sang le soir des noces. Un recours de plus en plus fréquent ces vingt dernières années, depuis que les jeunes Maghrébines nées en France sont l'objet d'un double message, celui du respect des traditions de leurs parents et celui de la liberté des moeurs prônée par la société occidentale. « Comme d'autres formes d'artifices, constate le philosophe Malek Chebel, la réfection d'hymen permet de sauver la face. » Sans oublier ces « certificats de virginité » que les médecins sont de plus en plus réticents à rédiger, malgré la pression des familles, y trouvant une atteinte à la dignité des femmes. Un conservatisme dont le Coran ne contient aucune trace, ni dans les prescriptions, ni dans les jugements de valeur. « La virginité relève de la tradition. Elle est l'équivalent d'un "livret de famille", explique Malek Chebel. À l'origine, elle représentait une forme de contrôle sur la fécondité de l'épouse et sur la descendance. Elle n'avait pas de connotation morale. Aujourd'hui, on peut y lire une volonté de culpabilisation des filles, surveillées de près par leur mère, afin de préserver l'honneur de la famille. »
Bals et « anneau de pureté »
Mais cette exigence de la virginité est loin de ne concerner que le monde musulman. En témoignent ces « bals des vierges » créés il y a une dizaine d'années aux États-Unis par Randy Wilson, un dirigeant du Family Research Council, prêcheur évangéliste et père de 7 enfants. Lors de ces soirées qui évoquent un mariage collectif, des jeunes filles, arrivant au bras de leur père, portent des robes longues et dansent autour d'une pièce montée. Parfois pré-pubères (certaines ont 8 ou 9 ans tout au plus), elles viennent ici y faire voeux de chasteté jusqu'à leurs noces, devant leur père qui s'engage à son tour... à ne pas tromper leur mère. Nombre d'entre eux glissent même un « anneau de pureté » au doigt de leur progéniture, dans un curieux rituel au parfum incestueux. Pourtant, si ces « bals de pureté » se répandent au sein des mouvements chrétiens conservateurs, les jeunes adeptes de l'abstinence finissent souvent par « craquer », comme le confirme une étude des universités de Columbia et de Yale parue en 2005. Enfin, dans les discours religieux et politiques - ceux de la génération Bush par exemple - bannissant le recours au préservatif, la virginité est aussi prescrite comme protection contre le VIH.
Une régulation sociétale de la sexualité
Si elle rend la femme inaccessible et, d'une certaine manière, la protège d'une sexualité non-choisie ou trop précoce, la virginité fut longtemps une manière pour les hommes de s'assurer de la paternité de leurs enfants. Et donc de préserver la lignée. Une régulation de la sexualité établie par la société, qui a longtemps mis la jeune fille à la merci de la virginité hyménale (alors que l'hymen peut se rompre en dehors d'un rapport sexuel). Dans la Grèce ancienne, perdre son pucelage avant le mariage équivaut à être déshonorée et laissée-pour-compte, tradition que l'on retrouve dans la civilisation chrétienne. À la fin de XIXe siècle, la virginité, symbole d'innocence sexuelle, est toujours considérée comme un état naturel et nécessaire pour les femmes célibataires. Et sa perte, un signe évident de corruption morale. Avec la libération sexuelle des années 1970, un rejet de la virginité obligée s'est fait jour chez les femmes qui ont choisi d'adopter un comportement plus « masculin ». Depuis les années 1990 pourtant, la virginité connaît une nouvelle vogue, surtout aux États-Unis, chez les jeunes, filles comme garçons.
[ltr]L'obsession de la virginité[/ltr]
Dans les traditions religieuses, des déesses mères à Marie, la femme sacrée est vouée à une virginité éternelle. Aujourd'hui, si toutes les religions prescrivent la chasteté pré-maritale, c'est chez les musulmans et les évangélistes que cette quête de pureté est la plus exaltée.
Aussi loin que l'on remonte dans le temps, les déesses vierges ont toujours existé. C'est sous cet aspect que, de l'Inde à la Méditerranée, incarnant toutes les formes de fécondité, elles acquirent une influence dominante. Lorsque s'affirma le rôle du mâle dans la génération, des époux leur furent adjoints, mais qui n'étaient que leurs serviteurs. Régnant sur la nature entière, ces déesses conservèrent leur aspect à la fois maternel et virginal. Ainsi, Ishtar, Astarté et Anat, divinités de la fertilité et de l'amour du Proche-Orient sont-elles qualifiées de vierges, bien que ces Grandes Mères (Magna Mater) aient toutes des amants et un ou plusieurs fils. Dans ce cas précis, « être vierge » n'est pas synonyme de chasteté, mais désigne une femme qui n'est pas mariée ; être vierge dans le monde ancien se rapporte donc à une qualité. Mais pas seulement : c'est aussi une attitude psychologique et un état subjectif. Ainsi, en dépit d'une sexualité vivante et plurielle et de grossesses successives, ces déesses demeurent-elles vierges. Inscrites dans un système matriarcal, elles sont avant tout maîtresses d'elles-mêmes, donc libres de refuser ou d'accepter les demandes des hommes. Un aspect singulier, très éloigné de la tradition chrétienne, qui a pourtant survécu occasionnellement : Élisabeth Ière, surnommée la « reine vierge », collectionna les favoris. Mais l'acception du terme laisse entendre, ici, qu'aucun homme jamais ne la posséda (ou ne la déposséda d'elle-même).
Un pouvoir quasi magique
Pour Esther Harding, psychologue jungienne, la déesse mère vierge « est une par essence, elle n'est pas la simple réplique féminine d'un dieu mâle, elle possède son caractère propre, elle est l'ancienne et l'éternelle, la mère de Dieu ; le dieu qui lui est associé est son fils, elle le précède nécessairement. Elle possède sa divinité de plein droit ». Ainsi, Neith l'Égyptienne, créatrice de sa propre existence, qui se suffit à elle-même et qui engendre le dieu soleil Rê, sans partenaire mâle.
On retrouve cet état virginal dans les divinités et figures mythologiques guerrières (ou chasseresses) de l'Antiquité, comme Artémis, vouée à une virginité éternelle - elle rejette quant à elle tout contact amoureux -, Hippolythe, la reine des Amazones, Athéna ou encore Neith, armée de son bouclier et de ses flèches. La chasteté sacrée est ici le symbole de leur autonomie, elle n'a pas de connotation morale. Si ces déesses repoussent les hommes, c'est aussi pour conserver leur puissance extérieure et intérieure. Car la virginité présente un autre avantage pour le monde classique - dont héritera la chrétienté : elle confère un pouvoir quasi magique, celui de la force et de la pureté rituelle. Voilà pourquoi Héra, épouse de Zeus, mère de famille et divinité protectrice des femmes, se baignait chaque année dans la fontaine de Kanathos, afin de retrouver son pucelage.
« Une chapelle consacrée »
Dans le christianisme, Marie réunit tous les rôles attribués dans l'Antiquité aux déesses : mère, vierge, guerrière dominant les plantes et les animaux. Mais elle seule possède une virginité perpétuelle, et une impeccabilité absolue. En effet, pour les Pères de l'Église, la femme est la cause de la Chute, la tentatrice, que l'on range aux côtés de Satan. D'où l'impératif des premiers siècles de la chrétienté d'exempter la mère du Christ d'une sexualité abhorrée et d'affirmer sa pureté virginale. Le fils du Père ne peut être né que d'une matrice pure. Intacte, Marie est garante de la divinité de son fils et sa maternité virginale, la condition implicite de l'établissement du dogme.
Marie apparaît aussi comme la seconde ou nouvelle Ève, la mère du nouvel Adam dont le sacrifice rachète l'humanité déchue. Elle-même répare la désobéissance d'Ève et « libère ainsi par sa foi tout ce que son prototype avait tenu prisonnier », explique l'anthropologue des religions Edwin Oliver James. En 431, au concile d'Éphèse, où la Sainte Vierge est reconnue à la fois mère du Christ et Théotokos, mère de Dieu (c'est-à-dire mère à la fois de l'homme et du verbe de Dieu incarné), elle est proclamée « innocente et sans péché, inviolée, sans tache, qui a fleuri comme un lis parmi les épines... ignorante des mauvais penchants d'Ève ». Co-redemptrice, sa préservation de la souillure du péché originel est directement corrélée à la perfection inhérente à la personne du Christ. « Ô Marie, écrit saint Cyrille d'Alexandrie, véritable trésor de tout l'univers, couronne de la virginité... temple incorruptible. »
L'Église déclare définitivement sa virginité perpétuelle, qui a fait l'objet de débats théologiques, ante partum, in partu et post partum - avant, pendant et après - la naissance du Sauveur. C'est ainsi que le corps de la Vierge Marie devient, selon le philosophe Michel Cazenave, « temple de Dieu, une chapelle consacrée, une couche sanctifiée, et ses entrailles le trône où Jésus peut siéger ». Et la virginité chrétienne va prendre une dimension mystique, quasi prophétique : on vérifiera à plusieurs reprises l'hymen de Jeanne d'Arc, Dieu ne pouvant inspirer et parler qu'à une « pucelle ». Cette intégrité physique et spirituelle lui confèrera cette même puissance qui animait les guerrières antiques. Et le respect fidèle des troupes dont elle prendra la tête.
L'opprobre familial
Se « refaire une virginité » : c'est au sens propre que certaines communautés entendent aujourd'hui cette injonction. Par peur des représailles et de l'opprobre familial, des centaines de jeunes filles musulmanes se rendent chaque année dans les hôpitaux pour une réfection de l'hymen. Grâce à cette opération, le drap sera bien taché de sang le soir des noces. Un recours de plus en plus fréquent ces vingt dernières années, depuis que les jeunes Maghrébines nées en France sont l'objet d'un double message, celui du respect des traditions de leurs parents et celui de la liberté des moeurs prônée par la société occidentale. « Comme d'autres formes d'artifices, constate le philosophe Malek Chebel, la réfection d'hymen permet de sauver la face. » Sans oublier ces « certificats de virginité » que les médecins sont de plus en plus réticents à rédiger, malgré la pression des familles, y trouvant une atteinte à la dignité des femmes. Un conservatisme dont le Coran ne contient aucune trace, ni dans les prescriptions, ni dans les jugements de valeur. « La virginité relève de la tradition. Elle est l'équivalent d'un "livret de famille", explique Malek Chebel. À l'origine, elle représentait une forme de contrôle sur la fécondité de l'épouse et sur la descendance. Elle n'avait pas de connotation morale. Aujourd'hui, on peut y lire une volonté de culpabilisation des filles, surveillées de près par leur mère, afin de préserver l'honneur de la famille. »
Bals et « anneau de pureté »
Mais cette exigence de la virginité est loin de ne concerner que le monde musulman. En témoignent ces « bals des vierges » créés il y a une dizaine d'années aux États-Unis par Randy Wilson, un dirigeant du Family Research Council, prêcheur évangéliste et père de 7 enfants. Lors de ces soirées qui évoquent un mariage collectif, des jeunes filles, arrivant au bras de leur père, portent des robes longues et dansent autour d'une pièce montée. Parfois pré-pubères (certaines ont 8 ou 9 ans tout au plus), elles viennent ici y faire voeux de chasteté jusqu'à leurs noces, devant leur père qui s'engage à son tour... à ne pas tromper leur mère. Nombre d'entre eux glissent même un « anneau de pureté » au doigt de leur progéniture, dans un curieux rituel au parfum incestueux. Pourtant, si ces « bals de pureté » se répandent au sein des mouvements chrétiens conservateurs, les jeunes adeptes de l'abstinence finissent souvent par « craquer », comme le confirme une étude des universités de Columbia et de Yale parue en 2005. Enfin, dans les discours religieux et politiques - ceux de la génération Bush par exemple - bannissant le recours au préservatif, la virginité est aussi prescrite comme protection contre le VIH.
Une régulation sociétale de la sexualité
Si elle rend la femme inaccessible et, d'une certaine manière, la protège d'une sexualité non-choisie ou trop précoce, la virginité fut longtemps une manière pour les hommes de s'assurer de la paternité de leurs enfants. Et donc de préserver la lignée. Une régulation de la sexualité établie par la société, qui a longtemps mis la jeune fille à la merci de la virginité hyménale (alors que l'hymen peut se rompre en dehors d'un rapport sexuel). Dans la Grèce ancienne, perdre son pucelage avant le mariage équivaut à être déshonorée et laissée-pour-compte, tradition que l'on retrouve dans la civilisation chrétienne. À la fin de XIXe siècle, la virginité, symbole d'innocence sexuelle, est toujours considérée comme un état naturel et nécessaire pour les femmes célibataires. Et sa perte, un signe évident de corruption morale. Avec la libération sexuelle des années 1970, un rejet de la virginité obligée s'est fait jour chez les femmes qui ont choisi d'adopter un comportement plus « masculin ». Depuis les années 1990 pourtant, la virginité connaît une nouvelle vogue, surtout aux États-Unis, chez les jeunes, filles comme garçons.
 Re: Sexe et Religion
Re: Sexe et Religion
Le sexe et les religions
[ltr]L'ambivalence du judaïsme[/ltr]
Perpétuer l'espèce ou plaider la satisfaction du désir sexuel : la tradition juive a constamment oscillé entre la nécessité de réserver la sexualité à la procréation et la légitimation du plaisir.
La langue française a un lexique assez riche pour dire l'acte sexuel, l'expression la plus belle étant encore « faire l'amour ». Dans la langue de la Bible, la première occurrence se trouve dès le début de la Genèse, où l'amour est lié à la « connaissance » : « Et Adam connut sa femme Ève. » Rachi, le commentateur champenois et le plus illustre exégète biblique, ne s'en tient pas au sens commun, qui serait, on en conviendra, un peu idiot (on voit mal le premier homme faire la connaissance de sa promise au détour d'une rue). Il traduit « connaître » par « faire l'amour » précisément. Comme si on atteignait, dans l'acte d'amour, un degré supérieur de la connaissance. Comme si le désir du conjoint n'était pas un besoin physique, mais au contraire une forme d'accomplissement. Comme si, enfin, la connaissance de l'autre conférait à l'acte sexuel une dignité particulière.
Accouplement, rire et jeu
La deuxième occurrence est aussi dans la Genèse. C'est Isaac, dont la femme est convoitée par le roi Abimelekh, qui se ravise quand il aperçoit le patriarche « qui rit avec sa femme Rebecca ». Le rire, là encore, est une légèreté interprétée par le commentateur français - très français pour le coup - comme une union charnelle. De l'accouplement sexuel considéré comme un mélange de rire et de jeu.
Troisième occurrence, également dans la Genèse, c'est Joseph, en prise avec les tentatives de séduction de la femme de Potiphar, qui résiste - c'est même ce qui lui vaut, d'après les textes midrashiques, le titre de « saint », sans doute parce que la tradition tient qu'il n'y a rien de plus irrésistible et de plus difficile à dominer qu'un désir sexuel. Le texte dit : « Il n'y a rien dont mon maître Potiphar m'ait écarté, si ce n'est son pain. » Rachi, qui était vigneron et aurait pu être boulanger, traduit le « pain » par l'« épouse ». Cette métaphore nourricière pour désigner la femme est étrange, et en même temps évocatrice de substance, d'éternité, de sainteté aussi (dans le mobilier du Temple de Jérusalem, le pain dit « de proposition » devait être « en permanence » devant l'Arche sainte).
De belles histoires d'amour
Dans le Talmud et dans la littérature rabbinique, il y a un autre mot, beaucoup plus prosaïque, c'est tachmich, qu'on pourrait traduire par « usage » ou « service ». C'est évidemment moins poétique. La connaissance ? Le rire ? Le jeu ? Le pain ? L'usage ? Dans son approche de la sexualité, la tradition juive a constamment oscillé entre ces métaphores, évoluant aussi entre une position très stricte, réservant la sexualité aux seules nécessités de la procréation - « Croissez et multipliez-vous » est un impératif, un commandement, une Mitzva - et une attitude plus ouverte, plaidant pour une légitimité et même un droit au plaisir.
La Bible est traversée de belles histoires d'amour. Celle d'Isaac et de Rebecca. « Vayeehaveha » - « et il l'aima », avec cette sonorité poétique attachée à cette conjugaison particulière de l'hébreu. Et le texte ajoute, ce qui aurait plu au grand Sigmund s'il avait eu le loisir de lire la Bible autrement qu'en en feuilletant les pages : « Et il se consola de la perte de sa mère. »Celle de Jacob et de Rachel, le récit d'un coup de foudre devant un puits, avec le beau jeune homme qui fait boire les chameaux de sa dulcinée avant de travailler quatorze ans auprès de son oncle Laban et pouvoir convoler en justes noces : « Et ces années furent aux yeux de Jacob comme quelques jours tant il l'aimait. »
Des unions illicites
L'amour et la procréation se trouvent liés dans la Bible. Tout comme le mariage et la « sanctification » (on appelle le mariage kiddouchin). L'érotisme n'est pas condamné, qu'il soit pur objet de satisfaction ou qu'il préserve la continuité des générations, mais il est toujours quelque part sublimé. Tout Le Cantique des Cantiques est travaillé par l'idée d'une sanctification des relations entre l'amant et sa bien-aimée, comme métaphore des liens entre Dieu et sa créature, ou entre Dieu et la communauté d'Israël.
La Bible n'ignore pas néanmoins les unions sexuelles illicites. Celle de Judah et de Tamar. Judah, le fils de Jacob, condamné parce qu'il s'est offert les faveurs d'une prostituée rencontrée sur les routes, et dont il découvre que cette femme n'est autre que sa propre bru. Celle aussi de David et Bethsabée, des amours adultérines qui valent au souverain les admonestations du prophète Nathan, lequel décrète qu'il n'est pas digne de construire le Temple de Jérusalem.
L'onanisme est banni. Onan, qui devait épouser la veuve de son frère et lui donner une descendance, et qui préfère « verser sa semence par terre » mourra par sa faute. L'homosexualité est dénoncée comme une « abomination » - les exégètes les plus ouverts précisent en même temps que l'homosexuel n'est pas taxé d'« abominable », c'est l'acte qui est condamné, pas celui qui s'y adonne (lire en p. 40 à 43). La vie sexuelle du couple se trouve rythmée par les commandements de la nidda, période de règles de l'épouse pendant lesquelles est prescrite une abstinence sexuelle. La sexualité est bornée, limitée, encadrée. Nulle vision naïve dans cette approche, aucune confiance dans des vertus supposées naturelles, ou une innocence présumée.
Un acte privé
Le Talmud énonce qu'« en matière de sexualité, il n'y a pas de fiabilité ». Rien n'est garanti, tout est possible, et même le pire. Simplement, la notion de péché n'est pas directement associée à la pratique sexuelle, pas de manière originelle. L'attitude est constamment ambivalente. La sexualité a pour vocation première de perpétuer l'espèce, et en même temps le plaisir sexuel n'est pas prohibé. Seules des manifestations publiques sont naturellement interdites. Même s'il y a un récit dans le Talmud d'un élève caché sous le lit de son maître. Surpris et sermonné, l'élève répond en toute franchise qu'il veut tout apprendre de son rabbi, comment il lace ses chaussures, comment il faut se nourrir, et aussi comment il faut honorer son épouse : « C'est la Torah que je suis venu apprendre ! » J'imagine que ce récit - joli, au demeurant - n'est pas divulgué dans les écoles talmudiques pour l'édification des jeunes rabbis. Pris à la lettre, cela ferait quelques dégâts !
[ltr]L'ambivalence du judaïsme[/ltr]
Perpétuer l'espèce ou plaider la satisfaction du désir sexuel : la tradition juive a constamment oscillé entre la nécessité de réserver la sexualité à la procréation et la légitimation du plaisir.
La langue française a un lexique assez riche pour dire l'acte sexuel, l'expression la plus belle étant encore « faire l'amour ». Dans la langue de la Bible, la première occurrence se trouve dès le début de la Genèse, où l'amour est lié à la « connaissance » : « Et Adam connut sa femme Ève. » Rachi, le commentateur champenois et le plus illustre exégète biblique, ne s'en tient pas au sens commun, qui serait, on en conviendra, un peu idiot (on voit mal le premier homme faire la connaissance de sa promise au détour d'une rue). Il traduit « connaître » par « faire l'amour » précisément. Comme si on atteignait, dans l'acte d'amour, un degré supérieur de la connaissance. Comme si le désir du conjoint n'était pas un besoin physique, mais au contraire une forme d'accomplissement. Comme si, enfin, la connaissance de l'autre conférait à l'acte sexuel une dignité particulière.
Accouplement, rire et jeu
La deuxième occurrence est aussi dans la Genèse. C'est Isaac, dont la femme est convoitée par le roi Abimelekh, qui se ravise quand il aperçoit le patriarche « qui rit avec sa femme Rebecca ». Le rire, là encore, est une légèreté interprétée par le commentateur français - très français pour le coup - comme une union charnelle. De l'accouplement sexuel considéré comme un mélange de rire et de jeu.
Troisième occurrence, également dans la Genèse, c'est Joseph, en prise avec les tentatives de séduction de la femme de Potiphar, qui résiste - c'est même ce qui lui vaut, d'après les textes midrashiques, le titre de « saint », sans doute parce que la tradition tient qu'il n'y a rien de plus irrésistible et de plus difficile à dominer qu'un désir sexuel. Le texte dit : « Il n'y a rien dont mon maître Potiphar m'ait écarté, si ce n'est son pain. » Rachi, qui était vigneron et aurait pu être boulanger, traduit le « pain » par l'« épouse ». Cette métaphore nourricière pour désigner la femme est étrange, et en même temps évocatrice de substance, d'éternité, de sainteté aussi (dans le mobilier du Temple de Jérusalem, le pain dit « de proposition » devait être « en permanence » devant l'Arche sainte).
De belles histoires d'amour
Dans le Talmud et dans la littérature rabbinique, il y a un autre mot, beaucoup plus prosaïque, c'est tachmich, qu'on pourrait traduire par « usage » ou « service ». C'est évidemment moins poétique. La connaissance ? Le rire ? Le jeu ? Le pain ? L'usage ? Dans son approche de la sexualité, la tradition juive a constamment oscillé entre ces métaphores, évoluant aussi entre une position très stricte, réservant la sexualité aux seules nécessités de la procréation - « Croissez et multipliez-vous » est un impératif, un commandement, une Mitzva - et une attitude plus ouverte, plaidant pour une légitimité et même un droit au plaisir.
La Bible est traversée de belles histoires d'amour. Celle d'Isaac et de Rebecca. « Vayeehaveha » - « et il l'aima », avec cette sonorité poétique attachée à cette conjugaison particulière de l'hébreu. Et le texte ajoute, ce qui aurait plu au grand Sigmund s'il avait eu le loisir de lire la Bible autrement qu'en en feuilletant les pages : « Et il se consola de la perte de sa mère. »Celle de Jacob et de Rachel, le récit d'un coup de foudre devant un puits, avec le beau jeune homme qui fait boire les chameaux de sa dulcinée avant de travailler quatorze ans auprès de son oncle Laban et pouvoir convoler en justes noces : « Et ces années furent aux yeux de Jacob comme quelques jours tant il l'aimait. »
Des unions illicites
L'amour et la procréation se trouvent liés dans la Bible. Tout comme le mariage et la « sanctification » (on appelle le mariage kiddouchin). L'érotisme n'est pas condamné, qu'il soit pur objet de satisfaction ou qu'il préserve la continuité des générations, mais il est toujours quelque part sublimé. Tout Le Cantique des Cantiques est travaillé par l'idée d'une sanctification des relations entre l'amant et sa bien-aimée, comme métaphore des liens entre Dieu et sa créature, ou entre Dieu et la communauté d'Israël.
La Bible n'ignore pas néanmoins les unions sexuelles illicites. Celle de Judah et de Tamar. Judah, le fils de Jacob, condamné parce qu'il s'est offert les faveurs d'une prostituée rencontrée sur les routes, et dont il découvre que cette femme n'est autre que sa propre bru. Celle aussi de David et Bethsabée, des amours adultérines qui valent au souverain les admonestations du prophète Nathan, lequel décrète qu'il n'est pas digne de construire le Temple de Jérusalem.
L'onanisme est banni. Onan, qui devait épouser la veuve de son frère et lui donner une descendance, et qui préfère « verser sa semence par terre » mourra par sa faute. L'homosexualité est dénoncée comme une « abomination » - les exégètes les plus ouverts précisent en même temps que l'homosexuel n'est pas taxé d'« abominable », c'est l'acte qui est condamné, pas celui qui s'y adonne (lire en p. 40 à 43). La vie sexuelle du couple se trouve rythmée par les commandements de la nidda, période de règles de l'épouse pendant lesquelles est prescrite une abstinence sexuelle. La sexualité est bornée, limitée, encadrée. Nulle vision naïve dans cette approche, aucune confiance dans des vertus supposées naturelles, ou une innocence présumée.
Un acte privé
Le Talmud énonce qu'« en matière de sexualité, il n'y a pas de fiabilité ». Rien n'est garanti, tout est possible, et même le pire. Simplement, la notion de péché n'est pas directement associée à la pratique sexuelle, pas de manière originelle. L'attitude est constamment ambivalente. La sexualité a pour vocation première de perpétuer l'espèce, et en même temps le plaisir sexuel n'est pas prohibé. Seules des manifestations publiques sont naturellement interdites. Même s'il y a un récit dans le Talmud d'un élève caché sous le lit de son maître. Surpris et sermonné, l'élève répond en toute franchise qu'il veut tout apprendre de son rabbi, comment il lace ses chaussures, comment il faut se nourrir, et aussi comment il faut honorer son épouse : « C'est la Torah que je suis venu apprendre ! » J'imagine que ce récit - joli, au demeurant - n'est pas divulgué dans les écoles talmudiques pour l'édification des jeunes rabbis. Pris à la lettre, cela ferait quelques dégâts !
 Re: Sexe et Religion
Re: Sexe et Religion
Le sexe et les religions
[ltr]« C'est du manque que naît le désir »[/ltr]
Nombreuses sont encore les femmes juives à respecter l'abstinence lors de leurs règles et des sept jours suivants. Bain rituel, petits cadeaux et attentions : le douzième jour, la nuit des retrouvailles avec l'époux est minutieusement préparée.
«Pourquoi la Torah demande-t-elle que la femme soit impure pendant sept jours ? Parce que son mari pourrait se lasser d'elle. C'est pourquoi la Torah déclare : "Qu'elle demeure impure pendant sept jours, afin qu'elle soit ensuite aussi chère à son mari qu'au jour du dais nuptial" » : voilà comment, dans l'Asie mineure du IIe siècle, rabbi Méïr, l'un des grands sages de sa génération, décrit, dans le Traité Nida (31b), ce qui ressemble à une recette juive de bonheur conjugal. Nombreuses sont toujours aujourd'hui les femmes juives à respecter dans leur couple ce commandement qui leur est tout spécialement adressé. Durant les cinq jours des règles et les sept jours suivants, mari et femme s'abstiennent de tout rapport sexuel. À la nuit du douzième jour, la femme se rend au miqwe, le bain rituel. Là, elle s'immerge trois fois dans l'eau de pluie de ce bassin spécial. Au sortir : les retrouvailles - cela tombe bien, le jour de l'ovulation. Tant que la femme ne s'est pas rituellement trempée, point de baisers ni de caresses langoureuses... Les plus orthodoxes séparent leurs lits et s'interdisent tout contact. Mais cultivent l'impatience de leur désir. « Pendant douze jours, nous nous manquons », explique avec spontanéité Myriam (1), jeune femme dont le mari est rabbin dans l'ouest de Paris. Car bien entendu, « tout ce qui est interdit donne envie ». « Mais cette séparation n'est pas vécue comme une frustration trop dure à supporter, continue Myriam. On sait qu'elle permettra de mieux se retrouver. Alors, on compte les jours. »
« Un très bel orgasme »
Le docteur José Soussana, sexologue à La Roche-sur-Yon, et qui a participé à la rédaction d'un Manuel de sexologie (2), renchérit : « C'est du manque que naît le désir ; cette période de séparation ne peut pas être envisagée comme une thérapie pour un couple qui ne connaît plus le désir, mais pour un homme et une femme qui s'entendent bien, c'est une manière d'entretenir la flamme. C'est l'occasion pour eux, durant cette séparation momentanée, de se chercher dans la complicité du regard, avant de se rencontrer dans la proximité du geste. » Et le jour dit, que se passe-t-il ? « L'ambiance des retrouvailles est formidable, explique Clara (1), coquette psychologue clinicienne d'une cinquantaine d'années. La veille, je préviens mon mari que je vais aller au miqwe. Lui, il dit en riant : "Ah, bonne nouvelle !" » Bouquet de fleurs, boîte de chocolats, restaurant, nuit à l'hôtel, nouvelle lingerie... Le mari pense à de petites surprises pour sa femme, qui de son côté, prend le temps de se reposer, de se préparer : épilation, crèmes, massages, hammam, bain moussant... Selon les goûts de chacune. « Chaque mois, l'homme et la femme essayent de se surprendre, tout en s'appliquant à se rappeler ce qui plaît le mieux à l'autre. La femme, notamment, apprend à chaque fois un peu mieux à connaître sa propre intimité », raconte Myriam. Il faut dire aussi que c'est un commandement, pour l'homme juif, que de « réjouir sa femme » ; il s'y est engagé le jour de son mariage, sous le dais nuptial. Et la nuit des retrouvailles venue : « C'est un très bel orgasme », conclut Clara. « Mais pas seulement », ajoute-t-elle. Pas seulement ? Cette règle de vie ne serait donc pas une simple formule prodromique pour Viagra juif ? « Le rituel du miqwe nous rend matures, il nous installe dans une relation d'adultes. Il nous rappelle que nous ne sommes pas de petits enfants tout puissants, qui peuvent toujours obtenir tout, tout de suite ! », ainsi parle la psychologue. Il s'agit donc de considérer l'acte sexuel comme un lien entre deux êtres, et non comme l'assouvissement d'un besoin, qui devrait toujours être immédiat. C'est aussi l'avis du docteur Soussana : « Cette pratique cherche certainement à empêcher le mari et la femme de s'utiliser l'un l'autre comme de simples objets sexuels. » Anna (1), une jeune femme juive pratiquante, qui habite dans le XIXe arrondissement de Paris, développe cette idée : « Grâce à la Loi, l'amour est nourri par autre chose que l'acte physique, puisque pendant les jours de séparation, nous sommes bien obligés de nous aimer autrement. Du coup, quand le mari et la femme couchent ensemble, ce n'est pas seulement une manière pour eux d'assouvir un désir venu de l'extérieur, comme cela peut arriver parfois : l'homme revient à la maison émoustillé par une publicité, la femme par une plaisanterie avec un collègue de bureau, et dans leur lit, ils utilisent chacun le corps de l'autre pour se satisfaire. » Contre la réification du partenaire, privilégier la rencontre. Mais pourquoi décider d'instaurer une séparation justement pendant les règles et les sept jours qui les suivent ? Est-ce à dire que la femme est impure, souillée, pendant tout ce temps-là ? Clara s'agace : « Ce mot "impureté" fait se dresser mes cheveux sur la tête ! C'est pourtant en ces termes qu'on enseigne souvent, malheureusement, les lois de la vie conjugale aux jeunes filles pratiquantes... » Et c'est sans doute ainsi qu'elles sont parfois vécues, quand il n'y a pas d'amour dans le couple et qu'il ne reste donc qu'une Loi et une tradition difficiles à appliquer.
Se rappeler sa propre finitude
Cette impureté n'est pourtant que « symbolique », se récrient en cœur Anna et Clara. Lorsque la femme a ses règles, la possibilité d'une vie s'évanouit, puisque l'ovulation n'a pas eu lieu. Les femmes s'immergent pour lutter contre cet évanouissement. « Et non pour se nettoyer d'une tache, d'une saleté », selon Anna. Il s'agit surtout de se rappeler sa propre finitude, expliquent les rabbins (3) : les règles représentent une imperfection du système de reproduction humain, qui n'est pas toujours « en état de marche ». De la même manière, cette séparation mensuelle, qui renouvelle constamment le lien conjugal, rappelle aux époux l'imperfection de leur sexualité humaine. Retour nostalgique, donc, grâce à l'immersion dans le bassin du miqwe, à la perfection et au bien-être des eaux qui nous ont baignés autrefois, dans une matrice accomplie. La femme sortie des eaux est bien source universelle de coutumes et de représentations.
[ltr]« C'est du manque que naît le désir »[/ltr]
Nombreuses sont encore les femmes juives à respecter l'abstinence lors de leurs règles et des sept jours suivants. Bain rituel, petits cadeaux et attentions : le douzième jour, la nuit des retrouvailles avec l'époux est minutieusement préparée.
«Pourquoi la Torah demande-t-elle que la femme soit impure pendant sept jours ? Parce que son mari pourrait se lasser d'elle. C'est pourquoi la Torah déclare : "Qu'elle demeure impure pendant sept jours, afin qu'elle soit ensuite aussi chère à son mari qu'au jour du dais nuptial" » : voilà comment, dans l'Asie mineure du IIe siècle, rabbi Méïr, l'un des grands sages de sa génération, décrit, dans le Traité Nida (31b), ce qui ressemble à une recette juive de bonheur conjugal. Nombreuses sont toujours aujourd'hui les femmes juives à respecter dans leur couple ce commandement qui leur est tout spécialement adressé. Durant les cinq jours des règles et les sept jours suivants, mari et femme s'abstiennent de tout rapport sexuel. À la nuit du douzième jour, la femme se rend au miqwe, le bain rituel. Là, elle s'immerge trois fois dans l'eau de pluie de ce bassin spécial. Au sortir : les retrouvailles - cela tombe bien, le jour de l'ovulation. Tant que la femme ne s'est pas rituellement trempée, point de baisers ni de caresses langoureuses... Les plus orthodoxes séparent leurs lits et s'interdisent tout contact. Mais cultivent l'impatience de leur désir. « Pendant douze jours, nous nous manquons », explique avec spontanéité Myriam (1), jeune femme dont le mari est rabbin dans l'ouest de Paris. Car bien entendu, « tout ce qui est interdit donne envie ». « Mais cette séparation n'est pas vécue comme une frustration trop dure à supporter, continue Myriam. On sait qu'elle permettra de mieux se retrouver. Alors, on compte les jours. »
« Un très bel orgasme »
Le docteur José Soussana, sexologue à La Roche-sur-Yon, et qui a participé à la rédaction d'un Manuel de sexologie (2), renchérit : « C'est du manque que naît le désir ; cette période de séparation ne peut pas être envisagée comme une thérapie pour un couple qui ne connaît plus le désir, mais pour un homme et une femme qui s'entendent bien, c'est une manière d'entretenir la flamme. C'est l'occasion pour eux, durant cette séparation momentanée, de se chercher dans la complicité du regard, avant de se rencontrer dans la proximité du geste. » Et le jour dit, que se passe-t-il ? « L'ambiance des retrouvailles est formidable, explique Clara (1), coquette psychologue clinicienne d'une cinquantaine d'années. La veille, je préviens mon mari que je vais aller au miqwe. Lui, il dit en riant : "Ah, bonne nouvelle !" » Bouquet de fleurs, boîte de chocolats, restaurant, nuit à l'hôtel, nouvelle lingerie... Le mari pense à de petites surprises pour sa femme, qui de son côté, prend le temps de se reposer, de se préparer : épilation, crèmes, massages, hammam, bain moussant... Selon les goûts de chacune. « Chaque mois, l'homme et la femme essayent de se surprendre, tout en s'appliquant à se rappeler ce qui plaît le mieux à l'autre. La femme, notamment, apprend à chaque fois un peu mieux à connaître sa propre intimité », raconte Myriam. Il faut dire aussi que c'est un commandement, pour l'homme juif, que de « réjouir sa femme » ; il s'y est engagé le jour de son mariage, sous le dais nuptial. Et la nuit des retrouvailles venue : « C'est un très bel orgasme », conclut Clara. « Mais pas seulement », ajoute-t-elle. Pas seulement ? Cette règle de vie ne serait donc pas une simple formule prodromique pour Viagra juif ? « Le rituel du miqwe nous rend matures, il nous installe dans une relation d'adultes. Il nous rappelle que nous ne sommes pas de petits enfants tout puissants, qui peuvent toujours obtenir tout, tout de suite ! », ainsi parle la psychologue. Il s'agit donc de considérer l'acte sexuel comme un lien entre deux êtres, et non comme l'assouvissement d'un besoin, qui devrait toujours être immédiat. C'est aussi l'avis du docteur Soussana : « Cette pratique cherche certainement à empêcher le mari et la femme de s'utiliser l'un l'autre comme de simples objets sexuels. » Anna (1), une jeune femme juive pratiquante, qui habite dans le XIXe arrondissement de Paris, développe cette idée : « Grâce à la Loi, l'amour est nourri par autre chose que l'acte physique, puisque pendant les jours de séparation, nous sommes bien obligés de nous aimer autrement. Du coup, quand le mari et la femme couchent ensemble, ce n'est pas seulement une manière pour eux d'assouvir un désir venu de l'extérieur, comme cela peut arriver parfois : l'homme revient à la maison émoustillé par une publicité, la femme par une plaisanterie avec un collègue de bureau, et dans leur lit, ils utilisent chacun le corps de l'autre pour se satisfaire. » Contre la réification du partenaire, privilégier la rencontre. Mais pourquoi décider d'instaurer une séparation justement pendant les règles et les sept jours qui les suivent ? Est-ce à dire que la femme est impure, souillée, pendant tout ce temps-là ? Clara s'agace : « Ce mot "impureté" fait se dresser mes cheveux sur la tête ! C'est pourtant en ces termes qu'on enseigne souvent, malheureusement, les lois de la vie conjugale aux jeunes filles pratiquantes... » Et c'est sans doute ainsi qu'elles sont parfois vécues, quand il n'y a pas d'amour dans le couple et qu'il ne reste donc qu'une Loi et une tradition difficiles à appliquer.
Se rappeler sa propre finitude
Cette impureté n'est pourtant que « symbolique », se récrient en cœur Anna et Clara. Lorsque la femme a ses règles, la possibilité d'une vie s'évanouit, puisque l'ovulation n'a pas eu lieu. Les femmes s'immergent pour lutter contre cet évanouissement. « Et non pour se nettoyer d'une tache, d'une saleté », selon Anna. Il s'agit surtout de se rappeler sa propre finitude, expliquent les rabbins (3) : les règles représentent une imperfection du système de reproduction humain, qui n'est pas toujours « en état de marche ». De la même manière, cette séparation mensuelle, qui renouvelle constamment le lien conjugal, rappelle aux époux l'imperfection de leur sexualité humaine. Retour nostalgique, donc, grâce à l'immersion dans le bassin du miqwe, à la perfection et au bien-être des eaux qui nous ont baignés autrefois, dans une matrice accomplie. La femme sortie des eaux est bien source universelle de coutumes et de représentations.
 Re: Sexe et Religion
Re: Sexe et Religion
Le sexe et les religions
[ltr]Une histoire du refoulement chrétien[/ltr]
En sacralisant le couple, les Évangiles célèbrent la sexualité comme un rite intime. La pensée augustinienne et le monachisme occidental vont ensuite réduire le sexe au « péché de la chair ». Une éducation culpabilisante qui marquera des générations de catholiques.
Que nous disent les Évangiles sur la question de la sexualité ?
Jésus accomplit son premier miracle à l'occasion d'un mariage (Jean 2). Les noces de Cana sont une fête où le vin du bonheur doit couler en abondance. L'humanité de l'Évangile est sexuée et heureuse de l'être. Mais le mariage est une fête qui implique un engagement durable, plus définitif encore que dans la tradition juive (Matthieu 19, 4). Jésus considère le couple comme générique de l'humanité (Genèse 1 : « Homme et femme Il les fit... et les deux ne feront qu'une seule chair. »). C'est pourquoi il dépasse la Loi, qui admet la répudiation et dénonce surtout la « dureté du coeur » de celui ou celle qui abandonne. Cette fermeté de principe tranche avec la compassion avec laquelle il traite les femmes écrasées par la rigueur d'une loi toujours interprétée par l'homme. Par exemple, Jésus sauve la vie d'une femme adultère, traînée hors de la ville pour être lapidée : « Que celui qui n'a jamais pêché jette la première pierre » (Jean 8). Implicitement, il replace le problème de la faute sexuelle dans une perspective de justice. S'il y a une femme adultère, c'est bien qu'il y a eu un homme... Il ne condamne pas non plus la femme samaritaine (Jean 4), qui a eu cinq maris et vit avec un sixième. C'est même à elle qu'il révèle pour la première fois qu'il est le Messie. C'est à la fois une célébration de la tendresse et un hommage rendu à la femme méprisée.
Les Évangiles évoquent-ils la question de la sexualité de manière plus directe ?
Par pudeur, le Christ compare le Royaume des cieux à un festin de noces, mais il ne parle jamais du comment de la sexualité. Il ne dit jamais ce qui devrait ou ne devrait pas se passer dans le lit des époux. Dans les Évangiles, tout ce qui est un don gratuit doit rester secret (Matthieu 6) : l'aumône, le jeûne, la prière. Un des rares théologiens médiévaux qui ne sera pas obsédé par le péché sexuel, Rupert de Deutz, comparera l'union des corps à la prière qui doit se faire en secret. La sexualité est un rite. Le couple constitué est sacré. Le voisin doit le respecter, même en pensée (Matthieu 5, 27-28). A fortiori l'homme de Dieu.
Ne jamais parler du comment de la sexualité, n'est-ce pas une manière de la nier ?
Non. Même Ovide dit, dans L'Art d'aimer (1), que pour garder sa dignité, le rite de l'éros devait rester secret. Que le Christ ne parle jamais du comment de la sexualité n'est pas la nier mais l'humaniser. L'amour dont parle les Évangiles englobe l'éros (le plaisir d'aimer), mais il le transcende souvent en agapè (l'amour pour l'autre). Les Béatitudes (Matthieu 5, Luc 6) parlent de bonheur, de justice, de charité, pas d'extase amoureuse.
Saint Paul va-t-il jouer un rôle important dans le refoulement de la sexualité ?
Sur la longue durée, il faut distinguer le message de Paul et son instrumentalisation. De son temps, le port de Corinthe comptait plus de 10 000 prostituées. En revanche, dans les milieux juifs hellénisés, oserait-on dire « platonisés », l'influence stoïcienne était forte, en réaction contre l'érotisme ambiant et débridé. Dans ce contexte, saint Paul a pour mission d'implanter durablement des communautés en Grèce et à Rome. Il est donc très soucieux de décence ; les fidèles doivent renoncer à la fornication, à l'inceste, aux scandales (1 Corinthiens 5). Le responsable d'une communauté doit être « mari d'une seule femme » (Tite 1, 6). En termes de morale conjugale, enfin, quand Paul écrit « Femmes, soyez soumises à vos maris », il n'écrit rien de neuf dans la Méditerranée de son temps. Mais lorsqu'il dit : « Maris, aimez vos femmes comme le Christ aime son Église » (Éphésiens 5, 22-23), il parle d'un engagement mystique très neuf qui sera ensuite perverti. Pendant des siècles et jusqu'au Code Napoléon, l'homme utilisera comme une aubaine la formule paulinienne : « Le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église » (Éphésiens 5, 23).
Plus tard, la réception de ce message va se faire différemment dans l'Empire chrétien d'Orient et d'Occident...
Après la paix constantinienne (IVe siècle), les moeurs de l'Orient et de l'Occident bientôt envahi par les barbares se dissocient culturellement. Beaucoup d'évêques d'Orient sont mariés et fils d'évêques. Ils respectent leurs mères, leurs filles et leurs épouses. Mais conceptuellement, ils admirent la virginité parce qu'en bons disciples de Platon et d'Aristote, ils sont scandalisés par le cycle de la génération et de la corruption. À quoi rime un monde fait pour se générer puis mourir, se générer à nouveau puis mourir encore ? C'est une absurdité pour les Pères grecs. Afin d'y échapper, Grégoire de Nysse, pourtant marié, reconnaît, sans l'adopter, que la meilleure solution serait de rester vierge. Mais avec humour, il juge suspects ceux qui parlent des splendeurs de la virginité avec un étrange acharnement. Les Pères philosophes sont heureux en famille, mais ils voudraient que l'essentiel de la vie consiste à s'élever au-dessus du terrain mortel, jusqu'à la pureté de l'ange. Un écrit apocryphe de la fin du Ve siècle, attribué à Denys l'Aréopagite, décrit ainsi les montées vers Dieu de l'âme purifiée. Son influence sur le Moyen-Âge oriental et occidental sera considérable. Il permet de comprendre, dans sa pureté d'intention, la spiritualité du moine.
En Occident, c'est l'influence de saint Augustin qui va jouer un rôle déterminant. Quelle fut sa spécificité ?
Africain d'origine, à une époque où l'implantation chrétienne est forte dans l'Afrique romaine, Augustin ne se convertit que tardivement, après avoir mené à bien une carrière de rhéteur qui le conduira à Milan, alors capitale de l'empire d'Occident. De ses années d'études à Carthage, il garde le souvenir d'une vie de débauche, menée jusqu'au dégoût et au rejet des femmes. Partagé entre son admiration pour sa mère, sainte Monique, et son attachement à une compagne qui partagera sa vie pendant quatorze ans et lui donnera un fils - mais dont il ne cite même pas le nom -, il reste aussi fasciné et horrifié tout à la fois par le manichéisme dont il ne s'est affranchi qu'à l'âge de 28 ans ; l'homme, a-t-il longtemps admis, n'est pas maître des forces du bien et du mal. Depuis le péché originel, pense-t-il, dans un contexte d'invasion barbare, l'humanité est en danger de condamnation imminente. La femme en est la cause puisqu'Ève a cueilli la pomme la première. Alors que le Christ ne parle jamais du péché d'Ève, Augustin inscrit quasi génétiquement ce péché dans la nature humaine et, plus gravement, dans la nature de la femme. Cette certitude, ancrée dans la pensée médiévale, sera dogmatisée par une longue série de théologiens, depuis saint Anselme, au XIIe siècle, jusqu'à saint Thomas qui, au XIIIe siècle, renforcera le préjugé par la doctrine de la loi naturelle, sur laquelle les théologiens chrétiens n'auront aucun mal à s'accorder avec ceux de l'islam, puisque les uns et les autres, tous masculins, se référeront au second récit de la Genèse.
L'influence intellectuelle d'Augustin va donc marquer de façon indélébile l'Occident ?
Saint Augustin a immensément écrit, dans un très beau latin. Son oeuvre sera minutieusement recueillie et plus tard, recopiée par les moines bénédictins. C'est ainsi que son influence s'étendra sur toute l'ère du premier monachisme bénédictin, jusqu'au tournant du IXe et du Xe siècle, au moment de la réforme qui triomphe dans l'abbaye bénédictine de Cluny.
Quel rapport avec la sexualité ?
Malgré les mises en garde conciliaires, le clergé du premier Moyen-Âge occidental est loin d'avoir le détachement des anges. Au moment des invasions normandes et des razzias sarrasines, de nombreux évêques mariés sont des seigneurs de guerre, défenseurs armés de leurs villes. Transmis à leurs fils, leurs évêchés deviennent des fiefs héréditaires et militaires. Rome elle-même est aux mains de papes plus ou moins brigands, soumis à l'influence de leurs maîtresses ou de leurs mères. C'est en réaction à cela que triomphe la réforme clunisienne. L'oeuvre de Cluny sera immense, mais au prix du sacrifice de la femme. Chaste, le moine bénédictin ne l'est pas toujours en pensée, puisqu'il prend la femme en horreur et en fascination. Un siècle plus tard, la réforme cistercienne se veut plus radicale encore. Les écrits sur les femmes, non seulement misogynes mais morbides, traduisent à l'évidence les frustrations de moines qui répriment leur sexualité. Malgré cela, le succès des ordres monastiques est tel qu'au XIe siècle, le pape Grégoire VII décide d'organiser l'Église occidentale comme un grand monastère. Désormais, évêques et curés sont sommés de renvoyer leurs épouses et de vivre en communauté. Cette réforme mettra des décennies, des siècles à s'imposer.
Aux alentours du XIIe siècle, par une sorte de sublimation, l'image de la Vierge apparaît...
Oui. Nous atteignons l'époque des croisades. Paradoxalement, saint Bernard, le grand réformateur cistercien, qui s'insurge contre le laxisme des prêtres, est aussi le génie qui invente une prière de tendresse : l'Ave Maria. Dans le milieu des clercs qui dévalorise la femme de tous les jours, l'idéal féminin est sublimé en elle. Alors qu'en Orient orthodoxe, la Vierge représente l'humanité entière portant Dieu, la Théotokos, en Occident, naît et prend son essor l'image de l'« Immaculée Conception », accueillante mais née différente de toutes les autres femmes. Bientôt, l'Église institutionnelle s'identifie à la Vierge Marie, mère de Dieu, mère du Christ, mère du peuple, couronnée aux portails des cathédrales. Dans la tradition catholique, cette conception durera jusqu'à sa dogmatisation au milieu du XXe siècle. Dans la tradition réformée, Luther dénoncera un danger d'idolâtrie mariale, sans réfuter la virginité du coeur, qui permet d'accueillir le miracle d'un Dieu incarné.
Nous parvenons aux moments tragiques qui suivent la peste noire, les misères de la guerre de Cent ans, la poussée inexorable de l'islam puis la chute de Constantinople. Une névrose collective semble alors s'emparer de certains clercs, qui prennent les femmes pour cibles de leurs hantises. Pourquoi ?
Beaucoup de clercs vivent alors dans des cercles universitaires de plus en plus fermés et fondamentalistes. Ce qui est hors-norme doit être éradiqué. L'Inquisition mise en place au XIIIe siècle pour lutter contre les hérésies prend en horreur les savoirs des femmes. Elle se fonde sur une idée de la raison, empruntée à une mauvaise transmission des catégories d'Aristote. Depuis des siècles déjà, les hommes redoutaient les sages-femmes, des herboristes capables de transmettre par oral les secrets de filtres d'amour ou de stérilité. Les lieux de transmission féminine, les lavoirs, les arbres magiques, les lieux d'accouchement, étaient tabous pour l'homme. Seuls les confesseurs avaient écho de ces secrets hérités d'anciens savoirs romains ou préhistoriques. Croyant christianiser les campagnes, ils les condamnaient comme superstitions. À partir du XIVe siècle, les papes eux-mêmes accréditent la fable des sabbats de sorcières. On forme alors des experts en démonologie, inexorablement logiques à partir de postulats absurdes. On sait quels ravages provoquèrent ces hantises - dont la perversité sexuelle est parfois évidente - et quel nombre effrayant de bûchers furent dressés dans toutes les confessions chrétiennes - catholiques, orthodoxes et réformées - et ceci jusqu'au milieu du XVIIIe siècle.
Père de la réforme protestante, Luther est considéré comme un émancipateur. Néanmoins, le luthéranisme semble parfois plus sévère que le catholicisme, pouvez-nous expliquer cette contradiction apparente ?
À l'origine, Luther est un moine augustinien obsédé par l'idée d'enfer. Il ne croit pas au purgatoire, cette sorte de « session de rattrapage » qui, grâce à l'indulgence divine, permet d'espérer un accès différé au Paradis après des années de purification. En monnayant les années d'indulgence de façon éhontée, la papauté de son temps a ruiné cette idée de justice miséricordieuse. Devenu l'émancipateur des crédules, Luther, une fois marié, se trouve débordé par l'ampleur de la révolution qu'il a déclenchée. Calvin, à son tour, organise la réforme genevoise de façon très rigoriste, autour du concept augustinien de prédestination des âmes à l'enfer.
Et au XVIIe siècle ?
Dans la confession catholique, un courant janséniste, rigoriste et largement bourgeois cultive aussi l'angoisse de la prédestination. Un siècle plus tard, ce mouvement prend de l'ampleur, en pleine période des Lumières et d'un libertinage dont les enfants abandonnés font les frais par milliers. Entre ces extrêmes, Voltaire lui-même l'admet, le curé de campagne joue très souvent un rôle de modérateur. C'est lui qui préside aux baptêmes, aux rites de relevailles des femmes. Bien que le secret de la confession ne soit pas trahi, tout nous dit qu'il connaît les souffrances des femmes déchirées en couches, de celles qui enterrent un foetus dans les champs ou qui, en ville, abandonnent leurs enfants sur les marches des églises. Les registres paroissiaux montrent que, de cette époque, datent les premiers symptômes d'espacement volontaire des naissances. Ce modus vivendi semble s'être longtemps maintenu vaille que vaille dans plusieurs régions rurales jusqu'au milieu du XXe siècle, et ceci malgré le respect plus volontiers marqué par l'Église aux familles nombreuses, qui lui donnaient plusieurs enfants comme prêtres ou religieuses.
Et depuis ?
On mesure mal aujourd'hui à quel point les femmes du XIXe siècle, et même du premier XXe siècle, furent écrasées par une éducation culpabilisante, qui débordait de beaucoup le domaine de la sexualité. Sans même évoquer le « péché de chair » si effrayant qu'ils le taisent et se gardent bien de citer la Bible qui en parle, les missels à l'usage des femmes ne cessent de dire que communier en état de péché, c'est signer sa condamnation éternelle. Les maris se défendent par l'incrédulité et l'infidélité, mais, au moins dans le milieu bourgeois, les femmes ont peu d'échappatoires. L'abnégation et le sacrifice sont présentés comme les fleurons de leurs vertus « naturelles » (2).
La révolution de la sexualité au coeur des couples de tradition chrétienne n'est pas venue de l'Église, mais de la médecine. Elle date de la découverte du cycle hormonal féminin, dans les années 1930, puis, en 1955, de la synthèse chimique des hormones permettant à la femme d'échapper à la liaison inexorable entre l'union des corps et la fécondation d'un ovule. Par peur de ce qu'elle ne maîtrise pas et parfois ne comprend pas, l'Église catholique, à la différence des Églises réformées, s'engage alors dans une voie qui autorise la dissociation entre la sexualité et la procréation, mais à condition d'employer des méthodes décrétées naturelles... et d'une inefficacité notoire. Deux décennies après Humanae Vitae, publiée en juillet 1968, la majorité des couples catholiques avaient déjà fait leur choix. Ils avaient abandonné le médecin des âmes pour consulter le médecin des corps et, s'il le fallait, le psychanalyste. Ce changement fut capital pour l'Église, qui perdit l'antique proximité qu'elle entretenait avec les familles. L'erreur d'Humane Vitae fut, me semble-t-il, d'avoir tenté d'introduire un Diafoirus dans des millions de chambres d'époux. L'attitude chrétienne est plutôt de sacraliser le couple en le responsabilisant.
(1) L'Art d'aimer, Ovide, mort en 17 (Librio, 2005).
(2) Recueil de prières, comtesse de Flavigny (Mame, 1868).
Élisabeth Dufourcq
[ltr]Une histoire du refoulement chrétien[/ltr]
En sacralisant le couple, les Évangiles célèbrent la sexualité comme un rite intime. La pensée augustinienne et le monachisme occidental vont ensuite réduire le sexe au « péché de la chair ». Une éducation culpabilisante qui marquera des générations de catholiques.
Que nous disent les Évangiles sur la question de la sexualité ?
Jésus accomplit son premier miracle à l'occasion d'un mariage (Jean 2). Les noces de Cana sont une fête où le vin du bonheur doit couler en abondance. L'humanité de l'Évangile est sexuée et heureuse de l'être. Mais le mariage est une fête qui implique un engagement durable, plus définitif encore que dans la tradition juive (Matthieu 19, 4). Jésus considère le couple comme générique de l'humanité (Genèse 1 : « Homme et femme Il les fit... et les deux ne feront qu'une seule chair. »). C'est pourquoi il dépasse la Loi, qui admet la répudiation et dénonce surtout la « dureté du coeur » de celui ou celle qui abandonne. Cette fermeté de principe tranche avec la compassion avec laquelle il traite les femmes écrasées par la rigueur d'une loi toujours interprétée par l'homme. Par exemple, Jésus sauve la vie d'une femme adultère, traînée hors de la ville pour être lapidée : « Que celui qui n'a jamais pêché jette la première pierre » (Jean 8). Implicitement, il replace le problème de la faute sexuelle dans une perspective de justice. S'il y a une femme adultère, c'est bien qu'il y a eu un homme... Il ne condamne pas non plus la femme samaritaine (Jean 4), qui a eu cinq maris et vit avec un sixième. C'est même à elle qu'il révèle pour la première fois qu'il est le Messie. C'est à la fois une célébration de la tendresse et un hommage rendu à la femme méprisée.
Les Évangiles évoquent-ils la question de la sexualité de manière plus directe ?
Par pudeur, le Christ compare le Royaume des cieux à un festin de noces, mais il ne parle jamais du comment de la sexualité. Il ne dit jamais ce qui devrait ou ne devrait pas se passer dans le lit des époux. Dans les Évangiles, tout ce qui est un don gratuit doit rester secret (Matthieu 6) : l'aumône, le jeûne, la prière. Un des rares théologiens médiévaux qui ne sera pas obsédé par le péché sexuel, Rupert de Deutz, comparera l'union des corps à la prière qui doit se faire en secret. La sexualité est un rite. Le couple constitué est sacré. Le voisin doit le respecter, même en pensée (Matthieu 5, 27-28). A fortiori l'homme de Dieu.
Ne jamais parler du comment de la sexualité, n'est-ce pas une manière de la nier ?
Non. Même Ovide dit, dans L'Art d'aimer (1), que pour garder sa dignité, le rite de l'éros devait rester secret. Que le Christ ne parle jamais du comment de la sexualité n'est pas la nier mais l'humaniser. L'amour dont parle les Évangiles englobe l'éros (le plaisir d'aimer), mais il le transcende souvent en agapè (l'amour pour l'autre). Les Béatitudes (Matthieu 5, Luc 6) parlent de bonheur, de justice, de charité, pas d'extase amoureuse.
Saint Paul va-t-il jouer un rôle important dans le refoulement de la sexualité ?
Sur la longue durée, il faut distinguer le message de Paul et son instrumentalisation. De son temps, le port de Corinthe comptait plus de 10 000 prostituées. En revanche, dans les milieux juifs hellénisés, oserait-on dire « platonisés », l'influence stoïcienne était forte, en réaction contre l'érotisme ambiant et débridé. Dans ce contexte, saint Paul a pour mission d'implanter durablement des communautés en Grèce et à Rome. Il est donc très soucieux de décence ; les fidèles doivent renoncer à la fornication, à l'inceste, aux scandales (1 Corinthiens 5). Le responsable d'une communauté doit être « mari d'une seule femme » (Tite 1, 6). En termes de morale conjugale, enfin, quand Paul écrit « Femmes, soyez soumises à vos maris », il n'écrit rien de neuf dans la Méditerranée de son temps. Mais lorsqu'il dit : « Maris, aimez vos femmes comme le Christ aime son Église » (Éphésiens 5, 22-23), il parle d'un engagement mystique très neuf qui sera ensuite perverti. Pendant des siècles et jusqu'au Code Napoléon, l'homme utilisera comme une aubaine la formule paulinienne : « Le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église » (Éphésiens 5, 23).
Plus tard, la réception de ce message va se faire différemment dans l'Empire chrétien d'Orient et d'Occident...
Après la paix constantinienne (IVe siècle), les moeurs de l'Orient et de l'Occident bientôt envahi par les barbares se dissocient culturellement. Beaucoup d'évêques d'Orient sont mariés et fils d'évêques. Ils respectent leurs mères, leurs filles et leurs épouses. Mais conceptuellement, ils admirent la virginité parce qu'en bons disciples de Platon et d'Aristote, ils sont scandalisés par le cycle de la génération et de la corruption. À quoi rime un monde fait pour se générer puis mourir, se générer à nouveau puis mourir encore ? C'est une absurdité pour les Pères grecs. Afin d'y échapper, Grégoire de Nysse, pourtant marié, reconnaît, sans l'adopter, que la meilleure solution serait de rester vierge. Mais avec humour, il juge suspects ceux qui parlent des splendeurs de la virginité avec un étrange acharnement. Les Pères philosophes sont heureux en famille, mais ils voudraient que l'essentiel de la vie consiste à s'élever au-dessus du terrain mortel, jusqu'à la pureté de l'ange. Un écrit apocryphe de la fin du Ve siècle, attribué à Denys l'Aréopagite, décrit ainsi les montées vers Dieu de l'âme purifiée. Son influence sur le Moyen-Âge oriental et occidental sera considérable. Il permet de comprendre, dans sa pureté d'intention, la spiritualité du moine.
En Occident, c'est l'influence de saint Augustin qui va jouer un rôle déterminant. Quelle fut sa spécificité ?
Africain d'origine, à une époque où l'implantation chrétienne est forte dans l'Afrique romaine, Augustin ne se convertit que tardivement, après avoir mené à bien une carrière de rhéteur qui le conduira à Milan, alors capitale de l'empire d'Occident. De ses années d'études à Carthage, il garde le souvenir d'une vie de débauche, menée jusqu'au dégoût et au rejet des femmes. Partagé entre son admiration pour sa mère, sainte Monique, et son attachement à une compagne qui partagera sa vie pendant quatorze ans et lui donnera un fils - mais dont il ne cite même pas le nom -, il reste aussi fasciné et horrifié tout à la fois par le manichéisme dont il ne s'est affranchi qu'à l'âge de 28 ans ; l'homme, a-t-il longtemps admis, n'est pas maître des forces du bien et du mal. Depuis le péché originel, pense-t-il, dans un contexte d'invasion barbare, l'humanité est en danger de condamnation imminente. La femme en est la cause puisqu'Ève a cueilli la pomme la première. Alors que le Christ ne parle jamais du péché d'Ève, Augustin inscrit quasi génétiquement ce péché dans la nature humaine et, plus gravement, dans la nature de la femme. Cette certitude, ancrée dans la pensée médiévale, sera dogmatisée par une longue série de théologiens, depuis saint Anselme, au XIIe siècle, jusqu'à saint Thomas qui, au XIIIe siècle, renforcera le préjugé par la doctrine de la loi naturelle, sur laquelle les théologiens chrétiens n'auront aucun mal à s'accorder avec ceux de l'islam, puisque les uns et les autres, tous masculins, se référeront au second récit de la Genèse.
L'influence intellectuelle d'Augustin va donc marquer de façon indélébile l'Occident ?
Saint Augustin a immensément écrit, dans un très beau latin. Son oeuvre sera minutieusement recueillie et plus tard, recopiée par les moines bénédictins. C'est ainsi que son influence s'étendra sur toute l'ère du premier monachisme bénédictin, jusqu'au tournant du IXe et du Xe siècle, au moment de la réforme qui triomphe dans l'abbaye bénédictine de Cluny.
Quel rapport avec la sexualité ?
Malgré les mises en garde conciliaires, le clergé du premier Moyen-Âge occidental est loin d'avoir le détachement des anges. Au moment des invasions normandes et des razzias sarrasines, de nombreux évêques mariés sont des seigneurs de guerre, défenseurs armés de leurs villes. Transmis à leurs fils, leurs évêchés deviennent des fiefs héréditaires et militaires. Rome elle-même est aux mains de papes plus ou moins brigands, soumis à l'influence de leurs maîtresses ou de leurs mères. C'est en réaction à cela que triomphe la réforme clunisienne. L'oeuvre de Cluny sera immense, mais au prix du sacrifice de la femme. Chaste, le moine bénédictin ne l'est pas toujours en pensée, puisqu'il prend la femme en horreur et en fascination. Un siècle plus tard, la réforme cistercienne se veut plus radicale encore. Les écrits sur les femmes, non seulement misogynes mais morbides, traduisent à l'évidence les frustrations de moines qui répriment leur sexualité. Malgré cela, le succès des ordres monastiques est tel qu'au XIe siècle, le pape Grégoire VII décide d'organiser l'Église occidentale comme un grand monastère. Désormais, évêques et curés sont sommés de renvoyer leurs épouses et de vivre en communauté. Cette réforme mettra des décennies, des siècles à s'imposer.
Aux alentours du XIIe siècle, par une sorte de sublimation, l'image de la Vierge apparaît...
Oui. Nous atteignons l'époque des croisades. Paradoxalement, saint Bernard, le grand réformateur cistercien, qui s'insurge contre le laxisme des prêtres, est aussi le génie qui invente une prière de tendresse : l'Ave Maria. Dans le milieu des clercs qui dévalorise la femme de tous les jours, l'idéal féminin est sublimé en elle. Alors qu'en Orient orthodoxe, la Vierge représente l'humanité entière portant Dieu, la Théotokos, en Occident, naît et prend son essor l'image de l'« Immaculée Conception », accueillante mais née différente de toutes les autres femmes. Bientôt, l'Église institutionnelle s'identifie à la Vierge Marie, mère de Dieu, mère du Christ, mère du peuple, couronnée aux portails des cathédrales. Dans la tradition catholique, cette conception durera jusqu'à sa dogmatisation au milieu du XXe siècle. Dans la tradition réformée, Luther dénoncera un danger d'idolâtrie mariale, sans réfuter la virginité du coeur, qui permet d'accueillir le miracle d'un Dieu incarné.
Nous parvenons aux moments tragiques qui suivent la peste noire, les misères de la guerre de Cent ans, la poussée inexorable de l'islam puis la chute de Constantinople. Une névrose collective semble alors s'emparer de certains clercs, qui prennent les femmes pour cibles de leurs hantises. Pourquoi ?
Beaucoup de clercs vivent alors dans des cercles universitaires de plus en plus fermés et fondamentalistes. Ce qui est hors-norme doit être éradiqué. L'Inquisition mise en place au XIIIe siècle pour lutter contre les hérésies prend en horreur les savoirs des femmes. Elle se fonde sur une idée de la raison, empruntée à une mauvaise transmission des catégories d'Aristote. Depuis des siècles déjà, les hommes redoutaient les sages-femmes, des herboristes capables de transmettre par oral les secrets de filtres d'amour ou de stérilité. Les lieux de transmission féminine, les lavoirs, les arbres magiques, les lieux d'accouchement, étaient tabous pour l'homme. Seuls les confesseurs avaient écho de ces secrets hérités d'anciens savoirs romains ou préhistoriques. Croyant christianiser les campagnes, ils les condamnaient comme superstitions. À partir du XIVe siècle, les papes eux-mêmes accréditent la fable des sabbats de sorcières. On forme alors des experts en démonologie, inexorablement logiques à partir de postulats absurdes. On sait quels ravages provoquèrent ces hantises - dont la perversité sexuelle est parfois évidente - et quel nombre effrayant de bûchers furent dressés dans toutes les confessions chrétiennes - catholiques, orthodoxes et réformées - et ceci jusqu'au milieu du XVIIIe siècle.
Père de la réforme protestante, Luther est considéré comme un émancipateur. Néanmoins, le luthéranisme semble parfois plus sévère que le catholicisme, pouvez-nous expliquer cette contradiction apparente ?
À l'origine, Luther est un moine augustinien obsédé par l'idée d'enfer. Il ne croit pas au purgatoire, cette sorte de « session de rattrapage » qui, grâce à l'indulgence divine, permet d'espérer un accès différé au Paradis après des années de purification. En monnayant les années d'indulgence de façon éhontée, la papauté de son temps a ruiné cette idée de justice miséricordieuse. Devenu l'émancipateur des crédules, Luther, une fois marié, se trouve débordé par l'ampleur de la révolution qu'il a déclenchée. Calvin, à son tour, organise la réforme genevoise de façon très rigoriste, autour du concept augustinien de prédestination des âmes à l'enfer.
Et au XVIIe siècle ?
Dans la confession catholique, un courant janséniste, rigoriste et largement bourgeois cultive aussi l'angoisse de la prédestination. Un siècle plus tard, ce mouvement prend de l'ampleur, en pleine période des Lumières et d'un libertinage dont les enfants abandonnés font les frais par milliers. Entre ces extrêmes, Voltaire lui-même l'admet, le curé de campagne joue très souvent un rôle de modérateur. C'est lui qui préside aux baptêmes, aux rites de relevailles des femmes. Bien que le secret de la confession ne soit pas trahi, tout nous dit qu'il connaît les souffrances des femmes déchirées en couches, de celles qui enterrent un foetus dans les champs ou qui, en ville, abandonnent leurs enfants sur les marches des églises. Les registres paroissiaux montrent que, de cette époque, datent les premiers symptômes d'espacement volontaire des naissances. Ce modus vivendi semble s'être longtemps maintenu vaille que vaille dans plusieurs régions rurales jusqu'au milieu du XXe siècle, et ceci malgré le respect plus volontiers marqué par l'Église aux familles nombreuses, qui lui donnaient plusieurs enfants comme prêtres ou religieuses.
Et depuis ?
On mesure mal aujourd'hui à quel point les femmes du XIXe siècle, et même du premier XXe siècle, furent écrasées par une éducation culpabilisante, qui débordait de beaucoup le domaine de la sexualité. Sans même évoquer le « péché de chair » si effrayant qu'ils le taisent et se gardent bien de citer la Bible qui en parle, les missels à l'usage des femmes ne cessent de dire que communier en état de péché, c'est signer sa condamnation éternelle. Les maris se défendent par l'incrédulité et l'infidélité, mais, au moins dans le milieu bourgeois, les femmes ont peu d'échappatoires. L'abnégation et le sacrifice sont présentés comme les fleurons de leurs vertus « naturelles » (2).
La révolution de la sexualité au coeur des couples de tradition chrétienne n'est pas venue de l'Église, mais de la médecine. Elle date de la découverte du cycle hormonal féminin, dans les années 1930, puis, en 1955, de la synthèse chimique des hormones permettant à la femme d'échapper à la liaison inexorable entre l'union des corps et la fécondation d'un ovule. Par peur de ce qu'elle ne maîtrise pas et parfois ne comprend pas, l'Église catholique, à la différence des Églises réformées, s'engage alors dans une voie qui autorise la dissociation entre la sexualité et la procréation, mais à condition d'employer des méthodes décrétées naturelles... et d'une inefficacité notoire. Deux décennies après Humanae Vitae, publiée en juillet 1968, la majorité des couples catholiques avaient déjà fait leur choix. Ils avaient abandonné le médecin des âmes pour consulter le médecin des corps et, s'il le fallait, le psychanalyste. Ce changement fut capital pour l'Église, qui perdit l'antique proximité qu'elle entretenait avec les familles. L'erreur d'Humane Vitae fut, me semble-t-il, d'avoir tenté d'introduire un Diafoirus dans des millions de chambres d'époux. L'attitude chrétienne est plutôt de sacraliser le couple en le responsabilisant.
(1) L'Art d'aimer, Ovide, mort en 17 (Librio, 2005).
(2) Recueil de prières, comtesse de Flavigny (Mame, 1868).
Élisabeth Dufourcq
 Re: Sexe et Religion
Re: Sexe et Religion
Le sexe et les religions
[ltr]La veine amoureuse en islam[/ltr]
Inspirée de l'amour de Dieu, l'exaltation des sentiments prime, dans le monde musulman, sur celle des sens : si le rapport à la jouissance est bien une des constantes de la parole prophétique et de la littérature ancienne, les plaisirs de la chair ont été progressivement récusés par les docteurs de la loi.
La question du plaisir et de la jouissance en islam est stratégique à plus d'un titre. Elle est l'argument principal de l'harmonie au sein du couple. Elle structure les rapports de celui-ci avec la famille, le clan et la société tout entière. Elle est enfin un indice d'appréciation du « bonheur » au sein de l'islam, ou au moins de sa représentation, sans compter qu'elle est l'une des constantes de la parole prophétique. Le Coran évoque sans fard la question de la sexualité dans plus de 82 versets. La sexualité comme thème distinct est nommée dans les sourates suivantes : II, 187, 222 ; IV, 15-16, 21 ; V, 3 ; XV, 68. Quant aux sous-thèmes, ils sont extrêmement variés et forment une sorte de nomenclature sexuelle, un programme, avec son périmètre du possible (le permis, halal) et ses empêchements dogmatiques (haram). Voici les plus saillants : la nudité du couple adamique, la chasteté pré-maritale, la continence, beauté, séduction et luxure, la tentation et son antidote, la retenue, le mariage et son extrapolation, la polygamie, l'adultère, la débauche, la fornication, la répudiation, la jalousie, la place des eunuques, la froideur sexuelle, la flagellation du couple adultère, l'interdit de l'homosexualité (en relation avec l'histoire de Loth), la s........, le voilement des femmes, la projection fantasmatique des houris et des épouses du Paradis. Plusieurs dizaines de versets sont consacrées au régime matrimonial, au comportement idéal de la femme au sein de la famille, au rôle des enfants et le respect qu'ils doivent aux aînés. En islam, toute sexualité hors mariage est proscrite, tant pour les femmes que pour les hommes. Une évidence saute aux yeux : le périmètre idéal de la sexualité est une constante du Livre sacré et traverse le corpus du hadith du Prophète, en sachant que Mohammed (570-632) demeure in fine le meilleur exégète du Coran. Plusieurs indices objectifs montrent que la veine amoureuse s'est harmonieusement développée en terre arabe, avant, pendant et après l'avènement de l'islam. De fait, ce sont les poèmes courtois de l'antéislam qui nous alertent sur la sincérité d'une pléiade d'auteurs ayant chanté l'absence de la bien-aimée, et le miel des retrouvailles dans le faux de la dune. Au cours de la prédication, le Prophète en personne innove dans ce domaine, en réaffirmant haut et fort tout le bien qu'il pense des femmes, ce qui apparaît très distinctement dans L'Authentique (le Sahih) d'Al-Boukhari (810-870), un ouvrage de compilation qui fait foi. Par ailleurs, un grand nombre de règles aujourd'hui observées dans le domaine des relations amoureuses remontent à cet islam premier. Peu de temps après la prédication, commence l'ère des législateurs (fûqaha) et leur cortège d'édits (fetwas), de plus en plus restrictifs et contraignants. Mais peut-on vraiment enfermer le désir, lorsque toutes les raisons et déraisons de l'être humain poussent à l'idolâtrer ? Le corps et ses appétits sexuels, la beauté et ses ensorcellements, l'esprit et son subtil vagabondage, la société et ses propres exigences, et la famille dans cela, qui cherche à canaliser la libido des jeunes pousses...
Un langage riche et précis
L'un des indices de cet épanouissement est le langage amoureux, celui de la langue arabe, qui demeure aux yeux des musulmans la langue du sacré par excellence. Et ce répertoire est impressionnant par sa richesse et sa précision : une centaine de mots pour dire « Je t'aime », et plus encore pour exprimer la conquête amoureuse, la passion, le désir, le plaisir sexuel, l'acte de chair et la libération qui s'ensuit. Ainsi, le mot tahayyûj, qui signifie « être excité, éprouver une forte inclinaison pour quelqu'un, le vouloir charnellement ». En langue arabe, le mot est évocateur au point de vue de la sémantique, mais aussi dans sa phonétique, car c'est de mer en furie dont il s'agit, comme si le désir qui vient par vagues s'amasse à la surface du corps avant d'exploser. Un autre mot, ghûlma, soit la base biologique du désir, son substrat organique, son instinct (ghariza). Aussi, l'expression hâjat ghûlmatûhu signifie tout simplement que sa passion charnelle déborde. Pour montrer cette diversité, voici une dizaine d'autres termes employés par les amants, tout autant que les juges, les théologiens et les écrivains : 'ichq, pour désigner la passion amoureuse ; la chahwa, son interface biologique, l'instinct sexuel ; al-hûbb, l'amour, avec toutes ses variantes, dont al-hûbb al-ûdhri, l'amour chaste ou amour courtois, mais aussi hawa, mahibba et mawadda, amours aux accents spirituels, y compris ceux que l'on éprouve pour Dieu. Le plaisir, les agaceries amoureuses et la satisfaction sont appelés ladha, moula'aba et tamattû'. La faute sexuelle est dite zina, elle est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes. La femme est dite mûtabarrija, lorsqu'elle manifeste une trop grande liberté de mœurs. Le mot 'awra, littéralement « aveugle », désigne les organes sexuels. La discrétion voudrait qu'on les cache au hammam, c'est le kachf al-'awra. L'amour homosexuel est dit al-hûbb al-lûthi, tandis que la lesbienne est identifiée de manière imprécise (et plutôt négativement) par le mot de sihaq, mûsahaqa.
« Badinage » et « courtoisies »
L'art de la conversation et la connivence entre deux êtres sont évoqués dans un traité de Ibn Hayyan at-Tawhidi (Xe siècle), intitulé Al-Imta' wal-mû'anassa (De la délectation et de la (belle) compagnie). Il y est notamment question de « badinage sexuel, de courtoisies amoureuses, de douceur ». Les mêmes items sont traités par un nombre significatif de grammairiens, de poètes, de prosateurs et d'amoureux assez régulièrement éconduits. Ils ont pour noms Ibn Dawûd (868-910), auteur du Livre de la rose (Kitab az-zahra), qui pourrait être la première codification de l'amour courtois ; Ibn Hazm (993-1064), avec son Collier de la colombe (Tawq al-hamama), un récit de psychologie amoureuse ; le poète andalou Ibn Zaydûn (1003-1071) et même le chroniqueur avisé de Bagdad aux premiers temps des Abbassides, Al-Jahiz (776-868 ou 869). Celui-ci n'a pas cessé de décrire le comportement des buveurs de vin, des prostituées, des esclaves chanteuses, des mignons et des débauchés. Plus tard, en une deuxième vague, ce sont les mystiques et autres érudits, les « théologiens de l'amour », qui reprendront le flambeau de la vénération amoureuse, en produisant des traités extrêmement élaborés sur l'amour de Dieu et son_avatar humain, la passion. Ces mystiques ont pour noms Al-Jounayd, Ad-Daylami, Chibli, Sarradj, Rûmi, Ghazali, Ibn al-Jawziya et Ibn'Arabi (1165-1241), auteur de ces vers : « Quand je sus que l'amour était inestimable, sans que pourtant j'eusse d'emprise sur lui. Jusqu'au terme de ma vie, je m'épris à jamais de l'amour de l'amour [hûbb al-hûbb] ! »
Le bien-vivre en terre d'Allah
Enfin, une troisième vague, plus affranchie encore que les deux premières, s'est lancée dans la littérature érotique et amoureuse, parfois très crue. Plusieurs grands maîtres ont marqué les trois siècles les plus « chauds » de l'islam, à savoir les XIVe, XVe et XVIe siècles. Deux d'entre eux nous ont laissé des opuscules puissamment charpentés et libres (et libertins) de bout en bout. Si le plus connu est Chaykh An-Nafzaoui (XVe siècle), l'auteur du Jardin parfumé, il en est un autre que peu de gens connaissent, car il n'est pas encore traduit en français, c'est Ibn Foulayta (XIVe siècle), auteur d'une sorte de Kama Soutra arabe, intitulé Le Guide de l'éveillé pour la fréquentation du bien-aimé. La constante coranique s'est transformée au fil du temps en une nécessité de fait, et pour avoir cumulé tant de réflexions et tant de récits, la sexualité est devenue un article majeur du bien-vivre dans les terres d'Allah. Pourtant, quatorze siècles plus tard, et alors même que tous nos classiques arabes (dont certains, comme Les Mille et une nuits, sont devenus universels) rendent compte de la faconde avec laquelle les Arabes anciens ont abordé ces thèmes, la question de la jouissance sexuelle en islam est de nouveau très problématique. Que s'est-il passé depuis pour qu'on en arrive à l'affaissement d'aujourd'hui, avec des atrocités sans nom, comme l'excision qui progresse encore en Égypte et au Soudan, ou l'engraissement des Mauritaniennes avant leur mariage arrangé, ou encore la servitude sexuelle des épouses (en Afghanistan, récemment), le mariage de vieillards pédophiles avec des fillettes à peine nubiles (toujours à la frontière du Pakistan et de l'Afghanistan) et la vénalité de certaines unions, conçues dans le seul but d'élargir le cheptel féminin des grandes maisons ? Faut-il seulement se rappeler que dans De l'amour, paru en 1822, Stendhal écrivait encore : « C'est sous la tente noirâtre de l'Arabe-Bédouin qu'il faut chercher le modèle et la patrie du véritable amour. Là comme ailleurs, la solitude et un beau climat ont fait naître la plus noble des passions du cœur humain... » ? Et de poursuivre son analyse dithyrambique sur plusieurs pages, en faisant remarquer que dans ces contrées éloignées, bien que sèches et arides, il y avait encore des jeunes qui mourraient d'amour, ou plus exactement qui préservaient leur chasteté, quitte à mourir de consomption pour la bien-aimée, sans jamais la toucher, car cela reviendrait à l'offenser aux yeux de sa société.
Chasteté, honneur et rigidité
Or, toutes les notions dont il est question ici - chasteté, amour, honneur - sont les ingrédients d'une culture chevaleresque qui a prospéré sans retenue avant l'arrivée de l'islam. Depuis, on le sait, cette culture est certes observée par quelques raffinés qui ne croient plus à la nécessité de se battre pour imposer leurs choix, et encore moins aller contre la gouvernance rigide de la société actuelle. Monde arabe et islam, tradition et modernité : telle est la dualité dans laquelle il faut camper le récit amoureux ou, pour le dire autrement, il s'agit bien d'amour et de sentiment amoureux, et non pas forcément de sexualité, car elle semble aujourd'hui bien plus carencée que par le passé. En l'état, le monde musulman présente les deux facettes : celle des pères fouettards d'Iran, d'Afghanistan et d'Arabie, puisque l'édifice de leur « contrainte légitime » n'existe que par la chasse qu'ils mènent à la jouissance individuelle et à tout plaisir de la chair. De l'autre, un monde de jouisseurs impénitents, doux et amers à la fois, qui préfèrent se cacher ou s'exiler pour donner libre cours à leurs passions.
Un champ de l'imaginaire exigu
Cet autre monde est plus intimiste, plus secret. Il est celui que décrivent les écrivains voyageurs du XVIIIe siècle, en particulier les Français. Ils n'y ont vu malheureusement que l'écume des choses, une transmutation, ce qui explique les conséquences inattendues de leurs narrations : un Orient trop violemment sexuel et répondant aux qualificatifs peu flatteurs de lupanar géant, harem pour courtisanes soumises ou salon de beauté privatif où l'on cultive mollesse et oisiveté. Toujours, la même dualité, la même ligne de démarcation entre deux sociétés antinomiques qui se font face. La seconde est libérale et minoritaire. Elle prône la séparation du politique et du religieux, le droit au plaisir, la liberté de choix, notamment le choix d'épouser tel ou tel, le choix de divorcer, etc. La première est plus conservatrice, avec un champ de l'imaginaire par trop exigu. C'est cette seconde société qui a le vent en poupe aujourd'hui, raison pour laquelle toute attitude non-conforme est condamnée d'avance, réprimée, tandis que son auteur est vertement tancé, voire persécuté. Faut-il conclure ? En observant le matériau réuni depuis une vingtaine d'années par une pléiade d'auteurs venus d'horizons divers, on se rend compte des différentes strates qui organisent de manière invisible, voire clandestine, l'ensemble des émois. La femme éprouve le besoin de s'émanciper du carcan familial, mais n'a pas l'énergie suffisante pour sauter dans l'inconnu. Si dans les années 1970, les femmes pouvaient encore espérer un sursaut en leur faveur, notamment en matière de choix sexuels, la crispation actuelle caractérisée par l'islamisme politique et son pendant culturel, le fondamentaliste, a rayé d'un seul trait toutes leurs attentes. De son côté, l'homme veut bien encore consacrer quelques bougies en l'honneur de son dieu Éros, mais à condition que cela reste dans la stricte intimité de son couple et sans trop de fantaisie. Du coup, l'ensemble du corps social éprouve le malaise que les individus ressassent pour eux-mêmes. La sexualité est certes une belle promesse, mais les tabous ne tardent jamais à vouloir l'étouffer. De la jouissance effrénée des esprits les plus fins, on se retrouve avec une explosion sans précédent de mariages arrangés et sans joie, avec une surveillance accrue et un souci obsessionnel de la pureté morale qui, comme chacun sait, n'existe nulle part dans le monde...
Malek Chebel
Anthropologue des religions, spécialiste de l'islam. Il est l'auteur d'une nouvelle traduction du Coran (Fayard, 2009) et du Dictionnaire encyclopédique du Coran (Fayard, 2009).
[ltr]La veine amoureuse en islam[/ltr]
Inspirée de l'amour de Dieu, l'exaltation des sentiments prime, dans le monde musulman, sur celle des sens : si le rapport à la jouissance est bien une des constantes de la parole prophétique et de la littérature ancienne, les plaisirs de la chair ont été progressivement récusés par les docteurs de la loi.
La question du plaisir et de la jouissance en islam est stratégique à plus d'un titre. Elle est l'argument principal de l'harmonie au sein du couple. Elle structure les rapports de celui-ci avec la famille, le clan et la société tout entière. Elle est enfin un indice d'appréciation du « bonheur » au sein de l'islam, ou au moins de sa représentation, sans compter qu'elle est l'une des constantes de la parole prophétique. Le Coran évoque sans fard la question de la sexualité dans plus de 82 versets. La sexualité comme thème distinct est nommée dans les sourates suivantes : II, 187, 222 ; IV, 15-16, 21 ; V, 3 ; XV, 68. Quant aux sous-thèmes, ils sont extrêmement variés et forment une sorte de nomenclature sexuelle, un programme, avec son périmètre du possible (le permis, halal) et ses empêchements dogmatiques (haram). Voici les plus saillants : la nudité du couple adamique, la chasteté pré-maritale, la continence, beauté, séduction et luxure, la tentation et son antidote, la retenue, le mariage et son extrapolation, la polygamie, l'adultère, la débauche, la fornication, la répudiation, la jalousie, la place des eunuques, la froideur sexuelle, la flagellation du couple adultère, l'interdit de l'homosexualité (en relation avec l'histoire de Loth), la s........, le voilement des femmes, la projection fantasmatique des houris et des épouses du Paradis. Plusieurs dizaines de versets sont consacrées au régime matrimonial, au comportement idéal de la femme au sein de la famille, au rôle des enfants et le respect qu'ils doivent aux aînés. En islam, toute sexualité hors mariage est proscrite, tant pour les femmes que pour les hommes. Une évidence saute aux yeux : le périmètre idéal de la sexualité est une constante du Livre sacré et traverse le corpus du hadith du Prophète, en sachant que Mohammed (570-632) demeure in fine le meilleur exégète du Coran. Plusieurs indices objectifs montrent que la veine amoureuse s'est harmonieusement développée en terre arabe, avant, pendant et après l'avènement de l'islam. De fait, ce sont les poèmes courtois de l'antéislam qui nous alertent sur la sincérité d'une pléiade d'auteurs ayant chanté l'absence de la bien-aimée, et le miel des retrouvailles dans le faux de la dune. Au cours de la prédication, le Prophète en personne innove dans ce domaine, en réaffirmant haut et fort tout le bien qu'il pense des femmes, ce qui apparaît très distinctement dans L'Authentique (le Sahih) d'Al-Boukhari (810-870), un ouvrage de compilation qui fait foi. Par ailleurs, un grand nombre de règles aujourd'hui observées dans le domaine des relations amoureuses remontent à cet islam premier. Peu de temps après la prédication, commence l'ère des législateurs (fûqaha) et leur cortège d'édits (fetwas), de plus en plus restrictifs et contraignants. Mais peut-on vraiment enfermer le désir, lorsque toutes les raisons et déraisons de l'être humain poussent à l'idolâtrer ? Le corps et ses appétits sexuels, la beauté et ses ensorcellements, l'esprit et son subtil vagabondage, la société et ses propres exigences, et la famille dans cela, qui cherche à canaliser la libido des jeunes pousses...
Un langage riche et précis
L'un des indices de cet épanouissement est le langage amoureux, celui de la langue arabe, qui demeure aux yeux des musulmans la langue du sacré par excellence. Et ce répertoire est impressionnant par sa richesse et sa précision : une centaine de mots pour dire « Je t'aime », et plus encore pour exprimer la conquête amoureuse, la passion, le désir, le plaisir sexuel, l'acte de chair et la libération qui s'ensuit. Ainsi, le mot tahayyûj, qui signifie « être excité, éprouver une forte inclinaison pour quelqu'un, le vouloir charnellement ». En langue arabe, le mot est évocateur au point de vue de la sémantique, mais aussi dans sa phonétique, car c'est de mer en furie dont il s'agit, comme si le désir qui vient par vagues s'amasse à la surface du corps avant d'exploser. Un autre mot, ghûlma, soit la base biologique du désir, son substrat organique, son instinct (ghariza). Aussi, l'expression hâjat ghûlmatûhu signifie tout simplement que sa passion charnelle déborde. Pour montrer cette diversité, voici une dizaine d'autres termes employés par les amants, tout autant que les juges, les théologiens et les écrivains : 'ichq, pour désigner la passion amoureuse ; la chahwa, son interface biologique, l'instinct sexuel ; al-hûbb, l'amour, avec toutes ses variantes, dont al-hûbb al-ûdhri, l'amour chaste ou amour courtois, mais aussi hawa, mahibba et mawadda, amours aux accents spirituels, y compris ceux que l'on éprouve pour Dieu. Le plaisir, les agaceries amoureuses et la satisfaction sont appelés ladha, moula'aba et tamattû'. La faute sexuelle est dite zina, elle est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes. La femme est dite mûtabarrija, lorsqu'elle manifeste une trop grande liberté de mœurs. Le mot 'awra, littéralement « aveugle », désigne les organes sexuels. La discrétion voudrait qu'on les cache au hammam, c'est le kachf al-'awra. L'amour homosexuel est dit al-hûbb al-lûthi, tandis que la lesbienne est identifiée de manière imprécise (et plutôt négativement) par le mot de sihaq, mûsahaqa.
« Badinage » et « courtoisies »
L'art de la conversation et la connivence entre deux êtres sont évoqués dans un traité de Ibn Hayyan at-Tawhidi (Xe siècle), intitulé Al-Imta' wal-mû'anassa (De la délectation et de la (belle) compagnie). Il y est notamment question de « badinage sexuel, de courtoisies amoureuses, de douceur ». Les mêmes items sont traités par un nombre significatif de grammairiens, de poètes, de prosateurs et d'amoureux assez régulièrement éconduits. Ils ont pour noms Ibn Dawûd (868-910), auteur du Livre de la rose (Kitab az-zahra), qui pourrait être la première codification de l'amour courtois ; Ibn Hazm (993-1064), avec son Collier de la colombe (Tawq al-hamama), un récit de psychologie amoureuse ; le poète andalou Ibn Zaydûn (1003-1071) et même le chroniqueur avisé de Bagdad aux premiers temps des Abbassides, Al-Jahiz (776-868 ou 869). Celui-ci n'a pas cessé de décrire le comportement des buveurs de vin, des prostituées, des esclaves chanteuses, des mignons et des débauchés. Plus tard, en une deuxième vague, ce sont les mystiques et autres érudits, les « théologiens de l'amour », qui reprendront le flambeau de la vénération amoureuse, en produisant des traités extrêmement élaborés sur l'amour de Dieu et son_avatar humain, la passion. Ces mystiques ont pour noms Al-Jounayd, Ad-Daylami, Chibli, Sarradj, Rûmi, Ghazali, Ibn al-Jawziya et Ibn'Arabi (1165-1241), auteur de ces vers : « Quand je sus que l'amour était inestimable, sans que pourtant j'eusse d'emprise sur lui. Jusqu'au terme de ma vie, je m'épris à jamais de l'amour de l'amour [hûbb al-hûbb] ! »
Le bien-vivre en terre d'Allah
Enfin, une troisième vague, plus affranchie encore que les deux premières, s'est lancée dans la littérature érotique et amoureuse, parfois très crue. Plusieurs grands maîtres ont marqué les trois siècles les plus « chauds » de l'islam, à savoir les XIVe, XVe et XVIe siècles. Deux d'entre eux nous ont laissé des opuscules puissamment charpentés et libres (et libertins) de bout en bout. Si le plus connu est Chaykh An-Nafzaoui (XVe siècle), l'auteur du Jardin parfumé, il en est un autre que peu de gens connaissent, car il n'est pas encore traduit en français, c'est Ibn Foulayta (XIVe siècle), auteur d'une sorte de Kama Soutra arabe, intitulé Le Guide de l'éveillé pour la fréquentation du bien-aimé. La constante coranique s'est transformée au fil du temps en une nécessité de fait, et pour avoir cumulé tant de réflexions et tant de récits, la sexualité est devenue un article majeur du bien-vivre dans les terres d'Allah. Pourtant, quatorze siècles plus tard, et alors même que tous nos classiques arabes (dont certains, comme Les Mille et une nuits, sont devenus universels) rendent compte de la faconde avec laquelle les Arabes anciens ont abordé ces thèmes, la question de la jouissance sexuelle en islam est de nouveau très problématique. Que s'est-il passé depuis pour qu'on en arrive à l'affaissement d'aujourd'hui, avec des atrocités sans nom, comme l'excision qui progresse encore en Égypte et au Soudan, ou l'engraissement des Mauritaniennes avant leur mariage arrangé, ou encore la servitude sexuelle des épouses (en Afghanistan, récemment), le mariage de vieillards pédophiles avec des fillettes à peine nubiles (toujours à la frontière du Pakistan et de l'Afghanistan) et la vénalité de certaines unions, conçues dans le seul but d'élargir le cheptel féminin des grandes maisons ? Faut-il seulement se rappeler que dans De l'amour, paru en 1822, Stendhal écrivait encore : « C'est sous la tente noirâtre de l'Arabe-Bédouin qu'il faut chercher le modèle et la patrie du véritable amour. Là comme ailleurs, la solitude et un beau climat ont fait naître la plus noble des passions du cœur humain... » ? Et de poursuivre son analyse dithyrambique sur plusieurs pages, en faisant remarquer que dans ces contrées éloignées, bien que sèches et arides, il y avait encore des jeunes qui mourraient d'amour, ou plus exactement qui préservaient leur chasteté, quitte à mourir de consomption pour la bien-aimée, sans jamais la toucher, car cela reviendrait à l'offenser aux yeux de sa société.
Chasteté, honneur et rigidité
Or, toutes les notions dont il est question ici - chasteté, amour, honneur - sont les ingrédients d'une culture chevaleresque qui a prospéré sans retenue avant l'arrivée de l'islam. Depuis, on le sait, cette culture est certes observée par quelques raffinés qui ne croient plus à la nécessité de se battre pour imposer leurs choix, et encore moins aller contre la gouvernance rigide de la société actuelle. Monde arabe et islam, tradition et modernité : telle est la dualité dans laquelle il faut camper le récit amoureux ou, pour le dire autrement, il s'agit bien d'amour et de sentiment amoureux, et non pas forcément de sexualité, car elle semble aujourd'hui bien plus carencée que par le passé. En l'état, le monde musulman présente les deux facettes : celle des pères fouettards d'Iran, d'Afghanistan et d'Arabie, puisque l'édifice de leur « contrainte légitime » n'existe que par la chasse qu'ils mènent à la jouissance individuelle et à tout plaisir de la chair. De l'autre, un monde de jouisseurs impénitents, doux et amers à la fois, qui préfèrent se cacher ou s'exiler pour donner libre cours à leurs passions.
Un champ de l'imaginaire exigu
Cet autre monde est plus intimiste, plus secret. Il est celui que décrivent les écrivains voyageurs du XVIIIe siècle, en particulier les Français. Ils n'y ont vu malheureusement que l'écume des choses, une transmutation, ce qui explique les conséquences inattendues de leurs narrations : un Orient trop violemment sexuel et répondant aux qualificatifs peu flatteurs de lupanar géant, harem pour courtisanes soumises ou salon de beauté privatif où l'on cultive mollesse et oisiveté. Toujours, la même dualité, la même ligne de démarcation entre deux sociétés antinomiques qui se font face. La seconde est libérale et minoritaire. Elle prône la séparation du politique et du religieux, le droit au plaisir, la liberté de choix, notamment le choix d'épouser tel ou tel, le choix de divorcer, etc. La première est plus conservatrice, avec un champ de l'imaginaire par trop exigu. C'est cette seconde société qui a le vent en poupe aujourd'hui, raison pour laquelle toute attitude non-conforme est condamnée d'avance, réprimée, tandis que son auteur est vertement tancé, voire persécuté. Faut-il conclure ? En observant le matériau réuni depuis une vingtaine d'années par une pléiade d'auteurs venus d'horizons divers, on se rend compte des différentes strates qui organisent de manière invisible, voire clandestine, l'ensemble des émois. La femme éprouve le besoin de s'émanciper du carcan familial, mais n'a pas l'énergie suffisante pour sauter dans l'inconnu. Si dans les années 1970, les femmes pouvaient encore espérer un sursaut en leur faveur, notamment en matière de choix sexuels, la crispation actuelle caractérisée par l'islamisme politique et son pendant culturel, le fondamentaliste, a rayé d'un seul trait toutes leurs attentes. De son côté, l'homme veut bien encore consacrer quelques bougies en l'honneur de son dieu Éros, mais à condition que cela reste dans la stricte intimité de son couple et sans trop de fantaisie. Du coup, l'ensemble du corps social éprouve le malaise que les individus ressassent pour eux-mêmes. La sexualité est certes une belle promesse, mais les tabous ne tardent jamais à vouloir l'étouffer. De la jouissance effrénée des esprits les plus fins, on se retrouve avec une explosion sans précédent de mariages arrangés et sans joie, avec une surveillance accrue et un souci obsessionnel de la pureté morale qui, comme chacun sait, n'existe nulle part dans le monde...
Malek Chebel
Anthropologue des religions, spécialiste de l'islam. Il est l'auteur d'une nouvelle traduction du Coran (Fayard, 2009) et du Dictionnaire encyclopédique du Coran (Fayard, 2009).
 Re: Sexe et Religion
Re: Sexe et Religion
Le sexe et les religions
[ltr]La jouissance taoïste, un art de la longévité[/ltr]
La gestion de la sexualité dans le taoïsme passe par une régulation des forces yin et yang entre partenaires masculin et féminin. Son but : favoriser l'harmonie interne de chacun, afin de régénérer sa vitalité.
Depuis l'Antiquité, deux sources nourrissent la Chine sédentaire : le confucianisme et le taoïsme. Le premier considère la vie en société comme essentielle et place la vertu d'humanité au sommet de ses préoccupations ; le second, plus intime, se donne la joie de vivre le plus possible comme objectif primordial. À la base de ces deux enseignements, se trouve l'idée qu'à chaque être vivant est attribué à sa naissance un lot, une durée de vie. Cette sorte de capital « énergétique » se manifeste extérieurement par une place dans sa famille et dans la société ; et intérieurement par une incarnation physique, une santé spécifique. Si le confucianisme va se porter sur la gestion sociale de ce capital de départ, le taoïsme lui va chercher à le développer au niveau personnel. C'est pourquoi tous les arts physiques chinois se sont épanouis sous son obédience. Tous, en effet, ont le même objectif : yang sheng ; littéralement, « nourrir le vivre », qui ne connaît ni début ni fin, un trésor dont chacun des 10 000 êtres vivants porte une parcelle en lui. Seul l'être humain, qu'aucune destinée religieuse ne différencie des autres créatures vivantes, a une particularité spécifique : la conscience qu'il a de cette réalité, et donc la possibilité d'agir sur ce capital reçu à la naissance, en le diminuant par une conduite dissolue ou en le renforçant par une conduite appropriée. C'est dans ce cadre que se construit la vision taoïste de la sexualité.
Un exercice sérieux, total
Tout ce qui existe résulte d'un entrecroisement du yin et du yang - ces composants déterminent pour chaque être des propensions spécifiques. L'éclair, par exemple, violent et intense, est bien plus chargé de yang que la montagne ; il lui manque la durable stabilité. La montagne, de son côté, a besoin de la pluie féconde que l'éclair déclenche pour se couvrir de verdure. Il en est de même pour les humains en général, et pour leur comportement sexuel en particulier. La manifestation masculine de la sexualité sera plus yang, extérieure, rapide, superficielle ; et sa forme féminine plus yin, intérieure, lente et profonde. Mais le yin et le yang ne sont pas l'homme et la femme, ce ne sont que des essences, des fluides dont chaque sexe est porteur. C'est pourquoi leur réunion est favorable à cet échange, mais à la double condition que cet échange se produise et qu'alors il soit régulé. La sexualité devient un exercice sérieux, total, mobilisant tout ce que nous sommes pour une régulation et une augmentation de la vitalité.
Pour cela, la jouissance de chacun des partenaires est essentielle. Mais pour qu'elle ait lieu, il faut que soit prise en compte la différence avec laquelle chacun y parvient. La jouissance masculine est yang, simple, directe, « mécanique » ; la jouissance féminine est yin, plus profonde, plus mystérieuse. Le premier enseignement de la sexualité taoïste est que l'homme doit provoquer la jouissance de sa partenaire s'il veut bénéficier des bienfaits du « Tao de l'art d'aimer » (lire plus loin).
On comprend mieux alors pourquoi les enseignements de la sexualité taoïste s'adressent majoritairement aux hommes : parce que la régulation de la sexualité est un domaine où les hommes ont beaucoup plus à apprendre que les femmes. Cela ne tient à aucun primat du yang, mais simplement à la conjonction de deux faits : tous les êtres vivants, qu'ils soient hommes ou femmes, parce qu'ils sont vivants, chauds, mobiles, sont naturellement du côté du yang et, pour des raisons bien plus culturelles que naturelles, les hommes sont plus réceptifs aux conduites yang et les femmes aux conduites yin. La sagesse chinoise en a tiré une conclusion efficace, trop souvent négligée tant par les Occidentaux que par les Chinois : la stratégie yang, naturelle chez tous les vivants, n'a pas besoin d'être cultivée. C'est la stratégie yin, moins « évidente » mais plus efficace, qui doit être mise en oeuvre résolument, car elle est source de multiples bienfaits.
Cette prise de position, qui est également à la base du judo - dit la « voie de la souplesse » ou la « voie du yin » -, fonde la gestion taoïste de la sexualité, dans une optique de régénération de la vitalité. Celle-ci est exposée dans le Su Nu Jing, littéralement le Classique de la fille de candeur. Cet ouvrage fondateur se présente sous la forme d'un dialogue entre Huang Di, l'Empereur jaune - personnage mythologique à l'origine de la nation chinoise et au coeur de la tradition taoïste - avec Su Nu, littéralement la « fille de candeur », son instructrice dans l'art d'utiliser la sexualité bien tempérée pour atteindre la longévité. De ce vieux classique, Jolan Chang, un taoïste chinois, a tiré une adaptation moderne : Le Tao de l'art d'aimer(Calmann-Lévy, 1994), un ouvrage que tout homme découvre toujours trop tard et qui devrait être glissé sur la table de nuit des jeunes adolescents, afin de découvrir la sexualité sous un jour moins angoissant. Son idée de base est la dissociation entre jouissance et éjaculation : pour que l'échange des essences yin et yang se fasse, l'orgasme des deux partenaires est nécessaire ; mais pour qu'il soit énergétiquement vivifiant, il faut qu'ils y parviennent sans qu'il y ait éjaculation.
Une « habitude néfaste »
La femme doit pour cela développer en elle sa composante yang pour émettre son essence yin vers l'homme qui, de son côté, doit privilégier sa composante yin pour la recevoir. Chacun a besoin de la jouissance de l'autre pour augmenter son harmonie interne. Jolan Chang le spécifie bien : « C'est par habitude que nous qualifions l'éjaculation de point suprême du plaisir masculin, habitude néfaste, dans laquelle les puritanismes ont enraciné le sentiment tragique qui encombre la sexualité occidentale. À la "petite mort", le taoïsme oppose la grande vie cosmique que la maîtrise de l'éjaculation permet à chacun d'approcher. On lit en effet dans le Su Nu Jing : "On croit en général que l'homme tire un grand plaisir de l'éjaculation. Mais lorsqu'il apprendra l'art taoïste d'aimer, il éjaculera de moins en moins. Son plaisir n'en diminuera-t-il pas ?" À quoi son interlocuteur répond : "Absolument pas. Après l'éjaculation, l'homme est fatigué, ses oreilles bourdonnent, ses yeux sont alourdis, et il aspire au sommeil. Il a soif et ses membres sont inertes et ankylosés. Pendant l'éjaculation, il éprouve un bref instant de joie, mais il en résulte ensuite de longues heures de lassitude. Ce n'est pas vraiment de la volupté. Si au contraire, l'homme réduit et contrôle son éjaculation, son corps en sera fortifié, son esprit s'en trouvera ragaillardi, son ouïe plus fine et sa vue plus perçante. En maîtrisant la sensation que lui procure l'éjaculation, l'amour qu'il éprouve pour la femme grandit. C'est comme s'il ne pouvait la posséder en suffisance. Comment peut-on dire que ceci n'est pas une infinie volupté ?" »
[ltr]La jouissance taoïste, un art de la longévité[/ltr]
La gestion de la sexualité dans le taoïsme passe par une régulation des forces yin et yang entre partenaires masculin et féminin. Son but : favoriser l'harmonie interne de chacun, afin de régénérer sa vitalité.
Depuis l'Antiquité, deux sources nourrissent la Chine sédentaire : le confucianisme et le taoïsme. Le premier considère la vie en société comme essentielle et place la vertu d'humanité au sommet de ses préoccupations ; le second, plus intime, se donne la joie de vivre le plus possible comme objectif primordial. À la base de ces deux enseignements, se trouve l'idée qu'à chaque être vivant est attribué à sa naissance un lot, une durée de vie. Cette sorte de capital « énergétique » se manifeste extérieurement par une place dans sa famille et dans la société ; et intérieurement par une incarnation physique, une santé spécifique. Si le confucianisme va se porter sur la gestion sociale de ce capital de départ, le taoïsme lui va chercher à le développer au niveau personnel. C'est pourquoi tous les arts physiques chinois se sont épanouis sous son obédience. Tous, en effet, ont le même objectif : yang sheng ; littéralement, « nourrir le vivre », qui ne connaît ni début ni fin, un trésor dont chacun des 10 000 êtres vivants porte une parcelle en lui. Seul l'être humain, qu'aucune destinée religieuse ne différencie des autres créatures vivantes, a une particularité spécifique : la conscience qu'il a de cette réalité, et donc la possibilité d'agir sur ce capital reçu à la naissance, en le diminuant par une conduite dissolue ou en le renforçant par une conduite appropriée. C'est dans ce cadre que se construit la vision taoïste de la sexualité.
Un exercice sérieux, total
Tout ce qui existe résulte d'un entrecroisement du yin et du yang - ces composants déterminent pour chaque être des propensions spécifiques. L'éclair, par exemple, violent et intense, est bien plus chargé de yang que la montagne ; il lui manque la durable stabilité. La montagne, de son côté, a besoin de la pluie féconde que l'éclair déclenche pour se couvrir de verdure. Il en est de même pour les humains en général, et pour leur comportement sexuel en particulier. La manifestation masculine de la sexualité sera plus yang, extérieure, rapide, superficielle ; et sa forme féminine plus yin, intérieure, lente et profonde. Mais le yin et le yang ne sont pas l'homme et la femme, ce ne sont que des essences, des fluides dont chaque sexe est porteur. C'est pourquoi leur réunion est favorable à cet échange, mais à la double condition que cet échange se produise et qu'alors il soit régulé. La sexualité devient un exercice sérieux, total, mobilisant tout ce que nous sommes pour une régulation et une augmentation de la vitalité.
Pour cela, la jouissance de chacun des partenaires est essentielle. Mais pour qu'elle ait lieu, il faut que soit prise en compte la différence avec laquelle chacun y parvient. La jouissance masculine est yang, simple, directe, « mécanique » ; la jouissance féminine est yin, plus profonde, plus mystérieuse. Le premier enseignement de la sexualité taoïste est que l'homme doit provoquer la jouissance de sa partenaire s'il veut bénéficier des bienfaits du « Tao de l'art d'aimer » (lire plus loin).
On comprend mieux alors pourquoi les enseignements de la sexualité taoïste s'adressent majoritairement aux hommes : parce que la régulation de la sexualité est un domaine où les hommes ont beaucoup plus à apprendre que les femmes. Cela ne tient à aucun primat du yang, mais simplement à la conjonction de deux faits : tous les êtres vivants, qu'ils soient hommes ou femmes, parce qu'ils sont vivants, chauds, mobiles, sont naturellement du côté du yang et, pour des raisons bien plus culturelles que naturelles, les hommes sont plus réceptifs aux conduites yang et les femmes aux conduites yin. La sagesse chinoise en a tiré une conclusion efficace, trop souvent négligée tant par les Occidentaux que par les Chinois : la stratégie yang, naturelle chez tous les vivants, n'a pas besoin d'être cultivée. C'est la stratégie yin, moins « évidente » mais plus efficace, qui doit être mise en oeuvre résolument, car elle est source de multiples bienfaits.
Cette prise de position, qui est également à la base du judo - dit la « voie de la souplesse » ou la « voie du yin » -, fonde la gestion taoïste de la sexualité, dans une optique de régénération de la vitalité. Celle-ci est exposée dans le Su Nu Jing, littéralement le Classique de la fille de candeur. Cet ouvrage fondateur se présente sous la forme d'un dialogue entre Huang Di, l'Empereur jaune - personnage mythologique à l'origine de la nation chinoise et au coeur de la tradition taoïste - avec Su Nu, littéralement la « fille de candeur », son instructrice dans l'art d'utiliser la sexualité bien tempérée pour atteindre la longévité. De ce vieux classique, Jolan Chang, un taoïste chinois, a tiré une adaptation moderne : Le Tao de l'art d'aimer(Calmann-Lévy, 1994), un ouvrage que tout homme découvre toujours trop tard et qui devrait être glissé sur la table de nuit des jeunes adolescents, afin de découvrir la sexualité sous un jour moins angoissant. Son idée de base est la dissociation entre jouissance et éjaculation : pour que l'échange des essences yin et yang se fasse, l'orgasme des deux partenaires est nécessaire ; mais pour qu'il soit énergétiquement vivifiant, il faut qu'ils y parviennent sans qu'il y ait éjaculation.
Une « habitude néfaste »
La femme doit pour cela développer en elle sa composante yang pour émettre son essence yin vers l'homme qui, de son côté, doit privilégier sa composante yin pour la recevoir. Chacun a besoin de la jouissance de l'autre pour augmenter son harmonie interne. Jolan Chang le spécifie bien : « C'est par habitude que nous qualifions l'éjaculation de point suprême du plaisir masculin, habitude néfaste, dans laquelle les puritanismes ont enraciné le sentiment tragique qui encombre la sexualité occidentale. À la "petite mort", le taoïsme oppose la grande vie cosmique que la maîtrise de l'éjaculation permet à chacun d'approcher. On lit en effet dans le Su Nu Jing : "On croit en général que l'homme tire un grand plaisir de l'éjaculation. Mais lorsqu'il apprendra l'art taoïste d'aimer, il éjaculera de moins en moins. Son plaisir n'en diminuera-t-il pas ?" À quoi son interlocuteur répond : "Absolument pas. Après l'éjaculation, l'homme est fatigué, ses oreilles bourdonnent, ses yeux sont alourdis, et il aspire au sommeil. Il a soif et ses membres sont inertes et ankylosés. Pendant l'éjaculation, il éprouve un bref instant de joie, mais il en résulte ensuite de longues heures de lassitude. Ce n'est pas vraiment de la volupté. Si au contraire, l'homme réduit et contrôle son éjaculation, son corps en sera fortifié, son esprit s'en trouvera ragaillardi, son ouïe plus fine et sa vue plus perçante. En maîtrisant la sensation que lui procure l'éjaculation, l'amour qu'il éprouve pour la femme grandit. C'est comme s'il ne pouvait la posséder en suffisance. Comment peut-on dire que ceci n'est pas une infinie volupté ?" »
 Re: Sexe et Religion
Re: Sexe et Religion
Le sexe et les religions
[ltr]Sexualités extrême-orientales, le reflet de la vie[/ltr]
À l'origine, le bouddhisme et l'hindouisme considèrent le sexe comme un élément important et naturel du cycle humain. Si l'acte peut être source potentielle de l'Éveil, le désir reste néanmoins suspect, constituant une entrave au progrès spirituel.
Les religions extrême-orientales proposent une vision de la sexualité qui, aux yeux des Occidentaux, peut sembler étrange, voire exotique. Du bouddhisme tantrique au Kama Soutra, en passant par l'ascèse totale et la statuaire érotique, l'éventail des pratiques sexuelles et du poids social de la religion est si large et varié que l'on peut aisément s'y perdre, tant les apparences sont éloignées des concepts les plus courants.
Une manifestation de l'union divine
Dans le cas des religions indiennes, que l'on regroupe communément sous le terme d'hindouisme, la diversité a pour écho une variété de regards posés sur la sexualité. D'une façon générale, l'union entre l'homme et la femme est perçue comme une manifestation physique de l'union divine. Par l'acte sexuel, ce qui est divisé se trouve réuni, les polarités opposées sont transcendées. Dans la société traditionnelle, le désir et le plaisir charnels étaient largement valorisés, car ils étaient une expression de la danse divine, tout à la fois créatrice et destructrice. Ainsi, entre le IVe et le VIIe siècle, à l'époque où est rédigé le Kama Soutra, les « aphorismes du désir », le plus célèbre des ouvrages de la littérature « érotique » indienne, il ne fait nul doute que la société, pourtant très religieuse, connaît une réelle liberté sexuelle : on autorise alors l'homosexualité, les partenaires multiples, etc. Mais au fil du temps, avec le renfort appuyé du puritanisme des colons britanniques au XIXe siècle, une morale rigide s'impose.
L'union ultime que représente l'acte sexuel apparaît clairement dans la symbolique généralement liée au dieu Shiva. On y associe une pierre dressée, le lingam, un symbole phallique, et un symbole circulaire, ovoïde ou triangulaire, le yoni, la vulve. Ensemble, ils sont le vecteur d'une énergie primordiale et créatrice. Cette énergie est symbolisée par une spirale serpentiforme, la kundalini, qui, à l'échelle humaine, repose à la base de la colonne vertébrale. Pour les pratiquants des techniques de yogas sexuels, principalement rattachés au grand mouvement du culte de la Shakti, l'énergie divine d'essence féminine, elle est consciemment activée lors du rapport physique, durant lequel, le plus souvent, il n'y a aucune émission de semence. Montant le long de la colonne vertébrale, elle irrigue les différents centres psychiques (chakras) et, l'esprit du yogi se fondant avec la conscience universelle (âtman), il accède à la connaissance ultime. Ces techniques, toujours pratiquées de manière confidentielle et secrète, sont aujourd'hui fort éloignées du rigorisme ambiant qui, concevant toujours les couples divins comme une représentation de la nature ultime du monde, se méfie du désir charnel et relègue la dimension spirituelle de la sexualité à un statut de symbole.
Pour le bouddhisme, né du terreau spirituel indien, il n'existe pas de discours particulier sur la sexualité. Indissociable de la vie, elle doit, comme toutes les autres activités humaines, obéir à un principe éthique, respectueux de l'autre et de soi-même. Lorsque, peu après son éveil spirituel, le Bouddha énonce les premières règles de conduite qui doivent régir la vie de ceux qui souhaitent suivre le chemin intérieur qu'il indique, il insiste sur la nécessité qu'il y a à avoir une sexualité « correcte ». Cela implique que cette sexualité s'exprime sans violence, sans mensonges ou sans mauvaises pensées ou actions d'aucune sorte. La tromperie dans le couple est condamnée de prime abord comme l'un des premiers manquements à une sexualité correcte. Cependant, les relations extraconjugales sont tolérables si elles sont admises par toutes les personnes concernées.
Respect et non-violence
Le Bouddha ne préconise aucun ordre social particulier, rappelant sans cesse que la clé de tout progrès se trouve dans le respect et la non-violence. De là, la monogamie, la polygamie ou la polyandrie sont possibles, selon la culture locale ; de même, toute forme de sexualité est possible si, et seulement si, elle est fondée sur le respect. Le cas de l'homosexualité doit être précisé : il s'agit d'une relation sexuelle qui, par sa nature, peut être perçue comme une déviation, car chaque organe a une fonction précise. Cependant, si l'amour est sincère et librement exprimé, la relation peut être considérée comme valide. La sexualité renvoie naturellement à la question du désir ; or il n'y a « pire feu » que lui (Dhammapada, 251). S'il n'est pas reconnu et contrôlé, ce feu produit des pulsions qui, répétées, créent des empreintes conduisant à des renaissances inférieures, principalement dans le monde des animaux, car l'acte sexuel n'y est pas l'objet d'un choix, mais le résultat d'une simple pulsion.
Dans les enseignements ésotériques des tantras, qui se sont développés environ mille ans après la mort du Bouddha, l'énergie sexuelle est intégrée comme l'un des éléments moteurs de l'existence, ce que partagent les pratiquants des tantras de l'hindouisme. L'existence étant marquée par la dualité (bon-mauvais, soi-autrui, etc.), il existe en chaque être une polarité entre masculin (la méthode) et féminin (la sagesse). L'esprit éveillé, l'état de Bouddha, est au-delà de cette dualité. Pour le réaliser, les pratiques spirituelles découlant de ce principe mettent en jeu cette polarité, le plus souvent sous la forme d'un yoga intérieur, plus rarement sous la forme d'un acte sexuel. Le cadre est alors celui d'un rituel où la sexualité n'a plus rien de commun avec une sexualité ordinaire. Transmis de manière confidentielle de maître qualifié à disciple qualifié, ces enseignements sont là encore dits « secrets ».
L'absence de préjugés
À l'origine du moins, bouddhisme et hindouisme considèrent donc la sexualité comme une part importante et naturelle de la vie, sans préjugés particuliers. Source potentielle d'éveil spirituel, elle peut même être un élément important de la Voie intérieure. Pourtant, en elle réside un danger : celui du désir qui constitue une réelle entrave à tout progrès. Derrière lui, « comme le chien suit l'homme », se dissimulent à peine la possession, l'attachement, la jalousie... Autant de sentiments niant autrui.
[ltr]Sexualités extrême-orientales, le reflet de la vie[/ltr]
À l'origine, le bouddhisme et l'hindouisme considèrent le sexe comme un élément important et naturel du cycle humain. Si l'acte peut être source potentielle de l'Éveil, le désir reste néanmoins suspect, constituant une entrave au progrès spirituel.
Les religions extrême-orientales proposent une vision de la sexualité qui, aux yeux des Occidentaux, peut sembler étrange, voire exotique. Du bouddhisme tantrique au Kama Soutra, en passant par l'ascèse totale et la statuaire érotique, l'éventail des pratiques sexuelles et du poids social de la religion est si large et varié que l'on peut aisément s'y perdre, tant les apparences sont éloignées des concepts les plus courants.
Une manifestation de l'union divine
Dans le cas des religions indiennes, que l'on regroupe communément sous le terme d'hindouisme, la diversité a pour écho une variété de regards posés sur la sexualité. D'une façon générale, l'union entre l'homme et la femme est perçue comme une manifestation physique de l'union divine. Par l'acte sexuel, ce qui est divisé se trouve réuni, les polarités opposées sont transcendées. Dans la société traditionnelle, le désir et le plaisir charnels étaient largement valorisés, car ils étaient une expression de la danse divine, tout à la fois créatrice et destructrice. Ainsi, entre le IVe et le VIIe siècle, à l'époque où est rédigé le Kama Soutra, les « aphorismes du désir », le plus célèbre des ouvrages de la littérature « érotique » indienne, il ne fait nul doute que la société, pourtant très religieuse, connaît une réelle liberté sexuelle : on autorise alors l'homosexualité, les partenaires multiples, etc. Mais au fil du temps, avec le renfort appuyé du puritanisme des colons britanniques au XIXe siècle, une morale rigide s'impose.
L'union ultime que représente l'acte sexuel apparaît clairement dans la symbolique généralement liée au dieu Shiva. On y associe une pierre dressée, le lingam, un symbole phallique, et un symbole circulaire, ovoïde ou triangulaire, le yoni, la vulve. Ensemble, ils sont le vecteur d'une énergie primordiale et créatrice. Cette énergie est symbolisée par une spirale serpentiforme, la kundalini, qui, à l'échelle humaine, repose à la base de la colonne vertébrale. Pour les pratiquants des techniques de yogas sexuels, principalement rattachés au grand mouvement du culte de la Shakti, l'énergie divine d'essence féminine, elle est consciemment activée lors du rapport physique, durant lequel, le plus souvent, il n'y a aucune émission de semence. Montant le long de la colonne vertébrale, elle irrigue les différents centres psychiques (chakras) et, l'esprit du yogi se fondant avec la conscience universelle (âtman), il accède à la connaissance ultime. Ces techniques, toujours pratiquées de manière confidentielle et secrète, sont aujourd'hui fort éloignées du rigorisme ambiant qui, concevant toujours les couples divins comme une représentation de la nature ultime du monde, se méfie du désir charnel et relègue la dimension spirituelle de la sexualité à un statut de symbole.
Pour le bouddhisme, né du terreau spirituel indien, il n'existe pas de discours particulier sur la sexualité. Indissociable de la vie, elle doit, comme toutes les autres activités humaines, obéir à un principe éthique, respectueux de l'autre et de soi-même. Lorsque, peu après son éveil spirituel, le Bouddha énonce les premières règles de conduite qui doivent régir la vie de ceux qui souhaitent suivre le chemin intérieur qu'il indique, il insiste sur la nécessité qu'il y a à avoir une sexualité « correcte ». Cela implique que cette sexualité s'exprime sans violence, sans mensonges ou sans mauvaises pensées ou actions d'aucune sorte. La tromperie dans le couple est condamnée de prime abord comme l'un des premiers manquements à une sexualité correcte. Cependant, les relations extraconjugales sont tolérables si elles sont admises par toutes les personnes concernées.
Respect et non-violence
Le Bouddha ne préconise aucun ordre social particulier, rappelant sans cesse que la clé de tout progrès se trouve dans le respect et la non-violence. De là, la monogamie, la polygamie ou la polyandrie sont possibles, selon la culture locale ; de même, toute forme de sexualité est possible si, et seulement si, elle est fondée sur le respect. Le cas de l'homosexualité doit être précisé : il s'agit d'une relation sexuelle qui, par sa nature, peut être perçue comme une déviation, car chaque organe a une fonction précise. Cependant, si l'amour est sincère et librement exprimé, la relation peut être considérée comme valide. La sexualité renvoie naturellement à la question du désir ; or il n'y a « pire feu » que lui (Dhammapada, 251). S'il n'est pas reconnu et contrôlé, ce feu produit des pulsions qui, répétées, créent des empreintes conduisant à des renaissances inférieures, principalement dans le monde des animaux, car l'acte sexuel n'y est pas l'objet d'un choix, mais le résultat d'une simple pulsion.
Dans les enseignements ésotériques des tantras, qui se sont développés environ mille ans après la mort du Bouddha, l'énergie sexuelle est intégrée comme l'un des éléments moteurs de l'existence, ce que partagent les pratiquants des tantras de l'hindouisme. L'existence étant marquée par la dualité (bon-mauvais, soi-autrui, etc.), il existe en chaque être une polarité entre masculin (la méthode) et féminin (la sagesse). L'esprit éveillé, l'état de Bouddha, est au-delà de cette dualité. Pour le réaliser, les pratiques spirituelles découlant de ce principe mettent en jeu cette polarité, le plus souvent sous la forme d'un yoga intérieur, plus rarement sous la forme d'un acte sexuel. Le cadre est alors celui d'un rituel où la sexualité n'a plus rien de commun avec une sexualité ordinaire. Transmis de manière confidentielle de maître qualifié à disciple qualifié, ces enseignements sont là encore dits « secrets ».
L'absence de préjugés
À l'origine du moins, bouddhisme et hindouisme considèrent donc la sexualité comme une part importante et naturelle de la vie, sans préjugés particuliers. Source potentielle d'éveil spirituel, elle peut même être un élément important de la Voie intérieure. Pourtant, en elle réside un danger : celui du désir qui constitue une réelle entrave à tout progrès. Derrière lui, « comme le chien suit l'homme », se dissimulent à peine la possession, l'attachement, la jalousie... Autant de sentiments niant autrui.
 Re: Sexe et Religion
Re: Sexe et Religion
Enquête sur l'homosexualité
[ltr]Condamner l'acte, pas les personnes[/ltr]
Toutes les traditions religieuses considèrent l'acte homosexuel comme « contre nature ». Si l'interdit doctrinaire prédomine encore, certaines branches progressistes relancent le débat et ouvrent leurs communautés aux gays et aux lesbiennes.
«Non à l'homosexualité, mais oui aux homosexuels en tant que personnes et s'ils restent abstinents » : pour les monothéismes issus de la révélation abrahamique - judaïsme, christianisme, islam - et pour le bouddhisme, le rejet de l'homosexualité a toujours été, au cours des siècles, un terrain d'oecuménisme commode. Mais quelle que soit la tradition, ce sont bien les actes que l'on stigmatise (et non les personnes ou l'élan amoureux auquel elles sont sujettes), des conduites sexuelles hors-norme car s'exemptant de l'impératif de la reproduction humaine. Depuis une quarantaine d'années en France, l'émergence de la revendication homosexuelle pousse les religions majoritaires à réaffirmer ou à revoir leurs positions. Certaines branches progressistes n'ont d'ailleurs pas attendu les récents débats de société conflictuels (Pacs, homoparentalité) pour concevoir cette nécessaire adaptation. Car si le mouvement gay contemporain prône un nouveau modèle de société fondé sur l'identité sexuelle, il bouleverse des acquis anthropologiques et doctrinaires vieux de plusieurs milliers d'années.
À l'origine, la condamnation de l'homosexualité dans le judaïsme et le christianisme s'appuie sur deux textes du Lévitique 18-20, un pan du code de la Sainteté rédigé au Ve siècle avant notre ère : « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, ce serait une abomination » (18, 22); « Quand un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, [...] ils seront mis à mort » (20, 13). Selon le théologien Thomas Römer, à l'époque perse, cette « gestion de la sexualité » est constitutive de l'identité du judaïsme naissant, qui légitime uniquement la procréation (« Soyez féconds, et multipliez-vous », Genèse 1, 28) et les structures familiales et sociales qui en découlent - le mariage en premier lieu. Les rapports sexuels entre femmes ne sont jamais évoqués, leurs désirs ne préoccupant que rarement les législateurs, dans la société israélite misogyne et patriarcale de l'époque. Dans le Talmud, la Mishna (Sanh 7, 4) range l'homosexualité avec l'idolâtrie et l'homicide, des fautes capitales qui justifient la lapidation. La Bible n'évoquant pas les rapports lesbiens, ils ne sont passibles que de la flagellation.
Sodome et le « peuple de Loth »
Le texte qui fonde véritablement l'homophobie chrétienne est le récit de la destruction des villes pécheresses de Sodome (qui donnera les termes « sodomites » et « s........ ») et Gomorrhe (Genèse 19). Cet épisode biblique, dont l'interprétation est discutée, relate l'arrivée à Sodome de deux hommes, envoyés de Dieu, à qui Loth, frère ou neveu d'Abraham, offre refuge pour la nuit. La présence de ces étrangers provoque la colère de la population : « Ils n'étaient pas encore couchés que la maison fut cernée par les gens de la ville (...), le peuple en entier sans exception. Ils appelèrent Loth et lui dirent : "Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous pour que no tés à cette violence gratuite. Les messagers divins frappent alors de cécité les agresseurs, et s'empressent le lendemain, avec la famille de Loth, de fuir la ville, bientôt punie de la colère de Dieu : « Yhwh fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu » (19, 24). C'est aussi sur cette histoire du « peuple de Loth », qui a tenté de « déshonorer les envoyés de Dieu » (XV, 58-77), que s'appuie le Coran pour réprouver cette « action infâme », cette « turpitude ». Assimilée à une révolte contre l'ordre divin car stérile, elle remet en cause la bipartition sexuelle en deux pôles complémentaires - l'homme et la femme - voulue du Créateur. La sunna prescrit la peine de mort, le plus souvent par lapidation.
Enfin, contrairement aux monothéismes, le bouddhisme n'a pas élaboré de doctrine contre l'homosexualité. Les rares allusions au fait se trouvent dans le Vinaya, l'ensemble des règles disciplinaires édictées par le Bouddha à l'intention des communautés monastiques, contraintes à l'abstinence. Dans ces milieux clos, des mesures tentent de limiter la promiscuité, afin d'annihiler tout désir sexuel, quel qu'il soit, car il pourrait troubler l'harmonie de la collectivité.
En France, dans la lignée de Latran III (1179), premier concile oecuménique à condamner les actes homosexuels, l'Église catholique prononce au XIIIe siècle la stigmatisation théologique et canonique de l'homosexualité. Soutenue par les spécialistes de la théologie morale, dont saint Thomas d'Aquin, elle développe le thème de la dépravation de pratiques jugées « contre nature », déjà présent dans les écrits de saint Paul, mort vers 62-64 (Romains 1, 26). Au XXIe siècle, l'institution maintient l'anathème ; la dernière version du Catéchisme romain est formelle : « S'appuyant sur la Sainte Écriture, [...] "les actes d'homosexualité sont intrinsèquement désordonnés" ; ils ferment l'acte sexuel au don de la vie ; ils ne procèdent pas d'une complémentarité affective et sexuelle véritable ; ils ne sauraient recevoir l'approbation en aucun cas. »
Une attitude contradictoire
Une hostilité réaffirmée en 2008 par le pape Benoît XVI, qui a dénoncé la confusion des genres sexuels, conduisant selon lui à « l'auto-émancipation de l'homme de la Création et du Créateur »_: « L'homme [...] vit ainsi contre la Vérité, contre l'Esprit créateur », a-t-il déploré. Cette déclaration a soulevé une vague d'indignation, d'autant qu'elle est intervenue juste après le refus du Vatican de s'associer à l'appel lancé par 66 pays pour la dépénalisation universelle de l'homosexualité - pourtant répandue et tolérée dans le clergé chrétien, au sein des monastères et des séminaires. Un secret de Polichinelle que la virulence des condamnations de l'institution ne parvient pas à occulter : par peur du scandale, l'Église reste aujourd'hui prisonnière de cette contradiction.
Une bienveillance tiède
En témoigne le parcours du père Jacques, 77 ans : « La première réaction de mes responsables lorsque je leur ai annoncé mon homosexualité a été de s'exclamer : "Est-ce que ça se sait ? ! »
À la fin des années 1960, après cinq ans de magistère en milieu rural, il décide de prendre un congé pour mener une psychanalyse à Paris, torturé par sa « double vie ». À l'issue de sa thérapie, il participe au lancement de David et Jonathan (lire ci-dessous). « Je suis toujours dans les registres de mon évêché, mais je suis "en congé" et je n'ai pas de magistère depuis quarante ans. Mes activités sont reconnues sans être cautionnées. La dernière fois que j'ai vu mon vicaire général, je lui ai demandé ce que je devais faire, il m'a répondu : "Continue ce que tu fais." »
Le prêtre, qui vit avec son compagnon depuis quarante ans, mesure le chemin parcouru : « J'ai mis vingt ans à en parler librement. Mais je sais toute la liberté de conscience que m'a donnée ma situation, c'est le plus important des messages du Christ. Prônée par les Évangiles, elle a été confisquée par les clercs, des hommes qui vivent en dehors du travail et de la sexualité, et qui décident pourtant pour tout le monde, vous trouvez ça normal ? » Dans le sillage du centre pastoral des Halles-Beaubourg, qui, depuis la fin des années 1970, laisse la porte de son église Sainte-Merri « grande ouverte » aux communautés marginales, dont les gays et les lesbiennes, quelques paroisses catholiques font désormais le pas vers eux, suivant les recommandations du Catéchisme, pour les accueillir « avec respect, compassion et délicatesse ». C'est en effet cette bienveillance tiède que pointe le pasteur Stéphane Lavignotte, de la mission évangélique de la Maison verte, dans le XVIIIe arrondissement parisien : « Ici, on donne à la communauté gay une place non pas malgré ce qu'ils sont, mais avec ce qu'ils sont. Dieu accueille tout ce qui est, pourquoi prétendre ne pas accueillir tout le monde ? » Arrivent ainsi à la Maison verte des homosexuels rejetés d'autres paroisses protestantes ou des déçus de l'intransigeance catholique. « Nous pratiquons un accueil actif : dans nos statuts, il est inscrit que nous sommes une maison chrétienne "inclusive" », rappelle le pasteur.
La voie de l'« inclusivité »
Cette notion d'« inclusivité », d'origine anglo-saxonne, est aussi celle qui fonde l'accueil des homosexuels au sein du Mouvement juif libéral de France, une minorité du judaïsme français, majoritaire à l'échelle mondiale. « Le judaïsme accorde une vraie valeur à une sexualité épanouie et non-reproductive. Donc comment faire pour que les homosexuels et les familles homoparentales trouvent la voie et la voix parmi nous ?, s'interroge le rabbin Delphine Horvilleur. Nous menons cette réflexion sur l'altérité, en rappelant ce message de la Torah : "Souviens-toi que tu as été étranger." » Le mouvement libéral admet dans ses séminaires (aux États-Unis, en Angleterre et en Israël - il n'en existe pas en France) les homosexuels depuis une quinzaine d'années.
Si aux États-Unis, certaines branches orthodoxes participent depuis peu, aux côtés des libéraux, à abolir la discrimination dont font l'objet les homosexuels, en France, où l'orthodoxie domine, les espaces de dialogue sont encore rares. L'un d'eux, le Beït Havérim, « groupe juif gay et lesbien de France », a été fondé en 1977 et propose des échanges « au regard de cette double identité ». Sur le forum de son site Internet, nombreux sont les témoignages à dire la difficulté, parfois extrême, de se déclarer auprès de son entourage : « Mon coming out, c'était il y a quatre ans, écrit Okapi, 26 ans. Ma mère est presque devenue folle. Mon père ne savait pas quoi me dire et m'écrivait des lettres pour me convaincre de rester pur. » Et ce rejet ne provient pas forcément des « ascendants » : « Je suis lesbienne et avec mon amie, nous vivons un grand bonheur, raconte Life, 45 ans. Ma fille de 19 ans me rejette malgré tout son amour car elle ne trouve pas "cela normal" par rapport à la religion. »
Puisqu'il n'existe aucune association française les rendant visibles, c'est aussi Internet qui sert d'exutoire à de nombreux musulmans homosexuels, tel le blog de Najim, « beur gay et musulman » de 33 ans ([ltr]http://beur-gay.over-blog.fr/[/ltr]), pratiquant assidu : « Je reste discret vis-à-vis de ma famille. Lors de discussions critiquant l'homosexualité, c'est difficile à supporter car je dois faire comme si je n'étais pas concerné. Je serai jugé par Dieu pour mon péché d'être homo. Mais je garde espoir qu'il lira aussi dans mon coeur les souffrances que j'ai endurées. » Dissimulant le plus souvent leur sexualité à leur famille, les homosexuels musulmans, s'ils viennent des cités, doivent sortir de leur quartier pour pouvoir la vivre librement : à Paris, quelques établissements nocturnes lesbiens sont ainsi devenus le rendez-vous de ces banlieusardes clandestines, pour qui la foi reste cependant un repère indispensable. Dans la communauté musulmane française, le tabou persiste : « Jamais un fidèle n'osera franchir la porte de ma mosquée pour m'en parler, si lui ou un membre de sa famille est concerné par l'homosexualité », constate Khalil Merroun, le recteur de la mosquée d'Évry (Essonne), qui soumet cependant l'interdit coranique aux règles du jeu républicaines : « L'islam proscrit l'homosexualité, contraire à la nature humaine, mais au sein de la société française, il existe la liberté sexuelle, que notre communauté doit respecter. Cela dit, il y a une grosse différence entre un péché caché et un péché divulgué : si certains ont ce vice, c'est mieux d'être discret. »
Le bouddhisme prône, lui, une vision extensive de la compassion, et l'acceptation de l'homosexualité est de fait généralisée dans ses communautés. « Personnellement, je n'ai jamais entendu mes maîtres l'aborder comme un "problème", explique Stéphane Leluc, instructeur de méditation au centre Shambala de Paris, qui enseigne la tradition tibétaine. Nous accueillons donc les homosexuels d'abord comme des hommes et des femmes. »
L'exemple des États-Unis
En 2001, une déclaration du dalaï-lama a été particulièrement décriée : « [L'homosexualité] fait partie de ce que nous appelons "une mauvaise conduite sexuelle". Les organes ont été créés pour la reproduction entre l'élément masculin et l'élément féminin, et tout ce qui en dévie n'est pas acceptable d'un point de vue bouddhiste. » Il s'est ensuite empressé de la rectifier (« Seuls le respect et l'attention à l'autre devraient gouverner la relation d'un couple, qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel »), notamment sous la pression des communautés bouddhistes des États-Unis. Là encore, c'est bien le contexte américain qui s'érige en exemple d'ouverture. « J'ai grandi au sein de l'Église épiscopalienne [héritière de l'Église coloniale anglicane] mais le bouddhisme m'a semblé petit à petit plus relié à la réalité de la foi, raconte Marc, un Américain de 58 ans, qui vit à San Rafael, en Californie. À 23 ans, j'ai commencé à méditer, et j'ai fait mon coming out un an plus tard. Mes maîtres ont toujours été très ouverts : ils s'en fichent de savoir avec qui vous couchez, ce qui importe, c'est l'énergie qu'il y a entre deux personnes. Même si aux États-Unis, il y a beaucoup d'homophobie, ces perceptions sociétales "glissent" sur la communauté bouddhiste. Tout mon entourage est tolérant, et je me sens très bien avec moi-même. »
Ce récit détonne avec le paradoxe persistant qui gouverne la vie spirituelle d'une majorité de fidèles homosexuels français : chaque jour, comment gérer sa foi en une religion qui récuse ses amours, certes hors-norme, mais amours tout de même ? Si Dieu est amour et miséricorde pour l'humanité, pourquoi certains seraient-ils exclus de cette société des hommes ? Ce dilemme n'a pas fini de susciter, chez ces croyants, désarroi et souffrance, voire une réelle détresse.
La menace du schisme chez les anglicans
C'est la désignation, aux États-Unis, d'un évêque ouvertement homosexuel, Gene Robinson, qui a mis le feu aux poudres en 2004. La sexualité a toujours été, chez les anglicans, une ligne d'affrontement entre conservateurs (majoritaires dans les pays du Sud) et libéraux (majoritaires dans les pays occidentalisés). Mais c'est la première fois pour cette Église, créée au XVIe siècle et aujourd'hui présente dans 164 pays (77 millions de fidèles), que les dissensions vont jusqu'à menacer son unité. En août 2008, la conférence de Lambeth a réuni 670 évêques au siège historique de Canterbury, sous la houlette de l'archevêque Rowan Williams, primat de l'Église d'Angleterre et chef spirituel de la communion anglicane. Boycottée par les opposants à l'ordination des homosexuels, qui contestent aussi l'autorité du primat anglican, elle n'a pas permis de parvenir à un accord entre les deux courants, même si le schisme a été évité. Seule avancée concrète, la proposition d'un « moratoire » sur les ordinations d'évêques gays et les bénédictions de couples homosexuels.
David et Jonathan, pionniers du débat français
Créée en 1971, l'association David et Jonathan, « mouvement homosexuel chrétien ouvert à toutes et à tous », organise, en parallèle des temps d'accueil, des soirées débats, des visites et des retraites ; et a aujourd'hui essaimé dans une vingtaine de villes. La position de l'évêché reste toutefois frileuse. « Nous rencontrons l'évêque une fois par an. Évidemment, il y a des zones alibis dans toutes les institutions, mais il ne faut pas battre en retraite, il faut exister », insiste Marc Tourtelier, responsable du groupe local Île-de-France. Et c'est peut-être son endurance qui explique la longévité de David et Jonathan : « Nous pratiquons un militantisme "doux", plus "cheval de fond" que "cheval de course" », précise Patrick Sanguinetti, co-président de l'association, qui a lancé à Paris, depuis six mois, un accueil pour les musulmans, afin de pallier l'absence de structure destinée à cette communauté.
[ltr]Condamner l'acte, pas les personnes[/ltr]
Toutes les traditions religieuses considèrent l'acte homosexuel comme « contre nature ». Si l'interdit doctrinaire prédomine encore, certaines branches progressistes relancent le débat et ouvrent leurs communautés aux gays et aux lesbiennes.
«Non à l'homosexualité, mais oui aux homosexuels en tant que personnes et s'ils restent abstinents » : pour les monothéismes issus de la révélation abrahamique - judaïsme, christianisme, islam - et pour le bouddhisme, le rejet de l'homosexualité a toujours été, au cours des siècles, un terrain d'oecuménisme commode. Mais quelle que soit la tradition, ce sont bien les actes que l'on stigmatise (et non les personnes ou l'élan amoureux auquel elles sont sujettes), des conduites sexuelles hors-norme car s'exemptant de l'impératif de la reproduction humaine. Depuis une quarantaine d'années en France, l'émergence de la revendication homosexuelle pousse les religions majoritaires à réaffirmer ou à revoir leurs positions. Certaines branches progressistes n'ont d'ailleurs pas attendu les récents débats de société conflictuels (Pacs, homoparentalité) pour concevoir cette nécessaire adaptation. Car si le mouvement gay contemporain prône un nouveau modèle de société fondé sur l'identité sexuelle, il bouleverse des acquis anthropologiques et doctrinaires vieux de plusieurs milliers d'années.
À l'origine, la condamnation de l'homosexualité dans le judaïsme et le christianisme s'appuie sur deux textes du Lévitique 18-20, un pan du code de la Sainteté rédigé au Ve siècle avant notre ère : « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, ce serait une abomination » (18, 22); « Quand un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, [...] ils seront mis à mort » (20, 13). Selon le théologien Thomas Römer, à l'époque perse, cette « gestion de la sexualité » est constitutive de l'identité du judaïsme naissant, qui légitime uniquement la procréation (« Soyez féconds, et multipliez-vous », Genèse 1, 28) et les structures familiales et sociales qui en découlent - le mariage en premier lieu. Les rapports sexuels entre femmes ne sont jamais évoqués, leurs désirs ne préoccupant que rarement les législateurs, dans la société israélite misogyne et patriarcale de l'époque. Dans le Talmud, la Mishna (Sanh 7, 4) range l'homosexualité avec l'idolâtrie et l'homicide, des fautes capitales qui justifient la lapidation. La Bible n'évoquant pas les rapports lesbiens, ils ne sont passibles que de la flagellation.
Sodome et le « peuple de Loth »
Le texte qui fonde véritablement l'homophobie chrétienne est le récit de la destruction des villes pécheresses de Sodome (qui donnera les termes « sodomites » et « s........ ») et Gomorrhe (Genèse 19). Cet épisode biblique, dont l'interprétation est discutée, relate l'arrivée à Sodome de deux hommes, envoyés de Dieu, à qui Loth, frère ou neveu d'Abraham, offre refuge pour la nuit. La présence de ces étrangers provoque la colère de la population : « Ils n'étaient pas encore couchés que la maison fut cernée par les gens de la ville (...), le peuple en entier sans exception. Ils appelèrent Loth et lui dirent : "Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous pour que no tés à cette violence gratuite. Les messagers divins frappent alors de cécité les agresseurs, et s'empressent le lendemain, avec la famille de Loth, de fuir la ville, bientôt punie de la colère de Dieu : « Yhwh fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu » (19, 24). C'est aussi sur cette histoire du « peuple de Loth », qui a tenté de « déshonorer les envoyés de Dieu » (XV, 58-77), que s'appuie le Coran pour réprouver cette « action infâme », cette « turpitude ». Assimilée à une révolte contre l'ordre divin car stérile, elle remet en cause la bipartition sexuelle en deux pôles complémentaires - l'homme et la femme - voulue du Créateur. La sunna prescrit la peine de mort, le plus souvent par lapidation.
Enfin, contrairement aux monothéismes, le bouddhisme n'a pas élaboré de doctrine contre l'homosexualité. Les rares allusions au fait se trouvent dans le Vinaya, l'ensemble des règles disciplinaires édictées par le Bouddha à l'intention des communautés monastiques, contraintes à l'abstinence. Dans ces milieux clos, des mesures tentent de limiter la promiscuité, afin d'annihiler tout désir sexuel, quel qu'il soit, car il pourrait troubler l'harmonie de la collectivité.
En France, dans la lignée de Latran III (1179), premier concile oecuménique à condamner les actes homosexuels, l'Église catholique prononce au XIIIe siècle la stigmatisation théologique et canonique de l'homosexualité. Soutenue par les spécialistes de la théologie morale, dont saint Thomas d'Aquin, elle développe le thème de la dépravation de pratiques jugées « contre nature », déjà présent dans les écrits de saint Paul, mort vers 62-64 (Romains 1, 26). Au XXIe siècle, l'institution maintient l'anathème ; la dernière version du Catéchisme romain est formelle : « S'appuyant sur la Sainte Écriture, [...] "les actes d'homosexualité sont intrinsèquement désordonnés" ; ils ferment l'acte sexuel au don de la vie ; ils ne procèdent pas d'une complémentarité affective et sexuelle véritable ; ils ne sauraient recevoir l'approbation en aucun cas. »
Une attitude contradictoire
Une hostilité réaffirmée en 2008 par le pape Benoît XVI, qui a dénoncé la confusion des genres sexuels, conduisant selon lui à « l'auto-émancipation de l'homme de la Création et du Créateur »_: « L'homme [...] vit ainsi contre la Vérité, contre l'Esprit créateur », a-t-il déploré. Cette déclaration a soulevé une vague d'indignation, d'autant qu'elle est intervenue juste après le refus du Vatican de s'associer à l'appel lancé par 66 pays pour la dépénalisation universelle de l'homosexualité - pourtant répandue et tolérée dans le clergé chrétien, au sein des monastères et des séminaires. Un secret de Polichinelle que la virulence des condamnations de l'institution ne parvient pas à occulter : par peur du scandale, l'Église reste aujourd'hui prisonnière de cette contradiction.
Une bienveillance tiède
En témoigne le parcours du père Jacques, 77 ans : « La première réaction de mes responsables lorsque je leur ai annoncé mon homosexualité a été de s'exclamer : "Est-ce que ça se sait ? ! »
À la fin des années 1960, après cinq ans de magistère en milieu rural, il décide de prendre un congé pour mener une psychanalyse à Paris, torturé par sa « double vie ». À l'issue de sa thérapie, il participe au lancement de David et Jonathan (lire ci-dessous). « Je suis toujours dans les registres de mon évêché, mais je suis "en congé" et je n'ai pas de magistère depuis quarante ans. Mes activités sont reconnues sans être cautionnées. La dernière fois que j'ai vu mon vicaire général, je lui ai demandé ce que je devais faire, il m'a répondu : "Continue ce que tu fais." »
Le prêtre, qui vit avec son compagnon depuis quarante ans, mesure le chemin parcouru : « J'ai mis vingt ans à en parler librement. Mais je sais toute la liberté de conscience que m'a donnée ma situation, c'est le plus important des messages du Christ. Prônée par les Évangiles, elle a été confisquée par les clercs, des hommes qui vivent en dehors du travail et de la sexualité, et qui décident pourtant pour tout le monde, vous trouvez ça normal ? » Dans le sillage du centre pastoral des Halles-Beaubourg, qui, depuis la fin des années 1970, laisse la porte de son église Sainte-Merri « grande ouverte » aux communautés marginales, dont les gays et les lesbiennes, quelques paroisses catholiques font désormais le pas vers eux, suivant les recommandations du Catéchisme, pour les accueillir « avec respect, compassion et délicatesse ». C'est en effet cette bienveillance tiède que pointe le pasteur Stéphane Lavignotte, de la mission évangélique de la Maison verte, dans le XVIIIe arrondissement parisien : « Ici, on donne à la communauté gay une place non pas malgré ce qu'ils sont, mais avec ce qu'ils sont. Dieu accueille tout ce qui est, pourquoi prétendre ne pas accueillir tout le monde ? » Arrivent ainsi à la Maison verte des homosexuels rejetés d'autres paroisses protestantes ou des déçus de l'intransigeance catholique. « Nous pratiquons un accueil actif : dans nos statuts, il est inscrit que nous sommes une maison chrétienne "inclusive" », rappelle le pasteur.
La voie de l'« inclusivité »
Cette notion d'« inclusivité », d'origine anglo-saxonne, est aussi celle qui fonde l'accueil des homosexuels au sein du Mouvement juif libéral de France, une minorité du judaïsme français, majoritaire à l'échelle mondiale. « Le judaïsme accorde une vraie valeur à une sexualité épanouie et non-reproductive. Donc comment faire pour que les homosexuels et les familles homoparentales trouvent la voie et la voix parmi nous ?, s'interroge le rabbin Delphine Horvilleur. Nous menons cette réflexion sur l'altérité, en rappelant ce message de la Torah : "Souviens-toi que tu as été étranger." » Le mouvement libéral admet dans ses séminaires (aux États-Unis, en Angleterre et en Israël - il n'en existe pas en France) les homosexuels depuis une quinzaine d'années.
Si aux États-Unis, certaines branches orthodoxes participent depuis peu, aux côtés des libéraux, à abolir la discrimination dont font l'objet les homosexuels, en France, où l'orthodoxie domine, les espaces de dialogue sont encore rares. L'un d'eux, le Beït Havérim, « groupe juif gay et lesbien de France », a été fondé en 1977 et propose des échanges « au regard de cette double identité ». Sur le forum de son site Internet, nombreux sont les témoignages à dire la difficulté, parfois extrême, de se déclarer auprès de son entourage : « Mon coming out, c'était il y a quatre ans, écrit Okapi, 26 ans. Ma mère est presque devenue folle. Mon père ne savait pas quoi me dire et m'écrivait des lettres pour me convaincre de rester pur. » Et ce rejet ne provient pas forcément des « ascendants » : « Je suis lesbienne et avec mon amie, nous vivons un grand bonheur, raconte Life, 45 ans. Ma fille de 19 ans me rejette malgré tout son amour car elle ne trouve pas "cela normal" par rapport à la religion. »
Puisqu'il n'existe aucune association française les rendant visibles, c'est aussi Internet qui sert d'exutoire à de nombreux musulmans homosexuels, tel le blog de Najim, « beur gay et musulman » de 33 ans ([ltr]http://beur-gay.over-blog.fr/[/ltr]), pratiquant assidu : « Je reste discret vis-à-vis de ma famille. Lors de discussions critiquant l'homosexualité, c'est difficile à supporter car je dois faire comme si je n'étais pas concerné. Je serai jugé par Dieu pour mon péché d'être homo. Mais je garde espoir qu'il lira aussi dans mon coeur les souffrances que j'ai endurées. » Dissimulant le plus souvent leur sexualité à leur famille, les homosexuels musulmans, s'ils viennent des cités, doivent sortir de leur quartier pour pouvoir la vivre librement : à Paris, quelques établissements nocturnes lesbiens sont ainsi devenus le rendez-vous de ces banlieusardes clandestines, pour qui la foi reste cependant un repère indispensable. Dans la communauté musulmane française, le tabou persiste : « Jamais un fidèle n'osera franchir la porte de ma mosquée pour m'en parler, si lui ou un membre de sa famille est concerné par l'homosexualité », constate Khalil Merroun, le recteur de la mosquée d'Évry (Essonne), qui soumet cependant l'interdit coranique aux règles du jeu républicaines : « L'islam proscrit l'homosexualité, contraire à la nature humaine, mais au sein de la société française, il existe la liberté sexuelle, que notre communauté doit respecter. Cela dit, il y a une grosse différence entre un péché caché et un péché divulgué : si certains ont ce vice, c'est mieux d'être discret. »
Le bouddhisme prône, lui, une vision extensive de la compassion, et l'acceptation de l'homosexualité est de fait généralisée dans ses communautés. « Personnellement, je n'ai jamais entendu mes maîtres l'aborder comme un "problème", explique Stéphane Leluc, instructeur de méditation au centre Shambala de Paris, qui enseigne la tradition tibétaine. Nous accueillons donc les homosexuels d'abord comme des hommes et des femmes. »
L'exemple des États-Unis
En 2001, une déclaration du dalaï-lama a été particulièrement décriée : « [L'homosexualité] fait partie de ce que nous appelons "une mauvaise conduite sexuelle". Les organes ont été créés pour la reproduction entre l'élément masculin et l'élément féminin, et tout ce qui en dévie n'est pas acceptable d'un point de vue bouddhiste. » Il s'est ensuite empressé de la rectifier (« Seuls le respect et l'attention à l'autre devraient gouverner la relation d'un couple, qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel »), notamment sous la pression des communautés bouddhistes des États-Unis. Là encore, c'est bien le contexte américain qui s'érige en exemple d'ouverture. « J'ai grandi au sein de l'Église épiscopalienne [héritière de l'Église coloniale anglicane] mais le bouddhisme m'a semblé petit à petit plus relié à la réalité de la foi, raconte Marc, un Américain de 58 ans, qui vit à San Rafael, en Californie. À 23 ans, j'ai commencé à méditer, et j'ai fait mon coming out un an plus tard. Mes maîtres ont toujours été très ouverts : ils s'en fichent de savoir avec qui vous couchez, ce qui importe, c'est l'énergie qu'il y a entre deux personnes. Même si aux États-Unis, il y a beaucoup d'homophobie, ces perceptions sociétales "glissent" sur la communauté bouddhiste. Tout mon entourage est tolérant, et je me sens très bien avec moi-même. »
Ce récit détonne avec le paradoxe persistant qui gouverne la vie spirituelle d'une majorité de fidèles homosexuels français : chaque jour, comment gérer sa foi en une religion qui récuse ses amours, certes hors-norme, mais amours tout de même ? Si Dieu est amour et miséricorde pour l'humanité, pourquoi certains seraient-ils exclus de cette société des hommes ? Ce dilemme n'a pas fini de susciter, chez ces croyants, désarroi et souffrance, voire une réelle détresse.
La menace du schisme chez les anglicans
C'est la désignation, aux États-Unis, d'un évêque ouvertement homosexuel, Gene Robinson, qui a mis le feu aux poudres en 2004. La sexualité a toujours été, chez les anglicans, une ligne d'affrontement entre conservateurs (majoritaires dans les pays du Sud) et libéraux (majoritaires dans les pays occidentalisés). Mais c'est la première fois pour cette Église, créée au XVIe siècle et aujourd'hui présente dans 164 pays (77 millions de fidèles), que les dissensions vont jusqu'à menacer son unité. En août 2008, la conférence de Lambeth a réuni 670 évêques au siège historique de Canterbury, sous la houlette de l'archevêque Rowan Williams, primat de l'Église d'Angleterre et chef spirituel de la communion anglicane. Boycottée par les opposants à l'ordination des homosexuels, qui contestent aussi l'autorité du primat anglican, elle n'a pas permis de parvenir à un accord entre les deux courants, même si le schisme a été évité. Seule avancée concrète, la proposition d'un « moratoire » sur les ordinations d'évêques gays et les bénédictions de couples homosexuels.
David et Jonathan, pionniers du débat français
Créée en 1971, l'association David et Jonathan, « mouvement homosexuel chrétien ouvert à toutes et à tous », organise, en parallèle des temps d'accueil, des soirées débats, des visites et des retraites ; et a aujourd'hui essaimé dans une vingtaine de villes. La position de l'évêché reste toutefois frileuse. « Nous rencontrons l'évêque une fois par an. Évidemment, il y a des zones alibis dans toutes les institutions, mais il ne faut pas battre en retraite, il faut exister », insiste Marc Tourtelier, responsable du groupe local Île-de-France. Et c'est peut-être son endurance qui explique la longévité de David et Jonathan : « Nous pratiquons un militantisme "doux", plus "cheval de fond" que "cheval de course" », précise Patrick Sanguinetti, co-président de l'association, qui a lancé à Paris, depuis six mois, un accueil pour les musulmans, afin de pallier l'absence de structure destinée à cette communauté.
 Re: Sexe et Religion
Re: Sexe et Religion
Livre
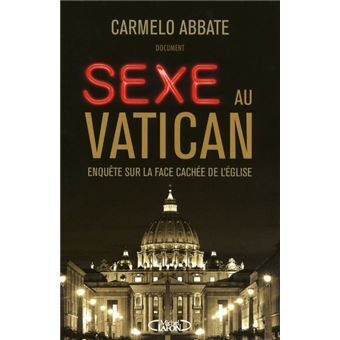
[ltr]Sexe au Vatican, enquête sur la face cachée de l’Eglise par Carmelo Abbate[/ltr]
Hadrien Poussin - publié le 24/06/2011
On se croirait projetés, dès les premières pages de ce livre de Carmelo Abbate, dans l’univers chaud et intime de la littérature érotique : « -Ça te plairait de faire ça à la chapelle? -Mon Dieu… Ce serait fabuleux […]. » Mais non, il s’agit là d’une enquête sur les affres sexuels des membres du Saint-Siège. Un ouvrage qui, sous forme de reportage confinant parfois au voyeurisme, entend lever le voile sur le silence des sœurs « manipulées, abusées, ignorées », la souffrance des femmes de l’ombre, le silence des gays, des lesbiennes, des évêques, des cardinaux et de tous ceux, dit l’auteur, « qui ont apporté leur pierre au mur du secret ». Pour ne pas avoir ainsi à répondre de leurs actes devant la société et ses lois.
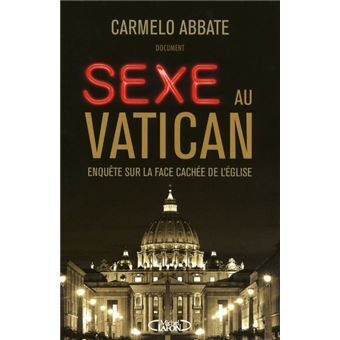
[ltr]Sexe au Vatican, enquête sur la face cachée de l’Eglise par Carmelo Abbate[/ltr]
Hadrien Poussin - publié le 24/06/2011
On se croirait projetés, dès les premières pages de ce livre de Carmelo Abbate, dans l’univers chaud et intime de la littérature érotique : « -Ça te plairait de faire ça à la chapelle? -Mon Dieu… Ce serait fabuleux […]. » Mais non, il s’agit là d’une enquête sur les affres sexuels des membres du Saint-Siège. Un ouvrage qui, sous forme de reportage confinant parfois au voyeurisme, entend lever le voile sur le silence des sœurs « manipulées, abusées, ignorées », la souffrance des femmes de l’ombre, le silence des gays, des lesbiennes, des évêques, des cardinaux et de tous ceux, dit l’auteur, « qui ont apporté leur pierre au mur du secret ». Pour ne pas avoir ainsi à répondre de leurs actes devant la société et ses lois.
 Re: Sexe et Religion
Re: Sexe et Religion
Le sexe et les religions
[ltr]La révolution freudienne[/ltr]
Jennifer Schwarz - publié le 01/07/2009
Au XIXe siècle, le traitement clinique de la sexualité s'inscrit de la tradition bourgeoise et chrétienne. Freud luttera contre cette morale et ses carcans liés aux interdits religieux. Un bouleversement aujourd'hui remis en cause.
Tout au long du XIXe siècle, avec l'apparition de la psychiatrie d'abord, puis de la psychologie clinique, le pouvoir anciennement dévolu au prêtre est progressivement transféré au médecin...
Le médecin va en effet prendre en charge la sexualité et le traitement des déviants. On s'occupe de plus en plus de la sexualité, non pas du point de vue du jugement divin mais de la reproduction, de la biologie et du désir. Ainsi sort-on d'un monde dominé par la puissance patriarcale et où les mariages étaient arrangés. Au lieu de traiter la question morale, au sens de la foi chrétienne, la bourgeoisie s'intéresse au sexe biologique et elle réinjecte la question sexuelle au coeur de cette nouvelle conception scientifique du sexe, construite sur la base du savoir médical. Dans la deuxième moitié du siècle, on s'intéresse particulièrement au développement de la sexualité infantile, à la femme hystérique et à l'homosexuel. Autrement dit, on s'occupe de l'anomalie. L'enfant doit être normalisé. On invente des appareils pour l'empêcher de se masturber. C'est la morale médicale qui est évidemment dans une continuité avec la morale bourgeoise, à la fois chrétienne et biologique.
Et que fait Freud ?
La théorie freudienne est, du point de vue de la sexualité, une révolution. Freud change le regard sur la sexualité. Aussi sera-t-il accusé, par toutes les religions, particulièrement le catholicisme, d'être un profanateur de la famille, un dynamiteur de la société, un démon darwinien et un obsédé sexuel. Pourquoi ? Parce qu'il considère que la société bourgeoise bride le désir sexuel. Au lieu de pointer du doigt l'anormalité, il va montrer que tous les conflits à l'origine de l'être humain sont au départ sexuels et liés au désir. Si les femmes de cette époque sont hystériques, c'est parce qu'elles ont des frustrations, non parce qu'elles sont anormales... Freud est un matérialiste, qui considère la sexualité comme un phénomène à la fois psychique et biologique. Il n'est pas un théoricien de la liberté sexuelle à tout prix, mais un émancipateur qui lutte contre la morale de son époque, trop patriarcale, avec ses carcans liés aux interdits religieux. Jusqu'en 1897, date à laquelle il élabore sa première théorie sexuelle, il voit beaucoup de femmes qui disent avoir subi des abus. La névrose adulte, pense-t-il d'abord, vient de traumatismes sexuels réels, et puis il s'aperçoit que si certaines femmes ont véritablement connu un abus, d'autres l'ont sincèrement imaginé : il invente ainsi la notion de fantasme. Il démontre donc que nous avons tous des problèmes sexuels dans la tête et pas seulement dans le corps ! C'est bien plus subversif ! Cela sera aussi très déstabilisant pour la civilisation de découvrir ce que les enfants désirent vraiment, quand ils élaborent des « théories » très crues sur les rapports sexuels et la naissance. Il fera ainsi scandale en 1905, en affirmant qu'il est parfaitement normal pour un enfant de se masturber et que tous les enfants ont une sexualité pulsionnelle. Cela devient « anormal », lorsque ça tourne à la manie fétichiste.
L'Église catholique condamne, jusqu'en 1945, l'oeuvre de Freud, au même titre que celle de Marx. Pourquoi ?
Car le communisme et la psychanalyse sont les deux ferments, pour l'Église, de la liquidation de la morale chrétienne : deux théories matérialistes élaborées par des Juifs hostiles à la religion. De même, toutes les dictatures vont bannir le freudisme, comme théorie de la liberté humaine. Par la suite, l'Église catholique romaine changera de doctrine, en introduisant l'expertise psychiatrique pour le discernement des vocations. L'Église n'a alors plus envie d'accueillir des pervers sexuels et des homosexuels refoulés dans ses rangs. On se fie dès lors aux théories psychiatriques, dominées à l'époque par celles de Freud. À la faveur de cette introduction, les jésuites et les dominicains se passionneront pour l'exploration de soi. Et à l'intérieur de l'expérience psychiatrique pour les novices, ils introduiront les cures psychanalytiques.
Sur les questions sexuelles, après avoir longtemps été l'ennemie des dogmes religieux, la psychanalyse n'a-t-elle pas tendance, depuis une vingtaine d'années, à se rapprocher du conservatisme moral de l'Église ?
La transformation s'est opérée en plusieurs temps, chez toutes les tendances des psychanalystes : kleiniens, lacaniens, lesquels sont les héritiers de Freud. Avec la création de l'International Psychoanalytical Association (IPA) en 1910, ce mouvement d'émancipation s'est transformé en une Église laïque, avec des règles pour la cure et une nouvelle morale orthodoxe... Après avoir été critiquée par les Églises pour des raisons morales, la psychanalyse a été violemment attaquée par les scientistes, pour lesquels il n'y a pas de psychisme hors des neurones et du fonctionnement cérébral. Quand la psychiatrie devient comportementaliste, elle exclut l'inconscient, la sexualité, le transfert, le désir, au profit d'une classification des comportements. La caractéristique des comportementalistes, c'est la détestation des religions, et pour eux, la psychanalyse est une religion et les psychanalystes, des prêtres masqués. Ils aiment certaines formes de religiosité qui ne sont pas la religion, comme par exemple la méditation transcendantale, en tant qu'outil technique.
Se sentant menacés, les psychanalystes se seraient donc naturellement rapprochés de l'Église ?
Oui et non. Non, car ils sont en général athées. Oui, car le débat avec les représentants des neurosciences est devenu, hélas, inopérant, à force de conformisme : ne parler que de sérotonine ou de circuits cérébraux, cela devient très ennuyeux. Aujourd'hui, les psychanalystes risquent d'être assignés à servir de supplétifs à tout ce qu'on ne peut pas traiter par les médicaments. Et donc, ce n'est guère intéressant du point de vue de la réflexion théorique. Le problème, c'est que la psychanalyse est une théorie philosophique et que l'on ne parle pas le même langage que les scientifiques, lesquels d'ailleurs dénoncent eux-mêmes les dérives scientistes de leurs disciplines. Le rapprochement des psychanalystes avec les idéaux de la vieille morale chrétienne, du fait de la pauvreté des débats avec la science, a eu des conséquences dramatiques. Ils sont passés à côté des grands débats sur les nouvelles formes de sexualité. On a vu les psychanalystes s'arc-bouter sur un conservatisme le plus étriqué, notamment à propos de l'homosexualité, du Pacs et des nouvelles formes de filiation : « On ne touche pas à notre théorie du père, il est impossible que deux personnes du même sexe élèvent un enfant, on a besoin d'un papa et d'une maman ! » À l'opposé, les cognitivo-comportementalistes sont apolitiques, ils sont pour le libéralisme absolu en matière de moeurs, puisqu'ils nient toute fonction symbolique. Leur philosophie spontanée, c'est le « jouir le mieux possible », tempéré par l'évaluation : un cauchemar moderne qui transforme les hommes en « choses ». Cela n'est pas pensable, avec la psychanalyse qui pose que l'être humain est soumis à la Loi (au sens juridique et symbolique), la Loi en tant qu'elle garantit la liberté de chacun, sans pour autant autoriser la barbarie de la jouissance pulsionnelle illimitée. Mais de nombreux psychanalystes ont confondu cette conception de la Loi avec la défense d'un vieux souverainisme étriqué fondé sur le culte du père comme équivalent de l'État-nation.
Élisabeth Roudinesco
Historienne et psychanalyste, elle est professeure à l'université Paris VII-Diderot et à l'École pratique des hautes études. Elle est l'auteure d'Histoire de la psychanalyse, tomes I et II (Fayard, 1994), de Le Patient, le thérapeute et l'État (Fayard, 2004) et de La Part obscure de nous-mêmes, une histoire des pervers (Albin Michel, 2007).
[ltr]La révolution freudienne[/ltr]
Jennifer Schwarz - publié le 01/07/2009
Au XIXe siècle, le traitement clinique de la sexualité s'inscrit de la tradition bourgeoise et chrétienne. Freud luttera contre cette morale et ses carcans liés aux interdits religieux. Un bouleversement aujourd'hui remis en cause.
Tout au long du XIXe siècle, avec l'apparition de la psychiatrie d'abord, puis de la psychologie clinique, le pouvoir anciennement dévolu au prêtre est progressivement transféré au médecin...
Le médecin va en effet prendre en charge la sexualité et le traitement des déviants. On s'occupe de plus en plus de la sexualité, non pas du point de vue du jugement divin mais de la reproduction, de la biologie et du désir. Ainsi sort-on d'un monde dominé par la puissance patriarcale et où les mariages étaient arrangés. Au lieu de traiter la question morale, au sens de la foi chrétienne, la bourgeoisie s'intéresse au sexe biologique et elle réinjecte la question sexuelle au coeur de cette nouvelle conception scientifique du sexe, construite sur la base du savoir médical. Dans la deuxième moitié du siècle, on s'intéresse particulièrement au développement de la sexualité infantile, à la femme hystérique et à l'homosexuel. Autrement dit, on s'occupe de l'anomalie. L'enfant doit être normalisé. On invente des appareils pour l'empêcher de se masturber. C'est la morale médicale qui est évidemment dans une continuité avec la morale bourgeoise, à la fois chrétienne et biologique.
Et que fait Freud ?
La théorie freudienne est, du point de vue de la sexualité, une révolution. Freud change le regard sur la sexualité. Aussi sera-t-il accusé, par toutes les religions, particulièrement le catholicisme, d'être un profanateur de la famille, un dynamiteur de la société, un démon darwinien et un obsédé sexuel. Pourquoi ? Parce qu'il considère que la société bourgeoise bride le désir sexuel. Au lieu de pointer du doigt l'anormalité, il va montrer que tous les conflits à l'origine de l'être humain sont au départ sexuels et liés au désir. Si les femmes de cette époque sont hystériques, c'est parce qu'elles ont des frustrations, non parce qu'elles sont anormales... Freud est un matérialiste, qui considère la sexualité comme un phénomène à la fois psychique et biologique. Il n'est pas un théoricien de la liberté sexuelle à tout prix, mais un émancipateur qui lutte contre la morale de son époque, trop patriarcale, avec ses carcans liés aux interdits religieux. Jusqu'en 1897, date à laquelle il élabore sa première théorie sexuelle, il voit beaucoup de femmes qui disent avoir subi des abus. La névrose adulte, pense-t-il d'abord, vient de traumatismes sexuels réels, et puis il s'aperçoit que si certaines femmes ont véritablement connu un abus, d'autres l'ont sincèrement imaginé : il invente ainsi la notion de fantasme. Il démontre donc que nous avons tous des problèmes sexuels dans la tête et pas seulement dans le corps ! C'est bien plus subversif ! Cela sera aussi très déstabilisant pour la civilisation de découvrir ce que les enfants désirent vraiment, quand ils élaborent des « théories » très crues sur les rapports sexuels et la naissance. Il fera ainsi scandale en 1905, en affirmant qu'il est parfaitement normal pour un enfant de se masturber et que tous les enfants ont une sexualité pulsionnelle. Cela devient « anormal », lorsque ça tourne à la manie fétichiste.
L'Église catholique condamne, jusqu'en 1945, l'oeuvre de Freud, au même titre que celle de Marx. Pourquoi ?
Car le communisme et la psychanalyse sont les deux ferments, pour l'Église, de la liquidation de la morale chrétienne : deux théories matérialistes élaborées par des Juifs hostiles à la religion. De même, toutes les dictatures vont bannir le freudisme, comme théorie de la liberté humaine. Par la suite, l'Église catholique romaine changera de doctrine, en introduisant l'expertise psychiatrique pour le discernement des vocations. L'Église n'a alors plus envie d'accueillir des pervers sexuels et des homosexuels refoulés dans ses rangs. On se fie dès lors aux théories psychiatriques, dominées à l'époque par celles de Freud. À la faveur de cette introduction, les jésuites et les dominicains se passionneront pour l'exploration de soi. Et à l'intérieur de l'expérience psychiatrique pour les novices, ils introduiront les cures psychanalytiques.
Sur les questions sexuelles, après avoir longtemps été l'ennemie des dogmes religieux, la psychanalyse n'a-t-elle pas tendance, depuis une vingtaine d'années, à se rapprocher du conservatisme moral de l'Église ?
La transformation s'est opérée en plusieurs temps, chez toutes les tendances des psychanalystes : kleiniens, lacaniens, lesquels sont les héritiers de Freud. Avec la création de l'International Psychoanalytical Association (IPA) en 1910, ce mouvement d'émancipation s'est transformé en une Église laïque, avec des règles pour la cure et une nouvelle morale orthodoxe... Après avoir été critiquée par les Églises pour des raisons morales, la psychanalyse a été violemment attaquée par les scientistes, pour lesquels il n'y a pas de psychisme hors des neurones et du fonctionnement cérébral. Quand la psychiatrie devient comportementaliste, elle exclut l'inconscient, la sexualité, le transfert, le désir, au profit d'une classification des comportements. La caractéristique des comportementalistes, c'est la détestation des religions, et pour eux, la psychanalyse est une religion et les psychanalystes, des prêtres masqués. Ils aiment certaines formes de religiosité qui ne sont pas la religion, comme par exemple la méditation transcendantale, en tant qu'outil technique.
Se sentant menacés, les psychanalystes se seraient donc naturellement rapprochés de l'Église ?
Oui et non. Non, car ils sont en général athées. Oui, car le débat avec les représentants des neurosciences est devenu, hélas, inopérant, à force de conformisme : ne parler que de sérotonine ou de circuits cérébraux, cela devient très ennuyeux. Aujourd'hui, les psychanalystes risquent d'être assignés à servir de supplétifs à tout ce qu'on ne peut pas traiter par les médicaments. Et donc, ce n'est guère intéressant du point de vue de la réflexion théorique. Le problème, c'est que la psychanalyse est une théorie philosophique et que l'on ne parle pas le même langage que les scientifiques, lesquels d'ailleurs dénoncent eux-mêmes les dérives scientistes de leurs disciplines. Le rapprochement des psychanalystes avec les idéaux de la vieille morale chrétienne, du fait de la pauvreté des débats avec la science, a eu des conséquences dramatiques. Ils sont passés à côté des grands débats sur les nouvelles formes de sexualité. On a vu les psychanalystes s'arc-bouter sur un conservatisme le plus étriqué, notamment à propos de l'homosexualité, du Pacs et des nouvelles formes de filiation : « On ne touche pas à notre théorie du père, il est impossible que deux personnes du même sexe élèvent un enfant, on a besoin d'un papa et d'une maman ! » À l'opposé, les cognitivo-comportementalistes sont apolitiques, ils sont pour le libéralisme absolu en matière de moeurs, puisqu'ils nient toute fonction symbolique. Leur philosophie spontanée, c'est le « jouir le mieux possible », tempéré par l'évaluation : un cauchemar moderne qui transforme les hommes en « choses ». Cela n'est pas pensable, avec la psychanalyse qui pose que l'être humain est soumis à la Loi (au sens juridique et symbolique), la Loi en tant qu'elle garantit la liberté de chacun, sans pour autant autoriser la barbarie de la jouissance pulsionnelle illimitée. Mais de nombreux psychanalystes ont confondu cette conception de la Loi avec la défense d'un vieux souverainisme étriqué fondé sur le culte du père comme équivalent de l'État-nation.
Élisabeth Roudinesco
Historienne et psychanalyste, elle est professeure à l'université Paris VII-Diderot et à l'École pratique des hautes études. Elle est l'auteure d'Histoire de la psychanalyse, tomes I et II (Fayard, 1994), de Le Patient, le thérapeute et l'État (Fayard, 2004) et de La Part obscure de nous-mêmes, une histoire des pervers (Albin Michel, 2007).
Page 1 sur 2 • 1, 2 
 Sujets similaires
Sujets similaires» Religion des Indiens
» Origine du mot "RELIGION"
» Histoire de la religion
» La religion Jedi
» Histoire de la religion
» Origine du mot "RELIGION"
» Histoire de la religion
» La religion Jedi
» Histoire de la religion
Page 1 sur 2
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum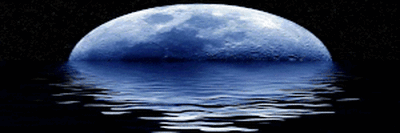
 S'enregistrer
S'enregistrer

