Religion et Philosophie
Forum Religion : Le Forum des Religions Pluriel :: ○ Science / Histoire :: Gnose/Philo :: Philosophie
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5 
 Religion et Philosophie
Religion et Philosophie
Religion et Philosophie
Religion & philosophie
On a suffisamment remarqué que la religion1 et la philosophie peuvent être rapprochées, notamment par les questions communes qu’elles se posent : celles de la place de l’homme dans la nature, du bien et du mal, et d’autres encore. En outre, quelques théologiens ont “emprunté” aux philosophes certains de leurs concepts et de leurs formes de raisonnement, comme saint Thomas d’Aquin à Aristote. La réciproque existe également, par exemple dans le concept philosophique de Dieu. Enfin, nombre de philosophes se sont réclamés ou se réclament d’une religion particulière. Ce sont là quelques unes des raisons de se demander si une philosophie peut être religieuse ou si une religion peut être philosophique2. Bien que la réponse soit évidemment positive pour beaucoup, nous tenterons de montrer ici que la religion comme la philosophie ne peuvent que se perdre elles-mêmes, c’est-à-dire renoncer à ce qui les caractérise respectivement, dans une telle “union”.
Pour étayer notre réponse, il nous faudra pour commencer déterminer quelques unes des propriétés spécifiques de la religion d’une part, de la philosophie d’autre part.
1. Considérations générales sur la religion et la philosophie
Il semble que la notion de révélation soit la première spécificité de la religion au sens habituel du terme – celui, précisément, de religion révélée3 –, dans la mesure où elle est la condition même de la possibilité d’une religion : aucune ne prétend en effet être une émanation de l’homme seul ; il faut donc qu’un principe extérieur à l’humanité soit en mesure de transmettre à celle-ci, quelle qu’en soit la manière, ce qui définira la religion en question. C’est cette transmission que nous appelons ici révélation.
Quant au principe lui-même, les cas du Bouddhisme et de quelques autres religions orientales suffisent à empêcher qu’on le définisse par le terme de divinité : il y a des religions sans dieu. Mais ces cas ne sont pas vraiment gênants, car on peut se référer plus largement à la notion de sacré ; la religion est alors ce qui met l’homme en rapport avec le sacré4. On peut ajouter que le sacré, bien qu’il se réfère, selon les religions, à des actions, des choses ou des entités fort diverses, doit être caractérisé dans chaque religion comme un absolu. Autrement dit, la sacralités de ce qui est sacré ne peut pas, à l’intérieur d’une religion donnée, être discutée, remise en cause ou a fortiori niée5. Il y a plus encore : l’affirmation de la sacralité de ce qui est sacré se présente comme le fondement de la religion concernée6, fondement qui, justement parce qu’il est indiscutable, n’a pas à être expliqué. Et dans tous les cas, les éventuelles “justifications” théologiques de ce fondement n’appartiennent pas en propre à la religion concernée. Nous voulons dire par là que premièrement, elles sont toujours développées a posteriori, et bien souvent dans un but plus didactique que véritablement religieux. Deuxièmement et en conséquence, elles sont au bout du compte facultatives, au sens où leur absence n’affaiblirait pas la religion en elle-même. Troisièmement, elles sont inutiles pour l’authentique croyant dont la foi n’a nul besoin d’explication. On peut même, d’un certain point de vue, les considérer comme nuisibles pour cette religion, dans la mesure où elles paraissent sous-entendre que le fondement de la religion en question ne va pas de soi. Autrement dit, les justifications rationnelles d’une religion prennent toujours le risque d’être perçues comme des aveux de faiblesse d’une doctrine qui aurait besoin de “se justifier”, au sens péjoratif de l’expression.
Que dire, dès lors, de la philosophie ? Pas plus que pour la religion, nous ne chercherons à la définir mais, ce qui sera ici suffisant, à la caractériser. Il semble que l’on peut dire de la philosophie l’exact opposé de ce qui vient d’être dit de la religion. Reprenons les points l’un après l’autre.
La seule idée de révélation rendra a priori le philosophe, au mieux, perplexe. Que pourrait en dire en effet la raison, pierre de touche de la recevabilité d’une argumentation philosophique ? Descartes ne s’y est pas trompé : « Je révérais notre théologie, et prétendais, autant qu’un autre, à gagner le ciel ; mais ayant appris, comme chose très assurée, que le chemin n’en est pas moins ouvert aux plus ignorants qu’aux plus doctes, et que les vérités révélées, qui y conduisent, sont au-dessus de notre intelligence, je n’eusse osé les soumettre à la faiblesse de mes raisonnements, et je pensais que, pour entreprendre de les examiner, et y réussir, il était besoin d’avoir quelque extraordinaire assistance du ciel, et d’être plus qu’homme. »7 Notons que ces lignes ne contredisent en rien les textes où le même Descartes traite de Dieu, des preuves de son existence, de sa nature, et ainsi de suite, par exemple dans les Méditations, puisqu’il ne s’agit pas alors de vérités révélées, mais bien de vérités rationnelles, donc accessibles au philosophe. Autrement dit, la religion et indirectement le passage ci-dessus traitent du “Dieu des religions”, alors que c’est du “Dieu des philosophes” que Descartes affirme certaines propriétés.
Prenant un exemple de vérité révélée, Spinoza va plus loin : « Quand certaines Églises ajoutent que Dieu a pris une forme humaine, j’ai expressément averti que je ne sais pas ce qu’elles veulent dire ; et même, à dire vrai, affirmer cela ne me paraît pas moins absurde que de dire que le cercle a pris la forme d’un carré. »8
D’une manière générale, nul ne saurait nier que, souvent, les “vérités révélées” déconcertent, pour ne pas dire plus, la raison. Cela ne signifie pas pour autant que, pour cette seule raison, le philosophe doive les rejeter inconditionnellement. Un tel rejet ne se justifie que pour un certain courant philosophique, à savoir le rationalisme9. Mais pour accepter positivement l’idée qu’une révélation, tout en étant manifestement irrationnelle, est source de vérité, il faudra franchir un pas qui, d’après nous, fait sortir de la philosophie. Le philosophe le plus “ouvert” aux religions ne peut donc qu’être réservé quant à l’idée même de révélation. Comment d’ailleurs choisirait-il entre les diverses religions ? Le philosophe ne peut, comme le font la quasi-totalité des croyants, adopter une religion uniquement en fonction de la société à laquelle il appartient par sa naissance et par son éducation10.
Concernant le contenu des dogmes eux-mêmes, le philosophe devra selon nous adopter la même prudence. On peut sans doute s’entendre pour considérer qu’en aucun cas le philosophe n’acceptera une “vérité” qui, sans être évidente en elle-même, ne s’accompagne d’aucune justification théorique. Or nous avons remarqué précédemment que le fondement d’une religion n’est précisément jamais justifié a priori ; quand il l’est a posteriori, ce ne peut donc être que par une personne qui l’a au préalable admis sans une telle justification. Comment le philosophe pourrait-il avaliser cette admission ? Comment pourrait-il ne pas dénoncer la justification a posteriori comme une imposture visant à légitimer philosophiquement une prise de position qui ne fut pas, au départ, philosophique ? Le fondement d’une philosophie ne saurait être lui-même extérieur à la philosophie. Or la religion, et elle s’en félicite, trouve son principe hors de l’humanité, donc hors de la philosophie. Nous reviendrons sur ce point dans la troisième partie de cette étude.
De même, le philosophe ne pourra pas ne pas trouver contraire à la philosophie le refus de remettre en cause ou même seulement de “discuter” de certains dogmes, et singulièrement l’affirmation de la sacralité. On objectera peut-être que les philosophes eux-mêmes considèrent parfois certaines de leurs “vérités” comme indiscutables, sans qu’on leur refuse pour cela le titre de philosophe. La différence, de taille, est que le philosophe produira toujours, même lorsqu’il prétend énoncer une vérité indiscutable, une justification théorique l’accompagnant – ne serait-ce que l’affirmation de son évidence rationnelle, qui ne saurait sérieusement valoir pour les vérités révélées. De plus, il ne refusera jamais de répondre à une éventuelle objection11, pour peu qu’elle soit philosophiquement intelligible, et ne menacera aucun contestataire des flammes de l’enfer.
On peut donc conclure que sans justification théorique, une proposition, quelle qu’elle soit, ne peut prétendre être philosophique. Autrement dit, le sens et la valeur de la philosophie ne résident pas moins dans l’argumentation des thèses que dans les thèses elles-mêmes, ce qui ne saurait raisonnablement se dire de quelque religion que ce soit.
Plus généralement, on pourrait dire que, si la religion est acceptée, elle rend la philosophie, pour une importante partie, inutile. En effet, certains dogmes religieux peuvent être considérés comme des réponses non philosophiques à des questions que se posent aussi les philosophes. Aussi le philosophe qui cherche à répondre, philosophiquement, à ces mêmes questions, entreprend-il une tâche ridicule du point de vue de la religion : sans pouvoir se targuer de la même “infaillibilité” que les religions, car la philosophie n’est qu’humaine – trop humaine ? –, il va chercher des réponses peu fiables – et, de fait, ses “collègues” philosophes ne se priveront pas de les critiquer – alors qu’il en existe déjà, et de beaucoup plus sûres, puisque d’essence bien souvent divine, et en tous cas non sujettes à la faillibilité humaine. Il ne restera donc au philosophe qu’à s’occuper de domaines que la religion a bien voulu négliger, car ne touchant manifestement pas, selon elle, au “salut” de l’homme : l’épistémologie ou l’esthétique par exemple. Mais pour les questions de métaphysique, d’éthique, d’anthropologie au sens large et parfois de politique, le débat doit être considéré, du point de vue religieux, comme clos. A l’opposé, on peut considérer que, du point de vue du philosophe, les questions philosophiques n’ont pour lui de raison d’être que s’il estime qu’elles n’ont pas encore reçu de réponse complète et définitive, émanant d’une religion quelconque, d’un autre philosophe ou de quelque autre source que ce soit. C’est seulement en acceptant cette “vacuité” que la philosophie a un sens.
Au fond, et on le verra mieux dans les deux cas précis étudiés ci-après, pour les philosophes religieux, la philosophie ne peut servir qu’à “redécouvrir” par la raison ce que la foi, par le biais de la révélation, a déjà enseigné. Cette conception de la philosophie comme « servante de la théologie », héritée du Moyen-Âge, ne peut pas disparaître si l’on admet, avant de philosopher, la vérité d’une religion. Et, même si l’on fait mine de se défendre d’adopter une telle conception, on voit mal comment il en serait autrement : « la vérité ne peut contredire la vérité », et si une vérité est admise au préalable – la vérité religieuse –, on sait déjà, avant même de commencer à philosopher, que la deuxième – la vérité philosophique – sera identique à la première ou au moins compatible avec elle ; il reste seulement à trouver des arguments philosophiques pour appuyer cette vérité unique, mais à deux visages. C’est par exemple la position de Jean-Paul II qui ouvre ainsi l’encyclique Fides et ratio : « La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l’esprit humain de s’élever vers la contemplation de la vérité »12. Mais si la métaphore est juste, les deux ailes doivent nécessairement voler de manière concordante. Le chemin et le but étant bien sûr déterminés, dès l’envol, par l’aile de la foi, l’aile de la raison n’a plus qu’à s’y plier…
On pourrait ici nous faire l’objection suivante : certes, si la religion est admise avant que la réflexion philosophique soit engagée, les jeux sont faits, et la philosophie n’en sera pas vraiment une, puisque sa fin, dans les deux sens du terme, est déjà connue, et surtout a été déterminée de l’extérieur de la philosophie. Mais qu’est-ce qui empêche un philosophe de découvrir au préalable, par la philosophie, des vérités dont il remarquera ensuite la conformité avec une religion donnée, adoptant ainsi cette dernière après, et non avant, la naissance de sa réflexion philosophique ? Nous ne pouvons ici qu’acquiescer sur le plan théorique. Si un tel itinéraire de pensée existait, c’est sans hésitation que nous lui accorderions le statut de philosophie. Deux remarques s’imposent toutefois :
– Premièrement, nous ne pouvons manquer de signaler l’extrême difficulté théorique d’un tel cheminement, ainsi que l’impossibilité pratique de vérifier l’ordre de ses étapes, telles qu’elles ont été décrites ci-dessus. Il est en effet indéniable que, dans la quasi-totalité des cas, la religion apparaît bien avant la philosophie dans l’existence d’un individu. Lorsque l’esprit de l’adolescent est suffisamment mûr pour philosopher, la religion y est souvent déjà présente depuis bien longtemps. Il est vrai que certains ont su se dégager de l’influence de l’éducation religieuse qu’ils ont reçue. Mais on voit bien que, sauf exception rarissime, c’est toujours la religion qui précède la philosophie dans l’histoire d’un homme. De qui peut-on donc affirmer qu’il a “redécouvert” dans la religion ce qu’il avait découvert dans la philosophie ?
– Deuxièmement, même si une philosophie parvenait à justifier philosophiquement tous les dogmes voire toutes les pratiques d’une religion donnée, cette philosophie n’aurait qu’une conformité extérieure et même fortuite avec cette religion, puisque la seule justification véritable d’une religion est la révélation et que celle-ci est, par définition, hors de portée de toute justification philosophique. Autrement dit, une telle philosophie ne serait pas vraiment religieuse.
Il faut à présent confronter les analyses générales qui précèdent à des cas concrets qui pourraient sembler les invalider. En premier lieu, pour “tester” notre thèse selon laquelle il ne peut exister de philosophie religieuse, nous étudierons les textes de deux philosophes en accord avec une certaine religion (en l’occurrence le Christianisme). En second lieu, pour vérifier qu’une religion philosophique est impossible, notre attention se portera sur religion particulière dont certains affirment le caractère philosophique.
Une remarque méthodologique s’impose ici. Des exemples, aussi nombreux soient-ils, ne constituent pas des preuves en eux-mêmes. Ils ne jouent ici qu’un rôle d’illustration, en vue de rendre concrète notre thèse.
2. Les philosophies de Leibniz et de Kant sont-elles des philosophies religieuses ?
Les “philosophies religieuses” que nous allons maintenant étudier sont celles de Leibniz et de Kant13. Nous ne prétendons pas ici livrer une analyse intégrale de la philosophie de la religion de ces auteurs, mais seulement indiquer le ou les moments où, selon nous, ils ont “glissé” de l’intérieur à l’extérieur de la philosophie pour tenter de justifier leur croyance religieuse. Un passage du début du Discours de métaphysique de Leibniz suffira à montrer ce que nous considérons comme une “sortie injustifiée” hors de la philosophie, injustifiée en ceci seulement qu’elle prétend prendre place dans une argumentation philosophique, tant dans le problème étudié que dans la méthode adoptée. Cela signifie que, en dehors de son activité philosophique, un philosophe peut fort bien écrire des textes exposant des vérités révélées – ou de la littérature, ou quoi que ce soit… –, à condition qu’il n’affirme ni ne sous-entende qu’il s’agit là de textes philosophiques ; or c’est précisément le cas de l’ouvrage évoqué ici, comme l’indique clairement son titre.
Après avoir défini Dieu comme étant « un être absolument parfait » et expliqué ce qu’on doit entendre par le concept de perfection, Leibniz conclut « que Dieu possédant la sagesse suprême et infinie agit de la manière la plus parfaite » et « que plus on sera éclairé et informé des ouvrages de Dieu, plus on sera disposé à les trouver excellents et entièrement satisfaisants à tout ce qu’on aurait pu souhaiter. » Bien qu’il y ait dans ces lignes matière à de nombreuses objections, nous sommes ici dans la philosophie, précisément parce que ces objections peuvent être elles-mêmes de nature philosophique. Il nous semble en revanche que Leibniz sort de la philosophie lorsqu’il écrit :
« Ainsi, je suis fort éloigné du sentiment de ceux qui soutiennent qu’il n’y a point de règle de bonté et de perfection dans la nature des choses, ou dans les idées que Dieu en a et que les ouvrages de Dieu ne sont bons que pour cette raison formelle que Dieu les a faits. Car si cela était, Dieu sachant qu’il en est l’auteur n’avait que faire de les regarder par après et de les trouver bons, comme le témoigne la sainte écriture. »14
L’importance de l’argument de l’autorité biblique est ici prépondérante : Dieu a regardé ses ouvrages et les a trouvés bons, car c’est ce qu’affirment l’écriture, qualifiée de “sainte” sans justification. Or il nous semble que le philosophe n’est pas tenu de croire a priori en la divinité de l’origine des Écritures. Mais, une fois admise l’autorité de la Bible, le passage ci-dessus ne se prête à aucune objection philosophique : dès lors, il est en quelque sorte “infalsifiable” au sens que Popper donne à ce terme. Aucun débat philosophique n’est plus possible. Le raisonnement de Leibniz, entièrement explicité, est en effet le suivant :
1. La Bible a été inspirée par Dieu.
2. Or Dieu possède toutes les perfections morales, dont celle d’être vérace.
3. Donc la Bible dit la vérité.
4. Or la Bible dit que Dieu, après avoir créé certaines de ses œuvres, vit qu’elles étaient bonnes (par exemple : « Dieu dit : “Que les eaux qui sont sous le ciel s’amassent en une seule masse et qu’apparaisse le continent” et il en fut ainsi. Dieu appela le continent “Terre” et la masse des eaux “mers”, et Dieu vit que cela était bon. »15)
5. Donc Dieu a pu constater, ou plus précisément “vérifier”, la bonté de ses œuvres en les regardant.
6. Donc les choses sont bonnes intrinsèquement, c’est-à-dire que la bonté est en elles-mêmes, et non pas extrinsèquement, c’est-à-dire seulement parce que Dieu en est l’auteur ou la cause.
On peut indifféremment inverser l’ordre des propositions 1. et 2. Il reste que la divinité des Écritures est un pilier de cette démonstration, et donc que sa remise en cause implique celle de tout le raisonnement. Or il semble clair que l’affirmation « La Bible a été inspirée par Dieu » n’est pas et ne peut pas être une thèse philosophique16, c’est-à-dire une affirmation susceptible d’être fondée et contredite par des arguments philosophiques – si du moins on se réfère au sens que Leibniz donne ici au mot “Dieu”, c’est-à-dire au sens religieux.
Nous affirmons donc que le raisonnement de Leibniz extrait du Discours de métaphysique n’est pas, par son fondement, philosophique, et plus généralement que tout système de pensée fondé sur une quelconque révélation, sans que la raison vienne justifier ce fondement17, ne saurait être qualifié de philosophie.
Pour Spinoza en revanche, la question de la divinité des Écritures peut se poser en termes philosophiques, mais en donnant au concept de Dieu un sens qui n’est assurément pas le sens religieux. Lorsqu’il écrit en effet : « (…) la plupart, en vue de comprendre l’Écriture et d’en dégager le vrai sens, posent pour commencer la divine vérité de son texte intégral. (Alors que cette conclusion devrait découler d’un examen sévère de son contenu.) »18, il est clair que l’expression « divine vérité » est quasiment, sous sa plume, un pléonasme, et donc que c’est en examinant le texte biblique lui-même que l’on pourra conclure qu’il dit la vérité – ou non –, et donc qu’il exprime la “divine vérité”. Pour Leibniz, la Bible dit vrai parce que Dieu en est l’auteur19 ; c’est du moins ce qu’on peut supposer en l’absence de toute autre justification.
Dans La religion dans les limites de la simple raison, Kant va tenter de montrer que le Christianisme n’est pas seulement un « religion révélée », étant apparue à une époque et un endroit précis, mais également une « religion naturelle », c’est-à-dire, en droit, universelle et mondiale : chaque homme, quelles que soient son époque et sa société, et pour autant qu’il soit doué de raison, peut reconnaître que les principes moraux enseignés par le Christianisme sont identiques à ceux que sa raison pratique lui dicte. Pour démontrer cette identité, Kant va se livrer à une exégèse détaillée du Sermon sur la montagne20, texte qui contient d’après lui l’essentiel des préceptes moraux du Christianisme. Ce que Kant relève notamment dans le Sermon, c’est qu’il enjoint de suivre l’esprit de la loi plutôt que la lettre. On retrouve ici la distinction faite par Kant dans les Fondements de la métaphysique des mœurs entre “agir par devoir” et “agir conformément au devoir”. Ainsi du fameux passage :
« Vous avez entendu qu’il a été dit : “Tu ne commettras pas l’adultère”. Eh bien ! Moi je vous dis : quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis, dans son cœur, l’adultère avec elle. »21
Kant comprend ces versets comme dénonçant l’hypocrisie d’une conduite extérieure ou plus précisément physique, seulement conforme extérieurement à l’interdiction de l’adultère22 – consistant à ne pas commettre l’acte de l’adultère –, et qui l’enfreint néanmoins si le désir est bien réel. Plus généralement, Kant rappelle que l’enseignement du Christ n’est pas supposé être différent de la loi hébraïque23, mais qu’il a interprété la Loi pour montrer sa conformité à la raison pratique : « Car au pied de la lettre, la loi autorisait exactement le contraire »24 de ce qu’autorise l’interprétation du Christ, dit Kant.
Remarquons que pour parvenir à la conviction que la Bible est en conformité avec la raison pratique, il a fallu tout d’abord que le Christ interprète la loi hébraïque, c’est-à-dire qu’il en révèle l’esprit en la débarrassant d’une lecture « au pied de la lettre », puis que Kant lui-même interprète les paroles du Christ pour montrer qu’elles ne sont qu’une autre formulation, sans doute plus accessible au plus grand nombre, de la loi morale prise en elle-même, énoncée en termes philosophiques.
C’est donc au prix de deux interprétations successives – celle de la loi hébraïque par le Christ puis celle des paroles du Christ par Kant – que l’on parvient à montrer la conformité de l’enseignement biblique avec la raison pratique. Et c’est bien là la première objection que l’on peut faire à Kant : une religion naturelle étant universelle, tout homme doit pouvoir accéder aux vérités qu’elle enseigne. S’il est déjà déconcertant que Dieu transmette aux hommes un texte énonçant une loi morale qu’il a, de toute façon, “inscrite” en tout homme possédant la raison pratique, il est encore plus étonnant que ce texte doive dans certains cas – l’Ancien Testament – “subir” tour à tour deux interprétations, dont le moins que l’on puisse dire est qu’elles ne vont pas de soi25, pour au bout du compte énoncer ce que tous savaient déjà avant ! Si l’on ajoute que le texte d’origine, supposé être inspiré par Dieu, enseigne selon Kant lui-même des choses opposées selon qu’on le prend à la lettre ou qu’on en dégage l’esprit, on comprend difficilement la valeur et la légitimité d’un tel texte. Kant ne cherche-t-il pas plutôt à “asseoir” la légitimité de sa philosophie morale sur l’autorité du Christianisme ? Sur le plan philosophique, qu’importe après tout que la “vraie” morale, que Kant prétend enseigner, soit ou non celle d’une religion institutionnelle, fût-ce la religion dominante ?
On peut également contester la prééminence et même l’exclusivité que Kant accorde au Christianisme en matière de morale : « Mais, suivant la religion morale (et parmi toutes les religions publiques qu’il y eut jamais, seule la religion chrétienne a ce caractère) … »26 Cette affirmation, écrite entre parenthèses, comme semblant si peu contestable qu’elle se passe de justification, a évidemment de quoi choquer par son intolérance. Mais elle déconcerte également celui qui a pris note du fait que le Christianisme n’enseigne en fin de compte rien de plus que le Judaïsme. Si le Christ, selon ses propres paroles, vient pour accomplir la Loi et les Prophètes27, c’est bien qu’il n’y a aucune différence de fond entre le Judaïsme et le Christianisme28. Si différence il y a, ce ne peut pas être une différence telle que le second serait une, ou plutôt “la” religion morale, ce que ne serait pas le premier ! Plus précisément, pour Kant, si le Judaïsme n’est pas une religion morale, c’est parce que, comme toutes les religions sauf le Christianisme, il comporte en lui la recherche des faveurs divines.
Cette délicate question tourne plus ou moins directement autour de ce qu’on appelle la morale de la rétribution, c’est-à-dire une morale qui affirme que les pieux et les justes sont récompensés et que les impies et les méchants sont punis. S’il est incontestable que la Bible hébraïque enseigne parfois une telle morale29, des livres comme ceux de Job30 et de l’Ecclésiaste la condamnent catégoriquement31 – ce dont Kant ne tient pas compte – en remarquant que le juste subit parfois des maux “naturels”, donc d’origine divine, et que la fortune sourit parfois au méchant. Chacun est alors invité à s’en remettre à la sagesse divine sans chercher à en percer les desseins.
Supposons toutefois que cette immoralité du Judaïsme soit fondée ce qui, on le voit, ne va pas de soi. Le plus paradoxal est encore que Kant, en critiquant indirectement la morale juive, condamne nécessairement la Bible hébraïque, où la morale de la rétribution apparaît effectivement. Or cette Bible hébraïque est, quelques différences infimes mises à part, reprise par le Christianisme à son propre compte sous le nom d’Ancien Testament. La recherche des faveurs est-elle présente ou absente des mêmes textes, selon qu’ils sont lus par les Juifs ou par les Chrétiens ? Il y a là encore, semble-t-il, une très forte partialité de Kant en faveur du Christianisme, partialité qu’une véritable neutralité philosophique a priori aurait rendue, selon nous, impossible. Nous affirmons bien que cette neutralité devrait exister a priori, sans qu’elle doive nécessairement se prolonger a posteriori. Mais Kant ne justifie par aucun argument philosophique la suprématie du Christianisme dans le domaine morale. On pourrait d’ailleurs remarquer que le Nouveau Testament n’est pas non plus exempt de passages exprimant une morale de la rétribution32, ce que Kant, là encore, passe sous silence.
Dans la même logique, il écrit : « Il n’existe qu’une religion (vraie) »33. Mais comment le Christianisme pourrait-il être la vraie religion s’il est, selon les paroles de Jésus lui-même, l’accomplissement d’une fausse religion, en l’occurrence le Judaïsme ?
Enfin34, Kant nous semble également faire preuve d’une précipitation suspecte et fort peu philosophique lorsqu’il écrit : « J’admets premièrement la proposition suivante, comme principe n’ayant pas besoin de preuve : Tout ce que l’homme pense pouvoir faire, hormis la bonne conduite, pour se rendre agréable à Dieu est simplement illusion religieuse et faux culte de Dieu »35. Non pas que nous pensions, le lecteur l’aura compris, que bien d’autres comportements sont susceptibles de plaire à Dieu ; mais ce qui est ici affirmé presque explicitement, c’est que la bonne conduite d’un homme le rend agréable à Dieu. Voilà certes une proposition qui aurait selon nous besoin de preuve, si cela était possible. A vrai dire, il peut sembler au contraire que l’idée d’un Dieu sensible aux comportements humains a quelque chose d’irrespectueux, pour ne pas dire d’hérétique, à moins d’affirmer que Kant utilise un langage anthropomorphique, ce que rien ne laisse supposer.
Bien d’autres remarques seraient possibles pour confirmer, avec celles qui précèdent, que Kant fait reposer sa philosophie morale sur un fondement non philosophique, mais bel et bien religieux a priori, donc non argumenté rationnellement.
3. Le Catholicisme est-il une religion philosophique ?
Nous allons à présent examiner un cas de religion prétendant ou pouvant prétendre être philosophique. Si nous choisissons le Catholicisme, ce n’est pas essentiellement parce qu’il est la religion plus répandue dans nos sociétés dites latines, mais surtout parce qu’il s’est doté d’une théologie plus “systématique” que d’autres religions, à la fois par sa “fréquentation” de la philosophie occidentale et par sa structure très hiérarchisée, qui ont permis l’établissement d’une doctrine unifiée et officielle, à l’abri, normalement, de toute contestation interne, ce qui facilite d’ailleurs grandement la recherche des références.
Quelques remarques préalables s’imposent toutefois. Nous avons déjà évoqué l’idée selon laquelle le fondement d’une philosophie ne saurait être “extra-philosophique”. C’est pourquoi la manière dont débute une philosophie est capitale. Notons que ce “début” n’est pas forcément – et, dans les faits, n’est que rarement – premier chronologiquement dans l’œuvre d’un philosophe. Ainsi le doute radical de Descartes est bien le début “logique” de sa philosophie sans apparaître dans ses premières œuvres. Si certains philosophes semblent ne pas s’être particulièrement souciés de ce “début philosophique”, ce ne peut être que parce qu’ils considèrent qu’il n’y a pas à proprement parler à fonder la philosophie, ou encore parce que toute réflexion philosophique peut servir de fondement à la philosophie.
Il ne saurait en aller de même dans une religion, dont le point de départ, à savoir la révélation, est toujours extérieur à la raison et même, plus largement, à l’homme. En fait, nous avons déjà rencontré ce cas de figure dans les textes de Leibniz et de Kant étudiés plus haut, dont nous avons montré qu’ils s’appuyaient sur des données spécifiquement religieuses, donc impossibles à argumenter philosophiquement.
Nous allons retrouver cette extériorité dans le fondement du Catholicisme : « Au point de départ de toute réflexion que l’Église entreprend, il y a la conscience d’être dépositaire d’un message qui a son origine en Dieu même (…). La connaissance qu’elle propose à l’homme ne vient pas de sa propre spéculation, fût-ce la plus élevée, mais du fait d’avoir accueilli la parole de Dieu dans la foi »36. Les choses sont donc claires : les vérités religieuses, auxquelles les hommes peuvent accéder par la révélation, préexistent à toute réflexion humaine. En raison de leur origine divine, elles sont infaillibles. Avant même d’inaugurer la moindre réflexion, le philosophe catholique sait donc vers quoi doit tendre sa philosophie. Celle-ci n’a par conséquent qu’un rôle secondaire de confirmation a posteriori de “vérités” admises comme vraies avant toute intervention de la raison philosophique. C’est donc en toute logique que Jean-Paul II écrit : « L’Église, pour sa part, ne peut qu’apprécier les efforts de la raison pour atteindre des objectifs qui rendent l’existence personnelle toujours plus digne. Elle voit en effet dans la philosophie le moyen de connaître des vérités fondamentales concernant l’existence de l’homme. En même temps, elle considère la philosophie comme une aide indispensable pour approfondir l’intelligence de la foi et pour communiquer la vérité de l’Évangile à ceux qui ne la connaissent pas encore »37. Ce que nous considérons comme contraire à la philosophie dans ces lignes, ce n’est pas, encore une fois, la position elle-même, c’est-à-dire la fonction “évangélisatrice” assignée à la philosophie, mais le fait que cette position soit assignée de l’extérieur de la philosophie, c’est-à-dire sans argumentation rationnelle. Dans la même logique, le pape condamne au terme de son encyclique un certain nombre de courants de pensée : l’éclectisme, l’historicisme, le scientisme, le pragmatisme et le nihilisme38. Ces doctrines sont considérées à la fois comme des « erreurs » et des « dangers ». C’est dire qu’il aurait mieux valu qu’elles ne soient jamais formulées. On ne peut là encore que refuser de qualifier de philosophie une pensée qui se voudrait sans “adversaire”, même intellectuel ; nous estimons en effet que l’esprit critique et l’ouverture à la contestation doivent être des soucis constants du philosophe, conscient qu’il est, et ne peut qu’être, de ne pouvoir se prévaloir d’aucune infaillibilité. Autrement dit, le philosophe a philosophiquement intérêt à être contesté, afin de tester la validité de sa pensée. Au contraire, une doctrine d’origine “surhumaine” ne peut avoir, envers une contestation humaine, qu’une attitude de commisération, d’indifférence, de mépris ou de violence, mais pas véritablement, on ne le voit que trop, d’écoute véritable.
On peut donc admettre que les “vérités religieuses” précèdent toute réflexion philosophique. Mais, objectera-t-on peut-être, la foi dans ces vérités religieuses ne peut-elle pas, quant à elle, être justifiée philosophiquement… ? Pas davantage, comme le reconnaît, là encore, le dogme catholique : « Le motif de croire n’est pas que les vérités révélées apparaissent comme vraies et intelligibles à la lumière de notre raison naturelle »39. Toutefois, pour que la foi soit conforme à la raison, Dieu a mis en œuvre des « preuves extérieures de sa Révélation » : « les miracles du Christ et des saints40, les prophéties, la propagation et la sainteté de l’Église, sa fécondité et sa stabilité ». La raison du philosophe trouvera-t-elle dans cette liste des preuves ou des « signes certains » de la révélation chrétienne ? Accordons au moins que cela n’est pas évident…
Conclusion
L’examen des “philosophies religieuses” de Leibniz et Kant a montré diverses “failles”, non pas en tant qu’erreurs à l’intérieur de leur philosophie, mais précisément en tant que manquements à l’exigence philosophique d’une argumentation rationnelle et donc de refus d’un quelconque argument d’autorité, fût-ce l’autorité de la Bible.
Nous pouvons donc conclure qu’une “philosophie religieuse” est soit extérieure à la religion, si la philosophie “précède” la religion41, soit extérieure à la philosophie si, comme nous croyons l’avoir montré pour les deux cas étudiés, la religion “précède” la philosophie. Cela ne signifie bien entendu pas que le philosophe soit par définition irréligieux. Dans la mesure où il est homme “avant” d’être philosophe, il pourra, comme Leibniz, Kant et beaucoup d’autres, croire en Dieu et même appartenir à une religion précise. Mais il devra renoncer à légitimer sa foi, ses croyances et ses pratiques par des arguments philosophiques, et donc renoncer à intégrer sa religion dans sa philosophie. Il pourra seulement – et même en tant que croyant, il devra probablement – expliquer pourquoi sa philosophie doit forcément laisser une place, hors d’elle (au-dessus, dira-t-il sûrement), à la religion. Il pourra par exemple, à la manière d’un Pascal, essayer de montrer que la raison et donc la philosophie peuvent reconnaître elles-mêmes leurs propres limites : « La dernière démarche de la raison est de reconnaître qu’il y a une infinité de choses qui la surpassent ; elle n’est que faible, si elle ne va jusqu’à connaître cela. »42
Le philosophe peut donc être religieux, mais il ne peut pas l’être en tant que philosophe. La philosophie peut indiscutablement aller jusqu’au déisme ou au théisme, mais le pas qui mène du théisme à une religion révélée est précisément le pas qui fait sortir de la philosophie.
L’hypothèse d’une religion philosophique, du fait du nécessaire fondement non humain de toute religion, est elle aussi, dès le départ, à exclure.
Quant à l’athéisme, il n’est jamais que le refus d’une certaine conception de Dieu ou des dieux. On peut le voir par exemple avec Spinoza qui, tout en démontrant l’existence de Dieu43, peut bien être considéré comme “athée”, au sens où il refuse l’existence d’un Dieu anthropomorphe44. On le voit encore avec Marcel Conche, qui s’attaque précisément à l’idée d’un Dieu à la fois moralement bon et tout-puissant : « Il est indubitable (…) que le supplice des enfants a été, et devait ne pas être, et que Dieu pouvait faire qu’il ne soit pas. Comme Dieu ne s’est pas manifesté dans des circonstances où, moralement, il l’aurait dû, s’il existait, il serait coupable. La notion d’un Dieu coupable et méchant apparaissant contradictoire, il faut conclure que Dieu n’est pas. »45 Nous n’affirmons certes pas que cette argumentation, non plus que les démonstrations de l’existence de Dieu de Spinoza, sont à l’abri de toute contestation, y compris philosophique. Mais nous avons bien là des exemples de raisonnement parfaitement intelligible, que même le plus fervent des croyants peut suivre, pour peu qu’il soit doué de raison. L’athéisme peut donc être philosophique ou, ce qui revient au même, une philosophie peut être athée.
On se méprendrait en voyant dans cette étude une attaque contre les religions en général. Nous avons même indiqué à plusieurs reprises que l’attitude des religieux est très souvent en parfaite cohérence avec leurs convictions. Nous avons uniquement cherché à montrer en quoi religion et philosophie, sans forcément se combattre mutuellement, ne peuvent pas s’unir sans une dangereuse “confusion des genres”. Pour les deux partis, une telle union ne serait donc pas pour le meilleur mais seulement pour le pire…
Marc Anglaret
(écrire à cet auteur)
Commentaire
1 Nous considérerons ici les religions dans leur approximative unité, et plus précisément dans leur rapport à la philosophie.
2 Ces deux questions reviennent, au bout du compte, au même, mais au bout du compte seulement.
3 Nous reviendrons, avec l’examen de la position kantienne, sur la distinction entre religion naturelle et religion révélée.
4 Nous précisons bien qu’il ne s’agit pas là de donner une définition, avec tout ce que cette opération implique, de la religion, mais bien de la distinguer de la philosophie.
5 La question n’est pas ici celle de l’intolérance des religions, fort diverses sur ce point comme sur d’autres, mais celle du statut de l’affirmation de la sacralité au sein même d’une religion. Nous soutenons ici que cette affirmation se présente toujours comme indubitable, au point que toute éventuelle critique à ce sujet doit être considérée comme “déplacée”, dans le meilleur des cas…
6 Nous distinguons ici le fondement d’une religion, c’est-à-dire la ou les croyances, toujours liées au sacré selon nous, sur lesquelles s’appuient les autres croyances, de son principe, qui n’est pas une croyance mais l’origine de sa révélation : par exemple Dieu dans les religions monothéistes.
7 Discours de la méthode, première partie. NRF Gallimard, « La Pléiade », p.130. C’est nous qui soulignons.
8 Lettre LXXIII à Oldenburg (1675). NRF Gallimard, « La Pléiade », p.1283. Ce célèbre passage devrait suffire à éviter toute “récupération” du spinozisme par le Christianisme – ce qui, dans les faits, n’est pas le cas.
9 On objectera que certains philosophes habituellement qualifiés de rationalistes – par exemple Leibniz – admettent les vérités révélées de certaines religions, notamment le Christianisme. Nous étudierons précisément plus loin le cas de Leibniz, en montrant pourquoi il ne peut pas, selon nous, être pleinement considéré comme rationaliste.
10 Il n’a toutefois échappé à personne que, par une étrange coïncidence, les philosophes croyants adoptent dans la quasi-totalité des cas la religion de leur éducation, familiale notamment, et ce pas seulement dans le cas du Christianisme, comme le montrent les cas d’Averroès et de Maïmonide par exemple. Nous ne connaissons pas de contre-exemple sur ce point (Schopenhauer ne peut pas, par exemple, être sérieusement qualifié de “philosophe bouddhiste”, bien qu’il se soit lui-même reconnu dans certaines thèses du Bouddhisme).
11 Nous pensons par exemple aux Objections faites aux Méditations de Descartes, ou à la correspondance de nombre de philosophes.
12 Jean-Paul II, Fides et ratio (la foi et la raison), I, prologue ; lettre encyclique du 14 septembre 1998. Supplément au quotidien « La Croix » du 16 octobre 1998, p.3
13 D’autres philosophies pourraient bien sûr avoir leur place ici, par exemple celle de Hegel. C’est pour ne pas rendre cette étude trop volumineuse que nous avons choisi ces deux exemples, à la fois pour leur relative simplicité et leur représentativité. Par ailleurs, il est certain que l’examen de “philosophies religieuses” non chrétiennes manque à cette étude. Notre quasi-ignorance en la matière est la raison de cette absence.
14 Discours de métaphysique, 1, II. Éditions Vrin, p.26. C’est nous qui soulignons.
15 Genèse, 1, 9 –10. C’est nous qui soulignons.
16 A fortiori ne peut-elle pas être la thèse d’un philosophe rationaliste, qualificatif que l’on attribue souvent à Leibniz.
17 Et pour cause : nous croyons avoir montré plus haut qu’une telle justification est impossible ; au moins devrait-elle être tentée par Leibniz s’il entend se placer dans une perspective philosophique.
18 Spinoza, Traité des autorités théologique et politique, préface. NRF Gallimard, « La Pléiade », p.612
19 Selon Spinoza, au contraire, on pourrait dire que Dieu est l’auteur de la Bible seulement si elle dit vrai (ce qui reste donc à démontrer rationnellement), mais en donnant au mot “Dieu” un sens qui exclut toute révélation : toute la première partie de l’Éthique, intitulée “de Dieu”, est exempte de la moindre allusion biblique ou théologique.
20 Évangile selon Matthieu, chapitres 5 à 7.
21 Évangile selon Matthieu, 5, 27 – 28.
22 Interdiction formulée dans le septième des dix commandements (Exode, 20, 14).
23 Évangile selon Matthieu, 5, 17 : « N’allez pas croire que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. »
24 La religion dans les limites de la simple raison, IV, 1, 1. Éditions Vrin, p.179
25 Puisque dans les deux cas, de nombreux siècles se sont écoulés entre le texte et son interprétation : de la rédaction du Décalogue dans l’Exode à l’interprétation qu’en fait Jésus dans les Évangiles d’une part, de la rédaction des Évangiles à l’interprétation qu’en fait Kant d’autre part.
26 La religion dans les limites de la simple raison, op. cit., I, Remarque générale. p.92. C’est nous qui soulignons.
27 Cf. note 23.
28 … ou plus exactement entre le Judaïsme et l’enseignement de Jésus, car rien dans les paroles de ce dernier n’indique clairement qu’il voulait fonder une nouvelle religion, mais plutôt, comme on l’a dit (note 23), qu’il était venu pour « accomplir » le Judaïsme.
29 Par exemple : « Si le juste ici-bas reçoit son salaire, combien plus le méchant et le pécheur » (Proverbes, 11, 31 ; le terme « salaire » est ici sans ambiguïté). Bien d’autres versets, dans ce livre ou dans d’autres, sont tout aussi explicites.
30 Dans le livre de Job, Yahvé, par l’intermédiaire de Satan, “éprouve” la foi de Job, homme riche et pieux, en détruisant ses biens, en faisant tuer ses serviteurs et ses enfants, puis en le frappant de maladie. Job, conformément aux prédictions de Satan et contre celles de Yahvé, reproche à ce dernier son injustice. La “leçon” du livre, donnée par Yahvé lui-même, est que nul ne doit se permettre de juger son Dieu, et ce même s’il lui semble injuste. Cela dit, Job recouvre à la fin du récit tout ce qu’il a perdu : la morale de la rétribution est confirmée, bien que le propos “officiel” du livre la condamne.
31 Les théologiens appellent cela une « évolution » de la doctrine biblique, terme certes moins brutale que celui de « contradiction »…
32 Par exemple : « C’est qu’en effet le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de son Père, et alors, il rendra à chacun selon sa conduite » (Évangile selon Matthieu, 16, 27).
33 La religion dans les limites de la simple raison, op. cit., III, 1, 5. p.137
34 Il n’y a bien entendu nulle prétention à l’exhaustivité dans ces quelques remarques.
35 La religion dans les limites de la simple raison, op. cit., IV, 2, 2. p.188
36 Jean-Paul II, Fides et ratio, I, 7 ; op. cit., p.5
37 Ibid., I, 5 ; p.4. C’est nous qui soulignons.
38 Ibid., VII, 86 - 90 ; pp.31 - 32.
39 Catéchisme de l’Église Catholique, première partie, chapitre troisième, article I, 3, §156. Mame / Plon, p.44
40 Mais que faire alors de ce verset : « « Il surgira, en effet, des faux Christ et des faux prophètes, qui produiront de grands signes et des prodiges, au point d’abuser, s’il était possible, même les élus. » (Évangile selon Matthieu, 24, 24).
41 On peut ici se reporter aux deux remarques précédant l’analyse de la “philosophie religieuse” de Leibniz, en haut de la page 4.
42 Pascal, Pensées, fragment 267 de l’établissement de Brunschvicg (188 de Lafuma). Garnier-Flammarion, p.266. Concernant les Pensées en général, il est bien malaisé de dire s’il s’agit bien là d’un ouvrage philosophique au sens où nous l’avons expliqué plus haut. En fait, certains fragments le sont sans aucun doute, comme celui du pari (Brunschvicg : 233 ; Lafuma : 418). D’autres ne le sont manifestement pas, comme ceux sur les « preuves de Jésus-Christ » (Brunschvicg : 737 et suivants), qui ne s’adressent pas à la raison, mais bien à la foi éventuelle du lecteur.
43 Éthique, I, proposition 11. NRF Gallimard, « La Pléiade », pp.317 – 319.
44 Appendice de la première partie de l’Éthique et Traité des autorités théologique et politique, surtout les chapitres I à XII.
45 Marcel Conche, Orientation philosophique. I. “La souffrance des enfants comme mal absolu”. P.U.F. p.57
 Re: Religion et Philosophie
Re: Religion et Philosophie
«Peut-on croire à une religion quand on est philosophe?…
… Et, par extension, le vrai philosophe n’est-il pas forcément athée ? » Question de Philippe Barbon
Cette opposition automatique entre la religion et la philosophie repose probablement sur des idées préconçues au sujet de la religion comme de la philosophie. Croire n’est pas nécessairement synonyme de foi mystérieuse, absolue et indubitable. Philosopher ne renvoie pas nécessairement à une analyse exclusivement rationnelle du réel. On peut croire en Dieu « de manière philoso-phique », par exemple en sachant incorpo-rer dans sa croyance une part de ce doute qui, de Socrate à Descartes, signe l’attitude philosophique. Il y aurait même là, comme l’explique Gianni Vatimmo dans Après la Chrétienté (Calmann-Lévy, 2004), un garde-fou contre le fanatisme, l’intolérance de celui qui ne supporte pas le doute des autres parce qu’il ne supporte d’abord pas le doute en lui. On peut aussi, à l’inverse, philosopher « de manière religieuse », par exemple en croyant en certaines idées qu’il n’est pas possible de démontrer rationnellement. Ainsi trouve-t-on dans la philosophie de Kant trois idées (le moi, le monde, Dieu), paradoxalement appelées « idées de la raison », en lesquelles nous pouvons croire, auxquelles nous pouvons accorder du crédit malgré leur caractère hypothétique, et qui ont un usage régulateur positif sur notre effort pour connaître, pour agir, pour vivre. Bien sûr, Kant explique qu’il faut savoir toujours distinguer le savoir de la croyance, mais il propose néanmoins une philosophie dans laquelle on a besoin de (bien) croire pour (mieux) savoir. Il n’y a donc pas opposition entre religion et philosophie ; ce n’est donc pas « un progrès de ne plus croire ». Chez Hegel, de même, on trouve cette idée que la religion nous révèle ce que la philosophie nous démontrera ensuite (et que l’art d’ailleurs a commencé par nous montrer) : il n’y a donc pas non plus opposition du religieux et du philosophique, mais le même Esprit du monde s’exprimant sous des formes différentes.
La meilleure façon de vous répondre reste toutefois de faire référence à tous ces philosophes qui ont voulu démontrer rationnellement l’existence de Dieu : Leibniz, Descartes, Spinoza, saint Anselme, saint Thomas. On peut bien sûr critiquer cette démarche, objecter par exemple à Descartes qu’il croit démontrer Dieu alors qu’il l’a simplement d’abord postulé, parce qu’il est d’abord croyant, ou à Spinoza qu’il a tout simplement redéfini Dieu par la puissance de sa philosophie. Mais dans tous les cas on ne peut pas réduire la philosophie à l’athéisme. On commence à philosopher parce que le monde fait problème. C’est probablement pour cette même raison qu’il y a des religions. L’une comme l’autre prouvent que nous ne sommes pas des bêtes.
… Et, par extension, le vrai philosophe n’est-il pas forcément athée ? » Question de Philippe Barbon
Cette opposition automatique entre la religion et la philosophie repose probablement sur des idées préconçues au sujet de la religion comme de la philosophie. Croire n’est pas nécessairement synonyme de foi mystérieuse, absolue et indubitable. Philosopher ne renvoie pas nécessairement à une analyse exclusivement rationnelle du réel. On peut croire en Dieu « de manière philoso-phique », par exemple en sachant incorpo-rer dans sa croyance une part de ce doute qui, de Socrate à Descartes, signe l’attitude philosophique. Il y aurait même là, comme l’explique Gianni Vatimmo dans Après la Chrétienté (Calmann-Lévy, 2004), un garde-fou contre le fanatisme, l’intolérance de celui qui ne supporte pas le doute des autres parce qu’il ne supporte d’abord pas le doute en lui. On peut aussi, à l’inverse, philosopher « de manière religieuse », par exemple en croyant en certaines idées qu’il n’est pas possible de démontrer rationnellement. Ainsi trouve-t-on dans la philosophie de Kant trois idées (le moi, le monde, Dieu), paradoxalement appelées « idées de la raison », en lesquelles nous pouvons croire, auxquelles nous pouvons accorder du crédit malgré leur caractère hypothétique, et qui ont un usage régulateur positif sur notre effort pour connaître, pour agir, pour vivre. Bien sûr, Kant explique qu’il faut savoir toujours distinguer le savoir de la croyance, mais il propose néanmoins une philosophie dans laquelle on a besoin de (bien) croire pour (mieux) savoir. Il n’y a donc pas opposition entre religion et philosophie ; ce n’est donc pas « un progrès de ne plus croire ». Chez Hegel, de même, on trouve cette idée que la religion nous révèle ce que la philosophie nous démontrera ensuite (et que l’art d’ailleurs a commencé par nous montrer) : il n’y a donc pas non plus opposition du religieux et du philosophique, mais le même Esprit du monde s’exprimant sous des formes différentes.
La meilleure façon de vous répondre reste toutefois de faire référence à tous ces philosophes qui ont voulu démontrer rationnellement l’existence de Dieu : Leibniz, Descartes, Spinoza, saint Anselme, saint Thomas. On peut bien sûr critiquer cette démarche, objecter par exemple à Descartes qu’il croit démontrer Dieu alors qu’il l’a simplement d’abord postulé, parce qu’il est d’abord croyant, ou à Spinoza qu’il a tout simplement redéfini Dieu par la puissance de sa philosophie. Mais dans tous les cas on ne peut pas réduire la philosophie à l’athéisme. On commence à philosopher parce que le monde fait problème. C’est probablement pour cette même raison qu’il y a des religions. L’une comme l’autre prouvent que nous ne sommes pas des bêtes.
 Re: Religion et Philosophie
Re: Religion et Philosophie
La religion
La question de la religion, en philosophie, c'est avant tout la question de la vérité, et la question du rapport entre la croyance et la raison.
Voici quelques questions typiques que l'on peut se poser :
La science est-elle l'ennemie de la religion ?
Des conflits indéniables
Commençons donc par cette question. A priori, oui, il y a une guerre, parfois violente, entre science et religion. Que l'on songe par exemple à l'Inquisition, au philosophe italien Giordano Bruno qui a été brûlé sur le bûcher à Rome, en 1600, par les pouvoirs religieux, pour avoir dit que l'univers était infini. Ou encore à Galilée à qui l'Eglise a intenté un procès pour avoir défendu la doctrine de l'héliocentrisme (c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non la Terre qui est au centre du monde) découverte par Copernic quelques décennies plus tôt (en 1543). Galilée a dû se rétracter, de peur de subir le même sort que Bruno. Il a finalement été réhabilité par l'Eglise... en 1992 !
Mais ces conflits ne sont pas limités au Moyen Age : aujourd'hui des luttes intenses ont lieu, par exemple aux Etats-Unis entre créationnistes (qui pensent que Dieu a créé le monde et l'homme) et évolutionnistes (qui pensent que l'homme est le fruit d'une évolution naturelle et qu'il descend du singe, selon la théorie de Darwin).
A partir de cela, de nombreux philosophes ont pu critiquer la religion :
Ces conflits entre science et religion montrent aussi que le savoir est un système de pouvoir...
Bref, dans la mesure où science et religion prétendent toutes deux nous révéler la vérité sur le monde, elles sont nécessairement en position de rivalité. L'opposition est d'autant plus certaine que leurs méthodes ne sont pas les mêmes : la science procède par expérience et démonstration logique, alors que la religion se contente de la révélation divine matérialisée dans l'Ecriture...
Mais cette différence dans les approches et les méthodes est peut-être le moyen de (ré)concilier science et religion...
Une conciliation possible ?
Mais on peut tenter de concilier la science et la religion, la foi et la raison.
En effet, ces deux types de discours ont-ils le même but, la même fonction ?
Si on laisse de côté la prétention de la religion à dire la vérité sur le monde, on peut soutenir que non : la science ne nous dit jamais comment vivre, elle ne répond pas à la question « Que faire ? ». Elle est descriptive et non prescriptive, autrement dit elle n'est pas normative : elle ne nous dit pas ce qu'il faut faire. Elle ne dit pas comment devrait être le monde, elle se contente de dire comment il est. Bref, elle n'est pas éthique ni pratique, elle est théorique.
On trouve chez [ltr]Spinoza[/ltr] cette idée d'une dissociation radicale entre la foi et la raison : la seule fonction de la foi, explique-t-il, est de nous faire obéir. La Bible, par exemple, ne vise qu'à cet objectif unique : nous faire suivre la loi morale, c'est-à-dire nous faire aimer notre prochain. Autrement dit, les pouvoirs devraient laisser les scientifiques tranquilles, parce que les progrès scientifiques n'empêchent nullement d'obéir à la loi morale. (Le but de Spinoza est ici de défendre la liberté de pensée et d'expression du philosophe et du scientifique contre la persécution des autorités religieuses.)
Mais on peut critiquer cette dissociation radicale entre pratique et théorie : toute conception du monde induit des normes, et réciproquement toute éthique doit s'appuyer sur une certaine représentation de la réalité. Pas d'éthique sans ontologie, pas d'ontologie sans éthique. Ainsi la science, bien qu'elle s'en défende, est en quelque sorte indirectement normative : en nous expliquant comment fonctionne le monde elle nous dit comment faire pour être heureux.
Une autre manière de dire que religion et science ne s'opposent pas serait de montrer que même au plan théorique on peut les concilier. C'est la grande idée de Pascal et de Kant : notre raison est limitée, par conséquent il reste une place pour la foi. Sur toutes les questions auxquelles la science ne peut répondre, c'est-à-dire les questions métaphysiques, dont les dogmes religieux font partie, nous pouvons croire ce que bon nous semble, ce qui nous aidera le mieux à vivre ou ce qui nous élèvera, nous rendra meilleurs...
Deux types d'intuition
Voici maintenant une analyse un peu plus développée de ce dernier argument, avec une critique importante.
On entend parfois l'argument suivant : « Tous les plus grands philosophes ont reconnu que la raison scientifique a des limites, et qu'en réalité elle dépend entièrement de l'intuition. Par conséquent la conception religieuse du monde est tout aussi défendable que la conception matérialiste. »
C'est d'ailleurs l'argument de [ltr]Blaise Pascal[/ltr] : l'homme, pris entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, est toujours infiniment loin de la connaissance absolue ; de plus, notre raison est limitée car les premiers principes ne peuvent pas être démontrés. Par conséquent, il faut faire appel à ce que Pascal appelle le « cœur » :

267. – La dernière démarche de la raison est de reconnaître qu’il y a une infinité de choses qui la surpassent ; elle n’est que faible, si elle ne va jusqu’à reconnaître cela.
270. – Il est donc juste qu’elle se soumette, quand elle juge qu’elle doit se soumettre.
272. – Il n’y a rien de si conforme à la raison que ce désaveu de la raison.
274. – Tout notre raisonnement se réduit à céder au sentiment.
277. – Le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point ; on le sait en mille choses.
Blaise Pascal, Pensées
Et pourtant, il y a là une grave confusion. Certes, il est rigoureusement impossible de démontrer les principes qui sont au fondement de toute démonstration. Pour cette raison on peut parler d'une « intuition » qui se trouve au fondement de toute pensée et donc de toute science. Pascal disait ainsi que les premiers principes nous sont connus, non par la raison, mais par le « cœur », le sentiment. Et c'est là qu'il y a un glissement pernicieux : on passe subrepticement de l'intuition intellectuelle (qui consiste, comme disait Descartes, en la claire conception d'un esprit qui analyse sont objet) à l'intuition au sens de l'intuition féminine, du sentiment, du sixième sens ou que sais-je encore.
Soyons plus précis : l'intuition intellectuelle peut désigner au moins deux choses :
Il est très clair que ces deux concepts n'ont rien à voir avec les intuitions « féminines » ou « religieuses ». Et par conséquent c'est un véritable acte de terrorisme intellectuel que de glisser d'un concept à l'autre. Ce qui reste vrai, et que l'on peut concéder à Pascal et à Kant, c'est que dans les domaines où la raison et la science sont impuissantes à nous découvrir la vérité, nous pouvons fort bien décider de croire l'hypothèse qui nous plaît le plus, celle qui nous aide à vivre ou celle qui nous rend meilleurs. Mais en cherchant le Bien on risque de ne pas trouver le Vrai.
Et surtout, et c'est là le point essentiel, la compréhension rigoureuse du concept d'intuition nous montre qu'en réalité la raison n'est pas limitée : car elle inclut aussi bien l'intuition que la déduction. Il n'y a pas de différence radicale entre les questions physiques et les questions métaphysiques. Au mieux il y a une différence de degré. Toutes les questions théoriques sont du même ordre. De sorte que finalement, contrairement à un préjugé tenace, la science répond à la question de l'existence de Dieu (pour autant que cette question puisse être posée !) aussi bien qu'à n'importe quelle autre question, c'est-à-dire sans nous donner de certitude, mais en nous proposant une hypothèse plus ou moins solide (c'est-à-dire plus ou moins fondamentale dans l'édifice théorique, dans la conception du monde) qui s'insère dans une représentation cohérente des phénomènes. En l'occurrence, la science dirait volontiers, comme Laplace disait à Napoléon, que Dieu est une hypothèse dont nous pouvons nous passer. Une chose est donc sûre : cette hypothèse-là ne répond pas à un besoin théorique.
Peut-on ne croire en rien ?
Ici je ne donnerai qu'une ébauche de réflexion.
D'une part, il faut penser aux diverses formes de croyances, y compris les plus naturelles et habituelles qui nous permettent de vivre chaque jour. En ce sens on est obligé de croire en quelque chose, le sceptique (celui qui douterait de tout) n'existe pas. Supposons qu'il existe : jetez-lui un caillou à la figure ; s'il l'esquive, c'est qu'il croit que ce caillou existe, et qu'il risque de lui faire mal, etc. : ce n'est donc pas véritablement un sceptique. Et s'il ne l'évite pas, il n'y a plus de sceptique ! (Inutile de réaliser cette expérience, bien entendu : l'expérience de pensée nous suffira !)
Ici la difficulté sera de savoir si on à affaire à de véritables croyances ou à de simples habitudes ou comportements...
D'autre part, on peut s'interroger sur la nécessité des croyances religieuses qui nous aident à vivre, nous donnent espoir. Elles sont peut-être nécessaires pour certains d'entre nous (peut-être ceux qui ont été habitués à ces croyances par leur éducation). Mais pour d'autres, la confiance en soi et l'optimisme sont probablement suffisants. Reste à savoir si ce sont là des croyances ou de simples sentiments ou attitudes existentielles...
Une autre question à se poser est celle des rumeurs et [ltr]légendes urbaines[/ltr], ainsi que la question de la superstition : pourquoi toutes ces croyances irrationnelles, même à l'époque de la science ? Pourquoi ces sectes qui prédisent régulièrement la fin du monde, ou, plus généralement, le mythe du « bug de l'an 2000 » par exemple ? Il y a peut-être en l'homme un goût pour le mystère, l'occulte, le surnaturel, et les idées qui vont à l'encontre des opinions dominantes. Il y a aussi, évidemment, des idées qui nous plaisent, que ce soit l'idée de paradis ou les petites histoires visant à critiquer les Etats-Unis (si nous sommes anti-américains, ce que je ne nous souhaite pas !). Les philosophes, quant à eux, ont tendance à expliquer la supersition par la conjonction de la crainte et de la bêtise...
Conclusion
Cet embryon de cours reste très incomplet... Pour conclure provisoirement je tiens à souligner l'opposition fondamentale entre l'esprit religieux et l'esprit philosophique : ce sont véritablement des attitudes intellectuelles opposées. D'une part le doute absolu et rigoureux, d'autre part l'acte de foi. Aussi, même si philosophes et religieux se rejoignent parfois, c'est par des chemins sensiblement différents.
La seule manière de nuancer ce point de vue serait de montrer qu'il y a aussi, dans la philosophie et la science, une part de croyance, la croyance paradoxale en la raison, l'idée que le monde est compréhensible et expliquable. Voilà la foi du philosophe : il a la foi en la raison. On peut parler d'idéal régulateur, selon la formule de Kant, pour désigner ces présupposés qui sont comme à l'horizon de certains types de discours. Ainsi le philosophe doit supposer que la vérité existe (quelque part, à l'horizon) et qu'elle est accessible, même si nous ne l'avons pas encore atteinte, et même si nous ne l'atteindrons jamais. Sans cela la réflexion et la discussion philosophiques sont impossibles et n'ont pas de sens.
La question de la religion, en philosophie, c'est avant tout la question de la vérité, et la question du rapport entre la croyance et la raison.
Voici quelques questions typiques que l'on peut se poser :
- La science est-elle l'ennemie de la religion ? La foi s'oppose-t-elle à la raison ?
- D'où vient la force des religions ? Pourquoi le progrès scientifique n'a-t-il pas fait disparaître les religions ? Ici on peut aussi s'interroger sur les mythes et illusions contemporaines : rumeurs, superstitions, [ltr]légendes urbaines[/ltr], etc.
- Peut-on ne croire en rien ? Faut-il tout soumettre à la raison ?
La science est-elle l'ennemie de la religion ?
Des conflits indéniables
Commençons donc par cette question. A priori, oui, il y a une guerre, parfois violente, entre science et religion. Que l'on songe par exemple à l'Inquisition, au philosophe italien Giordano Bruno qui a été brûlé sur le bûcher à Rome, en 1600, par les pouvoirs religieux, pour avoir dit que l'univers était infini. Ou encore à Galilée à qui l'Eglise a intenté un procès pour avoir défendu la doctrine de l'héliocentrisme (c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non la Terre qui est au centre du monde) découverte par Copernic quelques décennies plus tôt (en 1543). Galilée a dû se rétracter, de peur de subir le même sort que Bruno. Il a finalement été réhabilité par l'Eglise... en 1992 !
Mais ces conflits ne sont pas limités au Moyen Age : aujourd'hui des luttes intenses ont lieu, par exemple aux Etats-Unis entre créationnistes (qui pensent que Dieu a créé le monde et l'homme) et évolutionnistes (qui pensent que l'homme est le fruit d'une évolution naturelle et qu'il descend du singe, selon la théorie de Darwin).
A partir de cela, de nombreux philosophes ont pu critiquer la religion :
- Karl Marx considère que la religion est « l'opium du peuple », c'est-à-dire comme une drogue qui lui fait oublier ses soucis et le soulage, mais ne l'aide pas à résoudre ses problèmes (son exploitation économique), et bien au contraire l'affaiblit et le pousse à se soumettre (elle justifie le travail comme expiation du péché originel ; elle justifie la hiérarchie sociale, la monarchie de droit divin, et prône la soumission en général : « Rendez à César ce qui est à César »).
- Friedrich Nietzsche voit dans la religion (chrétienne notamment) la négation de la vie : car cette religion, dans le droit fil de l'idéalisme platonicien, renie le corps et réprime tous les désirs et plaisirs charnels, qu'elle considère comme des « péchés » : gourmandise, sexualité, etc.
- Sigmund Freud, fondateur de la psychanalyse, considère que la religion est une névrose, une forme de paranoïa : elle consiste à déformer les aspects insupportables du monde (solitude de l'homme, mort certaine, etc.) pour rendre celui-ci supportable. La religion serait une manière de réaliser nos désirs d'enfants. Dieu serait un père imaginaire et idéalisé pour consoler l'homme de sa solitude. Bref, la religion serait une illusion, au sens strict de Freud : c'est-à-dire non pas une erreur (l'illusion n'est pas nécessairement fausse), mais une croyance qui procède d'un désir : on ne croit pas en Dieu parce que cela semble vrai, on y croit parce qu'on aimerait qu'il existe...
- Enfin, Bertrand Russell, philosophe et logicien anglais du XXe siècle, a donné une critique décisive de la religion en soulignant son opposition à la science, le mal qu'elle fait à la vérité et aux hommes : on ne compte évidemment plus le nombre de guerres menées au nom de la religion.
- Pour ajouter un philosophe contemporain à cette liste, on pourrait mentionner Michel Onfray, qui poursuit cette tradition philosophique d'une critique radicale de la religion.
Ces conflits entre science et religion montrent aussi que le savoir est un système de pouvoir...
Bref, dans la mesure où science et religion prétendent toutes deux nous révéler la vérité sur le monde, elles sont nécessairement en position de rivalité. L'opposition est d'autant plus certaine que leurs méthodes ne sont pas les mêmes : la science procède par expérience et démonstration logique, alors que la religion se contente de la révélation divine matérialisée dans l'Ecriture...
Mais cette différence dans les approches et les méthodes est peut-être le moyen de (ré)concilier science et religion...
Une conciliation possible ?
Mais on peut tenter de concilier la science et la religion, la foi et la raison.
En effet, ces deux types de discours ont-ils le même but, la même fonction ?
Si on laisse de côté la prétention de la religion à dire la vérité sur le monde, on peut soutenir que non : la science ne nous dit jamais comment vivre, elle ne répond pas à la question « Que faire ? ». Elle est descriptive et non prescriptive, autrement dit elle n'est pas normative : elle ne nous dit pas ce qu'il faut faire. Elle ne dit pas comment devrait être le monde, elle se contente de dire comment il est. Bref, elle n'est pas éthique ni pratique, elle est théorique.
On trouve chez [ltr]Spinoza[/ltr] cette idée d'une dissociation radicale entre la foi et la raison : la seule fonction de la foi, explique-t-il, est de nous faire obéir. La Bible, par exemple, ne vise qu'à cet objectif unique : nous faire suivre la loi morale, c'est-à-dire nous faire aimer notre prochain. Autrement dit, les pouvoirs devraient laisser les scientifiques tranquilles, parce que les progrès scientifiques n'empêchent nullement d'obéir à la loi morale. (Le but de Spinoza est ici de défendre la liberté de pensée et d'expression du philosophe et du scientifique contre la persécution des autorités religieuses.)
Mais on peut critiquer cette dissociation radicale entre pratique et théorie : toute conception du monde induit des normes, et réciproquement toute éthique doit s'appuyer sur une certaine représentation de la réalité. Pas d'éthique sans ontologie, pas d'ontologie sans éthique. Ainsi la science, bien qu'elle s'en défende, est en quelque sorte indirectement normative : en nous expliquant comment fonctionne le monde elle nous dit comment faire pour être heureux.
Une autre manière de dire que religion et science ne s'opposent pas serait de montrer que même au plan théorique on peut les concilier. C'est la grande idée de Pascal et de Kant : notre raison est limitée, par conséquent il reste une place pour la foi. Sur toutes les questions auxquelles la science ne peut répondre, c'est-à-dire les questions métaphysiques, dont les dogmes religieux font partie, nous pouvons croire ce que bon nous semble, ce qui nous aidera le mieux à vivre ou ce qui nous élèvera, nous rendra meilleurs...
Deux types d'intuition
Voici maintenant une analyse un peu plus développée de ce dernier argument, avec une critique importante.
On entend parfois l'argument suivant : « Tous les plus grands philosophes ont reconnu que la raison scientifique a des limites, et qu'en réalité elle dépend entièrement de l'intuition. Par conséquent la conception religieuse du monde est tout aussi défendable que la conception matérialiste. »
C'est d'ailleurs l'argument de [ltr]Blaise Pascal[/ltr] : l'homme, pris entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, est toujours infiniment loin de la connaissance absolue ; de plus, notre raison est limitée car les premiers principes ne peuvent pas être démontrés. Par conséquent, il faut faire appel à ce que Pascal appelle le « cœur » :

267. – La dernière démarche de la raison est de reconnaître qu’il y a une infinité de choses qui la surpassent ; elle n’est que faible, si elle ne va jusqu’à reconnaître cela.
270. – Il est donc juste qu’elle se soumette, quand elle juge qu’elle doit se soumettre.
272. – Il n’y a rien de si conforme à la raison que ce désaveu de la raison.
274. – Tout notre raisonnement se réduit à céder au sentiment.
277. – Le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point ; on le sait en mille choses.
Blaise Pascal, Pensées
Et pourtant, il y a là une grave confusion. Certes, il est rigoureusement impossible de démontrer les principes qui sont au fondement de toute démonstration. Pour cette raison on peut parler d'une « intuition » qui se trouve au fondement de toute pensée et donc de toute science. Pascal disait ainsi que les premiers principes nous sont connus, non par la raison, mais par le « cœur », le sentiment. Et c'est là qu'il y a un glissement pernicieux : on passe subrepticement de l'intuition intellectuelle (qui consiste, comme disait Descartes, en la claire conception d'un esprit qui analyse sont objet) à l'intuition au sens de l'intuition féminine, du sentiment, du sixième sens ou que sais-je encore.
Soyons plus précis : l'intuition intellectuelle peut désigner au moins deux choses :
- L'intuition logique : il s'agit de notre compréhension intuitive des principes logiques, du type « A = A » ou « on ne peut pas dire une chose et son contraire ». Ce sont ces principes (ici le principe d'identité et le principe de contradiction) qui sont au fondement de toute démonstration, et sont par conséquent indémontrables.
- L'intuition empirique : il s'agit tout simplement de la perception, ou d'un concept qui en résulte comme celui de l'espace ou du temps. Ainsi les axiomes de la géométrie sont connus par intuition.
Il est très clair que ces deux concepts n'ont rien à voir avec les intuitions « féminines » ou « religieuses ». Et par conséquent c'est un véritable acte de terrorisme intellectuel que de glisser d'un concept à l'autre. Ce qui reste vrai, et que l'on peut concéder à Pascal et à Kant, c'est que dans les domaines où la raison et la science sont impuissantes à nous découvrir la vérité, nous pouvons fort bien décider de croire l'hypothèse qui nous plaît le plus, celle qui nous aide à vivre ou celle qui nous rend meilleurs. Mais en cherchant le Bien on risque de ne pas trouver le Vrai.
Et surtout, et c'est là le point essentiel, la compréhension rigoureuse du concept d'intuition nous montre qu'en réalité la raison n'est pas limitée : car elle inclut aussi bien l'intuition que la déduction. Il n'y a pas de différence radicale entre les questions physiques et les questions métaphysiques. Au mieux il y a une différence de degré. Toutes les questions théoriques sont du même ordre. De sorte que finalement, contrairement à un préjugé tenace, la science répond à la question de l'existence de Dieu (pour autant que cette question puisse être posée !) aussi bien qu'à n'importe quelle autre question, c'est-à-dire sans nous donner de certitude, mais en nous proposant une hypothèse plus ou moins solide (c'est-à-dire plus ou moins fondamentale dans l'édifice théorique, dans la conception du monde) qui s'insère dans une représentation cohérente des phénomènes. En l'occurrence, la science dirait volontiers, comme Laplace disait à Napoléon, que Dieu est une hypothèse dont nous pouvons nous passer. Une chose est donc sûre : cette hypothèse-là ne répond pas à un besoin théorique.
Peut-on ne croire en rien ?
Ici je ne donnerai qu'une ébauche de réflexion.
D'une part, il faut penser aux diverses formes de croyances, y compris les plus naturelles et habituelles qui nous permettent de vivre chaque jour. En ce sens on est obligé de croire en quelque chose, le sceptique (celui qui douterait de tout) n'existe pas. Supposons qu'il existe : jetez-lui un caillou à la figure ; s'il l'esquive, c'est qu'il croit que ce caillou existe, et qu'il risque de lui faire mal, etc. : ce n'est donc pas véritablement un sceptique. Et s'il ne l'évite pas, il n'y a plus de sceptique ! (Inutile de réaliser cette expérience, bien entendu : l'expérience de pensée nous suffira !)
Ici la difficulté sera de savoir si on à affaire à de véritables croyances ou à de simples habitudes ou comportements...
D'autre part, on peut s'interroger sur la nécessité des croyances religieuses qui nous aident à vivre, nous donnent espoir. Elles sont peut-être nécessaires pour certains d'entre nous (peut-être ceux qui ont été habitués à ces croyances par leur éducation). Mais pour d'autres, la confiance en soi et l'optimisme sont probablement suffisants. Reste à savoir si ce sont là des croyances ou de simples sentiments ou attitudes existentielles...
Une autre question à se poser est celle des rumeurs et [ltr]légendes urbaines[/ltr], ainsi que la question de la superstition : pourquoi toutes ces croyances irrationnelles, même à l'époque de la science ? Pourquoi ces sectes qui prédisent régulièrement la fin du monde, ou, plus généralement, le mythe du « bug de l'an 2000 » par exemple ? Il y a peut-être en l'homme un goût pour le mystère, l'occulte, le surnaturel, et les idées qui vont à l'encontre des opinions dominantes. Il y a aussi, évidemment, des idées qui nous plaisent, que ce soit l'idée de paradis ou les petites histoires visant à critiquer les Etats-Unis (si nous sommes anti-américains, ce que je ne nous souhaite pas !). Les philosophes, quant à eux, ont tendance à expliquer la supersition par la conjonction de la crainte et de la bêtise...
Conclusion
Cet embryon de cours reste très incomplet... Pour conclure provisoirement je tiens à souligner l'opposition fondamentale entre l'esprit religieux et l'esprit philosophique : ce sont véritablement des attitudes intellectuelles opposées. D'une part le doute absolu et rigoureux, d'autre part l'acte de foi. Aussi, même si philosophes et religieux se rejoignent parfois, c'est par des chemins sensiblement différents.
La seule manière de nuancer ce point de vue serait de montrer qu'il y a aussi, dans la philosophie et la science, une part de croyance, la croyance paradoxale en la raison, l'idée que le monde est compréhensible et expliquable. Voilà la foi du philosophe : il a la foi en la raison. On peut parler d'idéal régulateur, selon la formule de Kant, pour désigner ces présupposés qui sont comme à l'horizon de certains types de discours. Ainsi le philosophe doit supposer que la vérité existe (quelque part, à l'horizon) et qu'elle est accessible, même si nous ne l'avons pas encore atteinte, et même si nous ne l'atteindrons jamais. Sans cela la réflexion et la discussion philosophiques sont impossibles et n'ont pas de sens.
 Re: Religion et Philosophie
Re: Religion et Philosophie
La religion et la philosophie
les preuves de l’existence de Dieu établies par les philosophes !
par [ltr]Lydia COESSENS[/ltr]

LA RELIGION
I. L’apparition du problème religieux en philosophie
A. On partira de l’opposition entre religion et philosophie
Par religion on entend un ensemble de pratiques et de croyances fondées sur une révélation qui est crue et acceptée sans discussion.
Par philosophie on entend l’exercice de la raison par un sujet qui doute et n’accepte rien sans un minutieux examen[size]. [/size]
Opposition immédiate foi / raison.
On peut remarquer que la philosophie, dès sa naissance en Occident, a eu partie liée avec la science et avec l’exercice de la démonstration. Ces 2 définitions vont nous permettre de comprendre l’opposition entre philosophie et religion. En effet, le sujet de la science et de la philosophie, le cogito cartésien par exemple, exclut le sujet de l’expérience mystique. Il interdit le rapport mystique au monde. Plus tard la philosophie critique de Kant va interdire l’attitude exégétique et renvoyer la croyance à l’illusion. Cette division polémique a été nécessaire jusqu’au milieu du XIXème siècle ; elle est cependant actuellement interrogée par les philosophes, par les scientifiques depuis le milieu du XIXème environ. C’est pourquoi depuis cette époque la religion est devenue l’objet d’une science des religions et dans la philosophie elle va à présent désigner non plus l’ancienne théologie rationnelle mais un authentique savoir considéré comme un savoir d’un autre type que la raison.
B. Quelques remarques historiques
1. Pourquoi le problème ne fut pas, pendant longtemps, un problème philosophique ?
Dans la philo occidentale, jusqu’à Kant, la philosophie ne questionne pas véritablement la religion. On soumet en effet la science et la philosophie à la lumière divine, on exhibe sans problème les preuves de l’existence de Dieu et on va même identifier Dieu au Souverain Bien ou encore à la cause première. Dieu est présent au coeur des objets de savoir, il est le foyer de tous les réseaux de savoir. Il rend donc impossible pendant très longtemps le recul critique de l’esprit philosophique pour lequel le fait religieux sera un problème. Dieu s’impose donc à la philosophie comme un objet privilégié : le cogito doit être fondé sur Dieu ; on parle donc de Dieu, c’est-à-dire à partir de Dieu et afin de revenir à Dieu. En somme la religion n’est pas problématique car finalement la révélation religieuse et la philosophie parlent du même réel.
Les grands problèmes qu’abordent la philosophie seront de 2 natures :
a. Le problème de la nature divine : Ce problème recouvre 2 grands courants. Le premier déclare que Dieu est immanent et l’autre que Dieu est transcendant. Cette question semble déjà posée par la philosophie stoïcienne. Dans le stoïcisme il y a 3 grandes parties : logique, physique, morale. C’est dans la physique stoïcienne que l’on trouvera leur conception de Dieu et du monde. Pour les Stoïciens “Dieu est un vivant immortel, raisonnable, parfait, intelligent, bienheureux, ignorant tout mal, faisant régner sa providence sur le monde et tout ce qui s’y trouve ; il n’a pas de forme humaine. Il est l’architecte de tout et comme le père, et à cette partie de la divinité qui pénètre toute chose on donne communément différents noms suivant ses différents effets. On l’appelle Dia (= à travers de) parce qu’il est ce par quoi tout est fait, ou on l’appelle Zeus (-> zein = vivre) parce qu’il est la cause de la vie ou parce qu’il est intimement mêlé à tout ce qui vit “ Pour les Stoïciens Dieu ne fait qu’un avec le monde, c’est-à-dire la réalité dans ses différentes formes mais il est en même temps, principe directeur, architecte. En somme il est le même que le monde et en même temps autre que lui : Dieu est un fluide qui se répand dans la totalité du monde. A partir de cette thèse on verra s’affirmer 2 grands courants philosophiques : transcendance ou immanence de Dieu.
- Affirmation de la transcendance de Dieu :
Ce courant est développé dans la théologie et la philosophie chrétienne. Ainsi Leibniz conçoit l’univers constitué de monades et insiste sur l’unité individuelle. L’univers est réglé par la monade de toutes les monades, la monade dominante, c’est-à-dire Dieu. Il explique que Dieu est à la fois le créateur des existences mais aussi le créateur des vérités éternelles, des essences. Au niveau de l’existence il expliquera que Dieu est non seulement créateur des existences au niveau matériel et physique, mais aussi le créateur des existences au niveau de l’univers spirituel. Leibniz est le premier à concevoir Dieu comme le monarque de la République des esprits .
On peut remarquer aussi que dans la philosophie et notamment dans le christianisme, cette transcendance peut être aussi celle de la personne. Dieu est alors posé comme la valeur, l’idéal vers lequel tend et doit tendre le monde des esprits. Mais dans le christianisme cette transcendance peut être si radicale qu’on ne peut plus parler de Dieu. On trouve cette tendance chez Pascal : on ne peut plus parler de Dieu, il ne peut être objet de connaissance ni même de preuve. L’accès à Dieu par le biais de la connaissance et de la raison semble être barré, par contre il est possible par voie symbolique, de manière indirecte : la foi. On retrouve ce thème chez Kierkegaard : Dieu est l’Autre radical, absolu qu’on ne peut pas concevoir, mais avec lequel néanmoins on entre en relation intense . On voit ici apparaître la théologie négative qui consiste à dire qu’on ne peut pas dire ce qu’est Dieu, mais ce qu’il n’est pas.
- Affirmation de son immanence :
Spinoza explique que le grand péché du christianisme est l’anthropomorphisme. Ceci consiste à concevoir Dieu à l’image de l’homme. Le christianisme oublie les enseignements du judaïsme : il ne faut pas concevoir Dieu comme une personne transcendante. Pour éviter cette erreur des Chrétiens, Spinoza va affirmer, dans le livre I de l’Éthique consacré à Dieu, qu’il n’y a qu’une seule substance et cette substance est infinie, elle possède une infinité d’attributs : “Dieu, c’est-à-dire une substance constituée par une infinité d’attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie, existe nécessairement” .
Spinoza explique que cette substance infinie est la nature. Il importe cependant de ne pas faire de contre-sens sur le mot ‘nature’. La nature est à la fois la nature naturée (natura naturata) et la nature naturante (natura naturans). Dieu est la nature naturée, la nature produite, qui a été produite : on entendra la nature physique. C’est aussi la nature naturante, la nature productrice. Pour préciser ces analyses, il faut analyser le concept de nécessité : Spinoza explique qu’il y a 2 sortes de nécessité : la nécessité mécanique qui engendre l’ordre de succession des choses (necessitas coacta -> contraignante). un phénomène vient nécessairement par une cause nécessaire : c’est une causalité transitive car un effet est lié à sa cause et ne peut lui échapper. La seconde nécessité est la nécessité géométrique qui produit et engendre des conséquences. Ici la causalité n’est pas transitive mais immanente : cela signifie que la conséquence est interne au principe lui-même. Cette nécessité produit ses conséquences sans sortir d’elle-même, c’est pourquoi Spinoza peut dire que Dieu n’est pas le créateur du monde car on le concevrait alors comme une causalité transitive ; Dieu est bien plutôt la cause immanente de toute chose : “Dieu est cause immanente mais non transitive de toute chose” .
La conséquence de toutes ces affirmations c’est que, pour Spinoza, nous sommes un mode de Dieu. Tout est en Dieu. Il n’y a à ses yeux qu’une seule et unique substance, la divinité. Il n’y a pas de création donc pas de transcendance divine ; il n’y a qu’une production divine. Dieu n’est donc pas extérieur au monde, Dieu c’est la raison : “Deus sive natura sive ratio” (Dieu ou la nature ou la raison). Il n’y a pas de mystère, tout est parfaitement rationnel : il suffit d’ouvrir l’Ancien Testament. La philosophie hégélienne et notamment la formule selon laquelle ‘le réel est rationnel’ seront inspirées de Spinoza. La vertu essentielle c’est l’intelligence, il faut comprendre ce qui est, or ce qui est, c’est Dieu.
b. A côté de ce débat, la seconde préoccupation des philosophes a été celle de l’existence et des preuves de l’existence de Dieu :
On retiendra d’abord la thèse d’Aristote à propos du Théos puis l’on exposera les preuves que donnent à la suite d’Aristote, Saint Thomas et Descartes.
Le point de départ des démonstrations de l’existence peut déjà se trouver chez Aristote. Dans son analyse du réel, Aristote fait prévaloir la substance au milieu des catégories et au milieu du mouvement. Or il explique qu’il y a des substances qui ne connaissent absolument aucun mouvement, qui coïncident avec l’acte pur. Ces substances sont séparées et immobiles ; il y a donc pour lui une classe d’être qui mérite par excellence le titre d’être parce qu’ils sont au sens plein et premier du terme, ils sont immobiles. Aristote oppose donc l’acte au mouvement et pense à des actes parfaits qui ne sont plus le résultat d’un processus mais sont confondus avec l’acte lui-même. Ces actes ne sont plus transitifs mais jouissance dans l’exercice lui-même. L’acte parfait est celui qui a sa fin en lui-même ;à côté de l’acte qui devient (passage de la puissance à l’acte) il y a l’acte par excellence qui se présente achevé à chacun de ses moments, c’est l’Acte immanent et immobile qu’Aristote place au sommet de l’univers . L’acte par excellence c’est Dieu. Le mouvement circulaire est de ce point de vue l’expression la plus adéquate de la perfection puisque ce mouvement ne tend nulle part au sens d’un but et n’est pas un effort vers la perfection, il est la finalité immanente. Cette activité d’immobilité est celle de Dieu et celle aussi de la pensée de la pensée . Nous atteignons ici le terme de toute recherche sur l’être en même temps que la source de l’être, car nous sommes en présence de l’être immobile, éternel, incorruptible : le Théos. Selon Aristote, l’univers est gouverné par un premier moteur immobile qui est forme pure, réalité souveraine. Il ne peut y en avoir qu’un seul, autrement il y aurait plusieurs cieux.
Les preuves de l’existence de Dieu vont être développées par la théologie chrétienne qui s’appuiera parfois sur Platon (Saint Augustin), parfois sur Aristote (Saint Thomas). Cependant elles modifient totalement la nature de l’argumentation. Le problème que se posent les théologiens et philosophes est celui de la raison d’être du monde : comment se fait-il que ce monde-là existe ?
Il s’agit d’expliquer la causalité efficiente, d’expliquer pourquoi, comment le monde a été créé. Ce type de problèmes n’avait jamais été posé par les Grecs. C’est le christianisme, le judaïsme qui se demandent quelle est l’origine de l’existence en montrant que Dieu est la cause du monde.
On examinera les preuves que donne Saint Thomas : il nous en propose plusieurs, la preuve par le mouvement, la preuve par la causalité efficiente, la preuve par les causes finales. Ces preuves sont très influencées par Aristote.
- La preuve par le mouvement :
Saint Thomas explique qu’il est certain qu’il y a du mouvement dans le monde or ce qui se meut est mu par quelque chose. Mouvoir quelque chose c’est le faire passer de la puissance à l’acte or une chose ne peut être amenée à l’acte que par un être en acte. Ainsi le chaud en acte va rendre chaud en acte le bois qui n’était chaud qu’en puissance et en le faisant brûler il le meut. Il est impossible qu’une chose soit sous le même rapport et en même temps en puissance et en acte. Impossible qu’une chose soit motrice et mue. Donc tout ce qui se meut est mu par autre chose... On peut remonter à l’infini. Il est cependant nécessaire de s’arrêter. S’il n’y avait pas en effet de premier moteur on ne pourrait même pas parler de moteur puisqu’un second moteur ne se meut que parce qu’un premier moteur le meut. Il est donc nécessaire pour expliquer le mouvement de remonter à un premier moteur que rien ne meut et qui se nomme Dieu. Dieu est un existant qui est lui-même en acte. Cet existant en acte ne ressemble pas à l’acte pur d’Aristote ; Dieu c’est l’Esse (l’Être) : Dieu est l’acte pur d’exister du ‘je suis celui qui est’ de l’Exode.
- La preuve par la causalité efficiente :
Saint Thomas part de la considération des choses sensibles. Il constate que dans les choses sensibles il y a un ordre de causalité efficiente mais on ne peut y rencontrer un être qui soit cause de lui-même. Or il est impossible de remonter à l’infini dans la série des causes efficientes ; il est donc nécessaire de poser une cause efficiente première, c’est-à-dire Dieu. Dieu est la cause de la totalité de toutes les séries causales parce qu’il est cause de soi. En somme la première preuve nous fait atteindre Dieu comme cause du mouvement et de tous les mouvements qui en dépendent ; la deuxième nous le fait atteindre comme cause de l’existence de ce monde lui-même et c’est pourquoi l’on peut dire qu’il est à la fois premier moteur et première cause.
- La preuve par les causes finales :
“Il est impossible que les choses contraires et disparates viennent s’accorder et se concilier dans un même ordre... s’il n’existe un être qui les gouverne et qui fasse que toutes ensembles, elles tendent vers une fin déterminée. Or nous constatons que dans le monde, des choses de nature diverse se concilient dans un même ordre. Non point de temps à autre et par hasard, mais toujours ou la plupart du temps. Il doit donc exister un être par la Providence duquel le monde soit gouverné et c’est lui que nous appelons Dieu” . Ici nous avons la dernière preuve, la preuve par la finalité.
Par la suite se développeront d’autres types de preuves. Ainsi Descartes ne retiendra pas la preuve par le mouvement et Spinoza critiquera vivement la démonstration par les causes finales. Descartes va donc utiliser d’autres arguments : l’argument par la causalité de l’idée, l’argument par la contingence du moi, l’argument ontologique élaboré par Saint Anselme au XIème siècle, mais écarté par Saint Thomas.
Les 2 premiers arguments se trouvent dans la 3è Méditation des Méditations métaphysiques : Dieu n’est présent à l’esprit que sous la forme d’une idée dont on va montrer la réalité objective. A la différence de toutes les autres idées, Dieu est une réalité qui ne peut avoir été produite par l’esprit humain. Par conséquent, si elle n’est pas produite par moi elle ne peut avoir été mise en moi que par un être qui possède toutes les perfections que cette idée représente. Descartes va distinguer dans les idées 2 aspects : on peut envisager les idées sous l’angle de leur réalité matérielle, mais aussi sous l’angle de leur réalité formelle. Dans le premier cas, rien ne les distingue entre elles ; ce sont toutes des pensées découpées dans le même tissu, dans la même étoffe mentale. Dans le second cas elles sont très différentes, car l’on considère la réalité représentative de ces idées. Elles sont alors toutes différentes : d’une part par les objets qu’elles représentent mais elles sont aussi différentes par le type d’être qu’elles sont amenées à représenter. C’est alors qu’il explique que l’idée de substance “a plus de degrés d’être ou de perfection que les idées qui me représentent seulement des modes ou des accidents” . S’il est possible à Descartes de hiérarchiser les idées à partir de leur réalité objective , c’est-à-dire à partir de leur perfection, on peut donc maintenant envisager l’idée d’une substance infinie qui possède toutes les propriétés, c’est-à-dire la plus grande perfection. Descartes introduit à côté de la relation horizontale des idées, une relation verticale et hiérarchique entre les idées et les réalités qu’elles représentent. De ce point de vue apparaissent des inégalités dont l’esprit ne peut rendre compte par ses propres moyens ; notamment quand il s’agit de l’idée de Dieu qui “a certainement en soi plus de réalité objective...c’est-à-dire de perfection”. L’argument qui consiste à extraire de la seule idée de Dieu son existence nécessaire dépend donc de la valeur objective de cette idée et de la liaison conceptuelle entre perfection et réalité objective. L’idée que j’ai d’un être plus parfait que le mien doit nécessairement avoir été mise en moi par un être qui soit en effet plus parfait. L’argumentation de Descartes repose ici sur l’impossibilité de transférer des perfections dont la conscience voit qu’elles lui manquent, à un être imaginaire qu’elle composerait fictivement par addition indéfinie des perfections que la conscience trouverait en elle. Au contraire l’imperfection présuppose la perfection toute positive : je n’aurais pas la conscience de ce que les choses ne sont pas, de ce qui leur fait défaut si je n’avais préalablement l’idée d’une réalité qui est pleinement, parfaite, positive. A cette preuve par l’infiniment parfait, Descartes va ajouter une seconde qu’on peut appeler preuve par la contingence de l’existence puisqu’elle s’appuie sur la contingence du moi pensant.
Avec cette preuve je m’aperçois comme fini, comme être contingent (j’aurais pu ne pas être), donc différent de l’infini et du nécessaire. Je ne tiens donc pas mon existence de moi-même car dans ce cas je me serais donné toutes les perfections. “Il me reste à examiner de quelle façon j’ai acquis cette idée... elle n’est pas une pure production ou fiction de mon esprit ; .. par conséquent il ne reste plus autre chose à dire, sinon que, comme l’idée de moi-même, elle est née et produite avec moi-même dès lors que j’ai été créé. Et certes on ne doit pas trouver étrange que Dieu en me créant ait mis en moi cette idée, pour être comme la marque de l’ouvrier empreinte sur son ouvrage”. On voit ici que moi qui suis imparfait et qui ai l’idée de la perfection en moi néanmoins, je n’ai pu la recevoir que d’un être parfait qui me dépasse, que d’un auteur de mon être.
La dernière preuve est la preuve ontologique (Vè Méditation) : elle avait été développée par Saint Anselme. Dans le Proslogion, il part de l’idée de “l’être tel qu’on ne peut pas en concevoir de plus grand”. Cet être ne peut pas n’exister que conceptuellement car exister en réalité c’est être plus grand qu’exister seulement dans l’intelligence. Ainsi cet être existe et dans l’intelligence puisque je le conçois et dans la réalité. Ce que Saint Anselme appelle Dieu c’est l’être absolu qui réclame immédiatement la position de son existence par la pensée qui le conçoit. Descartes développera le même type de preuve puisqu’il écrit “j’ai en moi l’idée d’un être souverainement parfait, idée aussi claire et distincte que l’idée du triangle. De même que je peux déduire de l’idée du triangle que la somme de ses angles est égale à deux droits, de même de l’idée de l’être parfait je puis conclure que cet être existe”.
2. Le problème religieux
:
Il va apparaître dans la philosophie kantienne.
Kant, dans la Critique de la raison pure, met fin à un certain type de discours sur Dieu et notamment à toutes les preuves ontologiques de l’existence de Dieu. On remarque d’ailleurs que c’est à partir de Kant que se développeront les grandes critiques philosophiques de la religion.
C’est la philo kantienne qui interroge de manière décisive la démarche suivie par la philo et par la métaphysique. Pour interroger cette démarche, Kant s’appuie sur l’analyse de la démonstration de l’existence de Dieu. Ambiguïté de la notion de perfection -> n’a-t-elle pas un sens essentiellement pratique et relatif, existentiel ? Dans la Critique de la raison pure, il montre que l’existence n’est pas un prédicat ; mais est un problème de la connaissance qui n’est résolu qu’en référence au postulat de la pensée empirique, ie en relation au contexte de l’expérience. Il faut interdire à la raison les déterminations métaphysiques de l’existence de Dieu et il faut la limiter à la seule connaissance scientifique qui nous met en rapport avec l’expérience. Il nous est interdit de connaître Dieu, mais il nous est possible d’y penser, ie d’en avoir une idée qui relève à présent de la croyance ou de la foi. La théologie rationnelle est ruinée ; Dieu n’est plus l’objet d’un acte de connaissance : “Je dus donc abolir le savoir pour laisser une place à la foi” dit Kant.
Il s’agit dès lors de restaurer une croyance dans son usage pratique ou moral. Dieu devient une Idée de la raison.
Religion comme problème :
- Hegel :
Dieu peut enfin être connu comme sujet : si Dieu se rend visible et manifeste dans le discours religieux, le vrai sujet de la religion c’est Dieu. Il n’est pas d’autre Dieu que celui qui apparaît dans le discours. Dieu se manifeste dans la culture et dans l’histoire sous la forme de l’Esprit.
- Nietzsche
ne verra dans la religion que la forme d’un monde où s’exprime la volonté de puissance. Renoncement, mauvaise conscience et ressentiment sont les signes de la religion. La religion veut que nous renoncions à la vie.
II. La religion comme objet de savoir
:
A. Pour que la religion entre dans l’histoire profane, il faut donc qu’on ne la confonde pas avec d’autres savoirs, notamment avec les savoirs scientifiques et philosophiques.
Pratique du comparatisme -> pratique de la critique historique.
B. Les résultats du comparatisme
Grand comparatiste Max Müller (1823-1900) : va s’attacher à lire les mythes de l’humanité selon la science du langage : l’homme au début de son histoire a un seul parler. Il prononce les mots dans lesquels s’expriment directement une part de la substance des objets perçus ; dès que les mots ne sont plus en résonance avec le monde, passage au mythe...Pour lui le mythologique serait du côté de l’absurdité, de l’irrationnel, tandis que la religion serait le progrès dans le développement de la rationalité de l’homme.
Critique de cela.
Réflexions de l’école sociologique (Durkheim - Mauss).
Réflexions s’organisent autour de la notion de totémisme ; totem = animal sacré dans la culture indienne. Notion de sacrifice ... rites, on peut parler de formes élémentaires de la vie religieuse.
Durkheim se demande si ce n’est pas dans le totémisme que nous trouvons la coïncidence du social le plus primitif et du religieux le plus élémentaire. Équivalence social - sacré.
Une religion c’est un système solidaire de pratiques et de croyances qui réunissent dans une même communauté morale tous les pratiquants. Cf. église. Société crée le sacré.
Mauss dénonce cette interdépendance entre faits religieux et phénomènes sociaux. Il faut s’intéresser au fait religieux pour lui-même et essayer de le comprendre dans une totalité, le phénomène social total. Interroger les opérations intellectuelles que recouvrent les mythes ou les représentations religieuses.
C. La critique du religieux
Croyance religieuse comme aliénation. Cf. Marx, Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel. Elle consiste en une dépossession des caractères de l’être humain et en une projection de l’idéal humain dans un monde imaginaire. Pour comprendre la religion, il faut commencer par analyser la société dans laquelle vivent les hommes. La religion est une expression de la misère concrète et réelle des hommes et une protestation contre cette misère.
Problème : elle prône l’acceptation de cette misère, la résignation. La religion devient mystification idéologique. Ex de la charité qui perpétue l’injustice et l’inégalité.
D. L’analyse psychanalytique de la religion
Freud est amené à reprendre un certain nombre de conclusions qui valent pour les individus et à les considérer comme valables aussi pour les comportements sociaux.
Analyse de la situation oedipienne. Enfant confronté à l’interdit de l’inceste, condition d’intégration sociale. Puis refoulement du conflit oedipien. Freud pense qu’au coeur de la foi religieuse se trouve le rapport infantile avec le père, rapport protecteur et menaçant.
Père réel qui a seul jouissance de la mère et qui barre le désir de l’enfant + père symbolique qui représente la puissance et auquel l’enfant veut s’identifier.
Or dans le sacré on trouve la toute puissance de Dieu mais aussi la transcendance et la fascination. Voir les analyses de Totem et Tabou : meurtre du père de la horde primitive originaire et culpabilité -> d’où comportements religieux.
les preuves de l’existence de Dieu établies par les philosophes !
par [ltr]Lydia COESSENS[/ltr]

LA RELIGION
I. L’apparition du problème religieux en philosophie
A. On partira de l’opposition entre religion et philosophie
Par religion on entend un ensemble de pratiques et de croyances fondées sur une révélation qui est crue et acceptée sans discussion.
Par philosophie on entend l’exercice de la raison par un sujet qui doute et n’accepte rien sans un minutieux examen[size]. [/size]
Opposition immédiate foi / raison.
On peut remarquer que la philosophie, dès sa naissance en Occident, a eu partie liée avec la science et avec l’exercice de la démonstration. Ces 2 définitions vont nous permettre de comprendre l’opposition entre philosophie et religion. En effet, le sujet de la science et de la philosophie, le cogito cartésien par exemple, exclut le sujet de l’expérience mystique. Il interdit le rapport mystique au monde. Plus tard la philosophie critique de Kant va interdire l’attitude exégétique et renvoyer la croyance à l’illusion. Cette division polémique a été nécessaire jusqu’au milieu du XIXème siècle ; elle est cependant actuellement interrogée par les philosophes, par les scientifiques depuis le milieu du XIXème environ. C’est pourquoi depuis cette époque la religion est devenue l’objet d’une science des religions et dans la philosophie elle va à présent désigner non plus l’ancienne théologie rationnelle mais un authentique savoir considéré comme un savoir d’un autre type que la raison.
B. Quelques remarques historiques
1. Pourquoi le problème ne fut pas, pendant longtemps, un problème philosophique ?
Dans la philo occidentale, jusqu’à Kant, la philosophie ne questionne pas véritablement la religion. On soumet en effet la science et la philosophie à la lumière divine, on exhibe sans problème les preuves de l’existence de Dieu et on va même identifier Dieu au Souverain Bien ou encore à la cause première. Dieu est présent au coeur des objets de savoir, il est le foyer de tous les réseaux de savoir. Il rend donc impossible pendant très longtemps le recul critique de l’esprit philosophique pour lequel le fait religieux sera un problème. Dieu s’impose donc à la philosophie comme un objet privilégié : le cogito doit être fondé sur Dieu ; on parle donc de Dieu, c’est-à-dire à partir de Dieu et afin de revenir à Dieu. En somme la religion n’est pas problématique car finalement la révélation religieuse et la philosophie parlent du même réel.
Les grands problèmes qu’abordent la philosophie seront de 2 natures :
a. Le problème de la nature divine : Ce problème recouvre 2 grands courants. Le premier déclare que Dieu est immanent et l’autre que Dieu est transcendant. Cette question semble déjà posée par la philosophie stoïcienne. Dans le stoïcisme il y a 3 grandes parties : logique, physique, morale. C’est dans la physique stoïcienne que l’on trouvera leur conception de Dieu et du monde. Pour les Stoïciens “Dieu est un vivant immortel, raisonnable, parfait, intelligent, bienheureux, ignorant tout mal, faisant régner sa providence sur le monde et tout ce qui s’y trouve ; il n’a pas de forme humaine. Il est l’architecte de tout et comme le père, et à cette partie de la divinité qui pénètre toute chose on donne communément différents noms suivant ses différents effets. On l’appelle Dia (= à travers de) parce qu’il est ce par quoi tout est fait, ou on l’appelle Zeus (-> zein = vivre) parce qu’il est la cause de la vie ou parce qu’il est intimement mêlé à tout ce qui vit “ Pour les Stoïciens Dieu ne fait qu’un avec le monde, c’est-à-dire la réalité dans ses différentes formes mais il est en même temps, principe directeur, architecte. En somme il est le même que le monde et en même temps autre que lui : Dieu est un fluide qui se répand dans la totalité du monde. A partir de cette thèse on verra s’affirmer 2 grands courants philosophiques : transcendance ou immanence de Dieu.
- Affirmation de la transcendance de Dieu :
Ce courant est développé dans la théologie et la philosophie chrétienne. Ainsi Leibniz conçoit l’univers constitué de monades et insiste sur l’unité individuelle. L’univers est réglé par la monade de toutes les monades, la monade dominante, c’est-à-dire Dieu. Il explique que Dieu est à la fois le créateur des existences mais aussi le créateur des vérités éternelles, des essences. Au niveau de l’existence il expliquera que Dieu est non seulement créateur des existences au niveau matériel et physique, mais aussi le créateur des existences au niveau de l’univers spirituel. Leibniz est le premier à concevoir Dieu comme le monarque de la République des esprits .
On peut remarquer aussi que dans la philosophie et notamment dans le christianisme, cette transcendance peut être aussi celle de la personne. Dieu est alors posé comme la valeur, l’idéal vers lequel tend et doit tendre le monde des esprits. Mais dans le christianisme cette transcendance peut être si radicale qu’on ne peut plus parler de Dieu. On trouve cette tendance chez Pascal : on ne peut plus parler de Dieu, il ne peut être objet de connaissance ni même de preuve. L’accès à Dieu par le biais de la connaissance et de la raison semble être barré, par contre il est possible par voie symbolique, de manière indirecte : la foi. On retrouve ce thème chez Kierkegaard : Dieu est l’Autre radical, absolu qu’on ne peut pas concevoir, mais avec lequel néanmoins on entre en relation intense . On voit ici apparaître la théologie négative qui consiste à dire qu’on ne peut pas dire ce qu’est Dieu, mais ce qu’il n’est pas.
- Affirmation de son immanence :
Spinoza explique que le grand péché du christianisme est l’anthropomorphisme. Ceci consiste à concevoir Dieu à l’image de l’homme. Le christianisme oublie les enseignements du judaïsme : il ne faut pas concevoir Dieu comme une personne transcendante. Pour éviter cette erreur des Chrétiens, Spinoza va affirmer, dans le livre I de l’Éthique consacré à Dieu, qu’il n’y a qu’une seule substance et cette substance est infinie, elle possède une infinité d’attributs : “Dieu, c’est-à-dire une substance constituée par une infinité d’attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie, existe nécessairement” .
Spinoza explique que cette substance infinie est la nature. Il importe cependant de ne pas faire de contre-sens sur le mot ‘nature’. La nature est à la fois la nature naturée (natura naturata) et la nature naturante (natura naturans). Dieu est la nature naturée, la nature produite, qui a été produite : on entendra la nature physique. C’est aussi la nature naturante, la nature productrice. Pour préciser ces analyses, il faut analyser le concept de nécessité : Spinoza explique qu’il y a 2 sortes de nécessité : la nécessité mécanique qui engendre l’ordre de succession des choses (necessitas coacta -> contraignante). un phénomène vient nécessairement par une cause nécessaire : c’est une causalité transitive car un effet est lié à sa cause et ne peut lui échapper. La seconde nécessité est la nécessité géométrique qui produit et engendre des conséquences. Ici la causalité n’est pas transitive mais immanente : cela signifie que la conséquence est interne au principe lui-même. Cette nécessité produit ses conséquences sans sortir d’elle-même, c’est pourquoi Spinoza peut dire que Dieu n’est pas le créateur du monde car on le concevrait alors comme une causalité transitive ; Dieu est bien plutôt la cause immanente de toute chose : “Dieu est cause immanente mais non transitive de toute chose” .
La conséquence de toutes ces affirmations c’est que, pour Spinoza, nous sommes un mode de Dieu. Tout est en Dieu. Il n’y a à ses yeux qu’une seule et unique substance, la divinité. Il n’y a pas de création donc pas de transcendance divine ; il n’y a qu’une production divine. Dieu n’est donc pas extérieur au monde, Dieu c’est la raison : “Deus sive natura sive ratio” (Dieu ou la nature ou la raison). Il n’y a pas de mystère, tout est parfaitement rationnel : il suffit d’ouvrir l’Ancien Testament. La philosophie hégélienne et notamment la formule selon laquelle ‘le réel est rationnel’ seront inspirées de Spinoza. La vertu essentielle c’est l’intelligence, il faut comprendre ce qui est, or ce qui est, c’est Dieu.
b. A côté de ce débat, la seconde préoccupation des philosophes a été celle de l’existence et des preuves de l’existence de Dieu :
On retiendra d’abord la thèse d’Aristote à propos du Théos puis l’on exposera les preuves que donnent à la suite d’Aristote, Saint Thomas et Descartes.
Le point de départ des démonstrations de l’existence peut déjà se trouver chez Aristote. Dans son analyse du réel, Aristote fait prévaloir la substance au milieu des catégories et au milieu du mouvement. Or il explique qu’il y a des substances qui ne connaissent absolument aucun mouvement, qui coïncident avec l’acte pur. Ces substances sont séparées et immobiles ; il y a donc pour lui une classe d’être qui mérite par excellence le titre d’être parce qu’ils sont au sens plein et premier du terme, ils sont immobiles. Aristote oppose donc l’acte au mouvement et pense à des actes parfaits qui ne sont plus le résultat d’un processus mais sont confondus avec l’acte lui-même. Ces actes ne sont plus transitifs mais jouissance dans l’exercice lui-même. L’acte parfait est celui qui a sa fin en lui-même ;à côté de l’acte qui devient (passage de la puissance à l’acte) il y a l’acte par excellence qui se présente achevé à chacun de ses moments, c’est l’Acte immanent et immobile qu’Aristote place au sommet de l’univers . L’acte par excellence c’est Dieu. Le mouvement circulaire est de ce point de vue l’expression la plus adéquate de la perfection puisque ce mouvement ne tend nulle part au sens d’un but et n’est pas un effort vers la perfection, il est la finalité immanente. Cette activité d’immobilité est celle de Dieu et celle aussi de la pensée de la pensée . Nous atteignons ici le terme de toute recherche sur l’être en même temps que la source de l’être, car nous sommes en présence de l’être immobile, éternel, incorruptible : le Théos. Selon Aristote, l’univers est gouverné par un premier moteur immobile qui est forme pure, réalité souveraine. Il ne peut y en avoir qu’un seul, autrement il y aurait plusieurs cieux.
Les preuves de l’existence de Dieu vont être développées par la théologie chrétienne qui s’appuiera parfois sur Platon (Saint Augustin), parfois sur Aristote (Saint Thomas). Cependant elles modifient totalement la nature de l’argumentation. Le problème que se posent les théologiens et philosophes est celui de la raison d’être du monde : comment se fait-il que ce monde-là existe ?
Il s’agit d’expliquer la causalité efficiente, d’expliquer pourquoi, comment le monde a été créé. Ce type de problèmes n’avait jamais été posé par les Grecs. C’est le christianisme, le judaïsme qui se demandent quelle est l’origine de l’existence en montrant que Dieu est la cause du monde.
On examinera les preuves que donne Saint Thomas : il nous en propose plusieurs, la preuve par le mouvement, la preuve par la causalité efficiente, la preuve par les causes finales. Ces preuves sont très influencées par Aristote.
- La preuve par le mouvement :
Saint Thomas explique qu’il est certain qu’il y a du mouvement dans le monde or ce qui se meut est mu par quelque chose. Mouvoir quelque chose c’est le faire passer de la puissance à l’acte or une chose ne peut être amenée à l’acte que par un être en acte. Ainsi le chaud en acte va rendre chaud en acte le bois qui n’était chaud qu’en puissance et en le faisant brûler il le meut. Il est impossible qu’une chose soit sous le même rapport et en même temps en puissance et en acte. Impossible qu’une chose soit motrice et mue. Donc tout ce qui se meut est mu par autre chose... On peut remonter à l’infini. Il est cependant nécessaire de s’arrêter. S’il n’y avait pas en effet de premier moteur on ne pourrait même pas parler de moteur puisqu’un second moteur ne se meut que parce qu’un premier moteur le meut. Il est donc nécessaire pour expliquer le mouvement de remonter à un premier moteur que rien ne meut et qui se nomme Dieu. Dieu est un existant qui est lui-même en acte. Cet existant en acte ne ressemble pas à l’acte pur d’Aristote ; Dieu c’est l’Esse (l’Être) : Dieu est l’acte pur d’exister du ‘je suis celui qui est’ de l’Exode.
- La preuve par la causalité efficiente :
Saint Thomas part de la considération des choses sensibles. Il constate que dans les choses sensibles il y a un ordre de causalité efficiente mais on ne peut y rencontrer un être qui soit cause de lui-même. Or il est impossible de remonter à l’infini dans la série des causes efficientes ; il est donc nécessaire de poser une cause efficiente première, c’est-à-dire Dieu. Dieu est la cause de la totalité de toutes les séries causales parce qu’il est cause de soi. En somme la première preuve nous fait atteindre Dieu comme cause du mouvement et de tous les mouvements qui en dépendent ; la deuxième nous le fait atteindre comme cause de l’existence de ce monde lui-même et c’est pourquoi l’on peut dire qu’il est à la fois premier moteur et première cause.
- La preuve par les causes finales :
“Il est impossible que les choses contraires et disparates viennent s’accorder et se concilier dans un même ordre... s’il n’existe un être qui les gouverne et qui fasse que toutes ensembles, elles tendent vers une fin déterminée. Or nous constatons que dans le monde, des choses de nature diverse se concilient dans un même ordre. Non point de temps à autre et par hasard, mais toujours ou la plupart du temps. Il doit donc exister un être par la Providence duquel le monde soit gouverné et c’est lui que nous appelons Dieu” . Ici nous avons la dernière preuve, la preuve par la finalité.
Par la suite se développeront d’autres types de preuves. Ainsi Descartes ne retiendra pas la preuve par le mouvement et Spinoza critiquera vivement la démonstration par les causes finales. Descartes va donc utiliser d’autres arguments : l’argument par la causalité de l’idée, l’argument par la contingence du moi, l’argument ontologique élaboré par Saint Anselme au XIème siècle, mais écarté par Saint Thomas.
Les 2 premiers arguments se trouvent dans la 3è Méditation des Méditations métaphysiques : Dieu n’est présent à l’esprit que sous la forme d’une idée dont on va montrer la réalité objective. A la différence de toutes les autres idées, Dieu est une réalité qui ne peut avoir été produite par l’esprit humain. Par conséquent, si elle n’est pas produite par moi elle ne peut avoir été mise en moi que par un être qui possède toutes les perfections que cette idée représente. Descartes va distinguer dans les idées 2 aspects : on peut envisager les idées sous l’angle de leur réalité matérielle, mais aussi sous l’angle de leur réalité formelle. Dans le premier cas, rien ne les distingue entre elles ; ce sont toutes des pensées découpées dans le même tissu, dans la même étoffe mentale. Dans le second cas elles sont très différentes, car l’on considère la réalité représentative de ces idées. Elles sont alors toutes différentes : d’une part par les objets qu’elles représentent mais elles sont aussi différentes par le type d’être qu’elles sont amenées à représenter. C’est alors qu’il explique que l’idée de substance “a plus de degrés d’être ou de perfection que les idées qui me représentent seulement des modes ou des accidents” . S’il est possible à Descartes de hiérarchiser les idées à partir de leur réalité objective , c’est-à-dire à partir de leur perfection, on peut donc maintenant envisager l’idée d’une substance infinie qui possède toutes les propriétés, c’est-à-dire la plus grande perfection. Descartes introduit à côté de la relation horizontale des idées, une relation verticale et hiérarchique entre les idées et les réalités qu’elles représentent. De ce point de vue apparaissent des inégalités dont l’esprit ne peut rendre compte par ses propres moyens ; notamment quand il s’agit de l’idée de Dieu qui “a certainement en soi plus de réalité objective...c’est-à-dire de perfection”. L’argument qui consiste à extraire de la seule idée de Dieu son existence nécessaire dépend donc de la valeur objective de cette idée et de la liaison conceptuelle entre perfection et réalité objective. L’idée que j’ai d’un être plus parfait que le mien doit nécessairement avoir été mise en moi par un être qui soit en effet plus parfait. L’argumentation de Descartes repose ici sur l’impossibilité de transférer des perfections dont la conscience voit qu’elles lui manquent, à un être imaginaire qu’elle composerait fictivement par addition indéfinie des perfections que la conscience trouverait en elle. Au contraire l’imperfection présuppose la perfection toute positive : je n’aurais pas la conscience de ce que les choses ne sont pas, de ce qui leur fait défaut si je n’avais préalablement l’idée d’une réalité qui est pleinement, parfaite, positive. A cette preuve par l’infiniment parfait, Descartes va ajouter une seconde qu’on peut appeler preuve par la contingence de l’existence puisqu’elle s’appuie sur la contingence du moi pensant.
Avec cette preuve je m’aperçois comme fini, comme être contingent (j’aurais pu ne pas être), donc différent de l’infini et du nécessaire. Je ne tiens donc pas mon existence de moi-même car dans ce cas je me serais donné toutes les perfections. “Il me reste à examiner de quelle façon j’ai acquis cette idée... elle n’est pas une pure production ou fiction de mon esprit ; .. par conséquent il ne reste plus autre chose à dire, sinon que, comme l’idée de moi-même, elle est née et produite avec moi-même dès lors que j’ai été créé. Et certes on ne doit pas trouver étrange que Dieu en me créant ait mis en moi cette idée, pour être comme la marque de l’ouvrier empreinte sur son ouvrage”. On voit ici que moi qui suis imparfait et qui ai l’idée de la perfection en moi néanmoins, je n’ai pu la recevoir que d’un être parfait qui me dépasse, que d’un auteur de mon être.
La dernière preuve est la preuve ontologique (Vè Méditation) : elle avait été développée par Saint Anselme. Dans le Proslogion, il part de l’idée de “l’être tel qu’on ne peut pas en concevoir de plus grand”. Cet être ne peut pas n’exister que conceptuellement car exister en réalité c’est être plus grand qu’exister seulement dans l’intelligence. Ainsi cet être existe et dans l’intelligence puisque je le conçois et dans la réalité. Ce que Saint Anselme appelle Dieu c’est l’être absolu qui réclame immédiatement la position de son existence par la pensée qui le conçoit. Descartes développera le même type de preuve puisqu’il écrit “j’ai en moi l’idée d’un être souverainement parfait, idée aussi claire et distincte que l’idée du triangle. De même que je peux déduire de l’idée du triangle que la somme de ses angles est égale à deux droits, de même de l’idée de l’être parfait je puis conclure que cet être existe”.
2. Le problème religieux
:
Il va apparaître dans la philosophie kantienne.
Kant, dans la Critique de la raison pure, met fin à un certain type de discours sur Dieu et notamment à toutes les preuves ontologiques de l’existence de Dieu. On remarque d’ailleurs que c’est à partir de Kant que se développeront les grandes critiques philosophiques de la religion.
C’est la philo kantienne qui interroge de manière décisive la démarche suivie par la philo et par la métaphysique. Pour interroger cette démarche, Kant s’appuie sur l’analyse de la démonstration de l’existence de Dieu. Ambiguïté de la notion de perfection -> n’a-t-elle pas un sens essentiellement pratique et relatif, existentiel ? Dans la Critique de la raison pure, il montre que l’existence n’est pas un prédicat ; mais est un problème de la connaissance qui n’est résolu qu’en référence au postulat de la pensée empirique, ie en relation au contexte de l’expérience. Il faut interdire à la raison les déterminations métaphysiques de l’existence de Dieu et il faut la limiter à la seule connaissance scientifique qui nous met en rapport avec l’expérience. Il nous est interdit de connaître Dieu, mais il nous est possible d’y penser, ie d’en avoir une idée qui relève à présent de la croyance ou de la foi. La théologie rationnelle est ruinée ; Dieu n’est plus l’objet d’un acte de connaissance : “Je dus donc abolir le savoir pour laisser une place à la foi” dit Kant.
Il s’agit dès lors de restaurer une croyance dans son usage pratique ou moral. Dieu devient une Idée de la raison.
Religion comme problème :
- Hegel :
Dieu peut enfin être connu comme sujet : si Dieu se rend visible et manifeste dans le discours religieux, le vrai sujet de la religion c’est Dieu. Il n’est pas d’autre Dieu que celui qui apparaît dans le discours. Dieu se manifeste dans la culture et dans l’histoire sous la forme de l’Esprit.
- Nietzsche
ne verra dans la religion que la forme d’un monde où s’exprime la volonté de puissance. Renoncement, mauvaise conscience et ressentiment sont les signes de la religion. La religion veut que nous renoncions à la vie.
II. La religion comme objet de savoir
:
A. Pour que la religion entre dans l’histoire profane, il faut donc qu’on ne la confonde pas avec d’autres savoirs, notamment avec les savoirs scientifiques et philosophiques.
Pratique du comparatisme -> pratique de la critique historique.
B. Les résultats du comparatisme
Grand comparatiste Max Müller (1823-1900) : va s’attacher à lire les mythes de l’humanité selon la science du langage : l’homme au début de son histoire a un seul parler. Il prononce les mots dans lesquels s’expriment directement une part de la substance des objets perçus ; dès que les mots ne sont plus en résonance avec le monde, passage au mythe...Pour lui le mythologique serait du côté de l’absurdité, de l’irrationnel, tandis que la religion serait le progrès dans le développement de la rationalité de l’homme.
Critique de cela.
Réflexions de l’école sociologique (Durkheim - Mauss).
Réflexions s’organisent autour de la notion de totémisme ; totem = animal sacré dans la culture indienne. Notion de sacrifice ... rites, on peut parler de formes élémentaires de la vie religieuse.
Durkheim se demande si ce n’est pas dans le totémisme que nous trouvons la coïncidence du social le plus primitif et du religieux le plus élémentaire. Équivalence social - sacré.
Une religion c’est un système solidaire de pratiques et de croyances qui réunissent dans une même communauté morale tous les pratiquants. Cf. église. Société crée le sacré.
Mauss dénonce cette interdépendance entre faits religieux et phénomènes sociaux. Il faut s’intéresser au fait religieux pour lui-même et essayer de le comprendre dans une totalité, le phénomène social total. Interroger les opérations intellectuelles que recouvrent les mythes ou les représentations religieuses.
C. La critique du religieux
Croyance religieuse comme aliénation. Cf. Marx, Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel. Elle consiste en une dépossession des caractères de l’être humain et en une projection de l’idéal humain dans un monde imaginaire. Pour comprendre la religion, il faut commencer par analyser la société dans laquelle vivent les hommes. La religion est une expression de la misère concrète et réelle des hommes et une protestation contre cette misère.
Problème : elle prône l’acceptation de cette misère, la résignation. La religion devient mystification idéologique. Ex de la charité qui perpétue l’injustice et l’inégalité.
D. L’analyse psychanalytique de la religion
Freud est amené à reprendre un certain nombre de conclusions qui valent pour les individus et à les considérer comme valables aussi pour les comportements sociaux.
Analyse de la situation oedipienne. Enfant confronté à l’interdit de l’inceste, condition d’intégration sociale. Puis refoulement du conflit oedipien. Freud pense qu’au coeur de la foi religieuse se trouve le rapport infantile avec le père, rapport protecteur et menaçant.
Père réel qui a seul jouissance de la mère et qui barre le désir de l’enfant + père symbolique qui représente la puissance et auquel l’enfant veut s’identifier.
Or dans le sacré on trouve la toute puissance de Dieu mais aussi la transcendance et la fascination. Voir les analyses de Totem et Tabou : meurtre du père de la horde primitive originaire et culpabilité -> d’où comportements religieux.
 Re: Religion et Philosophie
Re: Religion et Philosophie

La religion et la philosophie
Il faut bien distinguer la religion des [ltr]philosophes[/ltr] de la religion des théologiens.
La religion est souvent conçue, dans les doctrines philosophiques du XIXe et du XXe siècles, comme scission de l’homme d’avec lui-même (Feuerbach), réalisation fantastique de l’être humain (Marx), ou même comme expression « névrotique » (Freud). La religion est-elle un soleil illusoire ? C’est la question que posent certaines analyses modernes.
Du latin religio, son étymologie est à dissocier. Elle a trait à la pratique religieuse, au culte. Elle vient du verbe relegere, qui signifie recueillir, rassembler ou religare qui signifie lier, attacher.
Deux conceptions de la religion peuvent être envisagées :
– Objectivement, elle est une institution dont l’objet est de rendre à Dieu honneur et hommage. Elle est un ensemble de pratiques et de rites relatifs à une réalité sacrée, séparée du profane.
– Selon la conception subjective, elle est le sentiment intérieur du Sacré, avec croyance en la divinité et foi.
Définitions de la religion par les Philosophes :
– Hegel:
« La religion représente l’esprit absolu non seulement pour l’intuition et la représentation, mais aussi pour la pensée et la connaissance. Sa destination capitale est d’élever l’individu à la pensée de Dieu, de provoquer son union avec lui et de l’assurer de cette unité. La religion est la vérité, telle qu’elle est pour tous les hommes. L’essence de la véritable religion est l’amour. » ([ltr]Analyse de la Phénoménologie de l’Esprit[/ltr])
 Re: Religion et Philosophie
Re: Religion et Philosophie
Méta-philosophie de la religion
Roger Pouivet
Mots-clés :philosophie analytique, philosophie continentale, méta-philosophie
Keywords :Analytic philosophy, continental philosophy, metaphilosophy
Qu’est-ce qu’une méta-philosophie de la religion ?
1
Un philosophe australien, Nick Trakakis, a récemment publié un livre intitulé The End of Philosophy of Religion. « Mon but, dit-il, sera de montrer que la tradition analytique en philosophie, du fait de son attachement aux normes scientifiques de rationalité et de vérité, est incapable de saisir la réalité transcendante se manifestant dans la pratique religieuse » [Trakakis 2008, p. 2]. Le livre est une charge dirigée contre la philosophie analytique de la religion et une apologie de la philosophie continentale de la religion. L’un des chapitres est intitulé « méta-philosophie de la religion » ; il compare philosophie continentale et philosophie analytique de la religion. Plutôt que de proposer une critique directe, ce que j’ai fait par ailleurs [Pouivet 2010], je vais présenter ma propre méta-philosophie de la religion.
2
Par « méta-philosophie », j’entends la réponse à la question formulée par Jacques Bouveresse : « Que veut la philosophie et que peut-on attendre d’elle ? » [Bouveresse 1996]. La question possède une signification descriptive et une signification évaluative. La première revient à demander : À quoi les philosophes prétendent-ils parvenir et leurs prétentions sont-elles justifiées ? Quelles sont les attentes de leurs auditeurs et de leurs lecteurs ? La seconde correspond aux questions suivantes : Les prétentions des philosophes sont-elles raisonnables ? Sont-elles intellectuellement honnêtes ? Les auditeurs et les lecteurs ont-ils raison d’avoir les attentes qu’ils entretiennent ? Peuvent-ils en toute honnêteté se déclarer satisfaits de ce que les philosophes leur proposent ? La distinction entre philosophie continentale et philosophie analytique s’impose alors parce qu’à ces questions-là les réponses des deux bords sont nettement différentes.
3
Quelques précautions dans l’usage de la distinction entre analytique et continental sont cependant indispensables. Premièrement, cette distinction n’est pas absolue. Il existe des zones neutres en quelque sorte ; et donc il existe autre chose en philosophie que ces deux pôles. Je pense en particulier à certains secteurs de l’histoire de la philosophie. Deuxièmement, cette distinction n’est pas géographique ; elle ne recouvre pas non plus la différence entre la pratique de la philosophie en langue anglaise et sa pratique en langue française ou allemande. Troisièmement, la précaution est d’importance, cette distinction ne se confond pas avec un jugement de valeur intellectuelle : ce n’est pas tout bon d’un côté et tout mauvais de l’autre. Cette distinction recouvre des prétentions philosophiques distinctes et des espoirs fort variés des auditeurs et des lecteurs. Ce sont ces précautions et ces espoirs que j’examine ici s’agissant de la philosophie de la religion.
Philosophie analytique et philosophie continentale
4
Dans un livre intitulé Philosophie contemporaine [Pouivet 2008], je fais reposer la comparaison entre philosophie continentale et philosophie analytique sur deux séries de caractéristiques :
Philosophes analytiques
Philosophes continentaux
Primat de l’argumentation
Primat des « visions »
Caractère direct des problématiques
Caractère oblique et historique des problématiques
Clarté, précision et minutie
Profondeur, largeur de vue et globalité
Littéralité des formulations
Recours à la métaphore, effort stylistique
Visée aléthique de la philosophie
Visée interprétative de la philosophie
5
Je me contente ici de mentionner ces deux séries, commentées dans mon livre. Mais pour mieux cerner ce qui est propre à la philosophie de la religion, j’ajoute d’autres distinctions :
Philosophie analytique de la religion
Philosophie continentale de la religion
Argumentation et rationalité
Perspective et généalogie
Primat de l’épistémologie
Primat de la phénoménologie et de la pratique
Réalisme ou Fictionnalisme
Antiréalisme
6
Ces deux séries ne composent pas seulement une différence cosmétique. C’est une opposition. Un peu de bonne volonté ou de compréhension de part et d’autre ne permet pas de la surmonter. Ce que prétendent faire le philosophe continental de la religion et son alter ego analytique, ce n’est vraiment pas la même chose. Les attentes que peuvent décemment entretenir leurs auditeurs et lecteurs sont nettement différentes.
7
Je me contenterai de citer deux séries de noms, afin de ne pas multiplier les références. La première de philosophes continentaux de la religion : John D. Caputo, Michel Henry, John Hick, Emmanuel Levinas, Dewi Z. Phillips, Jean-Luc Marion, Paul Ricœur, Nick Trakakis, Merold Westphal. La seconde de philosophes analytiques de la religion : William Alston, Peter Geach, Paul Helm, Anthony Kenny, Graham Oppy, Alvin Plantinga, Peter van Inwagen, Richard Swinburne, Nicholas Wolterstorff. Dans chaque cas, il faut ajouter « et bien d’autres ».
Perspective et généalogie vs argumentation et rationalité
8
Les philosophes continentaux pensent majoritairement que nous ne pouvons parvenir à une connaissance de la réalité qui ne soit pas une façon de nous la représenter. Dès lors, nous adoptons inévitablement une perspective sur la réalité ; ce qu’elle est « vraiment » nous échappe. Autrement dit, notre savoir serait relatif à un schème conceptuel. Il nous est difficile, voire impossible, de distinguer une description et une interprétation de la réalité. Toute interprétation comprend des intentions et des valeurs qui ne sont pas données, mais choisies ou préférées par ceux qui interprètent ; les philosophes seraient là, pensent beaucoup de philosophes continentaux, pour mettre au jour ses intentions et ses valeurs, liées à nos désirs et à nos appétits de pouvoir.
9
Le perspectiviste est ainsi dubitatif dès qu’on prétend s’assurer de la vérité d’une thèse et trouver des raisons objectives de l’entretenir. Il rejette à la fois la thèse selon laquelle la réalité nous est accessible et l’idée d’une raison désintéressée. Il met l’accent sur nos illusions épistémologiques et sur des récits donnant un sens à l’histoire. Il se présente comme le meilleur spécialiste pour saisir et apprécier la signification du moment où nous en sommes dans le développement de la pensée. Le philosophe continental parviendrait à manifester le sens caché, peut-être inavouable, des tentatives passées, chez les philosophes, mais aussi dans la théologie et les sciences, pour dire ce qu’est la réalité. Il se propose d’en fournir une compréhension en profondeur en manifestant leur sens latent.
10
Ayant renoncé à l’objectivité de la vérité fondée sur des arguments ou des raisons, le perspectiviste peut donner l’impression d’adopter une attitude sceptique et intellectuellement modeste. Toutefois, donner le sens profond de toute l’histoire de la pensée, c’est un scepticisme grandiose, solidaire d’une grande confiance herméneutique ; c’est au moins, on me l’accordera, d’une modestie toute relative. Le récit interprétatif du perspectiviste sera par exemple une interprétation de l’histoire de la philosophie médiévale et classique comme cosmo-théologie et onto-théo-logie, pour reprendre le vocabulaire kantien, c’est-à-dire comme continuité d’être du Créateur aux créatures. L’important serait de savoir où nous en sommes après l’achèvement de la métaphysique – un achèvement qui serait l’œuvre de Nietzsche et de Heidegger. Nous pensons après eux et donc nécessairement avec eux, dit-on. Pour sortir d’une métaphysique dite « de la présence », il faut alors déconstruire (dés-onto-théo-logiser) la pensée chrétienne. Rien de moins.
1 Voir Schellenberg, 2007.
11
À l’aune d’un tel programme, ce que prétendent faire la plupart des philosophes analytiques : reformuler d’anciennes thèses métaphysiques, reprendre les arguments en faveur de l’existence de Dieu, en les améliorant, si possible, du moins en tâchant de bien les comprendre, et poser la question de la justification épistémique (du droit de croire), cela peut semble bien naïf et vain. Pour le philosophe continental, la métaphysique et l’épistémologie sont achevées. Discuter un argument ontologique ou proposer une métaphysique de la Trinité avec les instruments de la logique contemporaine et toute la scolastique de la philosophie analytique, quel sens cela peut-il alors avoir ? Pourtant, le philosophe analytique de la religion reste imperturbablement confiant dans notre capacité de produire, sur la base d’arguments, des affirmations justifiées au sujet de Dieu, de ses attributs, de ses intentions, des valeurs chrétiennes, de la Trinité, de la Rédemption ou de l’Incarnation. Tout comme au bon vieux temps. Certes, il existe aussi une voie sceptique en philosophie analytique, mais elle est elle-même argumentative à souhait1.
12
Une distinction me semble ici utile entre deux types de confiance intellectuelle à l’œuvre dans l’activité philosophique : la confiance argumentative et la confiance herméneutique. La première consiste à accorder un large crédit aux procédures argumentatives. La seconde met surtout l’accent sur la découverte d’une interprétation jugée éclairante. Chez Marx, Freud, Lacan, Lévi-Strauss, après et avec eux, dans toute une partie de ce qu’on appelle « sciences humaines et sociales », bien sûr chez la plupart des philosophes continentaux de la religion, on trouve le présupposé de ne jamais prendre pour argent comptant ce que les gens en général et les philosophes en particulier disent quand ils formulent des thèses et proposent des arguments. Leurs motivations véritables, dit l’herméneute, ne sont pas leurs raisons déclarées et apparentes. Il faut d’abord savoir ce qu’elles signifient, voire ce qu’elles cachent. Méfiance donc, et vision pénétrante. En faisant une interprétation généalogique, on s’apercevrait par exemple que les preuves de l’existence de Dieu ont en réalité la fonction cachée, surtout à ceux qui les formulent, d’imposer une continuité entre Dieu (pensé comme un être) et ses créatures, avec toutes les conséquences, politiques entre autres, que cela peut avoir. Et du coup, discuter sérieusement de ces preuves ou tenter de les réfuter est totalement inutile. On doit dévoiler ce qu’elles sont en réalité : des dispositifs philosophiques et non des arguments plus ou moins bons.
13
Dans le monde païen, la divination était pratiquée par les oracles et les augures. Ce rôle est joué aujourd’hui par des philosophes ou certains spécialistes des sciences humaines. Ils ne « lisent » pas dans les abats d’animaux ou le vol des oiseaux, mais dans les œuvres du passé ou dans les événements historiques. Si nous n’admirons plus les devins, les philosophes continentaux sont appréciés pour leurs interprétations profondes. Cette description du rôle des intellectuels, et particulièrement de certains philosophes, ne doit pas être tenue pour ironique ou méprisante. Il existe une demande humaine constante pour une forme de révélation du fond caché des choses que les oracles à leur façon pratiquaient, et que pratiquent aujourd’hui, à la leur, les philosophes continentaux, et en particulier ceux qui parlent de religion. Si vraiment ils réalisent les exploits généalogiques dont on les crédite parfois, ils satisfont alors une attente que la philosophie analytique, s’agissant de religion ou de quoi que ce soit d’autre, ne peut pas satisfaire.
Phénoménologie et pratique vs épistémologie
14
Examinons d’autres aspects des prétentions respectives de la philosophie continentale et de la philosophie analytique de la religion, ainsi que d’autres types d’attente qu’elles sont supposées satisfaire.
15
La philosophie continentale de la religion est phénoménologique. Elle porte fondamentalement sur une expérience. Cela ne signifie pas que la philosophie continentale soit nécessairement une phénoménologie de la religion. D’abord parce que cela pourrait encore impliquer une extériorité philosophique à l’égard du contenu de cette expérience. En cherchant à en déterminer la valeur épistémique, la philosophie continuerait à s’interroger en termes de correspondance avec quelque chose, le divin. Or nous est-il souvent expliqué, nous ne pouvons pas faire l’expérience de Dieu comme infini. Cependant l'expérience religieuse témoigne de la possibilité du surgissement de l'événement et dès lors l'effectivité serait en avance sur la possibilité logique – c’est au moins ce que je peux lire chez l’un des meilleurs philosophe continental de la religion. J’avoue que l’idée d’une avance prise par l’effectivité sur la possibilité bouscule sérieusement ce que j’avais cru comprendre des modalités, et disons même que je ne saisis pas ce que cela veut dire ; mais la formule est saisissante. Nombre de philosophes continentaux me semblent penser que si nous ne baignons pas dans une phénoménalité mystérieuse, voire nébuleuse, nous nous éloignons de l’expérience religieuse, alpha et oméga de la religion. Le pire serait de prétendre lui faire jouer un simple rôle dans une procédure épistémologique de justification épistémique. D’où l’attrait dans la philosophie continentale pour certaines figures de la tradition mystique comme Pseudo-Denys, Maître Eckhardt, Saint François d’Assise, Saint Jean de la Croix. D’où aussi le recours à des phénomènes dits saturés, comme celui de « donation », quand il s’agit de parler de l’appréhension phénoménale d’un amour, agape, surpassant toute fixation ontologique et épistémologique. On ne peut pas définir en quelques mots la donation, pas plus que la différance derridienne ou le regard levinasien ; on ne peut même pas semble-t-il les définir du tout.
16
D’autres philosophes continentaux de la religion accordent à la pratique une fonction comparable à celle que les phénoménologues accordent à l’expérience. Le langage religieux, disent-ils, n’est pas un instrument avec lequel nous décrivons une réalité divine. C’est une pratique dans une forme de vie dont la théologie est une grammaire et non une théorie. Dès lors, la philosophe de la religion ne propose pas une explication, ontologique ou épistémologique, de son objet, Dieu ou la religion, mais elle explore des pratiques qui sont constitutives de la religiosité.
2 Pouivet, 2012.
17
En revanche, la philosophie analytique ne porte pas sur une phénoménalité propre de l’expérience religieuse, ni ne décrit des formes de vie. Elle ne se départit jamais d’une intention épistémologique et ontologique. C’est pourquoi la question de la justification des croyances religieuses y est centrale. Ces croyances peuvent résulter d’expériences qui en sont la source, voire les fondements ; et ces croyances sont parfois analysées dans le cadre de pratiques. Mais leur nature et leur spécificité sont évaluables, pour le philosophe analytique. Identifiant les croyances à des propositions, il s’interroge sur la possibilité qu’elles soient des conclusions d’arguments. La question de la légitimité épistémique d’une croyance en la révélation est la principale2.
18
L’attente est ainsi bien différente dans le cas de la philosophie continentale et de la philosophie analytique. Dans le premier cas, il s’agit d’une exploration du sens profond de certaines expériences ou de certaines pratiques. Dans le second cas, l’enquête relève d’une épistémologie normative et évaluative.
Anti-réalisme vs réalisme ou fictionnalisme
19
Venons-en finalement à l’opposition entre l’antiréalisme des continentaux et le réalisme des analytiques [Alston 1995]. Pour l’antiréaliste, un énoncé religieux ne fonctionne pas comme énoncé portant sur des faits (si jamais il y en a, car certains en doutent). L’énoncé religieux est lié, je l’ai déjà dit, à une expérience (pour les phénoménologues), à l’adoption d’une « forme de vie » (pour les néo-wittgensteiniens) ou à un récit (pour les néo-ricœuriens). Le discours religieux ne porte dès lors pas sur une réalité indépendante de notre vie phénoménale, de nos descriptions, croyances, théories, schèmes conceptuels.
20
Cela peut avoir des conséquences décisives au sujet de la vérité des énoncés religieux. Un antiréaliste pense que ce qui rend vrai p est toujours autre chose que p. En épistémologie, ce qui rend p vrai sera que p est vérifiable, confirmable, rationnellement acceptable, justifiable, compatible avec d’autres énoncés, etc. Dans le cas d’un énoncé religieux, ce sera plutôt une expérience, celle de la donation par exemple, ou ce sera une forme de vie, ou un récit. Dès lors, la notion de « vérité » ne renvoie pas à l’examen de critères de vérité et à ce qui rend vrai un énoncé. Elle signifie l’authenticité d’une expérience ou d’une forme de vie. Un énoncé religieux comme « Dieu nous aime et nous a créés afin que nous le connaissions » ne correspond pas à son amour pour nous. Il exprime une expérience ; il illumine et guide une vie. La philosophie de la religion fait la phénoménologie de cette expérience, des attitudes et des sentiments qui lui sont associés. Il est significatif que l’antiréaliste religieux mette entre guillemets tous les termes signifiant une réalité indépendante de notre expérience ou du langage. Dieu n’est pas jamais rencontré, mais il est « rencontré ». On doit parler de « Dieu » ou de Dieu ; on ne doit pas parler de Dieu. Car on ferait de lui un objet, comme une table ou chaise.
21
En revanche, le réaliste accepte ce schéma d’équivalence : p est vrai si et seulement si p. Dès lors, « Le Christ est ressuscité » si et seulement si le Christ est ressuscité. C’est pourquoi le théisme et l’athéisme sont, en philosophie de la religion, les meilleurs ennemis. Car ils ont la même prétention, simplement inversée. Dieu existe, dit l’un ; pas du tout pense l’autre. L’antiréaliste pour sa part pense que ce n’est pas ainsi qu’il convient de poser le problème, en termes d’existence d’un être ou de l’Être, et il se fait fort de sortir de la « métaphysique de la présence ».
3 Pouivet, 2011.
22
Cependant un philosophe analytique peut fort bien être antiréaliste. Alors, pourquoi cela ne serait-il pas possible en matière de philosophie de la religion ? Par exemple, une conception fictionnaliste affirme que le discours théologique, et la pratique religieuse en général, nous engage dans une forme de simulation (make-believe) [Le Poidevin 2003]. Pour le fictionnaliste religieux, il est vrai-dans-religion-chrétienne que, disons, Dieu s’est fait homme. Une telle théorie de la vérité fictionnelle affirme que ce qui rend fictionnellement vrai que p, c’est que p-dans-la-fiction. Certes, il existe un antiréalisme analytique en matière de philosophie de la religion. Mais il sert en réalité à défendre une version de l’athéisme. Vrais-dans-une-fiction, les énoncés religieux peuvent encore être importants pour nous, comme le sont certains romans ou certains films, mais ils ne sont pas vrais (ni faux peut-être)3. Cette conception est très différente d’un perspectivisme généralisé ; surtout elle est différente sur le fond de l’antiréalisme continental en philosophie de la religion ou de la critique de la « métaphysique de la présence ».
4 Une formule employée par Maxime Caron dans une interview qu’il a donnée au sujet de son livre La Vé (...)
23
On lit des philosophes analytiques de la religion pour savoir s’il est possible de justifier la vérité d’un énoncé comme « La Trinité est un seul Dieu en trois personnes », et comment. La Trinité est un mystère bien sûr. Mais l’affirmation que « La Trinité est un seul Dieu en trois personnes » n’en offre pas moins, pour le philosophe analytique, la possibilité d’une discussion rationnelle. Ainsi, ces derniers temps, les philosophes analytiques de la religion s’opposent au sujet de trois conceptions de la Trinité [McCall & Rea 2009]. Le « trinitarisme social » affirme qu’aucune personne divine ne peut exister indépendamment des autres personnes. Récemment elle a été défendue à l’aide d’une logique des touts et de parties (méréologie). Le « trinitarisme latin » applique à la question de la Trinité la théorie ontologique des tropes et la métaphysique des parties temporelles. Le « trinitarisme relatif » se fonde sur une théorie relativiste de la vérité – relativiste au sens logique où toute identité est relative à une sorte, non pas au sens où chacun aurait sa vérité. Je n’entre dans aucune des délicieuses complexités de ces trois conceptions et dans le débat scolastique entre les défenseurs de chacune d’elles. Seul le contraste avec l’attitude continentale m’importe ici. Le philosophe continental mettra lui l’accent sur le sens que peut avoir pour nous la Trinité. Voici une formule représentative : « Le Transcendant est la Différence fondamentale dont l’infinité de Gloire est infiniment démultipliée en Trinité »4. C’est un peu obscur non ? Ne serait-ce que parce qu’une démultiplication infinie en Trinité suppose une drôle d’arithmétique, pas classique en tous les cas. Quand le philosophe continental s’intéresse à la signification que la Trinité peut avoir dans le Devenir, ou à son rôle dans une expérience religieuse ou une pratique religieuse, le philosophe analytique continue de s’interroger sur l’intelligibilité d’un seul Dieu en trois personnes.
La philosophie analytique de la religion est une philosophie de croyants et d’incroyants
24
Revenons sur la différence entre les prétentions et les attentes divergentes des philosophes analytiques et des philosophes continentaux. Quand on lit un philosophe analytique de la religion, qu’il est croyant, catholique ou calviniste par exemple, c’est immédiatement clair. Car ses analyses philosophiques partent en général de ses croyances religieuses. Il entend montrer qu’il est autorisé – Nicholas Wolterstorff en anglais dirait « entitled » [Wolterstorff 2010] – à les avoir. Ou à l’inverse, il défend l’agnosticisme (Anthony Kenny) ou l’athéisme (J.L. Mackie ou Graham Oppy), et c’est tout aussi clair. Les philosophes analytiques déploient volontiers leurs bannières et pour eux la philosophie consiste à expliciter et à justifier ce que l’on croit. Ils n’avancent pas masqués. En revanche, la pratique de la philosophie continentale de la religion semble détachée d’une « appartenance » religieuse, mais aussi de l’agnosticisme ou de l’athéisme. Elle semble avoir pour finalité la philosophie pour elle-même et ne se présente que fort rarement comme la défense ou la critique de certaines croyances, religieuses ou autres.
25
La philosophie analytique de la religion est une philosophie de croyants ou d’incroyants. En revanche, les philosophes continentaux, même s’ils sont croyants, disent rarement : « Je suis croyant et je vais expliquer ce qui m’autorise à l’être » ; ou bien : « Je crois en la sainte Trinité, et cela n’a rien d’aberrant ». Pourquoi ? Parce que le philosophe continental rejette l’idée que ce dont il parle est extérieur à la philosophie – et que la philosophie n’est qu’une façon de s’y intéresser, parmi d’autres. Dès lors, il trouve déplacé d’entremêler des croyances extra philosophiques et des affirmations philosophiques. On peut deviner en le lisant qu’il est croyant ou non, mais ce ne sont pas ses croyances religieuses ordinaires qu’il examine, mais des surgissements ou des événements inouïs, des expériences de l’Absolu, des phénomènes saturés de sens.
Conclusion
5 Je remercie Philippe Capelle-Dumont, Frédéric Nef, Cyrille Michon et Nicholas Wolterstorff pour leu (...)
26
Les discours œcuméniques en philosophie affirment que même si prétentions et attentes sont apparemment différentes, la divergence des deux philosophies, analytique et continentale, n’est guère que ponctuelle et superficielle. Cela vaudrait aussi en matière de philosophie de la religion. La babélisme philosophique ne serait apparu que tardivement, par une incompréhension qui ne doit pas être prise trop au sérieux, et à laquelle il conviendrait de mettre fin au plus vite. Certains annoncent même une réconciliation générale. Je doute que ce babélisme soit récent, et que les raisons d’y mettre fin soient si généreuses que cela. La philosophie n’a vraisemblablement jamais eu beaucoup plus d’unité qu’elle n’en a aujourd’hui ; le clivage entre analytiques et continentaux est en réalité fort ancien ; il n’est pas contingent mais correspond à deux options intellectuelles fondamentales. Encore une fois, cette affirmation est différente d’un jugement de valeur systématique en faveur de la philosophie analytique. C’est plutôt l’idée d’une distinction radicale entre des prétentions et des attentes très différentes, qu’il s’agisse de Dieu ou d’autre chose. En tous les cas, s’agissait de philosophie de la religion, cette radicalité de la distinction ne me semble pas pouvoir être contestée5.
Haut de page
Bibliographie
William P. Alston, « Realism and the Christian Faith », International Journal for the Philosophy of Religion, 39, 1-3, 1995
Jacques Bouveresse, La demande philosophique. Que veut la philosophie et que peut-on vouloir d’elle ?, Paris : L’Éclat, 1996
Robin Le Poidevin, « Theistic Discourse and Fictional Truth », Revue Internationale de Philosophie (Analytic Philosophy of Relgion), n°3/2003
Thomas McCall & Michael C. Rea, Philosophical & Theological Essays in the Trinity, Oxford : Oxford University Press, 2009
Roger Pouivet, Philosophie contemporaine, Paris : Presses Universitaires de France, 2008
Roger Pouivet, « Review of N. Trakakis, The End of Philosophy of Religion », Philosophy in Review XXX (2010), no. 2. [ltr]http://journals.uvic.ca/index.php/pir[/ltr]
Roger Pouivet, « Against Theological Fictionalism », European Journal for Philosophy of Religion, vol. 3, nr 4, 2011
Roger Pouivet, « Le Dieu révélé et le droit de croire », Philippe Capelle-Dumont (éd.), Dieu en tant que Dieu, Paris : Les Éditions du Cerf, 2012
John L. Schellenberg, The Wisdom to Doubt. A Justification of Religious Skepticism, Ithaca : Cornell University Press, 2007
Nick Trakakis, The End of Philosophy of Religion, Londres, Continuum, 2008
Nicholas Wolterstorff, Practices of Belief, Cambridge : Cambridge University Press, 2010
Notes
1 Voir Schellenberg, 2007.
2 Pouivet, 2012.
3 Pouivet, 2011.
4 Une formule employée par Maxime Caron dans une interview qu’il a donnée au sujet de son livre La Vérité captive : < [ltr]http://mehdibelhajkacem.over-blog.com/c ... 48878.html[/ltr]>.
5 Je remercie Philippe Capelle-Dumont, Frédéric Nef, Cyrille Michon et Nicholas Wolterstorff pour leurs remarques sur ce texte.
Haut de page
Pour citer cet article
Référence électronique
Roger Pouivet, « Méta-philosophie de la religion », ThéoRèmes [En ligne], 2 | 2012, mis en ligne le 01 juillet 2012, consulté le 04 juin 2016. URL : [ltr]http://theoremes.revues.org/272[/ltr] ; DOI : 10.4000/theoremes.272
Haut de page
Auteur
Roger Pouivet
Université de Lorraine/LHSP-Archives Poincaré (CNRS)
Articles du même auteur
Sur la rationalité des croyances religieuses [Texte intégral]
Une discussion de Que peut-on faire de la religion ? de Jacques Bouveresse
Paru dans ThéoRèmes, 1 | 2011
Roger Pouivet
Qu’est-ce que la philosophie de la religion. Comment en faire ? La réponse à ces deux questions suppose aujourd’hui d’examiner la différence entre philosophie « continentale » et philosophie « analytique ». Par bien des aspects, la seconde reprend les problèmes de la métaphysique classique et prétend leur apporter de nouvelles réponses ou, plus souvent, les mêmes réponses sous de nouvelles formes. La première entend tirer de certains événements philosophiques jugés décisifs, particulièrement « la fin de la métaphysique », une façon très différente de parler de Dieu, si c’est jamais possible, et d’envisager l’expérience religieuse. Avons-nous alors affaire à deux domaines exclusifs, sans entre-deux ni dialogue possible, ou bien faut-il tenter une conciliation œcuménique des opposés ? Une méta-philosophie de la religion examine ce que veut la philosophie de la religion, qu’elle soit continentale ou analytique, et ce qu’on peut en attendre.
Mots-clés :philosophie analytique, philosophie continentale, méta-philosophie
Keywords :Analytic philosophy, continental philosophy, metaphilosophy
Qu’est-ce qu’une méta-philosophie de la religion ?
1
Un philosophe australien, Nick Trakakis, a récemment publié un livre intitulé The End of Philosophy of Religion. « Mon but, dit-il, sera de montrer que la tradition analytique en philosophie, du fait de son attachement aux normes scientifiques de rationalité et de vérité, est incapable de saisir la réalité transcendante se manifestant dans la pratique religieuse » [Trakakis 2008, p. 2]. Le livre est une charge dirigée contre la philosophie analytique de la religion et une apologie de la philosophie continentale de la religion. L’un des chapitres est intitulé « méta-philosophie de la religion » ; il compare philosophie continentale et philosophie analytique de la religion. Plutôt que de proposer une critique directe, ce que j’ai fait par ailleurs [Pouivet 2010], je vais présenter ma propre méta-philosophie de la religion.
2
Par « méta-philosophie », j’entends la réponse à la question formulée par Jacques Bouveresse : « Que veut la philosophie et que peut-on attendre d’elle ? » [Bouveresse 1996]. La question possède une signification descriptive et une signification évaluative. La première revient à demander : À quoi les philosophes prétendent-ils parvenir et leurs prétentions sont-elles justifiées ? Quelles sont les attentes de leurs auditeurs et de leurs lecteurs ? La seconde correspond aux questions suivantes : Les prétentions des philosophes sont-elles raisonnables ? Sont-elles intellectuellement honnêtes ? Les auditeurs et les lecteurs ont-ils raison d’avoir les attentes qu’ils entretiennent ? Peuvent-ils en toute honnêteté se déclarer satisfaits de ce que les philosophes leur proposent ? La distinction entre philosophie continentale et philosophie analytique s’impose alors parce qu’à ces questions-là les réponses des deux bords sont nettement différentes.
3
Quelques précautions dans l’usage de la distinction entre analytique et continental sont cependant indispensables. Premièrement, cette distinction n’est pas absolue. Il existe des zones neutres en quelque sorte ; et donc il existe autre chose en philosophie que ces deux pôles. Je pense en particulier à certains secteurs de l’histoire de la philosophie. Deuxièmement, cette distinction n’est pas géographique ; elle ne recouvre pas non plus la différence entre la pratique de la philosophie en langue anglaise et sa pratique en langue française ou allemande. Troisièmement, la précaution est d’importance, cette distinction ne se confond pas avec un jugement de valeur intellectuelle : ce n’est pas tout bon d’un côté et tout mauvais de l’autre. Cette distinction recouvre des prétentions philosophiques distinctes et des espoirs fort variés des auditeurs et des lecteurs. Ce sont ces précautions et ces espoirs que j’examine ici s’agissant de la philosophie de la religion.
Philosophie analytique et philosophie continentale
4
Dans un livre intitulé Philosophie contemporaine [Pouivet 2008], je fais reposer la comparaison entre philosophie continentale et philosophie analytique sur deux séries de caractéristiques :
Philosophes analytiques
Philosophes continentaux
Primat de l’argumentation
Primat des « visions »
Caractère direct des problématiques
Caractère oblique et historique des problématiques
Clarté, précision et minutie
Profondeur, largeur de vue et globalité
Littéralité des formulations
Recours à la métaphore, effort stylistique
Visée aléthique de la philosophie
Visée interprétative de la philosophie
5
Je me contente ici de mentionner ces deux séries, commentées dans mon livre. Mais pour mieux cerner ce qui est propre à la philosophie de la religion, j’ajoute d’autres distinctions :
Philosophie analytique de la religion
Philosophie continentale de la religion
Argumentation et rationalité
Perspective et généalogie
Primat de l’épistémologie
Primat de la phénoménologie et de la pratique
Réalisme ou Fictionnalisme
Antiréalisme
6
Ces deux séries ne composent pas seulement une différence cosmétique. C’est une opposition. Un peu de bonne volonté ou de compréhension de part et d’autre ne permet pas de la surmonter. Ce que prétendent faire le philosophe continental de la religion et son alter ego analytique, ce n’est vraiment pas la même chose. Les attentes que peuvent décemment entretenir leurs auditeurs et lecteurs sont nettement différentes.
7
Je me contenterai de citer deux séries de noms, afin de ne pas multiplier les références. La première de philosophes continentaux de la religion : John D. Caputo, Michel Henry, John Hick, Emmanuel Levinas, Dewi Z. Phillips, Jean-Luc Marion, Paul Ricœur, Nick Trakakis, Merold Westphal. La seconde de philosophes analytiques de la religion : William Alston, Peter Geach, Paul Helm, Anthony Kenny, Graham Oppy, Alvin Plantinga, Peter van Inwagen, Richard Swinburne, Nicholas Wolterstorff. Dans chaque cas, il faut ajouter « et bien d’autres ».
Perspective et généalogie vs argumentation et rationalité
8
Les philosophes continentaux pensent majoritairement que nous ne pouvons parvenir à une connaissance de la réalité qui ne soit pas une façon de nous la représenter. Dès lors, nous adoptons inévitablement une perspective sur la réalité ; ce qu’elle est « vraiment » nous échappe. Autrement dit, notre savoir serait relatif à un schème conceptuel. Il nous est difficile, voire impossible, de distinguer une description et une interprétation de la réalité. Toute interprétation comprend des intentions et des valeurs qui ne sont pas données, mais choisies ou préférées par ceux qui interprètent ; les philosophes seraient là, pensent beaucoup de philosophes continentaux, pour mettre au jour ses intentions et ses valeurs, liées à nos désirs et à nos appétits de pouvoir.
9
Le perspectiviste est ainsi dubitatif dès qu’on prétend s’assurer de la vérité d’une thèse et trouver des raisons objectives de l’entretenir. Il rejette à la fois la thèse selon laquelle la réalité nous est accessible et l’idée d’une raison désintéressée. Il met l’accent sur nos illusions épistémologiques et sur des récits donnant un sens à l’histoire. Il se présente comme le meilleur spécialiste pour saisir et apprécier la signification du moment où nous en sommes dans le développement de la pensée. Le philosophe continental parviendrait à manifester le sens caché, peut-être inavouable, des tentatives passées, chez les philosophes, mais aussi dans la théologie et les sciences, pour dire ce qu’est la réalité. Il se propose d’en fournir une compréhension en profondeur en manifestant leur sens latent.
10
Ayant renoncé à l’objectivité de la vérité fondée sur des arguments ou des raisons, le perspectiviste peut donner l’impression d’adopter une attitude sceptique et intellectuellement modeste. Toutefois, donner le sens profond de toute l’histoire de la pensée, c’est un scepticisme grandiose, solidaire d’une grande confiance herméneutique ; c’est au moins, on me l’accordera, d’une modestie toute relative. Le récit interprétatif du perspectiviste sera par exemple une interprétation de l’histoire de la philosophie médiévale et classique comme cosmo-théologie et onto-théo-logie, pour reprendre le vocabulaire kantien, c’est-à-dire comme continuité d’être du Créateur aux créatures. L’important serait de savoir où nous en sommes après l’achèvement de la métaphysique – un achèvement qui serait l’œuvre de Nietzsche et de Heidegger. Nous pensons après eux et donc nécessairement avec eux, dit-on. Pour sortir d’une métaphysique dite « de la présence », il faut alors déconstruire (dés-onto-théo-logiser) la pensée chrétienne. Rien de moins.
1 Voir Schellenberg, 2007.
11
À l’aune d’un tel programme, ce que prétendent faire la plupart des philosophes analytiques : reformuler d’anciennes thèses métaphysiques, reprendre les arguments en faveur de l’existence de Dieu, en les améliorant, si possible, du moins en tâchant de bien les comprendre, et poser la question de la justification épistémique (du droit de croire), cela peut semble bien naïf et vain. Pour le philosophe continental, la métaphysique et l’épistémologie sont achevées. Discuter un argument ontologique ou proposer une métaphysique de la Trinité avec les instruments de la logique contemporaine et toute la scolastique de la philosophie analytique, quel sens cela peut-il alors avoir ? Pourtant, le philosophe analytique de la religion reste imperturbablement confiant dans notre capacité de produire, sur la base d’arguments, des affirmations justifiées au sujet de Dieu, de ses attributs, de ses intentions, des valeurs chrétiennes, de la Trinité, de la Rédemption ou de l’Incarnation. Tout comme au bon vieux temps. Certes, il existe aussi une voie sceptique en philosophie analytique, mais elle est elle-même argumentative à souhait1.
12
Une distinction me semble ici utile entre deux types de confiance intellectuelle à l’œuvre dans l’activité philosophique : la confiance argumentative et la confiance herméneutique. La première consiste à accorder un large crédit aux procédures argumentatives. La seconde met surtout l’accent sur la découverte d’une interprétation jugée éclairante. Chez Marx, Freud, Lacan, Lévi-Strauss, après et avec eux, dans toute une partie de ce qu’on appelle « sciences humaines et sociales », bien sûr chez la plupart des philosophes continentaux de la religion, on trouve le présupposé de ne jamais prendre pour argent comptant ce que les gens en général et les philosophes en particulier disent quand ils formulent des thèses et proposent des arguments. Leurs motivations véritables, dit l’herméneute, ne sont pas leurs raisons déclarées et apparentes. Il faut d’abord savoir ce qu’elles signifient, voire ce qu’elles cachent. Méfiance donc, et vision pénétrante. En faisant une interprétation généalogique, on s’apercevrait par exemple que les preuves de l’existence de Dieu ont en réalité la fonction cachée, surtout à ceux qui les formulent, d’imposer une continuité entre Dieu (pensé comme un être) et ses créatures, avec toutes les conséquences, politiques entre autres, que cela peut avoir. Et du coup, discuter sérieusement de ces preuves ou tenter de les réfuter est totalement inutile. On doit dévoiler ce qu’elles sont en réalité : des dispositifs philosophiques et non des arguments plus ou moins bons.
13
Dans le monde païen, la divination était pratiquée par les oracles et les augures. Ce rôle est joué aujourd’hui par des philosophes ou certains spécialistes des sciences humaines. Ils ne « lisent » pas dans les abats d’animaux ou le vol des oiseaux, mais dans les œuvres du passé ou dans les événements historiques. Si nous n’admirons plus les devins, les philosophes continentaux sont appréciés pour leurs interprétations profondes. Cette description du rôle des intellectuels, et particulièrement de certains philosophes, ne doit pas être tenue pour ironique ou méprisante. Il existe une demande humaine constante pour une forme de révélation du fond caché des choses que les oracles à leur façon pratiquaient, et que pratiquent aujourd’hui, à la leur, les philosophes continentaux, et en particulier ceux qui parlent de religion. Si vraiment ils réalisent les exploits généalogiques dont on les crédite parfois, ils satisfont alors une attente que la philosophie analytique, s’agissant de religion ou de quoi que ce soit d’autre, ne peut pas satisfaire.
Phénoménologie et pratique vs épistémologie
14
Examinons d’autres aspects des prétentions respectives de la philosophie continentale et de la philosophie analytique de la religion, ainsi que d’autres types d’attente qu’elles sont supposées satisfaire.
15
La philosophie continentale de la religion est phénoménologique. Elle porte fondamentalement sur une expérience. Cela ne signifie pas que la philosophie continentale soit nécessairement une phénoménologie de la religion. D’abord parce que cela pourrait encore impliquer une extériorité philosophique à l’égard du contenu de cette expérience. En cherchant à en déterminer la valeur épistémique, la philosophie continuerait à s’interroger en termes de correspondance avec quelque chose, le divin. Or nous est-il souvent expliqué, nous ne pouvons pas faire l’expérience de Dieu comme infini. Cependant l'expérience religieuse témoigne de la possibilité du surgissement de l'événement et dès lors l'effectivité serait en avance sur la possibilité logique – c’est au moins ce que je peux lire chez l’un des meilleurs philosophe continental de la religion. J’avoue que l’idée d’une avance prise par l’effectivité sur la possibilité bouscule sérieusement ce que j’avais cru comprendre des modalités, et disons même que je ne saisis pas ce que cela veut dire ; mais la formule est saisissante. Nombre de philosophes continentaux me semblent penser que si nous ne baignons pas dans une phénoménalité mystérieuse, voire nébuleuse, nous nous éloignons de l’expérience religieuse, alpha et oméga de la religion. Le pire serait de prétendre lui faire jouer un simple rôle dans une procédure épistémologique de justification épistémique. D’où l’attrait dans la philosophie continentale pour certaines figures de la tradition mystique comme Pseudo-Denys, Maître Eckhardt, Saint François d’Assise, Saint Jean de la Croix. D’où aussi le recours à des phénomènes dits saturés, comme celui de « donation », quand il s’agit de parler de l’appréhension phénoménale d’un amour, agape, surpassant toute fixation ontologique et épistémologique. On ne peut pas définir en quelques mots la donation, pas plus que la différance derridienne ou le regard levinasien ; on ne peut même pas semble-t-il les définir du tout.
16
D’autres philosophes continentaux de la religion accordent à la pratique une fonction comparable à celle que les phénoménologues accordent à l’expérience. Le langage religieux, disent-ils, n’est pas un instrument avec lequel nous décrivons une réalité divine. C’est une pratique dans une forme de vie dont la théologie est une grammaire et non une théorie. Dès lors, la philosophe de la religion ne propose pas une explication, ontologique ou épistémologique, de son objet, Dieu ou la religion, mais elle explore des pratiques qui sont constitutives de la religiosité.
2 Pouivet, 2012.
17
En revanche, la philosophie analytique ne porte pas sur une phénoménalité propre de l’expérience religieuse, ni ne décrit des formes de vie. Elle ne se départit jamais d’une intention épistémologique et ontologique. C’est pourquoi la question de la justification des croyances religieuses y est centrale. Ces croyances peuvent résulter d’expériences qui en sont la source, voire les fondements ; et ces croyances sont parfois analysées dans le cadre de pratiques. Mais leur nature et leur spécificité sont évaluables, pour le philosophe analytique. Identifiant les croyances à des propositions, il s’interroge sur la possibilité qu’elles soient des conclusions d’arguments. La question de la légitimité épistémique d’une croyance en la révélation est la principale2.
18
L’attente est ainsi bien différente dans le cas de la philosophie continentale et de la philosophie analytique. Dans le premier cas, il s’agit d’une exploration du sens profond de certaines expériences ou de certaines pratiques. Dans le second cas, l’enquête relève d’une épistémologie normative et évaluative.
Anti-réalisme vs réalisme ou fictionnalisme
19
Venons-en finalement à l’opposition entre l’antiréalisme des continentaux et le réalisme des analytiques [Alston 1995]. Pour l’antiréaliste, un énoncé religieux ne fonctionne pas comme énoncé portant sur des faits (si jamais il y en a, car certains en doutent). L’énoncé religieux est lié, je l’ai déjà dit, à une expérience (pour les phénoménologues), à l’adoption d’une « forme de vie » (pour les néo-wittgensteiniens) ou à un récit (pour les néo-ricœuriens). Le discours religieux ne porte dès lors pas sur une réalité indépendante de notre vie phénoménale, de nos descriptions, croyances, théories, schèmes conceptuels.
20
Cela peut avoir des conséquences décisives au sujet de la vérité des énoncés religieux. Un antiréaliste pense que ce qui rend vrai p est toujours autre chose que p. En épistémologie, ce qui rend p vrai sera que p est vérifiable, confirmable, rationnellement acceptable, justifiable, compatible avec d’autres énoncés, etc. Dans le cas d’un énoncé religieux, ce sera plutôt une expérience, celle de la donation par exemple, ou ce sera une forme de vie, ou un récit. Dès lors, la notion de « vérité » ne renvoie pas à l’examen de critères de vérité et à ce qui rend vrai un énoncé. Elle signifie l’authenticité d’une expérience ou d’une forme de vie. Un énoncé religieux comme « Dieu nous aime et nous a créés afin que nous le connaissions » ne correspond pas à son amour pour nous. Il exprime une expérience ; il illumine et guide une vie. La philosophie de la religion fait la phénoménologie de cette expérience, des attitudes et des sentiments qui lui sont associés. Il est significatif que l’antiréaliste religieux mette entre guillemets tous les termes signifiant une réalité indépendante de notre expérience ou du langage. Dieu n’est pas jamais rencontré, mais il est « rencontré ». On doit parler de « Dieu » ou de Dieu ; on ne doit pas parler de Dieu. Car on ferait de lui un objet, comme une table ou chaise.
21
En revanche, le réaliste accepte ce schéma d’équivalence : p est vrai si et seulement si p. Dès lors, « Le Christ est ressuscité » si et seulement si le Christ est ressuscité. C’est pourquoi le théisme et l’athéisme sont, en philosophie de la religion, les meilleurs ennemis. Car ils ont la même prétention, simplement inversée. Dieu existe, dit l’un ; pas du tout pense l’autre. L’antiréaliste pour sa part pense que ce n’est pas ainsi qu’il convient de poser le problème, en termes d’existence d’un être ou de l’Être, et il se fait fort de sortir de la « métaphysique de la présence ».
3 Pouivet, 2011.
22
Cependant un philosophe analytique peut fort bien être antiréaliste. Alors, pourquoi cela ne serait-il pas possible en matière de philosophie de la religion ? Par exemple, une conception fictionnaliste affirme que le discours théologique, et la pratique religieuse en général, nous engage dans une forme de simulation (make-believe) [Le Poidevin 2003]. Pour le fictionnaliste religieux, il est vrai-dans-religion-chrétienne que, disons, Dieu s’est fait homme. Une telle théorie de la vérité fictionnelle affirme que ce qui rend fictionnellement vrai que p, c’est que p-dans-la-fiction. Certes, il existe un antiréalisme analytique en matière de philosophie de la religion. Mais il sert en réalité à défendre une version de l’athéisme. Vrais-dans-une-fiction, les énoncés religieux peuvent encore être importants pour nous, comme le sont certains romans ou certains films, mais ils ne sont pas vrais (ni faux peut-être)3. Cette conception est très différente d’un perspectivisme généralisé ; surtout elle est différente sur le fond de l’antiréalisme continental en philosophie de la religion ou de la critique de la « métaphysique de la présence ».
4 Une formule employée par Maxime Caron dans une interview qu’il a donnée au sujet de son livre La Vé (...)
23
On lit des philosophes analytiques de la religion pour savoir s’il est possible de justifier la vérité d’un énoncé comme « La Trinité est un seul Dieu en trois personnes », et comment. La Trinité est un mystère bien sûr. Mais l’affirmation que « La Trinité est un seul Dieu en trois personnes » n’en offre pas moins, pour le philosophe analytique, la possibilité d’une discussion rationnelle. Ainsi, ces derniers temps, les philosophes analytiques de la religion s’opposent au sujet de trois conceptions de la Trinité [McCall & Rea 2009]. Le « trinitarisme social » affirme qu’aucune personne divine ne peut exister indépendamment des autres personnes. Récemment elle a été défendue à l’aide d’une logique des touts et de parties (méréologie). Le « trinitarisme latin » applique à la question de la Trinité la théorie ontologique des tropes et la métaphysique des parties temporelles. Le « trinitarisme relatif » se fonde sur une théorie relativiste de la vérité – relativiste au sens logique où toute identité est relative à une sorte, non pas au sens où chacun aurait sa vérité. Je n’entre dans aucune des délicieuses complexités de ces trois conceptions et dans le débat scolastique entre les défenseurs de chacune d’elles. Seul le contraste avec l’attitude continentale m’importe ici. Le philosophe continental mettra lui l’accent sur le sens que peut avoir pour nous la Trinité. Voici une formule représentative : « Le Transcendant est la Différence fondamentale dont l’infinité de Gloire est infiniment démultipliée en Trinité »4. C’est un peu obscur non ? Ne serait-ce que parce qu’une démultiplication infinie en Trinité suppose une drôle d’arithmétique, pas classique en tous les cas. Quand le philosophe continental s’intéresse à la signification que la Trinité peut avoir dans le Devenir, ou à son rôle dans une expérience religieuse ou une pratique religieuse, le philosophe analytique continue de s’interroger sur l’intelligibilité d’un seul Dieu en trois personnes.
La philosophie analytique de la religion est une philosophie de croyants et d’incroyants
24
Revenons sur la différence entre les prétentions et les attentes divergentes des philosophes analytiques et des philosophes continentaux. Quand on lit un philosophe analytique de la religion, qu’il est croyant, catholique ou calviniste par exemple, c’est immédiatement clair. Car ses analyses philosophiques partent en général de ses croyances religieuses. Il entend montrer qu’il est autorisé – Nicholas Wolterstorff en anglais dirait « entitled » [Wolterstorff 2010] – à les avoir. Ou à l’inverse, il défend l’agnosticisme (Anthony Kenny) ou l’athéisme (J.L. Mackie ou Graham Oppy), et c’est tout aussi clair. Les philosophes analytiques déploient volontiers leurs bannières et pour eux la philosophie consiste à expliciter et à justifier ce que l’on croit. Ils n’avancent pas masqués. En revanche, la pratique de la philosophie continentale de la religion semble détachée d’une « appartenance » religieuse, mais aussi de l’agnosticisme ou de l’athéisme. Elle semble avoir pour finalité la philosophie pour elle-même et ne se présente que fort rarement comme la défense ou la critique de certaines croyances, religieuses ou autres.
25
La philosophie analytique de la religion est une philosophie de croyants ou d’incroyants. En revanche, les philosophes continentaux, même s’ils sont croyants, disent rarement : « Je suis croyant et je vais expliquer ce qui m’autorise à l’être » ; ou bien : « Je crois en la sainte Trinité, et cela n’a rien d’aberrant ». Pourquoi ? Parce que le philosophe continental rejette l’idée que ce dont il parle est extérieur à la philosophie – et que la philosophie n’est qu’une façon de s’y intéresser, parmi d’autres. Dès lors, il trouve déplacé d’entremêler des croyances extra philosophiques et des affirmations philosophiques. On peut deviner en le lisant qu’il est croyant ou non, mais ce ne sont pas ses croyances religieuses ordinaires qu’il examine, mais des surgissements ou des événements inouïs, des expériences de l’Absolu, des phénomènes saturés de sens.
Conclusion
5 Je remercie Philippe Capelle-Dumont, Frédéric Nef, Cyrille Michon et Nicholas Wolterstorff pour leu (...)
26
Les discours œcuméniques en philosophie affirment que même si prétentions et attentes sont apparemment différentes, la divergence des deux philosophies, analytique et continentale, n’est guère que ponctuelle et superficielle. Cela vaudrait aussi en matière de philosophie de la religion. La babélisme philosophique ne serait apparu que tardivement, par une incompréhension qui ne doit pas être prise trop au sérieux, et à laquelle il conviendrait de mettre fin au plus vite. Certains annoncent même une réconciliation générale. Je doute que ce babélisme soit récent, et que les raisons d’y mettre fin soient si généreuses que cela. La philosophie n’a vraisemblablement jamais eu beaucoup plus d’unité qu’elle n’en a aujourd’hui ; le clivage entre analytiques et continentaux est en réalité fort ancien ; il n’est pas contingent mais correspond à deux options intellectuelles fondamentales. Encore une fois, cette affirmation est différente d’un jugement de valeur systématique en faveur de la philosophie analytique. C’est plutôt l’idée d’une distinction radicale entre des prétentions et des attentes très différentes, qu’il s’agisse de Dieu ou d’autre chose. En tous les cas, s’agissait de philosophie de la religion, cette radicalité de la distinction ne me semble pas pouvoir être contestée5.
Haut de page
Bibliographie
William P. Alston, « Realism and the Christian Faith », International Journal for the Philosophy of Religion, 39, 1-3, 1995
Jacques Bouveresse, La demande philosophique. Que veut la philosophie et que peut-on vouloir d’elle ?, Paris : L’Éclat, 1996
Robin Le Poidevin, « Theistic Discourse and Fictional Truth », Revue Internationale de Philosophie (Analytic Philosophy of Relgion), n°3/2003
Thomas McCall & Michael C. Rea, Philosophical & Theological Essays in the Trinity, Oxford : Oxford University Press, 2009
Roger Pouivet, Philosophie contemporaine, Paris : Presses Universitaires de France, 2008
Roger Pouivet, « Review of N. Trakakis, The End of Philosophy of Religion », Philosophy in Review XXX (2010), no. 2. [ltr]http://journals.uvic.ca/index.php/pir[/ltr]
Roger Pouivet, « Against Theological Fictionalism », European Journal for Philosophy of Religion, vol. 3, nr 4, 2011
Roger Pouivet, « Le Dieu révélé et le droit de croire », Philippe Capelle-Dumont (éd.), Dieu en tant que Dieu, Paris : Les Éditions du Cerf, 2012
John L. Schellenberg, The Wisdom to Doubt. A Justification of Religious Skepticism, Ithaca : Cornell University Press, 2007
Nick Trakakis, The End of Philosophy of Religion, Londres, Continuum, 2008
Nicholas Wolterstorff, Practices of Belief, Cambridge : Cambridge University Press, 2010
Notes
1 Voir Schellenberg, 2007.
2 Pouivet, 2012.
3 Pouivet, 2011.
4 Une formule employée par Maxime Caron dans une interview qu’il a donnée au sujet de son livre La Vérité captive : < [ltr]http://mehdibelhajkacem.over-blog.com/c ... 48878.html[/ltr]>.
5 Je remercie Philippe Capelle-Dumont, Frédéric Nef, Cyrille Michon et Nicholas Wolterstorff pour leurs remarques sur ce texte.
Haut de page
Pour citer cet article
Référence électronique
Roger Pouivet, « Méta-philosophie de la religion », ThéoRèmes [En ligne], 2 | 2012, mis en ligne le 01 juillet 2012, consulté le 04 juin 2016. URL : [ltr]http://theoremes.revues.org/272[/ltr] ; DOI : 10.4000/theoremes.272
Haut de page
Auteur
Roger Pouivet
Université de Lorraine/LHSP-Archives Poincaré (CNRS)
Articles du même auteur
Sur la rationalité des croyances religieuses [Texte intégral]
Une discussion de Que peut-on faire de la religion ? de Jacques Bouveresse
Paru dans ThéoRèmes, 1 | 2011
 Re: Religion et Philosophie
Re: Religion et Philosophie
La critique philosophique de la religion au XVIIIème siècle.

Mark Sherringham, directeur de l'IUFM d'Alsace
Le XVIIIème siècle européen a eu l'ambition de penser d'une façon nouvelle les rapports de la raison avec le christianisme en particulier, et les religions en général. Cet effort audacieux de remise en question et de clarification est inséparable de l'entrée dans une nouvelle phase du processus de constitution de notre modernité, qui n'a pas été sans affrontements ni polémiques, parfois d'une grande violence. Mais le siècle des Lumières s'est aussi montré capable de dégager, autour de la question de la religion, des principes, des problèmes et des essais de solution dont nous sommes, à plus d'un titre, les héritiers, et qui peuvent nous alerter, aujourd'hui encore, sur les impasses à éviter et les perspectives qui méritent d'être parcourues plus profondément.
Le procès de Dieu
L'ouvrage qui ouvre l'espace intellectuel du XVIIIème siècle dans son rapport à la religion est la Théodicée de Leibniz, paru en 1710. Voltaire ne s'y était pas trompé, puisqu'il tente à sa manière de le neutraliser à travers le récit des aventures imaginaires de son Candide. Mais, en réalité, si Voltaire s'oppose à Leibniz sur la solution, il partage avec lui la position du problème. Dieu se trouve convoqué devant le Tribunal de la raison humaine pour se justifier de l'existence du mal. Peu importe que l'accusé soit disculpé ou reconnu coupable, l'audace inaugurale réside bien dans la mise en accusation de Dieu. Ainsi le XVIIIème siècle, qui commence avec le procès de Dieu, culminera dans le procès du roi. Dans les deux cas, il s'agit d'un procès politique et moral. Le roi se trouve accusé d'avoir trahi la Révolution qu'il avait en apparence acceptée. Dieu se trouve accusé d'avoir mal gouverné le monde en autorisant le mal, alors que sa toute-puissance et sa sagesse auraient dû permettre de le rendre inutile et inexistant. La question du mal, à l'aube du XVIIIème siècle, au lieu d'interroger prioritairement l'homme, se retourne contre Dieu, qui est désigné, sinon comme son auteur, du moins comme son complice.
Le lieu même de ce procès doit être souligné. Il s'agit bien de la morale ou de la politique, et pas d'abord de la science. Aux XVIIème et XVIIIème siècles, le sentiment de la solidarité entre l'existence de Dieu et la possibilité de la science de la nature reste largement partagé. Descartes exprime bien ce qu'on pourrait appeler l'opinion dominante des savants de son temps, et même du siècle suivant, quand il pose Dieu comme le garant des vérités éternelles et la condition de possibilité de la science de la nature. Bien sûr, les "libres-penseurs"du siècle classique et les philosophes "matérialiste" du siècle des Lumières maintiennent vivante l'antique tradition épicurienne. Quant à Spinoza, posant au commencement de son Éthiquel'identité de Dieu et de la nature, il retrouve, contre la science des modernes, la position grecque de la divinité de la nature. Mais majoritairement, les modernes, en science comme en philosophie, continuent de percevoir, par delà le procès emblématique de Galilée, à quel point le Dieu chrétien, délivré de son habillage grec et scolastique grâce à la Réforme protestante, rend théoriquement possible la science de la nature pour au moins deux raisons : la "dé-divinisation"de la nature qu'opère le retour à la séparation biblique de la création et du créateur, et la garantie divine de la régularité et de l'unité des lois naturelles, qui rend la connaissance de la nature accessible à l'esprit humain. C'est justement la prise au sérieux du motif biblique de la création, dans sa double dimension de séparation entre Dieu et la nature et de fondation de la nature sur l'intelligence divine, qui permet à Descartes d'énoncer l'ambition moderne : devenir "maître et possesseur de la nature ".
En revanche, dans le domaine politico-moral, la gouvernance de Dieu va se trouver fondamentalement remise en question. Sans doute peut-on mieux comprendre ce processus si l'on se réfère, là aussi, au développement de la Réforme en Europe. Le protestantisme, grâce au retour à la vision biblique du monde contre la cosmologie et la physique héritées d'Aristote, auxquelles s'était parfois identifiée l'Église romaine, a globalement favorisé l'essor de la science moderne. Mais, dans le domaine moral, la Réforme contredit ouvertement la valeur humaniste de la liberté humaine, avec laquelle le catholicisme parvient plus facilement à transiger. C'est d'abord Luther qui s'oppose à Érasme avec son Traité du serf-arbitre, et c'est ensuite Calvin qui fonde l'interprétation stricte de la double prédestination sur le respect scrupuleux de l'Écriture sainte. Le "scandale" de la prédestination, qui semble annuler tout le libre-arbitre de l'homme, me semble être la cause profonde du procès fait à Dieu par la raison moderne. Si tout dépend de la volonté divine, si l'humanité ne peut rien décider sans l'autorisation divine, si l'individu ne peut rien entreprendre qui ne soit déjà prévu par Dieu, ne devient-il pas logique et légitime de demander des comptes à un tel maître, de lui demander raison du mal qu'il autorise pour sa plus grande gloire ? La réaction contre le calvinisme, dans ce qu'il a de plus "réactionnaire"par rapport à la modernité, dans ce qu'il a de plus paradoxal par rapport à la liberté des modernes, alimente le procès de Dieu.
Ce procès connaîtra trois phases : le premier moment est dominé par la réponse leibnizienne. Grâce à la distinction faite dans la Théodicée entre le mal métaphysique, le mal moral et le mal physique, Leibniz parvient à innocenter Dieu ou, en tous cas, à aboutir à un non-lieu. En aucune façon l'être divin ne peut être tenu pour la cause directe du mal physique et moral, même si, dans sa sagesse suprême qui veut le meilleur des mondes possibles, il est amené à autoriser une certaine quantité de ces deux types de maux, dans la mesure exacte où ils se révèlent indispensables à la réalisation du meilleur état possible de l'univers. Seul le mal métaphysique, c'est-à-dire l'imperfection et la limitation inhérentes à la notion même de créature, est la conséquence directe de la volonté de Dieu comme créateur du monde. Malheureusement le plaidoyer de Leibniz souffre de trois défauts majeurs. Tout d'abord, il abandonne la position chrétienne du "mystère"du mal, en faisant dépendre l'innocence de Dieu de la nécessité paradoxale du mal qui trouve son fondement dans l'être divin lui-même en tant qu'il a décidé de créer le monde et l'a voulu le meilleur possible. Si l'on suit Leibniz, la nécessité du mal est inscrite dans la bonté même de Dieu. Mais Leibniz abandonne également la position chrétienne du "scandale" du mal, qui doit demeurer toujours absolument injustifiable, et que seule peut vaincre la passion du Christ sur la croix. Enfin la solution leibnizienne, malgré sa finesse conceptuelle, résistera difficilement à l'ironie d'un Voltaire ou à l'incompréhension qui suit le tremblement de terre de Lisbonne.
Commence alors un procès en appel, qui sera instruit par Hume. Dans ses Dialogues sur la Religion naturelle, qui paraissent en 1779 (mais qui ont été rédigés autour de 1750), Hume attaque à la fois la gouvernance de Dieu et son existence. Il y a donc radicalisation et généralisation de l'acte d'accusation. De la question de l'existence du mal, on passe à la question de l'(in)existence de Dieu. Par ailleurs, la gouvernance de Dieu n'est plus seulement examinée par rapport au mal moral, mais aussi par rapport à la cohérence et à l'unité du monde physique. De même que Hume avait sapé les fondements de la science moderne en s'attaquant au principe de causalité, ramené à une simple croyance fondée sur l'habitude, de même il s'attaque à la relation même de Dieu à la nature et au monde en critiquant la notion de finalité. En réalité, nous fait comprendre Hume, l'action divine sur la nature, "la marque de Dieu sur son ouvrage ", n'est pas aussi visible ou lisible qu'on veut bien le dire. La Religion naturelle, comprise comme la croyance en l'existence d'un Dieu créateur du monde, ne peut pas être prouvée à partir des caractéristiques de la nature ou de la raison humaine. Tout ce qu'on peut admettre est une "lointaine analogie"entre la raison humaine et la cause productrice de la nature : "Le tout de la théologie naturelle, comme quelques-uns semblent le soutenir, se résout en une seule proposition, simple, quoique assez ambiguë, ou du moins indéfinie, que la cause ou les causes de l'ordre de l'univers présentent probablement quelque lointaine analogie avec l'intelligence humaine […]."[ltr]1[/ltr]
Pour autant, Hume ne conclut pas à l'inexistence de Dieu, mais il se contente de relever le fait que le désordre moral et physique du monde rend l'affirmation de l'existence de son créateur assez difficile à percevoir. Au contraire, sa déconstruction sceptique des preuves de l'existence de Dieu se termine par un appel, qui n'est pas seulement ironique, même s'il demeure paradoxal, à la Révélation divine : "Mais croyez-moi, Cléanthe, le sentiment le plus naturel qu'un esprit bien disposé puisse éprouver en cette occasion, est une attente ardente et un vif désir qu'il plaise au ciel de dissiper, ou du moins d'alléger, cette profonde ignorance, en accordant à l'humanité quelque révélation plus particulière et en lui découvrant quelque chose de la nature, des attributs et des opérations du divin objet de notre foi. Toute personne pénétrée d'un juste sentiment des imperfections de la raison humaine se précipitera avec la plus grande avidité vers la vérité révélée."[ltr]2[/ltr]
La deuxième phase du procès de Dieu aboutit donc à ce que Hume appelle "un juste sentiment des imperfections de la raison humaine ". Le jugement de Dieu aboutit à la confirmation de la condamnation sceptique de la raison. Celle-ci doit reconnaître sa faiblesse et ses limites, du fait même de sa confrontation à un divin à la fois insaisissable et indécidable. On est loin du triomphe de la raison comme marque distinctive d'un optimisme des Lumières qui n'a sans doute jamais vraiment existé. Face à une nature incohérente, confrontée à une histoire qui voit trop souvent triompher la folie des hommes, sommée de s'expliquer avec un Dieu caché et incompréhensible, la raison est forcée de reconnaître sa faiblesse. Tel est le premier résultat du rationalisme sceptique de Hume.
Le troisième acte du procès de Dieu - qui est aussi devenu le procès de la raison - commence avec Kant. En partisan affirmé des Lumières et en observateur attentif de son siècle, il perçoit parfaitement le danger. La justification de Dieu par la raison, à la suite de Leibniz ou de Locke, n'emporte pas l'adhésion, et tend à affaiblir la position de la divinité qu'elle visait pourtant à renforcer. Quant au questionnement sceptique de Dieu, à la suite de Hume, il aboutit au constat que la raison est amenée à faire de sa propre imperfection. Le bilan des Lumières apparaît alors comme bien peu satisfaisant, nous laissant le choix entre un Dieu affaibli et une raison épuisée. Pour échapper à ce dilemme, il convient de repenser le procès de Dieu sur de nouvelles bases. Devant le "Tribunal de la raison humaine", Kant procède à un double retournement.
En premier lieu, la charge de la preuve repose dorénavant sur la raison. Le tribunal kantien est d'abord ce lieu où la raison se juge elle-même. Il lui revient de définir ses propres limites. En examinant ce que Kant appelle, dans sa Critique de la raison pure, la "dialectique de la raison ", il devient évident, si du moins l'on accepte les prémisses kantiennes, que les trois types possibles de preuves de l'existence de Dieu (la preuve ontologique, la preuve cosmologique et la preuve physico-théologique) manquent nécessairement leur but à cause de la nature des facultés humaines de connaissance. C'est que Dieu n'est pas un objet possible de l'intuition sensible, et qu'il ne peut pas se comprendre à partir des catégories de l'entendement. Du point de vue de la raison théorique, il est précisément une "Idée régulatrice"ou un "Idéal ", mais en aucune façon l'objet d'une connaissance possible. De Dieu, la raison ne peut prouver, ni qu'il existe, ni qu'il n'existe pas. Mais l'aveu d'incompétence de la raison théorique devant la question de Dieu aboutit, paradoxalement en apparence, à l'affirmation de la toute-puissance du sujet humain de la connaissance par rapport à la nature. Si Laplace pourra affirmer que Dieu est devenu une hypothèse inutile, c'est justement parce que Kant avait installé le sujet transcendantal à la place du Dieu transcendant dans le rapport théorique ou scientifique à la nature. Si la raison théorique ne peut plus affirmer ou nier l'existence de l'être divin, elle devient la source unique de l'ordre et de l'unité de la nature connaissable. Dieu se trouve bien remplacé par la raison, mais la fonction divine par rapport à la connaissance scientifique de la nature demeure indispensable. La science de la nature ne peut pas se passer d'un garant.
Le second retournement qu'opère Kant concerne la morale. A la mise en cause de l'être divin par l'existence du mal répond maintenant le postulat de l'existence de Dieu par la raison pratique ou la volonté bonne. L'homme moral est en droit d'attendre de Dieu qu'il existe. Le bonheur qu'il peut légitimement espérer rend nécessaire le recours à l'Être suprême et à l'immortalité de l'âme. L'exercice de la liberté humaine, ou plutôt l'idée de la liberté de la volonté, fonde le besoin de Dieu qu'éprouve la raison. Celui-ci doit exister parce que l'homme est capable de moralité.
Finalement, à travers ce double retournement, la philosophie critique aboutit à la justification pratique de l'existence de Dieu et à la limitation théorique de la raison humaine à la connaissance de la nature. Ce faisant, Kant donne raison à Leibniz sur l'innocence divine, mais sans avoir besoin de recourir à l'argument du meilleur des mondes possibles, c'est-à-dire en évitant à la raison humaine de se placer au point de vue de Dieu. Kant donne aussi raison à Hume sur l'impossibilité des preuves de l'existence de Dieu, mais sans mettre en question la capacité de la raison à connaître la nature. Le procès se termine par un accord qui scelle une séparation théorique et une solidarité pratique entre le divin et l'humain. Séparation et solidarité qui, dans l'esprit de la philosophie kantienne, laisse s'ouvrir une nouvelle ère de paix perpétuelle, délivrée des conflits qu'entraînent les positions philosophiques du dogmatisme et du scepticisme. À travers la "paix critique ", le XVIIIème siècle découvre que la raison humaine peut se vouloir à la fois indépendante et solidaire de l'Être suprême.
La Révélation devant la Raison
Se pose alors avec une urgence nouvelle la question du statut de la Révélation religieuse, c'est-à-dire de la possibilité d'une relation à Dieu qui ne dépende pas de la raison des hommes. C'est la notion même de Révélation, ainsi que le contenu spécifique des dogmes chrétiens, qui vont se trouver mis en question. Le XVIIIème siècle lira avec avidité le Traité des trois imposteurs, dont l'origine demeure incertaine, puisqu'on l'attribue aussi bien à Frédéric II de Hohenstauffen que, plus récemment, à Spinoza ou à l'un de ses disciples. La notion de révélation s'y trouve entièrement ramenée à un projet politique de domination : "Les ambitieux, qui ont toujours été de grands maîtres en l'art de fourber, ont tous suivi la même route dans l'établissement de leurs lois. Pour obliger le peuple à s'y soumettre de lui-même, ils l'ont persuadé, à la faveur de l'ignorance qui lui est naturelle, qu'ils les avaient reçues ou d'un dieu ou d'une déesse."[ltr]3[/ltr]
La démonstration de cette imposture des fondateurs de religion au service de leur ambition politique est faite successivement pour Moïse, Numa-Pompilius, Jésus-Christ et Mahomet. Tous apparaissent comme des précurseurs du Prince de Machiavel (même si le Christ rentre plus difficilement dans ce rôle), incarnations exemplaires d'une volonté de puissance hostile à la vie et à la vérité. De leur côté, Diderot, dans ses Pensées philosophiques de 1746 et l'Addition de 1770, et Voltaire, dans son Dictionnaire philosophique de 1764, prennent le parti de mettre en évidence les "absurdités"de toute religion qui se prétend révélée, et du christianisme en particulier. Leurs armes essentielles sont l'ironie, la dérision ou l'indignation. Il n'est aucun des artifices des créateurs de religion en général, ni des dogmes ou des articles de foi de la religion chrétienne, qui ne se trouvent pris d'assaut et dénoncés sans pitié. Ainsi Diderot : "Tous les peuples ont de ces faits, à qui, pour être merveilleux, il ne manque que d'être vrais ; avec lesquels on démontre tout, mais qu'on ne prouve point ; qu'on n'ose nier sans être impie, et qu'on ne peut croire sans être Imbéc...."[ltr]4[/ltr]
Ainsi Voltaire : "Après notre sainte religion, qui sans doute est la seule bonne, quelle serait la moins mauvaise ? Ne serait-ce pas la plus simple ? Ne serait-ce pas celle qui enseignerait beaucoup de morale et très peu de dogmes ? celle qui tendrait à rendre les hommes justes sans les rendre absurdes ? celle qui n'ordonnerait point de croire des choses impossibles, contradictoires, injurieuses à la Divinité et pernicieuses au genre humain, et qui n'oserait point menacer des peines éternelles quiconque aurait le sens commun ? Ne serait-ce point celle qui ne soutiendrait pas sa créance par des bourreaux, et qui n'inonderait pas la terre de sang pour des sophismes inintelligibles ? celle dans laquelle une équivoque, un jeu de mots, et deux ou trois chartes supposées ne feraient pas un souverain et un dieu d'un prêtre souvent incestueux, homicide et empoisonneur ? celle qui ne soumettrait pas les rois à ce prêtre ? celle qui n'enseignerait que l'adoration d'un Dieu, la justice, la tolérance et l'humanité ? "[ltr]5[/ltr]
Mais ce faisant, il faut le remarquer, Voltaire et Diderot n'inaugurent pas vraiment une ère nouvelle dans les relations entre la philosophie et les religions, même s'ils placent avec passion et éloquence le geste philosophique sous la bannière de la dénonciation de la religion. On assiste plutôt à la réactivation des éléments de polémique anti-religieuse déjà présents dans la philosophie grecque classique ainsi que dans la réaction païenne qui s'était développée, au début de l'ère chrétienne, autour de Celse, du néo-platonisme et des tentatives de restauration de Julien l'Apostat. C'est donc un très ancien fond de refus et d'indignation qui resurgit ici, et pas du tout le résultat d'un nouveau positionnement de la raison moderne ou du progrès intellectuel de la compréhension scientifique du monde. Au contraire, Diderot lui-même souligne que la science moderne contredit le "matérialisme ", et encourage la croyance d'origine chrétienne en un dieu créateur de la nature : "Ce n'est que dans les ouvrages de Newton, de Musschenbroek, d'Hartsoeker et de Nieuwentyt, qu'on a trouvé des preuves satisfaisantes de l'existence d'un être souverainement intelligent. Grâce aux travaux de ces grands hommes, le monde n'est plus un dieu : c'est une machine qui a ses roues, ses cordes, ses poulies, ses ressorts et ses poids."[ltr]6[/ltr]
Comme chez Descartes, se maintient ici la solidarité moderne entre la création divine et le mécanisme de la nature. La nouveauté ne réside pas non plus dans l'accusation portée contre l'absurdité de la Révélation chrétienne aux yeux de la raison philosophique traditionnelle - c'était déjà un lieu commun de l'apologétique des Pères de l'Église. La part moderne de cette polémique réside avant tout dans la reprise des arguments de Luther ou de Calvin contre le pouvoir des Papes, ainsi que de ceux de Bayle et de Locke en faveur de la tolérance dans le domaine de la foi religieuse. Dans cette perspective, à la dénonciation ancienne et passablement ambiguë de l'absurdité de toute Révélation vient s'ajouter l'appel plus proprement moderne à la lutte contre le pouvoir temporel et spirituel de Rome et à la tolérance de l'État en matière de religion.
Toutefois, le XVIIIème siècle explore encore une autre voie dans sa volonté de rendre compte de la Révélation : il s'agit de la tentative de réduire celle-ci à son noyau rationnel. Là non plus, l'innovation n'est pas, en apparence, radicale. La question des relations de la raison humaine et de la Révélation biblique est posée depuis les Pères de l'Église, et nombreux furent ceux qui montrèrent l'accord profond de la raison et de la révélation, comme Saint Thomas ou Maïmonide. Cependant, il reviendra à Kant de porter à son point culminant l'ambition du XVIIIème siècle, non pas seulement d'harmoniser raison et révélation, mais bien d'inclure la Révélation chrétienne dans le cadre de la raison humaine, et plus précisément de soumettre complètement le dogme au libre examen de la raison. Dorénavant, ce n'est plus la Révélation qui est la "pierre de touche"de la raison, mais bien la raison qui prétend dicter ses lois à la Révélation. Dans l'un de ses derniers ouvrages, Le conflit des Facultés, publié en 1798, Kant résume la nouvelle relation de la philosophie et de la théologie qu'il appelle de ses vœux, en reprenant la formule célèbre : "On peut aussi, sans doute, concéder à la Faculté de Théologie l'orgueilleuse prétention de prendre la Faculté de philosophie pour sa servante, mais alors la question subsiste toujours de savoir si celle-ci précède avec la torche sa gracieuse Dame, ou si elle la suit portant la traîne […]."[ltr]7[/ltr]
Dans le contexte de la réaction contre les principes des Lumières, qui suivit en Prusse la mort de Frédéric II et qu'amplifia le déroulement de la Révolution française, Kant cherche à déterminer les rapports légitimes entre la Théologie et la Philosophie, de façon à assurer les droits de la raison humaine. Le conflit des deux Facultés à l'intérieur de l'espace de l'Université renvoie à la distinction de deux principes que Kant désigne comme "la foi d'Église"et "la foi religieuse ". La première repose "sur des statuts, c'est-à-dire des lois dérivant de la volonté d'un autre"[ltr]8[/ltr]. La seconde renvoie, au contraire, à "des lois intérieures qui peuvent se déduire de la raison propre de tout homme"[ltr]9[/ltr]. Cette distinction, qui permet d'opposer le travail du "docteur de la loi"à celui du "savant de la raison"dérive directement de la séparation, propre à la philosophie kantienne, des principes d'hétéronomie et d'autonomie. Le théologien accepte de placer la volonté de l'homme sous l'autorité d'un Dieu extérieur, le philosophe des Lumières pense la divinité comme la loi de la raison pratique qui s'inscrit tout entière dans l'intériorité de l'humain.
Ainsi compris, le concept kantien de la religion ne renvoie plus "au contenu de certains dogmes considérés comme révélation divine (ceci, c'est la théologie), mais à celui de tous nos devoirs en général en tant que commandements divins (subjectivement, de la maxime de s'y conformer comme tels)"[ltr]10[/ltr]. La religion est donc identique, dans son contenu, à la morale. Elle en diffère seulement par la forme, en ce qu'elle présente les lois de la raison pratique comme l'expression de la volonté divine, de façon à en faciliter l'accomplissement par la volonté humaine. Dans cette perspective, le christianisme est la foi d'Église qui "convient le mieux"à la religion de la raison. "Or, celui-ci se trouve, dans la Bible, composé de deux parties dissemblables : l'une, qui contient le canon, et l'autre l'organon ou véhicule de la religion ; le premier peut être appelé la pure foi religieuse (fondée sans statuts, sur la simple raison), et l'autre la foi de l'Église qui, tout entière, repose sur des statuts, exigeant une révélation, pour être regardés comme un enseignement et des préceptes sacrés."[ltr]11[/ltr]
De cette définition du christianisme biblique se déduisent les principes philosophiques de l'exégèse scripturaire qui sont au nombre de trois : tout d'abord, les passages de l'Écriture qui contiennent des dogmes théoriques dépassant tout concept rationnel, comme la Trinité ou l'Incarnation, doivent toujours être ramenés à leur contenu rationnel - ici, par exemple, l'idée de la personne et celle de l'humanité. Contre l'horizon d'une Révélation imaginée comme un au-delà de la raison, Kant affirme l'immanence de la première à l'intérieur du cadre de la seconde, c'est-à-dire l'inscription de la Révélation dans les limites de la simple raison. Ensuite, il convient d'affirmer que la foi en des dogmes scripturaires n'a aucun mérite en soi. Dans la vraie religion (morale), le doute à propos du dogme n'est pas une faute. Seul compte l'agir conforme à la moralité. Contre la foi, Kant affirme l'unique valeur des "œuvres ". Enfin, l'action humaine doit toujours être présentée comme résultant de l'usage particulier que l'homme fait de ses forces morales, sans recours à l'intervention divine. Contre la grâce divine, Kant soutient l'autosuffisance de la raison humaine. Ce faisant, il rompt ouvertement et délibérément avec la tradition de la Réforme, qui faisait résider l'essence du christianisme dans les trois principes de l'Écriture seule, de la foi seule, et de la grâce seule. Dorénavant, la raison seule doit prévaloir et se soumettre l'Écriture tout en congédiant la foi et la grâce. Ainsi s'accomplit la logique immanente de l'autonomie.
Le compromis que propose Kant est finalement le suivant : la philosophie reconnaît le "noyau rationnel"de la révélation chrétienne, et la théologie reconnaît, pour sa part, la validité de l'interprétation philosophique des Écritures. Mais ce compromis demeure profondément instable. Presque immédiatement il sera contesté, du côté de la philosophie, par ceux qui, depuis le jeune Hegel de l'Esprit du christianisme et son destin jusqu'au Bergson des Deux sources de la morale et de la religion, préféreront placer l'essence du christianisme dans un "amour"qui transcende toute légalité morale. Quant à ceux qui accepteront la leçon kantienne de l'identité de la morale et de la religion, ils n'hésiteront pas, comme Nietzsche, à en déduire la condamnation conjointe de la raison et de la religion au nom de l'affirmation de la puissance vitale. Enfin les théologiens eux-mêmes, d'abord tentés par cette offre de paix, seraient bien avisés de se demander ce qui subsiste de cette foi d'Église, qu'ils sont censés défendre, dans la religion de la raison.
La généalogie de la religion
Après Dieu et la Révélation, la philosophie des Lumières va devoir se confronter au concept même de religion. Dans l'Histoire Naturelle de la Religion, rédigée autour de 1750 et publiée en 1757, Hume distingue deux questions, "celle qui concerne le fondement de la religion dans la raison"et "celle qui concerne son origine dans la nature humaine"[ltr]12[/ltr]. La première fera l'objet des Dialogues sur la Religion naturelle. La seconde commande l'enquête généalogique sur la religion qui fait l'objet du premier ouvrage. La réponse qu'apporte Hume s'organise autour de deux axes.
La religion en général est définie comme la croyance en une puissance invisible et intelligente qui agit dans les œuvres de la nature, ainsi que dans les "événements divers et contraires de la vie humaine"[ltr]13[/ltr]. La contemplation de la nature, de son unité et de son uniformité, conduit inévitablement à poser un "dessein"ou une finalité qui renvoie nécessairement à l'existence d'un "auteur unique ". Cette croyance de la raison en un Dieu principe et cause suprême de la nature correspond à la religion naturelle des savants et des philosophes [ltr]14[/ltr]. C'est d'ailleurs pourquoi cette espèce de religion n'est pas primitive, mais suppose au contraire un degré élevé de science et de culture. De plus, elle ne peut jamais être "populaire"et son influence sur la conduite des sociétés humaines reste négligeable. Enfin son contenu, une fois passé au crible de la critique, reste très pauvre, puisqu'il se limite, comme on l'a vu précédemment, à poser une "lointaine analogie" entre la cause de la nature et l'intelligence humaine [ltr]15[/ltr]. L'existence de cette religion naturelle, à laquelle Hume reconnaît le statut de croyance inévitable de la raison, permet cependant de souligner, encore une fois, la relation étroite qui unit la science et la religion dans la culture savante du XVIIIème siècle jusqu'à la "révolution" kantienne.
Quant aux religions populaires ou historiques, elles n'entretiennent aucun lien avec la science dans leur origine, c'est-à-dire qu'elles ne découlent pas de "la contemplation des œuvres de la nature ". Elles prennent leur source uniquement dans les "affections ordinaires de la vie humaine", qui se ramènent aux passions de l'espoir et de la crainte, c'est-à-dire "le souci anxieux du bonheur, la crainte des maux futurs, la terreur de la mort, la soif de vengeance, la faim et l'aspiration aux autres nécessités de l'existence" [ltr]16[/ltr]. Ces deux grandes passions, en relation avec les événements de la vie humaine, se renforcent et se maintiennent à cause de "l'ignorance"dans laquelle les hommes sont et resteront par rapport aux causes qui dirigent le cours ordinaire de leur vie. La puissance des passions et l'impuissance de la raison sont donc le terreau fertile d'où sont issues les religions populaires. Cette conjonction explique l'universalité, la permanence et la force de la croyance religieuse. La généalogie de la religion que propose Hume n'autorise aucune illusion quant à une disparition future des religions populaires, non seulement parce que les passions sont, dans la philosophie sceptique de Hume, plus primitives et plus puissantes que la raison, mais aussi parce qu'il ne croit pas que la raison pourra jamais diriger et éclairer le cours de la vie quotidienne des hommes. Jamais la science ne pourra complètement calmer les espoirs et les craintes que font naître les aléas de notre existence individuelle. C'est pour cela que Hume ne fait pas de la religion une simple invention des prêtres, même si ceux-ci savent utiliser à leur profit cette tendance de la nature humaine.
À partir de cette source unique découlent deux types de religions historiques. D'abord vient le polythéisme, croyance primitive de l'humanité, la plus naturelle, consistant à attribuer les événements contraires et les occupations diverses de la vie humaine à des puissances, elles aussi, multiples et variées. Mais à cette pluralité des dieux, des esprits et des puissances invisibles peut succéder ce que Hume nomme le théisme, et que nous appellerions plus volontiers le monothéisme. Cette forme de religion populaire, qui n'a rien à voir, ni historiquement, ni psychologiquement, avec la religion naturelle de la raison, est présentée comme une simple évolution du polythéisme, une conséquence de la tendance humaine à exagérer la puissance et les attributs des divinités du polythéisme afin de s'en attirer et de s'en conserver les faveurs. Hume insiste bien sur l'idée selon laquelle le théisme n'est pas une rupture par rapport au polythéisme, mais sa continuation sous une autre forme. Le théisme est issu d'une concentration du polythéisme sur une seule divinité privilégiée. C'est aussi la raison pour laquelle rien n'interdit d'envisager un basculement en retour du théisme dans le polythéisme. Ces deux types de religion sont bien les deux espèces d'un même genre : la religion populaire, avec son cortège de superstitions et de persécutions.
Quand Hume aborde l'évaluation comparée des religions, elle tourne rapidement et complètement à l'avantage du polythéisme. Successivement, quatre séries de critères sont pris en compte : la persécution et la tolérance, le courage et l'humilité, la raison et l'absurdité, le doute et la conviction. L'histoire montre, dans chaque cas, si l'on accepte de suivre notre auteur dans sa démonstration impitoyable, que le polythéisme s'en sort mieux que le théisme par rapport à la tolérance, à l'esprit de soumission, à l'acceptation des croyances absurdes et à la place laissée au doute et à l'esprit critique. Le type humain que produit le monothéisme serait inférieur en tous points à celui qu'autorise le polythéisme. Pour faire semblant d'atténuer ce constat redoutable pour les trois religions monothéistes, Hume rappelle, non sans ironie, le principe selon lequel "la corruption des meilleures choses engendre les pires"[ltr]17[/ltr].
On le voit, la charge de Hume est terrible. Elle s'attaque précisément à ces deux lieux communs de l'apologétique chrétienne que sont la supériorité du christianisme par rapport au polythéisme des Grecs et des Romains, ainsi que la proximité du christianisme et de la raison naturelle. Le verdict de Hume est sans pitié : les religions en général, et le théisme chrétien en particulier, ne sont pas des croyances rationnelles, et ce qu'elles ont en commun reste plus profond et plus significatif que ce qui les distingue. Enfin, le théisme populaire, loin d'être historiquement supérieur au polythéisme, serait plus nocif et dangereux pour les sociétés humaines. Ce jugement est donc sans appel, même si Hume ne se fait aucune illusion sur son efficacité. Là encore, la raison sceptique se reconnaît sans pouvoir devant le cours impétueux et désordonné des passions humaines, qui demeurent le seul véritable moteur de l'histoire universelle. Pour Hume, comme pour Shakespeare avant lui et Schopenhauer après lui, l'histoire sert de théâtre aux passions et illustre leur puissance irrésistible. Les avancées de la raison restent fragiles et ne laissent pas espérer un quelconque progrès moral. La religion de la raison ne pourra jamais supplanter les religions populaires. À la limite, une résurgence du polythéisme permettrait d'atténuer les excès des monothéismes et offrirait paradoxalement à la religion de la raison un champ d'expansion limité, mais mieux toléré. Ainsi l'histoire permet au philosophe d'approfondir sa connaissance du phénomène religieux, mais nullement d'en entrevoir la fin.
Le recours à l'histoire
Chez Hume, l'histoire constituait le prolongement naturel de l'analyse généalogique et servait seulement à illustrer l'alchimie des passions dans son rapport au mécanisme des religions. Il n'en va plus de même avec Condorcet. D'argument contre la religion, l'histoire est élevée au statut de recours et de moyen de salut à l'encontre de "l'oppression" religieuse. Or ceci est rendu possible justement parce que l'usage que Condorcet va faire de l'histoire dans son Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain se situe entièrement à l'intérieur de la tradition de l'apologétique chrétienne. On sait que le christianisme est une religion historique, c'est-à-dire une religion dont la justification se situe à l'intérieur du temps qu'habitent les hommes. La vérité du christianisme se présente d'abord comme une vérité inscrite dans l'histoire, et qui tend à faire de celle-ci le récit où se déploie et s'expose la révélation divine. À travers l'Incarnation, la vérité éternelle de Dieu pénètre dans l'histoire des hommes, qui se trouve tout entière orientée en fonction de cet événement unique et de son achèvement annoncé et promis : le retour en gloire du Christ et la fin de l'histoire. Le christianisme n'est donc pas seulement prophétique et messianique : sa vérité n'est pas seulement saisie dans la dimension de l'attente ou de l'inaccomplissement. L'histoire, dans son déroulement passé et présent, a pour mission de manifester la puissance du Christ et de son Eglise. En ce sens, l'histoire des hommes est bien de part en part une histoire sainte et providentielle.
C'est ce que Bossuet va vouloir illustrer à travers son Discours sur l'histoire universelle, publié en 1681, alors même que s'achève son préceptorat du Dauphin. Dans la première partie de son ouvrage, intitulée "Les époques ou la suite des temps", Bossuet précise le sens qu'il convient de donner à la notion d'époque, fournissant à ses successeurs un modèle de périodisation qu'ils sauront utiliser : "Ainsi, dans l'ordre des siècles, il faut certains temps marqués par quelque grand événement auquel on rapporte tout le reste. C'est ce qui s'appelle ÉPOQUE, d'un mot grec qui signifie s'arrêter, parce qu'on s'arrête là pour considérer comme d'un lieu de repos tout ce qui est arrivé devant ou après et éviter par ce moyen les anachronismes, c'est-à-dire cette sorte d'erreur qui fait confondre les temps." [ltr]18[/ltr]
Bossuet va ensuite distinguer douze époques correspondant aux sept âges du monde :
Comme on le voit, l'histoire sainte et l'histoire profane sont savamment entremêlées par Bossuet, et placées l'une et l'autre sous l'autorité de la providence divine qui fait tout concourir à sa plus grande gloire. Dans les neufs époques qui précèdent la venue du Christ, et en dehors de la première renvoyant à la naissance de l'humanité en Adam, un équilibre parfait s'établit entre quatre personnages bibliques (Noé, Abraham, Moïse et Salomon) et quatre personnages de l'Antiquité classique (Homère, Romulus, Cyrus et Scipion). C'est ici que la volonté catholique de l'harmonie des deux cultures, la biblique et l'antique, s'exprime de la façon la plus éclatante, donnant au classicisme français son modèle indépassable. Elle permet aussi de souligner le fait que la providence divine exerce son autorité sur toute l'humanité et sur ses rois. Après la naissance du Christ, l'unité prend une forme nouvelle : Constantin et Charlemagne manifestent dans leur personne la soumission du pouvoir temporel au pouvoir spirituel, et annoncent ainsi la venue du règne de Dieu.
En 1750, Turgot, le maître et l'ami de Condorcet, prononce à la Sorbonne un discours resté célèbre présentant un Tableau philosophique des progrès successifs de l'esprit humain, où il développe trois grands thèmes : celui de "l'avancement réel de l'esprit humain, qui se décèle jusque dans ses égarements" ; celui de l'importance de la communication des idées et de la transmission du savoir que l'invention de l'imprimerie fera entrer dans une ère nouvelle ; enfin "les avantages que l'établissement du christianisme a procurés au genre humain". Turgot précise que la religion chrétienne, "en répandant sur la terre le germe du salut éternel, y a versé les lumières, la paix et le bonheur". [ltr]19[/ltr]
En 1793, quand Condorcet rédige sa propre Esquisse, il se souvient certainement du Tableau philosophique de Turgot, dont il reprend l'ambition, et il n'ignore pas le Discours de Bossuet, auquel il emprunte sa division en époques. Cependant, son programme est volontairement tout autre. Contre Bossuet, il rejette l'idée d'une Providence divine extérieure à l'humanité, et pose bien plutôt l'Esprit humain comme le seul acteur et auteur de son histoire et de ses progrès. Contre Turgot, il refuse absolument la thèse du concours de la religion chrétienne au progrès intellectuel et spirituel de l'humanité. Pour Bossuet et Turgot, le recours à l'histoire permettait de lier le christianisme au salut de l'humanité. Il n'en va plus de même chez Condorcet : l'histoire illustre à la fois l'autosuffisance de l'esprit humain, seul responsable de sa marche vers le progrès, et le rôle néfaste de toutes les religions dans ce processus émancipateur. On assiste donc au retournement volontaire et conscient de la tradition apologétique de l'histoire providentielle. Mais cette différence fondamentale de contenu inscrit en même temps Condorcet dans la tradition chrétienne de l'histoire avec laquelle il prétend rompre. Car le retournement d'une tradition, ou même son utilisation polémique contre son modèle, n'implique aucune rupture structurelle. Bien plutôt, le résultat de cette opération se déploie sur le mode de la répétition simplement inversée. D'un argument en faveur de la religion chrétienne, l'histoire s'inverse en réquisitoire contre la religion en général. Mais, ce faisant, Condorcet n'échappe pas du tout à la forme de l'histoire providentielle et à la perspective du salut, héritées du christianisme, qu'il retrouve consciemment dans le devenir immanent de l'humanité. C'est donc à l'intérieur d'un cadre issu de la religion chrétienne, que Condorcet va s'employer à dénoncer les méfaits des religions. Ses principales thèses sont les suivantes :
Premièrement, les religions proviennent, dès l'origine de l'humanité, de l'élaboration et de la confiscation du savoir par une minorité savante. La différence entre la minorité savante et la masse ignorante est la structure de base de la religion.
Deuxièmement, les religions se développent à partir de la constitution d'une "caste sacerdotale" qui s'édifie sur la base fournie par la minorité savante. Cette caste, pour mieux asseoir son pouvoir sur le peuple, s'allie naturellement à la caste des chefs de guerre et des rois.
Troisièmement, le christianisme d'Église, loin de modifier ce système de domination, l'a encore aggravé. Les prêtres et les moines vont tout faire pour étouffer ou retarder les progrès de l'esprit humain, dans lesquels ils discernent la menace la plus sérieuse contre leur pouvoir. La domination des prêtres supposant l'ignorance du peuple, la caste sacerdotale ne peut que s'opposer au développement du savoir et de la science. Mais Condorcet reconnaît que le christianisme fait ainsi éclater la contradiction existant entre son message de base, l'Évangile, et le système de domination politique mis en place par l'Église romaine. C'est en ces termes qu'il évoque la conception évangélique de l'égalité des hommes : "Enfin, les principes de fraternité générale, qui faisaient partie de la morale chrétienne, condamnaient l'esclavage ; et les prêtres, n'ayant aucun intérêt politique à contredire sur ce point des maximes qui honoraient leur cause, aidèrent par leurs discours à une destruction que les événements et les mœurs devaient nécessairement amener. Ce changement a été le germe d'une révolution dans les destinées de l'espèce humaine ; elle lui doit d'avoir pu connaître la véritable liberté."[ltr]20[/ltr] Dans le même esprit, Condorcet saluera le rôle positif des Réformateurs, à travers leur doctrine du libre examen de l'Écriture Sainte, au service de l'émancipation de l'humanité.
Enfin, quatrièmement, l'événement qui fera basculer définitivement le sort de ce combat pour la domination intellectuelle et politique des sociétés européennes sera l'invention de l'imprimerie et la diffusion universelle des savoirs qu'elle rend possible. Dorénavant, la science n'est plus réservée à une élite, les Lumières ne peuvent plus être "mises sous le boisseau ", dorénavant se développe une "opinion publique" qui devient progressivement le seul juge des débats et des combats en faveur des progrès de l'esprit humain. Cet événement décisif entraînera le déclin inexorable du pouvoir sacerdotal et son remplacement prévisible par la nouvelle classe des savants, qui est inséparable de la publicité du débat intellectuel et de l'universalité de sa diffusion. Annonçant Auguste Comte, Condorcet prédit la victoire de la communauté scientifique et sa substitution à la caste sacerdotale. La confiance qu'il porte aux savants repose moins sur une croyance naïve dans une amélioration morale de la nature humaine que sur le constat du changement des conditions réelles de production et de diffusion du savoir.
On le voit, l'originalité de Condorcet repose bien sur une analyse principalement "politique" du rôle de la religion dans l'histoire, faisant écho aux propos de Marx selon lesquels les Français avaient fait la révolution dans la politique, alors que les Anglais l'avaient faite dans l'économie, et qu'il appartenait aux Allemands de la faire en philosophie. La confrontation historique, ainsi que sa solution, sont entièrement de nature politique : le savant est appelé à supplanter le prêtre comme détenteur du pouvoir spirituel, de même que la science remplace progressivement la religion en tant que mode de production du savoir, et que le règne de "l'opinion publique" met définitivement fin au principe d'autorité. On trouve ici une des sources historiques de la laïcité républicaine : la méfiance devant le rôle "obscurantiste" des religions et la certitude que la science et la raison vont s'imposer dans la conscience du peuple. Est-il besoin d'ajouter que la dénonciation systématique du rôle néfaste des prêtres et des moines à laquelle s'est livrée, avec tant d'autres, Condorcet, n'a pas toujours abouti à un progrès des Lumières ? Un seul exemple suffira, parmi bien d'autres. En 1793, brûleront une semaine durant les ouvrages contenus dans la bibliothèque de l'abbaye de Cluny. "Ce gigantesque autodafé est dressé sur la place du champ de foire par le libraire Tournier. Les documents qui échappent au feu vont, durant plusieurs années, servir à fabriquer des milliers de couvercles pour les pots à confiture. Thibaudet rapporte que de belles feuilles d'antiphonaire, décorées de miniatures et de dorures, servent à fabriquer des cerfs-volants que certains se souviennent avoir lancés sur la place Notre-Dame."[ltr]21[/ltr] Comme l'illustrera Goya, les rêves de la raison peuvent aussi engendrer des monstres.
Quant aux espoirs qu'on peut placer dans le triomphe de l'esprit scientifique, ils font l'objet de la dixième époque de l'Esquisse de Condorcet, intitulée "Des progrès futurs de l'esprit humain". Il est à noter que, chez Bossuet, la dixième époque correspond à l'avènement du Christ. Pour Bossuet, comme pour Condorcet, cette dixième époque marque le début du "dernier âge de l'humanité ", dont s'inspirera la terminologie hégélienne de la "fin de l'histoire ". Chez Condorcet, trois questions vont y trouver une réponse nouvelle et positive grâce au développement prévisible des sciences : "Nos espérances sur l'état à venir de l'espèce humaine peuvent se réduire à ces trois points importants : la destruction de l'inégalité entre les nations ; les progrès de l'égalité dans un même peuple ; enfin, le perfectionnement réel de l'homme."[ltr]22[/ltr]
Mais l'optimisme de Condorcet, d'autant plus admirable qu'il s'exprime alors que, proscrit, il doit se cacher pour éviter l'arrestation qu'il pressent inévitable, ne repose pas sur l'ignorance des conditions historiques présentes de l'humanité. La contemplation du tableau à venir de l'humanité "affranchie de toutes ses chaînes", écrit Condorcet, "présente au philosophe un spectacle qui le console des erreurs, des crimes, des injustices dont la terre est encore souillée, et dont il est souvent la victime" [ltr]23.[/ltr] Comment ne pas comparer ces dernières lignes à laConsolation de la philosophie de Boèce ? Par delà les siècles, par-delà le christianisme proclamé de l'un et l'anti-christianisme militant de l'autre, une même tonalité proprement philosophique résonne et nous parle encore aujourd'hui : la foi dans la victoire de la raison, malgré le triomphe apparent de l'injustice et de l'oppression, dont on peut être soi-même la victime.
C'est finalement un XVIIIème siècle complexe et puissant jusque dans ses apories qui surgit de ce trop bref tableau des relations de la philosophie des Lumières avec les religions. Le procès de Dieu, s'il ne parvient pas à asseoir le triomphe de la raison, éclaire d'un jour nouveau ce besoin du divin présent au cœur du sujet de la connaissance. La solution du conflit entre la philosophie et la Révélation, si elle se révèle peu stable dans ses fondements et limitée dans sa durée, oblige à penser les conditions de possibilité d'une parole divine adressée à l'humanité. La généalogie de la religion, si elle rend incertaine toute sortie de l'ère religieuse, amène à réfléchir sur les raisons de cette permanence constitutive de l'humain. Quant à la dénonciation du rôle politique de la caste sacerdotale et de ses abus obscurantistes, si elle risque toujours de faire le lit d'un nouveau fanatisme, elle suppose de s'interroger sur la capacité de la science à répondre à l'angoisse des hommes. Enfin le recours à l'histoire, si caractéristique du rapport aux religions de la philosophie française de la laïcité, depuis l'Esquisse de Condorcet jusqu'à l'Uchronie de Charles Renouvier, parue en 1876, en passant par la loi des trois états énoncée par Auguste Comte dans le Discours sur l'Esprit positif de 1844, s'il permet de donner sens à la spécificité et à la variété du phénomène religieux, oblige à revenir sur la problématique du salut historique et de la fin de l'histoire.
Mais l'actualité profonde du XVIIIème siècle ne réside pas seulement dans la richesse et le foisonnement parfois contradictoire des questions et des réponses qu'il nous a léguées. Elle vaut, plus profondément encore, par son exemple intellectuel et moral, qui peut nous aider dans la réflexion urgente, à plus d'un titre, sur le devenir de la laïcité française. La première leçon est celle du courage de la raison, prête à aller jusqu'au bout d'elle-même dans sa confrontation avec Dieu, la Révélation et les religions, fidèle à la formule antique selon laquelle "rien de ce qui est humain ne peut lui rester étranger". La deuxième leçon est de ne pas se contenter de réfléchir sur le "fait" religieux, mais d'oser la question du sens et de la vérité, en reconnaissant la contribution qu'y apportent les religions. À ces deux sources, qui nous placent à "l'ombre des Lumières", pourra s'abreuver la réflexion philosophique dont la laïcité a besoin aujourd'hui.


Mark Sherringham, directeur de l'IUFM d'Alsace
Le XVIIIème siècle européen a eu l'ambition de penser d'une façon nouvelle les rapports de la raison avec le christianisme en particulier, et les religions en général. Cet effort audacieux de remise en question et de clarification est inséparable de l'entrée dans une nouvelle phase du processus de constitution de notre modernité, qui n'a pas été sans affrontements ni polémiques, parfois d'une grande violence. Mais le siècle des Lumières s'est aussi montré capable de dégager, autour de la question de la religion, des principes, des problèmes et des essais de solution dont nous sommes, à plus d'un titre, les héritiers, et qui peuvent nous alerter, aujourd'hui encore, sur les impasses à éviter et les perspectives qui méritent d'être parcourues plus profondément.
Le procès de Dieu
L'ouvrage qui ouvre l'espace intellectuel du XVIIIème siècle dans son rapport à la religion est la Théodicée de Leibniz, paru en 1710. Voltaire ne s'y était pas trompé, puisqu'il tente à sa manière de le neutraliser à travers le récit des aventures imaginaires de son Candide. Mais, en réalité, si Voltaire s'oppose à Leibniz sur la solution, il partage avec lui la position du problème. Dieu se trouve convoqué devant le Tribunal de la raison humaine pour se justifier de l'existence du mal. Peu importe que l'accusé soit disculpé ou reconnu coupable, l'audace inaugurale réside bien dans la mise en accusation de Dieu. Ainsi le XVIIIème siècle, qui commence avec le procès de Dieu, culminera dans le procès du roi. Dans les deux cas, il s'agit d'un procès politique et moral. Le roi se trouve accusé d'avoir trahi la Révolution qu'il avait en apparence acceptée. Dieu se trouve accusé d'avoir mal gouverné le monde en autorisant le mal, alors que sa toute-puissance et sa sagesse auraient dû permettre de le rendre inutile et inexistant. La question du mal, à l'aube du XVIIIème siècle, au lieu d'interroger prioritairement l'homme, se retourne contre Dieu, qui est désigné, sinon comme son auteur, du moins comme son complice.
Le lieu même de ce procès doit être souligné. Il s'agit bien de la morale ou de la politique, et pas d'abord de la science. Aux XVIIème et XVIIIème siècles, le sentiment de la solidarité entre l'existence de Dieu et la possibilité de la science de la nature reste largement partagé. Descartes exprime bien ce qu'on pourrait appeler l'opinion dominante des savants de son temps, et même du siècle suivant, quand il pose Dieu comme le garant des vérités éternelles et la condition de possibilité de la science de la nature. Bien sûr, les "libres-penseurs"du siècle classique et les philosophes "matérialiste" du siècle des Lumières maintiennent vivante l'antique tradition épicurienne. Quant à Spinoza, posant au commencement de son Éthiquel'identité de Dieu et de la nature, il retrouve, contre la science des modernes, la position grecque de la divinité de la nature. Mais majoritairement, les modernes, en science comme en philosophie, continuent de percevoir, par delà le procès emblématique de Galilée, à quel point le Dieu chrétien, délivré de son habillage grec et scolastique grâce à la Réforme protestante, rend théoriquement possible la science de la nature pour au moins deux raisons : la "dé-divinisation"de la nature qu'opère le retour à la séparation biblique de la création et du créateur, et la garantie divine de la régularité et de l'unité des lois naturelles, qui rend la connaissance de la nature accessible à l'esprit humain. C'est justement la prise au sérieux du motif biblique de la création, dans sa double dimension de séparation entre Dieu et la nature et de fondation de la nature sur l'intelligence divine, qui permet à Descartes d'énoncer l'ambition moderne : devenir "maître et possesseur de la nature ".
En revanche, dans le domaine politico-moral, la gouvernance de Dieu va se trouver fondamentalement remise en question. Sans doute peut-on mieux comprendre ce processus si l'on se réfère, là aussi, au développement de la Réforme en Europe. Le protestantisme, grâce au retour à la vision biblique du monde contre la cosmologie et la physique héritées d'Aristote, auxquelles s'était parfois identifiée l'Église romaine, a globalement favorisé l'essor de la science moderne. Mais, dans le domaine moral, la Réforme contredit ouvertement la valeur humaniste de la liberté humaine, avec laquelle le catholicisme parvient plus facilement à transiger. C'est d'abord Luther qui s'oppose à Érasme avec son Traité du serf-arbitre, et c'est ensuite Calvin qui fonde l'interprétation stricte de la double prédestination sur le respect scrupuleux de l'Écriture sainte. Le "scandale" de la prédestination, qui semble annuler tout le libre-arbitre de l'homme, me semble être la cause profonde du procès fait à Dieu par la raison moderne. Si tout dépend de la volonté divine, si l'humanité ne peut rien décider sans l'autorisation divine, si l'individu ne peut rien entreprendre qui ne soit déjà prévu par Dieu, ne devient-il pas logique et légitime de demander des comptes à un tel maître, de lui demander raison du mal qu'il autorise pour sa plus grande gloire ? La réaction contre le calvinisme, dans ce qu'il a de plus "réactionnaire"par rapport à la modernité, dans ce qu'il a de plus paradoxal par rapport à la liberté des modernes, alimente le procès de Dieu.
Ce procès connaîtra trois phases : le premier moment est dominé par la réponse leibnizienne. Grâce à la distinction faite dans la Théodicée entre le mal métaphysique, le mal moral et le mal physique, Leibniz parvient à innocenter Dieu ou, en tous cas, à aboutir à un non-lieu. En aucune façon l'être divin ne peut être tenu pour la cause directe du mal physique et moral, même si, dans sa sagesse suprême qui veut le meilleur des mondes possibles, il est amené à autoriser une certaine quantité de ces deux types de maux, dans la mesure exacte où ils se révèlent indispensables à la réalisation du meilleur état possible de l'univers. Seul le mal métaphysique, c'est-à-dire l'imperfection et la limitation inhérentes à la notion même de créature, est la conséquence directe de la volonté de Dieu comme créateur du monde. Malheureusement le plaidoyer de Leibniz souffre de trois défauts majeurs. Tout d'abord, il abandonne la position chrétienne du "mystère"du mal, en faisant dépendre l'innocence de Dieu de la nécessité paradoxale du mal qui trouve son fondement dans l'être divin lui-même en tant qu'il a décidé de créer le monde et l'a voulu le meilleur possible. Si l'on suit Leibniz, la nécessité du mal est inscrite dans la bonté même de Dieu. Mais Leibniz abandonne également la position chrétienne du "scandale" du mal, qui doit demeurer toujours absolument injustifiable, et que seule peut vaincre la passion du Christ sur la croix. Enfin la solution leibnizienne, malgré sa finesse conceptuelle, résistera difficilement à l'ironie d'un Voltaire ou à l'incompréhension qui suit le tremblement de terre de Lisbonne.
Commence alors un procès en appel, qui sera instruit par Hume. Dans ses Dialogues sur la Religion naturelle, qui paraissent en 1779 (mais qui ont été rédigés autour de 1750), Hume attaque à la fois la gouvernance de Dieu et son existence. Il y a donc radicalisation et généralisation de l'acte d'accusation. De la question de l'existence du mal, on passe à la question de l'(in)existence de Dieu. Par ailleurs, la gouvernance de Dieu n'est plus seulement examinée par rapport au mal moral, mais aussi par rapport à la cohérence et à l'unité du monde physique. De même que Hume avait sapé les fondements de la science moderne en s'attaquant au principe de causalité, ramené à une simple croyance fondée sur l'habitude, de même il s'attaque à la relation même de Dieu à la nature et au monde en critiquant la notion de finalité. En réalité, nous fait comprendre Hume, l'action divine sur la nature, "la marque de Dieu sur son ouvrage ", n'est pas aussi visible ou lisible qu'on veut bien le dire. La Religion naturelle, comprise comme la croyance en l'existence d'un Dieu créateur du monde, ne peut pas être prouvée à partir des caractéristiques de la nature ou de la raison humaine. Tout ce qu'on peut admettre est une "lointaine analogie"entre la raison humaine et la cause productrice de la nature : "Le tout de la théologie naturelle, comme quelques-uns semblent le soutenir, se résout en une seule proposition, simple, quoique assez ambiguë, ou du moins indéfinie, que la cause ou les causes de l'ordre de l'univers présentent probablement quelque lointaine analogie avec l'intelligence humaine […]."[ltr]1[/ltr]
Pour autant, Hume ne conclut pas à l'inexistence de Dieu, mais il se contente de relever le fait que le désordre moral et physique du monde rend l'affirmation de l'existence de son créateur assez difficile à percevoir. Au contraire, sa déconstruction sceptique des preuves de l'existence de Dieu se termine par un appel, qui n'est pas seulement ironique, même s'il demeure paradoxal, à la Révélation divine : "Mais croyez-moi, Cléanthe, le sentiment le plus naturel qu'un esprit bien disposé puisse éprouver en cette occasion, est une attente ardente et un vif désir qu'il plaise au ciel de dissiper, ou du moins d'alléger, cette profonde ignorance, en accordant à l'humanité quelque révélation plus particulière et en lui découvrant quelque chose de la nature, des attributs et des opérations du divin objet de notre foi. Toute personne pénétrée d'un juste sentiment des imperfections de la raison humaine se précipitera avec la plus grande avidité vers la vérité révélée."[ltr]2[/ltr]
La deuxième phase du procès de Dieu aboutit donc à ce que Hume appelle "un juste sentiment des imperfections de la raison humaine ". Le jugement de Dieu aboutit à la confirmation de la condamnation sceptique de la raison. Celle-ci doit reconnaître sa faiblesse et ses limites, du fait même de sa confrontation à un divin à la fois insaisissable et indécidable. On est loin du triomphe de la raison comme marque distinctive d'un optimisme des Lumières qui n'a sans doute jamais vraiment existé. Face à une nature incohérente, confrontée à une histoire qui voit trop souvent triompher la folie des hommes, sommée de s'expliquer avec un Dieu caché et incompréhensible, la raison est forcée de reconnaître sa faiblesse. Tel est le premier résultat du rationalisme sceptique de Hume.
Le troisième acte du procès de Dieu - qui est aussi devenu le procès de la raison - commence avec Kant. En partisan affirmé des Lumières et en observateur attentif de son siècle, il perçoit parfaitement le danger. La justification de Dieu par la raison, à la suite de Leibniz ou de Locke, n'emporte pas l'adhésion, et tend à affaiblir la position de la divinité qu'elle visait pourtant à renforcer. Quant au questionnement sceptique de Dieu, à la suite de Hume, il aboutit au constat que la raison est amenée à faire de sa propre imperfection. Le bilan des Lumières apparaît alors comme bien peu satisfaisant, nous laissant le choix entre un Dieu affaibli et une raison épuisée. Pour échapper à ce dilemme, il convient de repenser le procès de Dieu sur de nouvelles bases. Devant le "Tribunal de la raison humaine", Kant procède à un double retournement.
En premier lieu, la charge de la preuve repose dorénavant sur la raison. Le tribunal kantien est d'abord ce lieu où la raison se juge elle-même. Il lui revient de définir ses propres limites. En examinant ce que Kant appelle, dans sa Critique de la raison pure, la "dialectique de la raison ", il devient évident, si du moins l'on accepte les prémisses kantiennes, que les trois types possibles de preuves de l'existence de Dieu (la preuve ontologique, la preuve cosmologique et la preuve physico-théologique) manquent nécessairement leur but à cause de la nature des facultés humaines de connaissance. C'est que Dieu n'est pas un objet possible de l'intuition sensible, et qu'il ne peut pas se comprendre à partir des catégories de l'entendement. Du point de vue de la raison théorique, il est précisément une "Idée régulatrice"ou un "Idéal ", mais en aucune façon l'objet d'une connaissance possible. De Dieu, la raison ne peut prouver, ni qu'il existe, ni qu'il n'existe pas. Mais l'aveu d'incompétence de la raison théorique devant la question de Dieu aboutit, paradoxalement en apparence, à l'affirmation de la toute-puissance du sujet humain de la connaissance par rapport à la nature. Si Laplace pourra affirmer que Dieu est devenu une hypothèse inutile, c'est justement parce que Kant avait installé le sujet transcendantal à la place du Dieu transcendant dans le rapport théorique ou scientifique à la nature. Si la raison théorique ne peut plus affirmer ou nier l'existence de l'être divin, elle devient la source unique de l'ordre et de l'unité de la nature connaissable. Dieu se trouve bien remplacé par la raison, mais la fonction divine par rapport à la connaissance scientifique de la nature demeure indispensable. La science de la nature ne peut pas se passer d'un garant.
Le second retournement qu'opère Kant concerne la morale. A la mise en cause de l'être divin par l'existence du mal répond maintenant le postulat de l'existence de Dieu par la raison pratique ou la volonté bonne. L'homme moral est en droit d'attendre de Dieu qu'il existe. Le bonheur qu'il peut légitimement espérer rend nécessaire le recours à l'Être suprême et à l'immortalité de l'âme. L'exercice de la liberté humaine, ou plutôt l'idée de la liberté de la volonté, fonde le besoin de Dieu qu'éprouve la raison. Celui-ci doit exister parce que l'homme est capable de moralité.
Finalement, à travers ce double retournement, la philosophie critique aboutit à la justification pratique de l'existence de Dieu et à la limitation théorique de la raison humaine à la connaissance de la nature. Ce faisant, Kant donne raison à Leibniz sur l'innocence divine, mais sans avoir besoin de recourir à l'argument du meilleur des mondes possibles, c'est-à-dire en évitant à la raison humaine de se placer au point de vue de Dieu. Kant donne aussi raison à Hume sur l'impossibilité des preuves de l'existence de Dieu, mais sans mettre en question la capacité de la raison à connaître la nature. Le procès se termine par un accord qui scelle une séparation théorique et une solidarité pratique entre le divin et l'humain. Séparation et solidarité qui, dans l'esprit de la philosophie kantienne, laisse s'ouvrir une nouvelle ère de paix perpétuelle, délivrée des conflits qu'entraînent les positions philosophiques du dogmatisme et du scepticisme. À travers la "paix critique ", le XVIIIème siècle découvre que la raison humaine peut se vouloir à la fois indépendante et solidaire de l'Être suprême.
La Révélation devant la Raison
Se pose alors avec une urgence nouvelle la question du statut de la Révélation religieuse, c'est-à-dire de la possibilité d'une relation à Dieu qui ne dépende pas de la raison des hommes. C'est la notion même de Révélation, ainsi que le contenu spécifique des dogmes chrétiens, qui vont se trouver mis en question. Le XVIIIème siècle lira avec avidité le Traité des trois imposteurs, dont l'origine demeure incertaine, puisqu'on l'attribue aussi bien à Frédéric II de Hohenstauffen que, plus récemment, à Spinoza ou à l'un de ses disciples. La notion de révélation s'y trouve entièrement ramenée à un projet politique de domination : "Les ambitieux, qui ont toujours été de grands maîtres en l'art de fourber, ont tous suivi la même route dans l'établissement de leurs lois. Pour obliger le peuple à s'y soumettre de lui-même, ils l'ont persuadé, à la faveur de l'ignorance qui lui est naturelle, qu'ils les avaient reçues ou d'un dieu ou d'une déesse."[ltr]3[/ltr]
La démonstration de cette imposture des fondateurs de religion au service de leur ambition politique est faite successivement pour Moïse, Numa-Pompilius, Jésus-Christ et Mahomet. Tous apparaissent comme des précurseurs du Prince de Machiavel (même si le Christ rentre plus difficilement dans ce rôle), incarnations exemplaires d'une volonté de puissance hostile à la vie et à la vérité. De leur côté, Diderot, dans ses Pensées philosophiques de 1746 et l'Addition de 1770, et Voltaire, dans son Dictionnaire philosophique de 1764, prennent le parti de mettre en évidence les "absurdités"de toute religion qui se prétend révélée, et du christianisme en particulier. Leurs armes essentielles sont l'ironie, la dérision ou l'indignation. Il n'est aucun des artifices des créateurs de religion en général, ni des dogmes ou des articles de foi de la religion chrétienne, qui ne se trouvent pris d'assaut et dénoncés sans pitié. Ainsi Diderot : "Tous les peuples ont de ces faits, à qui, pour être merveilleux, il ne manque que d'être vrais ; avec lesquels on démontre tout, mais qu'on ne prouve point ; qu'on n'ose nier sans être impie, et qu'on ne peut croire sans être Imbéc...."[ltr]4[/ltr]
Ainsi Voltaire : "Après notre sainte religion, qui sans doute est la seule bonne, quelle serait la moins mauvaise ? Ne serait-ce pas la plus simple ? Ne serait-ce pas celle qui enseignerait beaucoup de morale et très peu de dogmes ? celle qui tendrait à rendre les hommes justes sans les rendre absurdes ? celle qui n'ordonnerait point de croire des choses impossibles, contradictoires, injurieuses à la Divinité et pernicieuses au genre humain, et qui n'oserait point menacer des peines éternelles quiconque aurait le sens commun ? Ne serait-ce point celle qui ne soutiendrait pas sa créance par des bourreaux, et qui n'inonderait pas la terre de sang pour des sophismes inintelligibles ? celle dans laquelle une équivoque, un jeu de mots, et deux ou trois chartes supposées ne feraient pas un souverain et un dieu d'un prêtre souvent incestueux, homicide et empoisonneur ? celle qui ne soumettrait pas les rois à ce prêtre ? celle qui n'enseignerait que l'adoration d'un Dieu, la justice, la tolérance et l'humanité ? "[ltr]5[/ltr]
Mais ce faisant, il faut le remarquer, Voltaire et Diderot n'inaugurent pas vraiment une ère nouvelle dans les relations entre la philosophie et les religions, même s'ils placent avec passion et éloquence le geste philosophique sous la bannière de la dénonciation de la religion. On assiste plutôt à la réactivation des éléments de polémique anti-religieuse déjà présents dans la philosophie grecque classique ainsi que dans la réaction païenne qui s'était développée, au début de l'ère chrétienne, autour de Celse, du néo-platonisme et des tentatives de restauration de Julien l'Apostat. C'est donc un très ancien fond de refus et d'indignation qui resurgit ici, et pas du tout le résultat d'un nouveau positionnement de la raison moderne ou du progrès intellectuel de la compréhension scientifique du monde. Au contraire, Diderot lui-même souligne que la science moderne contredit le "matérialisme ", et encourage la croyance d'origine chrétienne en un dieu créateur de la nature : "Ce n'est que dans les ouvrages de Newton, de Musschenbroek, d'Hartsoeker et de Nieuwentyt, qu'on a trouvé des preuves satisfaisantes de l'existence d'un être souverainement intelligent. Grâce aux travaux de ces grands hommes, le monde n'est plus un dieu : c'est une machine qui a ses roues, ses cordes, ses poulies, ses ressorts et ses poids."[ltr]6[/ltr]
Comme chez Descartes, se maintient ici la solidarité moderne entre la création divine et le mécanisme de la nature. La nouveauté ne réside pas non plus dans l'accusation portée contre l'absurdité de la Révélation chrétienne aux yeux de la raison philosophique traditionnelle - c'était déjà un lieu commun de l'apologétique des Pères de l'Église. La part moderne de cette polémique réside avant tout dans la reprise des arguments de Luther ou de Calvin contre le pouvoir des Papes, ainsi que de ceux de Bayle et de Locke en faveur de la tolérance dans le domaine de la foi religieuse. Dans cette perspective, à la dénonciation ancienne et passablement ambiguë de l'absurdité de toute Révélation vient s'ajouter l'appel plus proprement moderne à la lutte contre le pouvoir temporel et spirituel de Rome et à la tolérance de l'État en matière de religion.
Toutefois, le XVIIIème siècle explore encore une autre voie dans sa volonté de rendre compte de la Révélation : il s'agit de la tentative de réduire celle-ci à son noyau rationnel. Là non plus, l'innovation n'est pas, en apparence, radicale. La question des relations de la raison humaine et de la Révélation biblique est posée depuis les Pères de l'Église, et nombreux furent ceux qui montrèrent l'accord profond de la raison et de la révélation, comme Saint Thomas ou Maïmonide. Cependant, il reviendra à Kant de porter à son point culminant l'ambition du XVIIIème siècle, non pas seulement d'harmoniser raison et révélation, mais bien d'inclure la Révélation chrétienne dans le cadre de la raison humaine, et plus précisément de soumettre complètement le dogme au libre examen de la raison. Dorénavant, ce n'est plus la Révélation qui est la "pierre de touche"de la raison, mais bien la raison qui prétend dicter ses lois à la Révélation. Dans l'un de ses derniers ouvrages, Le conflit des Facultés, publié en 1798, Kant résume la nouvelle relation de la philosophie et de la théologie qu'il appelle de ses vœux, en reprenant la formule célèbre : "On peut aussi, sans doute, concéder à la Faculté de Théologie l'orgueilleuse prétention de prendre la Faculté de philosophie pour sa servante, mais alors la question subsiste toujours de savoir si celle-ci précède avec la torche sa gracieuse Dame, ou si elle la suit portant la traîne […]."[ltr]7[/ltr]
Dans le contexte de la réaction contre les principes des Lumières, qui suivit en Prusse la mort de Frédéric II et qu'amplifia le déroulement de la Révolution française, Kant cherche à déterminer les rapports légitimes entre la Théologie et la Philosophie, de façon à assurer les droits de la raison humaine. Le conflit des deux Facultés à l'intérieur de l'espace de l'Université renvoie à la distinction de deux principes que Kant désigne comme "la foi d'Église"et "la foi religieuse ". La première repose "sur des statuts, c'est-à-dire des lois dérivant de la volonté d'un autre"[ltr]8[/ltr]. La seconde renvoie, au contraire, à "des lois intérieures qui peuvent se déduire de la raison propre de tout homme"[ltr]9[/ltr]. Cette distinction, qui permet d'opposer le travail du "docteur de la loi"à celui du "savant de la raison"dérive directement de la séparation, propre à la philosophie kantienne, des principes d'hétéronomie et d'autonomie. Le théologien accepte de placer la volonté de l'homme sous l'autorité d'un Dieu extérieur, le philosophe des Lumières pense la divinité comme la loi de la raison pratique qui s'inscrit tout entière dans l'intériorité de l'humain.
Ainsi compris, le concept kantien de la religion ne renvoie plus "au contenu de certains dogmes considérés comme révélation divine (ceci, c'est la théologie), mais à celui de tous nos devoirs en général en tant que commandements divins (subjectivement, de la maxime de s'y conformer comme tels)"[ltr]10[/ltr]. La religion est donc identique, dans son contenu, à la morale. Elle en diffère seulement par la forme, en ce qu'elle présente les lois de la raison pratique comme l'expression de la volonté divine, de façon à en faciliter l'accomplissement par la volonté humaine. Dans cette perspective, le christianisme est la foi d'Église qui "convient le mieux"à la religion de la raison. "Or, celui-ci se trouve, dans la Bible, composé de deux parties dissemblables : l'une, qui contient le canon, et l'autre l'organon ou véhicule de la religion ; le premier peut être appelé la pure foi religieuse (fondée sans statuts, sur la simple raison), et l'autre la foi de l'Église qui, tout entière, repose sur des statuts, exigeant une révélation, pour être regardés comme un enseignement et des préceptes sacrés."[ltr]11[/ltr]
De cette définition du christianisme biblique se déduisent les principes philosophiques de l'exégèse scripturaire qui sont au nombre de trois : tout d'abord, les passages de l'Écriture qui contiennent des dogmes théoriques dépassant tout concept rationnel, comme la Trinité ou l'Incarnation, doivent toujours être ramenés à leur contenu rationnel - ici, par exemple, l'idée de la personne et celle de l'humanité. Contre l'horizon d'une Révélation imaginée comme un au-delà de la raison, Kant affirme l'immanence de la première à l'intérieur du cadre de la seconde, c'est-à-dire l'inscription de la Révélation dans les limites de la simple raison. Ensuite, il convient d'affirmer que la foi en des dogmes scripturaires n'a aucun mérite en soi. Dans la vraie religion (morale), le doute à propos du dogme n'est pas une faute. Seul compte l'agir conforme à la moralité. Contre la foi, Kant affirme l'unique valeur des "œuvres ". Enfin, l'action humaine doit toujours être présentée comme résultant de l'usage particulier que l'homme fait de ses forces morales, sans recours à l'intervention divine. Contre la grâce divine, Kant soutient l'autosuffisance de la raison humaine. Ce faisant, il rompt ouvertement et délibérément avec la tradition de la Réforme, qui faisait résider l'essence du christianisme dans les trois principes de l'Écriture seule, de la foi seule, et de la grâce seule. Dorénavant, la raison seule doit prévaloir et se soumettre l'Écriture tout en congédiant la foi et la grâce. Ainsi s'accomplit la logique immanente de l'autonomie.
Le compromis que propose Kant est finalement le suivant : la philosophie reconnaît le "noyau rationnel"de la révélation chrétienne, et la théologie reconnaît, pour sa part, la validité de l'interprétation philosophique des Écritures. Mais ce compromis demeure profondément instable. Presque immédiatement il sera contesté, du côté de la philosophie, par ceux qui, depuis le jeune Hegel de l'Esprit du christianisme et son destin jusqu'au Bergson des Deux sources de la morale et de la religion, préféreront placer l'essence du christianisme dans un "amour"qui transcende toute légalité morale. Quant à ceux qui accepteront la leçon kantienne de l'identité de la morale et de la religion, ils n'hésiteront pas, comme Nietzsche, à en déduire la condamnation conjointe de la raison et de la religion au nom de l'affirmation de la puissance vitale. Enfin les théologiens eux-mêmes, d'abord tentés par cette offre de paix, seraient bien avisés de se demander ce qui subsiste de cette foi d'Église, qu'ils sont censés défendre, dans la religion de la raison.
La généalogie de la religion
Après Dieu et la Révélation, la philosophie des Lumières va devoir se confronter au concept même de religion. Dans l'Histoire Naturelle de la Religion, rédigée autour de 1750 et publiée en 1757, Hume distingue deux questions, "celle qui concerne le fondement de la religion dans la raison"et "celle qui concerne son origine dans la nature humaine"[ltr]12[/ltr]. La première fera l'objet des Dialogues sur la Religion naturelle. La seconde commande l'enquête généalogique sur la religion qui fait l'objet du premier ouvrage. La réponse qu'apporte Hume s'organise autour de deux axes.
La religion en général est définie comme la croyance en une puissance invisible et intelligente qui agit dans les œuvres de la nature, ainsi que dans les "événements divers et contraires de la vie humaine"[ltr]13[/ltr]. La contemplation de la nature, de son unité et de son uniformité, conduit inévitablement à poser un "dessein"ou une finalité qui renvoie nécessairement à l'existence d'un "auteur unique ". Cette croyance de la raison en un Dieu principe et cause suprême de la nature correspond à la religion naturelle des savants et des philosophes [ltr]14[/ltr]. C'est d'ailleurs pourquoi cette espèce de religion n'est pas primitive, mais suppose au contraire un degré élevé de science et de culture. De plus, elle ne peut jamais être "populaire"et son influence sur la conduite des sociétés humaines reste négligeable. Enfin son contenu, une fois passé au crible de la critique, reste très pauvre, puisqu'il se limite, comme on l'a vu précédemment, à poser une "lointaine analogie" entre la cause de la nature et l'intelligence humaine [ltr]15[/ltr]. L'existence de cette religion naturelle, à laquelle Hume reconnaît le statut de croyance inévitable de la raison, permet cependant de souligner, encore une fois, la relation étroite qui unit la science et la religion dans la culture savante du XVIIIème siècle jusqu'à la "révolution" kantienne.
Quant aux religions populaires ou historiques, elles n'entretiennent aucun lien avec la science dans leur origine, c'est-à-dire qu'elles ne découlent pas de "la contemplation des œuvres de la nature ". Elles prennent leur source uniquement dans les "affections ordinaires de la vie humaine", qui se ramènent aux passions de l'espoir et de la crainte, c'est-à-dire "le souci anxieux du bonheur, la crainte des maux futurs, la terreur de la mort, la soif de vengeance, la faim et l'aspiration aux autres nécessités de l'existence" [ltr]16[/ltr]. Ces deux grandes passions, en relation avec les événements de la vie humaine, se renforcent et se maintiennent à cause de "l'ignorance"dans laquelle les hommes sont et resteront par rapport aux causes qui dirigent le cours ordinaire de leur vie. La puissance des passions et l'impuissance de la raison sont donc le terreau fertile d'où sont issues les religions populaires. Cette conjonction explique l'universalité, la permanence et la force de la croyance religieuse. La généalogie de la religion que propose Hume n'autorise aucune illusion quant à une disparition future des religions populaires, non seulement parce que les passions sont, dans la philosophie sceptique de Hume, plus primitives et plus puissantes que la raison, mais aussi parce qu'il ne croit pas que la raison pourra jamais diriger et éclairer le cours de la vie quotidienne des hommes. Jamais la science ne pourra complètement calmer les espoirs et les craintes que font naître les aléas de notre existence individuelle. C'est pour cela que Hume ne fait pas de la religion une simple invention des prêtres, même si ceux-ci savent utiliser à leur profit cette tendance de la nature humaine.
À partir de cette source unique découlent deux types de religions historiques. D'abord vient le polythéisme, croyance primitive de l'humanité, la plus naturelle, consistant à attribuer les événements contraires et les occupations diverses de la vie humaine à des puissances, elles aussi, multiples et variées. Mais à cette pluralité des dieux, des esprits et des puissances invisibles peut succéder ce que Hume nomme le théisme, et que nous appellerions plus volontiers le monothéisme. Cette forme de religion populaire, qui n'a rien à voir, ni historiquement, ni psychologiquement, avec la religion naturelle de la raison, est présentée comme une simple évolution du polythéisme, une conséquence de la tendance humaine à exagérer la puissance et les attributs des divinités du polythéisme afin de s'en attirer et de s'en conserver les faveurs. Hume insiste bien sur l'idée selon laquelle le théisme n'est pas une rupture par rapport au polythéisme, mais sa continuation sous une autre forme. Le théisme est issu d'une concentration du polythéisme sur une seule divinité privilégiée. C'est aussi la raison pour laquelle rien n'interdit d'envisager un basculement en retour du théisme dans le polythéisme. Ces deux types de religion sont bien les deux espèces d'un même genre : la religion populaire, avec son cortège de superstitions et de persécutions.
Quand Hume aborde l'évaluation comparée des religions, elle tourne rapidement et complètement à l'avantage du polythéisme. Successivement, quatre séries de critères sont pris en compte : la persécution et la tolérance, le courage et l'humilité, la raison et l'absurdité, le doute et la conviction. L'histoire montre, dans chaque cas, si l'on accepte de suivre notre auteur dans sa démonstration impitoyable, que le polythéisme s'en sort mieux que le théisme par rapport à la tolérance, à l'esprit de soumission, à l'acceptation des croyances absurdes et à la place laissée au doute et à l'esprit critique. Le type humain que produit le monothéisme serait inférieur en tous points à celui qu'autorise le polythéisme. Pour faire semblant d'atténuer ce constat redoutable pour les trois religions monothéistes, Hume rappelle, non sans ironie, le principe selon lequel "la corruption des meilleures choses engendre les pires"[ltr]17[/ltr].
On le voit, la charge de Hume est terrible. Elle s'attaque précisément à ces deux lieux communs de l'apologétique chrétienne que sont la supériorité du christianisme par rapport au polythéisme des Grecs et des Romains, ainsi que la proximité du christianisme et de la raison naturelle. Le verdict de Hume est sans pitié : les religions en général, et le théisme chrétien en particulier, ne sont pas des croyances rationnelles, et ce qu'elles ont en commun reste plus profond et plus significatif que ce qui les distingue. Enfin, le théisme populaire, loin d'être historiquement supérieur au polythéisme, serait plus nocif et dangereux pour les sociétés humaines. Ce jugement est donc sans appel, même si Hume ne se fait aucune illusion sur son efficacité. Là encore, la raison sceptique se reconnaît sans pouvoir devant le cours impétueux et désordonné des passions humaines, qui demeurent le seul véritable moteur de l'histoire universelle. Pour Hume, comme pour Shakespeare avant lui et Schopenhauer après lui, l'histoire sert de théâtre aux passions et illustre leur puissance irrésistible. Les avancées de la raison restent fragiles et ne laissent pas espérer un quelconque progrès moral. La religion de la raison ne pourra jamais supplanter les religions populaires. À la limite, une résurgence du polythéisme permettrait d'atténuer les excès des monothéismes et offrirait paradoxalement à la religion de la raison un champ d'expansion limité, mais mieux toléré. Ainsi l'histoire permet au philosophe d'approfondir sa connaissance du phénomène religieux, mais nullement d'en entrevoir la fin.
Le recours à l'histoire
Chez Hume, l'histoire constituait le prolongement naturel de l'analyse généalogique et servait seulement à illustrer l'alchimie des passions dans son rapport au mécanisme des religions. Il n'en va plus de même avec Condorcet. D'argument contre la religion, l'histoire est élevée au statut de recours et de moyen de salut à l'encontre de "l'oppression" religieuse. Or ceci est rendu possible justement parce que l'usage que Condorcet va faire de l'histoire dans son Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain se situe entièrement à l'intérieur de la tradition de l'apologétique chrétienne. On sait que le christianisme est une religion historique, c'est-à-dire une religion dont la justification se situe à l'intérieur du temps qu'habitent les hommes. La vérité du christianisme se présente d'abord comme une vérité inscrite dans l'histoire, et qui tend à faire de celle-ci le récit où se déploie et s'expose la révélation divine. À travers l'Incarnation, la vérité éternelle de Dieu pénètre dans l'histoire des hommes, qui se trouve tout entière orientée en fonction de cet événement unique et de son achèvement annoncé et promis : le retour en gloire du Christ et la fin de l'histoire. Le christianisme n'est donc pas seulement prophétique et messianique : sa vérité n'est pas seulement saisie dans la dimension de l'attente ou de l'inaccomplissement. L'histoire, dans son déroulement passé et présent, a pour mission de manifester la puissance du Christ et de son Eglise. En ce sens, l'histoire des hommes est bien de part en part une histoire sainte et providentielle.
C'est ce que Bossuet va vouloir illustrer à travers son Discours sur l'histoire universelle, publié en 1681, alors même que s'achève son préceptorat du Dauphin. Dans la première partie de son ouvrage, intitulée "Les époques ou la suite des temps", Bossuet précise le sens qu'il convient de donner à la notion d'époque, fournissant à ses successeurs un modèle de périodisation qu'ils sauront utiliser : "Ainsi, dans l'ordre des siècles, il faut certains temps marqués par quelque grand événement auquel on rapporte tout le reste. C'est ce qui s'appelle ÉPOQUE, d'un mot grec qui signifie s'arrêter, parce qu'on s'arrête là pour considérer comme d'un lieu de repos tout ce qui est arrivé devant ou après et éviter par ce moyen les anachronismes, c'est-à-dire cette sorte d'erreur qui fait confondre les temps." [ltr]18[/ltr]
Bossuet va ensuite distinguer douze époques correspondant aux sept âges du monde :
- Adam ou la création (premier âge du monde) ;
- Noé ou le déluge (deuxième âge du monde) ;
- La vocation d'Abraham, ou le commencement du peuple de Dieu et de l'Alliance (troisième âge du monde) ;
- Moïse ou la loi écrite (quatrième âge du monde) ;
- La prise de Troie et les temps héroïques ;
- Salomon, ou le temple achevé (cinquième âge du monde) ;
- Romulus, ou Rome fondée ;
- Cyrus, ou les Juifs rétablis (sixième âge du monde) ;
- Scipion, ou Carthage vaincue ;
- Naissance de Jésus-Christ (septième et dernier âge du monde) ;
- Constantin, ou la paix de l'Église ;
- Charlemagne, ou l'établissement du nouvel empire.
Comme on le voit, l'histoire sainte et l'histoire profane sont savamment entremêlées par Bossuet, et placées l'une et l'autre sous l'autorité de la providence divine qui fait tout concourir à sa plus grande gloire. Dans les neufs époques qui précèdent la venue du Christ, et en dehors de la première renvoyant à la naissance de l'humanité en Adam, un équilibre parfait s'établit entre quatre personnages bibliques (Noé, Abraham, Moïse et Salomon) et quatre personnages de l'Antiquité classique (Homère, Romulus, Cyrus et Scipion). C'est ici que la volonté catholique de l'harmonie des deux cultures, la biblique et l'antique, s'exprime de la façon la plus éclatante, donnant au classicisme français son modèle indépassable. Elle permet aussi de souligner le fait que la providence divine exerce son autorité sur toute l'humanité et sur ses rois. Après la naissance du Christ, l'unité prend une forme nouvelle : Constantin et Charlemagne manifestent dans leur personne la soumission du pouvoir temporel au pouvoir spirituel, et annoncent ainsi la venue du règne de Dieu.
En 1750, Turgot, le maître et l'ami de Condorcet, prononce à la Sorbonne un discours resté célèbre présentant un Tableau philosophique des progrès successifs de l'esprit humain, où il développe trois grands thèmes : celui de "l'avancement réel de l'esprit humain, qui se décèle jusque dans ses égarements" ; celui de l'importance de la communication des idées et de la transmission du savoir que l'invention de l'imprimerie fera entrer dans une ère nouvelle ; enfin "les avantages que l'établissement du christianisme a procurés au genre humain". Turgot précise que la religion chrétienne, "en répandant sur la terre le germe du salut éternel, y a versé les lumières, la paix et le bonheur". [ltr]19[/ltr]
En 1793, quand Condorcet rédige sa propre Esquisse, il se souvient certainement du Tableau philosophique de Turgot, dont il reprend l'ambition, et il n'ignore pas le Discours de Bossuet, auquel il emprunte sa division en époques. Cependant, son programme est volontairement tout autre. Contre Bossuet, il rejette l'idée d'une Providence divine extérieure à l'humanité, et pose bien plutôt l'Esprit humain comme le seul acteur et auteur de son histoire et de ses progrès. Contre Turgot, il refuse absolument la thèse du concours de la religion chrétienne au progrès intellectuel et spirituel de l'humanité. Pour Bossuet et Turgot, le recours à l'histoire permettait de lier le christianisme au salut de l'humanité. Il n'en va plus de même chez Condorcet : l'histoire illustre à la fois l'autosuffisance de l'esprit humain, seul responsable de sa marche vers le progrès, et le rôle néfaste de toutes les religions dans ce processus émancipateur. On assiste donc au retournement volontaire et conscient de la tradition apologétique de l'histoire providentielle. Mais cette différence fondamentale de contenu inscrit en même temps Condorcet dans la tradition chrétienne de l'histoire avec laquelle il prétend rompre. Car le retournement d'une tradition, ou même son utilisation polémique contre son modèle, n'implique aucune rupture structurelle. Bien plutôt, le résultat de cette opération se déploie sur le mode de la répétition simplement inversée. D'un argument en faveur de la religion chrétienne, l'histoire s'inverse en réquisitoire contre la religion en général. Mais, ce faisant, Condorcet n'échappe pas du tout à la forme de l'histoire providentielle et à la perspective du salut, héritées du christianisme, qu'il retrouve consciemment dans le devenir immanent de l'humanité. C'est donc à l'intérieur d'un cadre issu de la religion chrétienne, que Condorcet va s'employer à dénoncer les méfaits des religions. Ses principales thèses sont les suivantes :
Premièrement, les religions proviennent, dès l'origine de l'humanité, de l'élaboration et de la confiscation du savoir par une minorité savante. La différence entre la minorité savante et la masse ignorante est la structure de base de la religion.
Deuxièmement, les religions se développent à partir de la constitution d'une "caste sacerdotale" qui s'édifie sur la base fournie par la minorité savante. Cette caste, pour mieux asseoir son pouvoir sur le peuple, s'allie naturellement à la caste des chefs de guerre et des rois.
Troisièmement, le christianisme d'Église, loin de modifier ce système de domination, l'a encore aggravé. Les prêtres et les moines vont tout faire pour étouffer ou retarder les progrès de l'esprit humain, dans lesquels ils discernent la menace la plus sérieuse contre leur pouvoir. La domination des prêtres supposant l'ignorance du peuple, la caste sacerdotale ne peut que s'opposer au développement du savoir et de la science. Mais Condorcet reconnaît que le christianisme fait ainsi éclater la contradiction existant entre son message de base, l'Évangile, et le système de domination politique mis en place par l'Église romaine. C'est en ces termes qu'il évoque la conception évangélique de l'égalité des hommes : "Enfin, les principes de fraternité générale, qui faisaient partie de la morale chrétienne, condamnaient l'esclavage ; et les prêtres, n'ayant aucun intérêt politique à contredire sur ce point des maximes qui honoraient leur cause, aidèrent par leurs discours à une destruction que les événements et les mœurs devaient nécessairement amener. Ce changement a été le germe d'une révolution dans les destinées de l'espèce humaine ; elle lui doit d'avoir pu connaître la véritable liberté."[ltr]20[/ltr] Dans le même esprit, Condorcet saluera le rôle positif des Réformateurs, à travers leur doctrine du libre examen de l'Écriture Sainte, au service de l'émancipation de l'humanité.
Enfin, quatrièmement, l'événement qui fera basculer définitivement le sort de ce combat pour la domination intellectuelle et politique des sociétés européennes sera l'invention de l'imprimerie et la diffusion universelle des savoirs qu'elle rend possible. Dorénavant, la science n'est plus réservée à une élite, les Lumières ne peuvent plus être "mises sous le boisseau ", dorénavant se développe une "opinion publique" qui devient progressivement le seul juge des débats et des combats en faveur des progrès de l'esprit humain. Cet événement décisif entraînera le déclin inexorable du pouvoir sacerdotal et son remplacement prévisible par la nouvelle classe des savants, qui est inséparable de la publicité du débat intellectuel et de l'universalité de sa diffusion. Annonçant Auguste Comte, Condorcet prédit la victoire de la communauté scientifique et sa substitution à la caste sacerdotale. La confiance qu'il porte aux savants repose moins sur une croyance naïve dans une amélioration morale de la nature humaine que sur le constat du changement des conditions réelles de production et de diffusion du savoir.
On le voit, l'originalité de Condorcet repose bien sur une analyse principalement "politique" du rôle de la religion dans l'histoire, faisant écho aux propos de Marx selon lesquels les Français avaient fait la révolution dans la politique, alors que les Anglais l'avaient faite dans l'économie, et qu'il appartenait aux Allemands de la faire en philosophie. La confrontation historique, ainsi que sa solution, sont entièrement de nature politique : le savant est appelé à supplanter le prêtre comme détenteur du pouvoir spirituel, de même que la science remplace progressivement la religion en tant que mode de production du savoir, et que le règne de "l'opinion publique" met définitivement fin au principe d'autorité. On trouve ici une des sources historiques de la laïcité républicaine : la méfiance devant le rôle "obscurantiste" des religions et la certitude que la science et la raison vont s'imposer dans la conscience du peuple. Est-il besoin d'ajouter que la dénonciation systématique du rôle néfaste des prêtres et des moines à laquelle s'est livrée, avec tant d'autres, Condorcet, n'a pas toujours abouti à un progrès des Lumières ? Un seul exemple suffira, parmi bien d'autres. En 1793, brûleront une semaine durant les ouvrages contenus dans la bibliothèque de l'abbaye de Cluny. "Ce gigantesque autodafé est dressé sur la place du champ de foire par le libraire Tournier. Les documents qui échappent au feu vont, durant plusieurs années, servir à fabriquer des milliers de couvercles pour les pots à confiture. Thibaudet rapporte que de belles feuilles d'antiphonaire, décorées de miniatures et de dorures, servent à fabriquer des cerfs-volants que certains se souviennent avoir lancés sur la place Notre-Dame."[ltr]21[/ltr] Comme l'illustrera Goya, les rêves de la raison peuvent aussi engendrer des monstres.
Quant aux espoirs qu'on peut placer dans le triomphe de l'esprit scientifique, ils font l'objet de la dixième époque de l'Esquisse de Condorcet, intitulée "Des progrès futurs de l'esprit humain". Il est à noter que, chez Bossuet, la dixième époque correspond à l'avènement du Christ. Pour Bossuet, comme pour Condorcet, cette dixième époque marque le début du "dernier âge de l'humanité ", dont s'inspirera la terminologie hégélienne de la "fin de l'histoire ". Chez Condorcet, trois questions vont y trouver une réponse nouvelle et positive grâce au développement prévisible des sciences : "Nos espérances sur l'état à venir de l'espèce humaine peuvent se réduire à ces trois points importants : la destruction de l'inégalité entre les nations ; les progrès de l'égalité dans un même peuple ; enfin, le perfectionnement réel de l'homme."[ltr]22[/ltr]
Mais l'optimisme de Condorcet, d'autant plus admirable qu'il s'exprime alors que, proscrit, il doit se cacher pour éviter l'arrestation qu'il pressent inévitable, ne repose pas sur l'ignorance des conditions historiques présentes de l'humanité. La contemplation du tableau à venir de l'humanité "affranchie de toutes ses chaînes", écrit Condorcet, "présente au philosophe un spectacle qui le console des erreurs, des crimes, des injustices dont la terre est encore souillée, et dont il est souvent la victime" [ltr]23.[/ltr] Comment ne pas comparer ces dernières lignes à laConsolation de la philosophie de Boèce ? Par delà les siècles, par-delà le christianisme proclamé de l'un et l'anti-christianisme militant de l'autre, une même tonalité proprement philosophique résonne et nous parle encore aujourd'hui : la foi dans la victoire de la raison, malgré le triomphe apparent de l'injustice et de l'oppression, dont on peut être soi-même la victime.
C'est finalement un XVIIIème siècle complexe et puissant jusque dans ses apories qui surgit de ce trop bref tableau des relations de la philosophie des Lumières avec les religions. Le procès de Dieu, s'il ne parvient pas à asseoir le triomphe de la raison, éclaire d'un jour nouveau ce besoin du divin présent au cœur du sujet de la connaissance. La solution du conflit entre la philosophie et la Révélation, si elle se révèle peu stable dans ses fondements et limitée dans sa durée, oblige à penser les conditions de possibilité d'une parole divine adressée à l'humanité. La généalogie de la religion, si elle rend incertaine toute sortie de l'ère religieuse, amène à réfléchir sur les raisons de cette permanence constitutive de l'humain. Quant à la dénonciation du rôle politique de la caste sacerdotale et de ses abus obscurantistes, si elle risque toujours de faire le lit d'un nouveau fanatisme, elle suppose de s'interroger sur la capacité de la science à répondre à l'angoisse des hommes. Enfin le recours à l'histoire, si caractéristique du rapport aux religions de la philosophie française de la laïcité, depuis l'Esquisse de Condorcet jusqu'à l'Uchronie de Charles Renouvier, parue en 1876, en passant par la loi des trois états énoncée par Auguste Comte dans le Discours sur l'Esprit positif de 1844, s'il permet de donner sens à la spécificité et à la variété du phénomène religieux, oblige à revenir sur la problématique du salut historique et de la fin de l'histoire.
Mais l'actualité profonde du XVIIIème siècle ne réside pas seulement dans la richesse et le foisonnement parfois contradictoire des questions et des réponses qu'il nous a léguées. Elle vaut, plus profondément encore, par son exemple intellectuel et moral, qui peut nous aider dans la réflexion urgente, à plus d'un titre, sur le devenir de la laïcité française. La première leçon est celle du courage de la raison, prête à aller jusqu'au bout d'elle-même dans sa confrontation avec Dieu, la Révélation et les religions, fidèle à la formule antique selon laquelle "rien de ce qui est humain ne peut lui rester étranger". La deuxième leçon est de ne pas se contenter de réfléchir sur le "fait" religieux, mais d'oser la question du sens et de la vérité, en reconnaissant la contribution qu'y apportent les religions. À ces deux sources, qui nous placent à "l'ombre des Lumières", pourra s'abreuver la réflexion philosophique dont la laïcité a besoin aujourd'hui.

- HUME, Dialogues sur la Religion naturelle, trad. M. Malherbe, Vrin, Paris, 1987, p. 158.
- Ibid.
- Traité des trois imposteurs, Max Milo Editions, Paris, 2002, p. 61.
- DIDEROT, Œuvres philosophiques, textes établis par P. Vernière, Garnier, Paris, 1964, p. 39.
- VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, Garnier-Flammarion, Paris, 1964, p. 333-334.
- DIDEROT, Œuvres philosophiques, op. cit., p. 17-18.
- KANT, Le conflit des Facultés, trad. J. Gibelin, Vrin, Paris, 1973, p. 27.
- Ibid., p. 38.
- Ibid.
- Ibid., p. 38-39.
- Ibid., p. 39.
- HUME, L'histoire naturelle de la religion, trad. M. Malherbe, Vrin, Paris, 1980, p. 39.
- Ibid., p. 44-45.
- HUME, Dialogues sur la Religion naturelle, op. cit., p. 144-145.
- Ibid., p. 158.
- HUME, L'histoire naturelle de la religion, op. cit., p. 46-47.
- Ibid., p. 77.
- BOSSUET, Discours sur l'histoire universelle, Garnier-Flammarion, Paris, 1966, p. 41.
- CONDORCET, Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, Garnier-Flammarion, Paris, 1988, Introduction, p. 42-43.
- Ibid., p. 164.
- Agnès GERHARDS, L'Abbaye de Cluny, Complexe, Bruxelles, 1992, p. 93-94.
- CONDORCET, Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, op. cit., p. 265-266.
- Ibid., p. 296.
 Re: Religion et Philosophie
Re: Religion et Philosophie
Science, philosophie, religion : quels rapports ?
dossier "Science et religions"
Peut-on « sauver » la religion ? Cette question peut sembler saugrenue tant les religions semblent se porter à merveille, à l’échelle du monde. Mais ce qui est curieux c’est que, dans une Europe relativement déchristianisée, la religion est redevenue, aux yeux de beaucoup de non croyants, intellectuellement respectable. Tant que la religion s’exprime sous une forme « modérée », elle est perçue comme compatible avec la démocratie, la science, la laïcité, l’égalité homme/femme, etc. Mais cette position est-elle intellectuellement défendable ?
Science et religion
Un sondage publié en août 2010 par l’hebdomadaire Le Point [1], fait auprès de 16 membres du Collège de France, montre que 75 % des interviewés disent ne pas croire en Dieu, mais que 85 % d’entre eux pensent que l’on peut « concilier » science et croyance. Malheureusement, on ne leur a pas demandé ce qu’ils entendaient par « concilier ». On pourrait donner un sens très faible à ce mot en le réduisant à l’observation que beaucoup de grands scientifiques se sont déclarés croyants. Mais, comme le fait remarquer Richard Dawkins [2], il y a de moins en moins de grands scientifiques croyants. Et, pour ceux de l’époque de Galilée ou Newton, qui vivaient dans des sociétés où l’athéisme était fortement réprimé, on doit se poser la question de leur sincérité ou, du moins, de savoir dans quelle mesure ils ne faisaient pas de nécessité vertu. Darwin, qui vivait à une époque ultérieure, était sans doute athée, mais était bien trop respectueux des mœurs de son temps (et des opinions de sa femme) pour en faire état publiquement. Néanmoins, comme on le verra plus loin, la question cruciale est de savoir ce que les savants croyants veulent dire exactement quand ils disent « croire en Dieu ».
On pourrait cependant donner un sens plus fort au terme « concilier », à savoir que l’on peut rationnellement être à la fois scientifique et croyant. Et, bien que ce sondage soit incomplet et pas très représentatif, il est probable qu’il reflète l’opinion dominante de beaucoup de scientifiques et d’incroyants : nous, personnellement, ne croyons pas ou nous « n’avons pas la foi », mais il n’y a, par ailleurs, aucune opposition entre science et religion. Il existe de multiples façons d’exprimer cette idée :
La plupart des religieux « modernes », surtout parmi les chrétiens, tiennent le même genre de discours : ils ne pensent nullement contester la théorie de l’évolution ou toute autre théorie scientifique et voient la religion comme totalement indépendante de la science et par conséquent, conciliable avec elle. Ce consensus peut paraître étrange car, après tout, pendant des siècles, il y a bien eu un combat entre science et religion (voir Science et Religion de Bertrand Russel [3] pour une description détaillée) ; pourquoi ce combat se serait-il terminé ? Est-ce la science qui a changé ? Ou la religion ? Ou les deux ? Pour tenter de répondre à ces questions, il faut d’abord examiner les différents sens que peut avoir la croyance religieuse.
Que veut dire « croire en Dieu » ?
Il existe en fait différentes sortes de croyances religieuses qu’on pourrait résumer en parlant de différents « Dieux » : le Dieu-superstition, le Dieu-métaphysique et le Dieu-garant-de-la-morale ; avant d’expliciter ces notions, soulignons que l’expression « Dieu » est utilisée ici pour parler de façon condensée « d’une forme de Dieu auquel certaines personnes croient » et qu’on utilise le mot Dieu au singulier, pour la facilité, mais que les croyances auxquelles cette expression renvoie sont très variées.
Lorsque l’on visite un temple en Inde, on y voit un grand nombre de gens, souvent très pauvres, qui font des offrandes ou se prosternent devant ce que les chrétiens et les musulmans appellent des idoles, c’est-à-dire des statues de pierre représentant différentes divinités. Si l’on questionne ces personnes sur leurs motivations, il est peu probable qu’elles répondent qu’elles « ont la foi » ou qu’elles « ont fait le choix » de vivre ainsi. Elles ne se posent sans doute pas de questions, mais elles « savent », ou plus exactement elles croient savoir, que ces cultes ont des effets bénéfiques dans leur vie et que les négliger risque d’avoir des conséquences négatives. Leur poser la question des raisons de leurs croyances semblerait aussi saugrenu à leurs yeux que nous paraîtrait à nous la question de savoir pourquoi nous « croyons » que la bataille de Waterloo a eu lieu en 1815 ou que Tokyo est la capitale du Japon. Ce sont des faits bien connus dirions-nous, et eux répondraient sans doute la même chose.
Dieu-superstition
Cela illustre l’idée du Dieu-superstition qui est, avant tout, une sorte de personne humaine, ayant comme nous des désirs et des caprices, mais invisible et dotée de pouvoirs surnaturels. C’est quelqu’un qui répond à nos prières, accomplit des miracles et nous punit si l’on manque de respect à son égard. Contrairement à ce que voudraient croire les théologiens et les intellectuels chrétiens ou musulmans, qui aspirent à une religion « pure », non superstitieuse, ce Dieu-superstition est probablement le véritable Dieu de l’immense majorité des croyants, le Dieu qui intéresse réellement la plupart des êtres humains, parce que ceux-ci se préoccupent avant tout de leur bien-être, de leur santé, de la réussite de leurs enfants et que ce Dieu-superstition est supposé les aider sur ce plan-là, dans la vie ici-bas, non dans l’au-delà. C’est le Dieu-superstition que l’on invoque pour guérir d’une maladie, pour éviter des intempéries ou des catastrophes naturelles, ou encore pour « avoir la force » de surmonter diverses épreuves. C’est aussi le Dieu du « Gott mit uns », le Dieu qui « bénit l’Amérique » ou, plus prosaïquement, celui auquel pensent les joueurs de football qui font le signe de croix en montant sur le terrain.

 Jan Brueghel l’Ancien et Pierre Paul Rubens, Le jardin d’Eden et la chute de l’homme (1615)
Jan Brueghel l’Ancien et Pierre Paul Rubens, Le jardin d’Eden et la chute de l’homme (1615)
Le Dieu-superstition est analogue à la croyance aux esprits, à l’animisme ou au polythéisme, mais, malgré les dénégations de leurs représentants officiels, il est extrêmement présent dans les religions nominalement monothéistes ; pensons simplement aux images de saints, aux pèlerinages, aux bougies dans les églises, etc. et au caractère massif et extraordinairement populaire de ce genre de phénomènes.
Pour illustrer le fait que les croyances religieuses modernes ne sont pas tellement plus rationnelles que l’animisme, l’anthropologue Pascal Boyer rapporte l’histoire d’un dîner à Cambridge, au cours duquel il expliquait que chez les Fang, un peuple gabonais, on croit que les sorciers ont un organe interne qui s’envole la nuit pour détruire les récoltes des gens et qu’ils organisent des festins pendant lesquels ils dévorent leurs victimes. Un théologien catholique présent lui dit que ce qui rendait l’anthropologie passionnante, c’était d’essayer de comprendre comment les gens pouvaient croire de telles inepties. Pascal Boyer fut trop poli pour lui répondre, mais il se dit que les Fang n’en reviendraient pas si on leur expliquait que« trois personnes étaient en réalité une seule personne tout en étant trois personnes, ou que tous nos malheurs dans cette vallée de larmes sont dus à deux ancêtres qui ont voulu goûter à un fruit exotique dans un jardin »[4].
Le théologien lui aurait sans doute répondu que les croyances catholiques, dans leur aspect superstitieux, ne doivent pas être prises au pied de la lettre. Mais si l’on « retirait » les superstitions des religions monothéistes comme le souhaitent certains théologiens et intellectuels, ces religions ne conserveraient que peu d’adeptes. En fait, ces théologiens et intellectuels sont tout aussi athées que les athées déclarés par rapport au Dieu-superstition, c’est-à-dire par rapport à celui qui compte réellement pour l’immense majorité des croyants.
 Piero della Francesca, Saint Antoine ressuscite un enfant, 1460
Piero della Francesca, Saint Antoine ressuscite un enfant, 1460
La sécularisation de nos sociétés n’a pas fait réellement disparaître le Dieu-superstition, elle l’a en partie déplacé vers les superstitions usuelles : l’astrologie ou les médecines parallèles. On peut même voir la psychanalyse, qui est sans doute, à l’heure actuelle, en France, la plus intellectuelle des superstitions, comme une forme d’animisme : l’inconscient freudien fonctionnant comme une sorte d’esprit ayant, tout comme notre esprit, des désirs et des aspirations. Bien sûr, cet inconscient ne répond pas à nos prières, mais il existe une sorte de prêtres, les psychanalystes, qui sont supposés y avoir accès et sont, parfois, capables de le manipuler.
Le Dieu-superstition entre manifestement en conflit avec la science moderne, comme toutes les superstitions. Des assertions faites à propos de miracles ou de l’efficacité de la prière sont parfaitement testables, au moins autant que les assertions de l’astrologie ou des médecines parallèles. Les tests réalisés jusqu’à présent sont négatifs (voir Dawkins, Pour en finir avec Dieu [2])[ltr]1[/ltr].
Un autre problème du Dieu-superstition, c’est sa multiplicité. Toutes les cultures ont ce genre de croyances et il est difficile d’imaginer qu’elles soient toutes vraies ; cela justifierait un degré de polythéisme difficile à accepter. Mais, dans toutes les cultures, on trouvera des témoignages sur l’efficacité des prières et la présence de miracles ; si les chrétiens et les musulmans n’accordent que peu de foi aux miracles, mettons, de la religion hindoue, pourquoi accorder foi à leurs prodiges ?
Une façon d’essayer de sortir du problème de la multiplicité des croyances, c’est d’introduire le Dieu-métaphysique ; celui-ci est le créateur de l’Univers, le fondement de l’Être, le premier moteur, le principe fondamental du Tout. C’est peut-être l’Inconnu suprême, le Dieu négatif, le « quelque chose qui nous dépasse », le mystère absolu. C’est le Dieu dont St Thomas, St Anselme, Descartes ou Gödel ont tenté de prouver l’existence. C’est le Grand Architecte de l’Univers. C’est le Dieu des déistes et celui sur l’existence duquel les agnostiques refusent de se prononcer. Pour certains, le Dieu-métaphysique peut même se réduire à la Nature ou à ses Lois, auquel cas l’épithète métaphysique devient discutable.
Dieu-métaphysique
 Dieu, Grand Architecte, enluminure médiévale (vers1250)
Dieu, Grand Architecte, enluminure médiévale (vers1250)
Quand Bertrand Russell fut mis en prison pendant la première guerre mondiale pour son opposition à la guerre, le gardien lui demanda quelle était sa religion. Il répondit « agnostique » et le gardien, perplexe lui dit : « je pense que cela va, nous croyons tous dans le même Dieu ». C’était de nouveau du Dieu-métaphysique qu’il s’agissait, Russell n’étant sûrement pas agnostique par rapport au Dieu-superstition. Le Dieu-métaphysique est le seul qui peut être le « même » pour tout le monde, parce qu’il ne possède aucune propriété précise, contrairement au Dieu-superstition, dont les propriétés varient d’une culture à l’autre.
C’est sur le Dieu-métaphysique que se concentrent les discussions sur l’athéisme, l’agnosticisme ou les relations entre science et foi. La bonne posture n’est pas de nier l’existence du Dieu-métaphysique (comme on doit le faire avec le Dieu-superstition) mais de rejeter la question comme étant dénuée de sens et d’intérêt. En effet, que savons-nous de Lui, rien, strictement rien – et c’est bien pour cela qu’il est raisonnable de le mettre de côté. Ce qui intéresse réellement les êtres humains, c’est un Dieu qui s’ingère dans nos affaires, en nous aidant ou en punissant les « méchants ».
Mais comment peut-on imaginer que le Dieu-métaphysique se préoccupe le moins du monde de savoir si Ahmed ou Jacob mangent du porc, si Fatima a un voile qui cache ses cheveux, ou si Jacques va à la messe tous les dimanches ? Ce Dieu-là se préoccupe-t-il de savoir qui gagne une guerre ou un match de football ? Se soucie-t-il même de cette petite créature s’agitant sur une planète perdue dans l’Univers et qu’on appelle l’Homme ?
Quand on dit que certains scientifiques célèbres sont croyants, on parle presque toujours de la croyance en un Dieu-métaphysique, pas en un Dieu-superstition. Et quand les membres du Collège de France disent que science et croyance sont compatibles, ils pensent sans doute à la croyance dans le Dieu-métaphysique, pas dans le Dieu-superstition, qui est évidemment incompatible avec la science.
Le Dieu-métaphysique est néanmoins incompatible avec l’esprit de la science, précisément parce qu’il est métaphysique, c’est-à-dire inconnaissable et qu’aucune hypothèse faite à son sujet ne peut être testée.
Le Dieu-métaphysique est aussi le Dieu du « principe anthropique », qui
 Saint Augustin, Piero della Francesca (vers 1460)
Saint Augustin, Piero della Francesca (vers 1460)
affirme que diverses constantes physiques ont dû être soigneusement « choisies » pour que la vie ait pu exister dans l’Univers et celui du « dessein intelligent » qui considère que la sélection naturelle ne peut, à elle seule, expliquer l’évolution de la vie. C’est le Dieu dont on parle quand on dit que la science mène à Dieu, ou que l’on veut aller « au-delà » de la science, tout en prétendant rester dans sa logique, en invoquant la théorie du chaos, la mécanique quantique ou le théorème de Gödel. Mais ces Dieux ne font que remplir artificiellement les trous (bien réels) dans nos connaissances. Comme personne ne peut inférer la moindre propriété concrète du dessein intelligent ou de ce qui serait derrière le principe anthropique, à part le fait qu’ils ont exactement les propriétés nécessaires pour que le monde soit ce qu’il est, les invoquer revient à dire « on ne sait pas ».
La différence entre les athées et les agnostiques porte presque toujours sur le Dieu métaphysique – les agnostiques pensent souvent que l’athéisme consiste à affirmer avec certitude l’inexistence du Dieu métaphysique, ce qui est effectivement, presque par définition, impossible. Si, par contre, on définit l’athéisme comme le rejet du Dieu-superstition et comme l’indifférence à l’égard de l’inconnaissable Dieu-métaphysique, alors la différence avec l’agnosticisme devient difficile à définir.
La seule façon de faire un lien entre le Dieu-superstition et le Dieu-métaphysique est à travers la révélation ou l’envoi d’un « messager ». Dans la révélation, le Dieu tout puissant, créateur de l’Univers, de toutes les choses visibles et invisibles, etc. explique aux hommes ce qu’il attend d’eux, comment le respecter et comment obtenir certains avantages. Tout cela est en général expliqué dans un Livre.
Mais la révélation rencontre un problème similaire à celui de la superstition : laquelle choisir ? Même en se restreignant aux religions du Livre, on a l’embarras du choix, non seulement entre judaïsme, christianisme et islam, mais entre toutes les variantes à l’intérieur de ces différentes religions. Même à l’intérieur d’une variante donnée, mettons le catholicisme, où il existe une hiérarchie qui garantit en principe l’homogénéité idéologique, on trouve un grand nombre d’interprétations divergentes.
Évidemment, chaque religion ou chaque secte a sa propre apologétique, tendant à démontrer que son interprétation de son livre sacré est la « bonne ». Ce qu’il importe de souligner, c’est que chaque interprétation se justifie au moyen de critères qui sont, en fin de compte, purement humains. Les chrétiens diront que leur religion est plus compatible avec la démocratie, la laïcité ou le féminisme que l’islam. Les chrétiens de gauche ou les théologiens de la libération diront que leur version du christianisme est plus proche des pauvres. Les musulmans rétorqueront que leur religion est plus purement monothéiste, etc.
Mais comment savoir ce que le Dieu-métaphysique est ou veut vraiment ? Comment savoir s’il ne souhaite pas un ordre social injuste (à nos yeux), la soumission des femmes ou la dictature ? Comment même savoir s’il est unique et pas multiple ? Comment même imaginer un argument qui permette de départager les différentes religions ou interprétations de ce point de vue-là et non d’un point de vue purement humain ? On ne peut pas aller demander au Dieu métaphysique ce qu’il a vraiment voulu dire, parce que tout ce dont on dispose, c’est un certain nombre de textes, contradictoires entre eux, ouverts à une multitude d’interprétations, également contradictoires entre elles et nous n’avons accès à strictement rien d’autre.
L’autre problème lié aux révélations, c’est que les livres sacrés contiennent presque tous des textes indéfendables aujourd’hui, soit pour des raisons morales, soit à cause de développements scientifiques. La réponse des croyants est, en général, qu’il faut situer ces écrits dans le contexte de leur époque et tenir compte du fait qu’ils ont été produits par des êtres humains faillibles et imparfaits. Mais, à nouveau, comment séparer ce qui est humain de ce qui est vraiment révélé ? Qui sommes-nous pour traduire ce que Dieu a vraiment voulu dire ? L’attitude littéraliste, même si elle force ses adhérents à avaler un bon nombre de couleuvres, a au moins l’avantage de la cohérence.
Dieu-garant-de-la-morale
Finalement, il y a le Dieu-garant-de-la-morale. Le Dieu-superstition est en partie garant de la morale, dans la mesure où il nous récompense et nous punit dans ce monde-ci pour nos actions.
 Le jardin des délices (détail). Jérôme Bosch (1516)
Le jardin des délices (détail). Jérôme Bosch (1516)
Mais comme manifestement les infortunes de la vertu et les prospérités du vice abondent dans le monde ici-bas, il faut nécessairement introduire l’idée d’une vie après la mort pour que justice soit faite. Et c’est cette idée qui pose le plus de problèmes. Elle est d’une certaine façon métaphysique, parce que non testable, tout en étant superstitieuse et en réalité incompréhensible : ce qui est supposé survivre à la mort physique, c’est d’une certaine façon notre esprit. Mais sous quelle forme ? Si quelqu’un meurt en état d’inconscience, est-ce que son esprit survit inconscient pour l’éternité ? Si non, sous quelle forme survit-il ? Revient-on à un âge antérieur à celui de notre mort et si oui, lequel ?
De nouveau, les théologiens apportent sans doute des réponses multiples à ces questions, mais sans jamais avoir le moyen de déterminer, même en principe, quelle est la bonne, parce qu’il n’y a aucun moyen d’interroger le Dieu-métaphysique sur le sort qu’il nous réserve dans l’au-delà.
En fin de compte, toutes les variantes de la « croyance en Dieu » sont bel et bien incompatibles avec la science, ou du moins avec son esprit.
Considérations pratiques
C’est le Dieu-garant-de-la-morale qui, d’un point de vue pratique, est le plus important de tous, parce que c’est lui qui fait en sorte que la religion ait un impact politique. Le Dieu-superstition fait beaucoup de tort, parce qu’il mène à préférer les mauvaises thérapies aux bonnes et en général, mène à des choix pratiques inefficaces, mais pas plus que les superstitions, puisqu’il est de même nature que celles-ci. Le Dieu-métaphysique, à lui seul, ne fait aucun tort si ce n’est d’obscurcir la pensée humaine, comme le fait en général la métaphysique, mais c’est sans doute un mal dont les effets sont limités.
Quels sont les effets du Dieu-garant-de-la-morale ? Diderot distinguait dans les « livres inspirés » (c’est-à-dire révélés) deux morales : « l’une, générale et commune à toutes les Nations, à tous les cultes et qu’on suit à peu près ; une autre, propre à chaque nation et à chaque culte, à laquelle on croit, qu’on prêche dans les temples, qu’on préconise dans les maisons, et qu’on ne suit point du tout » [5]. Quand Diderot dit qu’on ne suit « point du tout » la morale spécifique à chaque culte, il pense sans doute au christianisme décadent de son époque, mais il est évident qu’à d’autres époques et en d’autres lieux, les règles vestimentaires, culinaires ou sexuelles particulières à chaque religion, sont très suivies. Et, pour ce qui est de la « morale commune », ce concept est sans doute plus difficile à préciser que Diderot ne le pensait ; cependant, quand les gens abandonnent leurs croyances religieuses, ils abandonnent aussi certaines pratiques, celles liées spécifiquement à leur religion, mais ils ne se mettent pas, en règle générale, à tuer ou à voler leurs voisins, c’est-à-dire qu’ils continuent à respecter une morale commune et humaine.
Notons qu’un des principaux arguments des religieux est que seule la religion permet de garder les gens « dans le droit chemin » et de leur faire respecter justement cette morale commune. Cette idée est extrêmement répandue, y compris parmi beaucoup d’incroyants. Néanmoins, certaines études empiriques montrent une corrélation assez forte dans les pays développés entre croyance en Dieu et certains maux sociaux tels que les homicides, la mortalité juvénile, les maladies vénériennes, les adolescentes enceintes et même l’avortement [6]. Bien sûr, on ne peut pas tirer de cette corrélation un lien de cause à effet (il est probable que ces maux sociaux et la croyance religieuse aient des causes communes, par exemple l’inégalité sociale – voir [7]), mais cela montre que l’existence d’un lien causal inverse, entre absence de croyance religieuse et immoralité, que beaucoup de religieux soutiennent, est loin d’être démontrée. De toute façon, même si cet argument utilitariste en faveur de la religion (comme moyen de faire respecter la morale) était vrai, il ne nous dirait rien sur la question de savoir si celle-ci est vraie ou fausse.
Il y a un troisième impact moral de la religion, ce qu’on pourrait appeler l’encouragement au fanatisme, c’est-à-dire à des actions qui vont à l’encontre de la morale commune, tuer des innocents par exemple, ou imposer les morales particulières à une religion donnée à l’ensemble de la société. Le fanatisme est presque toujours lié à la croyance dans l’au-delà. En effet, si la vie ici-bas n’est qu’une préparation à la vie éternelle dans l’au-delà, pourquoi se soucier d’autres commandements que les commandements divins ou supposés tels ?
Évidemment, beaucoup de chrétiens modernes, libéraux ou « progressistes », ont laissé tomber les aspects fanatiques de leur religion, ainsi que l’interprétation littérale des textes sacrés. Ils mettent de côté l’idée du ciel et de l’enfer (en tout cas, de l’enfer) et se replient de plus en plus sur le Dieu métaphysique. À la limite, la question de savoir si ce qu’ils disent est vrai ou faux ne les intéresse pas. Ce qui compte, ce sont les « choix personnels » que l’on fait ou « se sentir bien ». Mais la question qu’on est en droit de leur poser est « que peut bien encore signifier votre religion ? » Lorsqu’ils parlent, comme ils le font souvent, de « donner du sens » ou de « l’espérance », qu’est-ce que cela veut dire si on ne croit pas à la vie éternelle ? Et si on y croit, pourquoi ne pas la prendre au sérieux et passer la vie ici-bas à s’y préparer en suivant à la lettre les prescriptions divines ?

 Krishna jouant de la flûte au milieu de vaches sacrées (vers 1740).
Krishna jouant de la flûte au milieu de vaches sacrées (vers 1740).
Le christianisme moderne est devenu tellement vide de contenu qu’il peut paraître inoffensif, et il l’est effectivement, si l’on met de côté la confusion intellectuelle qu’il engendre. Il a néanmoins des effets pervers : il amène bon nombre d’incroyants et de laïcs en Europe, à le prendre pour le paradigme de ce qu’est une religion. Ceci entraîne l’abandon progressif de la critique rationaliste de la religion, vue comme dépassée, étant donné le côté « inoffensif » du christianisme moderne. Une des raisons pour lesquelles beaucoup de laïcs et de scientifiques acceptent l’idée de la compatibilité entre science et foi, c’est que, présentée sous la forme du christianisme moderne, la foi ne veut plus rien dire (ou presque). Mais d’un point de vue géographique et historique, le christianisme moderne est une aberration dans l’ensemble de croyances religieuses qui sont, pour la plupart, littéralistes.
De plus, cela amène beaucoup d’incroyants à exiger des autres religions, l’islam ici ou le christianisme fondamentaliste aux États-Unis, qu’elles « s’adaptent » ou se « modernisent », pour ressembler au christianisme moderne. Mais c’est oublier que celui-ci est le résultat de siècles de combat rationaliste contre la religion, la croyance, et l’irrationnel en général. Les chrétiens modernes ne le sont pas devenus parce qu’on leur a dit d’être laïcs ou d’être gentils avec les femmes, les homosexuels ou les incroyants, mais parce que la solidité de leurs croyances a été petit à petit sapée par la critique scientifique et rationaliste. Le christianisme moderne est en grande partie une réaction d’adaptation face à la défaite intellectuelle du christianisme traditionnel.
La critique des religions qui sont considérées comme nocives (en Europe, essentiellement, l’islam) est aujourd’hui presque exclusivement une critique morale, se concentrant sur les aspects « barbares » de certaines pratiques particulières, sur le fondamentalisme au niveau dogmatique, ou sur le fanatisme. Mais c’est sous-estimer le fait que la critique purement morale de la religion est sans effet, parce que ce qui semble fanatique aux incroyants est parfaitement rationnel pour les croyants, du moins pour ceux qui prennent au sérieux l’idée de la vie éternelle et du ciel et de l’enfer. Si on accepte ces prémisses (sur le ciel et l’enfer) il serait totalement absurde de risquer d’aller en enfer pour se conformer à de simples prescriptions humaines. Pour changer les comportements, il faudrait d’abord ébranler les croyances et, pour cela, revenir à une critique rationaliste et non purement morale de la religion.
Un autre problème rencontré par la critique morale de la religion est que les religieux ripostent en soulignant le côté immoral de nombreux courants athées ou supposés tels ; au choix : nazisme, communisme, colonialisme, ou consumérisme destructeur de l’environnement. D’un côté, on hurle en parlant de l’Inquisition ou des Croisades et de l’autre, on répond avec Hitler et Staline. Si les incroyants disent que les idées de ces derniers constituent en réalité une forme de croyance quasi-religieuse, les croyants répondront que la violence faite au nom de la religion est une déformation du « véritable » message religieux. On ne s’en sort pas, tant qu’on ne pose pas la question de la vérité : le discours religieux est-il vrai ou faux ? Imaginons un instant que Dieu existe vraiment et qu’il aime, mettons les Croisades, l’Inquisition ou le régime féodal, comme on l’imaginait au Moyen-Âge. Il enverrait par conséquent en enfer tous ceux, y compris les chrétiens modernes, qui s’opposent à ces pratiques. Quelle objection pourrait-on bien soulever dans ce cas à ces pratiques que nous condamnons comme moyenâgeuses ? Bien sûr, presque plus personne ne croit dans ce genre de Dieu, mais justement, cela veut dire qu’on ne croit plus que ce type de discours religieux soit vrai. Et cela montre que même le discours chrétien moderne qui tente de mettre de côté la question de la vérité ou de la fausseté de la religion, présuppose que certaines choses auxquelles les croyants ont adhéré pendant des siècles sont, en réalité, fausses.
Le christianisme moderne fonctionne comme une sorte de ruse de la déraison qui amène les incroyants à ne plus comprendre la logique de la religion, à abandonner la critique rationaliste de celle-ci et à la combattre lorsqu’ils considèrent ce combat nécessaire, à travers un discours purement moralisateur dont on peut sérieusement craindre qu’il ne soit totalement inefficace.
Références
[1] Le Point, n° 1977, 5 août 2010, p. 44.
[2] Richard Dawkins, Pour en finir avec Dieu, (trad. M-F Desjeux-Lefort) Librairie Académique Perrin, Paris, 2009.
[3] Bertrand Russell, (trad. Philippe-Roger Mantoux), Science et religion, Gallimard, Paris, 1990.
[4] Pascal Boyer, Et l’homme créa les dieux, Robert Laffont, Paris 2001, p. 293.
[5] Denis Diderot, Pour une morale de l’athéisme. Entretien d’un philosophe avec la maréchale de ***. Mille et une nuits, Paris, 2007, p. 24.
[6] Gregory S. Paul, « Cross-National Correlations of Quantifiable Societal Health with Popular Religiosity and Secularism in the Prosperous Democracies : A First Look », Journal of Religion & Society 7 (2005), [ltr]http://moses.creighton.edu/jrs/2005...[/ltr]
[7] Sur le lien entre inégalité et maux sociaux, voir Richard Wilkinson, Kate Pickett, The Spirit Level. Why Equality is Better for Everyone, Penguin Books, Londres, 2010.
[ltr]1[/ltr] Les premières études statistiques sur l’(in)efficacité de la prière remontent au moins à Francis Galton, « Statistical Enquiries into the Efficacy of Prayers », The Fortnightly Review, n° 12, août 1872, p. 125-135.
dossier "Science et religions"
Peut-on « sauver » la religion ? Cette question peut sembler saugrenue tant les religions semblent se porter à merveille, à l’échelle du monde. Mais ce qui est curieux c’est que, dans une Europe relativement déchristianisée, la religion est redevenue, aux yeux de beaucoup de non croyants, intellectuellement respectable. Tant que la religion s’exprime sous une forme « modérée », elle est perçue comme compatible avec la démocratie, la science, la laïcité, l’égalité homme/femme, etc. Mais cette position est-elle intellectuellement défendable ?
Science et religion
Un sondage publié en août 2010 par l’hebdomadaire Le Point [1], fait auprès de 16 membres du Collège de France, montre que 75 % des interviewés disent ne pas croire en Dieu, mais que 85 % d’entre eux pensent que l’on peut « concilier » science et croyance. Malheureusement, on ne leur a pas demandé ce qu’ils entendaient par « concilier ». On pourrait donner un sens très faible à ce mot en le réduisant à l’observation que beaucoup de grands scientifiques se sont déclarés croyants. Mais, comme le fait remarquer Richard Dawkins [2], il y a de moins en moins de grands scientifiques croyants. Et, pour ceux de l’époque de Galilée ou Newton, qui vivaient dans des sociétés où l’athéisme était fortement réprimé, on doit se poser la question de leur sincérité ou, du moins, de savoir dans quelle mesure ils ne faisaient pas de nécessité vertu. Darwin, qui vivait à une époque ultérieure, était sans doute athée, mais était bien trop respectueux des mœurs de son temps (et des opinions de sa femme) pour en faire état publiquement. Néanmoins, comme on le verra plus loin, la question cruciale est de savoir ce que les savants croyants veulent dire exactement quand ils disent « croire en Dieu ».
On pourrait cependant donner un sens plus fort au terme « concilier », à savoir que l’on peut rationnellement être à la fois scientifique et croyant. Et, bien que ce sondage soit incomplet et pas très représentatif, il est probable qu’il reflète l’opinion dominante de beaucoup de scientifiques et d’incroyants : nous, personnellement, ne croyons pas ou nous « n’avons pas la foi », mais il n’y a, par ailleurs, aucune opposition entre science et religion. Il existe de multiples façons d’exprimer cette idée :
- La science répond à la question du « comment ? » mais pas du « pourquoi ? »
- La science ne répond pas à la question du sens.
- La science s’occupe de questions de fait, la religion de questions de valeur. Ce sont des « registres » différents.
- La religion s’occupe de questions « ultimes ».
La plupart des religieux « modernes », surtout parmi les chrétiens, tiennent le même genre de discours : ils ne pensent nullement contester la théorie de l’évolution ou toute autre théorie scientifique et voient la religion comme totalement indépendante de la science et par conséquent, conciliable avec elle. Ce consensus peut paraître étrange car, après tout, pendant des siècles, il y a bien eu un combat entre science et religion (voir Science et Religion de Bertrand Russel [3] pour une description détaillée) ; pourquoi ce combat se serait-il terminé ? Est-ce la science qui a changé ? Ou la religion ? Ou les deux ? Pour tenter de répondre à ces questions, il faut d’abord examiner les différents sens que peut avoir la croyance religieuse.
Que veut dire « croire en Dieu » ?
Il existe en fait différentes sortes de croyances religieuses qu’on pourrait résumer en parlant de différents « Dieux » : le Dieu-superstition, le Dieu-métaphysique et le Dieu-garant-de-la-morale ; avant d’expliciter ces notions, soulignons que l’expression « Dieu » est utilisée ici pour parler de façon condensée « d’une forme de Dieu auquel certaines personnes croient » et qu’on utilise le mot Dieu au singulier, pour la facilité, mais que les croyances auxquelles cette expression renvoie sont très variées.
Lorsque l’on visite un temple en Inde, on y voit un grand nombre de gens, souvent très pauvres, qui font des offrandes ou se prosternent devant ce que les chrétiens et les musulmans appellent des idoles, c’est-à-dire des statues de pierre représentant différentes divinités. Si l’on questionne ces personnes sur leurs motivations, il est peu probable qu’elles répondent qu’elles « ont la foi » ou qu’elles « ont fait le choix » de vivre ainsi. Elles ne se posent sans doute pas de questions, mais elles « savent », ou plus exactement elles croient savoir, que ces cultes ont des effets bénéfiques dans leur vie et que les négliger risque d’avoir des conséquences négatives. Leur poser la question des raisons de leurs croyances semblerait aussi saugrenu à leurs yeux que nous paraîtrait à nous la question de savoir pourquoi nous « croyons » que la bataille de Waterloo a eu lieu en 1815 ou que Tokyo est la capitale du Japon. Ce sont des faits bien connus dirions-nous, et eux répondraient sans doute la même chose.
Dieu-superstition
Cela illustre l’idée du Dieu-superstition qui est, avant tout, une sorte de personne humaine, ayant comme nous des désirs et des caprices, mais invisible et dotée de pouvoirs surnaturels. C’est quelqu’un qui répond à nos prières, accomplit des miracles et nous punit si l’on manque de respect à son égard. Contrairement à ce que voudraient croire les théologiens et les intellectuels chrétiens ou musulmans, qui aspirent à une religion « pure », non superstitieuse, ce Dieu-superstition est probablement le véritable Dieu de l’immense majorité des croyants, le Dieu qui intéresse réellement la plupart des êtres humains, parce que ceux-ci se préoccupent avant tout de leur bien-être, de leur santé, de la réussite de leurs enfants et que ce Dieu-superstition est supposé les aider sur ce plan-là, dans la vie ici-bas, non dans l’au-delà. C’est le Dieu-superstition que l’on invoque pour guérir d’une maladie, pour éviter des intempéries ou des catastrophes naturelles, ou encore pour « avoir la force » de surmonter diverses épreuves. C’est aussi le Dieu du « Gott mit uns », le Dieu qui « bénit l’Amérique » ou, plus prosaïquement, celui auquel pensent les joueurs de football qui font le signe de croix en montant sur le terrain.
 Jan Brueghel l’Ancien et Pierre Paul Rubens, Le jardin d’Eden et la chute de l’homme (1615)
Jan Brueghel l’Ancien et Pierre Paul Rubens, Le jardin d’Eden et la chute de l’homme (1615)Le Dieu-superstition est analogue à la croyance aux esprits, à l’animisme ou au polythéisme, mais, malgré les dénégations de leurs représentants officiels, il est extrêmement présent dans les religions nominalement monothéistes ; pensons simplement aux images de saints, aux pèlerinages, aux bougies dans les églises, etc. et au caractère massif et extraordinairement populaire de ce genre de phénomènes.
Pour illustrer le fait que les croyances religieuses modernes ne sont pas tellement plus rationnelles que l’animisme, l’anthropologue Pascal Boyer rapporte l’histoire d’un dîner à Cambridge, au cours duquel il expliquait que chez les Fang, un peuple gabonais, on croit que les sorciers ont un organe interne qui s’envole la nuit pour détruire les récoltes des gens et qu’ils organisent des festins pendant lesquels ils dévorent leurs victimes. Un théologien catholique présent lui dit que ce qui rendait l’anthropologie passionnante, c’était d’essayer de comprendre comment les gens pouvaient croire de telles inepties. Pascal Boyer fut trop poli pour lui répondre, mais il se dit que les Fang n’en reviendraient pas si on leur expliquait que« trois personnes étaient en réalité une seule personne tout en étant trois personnes, ou que tous nos malheurs dans cette vallée de larmes sont dus à deux ancêtres qui ont voulu goûter à un fruit exotique dans un jardin »[4].
Le théologien lui aurait sans doute répondu que les croyances catholiques, dans leur aspect superstitieux, ne doivent pas être prises au pied de la lettre. Mais si l’on « retirait » les superstitions des religions monothéistes comme le souhaitent certains théologiens et intellectuels, ces religions ne conserveraient que peu d’adeptes. En fait, ces théologiens et intellectuels sont tout aussi athées que les athées déclarés par rapport au Dieu-superstition, c’est-à-dire par rapport à celui qui compte réellement pour l’immense majorité des croyants.
 Piero della Francesca, Saint Antoine ressuscite un enfant, 1460
Piero della Francesca, Saint Antoine ressuscite un enfant, 1460La sécularisation de nos sociétés n’a pas fait réellement disparaître le Dieu-superstition, elle l’a en partie déplacé vers les superstitions usuelles : l’astrologie ou les médecines parallèles. On peut même voir la psychanalyse, qui est sans doute, à l’heure actuelle, en France, la plus intellectuelle des superstitions, comme une forme d’animisme : l’inconscient freudien fonctionnant comme une sorte d’esprit ayant, tout comme notre esprit, des désirs et des aspirations. Bien sûr, cet inconscient ne répond pas à nos prières, mais il existe une sorte de prêtres, les psychanalystes, qui sont supposés y avoir accès et sont, parfois, capables de le manipuler.
Le Dieu-superstition entre manifestement en conflit avec la science moderne, comme toutes les superstitions. Des assertions faites à propos de miracles ou de l’efficacité de la prière sont parfaitement testables, au moins autant que les assertions de l’astrologie ou des médecines parallèles. Les tests réalisés jusqu’à présent sont négatifs (voir Dawkins, Pour en finir avec Dieu [2])[ltr]1[/ltr].
Un autre problème du Dieu-superstition, c’est sa multiplicité. Toutes les cultures ont ce genre de croyances et il est difficile d’imaginer qu’elles soient toutes vraies ; cela justifierait un degré de polythéisme difficile à accepter. Mais, dans toutes les cultures, on trouvera des témoignages sur l’efficacité des prières et la présence de miracles ; si les chrétiens et les musulmans n’accordent que peu de foi aux miracles, mettons, de la religion hindoue, pourquoi accorder foi à leurs prodiges ?
Une façon d’essayer de sortir du problème de la multiplicité des croyances, c’est d’introduire le Dieu-métaphysique ; celui-ci est le créateur de l’Univers, le fondement de l’Être, le premier moteur, le principe fondamental du Tout. C’est peut-être l’Inconnu suprême, le Dieu négatif, le « quelque chose qui nous dépasse », le mystère absolu. C’est le Dieu dont St Thomas, St Anselme, Descartes ou Gödel ont tenté de prouver l’existence. C’est le Grand Architecte de l’Univers. C’est le Dieu des déistes et celui sur l’existence duquel les agnostiques refusent de se prononcer. Pour certains, le Dieu-métaphysique peut même se réduire à la Nature ou à ses Lois, auquel cas l’épithète métaphysique devient discutable.
Dieu-métaphysique
 Dieu, Grand Architecte, enluminure médiévale (vers1250)
Dieu, Grand Architecte, enluminure médiévale (vers1250)Quand Bertrand Russell fut mis en prison pendant la première guerre mondiale pour son opposition à la guerre, le gardien lui demanda quelle était sa religion. Il répondit « agnostique » et le gardien, perplexe lui dit : « je pense que cela va, nous croyons tous dans le même Dieu ». C’était de nouveau du Dieu-métaphysique qu’il s’agissait, Russell n’étant sûrement pas agnostique par rapport au Dieu-superstition. Le Dieu-métaphysique est le seul qui peut être le « même » pour tout le monde, parce qu’il ne possède aucune propriété précise, contrairement au Dieu-superstition, dont les propriétés varient d’une culture à l’autre.
C’est sur le Dieu-métaphysique que se concentrent les discussions sur l’athéisme, l’agnosticisme ou les relations entre science et foi. La bonne posture n’est pas de nier l’existence du Dieu-métaphysique (comme on doit le faire avec le Dieu-superstition) mais de rejeter la question comme étant dénuée de sens et d’intérêt. En effet, que savons-nous de Lui, rien, strictement rien – et c’est bien pour cela qu’il est raisonnable de le mettre de côté. Ce qui intéresse réellement les êtres humains, c’est un Dieu qui s’ingère dans nos affaires, en nous aidant ou en punissant les « méchants ».
Mais comment peut-on imaginer que le Dieu-métaphysique se préoccupe le moins du monde de savoir si Ahmed ou Jacob mangent du porc, si Fatima a un voile qui cache ses cheveux, ou si Jacques va à la messe tous les dimanches ? Ce Dieu-là se préoccupe-t-il de savoir qui gagne une guerre ou un match de football ? Se soucie-t-il même de cette petite créature s’agitant sur une planète perdue dans l’Univers et qu’on appelle l’Homme ?
Quand on dit que certains scientifiques célèbres sont croyants, on parle presque toujours de la croyance en un Dieu-métaphysique, pas en un Dieu-superstition. Et quand les membres du Collège de France disent que science et croyance sont compatibles, ils pensent sans doute à la croyance dans le Dieu-métaphysique, pas dans le Dieu-superstition, qui est évidemment incompatible avec la science.
Le Dieu-métaphysique est néanmoins incompatible avec l’esprit de la science, précisément parce qu’il est métaphysique, c’est-à-dire inconnaissable et qu’aucune hypothèse faite à son sujet ne peut être testée.
Le Dieu-métaphysique est aussi le Dieu du « principe anthropique », qui
 Saint Augustin, Piero della Francesca (vers 1460)
Saint Augustin, Piero della Francesca (vers 1460)affirme que diverses constantes physiques ont dû être soigneusement « choisies » pour que la vie ait pu exister dans l’Univers et celui du « dessein intelligent » qui considère que la sélection naturelle ne peut, à elle seule, expliquer l’évolution de la vie. C’est le Dieu dont on parle quand on dit que la science mène à Dieu, ou que l’on veut aller « au-delà » de la science, tout en prétendant rester dans sa logique, en invoquant la théorie du chaos, la mécanique quantique ou le théorème de Gödel. Mais ces Dieux ne font que remplir artificiellement les trous (bien réels) dans nos connaissances. Comme personne ne peut inférer la moindre propriété concrète du dessein intelligent ou de ce qui serait derrière le principe anthropique, à part le fait qu’ils ont exactement les propriétés nécessaires pour que le monde soit ce qu’il est, les invoquer revient à dire « on ne sait pas ».
La différence entre les athées et les agnostiques porte presque toujours sur le Dieu métaphysique – les agnostiques pensent souvent que l’athéisme consiste à affirmer avec certitude l’inexistence du Dieu métaphysique, ce qui est effectivement, presque par définition, impossible. Si, par contre, on définit l’athéisme comme le rejet du Dieu-superstition et comme l’indifférence à l’égard de l’inconnaissable Dieu-métaphysique, alors la différence avec l’agnosticisme devient difficile à définir.
La seule façon de faire un lien entre le Dieu-superstition et le Dieu-métaphysique est à travers la révélation ou l’envoi d’un « messager ». Dans la révélation, le Dieu tout puissant, créateur de l’Univers, de toutes les choses visibles et invisibles, etc. explique aux hommes ce qu’il attend d’eux, comment le respecter et comment obtenir certains avantages. Tout cela est en général expliqué dans un Livre.
Mais la révélation rencontre un problème similaire à celui de la superstition : laquelle choisir ? Même en se restreignant aux religions du Livre, on a l’embarras du choix, non seulement entre judaïsme, christianisme et islam, mais entre toutes les variantes à l’intérieur de ces différentes religions. Même à l’intérieur d’une variante donnée, mettons le catholicisme, où il existe une hiérarchie qui garantit en principe l’homogénéité idéologique, on trouve un grand nombre d’interprétations divergentes.
Évidemment, chaque religion ou chaque secte a sa propre apologétique, tendant à démontrer que son interprétation de son livre sacré est la « bonne ». Ce qu’il importe de souligner, c’est que chaque interprétation se justifie au moyen de critères qui sont, en fin de compte, purement humains. Les chrétiens diront que leur religion est plus compatible avec la démocratie, la laïcité ou le féminisme que l’islam. Les chrétiens de gauche ou les théologiens de la libération diront que leur version du christianisme est plus proche des pauvres. Les musulmans rétorqueront que leur religion est plus purement monothéiste, etc.
Mais comment savoir ce que le Dieu-métaphysique est ou veut vraiment ? Comment savoir s’il ne souhaite pas un ordre social injuste (à nos yeux), la soumission des femmes ou la dictature ? Comment même savoir s’il est unique et pas multiple ? Comment même imaginer un argument qui permette de départager les différentes religions ou interprétations de ce point de vue-là et non d’un point de vue purement humain ? On ne peut pas aller demander au Dieu métaphysique ce qu’il a vraiment voulu dire, parce que tout ce dont on dispose, c’est un certain nombre de textes, contradictoires entre eux, ouverts à une multitude d’interprétations, également contradictoires entre elles et nous n’avons accès à strictement rien d’autre.
L’autre problème lié aux révélations, c’est que les livres sacrés contiennent presque tous des textes indéfendables aujourd’hui, soit pour des raisons morales, soit à cause de développements scientifiques. La réponse des croyants est, en général, qu’il faut situer ces écrits dans le contexte de leur époque et tenir compte du fait qu’ils ont été produits par des êtres humains faillibles et imparfaits. Mais, à nouveau, comment séparer ce qui est humain de ce qui est vraiment révélé ? Qui sommes-nous pour traduire ce que Dieu a vraiment voulu dire ? L’attitude littéraliste, même si elle force ses adhérents à avaler un bon nombre de couleuvres, a au moins l’avantage de la cohérence.
Dieu-garant-de-la-morale
Finalement, il y a le Dieu-garant-de-la-morale. Le Dieu-superstition est en partie garant de la morale, dans la mesure où il nous récompense et nous punit dans ce monde-ci pour nos actions.
 Le jardin des délices (détail). Jérôme Bosch (1516)
Le jardin des délices (détail). Jérôme Bosch (1516)Mais comme manifestement les infortunes de la vertu et les prospérités du vice abondent dans le monde ici-bas, il faut nécessairement introduire l’idée d’une vie après la mort pour que justice soit faite. Et c’est cette idée qui pose le plus de problèmes. Elle est d’une certaine façon métaphysique, parce que non testable, tout en étant superstitieuse et en réalité incompréhensible : ce qui est supposé survivre à la mort physique, c’est d’une certaine façon notre esprit. Mais sous quelle forme ? Si quelqu’un meurt en état d’inconscience, est-ce que son esprit survit inconscient pour l’éternité ? Si non, sous quelle forme survit-il ? Revient-on à un âge antérieur à celui de notre mort et si oui, lequel ?
De nouveau, les théologiens apportent sans doute des réponses multiples à ces questions, mais sans jamais avoir le moyen de déterminer, même en principe, quelle est la bonne, parce qu’il n’y a aucun moyen d’interroger le Dieu-métaphysique sur le sort qu’il nous réserve dans l’au-delà.
En fin de compte, toutes les variantes de la « croyance en Dieu » sont bel et bien incompatibles avec la science, ou du moins avec son esprit.
Considérations pratiques
C’est le Dieu-garant-de-la-morale qui, d’un point de vue pratique, est le plus important de tous, parce que c’est lui qui fait en sorte que la religion ait un impact politique. Le Dieu-superstition fait beaucoup de tort, parce qu’il mène à préférer les mauvaises thérapies aux bonnes et en général, mène à des choix pratiques inefficaces, mais pas plus que les superstitions, puisqu’il est de même nature que celles-ci. Le Dieu-métaphysique, à lui seul, ne fait aucun tort si ce n’est d’obscurcir la pensée humaine, comme le fait en général la métaphysique, mais c’est sans doute un mal dont les effets sont limités.
Quels sont les effets du Dieu-garant-de-la-morale ? Diderot distinguait dans les « livres inspirés » (c’est-à-dire révélés) deux morales : « l’une, générale et commune à toutes les Nations, à tous les cultes et qu’on suit à peu près ; une autre, propre à chaque nation et à chaque culte, à laquelle on croit, qu’on prêche dans les temples, qu’on préconise dans les maisons, et qu’on ne suit point du tout » [5]. Quand Diderot dit qu’on ne suit « point du tout » la morale spécifique à chaque culte, il pense sans doute au christianisme décadent de son époque, mais il est évident qu’à d’autres époques et en d’autres lieux, les règles vestimentaires, culinaires ou sexuelles particulières à chaque religion, sont très suivies. Et, pour ce qui est de la « morale commune », ce concept est sans doute plus difficile à préciser que Diderot ne le pensait ; cependant, quand les gens abandonnent leurs croyances religieuses, ils abandonnent aussi certaines pratiques, celles liées spécifiquement à leur religion, mais ils ne se mettent pas, en règle générale, à tuer ou à voler leurs voisins, c’est-à-dire qu’ils continuent à respecter une morale commune et humaine.
Notons qu’un des principaux arguments des religieux est que seule la religion permet de garder les gens « dans le droit chemin » et de leur faire respecter justement cette morale commune. Cette idée est extrêmement répandue, y compris parmi beaucoup d’incroyants. Néanmoins, certaines études empiriques montrent une corrélation assez forte dans les pays développés entre croyance en Dieu et certains maux sociaux tels que les homicides, la mortalité juvénile, les maladies vénériennes, les adolescentes enceintes et même l’avortement [6]. Bien sûr, on ne peut pas tirer de cette corrélation un lien de cause à effet (il est probable que ces maux sociaux et la croyance religieuse aient des causes communes, par exemple l’inégalité sociale – voir [7]), mais cela montre que l’existence d’un lien causal inverse, entre absence de croyance religieuse et immoralité, que beaucoup de religieux soutiennent, est loin d’être démontrée. De toute façon, même si cet argument utilitariste en faveur de la religion (comme moyen de faire respecter la morale) était vrai, il ne nous dirait rien sur la question de savoir si celle-ci est vraie ou fausse.
Il y a un troisième impact moral de la religion, ce qu’on pourrait appeler l’encouragement au fanatisme, c’est-à-dire à des actions qui vont à l’encontre de la morale commune, tuer des innocents par exemple, ou imposer les morales particulières à une religion donnée à l’ensemble de la société. Le fanatisme est presque toujours lié à la croyance dans l’au-delà. En effet, si la vie ici-bas n’est qu’une préparation à la vie éternelle dans l’au-delà, pourquoi se soucier d’autres commandements que les commandements divins ou supposés tels ?
Évidemment, beaucoup de chrétiens modernes, libéraux ou « progressistes », ont laissé tomber les aspects fanatiques de leur religion, ainsi que l’interprétation littérale des textes sacrés. Ils mettent de côté l’idée du ciel et de l’enfer (en tout cas, de l’enfer) et se replient de plus en plus sur le Dieu métaphysique. À la limite, la question de savoir si ce qu’ils disent est vrai ou faux ne les intéresse pas. Ce qui compte, ce sont les « choix personnels » que l’on fait ou « se sentir bien ». Mais la question qu’on est en droit de leur poser est « que peut bien encore signifier votre religion ? » Lorsqu’ils parlent, comme ils le font souvent, de « donner du sens » ou de « l’espérance », qu’est-ce que cela veut dire si on ne croit pas à la vie éternelle ? Et si on y croit, pourquoi ne pas la prendre au sérieux et passer la vie ici-bas à s’y préparer en suivant à la lettre les prescriptions divines ?
 Krishna jouant de la flûte au milieu de vaches sacrées (vers 1740).
Krishna jouant de la flûte au milieu de vaches sacrées (vers 1740).Le christianisme moderne est devenu tellement vide de contenu qu’il peut paraître inoffensif, et il l’est effectivement, si l’on met de côté la confusion intellectuelle qu’il engendre. Il a néanmoins des effets pervers : il amène bon nombre d’incroyants et de laïcs en Europe, à le prendre pour le paradigme de ce qu’est une religion. Ceci entraîne l’abandon progressif de la critique rationaliste de la religion, vue comme dépassée, étant donné le côté « inoffensif » du christianisme moderne. Une des raisons pour lesquelles beaucoup de laïcs et de scientifiques acceptent l’idée de la compatibilité entre science et foi, c’est que, présentée sous la forme du christianisme moderne, la foi ne veut plus rien dire (ou presque). Mais d’un point de vue géographique et historique, le christianisme moderne est une aberration dans l’ensemble de croyances religieuses qui sont, pour la plupart, littéralistes.
De plus, cela amène beaucoup d’incroyants à exiger des autres religions, l’islam ici ou le christianisme fondamentaliste aux États-Unis, qu’elles « s’adaptent » ou se « modernisent », pour ressembler au christianisme moderne. Mais c’est oublier que celui-ci est le résultat de siècles de combat rationaliste contre la religion, la croyance, et l’irrationnel en général. Les chrétiens modernes ne le sont pas devenus parce qu’on leur a dit d’être laïcs ou d’être gentils avec les femmes, les homosexuels ou les incroyants, mais parce que la solidité de leurs croyances a été petit à petit sapée par la critique scientifique et rationaliste. Le christianisme moderne est en grande partie une réaction d’adaptation face à la défaite intellectuelle du christianisme traditionnel.
La critique des religions qui sont considérées comme nocives (en Europe, essentiellement, l’islam) est aujourd’hui presque exclusivement une critique morale, se concentrant sur les aspects « barbares » de certaines pratiques particulières, sur le fondamentalisme au niveau dogmatique, ou sur le fanatisme. Mais c’est sous-estimer le fait que la critique purement morale de la religion est sans effet, parce que ce qui semble fanatique aux incroyants est parfaitement rationnel pour les croyants, du moins pour ceux qui prennent au sérieux l’idée de la vie éternelle et du ciel et de l’enfer. Si on accepte ces prémisses (sur le ciel et l’enfer) il serait totalement absurde de risquer d’aller en enfer pour se conformer à de simples prescriptions humaines. Pour changer les comportements, il faudrait d’abord ébranler les croyances et, pour cela, revenir à une critique rationaliste et non purement morale de la religion.
Un autre problème rencontré par la critique morale de la religion est que les religieux ripostent en soulignant le côté immoral de nombreux courants athées ou supposés tels ; au choix : nazisme, communisme, colonialisme, ou consumérisme destructeur de l’environnement. D’un côté, on hurle en parlant de l’Inquisition ou des Croisades et de l’autre, on répond avec Hitler et Staline. Si les incroyants disent que les idées de ces derniers constituent en réalité une forme de croyance quasi-religieuse, les croyants répondront que la violence faite au nom de la religion est une déformation du « véritable » message religieux. On ne s’en sort pas, tant qu’on ne pose pas la question de la vérité : le discours religieux est-il vrai ou faux ? Imaginons un instant que Dieu existe vraiment et qu’il aime, mettons les Croisades, l’Inquisition ou le régime féodal, comme on l’imaginait au Moyen-Âge. Il enverrait par conséquent en enfer tous ceux, y compris les chrétiens modernes, qui s’opposent à ces pratiques. Quelle objection pourrait-on bien soulever dans ce cas à ces pratiques que nous condamnons comme moyenâgeuses ? Bien sûr, presque plus personne ne croit dans ce genre de Dieu, mais justement, cela veut dire qu’on ne croit plus que ce type de discours religieux soit vrai. Et cela montre que même le discours chrétien moderne qui tente de mettre de côté la question de la vérité ou de la fausseté de la religion, présuppose que certaines choses auxquelles les croyants ont adhéré pendant des siècles sont, en réalité, fausses.
Le christianisme moderne fonctionne comme une sorte de ruse de la déraison qui amène les incroyants à ne plus comprendre la logique de la religion, à abandonner la critique rationaliste de celle-ci et à la combattre lorsqu’ils considèrent ce combat nécessaire, à travers un discours purement moralisateur dont on peut sérieusement craindre qu’il ne soit totalement inefficace.
Références
[1] Le Point, n° 1977, 5 août 2010, p. 44.
[2] Richard Dawkins, Pour en finir avec Dieu, (trad. M-F Desjeux-Lefort) Librairie Académique Perrin, Paris, 2009.
[3] Bertrand Russell, (trad. Philippe-Roger Mantoux), Science et religion, Gallimard, Paris, 1990.
[4] Pascal Boyer, Et l’homme créa les dieux, Robert Laffont, Paris 2001, p. 293.
[5] Denis Diderot, Pour une morale de l’athéisme. Entretien d’un philosophe avec la maréchale de ***. Mille et une nuits, Paris, 2007, p. 24.
[6] Gregory S. Paul, « Cross-National Correlations of Quantifiable Societal Health with Popular Religiosity and Secularism in the Prosperous Democracies : A First Look », Journal of Religion & Society 7 (2005), [ltr]http://moses.creighton.edu/jrs/2005...[/ltr]
[7] Sur le lien entre inégalité et maux sociaux, voir Richard Wilkinson, Kate Pickett, The Spirit Level. Why Equality is Better for Everyone, Penguin Books, Londres, 2010.
[ltr]1[/ltr] Les premières études statistiques sur l’(in)efficacité de la prière remontent au moins à Francis Galton, « Statistical Enquiries into the Efficacy of Prayers », The Fortnightly Review, n° 12, août 1872, p. 125-135.
 Re: Religion et Philosophie
Re: Religion et Philosophie
Cléo Marchand
1997
La différence entre les discours philosophiques et religieux
Plusieurs discours ont été élaborés afin de répondre aux besoins nombreux des êtres humains. Dans ces discours, on retrouve notamment la religion et la philosophie qui ont leurs caractéristiques propres. Pourtant, ces deux discours ont un point en commun: celui d'être basé sur l'être humain et ses origines et/ou caractéristiques, ce qui incite certaines personnes à les rapprocher malgré leurs nombreuses différences. Quelles sont-elles?
La religion existe depuis toujours. Elle a pris différentes formes selon les époques et les peuples. La religion est, encore aujourd'hui, très difficile à définir, mais on a tout de même trouvé ses principales caractéristiques. C'est, en fait, une croyance très puissante que l'on peut porter à un être suprême: Dieu dans notre cas. Certains ne vivent que pour adorer leurs dieux: la religion peut être si forte qu'elle causera dans certains cas la haine de certaines personnes d'un type de religion envers une autre. Pourtant, dans tous, ou presque, les systèmes religieux, on prône la paix et l'amour envers les autres. De plus, nul ne peut contredire ce que les prophètes ont révélé, car Dieu a toujours raison. La religion est donc une réponse au pourquoi de la vie, qui semble satisfaire pleinement ses adeptes. Du côté de la philosophie, on préfère le questionnement logique: la réflexion rationnelle. Là aussi le but est de donner une signification à la vie, mais d'une façon critique, et ce jusqu'à ce que la vérité soit atteinte. Contrairement à la religion, la philosophie dépend des connaissances de chacun, car elle est plutôt personnelle. C'est-à-dire que chacun est libre de penser à sa façon, ce qui occasionne des réponses très différentes. Lorsqu'un philosophe croit avoir trouvé une vérité, c'est-à-dire une réponse à sa question, chacun peut librement la modifier, ce qui s'oppose aux principes de la religion. À première vue, la philosophie et la religion peuvent sembler avoir le même principe fondamental, mais c'est la démarche pour atteindre celui-ci qui est complètement différente.
À mon avis, la philosophie est beaucoup plus élaborée que la religion: elle nous permet une liberté de reflexion, qui développe la créativité de l'imagination. Avec la philosophie, on peut dépasser des limites imaginaires en s'abandonnant à nos pensées et en se questionnant sur l'univers et ses composantes. Or, la religion nous impose une façon de penser. Elle nous dicte sa théorie sur nos valeurs, notre comportement et nos origines, sans compter qu'elle est intouchable, c'est-à-dire que nul ne peut changer ses principes. De plus, la philosophie est possible grâce aux connaissances personnelles du philosophe. Plus la connaissance rationnelle est grande, plus on risque de parvenir à un but devenant de plus en plus complexe. La religion est davantage un "pansement" qui efface le besoin qu'ont les humains à raisonner sur leurs origines et sur la raison de la vie. Il a d'ailleurs été confirmé que plus une population est analphabète, plus elle s'adonne à la religion. Celle-ci dissimule donc le manque de connaissance d'une société. Aussi, je crois qu'il faut être, en un sens, lâche pour ne considérer que la religion, car on se fie trop souvent à Dieu en se demandant: "Que ferait-il à ma place?". Certains ne font que prier pour que ce qu'ils souhaitent se réalise: cette situation est donc la même qu'un moineau qui attend sa mère pour avoir sa nourriture toute crue dans le bec.
Tout compte fait, il y a plusieurs différences entre les discours de la religion et de la philosophie. L'une est trop simple et controversée et l'autre, complexe et ravivante. Pourtant, plusieurs individus n'y accordent pas trop de différences en se disant que le but est le même: répondre à nos questions. Comme la religion nous dicte des réponses impossibles à vérifier, il serait grand temps que l'on découvre l'importance de la réflexion du sens de la vie, car nous sommes tous autant concernés.
(642 mots)
1997
La différence entre les discours philosophiques et religieux
Plusieurs discours ont été élaborés afin de répondre aux besoins nombreux des êtres humains. Dans ces discours, on retrouve notamment la religion et la philosophie qui ont leurs caractéristiques propres. Pourtant, ces deux discours ont un point en commun: celui d'être basé sur l'être humain et ses origines et/ou caractéristiques, ce qui incite certaines personnes à les rapprocher malgré leurs nombreuses différences. Quelles sont-elles?
La religion existe depuis toujours. Elle a pris différentes formes selon les époques et les peuples. La religion est, encore aujourd'hui, très difficile à définir, mais on a tout de même trouvé ses principales caractéristiques. C'est, en fait, une croyance très puissante que l'on peut porter à un être suprême: Dieu dans notre cas. Certains ne vivent que pour adorer leurs dieux: la religion peut être si forte qu'elle causera dans certains cas la haine de certaines personnes d'un type de religion envers une autre. Pourtant, dans tous, ou presque, les systèmes religieux, on prône la paix et l'amour envers les autres. De plus, nul ne peut contredire ce que les prophètes ont révélé, car Dieu a toujours raison. La religion est donc une réponse au pourquoi de la vie, qui semble satisfaire pleinement ses adeptes. Du côté de la philosophie, on préfère le questionnement logique: la réflexion rationnelle. Là aussi le but est de donner une signification à la vie, mais d'une façon critique, et ce jusqu'à ce que la vérité soit atteinte. Contrairement à la religion, la philosophie dépend des connaissances de chacun, car elle est plutôt personnelle. C'est-à-dire que chacun est libre de penser à sa façon, ce qui occasionne des réponses très différentes. Lorsqu'un philosophe croit avoir trouvé une vérité, c'est-à-dire une réponse à sa question, chacun peut librement la modifier, ce qui s'oppose aux principes de la religion. À première vue, la philosophie et la religion peuvent sembler avoir le même principe fondamental, mais c'est la démarche pour atteindre celui-ci qui est complètement différente.
À mon avis, la philosophie est beaucoup plus élaborée que la religion: elle nous permet une liberté de reflexion, qui développe la créativité de l'imagination. Avec la philosophie, on peut dépasser des limites imaginaires en s'abandonnant à nos pensées et en se questionnant sur l'univers et ses composantes. Or, la religion nous impose une façon de penser. Elle nous dicte sa théorie sur nos valeurs, notre comportement et nos origines, sans compter qu'elle est intouchable, c'est-à-dire que nul ne peut changer ses principes. De plus, la philosophie est possible grâce aux connaissances personnelles du philosophe. Plus la connaissance rationnelle est grande, plus on risque de parvenir à un but devenant de plus en plus complexe. La religion est davantage un "pansement" qui efface le besoin qu'ont les humains à raisonner sur leurs origines et sur la raison de la vie. Il a d'ailleurs été confirmé que plus une population est analphabète, plus elle s'adonne à la religion. Celle-ci dissimule donc le manque de connaissance d'une société. Aussi, je crois qu'il faut être, en un sens, lâche pour ne considérer que la religion, car on se fie trop souvent à Dieu en se demandant: "Que ferait-il à ma place?". Certains ne font que prier pour que ce qu'ils souhaitent se réalise: cette situation est donc la même qu'un moineau qui attend sa mère pour avoir sa nourriture toute crue dans le bec.
Tout compte fait, il y a plusieurs différences entre les discours de la religion et de la philosophie. L'une est trop simple et controversée et l'autre, complexe et ravivante. Pourtant, plusieurs individus n'y accordent pas trop de différences en se disant que le but est le même: répondre à nos questions. Comme la religion nous dicte des réponses impossibles à vérifier, il serait grand temps que l'on découvre l'importance de la réflexion du sens de la vie, car nous sommes tous autant concernés.
(642 mots)
 Re: Religion et Philosophie
Re: Religion et Philosophie
Averroès - La philosophie et la religion : l'interprétation du texte coranique
Averroès - La philosophie et la religion : l'interprétation du texte coranique
Bien qu’il y ait eu, en terre d'Islam, de nombreux philosophes entre les XIIIe et XVIIe siècles, de l’andalou Ibn Sab'în (XIIIe siècle) jusqu’au perse Molla Sadra (XVIIe siècle), la plupart des recherches s'accordent à dire que c’est Averroès (1126-1198) qui est le dernier philosophe de la civilisation de l'Islam classique. Ce jugement, qui doit être nuancé sur certains points, repose principalement sur l’ampleur du projet qu’il a réalisé, et surtout sur la réception de ce même projet dans l'Occident latin pendant le Moyen Âge.
Dans son travail, Averroès cherchait, en effet, à renouer avec l’aristotélisme et avec la méthode rationnelle, longtemps occultés par l’intérêt des philosophes arabes et alexandrins pour les commentaires de l’œuvre du Stagirite plutôt que pour ses textes eux-mêmes. Parallèlement au commentaire systématique des textes d’Aristote, Averroès a entrepris un autre travail de défense de l’acte de philosopher qui s’était trouvé fortement remis en cause par les accusations d’impiété lancées par al-Ghazâlî (1058-1111) contre les philosophes. Ce sont les réponses aux problèmes soulevés par al-Ghazâlî et la discussion de questions comme le rapport entre la philosophie et la religion, la foi et la raison, le philosophe et la cité qui occupent la partie centrale des œuvres personnelles d’Averroès (le Discours décisif, le Traité du dévoilement, et l’Incohérence de l’Incohérence) et qui contiennent une part importante de ses idées politiques.
Renouer avec la méthode scientifique dont le modèle est Aristote et lutter contre le projet intellectuel d’al-Ghazâlî constituent donc les deux dynamiques sur lesquelles repose un pan entier de la philosophie politique d'Averroès. Celle-ci s'engage dans une réflexion sur des sujets qui sont à l’origine de la Modernité, comme, par exemple, l’étude du problème théologico-politique qui est directement lié à la définition du processus de sécularisation. Comment ce travail se présente-t-il dans les textes d’Averroès et de quelle manière peut-il être interprété dans les limites du contexte culturel de l’Islam du XIIe siècle?
En dehors de ce premier aspect, Averroès peut être considéré, du point de vue de la philosophie politique classique, comme le dernier représentant d’une tradition qui remonte aux Grecs et qui est, à partir du Xe siècle, solidement ancrée en terre d’Islam grâce aux écrits de Fârâbî (870-950). Cette tradition consiste à étudier les conditions de la réalisation d’une cité juste et de l’instauration d’un régime parfait. Consignés dans le principal texte politique d’Averroès qui est le Commentaire de la République de Platon, ces développements abordant, entre autres, le statut et le rôle du chef de la cité parfaite, les cités injustes, et la meilleure éducation des citoyens sont loin d’être une spéculation théorique gratuite et éloignée des soucis du réel.
Au contraire, cette recherche s’inscrit pleinement dans un cadre qui reprend les enseignements platoniciens sur la cité idéale tout en les transformant et en les adaptant à un nouveau contexte. Le modèle politique platonicien subira ainsi de nombreuses transformations du fait de l’introduction d’éléments aristotéliciens dans le Commentaire, et de la volonté de redéfinir, sur d’autres bases épistémologiques, l’art politique lui-même. Ce deuxième axe nous permettra donc de voir comment se pose le problème du rapport entre un modèle normatif de la politique hérité des Grecs et l’un des usages qui en est fait, en l'occurrence par Averroès, afin de comprendre l’histoire de l’Islam en général et celle de l'Andalousie en particulier.
Plan du cours :
Première partie : une biographie politique
1) Le philosophe et le politique
2) Le milieu intellectuel andalou et le projet d'Averroès
3) Averroès et les traditions de pensée politiques de l'islam classique
4) La fondation de la science politique : le paradigme médical
Deuxième partie : la cité parfaite
1) La théorie des excellences humaines
2) Le statut du roi-philosophe
3) Les attributs de la cité parfaite
4) Les régimes injustes
Troisième partie : les conditions de la politique parfaite
1) L'éducation des citoyens
2) La philosophie et la religion : l'interprétation du texte coranique
3) La théologie politique
Conclusion
Directeur de la publication: Olivier Faron
Producteur executif: Christophe Porlier
Réalisation: Francis Oudréaogo
Image et post-production: Mathias Chassagneux
Lumière: Sébastien Boudin
Son: Xavier Comméat
Diffusion Web: Jean Claude Troncard
Averroès - La philosophie et la religion : l'interprétation du texte coranique
Bien qu’il y ait eu, en terre d'Islam, de nombreux philosophes entre les XIIIe et XVIIe siècles, de l’andalou Ibn Sab'în (XIIIe siècle) jusqu’au perse Molla Sadra (XVIIe siècle), la plupart des recherches s'accordent à dire que c’est Averroès (1126-1198) qui est le dernier philosophe de la civilisation de l'Islam classique. Ce jugement, qui doit être nuancé sur certains points, repose principalement sur l’ampleur du projet qu’il a réalisé, et surtout sur la réception de ce même projet dans l'Occident latin pendant le Moyen Âge.
Dans son travail, Averroès cherchait, en effet, à renouer avec l’aristotélisme et avec la méthode rationnelle, longtemps occultés par l’intérêt des philosophes arabes et alexandrins pour les commentaires de l’œuvre du Stagirite plutôt que pour ses textes eux-mêmes. Parallèlement au commentaire systématique des textes d’Aristote, Averroès a entrepris un autre travail de défense de l’acte de philosopher qui s’était trouvé fortement remis en cause par les accusations d’impiété lancées par al-Ghazâlî (1058-1111) contre les philosophes. Ce sont les réponses aux problèmes soulevés par al-Ghazâlî et la discussion de questions comme le rapport entre la philosophie et la religion, la foi et la raison, le philosophe et la cité qui occupent la partie centrale des œuvres personnelles d’Averroès (le Discours décisif, le Traité du dévoilement, et l’Incohérence de l’Incohérence) et qui contiennent une part importante de ses idées politiques.
Renouer avec la méthode scientifique dont le modèle est Aristote et lutter contre le projet intellectuel d’al-Ghazâlî constituent donc les deux dynamiques sur lesquelles repose un pan entier de la philosophie politique d'Averroès. Celle-ci s'engage dans une réflexion sur des sujets qui sont à l’origine de la Modernité, comme, par exemple, l’étude du problème théologico-politique qui est directement lié à la définition du processus de sécularisation. Comment ce travail se présente-t-il dans les textes d’Averroès et de quelle manière peut-il être interprété dans les limites du contexte culturel de l’Islam du XIIe siècle?
En dehors de ce premier aspect, Averroès peut être considéré, du point de vue de la philosophie politique classique, comme le dernier représentant d’une tradition qui remonte aux Grecs et qui est, à partir du Xe siècle, solidement ancrée en terre d’Islam grâce aux écrits de Fârâbî (870-950). Cette tradition consiste à étudier les conditions de la réalisation d’une cité juste et de l’instauration d’un régime parfait. Consignés dans le principal texte politique d’Averroès qui est le Commentaire de la République de Platon, ces développements abordant, entre autres, le statut et le rôle du chef de la cité parfaite, les cités injustes, et la meilleure éducation des citoyens sont loin d’être une spéculation théorique gratuite et éloignée des soucis du réel.
Au contraire, cette recherche s’inscrit pleinement dans un cadre qui reprend les enseignements platoniciens sur la cité idéale tout en les transformant et en les adaptant à un nouveau contexte. Le modèle politique platonicien subira ainsi de nombreuses transformations du fait de l’introduction d’éléments aristotéliciens dans le Commentaire, et de la volonté de redéfinir, sur d’autres bases épistémologiques, l’art politique lui-même. Ce deuxième axe nous permettra donc de voir comment se pose le problème du rapport entre un modèle normatif de la politique hérité des Grecs et l’un des usages qui en est fait, en l'occurrence par Averroès, afin de comprendre l’histoire de l’Islam en général et celle de l'Andalousie en particulier.
Plan du cours :
Première partie : une biographie politique
1) Le philosophe et le politique
2) Le milieu intellectuel andalou et le projet d'Averroès
3) Averroès et les traditions de pensée politiques de l'islam classique
4) La fondation de la science politique : le paradigme médical
Deuxième partie : la cité parfaite
1) La théorie des excellences humaines
2) Le statut du roi-philosophe
3) Les attributs de la cité parfaite
4) Les régimes injustes
Troisième partie : les conditions de la politique parfaite
1) L'éducation des citoyens
2) La philosophie et la religion : l'interprétation du texte coranique
3) La théologie politique
Conclusion
Directeur de la publication: Olivier Faron
Producteur executif: Christophe Porlier
Réalisation: Francis Oudréaogo
Image et post-production: Mathias Chassagneux
Lumière: Sébastien Boudin
Son: Xavier Comméat
Diffusion Web: Jean Claude Troncard
 Re: Religion et Philosophie
Re: Religion et Philosophie
Une définition de la philosophie
La philosophie est la recherche et l'étude des principes de la pensée, de la connaissance de la réalité, et des finalités de l'action humaine. Cette recherche s'exprime par des pensées, des théories ou par des conceptions générales sur l'homme, le monde et l'être en général. Elle implique une réflexion critique sur le sujet pensant lui-même, selon la formule socratique : Connais-toi toi-même. La recherche philosophique met parfois au jour des problèmes insolubles (des apories). Cela ne contredit en rien sa finalité et met en lumière l'essence même du philosopher : interroger le réel quant à son être d'une façon rigoureuse et argumentée de façon à esquisser une compréhension de notre rapport à l'être, au monde et des principes de nos actions.
Les problèmes philosophiques consistent notamment en l'interrogation des concepts de réalité et de vérité (métaphysique et logique), de bien et de justice (morale et politique) et de beau (esthétique) :
(Source : wikipedia.org)
Ressources
 Biographies et citations
Biographies et citations  de quelques philosophes qui se sont intéressés à la religion.
de quelques philosophes qui se sont intéressés à la religion.
Alain
Bayle
Comte
Comte-Sponville
Démocrite
Diderot
Epicure
Feuerbach
Helvétius
Hobbes
Avis d'internautes - Echanges - discussions - témoignages
Sarkozy chanoine Quelques pensées au sujet de l'intronisation de notre président...
La foi religieuse n'est pas inexpugnable : Philosophie versus religion.
"Les 7 préceptes capitaux" pour une philosophie de la vie.
L'athéisme est-il une croyance ? Agnosticisme et athéisme.
Méditations métaphysiques : énergétisme vital, principes ordonnateurs du monde...
A propos du déterminisme et du libre arbitre : sélection de textes du "Livre d'or et de cendres".
 Citations sur Dieu, la religion et les croyances, classées par thèmes, par auteurs...
Citations sur Dieu, la religion et les croyances, classées par thèmes, par auteurs...
Voir en particulier les thèmes :
Jean le Rond d'Alembert, Emile-Michel Cioran, Marcel Conche, Alain Tête, Miguel de Unamuno.
Bibliographie :
"Dictionnaire philosophique" : Voltaire (Flammarion, 1964, 1ère édit. en 1764)
"L'essence du christianisme" : Ludwig Feuerbach (Gallimard / Tel (1992) - première publication en 1841)
"Le crépuscule des idoles" : Friedrich Nietzsche (Editions Denoël Gonthier, Bibliothèque Médiations (1972), première publication en 1888)
"L'existentialisme est un humanisme" : Jean-Paul Sartre (Gallimard / Folio essais (1996), texte de 1945)
"Insultes" Arthur Schopenhauer (Editions du Rocher, 1988)
"Petite philosophie à l'usage des non-philosophes" : Albert Jacquard (Calmann-Lévy / Livre de poche, 1997)
"La morale" : Eric Blondel (Flammarion, 1999)
"Dieu et Marianne, Philosophie de la laïcité" de Henri Pena-Ruiz (PUF, 1999)
"Présentation de la philosophie" : André Comte-Sponville (Albin Michel, 2000)
"La philosophie féroce" : Michel Onfray (Editions Galilée, 2004)
"Nous serons des dieux" : Hervé Fisher (V.L.B., 2006)
"Curieuses histoires de la Pensée" : Quand l'homme inventait les religions et la philosophie. Jean C. Baudet (Editions Jourdan, 2011)
"Survol de mes pensées : Athéisme et philosophie poétiques", Edouard Ch. Mion (Les Editions du Net, 2013)
"Intelligence du matérialisme" : Benoît Schneckenburger (Edition de l'Epervier, 2013)
"L'Amour de la Raison Universelle". Willeime (lulu.com, 2013)
"Du tragique au matérialisme (et retour)". André Comte-Sponville (P.U.F., 2015)
"Fatras du Soi, fracas de l'Autre". Stéphane Sangral (Editions Galilée, 2015)
"Ô ! Blaise ! à quoi tu penses ? : Essai sur les "Pensées" de Pascal". René Pommier (Editions Kimé, 2015)
Liens externes vers des sites ayant pour thème la philosophie.
La philosophie est la recherche et l'étude des principes de la pensée, de la connaissance de la réalité, et des finalités de l'action humaine. Cette recherche s'exprime par des pensées, des théories ou par des conceptions générales sur l'homme, le monde et l'être en général. Elle implique une réflexion critique sur le sujet pensant lui-même, selon la formule socratique : Connais-toi toi-même. La recherche philosophique met parfois au jour des problèmes insolubles (des apories). Cela ne contredit en rien sa finalité et met en lumière l'essence même du philosopher : interroger le réel quant à son être d'une façon rigoureuse et argumentée de façon à esquisser une compréhension de notre rapport à l'être, au monde et des principes de nos actions.
Les problèmes philosophiques consistent notamment en l'interrogation des concepts de réalité et de vérité (métaphysique et logique), de bien et de justice (morale et politique) et de beau (esthétique) :
- Qu'est-ce que l'être ? Quel rapport avons-nous avec lui ? Quelles choses sont réelles et quelles sont leurs natures ? Existe-t-il quelque chose indépendamment de notre perception ? Que sont l'espace, le temps, la pensée, la conscience, etc. ? Quelle place faire au divin dans le plan de la foi et de la pensée ? Ces thèmes sont explorés par la métaphysique.
- Quelle connaissance est possible ? Comment connaissons-nous ce que nous connaissons ? Pouvons-nous savoir s'il existe d'autres esprits que le nôtre ? Ces questions concernent la théorie de la connaissance.
- Y a-t-il des différences morales (bien et mal) entre certaines de nos actions ? En quoi consistent ces différences ? Quelles actions sont bonnes, quelles actions sont mauvaises ? Nos valeurs sont-elles absolues ou relatives ? Comment doit-on vivre ? Ces questions, et d'autres, concernent la morale et l'éthique.
(Source : wikipedia.org)
Ressources
 Dictionnaire des religions et des mouvements philosophiques associés. Voir plus particulièrement les mots suivants :
Dictionnaire des religions et des mouvements philosophiques associés. Voir plus particulièrement les mots suivants : - Au-delà de la non croyance : Des systèmes philosophiques formulés de manière positive. 11/11/2010.
- Une introduction au matérialisme.
Philosophie antique. Philosophie moderne. Principales oppositions entre matérialisme et spiritualisme. 15/03/2004. - Science, religion et métaphysique : Qu'est-ce qui les différencie ? 4/10/2004.
- Une présentation du taoïsme philosophique. Par Michaël D., 21/05/2003.
- Causalité et finalité : Un monde insensé. Comment la science, par le principe de causalité, parvient à écarter la notion de finalité, ne laissant ainsi plus de place pour Dieu. Par Augustin Delmas, 01/01/2005.
- Le monde du sens. Le sens que l'homme donne à sa vie. Par Augustin Delmas, 31/01/2005.
- Religion et philosophie. Une philosophie peut-elle être religieuse ou une religion peut-elle être philosophique ? Par Marc Anglaret, 10/03/2005.
- Bonheur postchrétien : Proposition d'un nouveau concept de "bonheur/amour en boucle". Par PdC, 04/04/2005.
- Philosophie et athéisme. Qu'est-ce que la philosophie et que peut-elle apporter aux athées ? Par Djhaidgh, 12/10/2005.
- Spiritualité athée. Par Crovax, 07/01/2007.
- Introduction au déterminisme universel. Essai Philosophique. Par Gilbert Gustine, 29/12/2007.
- Le culte de la vie. Par Baby Oz, 13/08/2009.
- Le libre examen. Par Pierre Sarlat, 03/01/2010.
- Métaphysique, Absolutisme et Relativité. Par Dustin Dewin, 17/01/2011.
- Lettre à Socrate. Par Erika Caubet-Bachem, 10/08/2011.
- Max Stirner contre l'Homme-Dieu ou le devoir d'iconoclastie. Par Eric Timmermans, 06/01/2012.
- Onfray et Athéologie. Par John, 24/12/2013.
- Réflexion : Le dilemme d'Euthyphron. Dieu et la morale. Par Albert Crispin, 04/04/2015.
- Dieu est une culture : La chose et le mot. Par M.G., 21/02/2016.
- Revue de presse
En quelques lignes, l'essentiel d'articles de la presse écrite sur les religions, Dieu ou les croyances. Quelques thèmes concernant la philosophie et la religion : - Philosophie
- Ethique
- Humanisme
- Sur l'actualité du matérialisme (Jean-François Kahn)
Marianne - 12 au 18 mars 2005 - (3 pages) - "Traité d'athéologie" de Michel Onfray
 Biographies et citations
Biographies et citations  de quelques philosophes qui se sont intéressés à la religion.
de quelques philosophes qui se sont intéressés à la religion. Citations sur Dieu, la religion et les croyances, classées par thèmes, par auteurs...
Citations sur Dieu, la religion et les croyances, classées par thèmes, par auteurs... Voir en particulier les thèmes :
Jean le Rond d'Alembert, Emile-Michel Cioran, Marcel Conche, Alain Tête, Miguel de Unamuno.
 Re: Religion et Philosophie
Re: Religion et Philosophie
a foi se résume-t-elle à l'obéissance?


Au cours de la séance précédente, nous avons vu que la religion donne un statut ambigu aux valeurs morales. Tantôt elles sont interprétées comme de simples commandements, qui réclament une stricte obéissance, sans possibilité de discussion ni de contestation. Tantôt au contraire, elles se présentent comme des principes inscrits dans le cœur de tout homme : elles ne sont plus seulement l’objet d’une obéissance mais plutôt d’une reconnaissance – chacun aurait ainsi une véritable conscience du juste et de l’injuste, indépendante des époques et des cultures... Et donc aussi indépendante des « commandements » de Dieu.
Cette dernière interprétation semble d’ailleurs conforme à l’un des textes les plus célèbres du monothéisme, à savoir la Genèse. Le péché originel consiste moins en une faute qu’en une prise de conscience : celle du bien et du mal. Avec cette « connaissance », Adam et Eve deviennent même « égaux à Dieu » : ils ont tout comme Dieu la puissance de saisir le sens des valeurs morales – comme si celles-ci excédaient même le pouvoir de Dieu, et subsistaient sans lui.
Un problème se pose alors, inévitablement : quel est le statut de la foi ? Comment la définir ? Si la morale se résume à de simples commandements, la foi permettrait de saisir la légitimité des impératifs divins - mais elle serait accessible aux seuls croyants. Si au contraire la conscience du juste et de l’injuste est commune à tout homme, et subsiste indépendamment de toute religion, la foi devient inutile… Nous approfondirons cette question, notamment avec Spinoza, en nous demandant si ce que l’on appelle « foi » ne serait pas plutôt un véritable instrument de pouvoir, instrument véritablement immoral puisqu’il interdit toute véritable prise de conscience du bien et du mal.
 philosophie et religion (12).mp3 (105.95 Mo)
philosophie et religion (12).mp3 (105.95 Mo)
Si Dieu n'existe pas, tout est-il permis?



Au cours des séances de l'année dernière, nous avons tenté d'approfondir un problème – celui des rapports, historiquement conflictuels, entre philosophie et religion. Nous avons presque soigneusement laissé de côté une question qui semble peut-être plus évidente, plus urgente même : non plus celle des rapports entre philosophie et religion, mais entre science et religion. C'est par elle que nous allons commencer les séances de cette année, quitte à rejoindre un peu plus tard la philosophie.
Nous commencerons par le conflit le plus connu, au cours de l'histoire, entre science et religion – à savoir le procès de Galilée, qui fait apparaître la querelle entre le géocentrisme traditionnellement défendu par l'Église catholique, et l'héliocentrisme de la science nouvelle. Nous retracerons l'histoire de ce procès, tâchant de se demander ce qui a pu apparaître si scandaleux, aux yeux de l'Église, dans la pensée galiléenne... S'agit-il seulement d'une opposition entre la lettre du texte religieux et le contenu d'une thèse scientifique ? Cette opposition ne masque-t-elle pas une différence plus profonde ?
Nous verrons comment la thèse de l'héliocentrisme met directement en question l'un des fondements du texte religieux – et non pas seulement un point de détail. C'est qu'en soumettant la nature à des lois invariables et universelles, qui prennent modèle sur les mathématiques, le monde perd de ses repères cardinaux : les lieux et les êtres n'ont plus la valeur que leur suppose la croyance. Dieu se retire du monde... La religion peut-elle subsister malgré la révolution scientifique qui s'opère au 17e siècle ?
Edit
L'enregistrement de la séance a été amputé de sa seconde moitié (faute de mémoire dans l'enregistreur). Nous nous en excusons... bonne écoute!
 philosophie et religion (10).mp3 (64.34 Mo)
philosophie et religion (10).mp3 (64.34 Mo)


Nous avons vu que la religion faisait un usage immodéré de la notion de jugement. La séance d'aujourd'hui a pour but de questionner un des plus fameux aspects du jugement dans le monothéisme, et plus particulièrement dans le Christianisme : l'idée d'un jugement dernier. A partir d'une lecture de l'Apocalypse selon Saint-Jean (Le livre final du Nouveau Testament), nous nous interrogerons sur la signification de cette fin des temps... Nous formerons l'hypothèse suivante : l'Apocalypse n'est pas seulement le délire d'une imagination travaillée par la vengeance. Il y a une véritable pensée de l'Apocalypse, un véritable pli de la pensée qui sous-tend l'ensemble du texte, et dont nous tenterons de faire apparaître la cohérence.
Sur quoi se fonde cette pensée ? Sur un certain rapport au temps. « La fin est proche » : tel est le leitmotiv qui traverse toute la littérature apocalyptique, depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. C'est à partir de cette affirmation initiale – celle d'une imminence du désastre – qu'il faut comprendre l'ensemble des développements apocalyptiques. L'Apocalypse présente en effet un monde peuplé de signes annonciateurs, signes opaques et incompréhensibles (chiffres, lettres et noms) suggérant des dimensions de la pensée inaccessibles à la raison humaine. Ce monde visible devient par là-même un monde réversible, monde d'apparences appelé à s'évanouir pour laisser place à l'autre monde... L'univers des hommes n'a dès lors plus aucune importance, puisqu'il est destiné à se consumer. Enfin, cette pensée est inséparable d'une représentation de Dieu comme « Tout puissant », comme figure d'un pouvoir surplombant, absolu et arbitraire – ce pouvoir qui provoque la destruction du monde des hommes.
 philosophie et religion (9).mp3 (47.42 Mo)
philosophie et religion (9).mp3 (47.42 Mo)


L'idée même de jugement semble consubstantielle à la foi – ne serait-ce qu'avec la croyance en un « jugement dernier », qui répartirait les âmes des morts selon leurs mérite, et accomplirait la séparation des élus et des damnés. Toutefois, derrière cet usage apparemment évident du jugement se cache une foule de problèmes... Déjà, quel est le sens de ce mot ? En quoi consiste cette opération qui consiste à « juger » ?
Tout jugement se construit en fonction de valeurs qu'il suppose légitime. En ce sens, le jugement est inséparable de l'expérience du mal : nous jugeons le mal négativement, comme ce qu'il faut exclure, et ce faisant nous posons un bien comme souhaitable et désirable. Juger est donc une pratique quasi-automatique, inévitable, dans la mesure où nous sommes confrontés à l'injustice – nous sommes alors prompts à louer ou à condamner.
Dès lors, l'usage du jugement dans la religion n'est pas simple. Au delà de l'idée d'un tribunal de la fin des temps (provoquant d'une punition ou d'une récompense éternelle), le jugement se diffuse à dans toutes les dimensions du discours religieux. En effet, la foi définit les valeurs qui permettent d'exercer le jugement – les commandements de Dieu sont autant de critères du bien et du mal. D'autre part, la foi porte un jugement sévère sur la vie terrestre – vallée de larmes, où les justes sont punis et les méchants récompensés... Nous tenterons de porter un regard critique sur toutes ces utilisations du jugement, en tentant paradoxalement de les évaluer, à notre tour... Que signifie ce qu'il faut bien appeler un tel système du jugement ? Est-il légitime ? Correspond-il à une exigence morale réelle, issue de notre expérience du mal ?
 philosophie et religion (8).mp3 (52.12 Mo)
philosophie et religion (8).mp3 (52.12 Mo)


Au cours de la séance précédente, nous avons vu que la religion donne un statut ambigu aux valeurs morales. Tantôt elles sont interprétées comme de simples commandements, qui réclament une stricte obéissance, sans possibilité de discussion ni de contestation. Tantôt au contraire, elles se présentent comme des principes inscrits dans le cœur de tout homme : elles ne sont plus seulement l’objet d’une obéissance mais plutôt d’une reconnaissance – chacun aurait ainsi une véritable conscience du juste et de l’injuste, indépendante des époques et des cultures... Et donc aussi indépendante des « commandements » de Dieu.
Cette dernière interprétation semble d’ailleurs conforme à l’un des textes les plus célèbres du monothéisme, à savoir la Genèse. Le péché originel consiste moins en une faute qu’en une prise de conscience : celle du bien et du mal. Avec cette « connaissance », Adam et Eve deviennent même « égaux à Dieu » : ils ont tout comme Dieu la puissance de saisir le sens des valeurs morales – comme si celles-ci excédaient même le pouvoir de Dieu, et subsistaient sans lui.
Un problème se pose alors, inévitablement : quel est le statut de la foi ? Comment la définir ? Si la morale se résume à de simples commandements, la foi permettrait de saisir la légitimité des impératifs divins - mais elle serait accessible aux seuls croyants. Si au contraire la conscience du juste et de l’injuste est commune à tout homme, et subsiste indépendamment de toute religion, la foi devient inutile… Nous approfondirons cette question, notamment avec Spinoza, en nous demandant si ce que l’on appelle « foi » ne serait pas plutôt un véritable instrument de pouvoir, instrument véritablement immoral puisqu’il interdit toute véritable prise de conscience du bien et du mal.
Si Dieu n'existe pas, tout est-il permis?

“Si Dieu n'existe pas, tout est permis”. Cette phrase, prononcée par Ivan Karamazov dans Les frère Karamazov de Dostoïevski, et devenue célèbre, semble tirer toutes les conséquences morales de l'athéisme. Mais elle se présente plutôt comme une interrogation : que reste-t-il de la morale si Dieu est absent ? Au cours de cette séance, nous tenterons de comprendre toutes les implications de cette question, et aussi d'en faire la critique.
En effet, l'expression “tout est permis” est équivoque... A première vue, elle paraît signifier que l'absence de châtiment après la mort autorise à faire le mal – aucune sanction ne viendra punir l'homme méchant, ce qui est déjà inquiétant. Mais plus profondément encore, elle semble nous dire : les valeurs morales sont définies par la religion, uniquement par la religion... En l'absence du Dieu, nous n'avons plus aucun guide pour définir le bien et le mal, pour nous orienter dans nos choix...
La remarque d'Ivan Karamazov pose donc un véritable problème pour la pensée : quelle est l'origine des valeurs morales ? Résultent-elles seulement des commandements religieux ? Et si c'est le cas, ont-elles une valeur simplement arbitraire ?
En effet, l'expression “tout est permis” est équivoque... A première vue, elle paraît signifier que l'absence de châtiment après la mort autorise à faire le mal – aucune sanction ne viendra punir l'homme méchant, ce qui est déjà inquiétant. Mais plus profondément encore, elle semble nous dire : les valeurs morales sont définies par la religion, uniquement par la religion... En l'absence du Dieu, nous n'avons plus aucun guide pour définir le bien et le mal, pour nous orienter dans nos choix...
La remarque d'Ivan Karamazov pose donc un véritable problème pour la pensée : quelle est l'origine des valeurs morales ? Résultent-elles seulement des commandements religieux ? Et si c'est le cas, ont-elles une valeur simplement arbitraire ?


Au cours des séances de l'année dernière, nous avons tenté d'approfondir un problème – celui des rapports, historiquement conflictuels, entre philosophie et religion. Nous avons presque soigneusement laissé de côté une question qui semble peut-être plus évidente, plus urgente même : non plus celle des rapports entre philosophie et religion, mais entre science et religion. C'est par elle que nous allons commencer les séances de cette année, quitte à rejoindre un peu plus tard la philosophie.
Nous commencerons par le conflit le plus connu, au cours de l'histoire, entre science et religion – à savoir le procès de Galilée, qui fait apparaître la querelle entre le géocentrisme traditionnellement défendu par l'Église catholique, et l'héliocentrisme de la science nouvelle. Nous retracerons l'histoire de ce procès, tâchant de se demander ce qui a pu apparaître si scandaleux, aux yeux de l'Église, dans la pensée galiléenne... S'agit-il seulement d'une opposition entre la lettre du texte religieux et le contenu d'une thèse scientifique ? Cette opposition ne masque-t-elle pas une différence plus profonde ?
Nous verrons comment la thèse de l'héliocentrisme met directement en question l'un des fondements du texte religieux – et non pas seulement un point de détail. C'est qu'en soumettant la nature à des lois invariables et universelles, qui prennent modèle sur les mathématiques, le monde perd de ses repères cardinaux : les lieux et les êtres n'ont plus la valeur que leur suppose la croyance. Dieu se retire du monde... La religion peut-elle subsister malgré la révolution scientifique qui s'opère au 17e siècle ?
Edit
L'enregistrement de la séance a été amputé de sa seconde moitié (faute de mémoire dans l'enregistreur). Nous nous en excusons... bonne écoute!


Nous avons vu que la religion faisait un usage immodéré de la notion de jugement. La séance d'aujourd'hui a pour but de questionner un des plus fameux aspects du jugement dans le monothéisme, et plus particulièrement dans le Christianisme : l'idée d'un jugement dernier. A partir d'une lecture de l'Apocalypse selon Saint-Jean (Le livre final du Nouveau Testament), nous nous interrogerons sur la signification de cette fin des temps... Nous formerons l'hypothèse suivante : l'Apocalypse n'est pas seulement le délire d'une imagination travaillée par la vengeance. Il y a une véritable pensée de l'Apocalypse, un véritable pli de la pensée qui sous-tend l'ensemble du texte, et dont nous tenterons de faire apparaître la cohérence.
Sur quoi se fonde cette pensée ? Sur un certain rapport au temps. « La fin est proche » : tel est le leitmotiv qui traverse toute la littérature apocalyptique, depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. C'est à partir de cette affirmation initiale – celle d'une imminence du désastre – qu'il faut comprendre l'ensemble des développements apocalyptiques. L'Apocalypse présente en effet un monde peuplé de signes annonciateurs, signes opaques et incompréhensibles (chiffres, lettres et noms) suggérant des dimensions de la pensée inaccessibles à la raison humaine. Ce monde visible devient par là-même un monde réversible, monde d'apparences appelé à s'évanouir pour laisser place à l'autre monde... L'univers des hommes n'a dès lors plus aucune importance, puisqu'il est destiné à se consumer. Enfin, cette pensée est inséparable d'une représentation de Dieu comme « Tout puissant », comme figure d'un pouvoir surplombant, absolu et arbitraire – ce pouvoir qui provoque la destruction du monde des hommes.


L'idée même de jugement semble consubstantielle à la foi – ne serait-ce qu'avec la croyance en un « jugement dernier », qui répartirait les âmes des morts selon leurs mérite, et accomplirait la séparation des élus et des damnés. Toutefois, derrière cet usage apparemment évident du jugement se cache une foule de problèmes... Déjà, quel est le sens de ce mot ? En quoi consiste cette opération qui consiste à « juger » ?
Tout jugement se construit en fonction de valeurs qu'il suppose légitime. En ce sens, le jugement est inséparable de l'expérience du mal : nous jugeons le mal négativement, comme ce qu'il faut exclure, et ce faisant nous posons un bien comme souhaitable et désirable. Juger est donc une pratique quasi-automatique, inévitable, dans la mesure où nous sommes confrontés à l'injustice – nous sommes alors prompts à louer ou à condamner.
Dès lors, l'usage du jugement dans la religion n'est pas simple. Au delà de l'idée d'un tribunal de la fin des temps (provoquant d'une punition ou d'une récompense éternelle), le jugement se diffuse à dans toutes les dimensions du discours religieux. En effet, la foi définit les valeurs qui permettent d'exercer le jugement – les commandements de Dieu sont autant de critères du bien et du mal. D'autre part, la foi porte un jugement sévère sur la vie terrestre – vallée de larmes, où les justes sont punis et les méchants récompensés... Nous tenterons de porter un regard critique sur toutes ces utilisations du jugement, en tentant paradoxalement de les évaluer, à notre tour... Que signifie ce qu'il faut bien appeler un tel système du jugement ? Est-il légitime ? Correspond-il à une exigence morale réelle, issue de notre expérience du mal ?
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5 
 Sujets similaires
Sujets similaires» Socrate Naissance De La Philosophie
» """Comment la philosophie peut nous sauver"""
» Islam et philosophie
» La Philosophie de Platon
» Histoire de la Philosophie
» """Comment la philosophie peut nous sauver"""
» Islam et philosophie
» La Philosophie de Platon
» Histoire de la Philosophie
Forum Religion : Le Forum des Religions Pluriel :: ○ Science / Histoire :: Gnose/Philo :: Philosophie
Page 1 sur 5
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum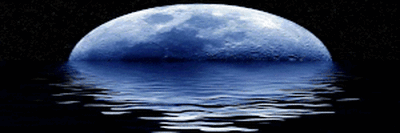
 S'enregistrer
S'enregistrer

