Religion et Philosophie
Forum Religion : Le Forum des Religions Pluriel :: ○ Science / Histoire :: Gnose/Philo :: Philosophie
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 •  1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5 
 Religion et Philosophie
Religion et Philosophie
Rappel du premier message :
Religion & philosophie
On a suffisamment remarqué que la religion1 et la philosophie peuvent être rapprochées, notamment par les questions communes qu’elles se posent : celles de la place de l’homme dans la nature, du bien et du mal, et d’autres encore. En outre, quelques théologiens ont “emprunté” aux philosophes certains de leurs concepts et de leurs formes de raisonnement, comme saint Thomas d’Aquin à Aristote. La réciproque existe également, par exemple dans le concept philosophique de Dieu. Enfin, nombre de philosophes se sont réclamés ou se réclament d’une religion particulière. Ce sont là quelques unes des raisons de se demander si une philosophie peut être religieuse ou si une religion peut être philosophique2. Bien que la réponse soit évidemment positive pour beaucoup, nous tenterons de montrer ici que la religion comme la philosophie ne peuvent que se perdre elles-mêmes, c’est-à-dire renoncer à ce qui les caractérise respectivement, dans une telle “union”.
Pour étayer notre réponse, il nous faudra pour commencer déterminer quelques unes des propriétés spécifiques de la religion d’une part, de la philosophie d’autre part.
1. Considérations générales sur la religion et la philosophie
Il semble que la notion de révélation soit la première spécificité de la religion au sens habituel du terme – celui, précisément, de religion révélée3 –, dans la mesure où elle est la condition même de la possibilité d’une religion : aucune ne prétend en effet être une émanation de l’homme seul ; il faut donc qu’un principe extérieur à l’humanité soit en mesure de transmettre à celle-ci, quelle qu’en soit la manière, ce qui définira la religion en question. C’est cette transmission que nous appelons ici révélation.
Quant au principe lui-même, les cas du Bouddhisme et de quelques autres religions orientales suffisent à empêcher qu’on le définisse par le terme de divinité : il y a des religions sans dieu. Mais ces cas ne sont pas vraiment gênants, car on peut se référer plus largement à la notion de sacré ; la religion est alors ce qui met l’homme en rapport avec le sacré4. On peut ajouter que le sacré, bien qu’il se réfère, selon les religions, à des actions, des choses ou des entités fort diverses, doit être caractérisé dans chaque religion comme un absolu. Autrement dit, la sacralités de ce qui est sacré ne peut pas, à l’intérieur d’une religion donnée, être discutée, remise en cause ou a fortiori niée5. Il y a plus encore : l’affirmation de la sacralité de ce qui est sacré se présente comme le fondement de la religion concernée6, fondement qui, justement parce qu’il est indiscutable, n’a pas à être expliqué. Et dans tous les cas, les éventuelles “justifications” théologiques de ce fondement n’appartiennent pas en propre à la religion concernée. Nous voulons dire par là que premièrement, elles sont toujours développées a posteriori, et bien souvent dans un but plus didactique que véritablement religieux. Deuxièmement et en conséquence, elles sont au bout du compte facultatives, au sens où leur absence n’affaiblirait pas la religion en elle-même. Troisièmement, elles sont inutiles pour l’authentique croyant dont la foi n’a nul besoin d’explication. On peut même, d’un certain point de vue, les considérer comme nuisibles pour cette religion, dans la mesure où elles paraissent sous-entendre que le fondement de la religion en question ne va pas de soi. Autrement dit, les justifications rationnelles d’une religion prennent toujours le risque d’être perçues comme des aveux de faiblesse d’une doctrine qui aurait besoin de “se justifier”, au sens péjoratif de l’expression.
Que dire, dès lors, de la philosophie ? Pas plus que pour la religion, nous ne chercherons à la définir mais, ce qui sera ici suffisant, à la caractériser. Il semble que l’on peut dire de la philosophie l’exact opposé de ce qui vient d’être dit de la religion. Reprenons les points l’un après l’autre.
La seule idée de révélation rendra a priori le philosophe, au mieux, perplexe. Que pourrait en dire en effet la raison, pierre de touche de la recevabilité d’une argumentation philosophique ? Descartes ne s’y est pas trompé : « Je révérais notre théologie, et prétendais, autant qu’un autre, à gagner le ciel ; mais ayant appris, comme chose très assurée, que le chemin n’en est pas moins ouvert aux plus ignorants qu’aux plus doctes, et que les vérités révélées, qui y conduisent, sont au-dessus de notre intelligence, je n’eusse osé les soumettre à la faiblesse de mes raisonnements, et je pensais que, pour entreprendre de les examiner, et y réussir, il était besoin d’avoir quelque extraordinaire assistance du ciel, et d’être plus qu’homme. »7 Notons que ces lignes ne contredisent en rien les textes où le même Descartes traite de Dieu, des preuves de son existence, de sa nature, et ainsi de suite, par exemple dans les Méditations, puisqu’il ne s’agit pas alors de vérités révélées, mais bien de vérités rationnelles, donc accessibles au philosophe. Autrement dit, la religion et indirectement le passage ci-dessus traitent du “Dieu des religions”, alors que c’est du “Dieu des philosophes” que Descartes affirme certaines propriétés.
Prenant un exemple de vérité révélée, Spinoza va plus loin : « Quand certaines Églises ajoutent que Dieu a pris une forme humaine, j’ai expressément averti que je ne sais pas ce qu’elles veulent dire ; et même, à dire vrai, affirmer cela ne me paraît pas moins absurde que de dire que le cercle a pris la forme d’un carré. »8
D’une manière générale, nul ne saurait nier que, souvent, les “vérités révélées” déconcertent, pour ne pas dire plus, la raison. Cela ne signifie pas pour autant que, pour cette seule raison, le philosophe doive les rejeter inconditionnellement. Un tel rejet ne se justifie que pour un certain courant philosophique, à savoir le rationalisme9. Mais pour accepter positivement l’idée qu’une révélation, tout en étant manifestement irrationnelle, est source de vérité, il faudra franchir un pas qui, d’après nous, fait sortir de la philosophie. Le philosophe le plus “ouvert” aux religions ne peut donc qu’être réservé quant à l’idée même de révélation. Comment d’ailleurs choisirait-il entre les diverses religions ? Le philosophe ne peut, comme le font la quasi-totalité des croyants, adopter une religion uniquement en fonction de la société à laquelle il appartient par sa naissance et par son éducation10.
Concernant le contenu des dogmes eux-mêmes, le philosophe devra selon nous adopter la même prudence. On peut sans doute s’entendre pour considérer qu’en aucun cas le philosophe n’acceptera une “vérité” qui, sans être évidente en elle-même, ne s’accompagne d’aucune justification théorique. Or nous avons remarqué précédemment que le fondement d’une religion n’est précisément jamais justifié a priori ; quand il l’est a posteriori, ce ne peut donc être que par une personne qui l’a au préalable admis sans une telle justification. Comment le philosophe pourrait-il avaliser cette admission ? Comment pourrait-il ne pas dénoncer la justification a posteriori comme une imposture visant à légitimer philosophiquement une prise de position qui ne fut pas, au départ, philosophique ? Le fondement d’une philosophie ne saurait être lui-même extérieur à la philosophie. Or la religion, et elle s’en félicite, trouve son principe hors de l’humanité, donc hors de la philosophie. Nous reviendrons sur ce point dans la troisième partie de cette étude.
De même, le philosophe ne pourra pas ne pas trouver contraire à la philosophie le refus de remettre en cause ou même seulement de “discuter” de certains dogmes, et singulièrement l’affirmation de la sacralité. On objectera peut-être que les philosophes eux-mêmes considèrent parfois certaines de leurs “vérités” comme indiscutables, sans qu’on leur refuse pour cela le titre de philosophe. La différence, de taille, est que le philosophe produira toujours, même lorsqu’il prétend énoncer une vérité indiscutable, une justification théorique l’accompagnant – ne serait-ce que l’affirmation de son évidence rationnelle, qui ne saurait sérieusement valoir pour les vérités révélées. De plus, il ne refusera jamais de répondre à une éventuelle objection11, pour peu qu’elle soit philosophiquement intelligible, et ne menacera aucun contestataire des flammes de l’enfer.
On peut donc conclure que sans justification théorique, une proposition, quelle qu’elle soit, ne peut prétendre être philosophique. Autrement dit, le sens et la valeur de la philosophie ne résident pas moins dans l’argumentation des thèses que dans les thèses elles-mêmes, ce qui ne saurait raisonnablement se dire de quelque religion que ce soit.
Plus généralement, on pourrait dire que, si la religion est acceptée, elle rend la philosophie, pour une importante partie, inutile. En effet, certains dogmes religieux peuvent être considérés comme des réponses non philosophiques à des questions que se posent aussi les philosophes. Aussi le philosophe qui cherche à répondre, philosophiquement, à ces mêmes questions, entreprend-il une tâche ridicule du point de vue de la religion : sans pouvoir se targuer de la même “infaillibilité” que les religions, car la philosophie n’est qu’humaine – trop humaine ? –, il va chercher des réponses peu fiables – et, de fait, ses “collègues” philosophes ne se priveront pas de les critiquer – alors qu’il en existe déjà, et de beaucoup plus sûres, puisque d’essence bien souvent divine, et en tous cas non sujettes à la faillibilité humaine. Il ne restera donc au philosophe qu’à s’occuper de domaines que la religion a bien voulu négliger, car ne touchant manifestement pas, selon elle, au “salut” de l’homme : l’épistémologie ou l’esthétique par exemple. Mais pour les questions de métaphysique, d’éthique, d’anthropologie au sens large et parfois de politique, le débat doit être considéré, du point de vue religieux, comme clos. A l’opposé, on peut considérer que, du point de vue du philosophe, les questions philosophiques n’ont pour lui de raison d’être que s’il estime qu’elles n’ont pas encore reçu de réponse complète et définitive, émanant d’une religion quelconque, d’un autre philosophe ou de quelque autre source que ce soit. C’est seulement en acceptant cette “vacuité” que la philosophie a un sens.
Au fond, et on le verra mieux dans les deux cas précis étudiés ci-après, pour les philosophes religieux, la philosophie ne peut servir qu’à “redécouvrir” par la raison ce que la foi, par le biais de la révélation, a déjà enseigné. Cette conception de la philosophie comme « servante de la théologie », héritée du Moyen-Âge, ne peut pas disparaître si l’on admet, avant de philosopher, la vérité d’une religion. Et, même si l’on fait mine de se défendre d’adopter une telle conception, on voit mal comment il en serait autrement : « la vérité ne peut contredire la vérité », et si une vérité est admise au préalable – la vérité religieuse –, on sait déjà, avant même de commencer à philosopher, que la deuxième – la vérité philosophique – sera identique à la première ou au moins compatible avec elle ; il reste seulement à trouver des arguments philosophiques pour appuyer cette vérité unique, mais à deux visages. C’est par exemple la position de Jean-Paul II qui ouvre ainsi l’encyclique Fides et ratio : « La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l’esprit humain de s’élever vers la contemplation de la vérité »12. Mais si la métaphore est juste, les deux ailes doivent nécessairement voler de manière concordante. Le chemin et le but étant bien sûr déterminés, dès l’envol, par l’aile de la foi, l’aile de la raison n’a plus qu’à s’y plier…
On pourrait ici nous faire l’objection suivante : certes, si la religion est admise avant que la réflexion philosophique soit engagée, les jeux sont faits, et la philosophie n’en sera pas vraiment une, puisque sa fin, dans les deux sens du terme, est déjà connue, et surtout a été déterminée de l’extérieur de la philosophie. Mais qu’est-ce qui empêche un philosophe de découvrir au préalable, par la philosophie, des vérités dont il remarquera ensuite la conformité avec une religion donnée, adoptant ainsi cette dernière après, et non avant, la naissance de sa réflexion philosophique ? Nous ne pouvons ici qu’acquiescer sur le plan théorique. Si un tel itinéraire de pensée existait, c’est sans hésitation que nous lui accorderions le statut de philosophie. Deux remarques s’imposent toutefois :
– Premièrement, nous ne pouvons manquer de signaler l’extrême difficulté théorique d’un tel cheminement, ainsi que l’impossibilité pratique de vérifier l’ordre de ses étapes, telles qu’elles ont été décrites ci-dessus. Il est en effet indéniable que, dans la quasi-totalité des cas, la religion apparaît bien avant la philosophie dans l’existence d’un individu. Lorsque l’esprit de l’adolescent est suffisamment mûr pour philosopher, la religion y est souvent déjà présente depuis bien longtemps. Il est vrai que certains ont su se dégager de l’influence de l’éducation religieuse qu’ils ont reçue. Mais on voit bien que, sauf exception rarissime, c’est toujours la religion qui précède la philosophie dans l’histoire d’un homme. De qui peut-on donc affirmer qu’il a “redécouvert” dans la religion ce qu’il avait découvert dans la philosophie ?
– Deuxièmement, même si une philosophie parvenait à justifier philosophiquement tous les dogmes voire toutes les pratiques d’une religion donnée, cette philosophie n’aurait qu’une conformité extérieure et même fortuite avec cette religion, puisque la seule justification véritable d’une religion est la révélation et que celle-ci est, par définition, hors de portée de toute justification philosophique. Autrement dit, une telle philosophie ne serait pas vraiment religieuse.
Il faut à présent confronter les analyses générales qui précèdent à des cas concrets qui pourraient sembler les invalider. En premier lieu, pour “tester” notre thèse selon laquelle il ne peut exister de philosophie religieuse, nous étudierons les textes de deux philosophes en accord avec une certaine religion (en l’occurrence le Christianisme). En second lieu, pour vérifier qu’une religion philosophique est impossible, notre attention se portera sur religion particulière dont certains affirment le caractère philosophique.
Une remarque méthodologique s’impose ici. Des exemples, aussi nombreux soient-ils, ne constituent pas des preuves en eux-mêmes. Ils ne jouent ici qu’un rôle d’illustration, en vue de rendre concrète notre thèse.
2. Les philosophies de Leibniz et de Kant sont-elles des philosophies religieuses ?
Les “philosophies religieuses” que nous allons maintenant étudier sont celles de Leibniz et de Kant13. Nous ne prétendons pas ici livrer une analyse intégrale de la philosophie de la religion de ces auteurs, mais seulement indiquer le ou les moments où, selon nous, ils ont “glissé” de l’intérieur à l’extérieur de la philosophie pour tenter de justifier leur croyance religieuse. Un passage du début du Discours de métaphysique de Leibniz suffira à montrer ce que nous considérons comme une “sortie injustifiée” hors de la philosophie, injustifiée en ceci seulement qu’elle prétend prendre place dans une argumentation philosophique, tant dans le problème étudié que dans la méthode adoptée. Cela signifie que, en dehors de son activité philosophique, un philosophe peut fort bien écrire des textes exposant des vérités révélées – ou de la littérature, ou quoi que ce soit… –, à condition qu’il n’affirme ni ne sous-entende qu’il s’agit là de textes philosophiques ; or c’est précisément le cas de l’ouvrage évoqué ici, comme l’indique clairement son titre.
Après avoir défini Dieu comme étant « un être absolument parfait » et expliqué ce qu’on doit entendre par le concept de perfection, Leibniz conclut « que Dieu possédant la sagesse suprême et infinie agit de la manière la plus parfaite » et « que plus on sera éclairé et informé des ouvrages de Dieu, plus on sera disposé à les trouver excellents et entièrement satisfaisants à tout ce qu’on aurait pu souhaiter. » Bien qu’il y ait dans ces lignes matière à de nombreuses objections, nous sommes ici dans la philosophie, précisément parce que ces objections peuvent être elles-mêmes de nature philosophique. Il nous semble en revanche que Leibniz sort de la philosophie lorsqu’il écrit :
« Ainsi, je suis fort éloigné du sentiment de ceux qui soutiennent qu’il n’y a point de règle de bonté et de perfection dans la nature des choses, ou dans les idées que Dieu en a et que les ouvrages de Dieu ne sont bons que pour cette raison formelle que Dieu les a faits. Car si cela était, Dieu sachant qu’il en est l’auteur n’avait que faire de les regarder par après et de les trouver bons, comme le témoigne la sainte écriture. »14
L’importance de l’argument de l’autorité biblique est ici prépondérante : Dieu a regardé ses ouvrages et les a trouvés bons, car c’est ce qu’affirment l’écriture, qualifiée de “sainte” sans justification. Or il nous semble que le philosophe n’est pas tenu de croire a priori en la divinité de l’origine des Écritures. Mais, une fois admise l’autorité de la Bible, le passage ci-dessus ne se prête à aucune objection philosophique : dès lors, il est en quelque sorte “infalsifiable” au sens que Popper donne à ce terme. Aucun débat philosophique n’est plus possible. Le raisonnement de Leibniz, entièrement explicité, est en effet le suivant :
1. La Bible a été inspirée par Dieu.
2. Or Dieu possède toutes les perfections morales, dont celle d’être vérace.
3. Donc la Bible dit la vérité.
4. Or la Bible dit que Dieu, après avoir créé certaines de ses œuvres, vit qu’elles étaient bonnes (par exemple : « Dieu dit : “Que les eaux qui sont sous le ciel s’amassent en une seule masse et qu’apparaisse le continent” et il en fut ainsi. Dieu appela le continent “Terre” et la masse des eaux “mers”, et Dieu vit que cela était bon. »15)
5. Donc Dieu a pu constater, ou plus précisément “vérifier”, la bonté de ses œuvres en les regardant.
6. Donc les choses sont bonnes intrinsèquement, c’est-à-dire que la bonté est en elles-mêmes, et non pas extrinsèquement, c’est-à-dire seulement parce que Dieu en est l’auteur ou la cause.
On peut indifféremment inverser l’ordre des propositions 1. et 2. Il reste que la divinité des Écritures est un pilier de cette démonstration, et donc que sa remise en cause implique celle de tout le raisonnement. Or il semble clair que l’affirmation « La Bible a été inspirée par Dieu » n’est pas et ne peut pas être une thèse philosophique16, c’est-à-dire une affirmation susceptible d’être fondée et contredite par des arguments philosophiques – si du moins on se réfère au sens que Leibniz donne ici au mot “Dieu”, c’est-à-dire au sens religieux.
Nous affirmons donc que le raisonnement de Leibniz extrait du Discours de métaphysique n’est pas, par son fondement, philosophique, et plus généralement que tout système de pensée fondé sur une quelconque révélation, sans que la raison vienne justifier ce fondement17, ne saurait être qualifié de philosophie.
Pour Spinoza en revanche, la question de la divinité des Écritures peut se poser en termes philosophiques, mais en donnant au concept de Dieu un sens qui n’est assurément pas le sens religieux. Lorsqu’il écrit en effet : « (…) la plupart, en vue de comprendre l’Écriture et d’en dégager le vrai sens, posent pour commencer la divine vérité de son texte intégral. (Alors que cette conclusion devrait découler d’un examen sévère de son contenu.) »18, il est clair que l’expression « divine vérité » est quasiment, sous sa plume, un pléonasme, et donc que c’est en examinant le texte biblique lui-même que l’on pourra conclure qu’il dit la vérité – ou non –, et donc qu’il exprime la “divine vérité”. Pour Leibniz, la Bible dit vrai parce que Dieu en est l’auteur19 ; c’est du moins ce qu’on peut supposer en l’absence de toute autre justification.
Dans La religion dans les limites de la simple raison, Kant va tenter de montrer que le Christianisme n’est pas seulement un « religion révélée », étant apparue à une époque et un endroit précis, mais également une « religion naturelle », c’est-à-dire, en droit, universelle et mondiale : chaque homme, quelles que soient son époque et sa société, et pour autant qu’il soit doué de raison, peut reconnaître que les principes moraux enseignés par le Christianisme sont identiques à ceux que sa raison pratique lui dicte. Pour démontrer cette identité, Kant va se livrer à une exégèse détaillée du Sermon sur la montagne20, texte qui contient d’après lui l’essentiel des préceptes moraux du Christianisme. Ce que Kant relève notamment dans le Sermon, c’est qu’il enjoint de suivre l’esprit de la loi plutôt que la lettre. On retrouve ici la distinction faite par Kant dans les Fondements de la métaphysique des mœurs entre “agir par devoir” et “agir conformément au devoir”. Ainsi du fameux passage :
« Vous avez entendu qu’il a été dit : “Tu ne commettras pas l’adultère”. Eh bien ! Moi je vous dis : quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis, dans son cœur, l’adultère avec elle. »21
Kant comprend ces versets comme dénonçant l’hypocrisie d’une conduite extérieure ou plus précisément physique, seulement conforme extérieurement à l’interdiction de l’adultère22 – consistant à ne pas commettre l’acte de l’adultère –, et qui l’enfreint néanmoins si le désir est bien réel. Plus généralement, Kant rappelle que l’enseignement du Christ n’est pas supposé être différent de la loi hébraïque23, mais qu’il a interprété la Loi pour montrer sa conformité à la raison pratique : « Car au pied de la lettre, la loi autorisait exactement le contraire »24 de ce qu’autorise l’interprétation du Christ, dit Kant.
Remarquons que pour parvenir à la conviction que la Bible est en conformité avec la raison pratique, il a fallu tout d’abord que le Christ interprète la loi hébraïque, c’est-à-dire qu’il en révèle l’esprit en la débarrassant d’une lecture « au pied de la lettre », puis que Kant lui-même interprète les paroles du Christ pour montrer qu’elles ne sont qu’une autre formulation, sans doute plus accessible au plus grand nombre, de la loi morale prise en elle-même, énoncée en termes philosophiques.
C’est donc au prix de deux interprétations successives – celle de la loi hébraïque par le Christ puis celle des paroles du Christ par Kant – que l’on parvient à montrer la conformité de l’enseignement biblique avec la raison pratique. Et c’est bien là la première objection que l’on peut faire à Kant : une religion naturelle étant universelle, tout homme doit pouvoir accéder aux vérités qu’elle enseigne. S’il est déjà déconcertant que Dieu transmette aux hommes un texte énonçant une loi morale qu’il a, de toute façon, “inscrite” en tout homme possédant la raison pratique, il est encore plus étonnant que ce texte doive dans certains cas – l’Ancien Testament – “subir” tour à tour deux interprétations, dont le moins que l’on puisse dire est qu’elles ne vont pas de soi25, pour au bout du compte énoncer ce que tous savaient déjà avant ! Si l’on ajoute que le texte d’origine, supposé être inspiré par Dieu, enseigne selon Kant lui-même des choses opposées selon qu’on le prend à la lettre ou qu’on en dégage l’esprit, on comprend difficilement la valeur et la légitimité d’un tel texte. Kant ne cherche-t-il pas plutôt à “asseoir” la légitimité de sa philosophie morale sur l’autorité du Christianisme ? Sur le plan philosophique, qu’importe après tout que la “vraie” morale, que Kant prétend enseigner, soit ou non celle d’une religion institutionnelle, fût-ce la religion dominante ?
On peut également contester la prééminence et même l’exclusivité que Kant accorde au Christianisme en matière de morale : « Mais, suivant la religion morale (et parmi toutes les religions publiques qu’il y eut jamais, seule la religion chrétienne a ce caractère) … »26 Cette affirmation, écrite entre parenthèses, comme semblant si peu contestable qu’elle se passe de justification, a évidemment de quoi choquer par son intolérance. Mais elle déconcerte également celui qui a pris note du fait que le Christianisme n’enseigne en fin de compte rien de plus que le Judaïsme. Si le Christ, selon ses propres paroles, vient pour accomplir la Loi et les Prophètes27, c’est bien qu’il n’y a aucune différence de fond entre le Judaïsme et le Christianisme28. Si différence il y a, ce ne peut pas être une différence telle que le second serait une, ou plutôt “la” religion morale, ce que ne serait pas le premier ! Plus précisément, pour Kant, si le Judaïsme n’est pas une religion morale, c’est parce que, comme toutes les religions sauf le Christianisme, il comporte en lui la recherche des faveurs divines.
Cette délicate question tourne plus ou moins directement autour de ce qu’on appelle la morale de la rétribution, c’est-à-dire une morale qui affirme que les pieux et les justes sont récompensés et que les impies et les méchants sont punis. S’il est incontestable que la Bible hébraïque enseigne parfois une telle morale29, des livres comme ceux de Job30 et de l’Ecclésiaste la condamnent catégoriquement31 – ce dont Kant ne tient pas compte – en remarquant que le juste subit parfois des maux “naturels”, donc d’origine divine, et que la fortune sourit parfois au méchant. Chacun est alors invité à s’en remettre à la sagesse divine sans chercher à en percer les desseins.
Supposons toutefois que cette immoralité du Judaïsme soit fondée ce qui, on le voit, ne va pas de soi. Le plus paradoxal est encore que Kant, en critiquant indirectement la morale juive, condamne nécessairement la Bible hébraïque, où la morale de la rétribution apparaît effectivement. Or cette Bible hébraïque est, quelques différences infimes mises à part, reprise par le Christianisme à son propre compte sous le nom d’Ancien Testament. La recherche des faveurs est-elle présente ou absente des mêmes textes, selon qu’ils sont lus par les Juifs ou par les Chrétiens ? Il y a là encore, semble-t-il, une très forte partialité de Kant en faveur du Christianisme, partialité qu’une véritable neutralité philosophique a priori aurait rendue, selon nous, impossible. Nous affirmons bien que cette neutralité devrait exister a priori, sans qu’elle doive nécessairement se prolonger a posteriori. Mais Kant ne justifie par aucun argument philosophique la suprématie du Christianisme dans le domaine morale. On pourrait d’ailleurs remarquer que le Nouveau Testament n’est pas non plus exempt de passages exprimant une morale de la rétribution32, ce que Kant, là encore, passe sous silence.
Dans la même logique, il écrit : « Il n’existe qu’une religion (vraie) »33. Mais comment le Christianisme pourrait-il être la vraie religion s’il est, selon les paroles de Jésus lui-même, l’accomplissement d’une fausse religion, en l’occurrence le Judaïsme ?
Enfin34, Kant nous semble également faire preuve d’une précipitation suspecte et fort peu philosophique lorsqu’il écrit : « J’admets premièrement la proposition suivante, comme principe n’ayant pas besoin de preuve : Tout ce que l’homme pense pouvoir faire, hormis la bonne conduite, pour se rendre agréable à Dieu est simplement illusion religieuse et faux culte de Dieu »35. Non pas que nous pensions, le lecteur l’aura compris, que bien d’autres comportements sont susceptibles de plaire à Dieu ; mais ce qui est ici affirmé presque explicitement, c’est que la bonne conduite d’un homme le rend agréable à Dieu. Voilà certes une proposition qui aurait selon nous besoin de preuve, si cela était possible. A vrai dire, il peut sembler au contraire que l’idée d’un Dieu sensible aux comportements humains a quelque chose d’irrespectueux, pour ne pas dire d’hérétique, à moins d’affirmer que Kant utilise un langage anthropomorphique, ce que rien ne laisse supposer.
Bien d’autres remarques seraient possibles pour confirmer, avec celles qui précèdent, que Kant fait reposer sa philosophie morale sur un fondement non philosophique, mais bel et bien religieux a priori, donc non argumenté rationnellement.
3. Le Catholicisme est-il une religion philosophique ?
Nous allons à présent examiner un cas de religion prétendant ou pouvant prétendre être philosophique. Si nous choisissons le Catholicisme, ce n’est pas essentiellement parce qu’il est la religion plus répandue dans nos sociétés dites latines, mais surtout parce qu’il s’est doté d’une théologie plus “systématique” que d’autres religions, à la fois par sa “fréquentation” de la philosophie occidentale et par sa structure très hiérarchisée, qui ont permis l’établissement d’une doctrine unifiée et officielle, à l’abri, normalement, de toute contestation interne, ce qui facilite d’ailleurs grandement la recherche des références.
Quelques remarques préalables s’imposent toutefois. Nous avons déjà évoqué l’idée selon laquelle le fondement d’une philosophie ne saurait être “extra-philosophique”. C’est pourquoi la manière dont débute une philosophie est capitale. Notons que ce “début” n’est pas forcément – et, dans les faits, n’est que rarement – premier chronologiquement dans l’œuvre d’un philosophe. Ainsi le doute radical de Descartes est bien le début “logique” de sa philosophie sans apparaître dans ses premières œuvres. Si certains philosophes semblent ne pas s’être particulièrement souciés de ce “début philosophique”, ce ne peut être que parce qu’ils considèrent qu’il n’y a pas à proprement parler à fonder la philosophie, ou encore parce que toute réflexion philosophique peut servir de fondement à la philosophie.
Il ne saurait en aller de même dans une religion, dont le point de départ, à savoir la révélation, est toujours extérieur à la raison et même, plus largement, à l’homme. En fait, nous avons déjà rencontré ce cas de figure dans les textes de Leibniz et de Kant étudiés plus haut, dont nous avons montré qu’ils s’appuyaient sur des données spécifiquement religieuses, donc impossibles à argumenter philosophiquement.
Nous allons retrouver cette extériorité dans le fondement du Catholicisme : « Au point de départ de toute réflexion que l’Église entreprend, il y a la conscience d’être dépositaire d’un message qui a son origine en Dieu même (…). La connaissance qu’elle propose à l’homme ne vient pas de sa propre spéculation, fût-ce la plus élevée, mais du fait d’avoir accueilli la parole de Dieu dans la foi »36. Les choses sont donc claires : les vérités religieuses, auxquelles les hommes peuvent accéder par la révélation, préexistent à toute réflexion humaine. En raison de leur origine divine, elles sont infaillibles. Avant même d’inaugurer la moindre réflexion, le philosophe catholique sait donc vers quoi doit tendre sa philosophie. Celle-ci n’a par conséquent qu’un rôle secondaire de confirmation a posteriori de “vérités” admises comme vraies avant toute intervention de la raison philosophique. C’est donc en toute logique que Jean-Paul II écrit : « L’Église, pour sa part, ne peut qu’apprécier les efforts de la raison pour atteindre des objectifs qui rendent l’existence personnelle toujours plus digne. Elle voit en effet dans la philosophie le moyen de connaître des vérités fondamentales concernant l’existence de l’homme. En même temps, elle considère la philosophie comme une aide indispensable pour approfondir l’intelligence de la foi et pour communiquer la vérité de l’Évangile à ceux qui ne la connaissent pas encore »37. Ce que nous considérons comme contraire à la philosophie dans ces lignes, ce n’est pas, encore une fois, la position elle-même, c’est-à-dire la fonction “évangélisatrice” assignée à la philosophie, mais le fait que cette position soit assignée de l’extérieur de la philosophie, c’est-à-dire sans argumentation rationnelle. Dans la même logique, le pape condamne au terme de son encyclique un certain nombre de courants de pensée : l’éclectisme, l’historicisme, le scientisme, le pragmatisme et le nihilisme38. Ces doctrines sont considérées à la fois comme des « erreurs » et des « dangers ». C’est dire qu’il aurait mieux valu qu’elles ne soient jamais formulées. On ne peut là encore que refuser de qualifier de philosophie une pensée qui se voudrait sans “adversaire”, même intellectuel ; nous estimons en effet que l’esprit critique et l’ouverture à la contestation doivent être des soucis constants du philosophe, conscient qu’il est, et ne peut qu’être, de ne pouvoir se prévaloir d’aucune infaillibilité. Autrement dit, le philosophe a philosophiquement intérêt à être contesté, afin de tester la validité de sa pensée. Au contraire, une doctrine d’origine “surhumaine” ne peut avoir, envers une contestation humaine, qu’une attitude de commisération, d’indifférence, de mépris ou de violence, mais pas véritablement, on ne le voit que trop, d’écoute véritable.
On peut donc admettre que les “vérités religieuses” précèdent toute réflexion philosophique. Mais, objectera-t-on peut-être, la foi dans ces vérités religieuses ne peut-elle pas, quant à elle, être justifiée philosophiquement… ? Pas davantage, comme le reconnaît, là encore, le dogme catholique : « Le motif de croire n’est pas que les vérités révélées apparaissent comme vraies et intelligibles à la lumière de notre raison naturelle »39. Toutefois, pour que la foi soit conforme à la raison, Dieu a mis en œuvre des « preuves extérieures de sa Révélation » : « les miracles du Christ et des saints40, les prophéties, la propagation et la sainteté de l’Église, sa fécondité et sa stabilité ». La raison du philosophe trouvera-t-elle dans cette liste des preuves ou des « signes certains » de la révélation chrétienne ? Accordons au moins que cela n’est pas évident…
Conclusion
L’examen des “philosophies religieuses” de Leibniz et Kant a montré diverses “failles”, non pas en tant qu’erreurs à l’intérieur de leur philosophie, mais précisément en tant que manquements à l’exigence philosophique d’une argumentation rationnelle et donc de refus d’un quelconque argument d’autorité, fût-ce l’autorité de la Bible.
Nous pouvons donc conclure qu’une “philosophie religieuse” est soit extérieure à la religion, si la philosophie “précède” la religion41, soit extérieure à la philosophie si, comme nous croyons l’avoir montré pour les deux cas étudiés, la religion “précède” la philosophie. Cela ne signifie bien entendu pas que le philosophe soit par définition irréligieux. Dans la mesure où il est homme “avant” d’être philosophe, il pourra, comme Leibniz, Kant et beaucoup d’autres, croire en Dieu et même appartenir à une religion précise. Mais il devra renoncer à légitimer sa foi, ses croyances et ses pratiques par des arguments philosophiques, et donc renoncer à intégrer sa religion dans sa philosophie. Il pourra seulement – et même en tant que croyant, il devra probablement – expliquer pourquoi sa philosophie doit forcément laisser une place, hors d’elle (au-dessus, dira-t-il sûrement), à la religion. Il pourra par exemple, à la manière d’un Pascal, essayer de montrer que la raison et donc la philosophie peuvent reconnaître elles-mêmes leurs propres limites : « La dernière démarche de la raison est de reconnaître qu’il y a une infinité de choses qui la surpassent ; elle n’est que faible, si elle ne va jusqu’à connaître cela. »42
Le philosophe peut donc être religieux, mais il ne peut pas l’être en tant que philosophe. La philosophie peut indiscutablement aller jusqu’au déisme ou au théisme, mais le pas qui mène du théisme à une religion révélée est précisément le pas qui fait sortir de la philosophie.
L’hypothèse d’une religion philosophique, du fait du nécessaire fondement non humain de toute religion, est elle aussi, dès le départ, à exclure.
Quant à l’athéisme, il n’est jamais que le refus d’une certaine conception de Dieu ou des dieux. On peut le voir par exemple avec Spinoza qui, tout en démontrant l’existence de Dieu43, peut bien être considéré comme “athée”, au sens où il refuse l’existence d’un Dieu anthropomorphe44. On le voit encore avec Marcel Conche, qui s’attaque précisément à l’idée d’un Dieu à la fois moralement bon et tout-puissant : « Il est indubitable (…) que le supplice des enfants a été, et devait ne pas être, et que Dieu pouvait faire qu’il ne soit pas. Comme Dieu ne s’est pas manifesté dans des circonstances où, moralement, il l’aurait dû, s’il existait, il serait coupable. La notion d’un Dieu coupable et méchant apparaissant contradictoire, il faut conclure que Dieu n’est pas. »45 Nous n’affirmons certes pas que cette argumentation, non plus que les démonstrations de l’existence de Dieu de Spinoza, sont à l’abri de toute contestation, y compris philosophique. Mais nous avons bien là des exemples de raisonnement parfaitement intelligible, que même le plus fervent des croyants peut suivre, pour peu qu’il soit doué de raison. L’athéisme peut donc être philosophique ou, ce qui revient au même, une philosophie peut être athée.
On se méprendrait en voyant dans cette étude une attaque contre les religions en général. Nous avons même indiqué à plusieurs reprises que l’attitude des religieux est très souvent en parfaite cohérence avec leurs convictions. Nous avons uniquement cherché à montrer en quoi religion et philosophie, sans forcément se combattre mutuellement, ne peuvent pas s’unir sans une dangereuse “confusion des genres”. Pour les deux partis, une telle union ne serait donc pas pour le meilleur mais seulement pour le pire…
Marc Anglaret
(écrire à cet auteur)
Commentaire
1 Nous considérerons ici les religions dans leur approximative unité, et plus précisément dans leur rapport à la philosophie.
2 Ces deux questions reviennent, au bout du compte, au même, mais au bout du compte seulement.
3 Nous reviendrons, avec l’examen de la position kantienne, sur la distinction entre religion naturelle et religion révélée.
4 Nous précisons bien qu’il ne s’agit pas là de donner une définition, avec tout ce que cette opération implique, de la religion, mais bien de la distinguer de la philosophie.
5 La question n’est pas ici celle de l’intolérance des religions, fort diverses sur ce point comme sur d’autres, mais celle du statut de l’affirmation de la sacralité au sein même d’une religion. Nous soutenons ici que cette affirmation se présente toujours comme indubitable, au point que toute éventuelle critique à ce sujet doit être considérée comme “déplacée”, dans le meilleur des cas…
6 Nous distinguons ici le fondement d’une religion, c’est-à-dire la ou les croyances, toujours liées au sacré selon nous, sur lesquelles s’appuient les autres croyances, de son principe, qui n’est pas une croyance mais l’origine de sa révélation : par exemple Dieu dans les religions monothéistes.
7 Discours de la méthode, première partie. NRF Gallimard, « La Pléiade », p.130. C’est nous qui soulignons.
8 Lettre LXXIII à Oldenburg (1675). NRF Gallimard, « La Pléiade », p.1283. Ce célèbre passage devrait suffire à éviter toute “récupération” du spinozisme par le Christianisme – ce qui, dans les faits, n’est pas le cas.
9 On objectera que certains philosophes habituellement qualifiés de rationalistes – par exemple Leibniz – admettent les vérités révélées de certaines religions, notamment le Christianisme. Nous étudierons précisément plus loin le cas de Leibniz, en montrant pourquoi il ne peut pas, selon nous, être pleinement considéré comme rationaliste.
10 Il n’a toutefois échappé à personne que, par une étrange coïncidence, les philosophes croyants adoptent dans la quasi-totalité des cas la religion de leur éducation, familiale notamment, et ce pas seulement dans le cas du Christianisme, comme le montrent les cas d’Averroès et de Maïmonide par exemple. Nous ne connaissons pas de contre-exemple sur ce point (Schopenhauer ne peut pas, par exemple, être sérieusement qualifié de “philosophe bouddhiste”, bien qu’il se soit lui-même reconnu dans certaines thèses du Bouddhisme).
11 Nous pensons par exemple aux Objections faites aux Méditations de Descartes, ou à la correspondance de nombre de philosophes.
12 Jean-Paul II, Fides et ratio (la foi et la raison), I, prologue ; lettre encyclique du 14 septembre 1998. Supplément au quotidien « La Croix » du 16 octobre 1998, p.3
13 D’autres philosophies pourraient bien sûr avoir leur place ici, par exemple celle de Hegel. C’est pour ne pas rendre cette étude trop volumineuse que nous avons choisi ces deux exemples, à la fois pour leur relative simplicité et leur représentativité. Par ailleurs, il est certain que l’examen de “philosophies religieuses” non chrétiennes manque à cette étude. Notre quasi-ignorance en la matière est la raison de cette absence.
14 Discours de métaphysique, 1, II. Éditions Vrin, p.26. C’est nous qui soulignons.
15 Genèse, 1, 9 –10. C’est nous qui soulignons.
16 A fortiori ne peut-elle pas être la thèse d’un philosophe rationaliste, qualificatif que l’on attribue souvent à Leibniz.
17 Et pour cause : nous croyons avoir montré plus haut qu’une telle justification est impossible ; au moins devrait-elle être tentée par Leibniz s’il entend se placer dans une perspective philosophique.
18 Spinoza, Traité des autorités théologique et politique, préface. NRF Gallimard, « La Pléiade », p.612
19 Selon Spinoza, au contraire, on pourrait dire que Dieu est l’auteur de la Bible seulement si elle dit vrai (ce qui reste donc à démontrer rationnellement), mais en donnant au mot “Dieu” un sens qui exclut toute révélation : toute la première partie de l’Éthique, intitulée “de Dieu”, est exempte de la moindre allusion biblique ou théologique.
20 Évangile selon Matthieu, chapitres 5 à 7.
21 Évangile selon Matthieu, 5, 27 – 28.
22 Interdiction formulée dans le septième des dix commandements (Exode, 20, 14).
23 Évangile selon Matthieu, 5, 17 : « N’allez pas croire que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. »
24 La religion dans les limites de la simple raison, IV, 1, 1. Éditions Vrin, p.179
25 Puisque dans les deux cas, de nombreux siècles se sont écoulés entre le texte et son interprétation : de la rédaction du Décalogue dans l’Exode à l’interprétation qu’en fait Jésus dans les Évangiles d’une part, de la rédaction des Évangiles à l’interprétation qu’en fait Kant d’autre part.
26 La religion dans les limites de la simple raison, op. cit., I, Remarque générale. p.92. C’est nous qui soulignons.
27 Cf. note 23.
28 … ou plus exactement entre le Judaïsme et l’enseignement de Jésus, car rien dans les paroles de ce dernier n’indique clairement qu’il voulait fonder une nouvelle religion, mais plutôt, comme on l’a dit (note 23), qu’il était venu pour « accomplir » le Judaïsme.
29 Par exemple : « Si le juste ici-bas reçoit son salaire, combien plus le méchant et le pécheur » (Proverbes, 11, 31 ; le terme « salaire » est ici sans ambiguïté). Bien d’autres versets, dans ce livre ou dans d’autres, sont tout aussi explicites.
30 Dans le livre de Job, Yahvé, par l’intermédiaire de Satan, “éprouve” la foi de Job, homme riche et pieux, en détruisant ses biens, en faisant tuer ses serviteurs et ses enfants, puis en le frappant de maladie. Job, conformément aux prédictions de Satan et contre celles de Yahvé, reproche à ce dernier son injustice. La “leçon” du livre, donnée par Yahvé lui-même, est que nul ne doit se permettre de juger son Dieu, et ce même s’il lui semble injuste. Cela dit, Job recouvre à la fin du récit tout ce qu’il a perdu : la morale de la rétribution est confirmée, bien que le propos “officiel” du livre la condamne.
31 Les théologiens appellent cela une « évolution » de la doctrine biblique, terme certes moins brutale que celui de « contradiction »…
32 Par exemple : « C’est qu’en effet le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de son Père, et alors, il rendra à chacun selon sa conduite » (Évangile selon Matthieu, 16, 27).
33 La religion dans les limites de la simple raison, op. cit., III, 1, 5. p.137
34 Il n’y a bien entendu nulle prétention à l’exhaustivité dans ces quelques remarques.
35 La religion dans les limites de la simple raison, op. cit., IV, 2, 2. p.188
36 Jean-Paul II, Fides et ratio, I, 7 ; op. cit., p.5
37 Ibid., I, 5 ; p.4. C’est nous qui soulignons.
38 Ibid., VII, 86 - 90 ; pp.31 - 32.
39 Catéchisme de l’Église Catholique, première partie, chapitre troisième, article I, 3, §156. Mame / Plon, p.44
40 Mais que faire alors de ce verset : « « Il surgira, en effet, des faux Christ et des faux prophètes, qui produiront de grands signes et des prodiges, au point d’abuser, s’il était possible, même les élus. » (Évangile selon Matthieu, 24, 24).
41 On peut ici se reporter aux deux remarques précédant l’analyse de la “philosophie religieuse” de Leibniz, en haut de la page 4.
42 Pascal, Pensées, fragment 267 de l’établissement de Brunschvicg (188 de Lafuma). Garnier-Flammarion, p.266. Concernant les Pensées en général, il est bien malaisé de dire s’il s’agit bien là d’un ouvrage philosophique au sens où nous l’avons expliqué plus haut. En fait, certains fragments le sont sans aucun doute, comme celui du pari (Brunschvicg : 233 ; Lafuma : 418). D’autres ne le sont manifestement pas, comme ceux sur les « preuves de Jésus-Christ » (Brunschvicg : 737 et suivants), qui ne s’adressent pas à la raison, mais bien à la foi éventuelle du lecteur.
43 Éthique, I, proposition 11. NRF Gallimard, « La Pléiade », pp.317 – 319.
44 Appendice de la première partie de l’Éthique et Traité des autorités théologique et politique, surtout les chapitres I à XII.
45 Marcel Conche, Orientation philosophique. I. “La souffrance des enfants comme mal absolu”. P.U.F. p.57
Religion et Philosophie
Religion & philosophie
On a suffisamment remarqué que la religion1 et la philosophie peuvent être rapprochées, notamment par les questions communes qu’elles se posent : celles de la place de l’homme dans la nature, du bien et du mal, et d’autres encore. En outre, quelques théologiens ont “emprunté” aux philosophes certains de leurs concepts et de leurs formes de raisonnement, comme saint Thomas d’Aquin à Aristote. La réciproque existe également, par exemple dans le concept philosophique de Dieu. Enfin, nombre de philosophes se sont réclamés ou se réclament d’une religion particulière. Ce sont là quelques unes des raisons de se demander si une philosophie peut être religieuse ou si une religion peut être philosophique2. Bien que la réponse soit évidemment positive pour beaucoup, nous tenterons de montrer ici que la religion comme la philosophie ne peuvent que se perdre elles-mêmes, c’est-à-dire renoncer à ce qui les caractérise respectivement, dans une telle “union”.
Pour étayer notre réponse, il nous faudra pour commencer déterminer quelques unes des propriétés spécifiques de la religion d’une part, de la philosophie d’autre part.
1. Considérations générales sur la religion et la philosophie
Il semble que la notion de révélation soit la première spécificité de la religion au sens habituel du terme – celui, précisément, de religion révélée3 –, dans la mesure où elle est la condition même de la possibilité d’une religion : aucune ne prétend en effet être une émanation de l’homme seul ; il faut donc qu’un principe extérieur à l’humanité soit en mesure de transmettre à celle-ci, quelle qu’en soit la manière, ce qui définira la religion en question. C’est cette transmission que nous appelons ici révélation.
Quant au principe lui-même, les cas du Bouddhisme et de quelques autres religions orientales suffisent à empêcher qu’on le définisse par le terme de divinité : il y a des religions sans dieu. Mais ces cas ne sont pas vraiment gênants, car on peut se référer plus largement à la notion de sacré ; la religion est alors ce qui met l’homme en rapport avec le sacré4. On peut ajouter que le sacré, bien qu’il se réfère, selon les religions, à des actions, des choses ou des entités fort diverses, doit être caractérisé dans chaque religion comme un absolu. Autrement dit, la sacralités de ce qui est sacré ne peut pas, à l’intérieur d’une religion donnée, être discutée, remise en cause ou a fortiori niée5. Il y a plus encore : l’affirmation de la sacralité de ce qui est sacré se présente comme le fondement de la religion concernée6, fondement qui, justement parce qu’il est indiscutable, n’a pas à être expliqué. Et dans tous les cas, les éventuelles “justifications” théologiques de ce fondement n’appartiennent pas en propre à la religion concernée. Nous voulons dire par là que premièrement, elles sont toujours développées a posteriori, et bien souvent dans un but plus didactique que véritablement religieux. Deuxièmement et en conséquence, elles sont au bout du compte facultatives, au sens où leur absence n’affaiblirait pas la religion en elle-même. Troisièmement, elles sont inutiles pour l’authentique croyant dont la foi n’a nul besoin d’explication. On peut même, d’un certain point de vue, les considérer comme nuisibles pour cette religion, dans la mesure où elles paraissent sous-entendre que le fondement de la religion en question ne va pas de soi. Autrement dit, les justifications rationnelles d’une religion prennent toujours le risque d’être perçues comme des aveux de faiblesse d’une doctrine qui aurait besoin de “se justifier”, au sens péjoratif de l’expression.
Que dire, dès lors, de la philosophie ? Pas plus que pour la religion, nous ne chercherons à la définir mais, ce qui sera ici suffisant, à la caractériser. Il semble que l’on peut dire de la philosophie l’exact opposé de ce qui vient d’être dit de la religion. Reprenons les points l’un après l’autre.
La seule idée de révélation rendra a priori le philosophe, au mieux, perplexe. Que pourrait en dire en effet la raison, pierre de touche de la recevabilité d’une argumentation philosophique ? Descartes ne s’y est pas trompé : « Je révérais notre théologie, et prétendais, autant qu’un autre, à gagner le ciel ; mais ayant appris, comme chose très assurée, que le chemin n’en est pas moins ouvert aux plus ignorants qu’aux plus doctes, et que les vérités révélées, qui y conduisent, sont au-dessus de notre intelligence, je n’eusse osé les soumettre à la faiblesse de mes raisonnements, et je pensais que, pour entreprendre de les examiner, et y réussir, il était besoin d’avoir quelque extraordinaire assistance du ciel, et d’être plus qu’homme. »7 Notons que ces lignes ne contredisent en rien les textes où le même Descartes traite de Dieu, des preuves de son existence, de sa nature, et ainsi de suite, par exemple dans les Méditations, puisqu’il ne s’agit pas alors de vérités révélées, mais bien de vérités rationnelles, donc accessibles au philosophe. Autrement dit, la religion et indirectement le passage ci-dessus traitent du “Dieu des religions”, alors que c’est du “Dieu des philosophes” que Descartes affirme certaines propriétés.
Prenant un exemple de vérité révélée, Spinoza va plus loin : « Quand certaines Églises ajoutent que Dieu a pris une forme humaine, j’ai expressément averti que je ne sais pas ce qu’elles veulent dire ; et même, à dire vrai, affirmer cela ne me paraît pas moins absurde que de dire que le cercle a pris la forme d’un carré. »8
D’une manière générale, nul ne saurait nier que, souvent, les “vérités révélées” déconcertent, pour ne pas dire plus, la raison. Cela ne signifie pas pour autant que, pour cette seule raison, le philosophe doive les rejeter inconditionnellement. Un tel rejet ne se justifie que pour un certain courant philosophique, à savoir le rationalisme9. Mais pour accepter positivement l’idée qu’une révélation, tout en étant manifestement irrationnelle, est source de vérité, il faudra franchir un pas qui, d’après nous, fait sortir de la philosophie. Le philosophe le plus “ouvert” aux religions ne peut donc qu’être réservé quant à l’idée même de révélation. Comment d’ailleurs choisirait-il entre les diverses religions ? Le philosophe ne peut, comme le font la quasi-totalité des croyants, adopter une religion uniquement en fonction de la société à laquelle il appartient par sa naissance et par son éducation10.
Concernant le contenu des dogmes eux-mêmes, le philosophe devra selon nous adopter la même prudence. On peut sans doute s’entendre pour considérer qu’en aucun cas le philosophe n’acceptera une “vérité” qui, sans être évidente en elle-même, ne s’accompagne d’aucune justification théorique. Or nous avons remarqué précédemment que le fondement d’une religion n’est précisément jamais justifié a priori ; quand il l’est a posteriori, ce ne peut donc être que par une personne qui l’a au préalable admis sans une telle justification. Comment le philosophe pourrait-il avaliser cette admission ? Comment pourrait-il ne pas dénoncer la justification a posteriori comme une imposture visant à légitimer philosophiquement une prise de position qui ne fut pas, au départ, philosophique ? Le fondement d’une philosophie ne saurait être lui-même extérieur à la philosophie. Or la religion, et elle s’en félicite, trouve son principe hors de l’humanité, donc hors de la philosophie. Nous reviendrons sur ce point dans la troisième partie de cette étude.
De même, le philosophe ne pourra pas ne pas trouver contraire à la philosophie le refus de remettre en cause ou même seulement de “discuter” de certains dogmes, et singulièrement l’affirmation de la sacralité. On objectera peut-être que les philosophes eux-mêmes considèrent parfois certaines de leurs “vérités” comme indiscutables, sans qu’on leur refuse pour cela le titre de philosophe. La différence, de taille, est que le philosophe produira toujours, même lorsqu’il prétend énoncer une vérité indiscutable, une justification théorique l’accompagnant – ne serait-ce que l’affirmation de son évidence rationnelle, qui ne saurait sérieusement valoir pour les vérités révélées. De plus, il ne refusera jamais de répondre à une éventuelle objection11, pour peu qu’elle soit philosophiquement intelligible, et ne menacera aucun contestataire des flammes de l’enfer.
On peut donc conclure que sans justification théorique, une proposition, quelle qu’elle soit, ne peut prétendre être philosophique. Autrement dit, le sens et la valeur de la philosophie ne résident pas moins dans l’argumentation des thèses que dans les thèses elles-mêmes, ce qui ne saurait raisonnablement se dire de quelque religion que ce soit.
Plus généralement, on pourrait dire que, si la religion est acceptée, elle rend la philosophie, pour une importante partie, inutile. En effet, certains dogmes religieux peuvent être considérés comme des réponses non philosophiques à des questions que se posent aussi les philosophes. Aussi le philosophe qui cherche à répondre, philosophiquement, à ces mêmes questions, entreprend-il une tâche ridicule du point de vue de la religion : sans pouvoir se targuer de la même “infaillibilité” que les religions, car la philosophie n’est qu’humaine – trop humaine ? –, il va chercher des réponses peu fiables – et, de fait, ses “collègues” philosophes ne se priveront pas de les critiquer – alors qu’il en existe déjà, et de beaucoup plus sûres, puisque d’essence bien souvent divine, et en tous cas non sujettes à la faillibilité humaine. Il ne restera donc au philosophe qu’à s’occuper de domaines que la religion a bien voulu négliger, car ne touchant manifestement pas, selon elle, au “salut” de l’homme : l’épistémologie ou l’esthétique par exemple. Mais pour les questions de métaphysique, d’éthique, d’anthropologie au sens large et parfois de politique, le débat doit être considéré, du point de vue religieux, comme clos. A l’opposé, on peut considérer que, du point de vue du philosophe, les questions philosophiques n’ont pour lui de raison d’être que s’il estime qu’elles n’ont pas encore reçu de réponse complète et définitive, émanant d’une religion quelconque, d’un autre philosophe ou de quelque autre source que ce soit. C’est seulement en acceptant cette “vacuité” que la philosophie a un sens.
Au fond, et on le verra mieux dans les deux cas précis étudiés ci-après, pour les philosophes religieux, la philosophie ne peut servir qu’à “redécouvrir” par la raison ce que la foi, par le biais de la révélation, a déjà enseigné. Cette conception de la philosophie comme « servante de la théologie », héritée du Moyen-Âge, ne peut pas disparaître si l’on admet, avant de philosopher, la vérité d’une religion. Et, même si l’on fait mine de se défendre d’adopter une telle conception, on voit mal comment il en serait autrement : « la vérité ne peut contredire la vérité », et si une vérité est admise au préalable – la vérité religieuse –, on sait déjà, avant même de commencer à philosopher, que la deuxième – la vérité philosophique – sera identique à la première ou au moins compatible avec elle ; il reste seulement à trouver des arguments philosophiques pour appuyer cette vérité unique, mais à deux visages. C’est par exemple la position de Jean-Paul II qui ouvre ainsi l’encyclique Fides et ratio : « La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l’esprit humain de s’élever vers la contemplation de la vérité »12. Mais si la métaphore est juste, les deux ailes doivent nécessairement voler de manière concordante. Le chemin et le but étant bien sûr déterminés, dès l’envol, par l’aile de la foi, l’aile de la raison n’a plus qu’à s’y plier…
On pourrait ici nous faire l’objection suivante : certes, si la religion est admise avant que la réflexion philosophique soit engagée, les jeux sont faits, et la philosophie n’en sera pas vraiment une, puisque sa fin, dans les deux sens du terme, est déjà connue, et surtout a été déterminée de l’extérieur de la philosophie. Mais qu’est-ce qui empêche un philosophe de découvrir au préalable, par la philosophie, des vérités dont il remarquera ensuite la conformité avec une religion donnée, adoptant ainsi cette dernière après, et non avant, la naissance de sa réflexion philosophique ? Nous ne pouvons ici qu’acquiescer sur le plan théorique. Si un tel itinéraire de pensée existait, c’est sans hésitation que nous lui accorderions le statut de philosophie. Deux remarques s’imposent toutefois :
– Premièrement, nous ne pouvons manquer de signaler l’extrême difficulté théorique d’un tel cheminement, ainsi que l’impossibilité pratique de vérifier l’ordre de ses étapes, telles qu’elles ont été décrites ci-dessus. Il est en effet indéniable que, dans la quasi-totalité des cas, la religion apparaît bien avant la philosophie dans l’existence d’un individu. Lorsque l’esprit de l’adolescent est suffisamment mûr pour philosopher, la religion y est souvent déjà présente depuis bien longtemps. Il est vrai que certains ont su se dégager de l’influence de l’éducation religieuse qu’ils ont reçue. Mais on voit bien que, sauf exception rarissime, c’est toujours la religion qui précède la philosophie dans l’histoire d’un homme. De qui peut-on donc affirmer qu’il a “redécouvert” dans la religion ce qu’il avait découvert dans la philosophie ?
– Deuxièmement, même si une philosophie parvenait à justifier philosophiquement tous les dogmes voire toutes les pratiques d’une religion donnée, cette philosophie n’aurait qu’une conformité extérieure et même fortuite avec cette religion, puisque la seule justification véritable d’une religion est la révélation et que celle-ci est, par définition, hors de portée de toute justification philosophique. Autrement dit, une telle philosophie ne serait pas vraiment religieuse.
Il faut à présent confronter les analyses générales qui précèdent à des cas concrets qui pourraient sembler les invalider. En premier lieu, pour “tester” notre thèse selon laquelle il ne peut exister de philosophie religieuse, nous étudierons les textes de deux philosophes en accord avec une certaine religion (en l’occurrence le Christianisme). En second lieu, pour vérifier qu’une religion philosophique est impossible, notre attention se portera sur religion particulière dont certains affirment le caractère philosophique.
Une remarque méthodologique s’impose ici. Des exemples, aussi nombreux soient-ils, ne constituent pas des preuves en eux-mêmes. Ils ne jouent ici qu’un rôle d’illustration, en vue de rendre concrète notre thèse.
2. Les philosophies de Leibniz et de Kant sont-elles des philosophies religieuses ?
Les “philosophies religieuses” que nous allons maintenant étudier sont celles de Leibniz et de Kant13. Nous ne prétendons pas ici livrer une analyse intégrale de la philosophie de la religion de ces auteurs, mais seulement indiquer le ou les moments où, selon nous, ils ont “glissé” de l’intérieur à l’extérieur de la philosophie pour tenter de justifier leur croyance religieuse. Un passage du début du Discours de métaphysique de Leibniz suffira à montrer ce que nous considérons comme une “sortie injustifiée” hors de la philosophie, injustifiée en ceci seulement qu’elle prétend prendre place dans une argumentation philosophique, tant dans le problème étudié que dans la méthode adoptée. Cela signifie que, en dehors de son activité philosophique, un philosophe peut fort bien écrire des textes exposant des vérités révélées – ou de la littérature, ou quoi que ce soit… –, à condition qu’il n’affirme ni ne sous-entende qu’il s’agit là de textes philosophiques ; or c’est précisément le cas de l’ouvrage évoqué ici, comme l’indique clairement son titre.
Après avoir défini Dieu comme étant « un être absolument parfait » et expliqué ce qu’on doit entendre par le concept de perfection, Leibniz conclut « que Dieu possédant la sagesse suprême et infinie agit de la manière la plus parfaite » et « que plus on sera éclairé et informé des ouvrages de Dieu, plus on sera disposé à les trouver excellents et entièrement satisfaisants à tout ce qu’on aurait pu souhaiter. » Bien qu’il y ait dans ces lignes matière à de nombreuses objections, nous sommes ici dans la philosophie, précisément parce que ces objections peuvent être elles-mêmes de nature philosophique. Il nous semble en revanche que Leibniz sort de la philosophie lorsqu’il écrit :
« Ainsi, je suis fort éloigné du sentiment de ceux qui soutiennent qu’il n’y a point de règle de bonté et de perfection dans la nature des choses, ou dans les idées que Dieu en a et que les ouvrages de Dieu ne sont bons que pour cette raison formelle que Dieu les a faits. Car si cela était, Dieu sachant qu’il en est l’auteur n’avait que faire de les regarder par après et de les trouver bons, comme le témoigne la sainte écriture. »14
L’importance de l’argument de l’autorité biblique est ici prépondérante : Dieu a regardé ses ouvrages et les a trouvés bons, car c’est ce qu’affirment l’écriture, qualifiée de “sainte” sans justification. Or il nous semble que le philosophe n’est pas tenu de croire a priori en la divinité de l’origine des Écritures. Mais, une fois admise l’autorité de la Bible, le passage ci-dessus ne se prête à aucune objection philosophique : dès lors, il est en quelque sorte “infalsifiable” au sens que Popper donne à ce terme. Aucun débat philosophique n’est plus possible. Le raisonnement de Leibniz, entièrement explicité, est en effet le suivant :
1. La Bible a été inspirée par Dieu.
2. Or Dieu possède toutes les perfections morales, dont celle d’être vérace.
3. Donc la Bible dit la vérité.
4. Or la Bible dit que Dieu, après avoir créé certaines de ses œuvres, vit qu’elles étaient bonnes (par exemple : « Dieu dit : “Que les eaux qui sont sous le ciel s’amassent en une seule masse et qu’apparaisse le continent” et il en fut ainsi. Dieu appela le continent “Terre” et la masse des eaux “mers”, et Dieu vit que cela était bon. »15)
5. Donc Dieu a pu constater, ou plus précisément “vérifier”, la bonté de ses œuvres en les regardant.
6. Donc les choses sont bonnes intrinsèquement, c’est-à-dire que la bonté est en elles-mêmes, et non pas extrinsèquement, c’est-à-dire seulement parce que Dieu en est l’auteur ou la cause.
On peut indifféremment inverser l’ordre des propositions 1. et 2. Il reste que la divinité des Écritures est un pilier de cette démonstration, et donc que sa remise en cause implique celle de tout le raisonnement. Or il semble clair que l’affirmation « La Bible a été inspirée par Dieu » n’est pas et ne peut pas être une thèse philosophique16, c’est-à-dire une affirmation susceptible d’être fondée et contredite par des arguments philosophiques – si du moins on se réfère au sens que Leibniz donne ici au mot “Dieu”, c’est-à-dire au sens religieux.
Nous affirmons donc que le raisonnement de Leibniz extrait du Discours de métaphysique n’est pas, par son fondement, philosophique, et plus généralement que tout système de pensée fondé sur une quelconque révélation, sans que la raison vienne justifier ce fondement17, ne saurait être qualifié de philosophie.
Pour Spinoza en revanche, la question de la divinité des Écritures peut se poser en termes philosophiques, mais en donnant au concept de Dieu un sens qui n’est assurément pas le sens religieux. Lorsqu’il écrit en effet : « (…) la plupart, en vue de comprendre l’Écriture et d’en dégager le vrai sens, posent pour commencer la divine vérité de son texte intégral. (Alors que cette conclusion devrait découler d’un examen sévère de son contenu.) »18, il est clair que l’expression « divine vérité » est quasiment, sous sa plume, un pléonasme, et donc que c’est en examinant le texte biblique lui-même que l’on pourra conclure qu’il dit la vérité – ou non –, et donc qu’il exprime la “divine vérité”. Pour Leibniz, la Bible dit vrai parce que Dieu en est l’auteur19 ; c’est du moins ce qu’on peut supposer en l’absence de toute autre justification.
Dans La religion dans les limites de la simple raison, Kant va tenter de montrer que le Christianisme n’est pas seulement un « religion révélée », étant apparue à une époque et un endroit précis, mais également une « religion naturelle », c’est-à-dire, en droit, universelle et mondiale : chaque homme, quelles que soient son époque et sa société, et pour autant qu’il soit doué de raison, peut reconnaître que les principes moraux enseignés par le Christianisme sont identiques à ceux que sa raison pratique lui dicte. Pour démontrer cette identité, Kant va se livrer à une exégèse détaillée du Sermon sur la montagne20, texte qui contient d’après lui l’essentiel des préceptes moraux du Christianisme. Ce que Kant relève notamment dans le Sermon, c’est qu’il enjoint de suivre l’esprit de la loi plutôt que la lettre. On retrouve ici la distinction faite par Kant dans les Fondements de la métaphysique des mœurs entre “agir par devoir” et “agir conformément au devoir”. Ainsi du fameux passage :
« Vous avez entendu qu’il a été dit : “Tu ne commettras pas l’adultère”. Eh bien ! Moi je vous dis : quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis, dans son cœur, l’adultère avec elle. »21
Kant comprend ces versets comme dénonçant l’hypocrisie d’une conduite extérieure ou plus précisément physique, seulement conforme extérieurement à l’interdiction de l’adultère22 – consistant à ne pas commettre l’acte de l’adultère –, et qui l’enfreint néanmoins si le désir est bien réel. Plus généralement, Kant rappelle que l’enseignement du Christ n’est pas supposé être différent de la loi hébraïque23, mais qu’il a interprété la Loi pour montrer sa conformité à la raison pratique : « Car au pied de la lettre, la loi autorisait exactement le contraire »24 de ce qu’autorise l’interprétation du Christ, dit Kant.
Remarquons que pour parvenir à la conviction que la Bible est en conformité avec la raison pratique, il a fallu tout d’abord que le Christ interprète la loi hébraïque, c’est-à-dire qu’il en révèle l’esprit en la débarrassant d’une lecture « au pied de la lettre », puis que Kant lui-même interprète les paroles du Christ pour montrer qu’elles ne sont qu’une autre formulation, sans doute plus accessible au plus grand nombre, de la loi morale prise en elle-même, énoncée en termes philosophiques.
C’est donc au prix de deux interprétations successives – celle de la loi hébraïque par le Christ puis celle des paroles du Christ par Kant – que l’on parvient à montrer la conformité de l’enseignement biblique avec la raison pratique. Et c’est bien là la première objection que l’on peut faire à Kant : une religion naturelle étant universelle, tout homme doit pouvoir accéder aux vérités qu’elle enseigne. S’il est déjà déconcertant que Dieu transmette aux hommes un texte énonçant une loi morale qu’il a, de toute façon, “inscrite” en tout homme possédant la raison pratique, il est encore plus étonnant que ce texte doive dans certains cas – l’Ancien Testament – “subir” tour à tour deux interprétations, dont le moins que l’on puisse dire est qu’elles ne vont pas de soi25, pour au bout du compte énoncer ce que tous savaient déjà avant ! Si l’on ajoute que le texte d’origine, supposé être inspiré par Dieu, enseigne selon Kant lui-même des choses opposées selon qu’on le prend à la lettre ou qu’on en dégage l’esprit, on comprend difficilement la valeur et la légitimité d’un tel texte. Kant ne cherche-t-il pas plutôt à “asseoir” la légitimité de sa philosophie morale sur l’autorité du Christianisme ? Sur le plan philosophique, qu’importe après tout que la “vraie” morale, que Kant prétend enseigner, soit ou non celle d’une religion institutionnelle, fût-ce la religion dominante ?
On peut également contester la prééminence et même l’exclusivité que Kant accorde au Christianisme en matière de morale : « Mais, suivant la religion morale (et parmi toutes les religions publiques qu’il y eut jamais, seule la religion chrétienne a ce caractère) … »26 Cette affirmation, écrite entre parenthèses, comme semblant si peu contestable qu’elle se passe de justification, a évidemment de quoi choquer par son intolérance. Mais elle déconcerte également celui qui a pris note du fait que le Christianisme n’enseigne en fin de compte rien de plus que le Judaïsme. Si le Christ, selon ses propres paroles, vient pour accomplir la Loi et les Prophètes27, c’est bien qu’il n’y a aucune différence de fond entre le Judaïsme et le Christianisme28. Si différence il y a, ce ne peut pas être une différence telle que le second serait une, ou plutôt “la” religion morale, ce que ne serait pas le premier ! Plus précisément, pour Kant, si le Judaïsme n’est pas une religion morale, c’est parce que, comme toutes les religions sauf le Christianisme, il comporte en lui la recherche des faveurs divines.
Cette délicate question tourne plus ou moins directement autour de ce qu’on appelle la morale de la rétribution, c’est-à-dire une morale qui affirme que les pieux et les justes sont récompensés et que les impies et les méchants sont punis. S’il est incontestable que la Bible hébraïque enseigne parfois une telle morale29, des livres comme ceux de Job30 et de l’Ecclésiaste la condamnent catégoriquement31 – ce dont Kant ne tient pas compte – en remarquant que le juste subit parfois des maux “naturels”, donc d’origine divine, et que la fortune sourit parfois au méchant. Chacun est alors invité à s’en remettre à la sagesse divine sans chercher à en percer les desseins.
Supposons toutefois que cette immoralité du Judaïsme soit fondée ce qui, on le voit, ne va pas de soi. Le plus paradoxal est encore que Kant, en critiquant indirectement la morale juive, condamne nécessairement la Bible hébraïque, où la morale de la rétribution apparaît effectivement. Or cette Bible hébraïque est, quelques différences infimes mises à part, reprise par le Christianisme à son propre compte sous le nom d’Ancien Testament. La recherche des faveurs est-elle présente ou absente des mêmes textes, selon qu’ils sont lus par les Juifs ou par les Chrétiens ? Il y a là encore, semble-t-il, une très forte partialité de Kant en faveur du Christianisme, partialité qu’une véritable neutralité philosophique a priori aurait rendue, selon nous, impossible. Nous affirmons bien que cette neutralité devrait exister a priori, sans qu’elle doive nécessairement se prolonger a posteriori. Mais Kant ne justifie par aucun argument philosophique la suprématie du Christianisme dans le domaine morale. On pourrait d’ailleurs remarquer que le Nouveau Testament n’est pas non plus exempt de passages exprimant une morale de la rétribution32, ce que Kant, là encore, passe sous silence.
Dans la même logique, il écrit : « Il n’existe qu’une religion (vraie) »33. Mais comment le Christianisme pourrait-il être la vraie religion s’il est, selon les paroles de Jésus lui-même, l’accomplissement d’une fausse religion, en l’occurrence le Judaïsme ?
Enfin34, Kant nous semble également faire preuve d’une précipitation suspecte et fort peu philosophique lorsqu’il écrit : « J’admets premièrement la proposition suivante, comme principe n’ayant pas besoin de preuve : Tout ce que l’homme pense pouvoir faire, hormis la bonne conduite, pour se rendre agréable à Dieu est simplement illusion religieuse et faux culte de Dieu »35. Non pas que nous pensions, le lecteur l’aura compris, que bien d’autres comportements sont susceptibles de plaire à Dieu ; mais ce qui est ici affirmé presque explicitement, c’est que la bonne conduite d’un homme le rend agréable à Dieu. Voilà certes une proposition qui aurait selon nous besoin de preuve, si cela était possible. A vrai dire, il peut sembler au contraire que l’idée d’un Dieu sensible aux comportements humains a quelque chose d’irrespectueux, pour ne pas dire d’hérétique, à moins d’affirmer que Kant utilise un langage anthropomorphique, ce que rien ne laisse supposer.
Bien d’autres remarques seraient possibles pour confirmer, avec celles qui précèdent, que Kant fait reposer sa philosophie morale sur un fondement non philosophique, mais bel et bien religieux a priori, donc non argumenté rationnellement.
3. Le Catholicisme est-il une religion philosophique ?
Nous allons à présent examiner un cas de religion prétendant ou pouvant prétendre être philosophique. Si nous choisissons le Catholicisme, ce n’est pas essentiellement parce qu’il est la religion plus répandue dans nos sociétés dites latines, mais surtout parce qu’il s’est doté d’une théologie plus “systématique” que d’autres religions, à la fois par sa “fréquentation” de la philosophie occidentale et par sa structure très hiérarchisée, qui ont permis l’établissement d’une doctrine unifiée et officielle, à l’abri, normalement, de toute contestation interne, ce qui facilite d’ailleurs grandement la recherche des références.
Quelques remarques préalables s’imposent toutefois. Nous avons déjà évoqué l’idée selon laquelle le fondement d’une philosophie ne saurait être “extra-philosophique”. C’est pourquoi la manière dont débute une philosophie est capitale. Notons que ce “début” n’est pas forcément – et, dans les faits, n’est que rarement – premier chronologiquement dans l’œuvre d’un philosophe. Ainsi le doute radical de Descartes est bien le début “logique” de sa philosophie sans apparaître dans ses premières œuvres. Si certains philosophes semblent ne pas s’être particulièrement souciés de ce “début philosophique”, ce ne peut être que parce qu’ils considèrent qu’il n’y a pas à proprement parler à fonder la philosophie, ou encore parce que toute réflexion philosophique peut servir de fondement à la philosophie.
Il ne saurait en aller de même dans une religion, dont le point de départ, à savoir la révélation, est toujours extérieur à la raison et même, plus largement, à l’homme. En fait, nous avons déjà rencontré ce cas de figure dans les textes de Leibniz et de Kant étudiés plus haut, dont nous avons montré qu’ils s’appuyaient sur des données spécifiquement religieuses, donc impossibles à argumenter philosophiquement.
Nous allons retrouver cette extériorité dans le fondement du Catholicisme : « Au point de départ de toute réflexion que l’Église entreprend, il y a la conscience d’être dépositaire d’un message qui a son origine en Dieu même (…). La connaissance qu’elle propose à l’homme ne vient pas de sa propre spéculation, fût-ce la plus élevée, mais du fait d’avoir accueilli la parole de Dieu dans la foi »36. Les choses sont donc claires : les vérités religieuses, auxquelles les hommes peuvent accéder par la révélation, préexistent à toute réflexion humaine. En raison de leur origine divine, elles sont infaillibles. Avant même d’inaugurer la moindre réflexion, le philosophe catholique sait donc vers quoi doit tendre sa philosophie. Celle-ci n’a par conséquent qu’un rôle secondaire de confirmation a posteriori de “vérités” admises comme vraies avant toute intervention de la raison philosophique. C’est donc en toute logique que Jean-Paul II écrit : « L’Église, pour sa part, ne peut qu’apprécier les efforts de la raison pour atteindre des objectifs qui rendent l’existence personnelle toujours plus digne. Elle voit en effet dans la philosophie le moyen de connaître des vérités fondamentales concernant l’existence de l’homme. En même temps, elle considère la philosophie comme une aide indispensable pour approfondir l’intelligence de la foi et pour communiquer la vérité de l’Évangile à ceux qui ne la connaissent pas encore »37. Ce que nous considérons comme contraire à la philosophie dans ces lignes, ce n’est pas, encore une fois, la position elle-même, c’est-à-dire la fonction “évangélisatrice” assignée à la philosophie, mais le fait que cette position soit assignée de l’extérieur de la philosophie, c’est-à-dire sans argumentation rationnelle. Dans la même logique, le pape condamne au terme de son encyclique un certain nombre de courants de pensée : l’éclectisme, l’historicisme, le scientisme, le pragmatisme et le nihilisme38. Ces doctrines sont considérées à la fois comme des « erreurs » et des « dangers ». C’est dire qu’il aurait mieux valu qu’elles ne soient jamais formulées. On ne peut là encore que refuser de qualifier de philosophie une pensée qui se voudrait sans “adversaire”, même intellectuel ; nous estimons en effet que l’esprit critique et l’ouverture à la contestation doivent être des soucis constants du philosophe, conscient qu’il est, et ne peut qu’être, de ne pouvoir se prévaloir d’aucune infaillibilité. Autrement dit, le philosophe a philosophiquement intérêt à être contesté, afin de tester la validité de sa pensée. Au contraire, une doctrine d’origine “surhumaine” ne peut avoir, envers une contestation humaine, qu’une attitude de commisération, d’indifférence, de mépris ou de violence, mais pas véritablement, on ne le voit que trop, d’écoute véritable.
On peut donc admettre que les “vérités religieuses” précèdent toute réflexion philosophique. Mais, objectera-t-on peut-être, la foi dans ces vérités religieuses ne peut-elle pas, quant à elle, être justifiée philosophiquement… ? Pas davantage, comme le reconnaît, là encore, le dogme catholique : « Le motif de croire n’est pas que les vérités révélées apparaissent comme vraies et intelligibles à la lumière de notre raison naturelle »39. Toutefois, pour que la foi soit conforme à la raison, Dieu a mis en œuvre des « preuves extérieures de sa Révélation » : « les miracles du Christ et des saints40, les prophéties, la propagation et la sainteté de l’Église, sa fécondité et sa stabilité ». La raison du philosophe trouvera-t-elle dans cette liste des preuves ou des « signes certains » de la révélation chrétienne ? Accordons au moins que cela n’est pas évident…
Conclusion
L’examen des “philosophies religieuses” de Leibniz et Kant a montré diverses “failles”, non pas en tant qu’erreurs à l’intérieur de leur philosophie, mais précisément en tant que manquements à l’exigence philosophique d’une argumentation rationnelle et donc de refus d’un quelconque argument d’autorité, fût-ce l’autorité de la Bible.
Nous pouvons donc conclure qu’une “philosophie religieuse” est soit extérieure à la religion, si la philosophie “précède” la religion41, soit extérieure à la philosophie si, comme nous croyons l’avoir montré pour les deux cas étudiés, la religion “précède” la philosophie. Cela ne signifie bien entendu pas que le philosophe soit par définition irréligieux. Dans la mesure où il est homme “avant” d’être philosophe, il pourra, comme Leibniz, Kant et beaucoup d’autres, croire en Dieu et même appartenir à une religion précise. Mais il devra renoncer à légitimer sa foi, ses croyances et ses pratiques par des arguments philosophiques, et donc renoncer à intégrer sa religion dans sa philosophie. Il pourra seulement – et même en tant que croyant, il devra probablement – expliquer pourquoi sa philosophie doit forcément laisser une place, hors d’elle (au-dessus, dira-t-il sûrement), à la religion. Il pourra par exemple, à la manière d’un Pascal, essayer de montrer que la raison et donc la philosophie peuvent reconnaître elles-mêmes leurs propres limites : « La dernière démarche de la raison est de reconnaître qu’il y a une infinité de choses qui la surpassent ; elle n’est que faible, si elle ne va jusqu’à connaître cela. »42
Le philosophe peut donc être religieux, mais il ne peut pas l’être en tant que philosophe. La philosophie peut indiscutablement aller jusqu’au déisme ou au théisme, mais le pas qui mène du théisme à une religion révélée est précisément le pas qui fait sortir de la philosophie.
L’hypothèse d’une religion philosophique, du fait du nécessaire fondement non humain de toute religion, est elle aussi, dès le départ, à exclure.
Quant à l’athéisme, il n’est jamais que le refus d’une certaine conception de Dieu ou des dieux. On peut le voir par exemple avec Spinoza qui, tout en démontrant l’existence de Dieu43, peut bien être considéré comme “athée”, au sens où il refuse l’existence d’un Dieu anthropomorphe44. On le voit encore avec Marcel Conche, qui s’attaque précisément à l’idée d’un Dieu à la fois moralement bon et tout-puissant : « Il est indubitable (…) que le supplice des enfants a été, et devait ne pas être, et que Dieu pouvait faire qu’il ne soit pas. Comme Dieu ne s’est pas manifesté dans des circonstances où, moralement, il l’aurait dû, s’il existait, il serait coupable. La notion d’un Dieu coupable et méchant apparaissant contradictoire, il faut conclure que Dieu n’est pas. »45 Nous n’affirmons certes pas que cette argumentation, non plus que les démonstrations de l’existence de Dieu de Spinoza, sont à l’abri de toute contestation, y compris philosophique. Mais nous avons bien là des exemples de raisonnement parfaitement intelligible, que même le plus fervent des croyants peut suivre, pour peu qu’il soit doué de raison. L’athéisme peut donc être philosophique ou, ce qui revient au même, une philosophie peut être athée.
On se méprendrait en voyant dans cette étude une attaque contre les religions en général. Nous avons même indiqué à plusieurs reprises que l’attitude des religieux est très souvent en parfaite cohérence avec leurs convictions. Nous avons uniquement cherché à montrer en quoi religion et philosophie, sans forcément se combattre mutuellement, ne peuvent pas s’unir sans une dangereuse “confusion des genres”. Pour les deux partis, une telle union ne serait donc pas pour le meilleur mais seulement pour le pire…
Marc Anglaret
(écrire à cet auteur)
Commentaire
1 Nous considérerons ici les religions dans leur approximative unité, et plus précisément dans leur rapport à la philosophie.
2 Ces deux questions reviennent, au bout du compte, au même, mais au bout du compte seulement.
3 Nous reviendrons, avec l’examen de la position kantienne, sur la distinction entre religion naturelle et religion révélée.
4 Nous précisons bien qu’il ne s’agit pas là de donner une définition, avec tout ce que cette opération implique, de la religion, mais bien de la distinguer de la philosophie.
5 La question n’est pas ici celle de l’intolérance des religions, fort diverses sur ce point comme sur d’autres, mais celle du statut de l’affirmation de la sacralité au sein même d’une religion. Nous soutenons ici que cette affirmation se présente toujours comme indubitable, au point que toute éventuelle critique à ce sujet doit être considérée comme “déplacée”, dans le meilleur des cas…
6 Nous distinguons ici le fondement d’une religion, c’est-à-dire la ou les croyances, toujours liées au sacré selon nous, sur lesquelles s’appuient les autres croyances, de son principe, qui n’est pas une croyance mais l’origine de sa révélation : par exemple Dieu dans les religions monothéistes.
7 Discours de la méthode, première partie. NRF Gallimard, « La Pléiade », p.130. C’est nous qui soulignons.
8 Lettre LXXIII à Oldenburg (1675). NRF Gallimard, « La Pléiade », p.1283. Ce célèbre passage devrait suffire à éviter toute “récupération” du spinozisme par le Christianisme – ce qui, dans les faits, n’est pas le cas.
9 On objectera que certains philosophes habituellement qualifiés de rationalistes – par exemple Leibniz – admettent les vérités révélées de certaines religions, notamment le Christianisme. Nous étudierons précisément plus loin le cas de Leibniz, en montrant pourquoi il ne peut pas, selon nous, être pleinement considéré comme rationaliste.
10 Il n’a toutefois échappé à personne que, par une étrange coïncidence, les philosophes croyants adoptent dans la quasi-totalité des cas la religion de leur éducation, familiale notamment, et ce pas seulement dans le cas du Christianisme, comme le montrent les cas d’Averroès et de Maïmonide par exemple. Nous ne connaissons pas de contre-exemple sur ce point (Schopenhauer ne peut pas, par exemple, être sérieusement qualifié de “philosophe bouddhiste”, bien qu’il se soit lui-même reconnu dans certaines thèses du Bouddhisme).
11 Nous pensons par exemple aux Objections faites aux Méditations de Descartes, ou à la correspondance de nombre de philosophes.
12 Jean-Paul II, Fides et ratio (la foi et la raison), I, prologue ; lettre encyclique du 14 septembre 1998. Supplément au quotidien « La Croix » du 16 octobre 1998, p.3
13 D’autres philosophies pourraient bien sûr avoir leur place ici, par exemple celle de Hegel. C’est pour ne pas rendre cette étude trop volumineuse que nous avons choisi ces deux exemples, à la fois pour leur relative simplicité et leur représentativité. Par ailleurs, il est certain que l’examen de “philosophies religieuses” non chrétiennes manque à cette étude. Notre quasi-ignorance en la matière est la raison de cette absence.
14 Discours de métaphysique, 1, II. Éditions Vrin, p.26. C’est nous qui soulignons.
15 Genèse, 1, 9 –10. C’est nous qui soulignons.
16 A fortiori ne peut-elle pas être la thèse d’un philosophe rationaliste, qualificatif que l’on attribue souvent à Leibniz.
17 Et pour cause : nous croyons avoir montré plus haut qu’une telle justification est impossible ; au moins devrait-elle être tentée par Leibniz s’il entend se placer dans une perspective philosophique.
18 Spinoza, Traité des autorités théologique et politique, préface. NRF Gallimard, « La Pléiade », p.612
19 Selon Spinoza, au contraire, on pourrait dire que Dieu est l’auteur de la Bible seulement si elle dit vrai (ce qui reste donc à démontrer rationnellement), mais en donnant au mot “Dieu” un sens qui exclut toute révélation : toute la première partie de l’Éthique, intitulée “de Dieu”, est exempte de la moindre allusion biblique ou théologique.
20 Évangile selon Matthieu, chapitres 5 à 7.
21 Évangile selon Matthieu, 5, 27 – 28.
22 Interdiction formulée dans le septième des dix commandements (Exode, 20, 14).
23 Évangile selon Matthieu, 5, 17 : « N’allez pas croire que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. »
24 La religion dans les limites de la simple raison, IV, 1, 1. Éditions Vrin, p.179
25 Puisque dans les deux cas, de nombreux siècles se sont écoulés entre le texte et son interprétation : de la rédaction du Décalogue dans l’Exode à l’interprétation qu’en fait Jésus dans les Évangiles d’une part, de la rédaction des Évangiles à l’interprétation qu’en fait Kant d’autre part.
26 La religion dans les limites de la simple raison, op. cit., I, Remarque générale. p.92. C’est nous qui soulignons.
27 Cf. note 23.
28 … ou plus exactement entre le Judaïsme et l’enseignement de Jésus, car rien dans les paroles de ce dernier n’indique clairement qu’il voulait fonder une nouvelle religion, mais plutôt, comme on l’a dit (note 23), qu’il était venu pour « accomplir » le Judaïsme.
29 Par exemple : « Si le juste ici-bas reçoit son salaire, combien plus le méchant et le pécheur » (Proverbes, 11, 31 ; le terme « salaire » est ici sans ambiguïté). Bien d’autres versets, dans ce livre ou dans d’autres, sont tout aussi explicites.
30 Dans le livre de Job, Yahvé, par l’intermédiaire de Satan, “éprouve” la foi de Job, homme riche et pieux, en détruisant ses biens, en faisant tuer ses serviteurs et ses enfants, puis en le frappant de maladie. Job, conformément aux prédictions de Satan et contre celles de Yahvé, reproche à ce dernier son injustice. La “leçon” du livre, donnée par Yahvé lui-même, est que nul ne doit se permettre de juger son Dieu, et ce même s’il lui semble injuste. Cela dit, Job recouvre à la fin du récit tout ce qu’il a perdu : la morale de la rétribution est confirmée, bien que le propos “officiel” du livre la condamne.
31 Les théologiens appellent cela une « évolution » de la doctrine biblique, terme certes moins brutale que celui de « contradiction »…
32 Par exemple : « C’est qu’en effet le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de son Père, et alors, il rendra à chacun selon sa conduite » (Évangile selon Matthieu, 16, 27).
33 La religion dans les limites de la simple raison, op. cit., III, 1, 5. p.137
34 Il n’y a bien entendu nulle prétention à l’exhaustivité dans ces quelques remarques.
35 La religion dans les limites de la simple raison, op. cit., IV, 2, 2. p.188
36 Jean-Paul II, Fides et ratio, I, 7 ; op. cit., p.5
37 Ibid., I, 5 ; p.4. C’est nous qui soulignons.
38 Ibid., VII, 86 - 90 ; pp.31 - 32.
39 Catéchisme de l’Église Catholique, première partie, chapitre troisième, article I, 3, §156. Mame / Plon, p.44
40 Mais que faire alors de ce verset : « « Il surgira, en effet, des faux Christ et des faux prophètes, qui produiront de grands signes et des prodiges, au point d’abuser, s’il était possible, même les élus. » (Évangile selon Matthieu, 24, 24).
41 On peut ici se reporter aux deux remarques précédant l’analyse de la “philosophie religieuse” de Leibniz, en haut de la page 4.
42 Pascal, Pensées, fragment 267 de l’établissement de Brunschvicg (188 de Lafuma). Garnier-Flammarion, p.266. Concernant les Pensées en général, il est bien malaisé de dire s’il s’agit bien là d’un ouvrage philosophique au sens où nous l’avons expliqué plus haut. En fait, certains fragments le sont sans aucun doute, comme celui du pari (Brunschvicg : 233 ; Lafuma : 418). D’autres ne le sont manifestement pas, comme ceux sur les « preuves de Jésus-Christ » (Brunschvicg : 737 et suivants), qui ne s’adressent pas à la raison, mais bien à la foi éventuelle du lecteur.
43 Éthique, I, proposition 11. NRF Gallimard, « La Pléiade », pp.317 – 319.
44 Appendice de la première partie de l’Éthique et Traité des autorités théologique et politique, surtout les chapitres I à XII.
45 Marcel Conche, Orientation philosophique. I. “La souffrance des enfants comme mal absolu”. P.U.F. p.57
 Re: Religion et Philosophie
Re: Religion et Philosophie
Lutte entre la religion et la philosophie au temps de Socrate
L’histoire de la Grèce est double : elle montre des faits qui excitent notre curiosité ou nous aident à former notre expérience politique, et des idées qui inspirent encore nos poètes, nos philosophes et nos artistes. C’est par les idées que les sociétés se transforment et que la civilisation se développe. La véritable histoire est donc celle de la pensée humaine ; or, vers la fin du Ve siècle avant notre ère, beaucoup de pensées fermentaient dans Athènes, et un grand homme y commençait une révolution morale qui allait donner une vigoureuse secousse à l’esprit grec ; il faut aller à lui.
Par la guerre du Péloponèse, Athènes avait perdu son empire, et bien autre chose ; ses anciennes mœurs et ses vieilles croyances étaient ébranlées. Maîtres d’une moitié du monde hellénique, les Athéniens avaient vu affluer dans leur cité les hommes et les richesses ; l’industrie, le commerce avaient pris un immense essor, et, au milieu de ce mouvement général, l’esprit n’avait pu rester le prisonnier de l’ancienne orthodoxie religieuse. Des horizons nouveaux s’étaient ouverts devant l’imagination du penseur, comme des mers nouvelles devant le navire du marchand. Eschyle, Sophocle, Hérodote, Thucydide, Aristophane, avaient rencontré, dans les voies où ils s’étaient élancés, les plus belles conceptions du génie ; Phidias avait vu Jupiter ; Anaxagore avait presque trouvé Dieu. Ainsi, le vieil Homère et tous les poètes qui l’avaient précédé ou qu’il inspira avaient paru, après que la race grecque se fut, comme une alluvion féconde, répandue sur les côtes de l’Asie et mêlée, par le commerce et par les armes, au monde oriental.
Le sentiment religieux s’était épuré, au moins pour quelques-uns. La conception de la divinité était plus élevée, et la grande question de l’autre vie, tout en restant fort obscure, tendait vers une solution moins grossière que celle qui en avait été donnée par Homère et Hésiode. La récompense des bons (grec) se rapprochait de celle qui leur est aujourd’hui promise. « Les âmes des hommes pieux, disent Épicharme, Pindare et Eschyle, habitent au ciel et célèbrent par des hymnes la grande divinité. » L’âme des bienheureux (grec), placée au milieu des astres, participait à la béatitude divine, et jouissait de la vue perpétuelle de la lumière pure, comme celle des élus de Dante.
Mais au-dessous des nobles préoccupations de ces grands esprits, que d’agitations stériles ! Combien qui, ne pouvant créer, détruisaient ; qui niaient le passé sans rien affirmer pour l’avenir ; qui tournaient en dérision les lois, les mœurs, les croyances du vieux temps, sans rien mettre à leur place. Les dévots entendaient avec effroi des hommes se rire de tout ce qui faisait encore leur vie morale et religieuse, douter de leurs dieux, parodier les mystères. Beaucoup même, voyant que les prières, les sacrifices n’avaient point sauvé Athènes des plus affreuses calamités, en vinrent à penser que les croyances transmises par les aïeux pourraient bien n’être que des mensonges ; déjà on volait les dieux, non pas l’argent déposé dans leurs sanctuaires, comme les Phocidiens le prendront à Delphes, mais, ce qui était un double sacrilège, les ornemens d’or qui recouvraient leurs statues
[ltr][1][/ltr]
. L’hellénisme était arrivé à ce carrefour ténébreux où les religions aboutissent, lorsque le doute commence à s’attacher à elles, et où la foule s’attarde, parce que, si la croyance ne conduit plus la vie, elle commande encore aux habitudes. De la partent des routes dans lesquelles s’engagent les esprits élevés et résolus qui laissent derrière eux le passé mourir lentement et cherchent à aller au-devant de l’avenir qui s’approche.
Longtemps épars à la circonférence du monde grec, en Asie, dans la Thrace et la Sicile, les philosophes étaient tous accourus au centre, ioniens, éléates, pythagoriciens, atomistes. Depuis le siècle de Périclès, Athènes était leur champ clos : c’est là qu’avait lieu la mêlée des systèmes ; là que commençait la révolution qui fit entrer le paganisme dans la période de décadence pour le peuple, de transformation morale pour les hommes supérieurs. L’ancienne religion voyait l’esprit se retirer d’elle par deux voies. Les mystères, surtout ceux d’Éleusis, avaient peu à peu dégagé, réuni et développé les élémens spiritualistes que les vieux cultes renfermaient, et, sans briser le polythéisme, tendaient à faire prévaloir l’idée d’un dieu unique. Plus hardis, plus libres, les philosophes remontaient par la raison seule à la cause première. Mais en agitant, pour l’éternel honneur de l’intelligence humaine, les grands problèmes que la religion populaire prétendait avoir résolus, ces hommes faisaient naturellement contre celle-ci acte d’insubordination et de révolte. Ils la réduisaient à n’être qu’une forme vide, un linceul de mort qui enveloppait l’état, et que, par prudence seule, par respect forcé pour les faiblesses populaires, ils se gardaient de déchirer.
Le panthéisme des Ioniens permettait bien encore à Thalès de dire : « Le monde est plein de dieux, » mais Hippocrate subordonnait leur action à des lois constantes et aux conditions de la matière. « Il n’existe pas, disait-il, de maladies divines ; toutes ont des causes naturelles. » C’était briser l’arc d’Apollon et ses flèches, qui portaient la peste et la mort dans les cités. Anaxagore, tout en proclamant une cause unique, dont Platon fera le (grec) et saint Paul le Verbum Dei, supprimait les auxiliaires que la foi lui avait donnés. Il osait enseigner que les aérolithes venaient du ciel, — ce que les popolani de Naples ne croient pas encore, — et en donnant aux pierres météoriques cette origine, il était aux astres leur divinité : Mars, Vénus, Hélios n’étaient plus que des masses rocheuses incandescentes. Lorsqu’il disait : « Rien ne naît ; rien ne meurt ; il n’y a partout que composition et décomposition ; chaque chose retourne d’où elle est venue, et le fond de la nature ne change pas, » il ruinait le surnaturel et, avec lui, la religion qui vit de merveilles. Xénophane, plus explicite, avait rejeté toute la théologie vulgaire et reproché aux poètes d’avoir divinisé les forces nuisibles ou favorables qui agissent sur l’homme ; Hésiode, même Homère, n’avaient pu trouver grâce devant lui ; il leur reprochait d’avoir dégradé l’idée de la divinité, en prêtant à leurs dieux des actions et des sentimens indignes de l’Être absolu. Toutefois, Xénophane n’était point parvenu à concilier, tout en les distinguant, Dieu et le monde, la cause et l’effet. Pour sortir de ce mélange indécis de théisme et de panthéisme, son disciple, le redoutable Parménide, comme Platon l’appelle, ne trouva d’autre moyen que de nier le monde. Il le déclara une apparence vaine, et nos sens qui nous le montrent des instrumens d’erreurs. Démocrite, au contraire, réduisait le problème de l’univers à une question de mécanique ; il n’existe, selon lui, d’autre substance que celle des corps, d’autre force motrice que la pesanteur, et il se riait de ceux qui des phénomènes de la nature avaient fait des dieux. Un de ses disciples, Diagoras de Mélos, niait résolument leur existence. Pour se moquer des douze travaux d’Hercule, il jetait au feu une statue en bois du fils de Jupiter et lui demandait d’accomplir un treizième exploit en triomphant de ce nouvel ennemi. A Samothrace, les prêtres lui montraient, en preuve de la puissance de leurs dieux, les offrandes des navigateurs échappés au naufrage. « Mais combien en auriez-vous, leur dit-il, si tous ceux qui ont péri vous en avaient envoyé ? »
Tandis que les philosophes minaient la religion nationale par la raison, les poètes comiques la tuaient par le ridicule, et leur influence s’étendait rapidement chez un peuple où tout le monde lisait, même en voyage. Quel devait être l’effet produit sur la foule réunie au théâtre, quand, à Athènes, on jouait le Plutus, les Oiseaux et les Grenouilles d’Aristophane, qui traitent les dieux si irrévérencieusement ? A la cour des tyrans de Sicile, la satire politique n’étant point de mise, l’Olympe paya pour l’Agora : les puissans du jour furent épargnés, mais les poètes vilipendèrent les anciennes puissances de la terre et du ciel. Dans ses comédies syracusaines, Épicharme faisait de Jupiter un gourmand obèse de Minerve une musicienne de carrefour ; de Castor et Pollux, des danseurs obscènes ; d’Hercule, une brute vorace. On sait que Plaute copia souvent ce poète audacieux, dans son Amphitryon par exemple ; et pourtant Épicharme était un personnage grave, dont on a fait un philosophe ! Syracuse lui éleva une statue avec cette inscription : « Autant le soleil l’emporte par son éclat sur les autres astres et la mer sur les fleuves, autant Épicharme l’emporté par sa sagesse sur les autres hommes. »
Ainsi, l’ancienne poésie qui avait vécu d’images, et la nouvelle philosophie, qui vivait d’abstractions, ne pouvaient pas s’entendre. L’une avait fait les Olympiens à la ressemblance de l’homme, l’autre leur enlevait la forme brillante dont ils avaient été revêtus pour les réduire à n’être que des entités métaphysiques. Le dieu philosophique, nouveau Saturne, allait dévorer les dieux des poètes.
L’art eut sa part dans cette œuvre de destruction. Les parodies des dieux étaient reproduites sur des vases peints, qui, circulant partout, remplissaient le rôle de nos journaux de caricature, et popularisaient les scènes irrévérencieuses de l’Olympe que les poètes comiques avaient mises au théâtre. Nos collections en conservent un certain nombre ; un d’eux, à la Vaticane, montre Jupiter à la porte d’Amphitryon. Le dieu, caché sous un masque barbu, tient l’échelle qui lui fera atteindre, comme un vulgaire coureur d’aventures galantes, la fenêtre où Alcmène l’attend. Près de lui Mercure, déguisé en esclave ventru, va faciliter l’amoureuse escalade en l’éclairant de son falot. Un autre vase, au British-Museum, représente Bacchus qui a enivré Vulcain, afin de pouvoir le ramener, malgré lui, dans l’Olympe où il a éprouvé des ennuis. Ailleurs, c’est Neptune, Hercule et Mercure qui pèchent à la ligne pour fournir aux bombances des dieux.
L’introduction des idées nouvelles est souvent accompagnée d’un ébranlement moral qui précède leur venue et dure jusqu’à leur triomphe. Les Erinnyes, personnification du remords qui poursuit incessamment le coupable, avaient joué un grand rôle chez les anciens Grecs ; avec elles disparut la sanction pénale que la religion avait établie pour cette vie et pour l’autre. Alors les vieilles lois étant méprisées et les nouvelles n’étant pas encore établies, les hommes se trouvent suspendus dans le vide, sans autre règle que leur conscience qui chancelle et que leurs passions qui les entraînent. Du même coup, la morale humaine s’affaiblit ; le sentiment du devoir diminue et les liens de la famille se relâchent. Ainsi en fut-il alors pour Athènes. « Nous avons, disait-on en face d’un tribunal, nous avons des courtisanes pour nos plaisirs, des concubines pour partager notre couche, des épouses pour nous donner des enfans légitimes et veiller au soin de la maison. » Est-ce Alcibiade qui parle ainsi ? Non, c’est peut-être le plus grand des orateurs d’Athènes.
Cette lutte entre la religion et la philosophie fût restée sans influence fâcheuse sur la cité si, dans le même temps, il ne s’était ouvert des écoles de doute universel et de morale facile, où l’art de parvenir remplaça le vieil et viril enseignement des vertus civiques. Le système d’éducation ne changea pas pour l’enfant ; les anciennes études de grammaire et de musique, les exercices militaires et gymnastiques continuèrent ; mais le jeune homme se trouva enveloppé d’un autre esprit. On a souvent montré le goût d’Athènes pour les arts ; il faut parler de l’art démocratique par excellence, la rhétorique. De celle-ci naquirent deux classes d’hommes, les rhéteurs et les sophistes, qui regardèrent le talent de discourir comme étant à lui-même son moyen et sa fin. Aussi leur unique souci était-il de rendre leurs élèves des parleurs redoutables, tandis que les anciens maîtres ne cherchaient qu’à faire des citoyens et des soldats. Autrefois, on apprenait à agir ; maintenant, on apprend à parler.
C’était une conséquence inévitable du développement des mœurs et des institutions démocratiques. Périclès lui-même n’avait pas dédaigné les entretiens de Protagoras. En de petites cités où tout se fait par la parole, l’éloquence est à la fois une épée et un bouclier ; avec elle on se défend et on attaque ; avec elle on gagne une charge ou un procès, la faveur du public ou l’indulgence des juges. A Athènes, chaque jour un citoyen risquait d’être accusé ou accusateur, et il fallait plaider soi-même. Une accusation bien soutenue mettait en lumière ; un échec avait le double inconvénient d’une défaite et d’une perte sérieuse, car l’accusateur qui ne prouvait pas son dire ou n’obtenait pas, au moins, le cinquième des suffrages, payait une amende de mille drachmes. Savoir parler était donc une nécessité. Pour arriver à la notoriété publique et à la puissance, l’Agora était la route la plus sûre ; comme moyen de parvenir, les exploits militaires ne venaient qu’après les discours. Cet art de bien dire, même sans bien penser, celui de revêtir une opinion fausse des apparences de la vérité et d’éblouir le vulgaire par l’éclat des mots, ce talent de l’avocat qui, au besoin, plaide, avec une conviction momentanée, une cause qu’il sait mauvaise, était fort recherché des jeunes Athéniens, moins curieux à présent de comprendre et de chanter les hymnes des vieux poètes que d’acquérir ce que le Gorgias de Platon appelle le plus grand des biens, à savoir le talent de persuader par sa parole les juges dans les tribunaux, les sénateurs dans le conseil, le peuple dans les assemblées. Aussi accouraient-ils en foule auprès des marchands d’argumens et de subtilités, et payaient-ils à prix d’or leurs leçons. Hippias d’Élis se vantait d’avoir, en Sicile, gagné par ses leçons, dans le court espace de quinze jours, plus de 150 mines, malgré la concurrence de Protagoras, alors au comble de la célébrité. Les sages avaient jadis semé les paroles de sagesse, mais ils ne les vendaient pas ; et Socrate, Platon, s’indignaient de ces marchés que nos sociétés modernes, assises, il est vrai, sur d’autres bases, voient pourtant sans colère.
Rhéteurs qui analysaient les procédés du langage, sophistes qui analysaient les idées morales et politiques, c’était tout un. Les derniers ne formaient pas une école enfermée dans un système particulier. Ils représentaient un certain état des esprits et un des côtés de la philosophie grecque, le scepticisme. Ils ne croyaient à rien, si ce n’est à l’art de bien dire ; préparaient, chacun a sa manière, des orateurs pour les assemblées ou des discours pour les plaideurs, comme nos avocats louent leur parole ou vendent leur science, comme nos maîtres de tout genre la donnent en échange d’un salaire légitime. On croit qu’ils vinrent de Sicile à un certain jour qu’on nomme et qu’on date. On peut le dire pour Gorgias ; mais les sophistes et les rhéteurs ne sont pas un produit artificiel ; ils sortent des entrailles mêmes de la société grecque de ce temps. « Le plus grand des sophistes, a dit Platon, c’est le peuple ; » il voulait dire : c’est la démocratie, qui aime trop les beaux parleurs et a bien rarement la prudence d’Ulysse, lorsqu’il passa près des Sirènes.
Les quatre écoles qui, depuis Thalès, avaient cherché la vérité hors de l’enseignement religieux, par les seuls efforts de l’esprit, n’avaient produit que des hypothèses fondées sur des raisonnemens a priori. La sophistique fut la réaction qui devait inévitablement se produire contre un dogmatisme impérieux, comme le scepticisme philosophique succédera aux affirmations doctrinales de Platon et d’Aristote. Ces oscillations de l’esprit sont d’ordre naturel. Les Ioniens avaient essayé d’expliquer la création par la matière, les Éléates par la pensée, les Pythagoriciens par les nombres, Leucippe et Démocrite par les atomes. Malgré des conceptions puissantes, aucun problème n’avait été résolu, et les systèmes s’étaient brisés les uns contre les autres, sans faire jaillir la lumière. Sur la voie suivie par les philosophes, on ne voyait donc que des ruines, et il y en aura toujours, attendu que, parmi les questions qu’ils agitent, il en est qui dépassent notre intelligence, comme il est des efforts qui sont au-dessus de notre puissance musculaire. C’est l’honneur de l’esprit humain de vouloir pénétrer jusqu’aux principes des choses ; c’est le malheur de sa condition de n’y arriver jamais ; et, quand il se sent vaincu dans cette lutte pour la conquête de la vérité, il s’abandonne parfois à des négations aussi téméraires que l’avaient été les audaces métaphysiques. Ainsi en arriva-t-il en Grèce au temps où nous sommes.
La sophistique, qu’Aristote définit « une sagesse apparente, mais non réelle, » est l’avènement de l’esprit critique. Comme toute puissance nouvelle, elle ne sut ni mesurer, ni ménager ses forces. Avec une méthode à la fois féconde et dangereuse, selon celui qui l’emploie, et qu’elle emprunta aux Éléates, la dialectique, elle prétendait tout analyser ; et elle mit tout en pièces, sans rien reconstituer. Elle ne le pouvait pas, car elle fut et elle resta la négation, arme de guerre bonne pour détruire, qui ne sert pas toujours à édifier. Lorsque Protagoras, de qui nous avons cependant de belles paroles sur la justice et la vertu, disait que « l’homme est la mesure des choses, » (GREC), cela signifiait que toute pensée est vraie pour celui qui la pense, mais seulement à l’instant, où elle se produit dans son esprit ; de sorte que, sur le même sujet, à des momens différens, l’affirmation et la négation ont une valeur égale, d’où il résulte que nul n’a le droit d’établir une loi générale. Il admettait pourtant qu’il y avait des opinions, sinon plus vraies, au moins meilleures que d’autres, et que c’était l’office du sage de les substituer aux plus mauvaises. Thrasymaque de Chalcédoine allait plus loin : il estimait que le juste se détermine par l’utile ; que le droit est toujours au plus fort ; qu’enfin les lois n’ont, été établies par les peuples et par les rois que pour leur avantage particulier. Dans le Gorgias de Platon, Polos d’Agrigente soutenait la thèse que l’intérêt personnel est la mesure de tout bien ; et il vantait le bonheur des rois de Perse et de Macédoine, qui s’étaient élevés au trône par le meurtre et la trahison. Les proscripteurs des habitans de Mélos n’avaient donc pas en de grands efforts d’imagination à faire pour démontrer à ces pauvres gens qu’ils avaient tort de se plaindre qu’Athènes les obligeât à tendre la gorge.
Le peuple, il est vrai, ne philosophait pas. Mais il avait un autre maître, la guerre, qui lui enseignait la morale des bêtes fauves. Aux mesures abominables, plusieurs fois prises en ce temps-là, Thucydide donne pour cause la lutte acharnée que soutenaient Tune contre l’autre Sparte et Athènes, ou l’aristocratie et la démocratie. Entre elles deux, il n’y avait d’autre principe que la force, et un demi-siècle plus tard, Démosthène répétera en gémissant, la sinistre formule : « Aujourd’hui, la force est la mesure du droit. »
De quelque côté que Tinssent ces doctrines, on pense bien que, désastreuses pour l’état, elles l’étaient aussi pour le ciel et qu’elles mettaient Les dieux en très grand péril. Protagoras disait d’eux, dans un de ses ouvrages : « Quant aux dieux, je ne puis savoir s’il y en a ou s’il n’y en a pas, car beaucoup de choses s’y opposent : en particulier, l’obscurité de la question et la brièveté de la vie. » Gorgias soutenait d’abord que rien n’existe ; ensuite, que, si quelque chose existait, il serait impossible de le connaître et d’en ; communiquer à d’autres la connaissance. C’était arriver, par un chemin opposé, au même point que Protagoras, c’est-à-dire à la négation de toute certitude.
Ainsi, rien n’est vrai, mais tout est vraisemblable ; du moins à force d’art on peut donner à tout les apparences de la vérité. Donc, il n’y avait pas de thèse qui ne se pût défendre. Si de telles, doctrines, bouleversement de la raison humaine, ruinaient la vertu, le patriotisme, la religion, elles n’en étaient pas moins, dans les bouches habiles qui les présentaient, fort séduisantes. Elles plaisaient à des esprits amoureux des subtilités ingénieuses et elles étaient utiles au défenseur de toute cause mauvaise. Aussi, chez ce peuple disputeur, eurent-elles de nombreux adeptes qui trouvèrent dans ce métier le moyen de briller et de s’enrichir. C’était à qui de ces prestidigitateurs surpasserait l’autre par l’étrangeté de ses thèses, par la subtilité de ses argumens, par la souplesse et l’éclat de sa parole, par son habileté à traiter sur-le-champ et successivement le oui et le non, le pour et le contre. Dans les écoles, dans les fêtes, dans les jeux publics d’Olympie, partout où beaucoup d’hommes se trouvaient réunis, on voyait aussitôt paraître un sophiste qui, se faisant donner un sujet quelconque, le traitait, quelque frivole ou paradoxal qu’il fût, aux applaudissemens des auditeurs, et ne s’avouait jamais vaincu. « Ces gens-là, dira Platon, on a beau les terrasser, ils se relèvent toujours : l’Hydre de Lerne était un sophiste. »
Mais il ne faut pas faire de la sophistique un attribut particulier de la démocratie. Critias, qui fut un des trente tyrans et un des plus abominables, ne voyait dans les institutions religieuses et dans la croyance aux dieux que l’effet d’une ruse habile. « Il fut un temps, disait-il, où la vie humaine était sans loi, semblable à celle des bêtes et esclave de la violence. Il n’y avait pas alors d’honneur pour les bons, et les supplices n’effrayaient pas encore les méchans. Puis les hommes fondèrent les lois, pour que la justice fût reine et l’injure asservie ; et le châtiment suivit alors le crime. Mais comme les hommes commettaient en secret les violences que la loi réprimait, lorsqu’elles osaient s’exercer à découvert, il se rencontra, je pense, un homme adroit et sage qui, pour imprimer la terreur aux mortels pervers, lorsqu’ils se porteraient à faire, à dire, ou même à penser quelque chose de mauvais, imagina la divinité. Il y a un dieu, dit-il, florissant d’une vie immortelle, qui sait, qui entend, qui voit par la pensée toutes choses, et dont l’attention est toujours éveillée sur la nature mortelle. Il entend tout ce qui se dit parmi les hommes ; il voit tout ce qui s’y fait. Si vous machinez quelque forfait en silence, il n’échappera point aux regards des dieux. A force de répéter de pareils discours, ce sage introduisit le plus heureux des enseignemens, cachant la vérité sous le mensonge. Et pour frapper davantage, pour mieux conduire les esprits, il leur conta que les dieux habitent aux lieux d’où viennent aux hommes les plus grandes terreurs et les plus grands secours de leur vie malheureuse ; aux lieux d’où s’échappent les feux de l’éclair et les terribles retentissemens de la foudre ; où, d’un autre côté, brille la voûte étoilée du ciel, œuvre admirable du temps, ce sage ouvrier, et d’où part la lumière brillante des astres, d’où la pluie pénétrante descend au sein de la terre. C’est ainsi, je pense, que quelque sage parvint à persuader les hommes de l’existence des dieux. »
Athènes eut l’honneur et le triste privilège de devenir le foyer de l’esprit sophistique, dont on retrouve les traces dans les mœurs publiques de quelques-uns de ses citoyens et jusque dans sa littérature. Les tragédies d’Euripide nous en ont déjà fourni la preuve
[ltr][2][/ltr]
; la vie d’Alcibiade en est une autre. Ce personnage fut en effet un sophiste politique, brillant rhéteur en actions, comme les autres l’étaient en paroles ; toujours prêt au oui et au non ; aujourd’hui avec Athènes, demain avec Sparte, Argos ou Tissapherne, indifférent, en un mot, sur ces questions de patrie et de vertu qui passionnaient si fortement les contemporains de Miltiade.
Contre ces doctrines qui détachaient les citoyens de la patrie et jetaient un reflet fâcheux sur les œuvres d’un aussi beau génie qu’Euripide, des protestations s’élevèrent. Il y en eut deux fameuses, l’une au nom du passé, l’autre au nom de l’avenir. Je parle d’Aristophane et de Socrate.
Aristophane combattit Euripide, Cléon, les sophistes et Socrate, en un mot l’esprit nouveau, bon ou mauvais, sans distinction. On a vu déjà que l’Athènes de Périclès et sa démocratie belliqueuse n’avaient pas les sympathies du poète satirique. Dans les Grenouilles, dont l’objet est de montrer combien Euripide est inférieur à Eschyle pour la noblesse des personnages et pour la convenance du style, qui est le même dans la bouche de tous, rois ou esclaves, Aristophane fait dire à Euripide lui-même : « Par Apollon ! en les faisant parler ainsi, je leur prêtais un air plus démocratique ! »
Mais ce furent les sophistes qu’il attaqua le plus violemment dans la personne de Socrate, ne distinguant point en lui l’homme sensé, caché peut-être sous trop d’habiletés de parole. La pièce des Nuées est un pamphlet étincelant d’esprit, mordant, qui porte juste en pleine sophistique, seulement il faudrait substituer le nom d’un de ces saltimbanques en paroles dont nous avons parlé à celui de Socrate, que le poète représente suspendu au-dessus de la terre, et invoquant les déesses tutélaires des sophistes, les Nuées, dont il croit entendre la voix au milieu des brouillards. Le vieux Strepsiade, ruiné par les désordres de son fils, voudrait bien trouver le moyen de ne pas payer les dettes que le prodigue a contractées : pour cela il l’envoie à l’école des sophistes. « Qu’irai-je y apprendre ? demande le fils.
STREPSIADE : — Ils enseignent, dit-on, deux raisonnemens : le juste et l’injuste. Par le moyen du second, on peut gagner les plus mauvaises causes. Si donc tu apprends ce raisonnement injuste, je ne paierai pas une obole de toutes les dettes que j’ai contractées pour toi. » Sur le refus de son fils, le vieillard se rend lui-même chez Socrate, et bientôt il y apprend à ne plus croire aux dieux. Il rencontre son fils et l’entend jurer par Jupiter Olympien. « Voyez, voyez, Jupiter Olympien ! quelle folie ! A ton âge, tu crois à Jupiter ! »
PHIDIPPIDE : — Y a-t-il en cela de quoi rire ?
— Tu n’es qu’un enfant pour admettre de telles vieilleries. Approche pourtant, que je t’instruise ; je vais le dire la chose, et alors tu seras homme ; mais ne va pas le répéter à personne !
— Eh bien ! qu’est-ce ?
— Tu viens de jurer par Jupiter ?
— Oui.
— Vois comme il est bon d’étudier : il n’y a pas de Jupiter, mon cher Phidippide.
— Qui est-ce donc ?
— C’est Tourbillon qui règne ; il a chassé Jupiter
[ltr][3][/ltr]
.
C’est le nous avons changé tout cela de Molière, et cette bonne dupe de Strepsiade rappelle notre bourgeois-gentilhomme, il ne faut pas oublier qu’il a perdu son manteau et ses souliers : insinuation de vol calomnieuse, assurément, contre Socrate, et qui l’était aussi contre les sophistes.
Après cette parodie des nouvelles doctrines qui substituaient à la royauté divine de Jupiter la domination des lois physiques, le poète met en scène le Juste et l’injuste : tous deux se livrent bataille à coups d’argumens ; le Juste trace le tableau de la vie ancienne, qui se passait au milieu des exercices de la palestre et dans-la pratique de la vertu, avec la pudeur, la modération et le respect des vieillards. L’Injuste étale toutes ses séductions, et c’est à fut qu’Aristophane fait demeurer le champ de bataille, comme s’il désespérait désormais de ramener les Athéniens à la justice : « : L’INJUSTE : — Or ça ! dis-moi, quelle espèce de gens sont les orateurs ?
LE JUSTE : — Des infâmes.
— Je le crois ; et nos poètes tragiques ?
— Des infâmes.
— Bien ; et les démagogues ?
— Des infâmes.
— Et les spectateurs, que sont-ils ? Vois quelle est la majorité.
— Attends, je regarde.
— Eh bien ! que vois-tu ?
— Les infâmes sont en majorité. En voilà un que je connais pour tel, celui-là encore, et cet autre avec ses longs cheveux. Qu’as-tu à dire maintenant ?
— Je suis vaincu. O infâmes, je vous en prie, recevez mon manteau ; je passe dans votre camp !
Phidippide se décide enfin à aller à l’école de Socrate.. Mais le bonhomme Strepsiade ne tarde pas à s’en repentir ; on le voit accourir sur la scène, battu par son fils : « Ho ! là, là ! voisins, parens, citoyens, secourez-moi ! On me tue ! Ah ! la tête ! Ah ! la mâchoire ! Scélérat, tu bats ton père ! »
PHIDIPPIDE : — Il est vrai, mon père.
— Vous l’entendez, il avoue qu’il me frappe.
— Sans doute.
— Scélérat ! Voleur ! Parricide !
— Répète les injures ; dis-en mille autres ; sais-tu que j’y prends plaisir ?
— Infâme !
— Tu me couvres de roses.
— Tu bats ton père !
— Et je le prouverai que j’ai en raison de te battre.
— L’impie ! Peut-on jamais avoir raison de battre son père ?
— Je te démontrerai, et tu seras convaincu.
— Je serai convaincu ?
— Rien de plus simple. Dis seulement lequel des deux raisonnemens tu veux que j’emploie.
Plus loin, Phidippide dit, en parlant de la loi qui permet aux pères de battre leurs fils et défend la réciprocité : « N’était-il pas homme comme nous, celui qui porta le premier cette loi, et la fit adopter à ceux de son temps ? Pourquoi ne pourrais-je pas également faire une loi nouvelle qui permette aux fils de battre les pères à leur tour ? Nous vous faisons grâce de tous les coups que nous avons reçus depuis l’établissement de cette loi ; nous voulons bien avoir été battus gratis. Mais vois les coqs et les autres animaux : ils se défendent contre leurs pères, et cependant quelle différence y a-t-il entre eux et nous, si ce n’est qu’ils ne rédigent pas de décrets ? » C’étaient là les raisonnemens favoris des sophistes, il est vrai en d’autres sujets. Enfin le vieillard revient à résipiscence, et, reconnaissant que les sophistes sont des fripons, il court avec un esclave, une torche dans une main, une hache dans l’autre, à l’assaut de l’école de Socrate, qu’il veut démolir et brûler avec tous ses habitans.
On sait par l’affaire de Mélos quel chemin avaient fait ces doctrines, qui donnèrent là un de leurs fruits naturels : la théorie du droit du plus fort ; et l’historien se demande quel pouvait être le patriotisme de ces nouveau-venus qui, ne voyant dans le passé que d’inutiles vieilleries, mettaient leur raison individuelle, tout armée d’argumens spécieux, à la place de la raison collective de la cité, faite du souvenir des joies et des tristesses éprouvées en commun. Un d’entre eux n’a-t-il pas dit que la loi était un tyran, parce qu’elle est une gêne : opposition contre la loi civile qui mettait en péril la loi morale. Ni Lycurgue ni Solon ne parlaient ainsi, et l’on se souvient que Pindare appelait la loi « la reine et impératrice du monde. »
La Grèce avait vécu dix siècles sous un régime municipal qui avait fini par lui donner puissance, gloire et liberté, avec un patriotisme étroit, mais énergique, devant lequel le Mède avait reculé. Et voici des hommes qui minaient le respect dû à la loi, aux divinités poliades, aux croyances des aïeux. Ces nomades, errant de ville en ville, en quête d’un salaire, n’avaient plus de patrie, et ils en détruisaient l’amour dans le cœur de ceux qui en avaient une encore. Les tristes effets de cette révolution morale qui agrandit les idées, mais qui laisse les caractères fléchir à tout vent de passion, ne tarderont pas à se faire sentir : avant deux tiers de siècle, les habitans de ces villes naguère si vivantes ne seront plus que les mornes sujets de l’empire macédonien. Quand la religion part, qu’au moins la patrie reste !
Nous mettons à la charge de la sophistique assez de méfaits pour être obligé de faire aussi la part des services qu’elle a rendus en donnant une direction nouvelle aux méditations philosophiques. Les physiciens des écoles précédentes n’étaient occupés que du cosmos ; les sophistes firent une part à l’étude de l’homme, de ses facultés, de son langage. En aiguisant l’esprit, à force de subtilités, ils le préparèrent pour des travaux plus utiles, et ils commencèrent l’opposition féconde entre le droit traditionnel, qui consacrait souvent des iniquités, et le droit naturel, qui ne pouvait se trouver qu’au fond de la conscience. Ces services sont dus surtout aux premiers sophistes, qu’il faut séparer des vendeurs de paroles, leurs disciples dégénérés, parce qu’ils furent des philosophes et d’habiles dialecticiens que Socrate et Platon respectaient. Chez quelques-uns, on rencontrerait des pensées que n’auraient pas réprouvées les anciens sages. « Tous les animaux, disait Protagoras, ont leurs moyens de défense ; à l’homme, la nature a donné le sens du juste et l’horreur de l’injustice. Ce sont les armes qui le protègent, parce que ces dispositions naturelles l’aident à établir de bonnes institutions. » Elle est de Prodicus, la belle allégorie d’Hercule, sollicité, au moment d’entrer dans la vie active, par la Vertu et la Volupté, et se décidant à suivre la première. Lycophron déclare que la noblesse est un avantage imaginaire ; Alcidamas, que la nature ne fait pas des hommes libres et des hommes esclaves, thèse que les derniers stoïciens reprendront. A travers cette sophistique purifiée par Socrate, on entrevoit un monde nouveau qui s’élève. Ce que le citoyen va perdre, l’homme le gagnera, et la lutte entre le jus civitatis et le jus gentium que les écoles socratiques vont entreprendre sera l’histoire même des progrès de l’humanité.
Aristophane avait attaqué la sophistique avec une vigueur singulière, sans proposer d’autre remède que de fermer les écoles des philosophes et de reculer de trois générations en arrière. Mais lui-même n’a-t-il pas tous les vices de son temps, l’immoralité et l’irréligion ? Le remède véritable n’était pas l’ignorance des anciens jours ; on le pouvait trouver dans la science virile que venait d’inaugurer un homme, et cet homme était celui que je poète avait le plus cruellement attaqué.
Lutte entre la religion et la philosophie au temps de Socrate
Victor Duruy
Revue des Deux Mondes
tome 84, 1887
Victor Duruy
Revue des Deux Mondes
tome 84, 1887
I
L’histoire de la Grèce est double : elle montre des faits qui excitent notre curiosité ou nous aident à former notre expérience politique, et des idées qui inspirent encore nos poètes, nos philosophes et nos artistes. C’est par les idées que les sociétés se transforment et que la civilisation se développe. La véritable histoire est donc celle de la pensée humaine ; or, vers la fin du Ve siècle avant notre ère, beaucoup de pensées fermentaient dans Athènes, et un grand homme y commençait une révolution morale qui allait donner une vigoureuse secousse à l’esprit grec ; il faut aller à lui.
Par la guerre du Péloponèse, Athènes avait perdu son empire, et bien autre chose ; ses anciennes mœurs et ses vieilles croyances étaient ébranlées. Maîtres d’une moitié du monde hellénique, les Athéniens avaient vu affluer dans leur cité les hommes et les richesses ; l’industrie, le commerce avaient pris un immense essor, et, au milieu de ce mouvement général, l’esprit n’avait pu rester le prisonnier de l’ancienne orthodoxie religieuse. Des horizons nouveaux s’étaient ouverts devant l’imagination du penseur, comme des mers nouvelles devant le navire du marchand. Eschyle, Sophocle, Hérodote, Thucydide, Aristophane, avaient rencontré, dans les voies où ils s’étaient élancés, les plus belles conceptions du génie ; Phidias avait vu Jupiter ; Anaxagore avait presque trouvé Dieu. Ainsi, le vieil Homère et tous les poètes qui l’avaient précédé ou qu’il inspira avaient paru, après que la race grecque se fut, comme une alluvion féconde, répandue sur les côtes de l’Asie et mêlée, par le commerce et par les armes, au monde oriental.
Le sentiment religieux s’était épuré, au moins pour quelques-uns. La conception de la divinité était plus élevée, et la grande question de l’autre vie, tout en restant fort obscure, tendait vers une solution moins grossière que celle qui en avait été donnée par Homère et Hésiode. La récompense des bons (grec) se rapprochait de celle qui leur est aujourd’hui promise. « Les âmes des hommes pieux, disent Épicharme, Pindare et Eschyle, habitent au ciel et célèbrent par des hymnes la grande divinité. » L’âme des bienheureux (grec), placée au milieu des astres, participait à la béatitude divine, et jouissait de la vue perpétuelle de la lumière pure, comme celle des élus de Dante.
Mais au-dessous des nobles préoccupations de ces grands esprits, que d’agitations stériles ! Combien qui, ne pouvant créer, détruisaient ; qui niaient le passé sans rien affirmer pour l’avenir ; qui tournaient en dérision les lois, les mœurs, les croyances du vieux temps, sans rien mettre à leur place. Les dévots entendaient avec effroi des hommes se rire de tout ce qui faisait encore leur vie morale et religieuse, douter de leurs dieux, parodier les mystères. Beaucoup même, voyant que les prières, les sacrifices n’avaient point sauvé Athènes des plus affreuses calamités, en vinrent à penser que les croyances transmises par les aïeux pourraient bien n’être que des mensonges ; déjà on volait les dieux, non pas l’argent déposé dans leurs sanctuaires, comme les Phocidiens le prendront à Delphes, mais, ce qui était un double sacrilège, les ornemens d’or qui recouvraient leurs statues
[ltr][1][/ltr]
. L’hellénisme était arrivé à ce carrefour ténébreux où les religions aboutissent, lorsque le doute commence à s’attacher à elles, et où la foule s’attarde, parce que, si la croyance ne conduit plus la vie, elle commande encore aux habitudes. De la partent des routes dans lesquelles s’engagent les esprits élevés et résolus qui laissent derrière eux le passé mourir lentement et cherchent à aller au-devant de l’avenir qui s’approche.
Longtemps épars à la circonférence du monde grec, en Asie, dans la Thrace et la Sicile, les philosophes étaient tous accourus au centre, ioniens, éléates, pythagoriciens, atomistes. Depuis le siècle de Périclès, Athènes était leur champ clos : c’est là qu’avait lieu la mêlée des systèmes ; là que commençait la révolution qui fit entrer le paganisme dans la période de décadence pour le peuple, de transformation morale pour les hommes supérieurs. L’ancienne religion voyait l’esprit se retirer d’elle par deux voies. Les mystères, surtout ceux d’Éleusis, avaient peu à peu dégagé, réuni et développé les élémens spiritualistes que les vieux cultes renfermaient, et, sans briser le polythéisme, tendaient à faire prévaloir l’idée d’un dieu unique. Plus hardis, plus libres, les philosophes remontaient par la raison seule à la cause première. Mais en agitant, pour l’éternel honneur de l’intelligence humaine, les grands problèmes que la religion populaire prétendait avoir résolus, ces hommes faisaient naturellement contre celle-ci acte d’insubordination et de révolte. Ils la réduisaient à n’être qu’une forme vide, un linceul de mort qui enveloppait l’état, et que, par prudence seule, par respect forcé pour les faiblesses populaires, ils se gardaient de déchirer.
Le panthéisme des Ioniens permettait bien encore à Thalès de dire : « Le monde est plein de dieux, » mais Hippocrate subordonnait leur action à des lois constantes et aux conditions de la matière. « Il n’existe pas, disait-il, de maladies divines ; toutes ont des causes naturelles. » C’était briser l’arc d’Apollon et ses flèches, qui portaient la peste et la mort dans les cités. Anaxagore, tout en proclamant une cause unique, dont Platon fera le (grec) et saint Paul le Verbum Dei, supprimait les auxiliaires que la foi lui avait donnés. Il osait enseigner que les aérolithes venaient du ciel, — ce que les popolani de Naples ne croient pas encore, — et en donnant aux pierres météoriques cette origine, il était aux astres leur divinité : Mars, Vénus, Hélios n’étaient plus que des masses rocheuses incandescentes. Lorsqu’il disait : « Rien ne naît ; rien ne meurt ; il n’y a partout que composition et décomposition ; chaque chose retourne d’où elle est venue, et le fond de la nature ne change pas, » il ruinait le surnaturel et, avec lui, la religion qui vit de merveilles. Xénophane, plus explicite, avait rejeté toute la théologie vulgaire et reproché aux poètes d’avoir divinisé les forces nuisibles ou favorables qui agissent sur l’homme ; Hésiode, même Homère, n’avaient pu trouver grâce devant lui ; il leur reprochait d’avoir dégradé l’idée de la divinité, en prêtant à leurs dieux des actions et des sentimens indignes de l’Être absolu. Toutefois, Xénophane n’était point parvenu à concilier, tout en les distinguant, Dieu et le monde, la cause et l’effet. Pour sortir de ce mélange indécis de théisme et de panthéisme, son disciple, le redoutable Parménide, comme Platon l’appelle, ne trouva d’autre moyen que de nier le monde. Il le déclara une apparence vaine, et nos sens qui nous le montrent des instrumens d’erreurs. Démocrite, au contraire, réduisait le problème de l’univers à une question de mécanique ; il n’existe, selon lui, d’autre substance que celle des corps, d’autre force motrice que la pesanteur, et il se riait de ceux qui des phénomènes de la nature avaient fait des dieux. Un de ses disciples, Diagoras de Mélos, niait résolument leur existence. Pour se moquer des douze travaux d’Hercule, il jetait au feu une statue en bois du fils de Jupiter et lui demandait d’accomplir un treizième exploit en triomphant de ce nouvel ennemi. A Samothrace, les prêtres lui montraient, en preuve de la puissance de leurs dieux, les offrandes des navigateurs échappés au naufrage. « Mais combien en auriez-vous, leur dit-il, si tous ceux qui ont péri vous en avaient envoyé ? »
Tandis que les philosophes minaient la religion nationale par la raison, les poètes comiques la tuaient par le ridicule, et leur influence s’étendait rapidement chez un peuple où tout le monde lisait, même en voyage. Quel devait être l’effet produit sur la foule réunie au théâtre, quand, à Athènes, on jouait le Plutus, les Oiseaux et les Grenouilles d’Aristophane, qui traitent les dieux si irrévérencieusement ? A la cour des tyrans de Sicile, la satire politique n’étant point de mise, l’Olympe paya pour l’Agora : les puissans du jour furent épargnés, mais les poètes vilipendèrent les anciennes puissances de la terre et du ciel. Dans ses comédies syracusaines, Épicharme faisait de Jupiter un gourmand obèse de Minerve une musicienne de carrefour ; de Castor et Pollux, des danseurs obscènes ; d’Hercule, une brute vorace. On sait que Plaute copia souvent ce poète audacieux, dans son Amphitryon par exemple ; et pourtant Épicharme était un personnage grave, dont on a fait un philosophe ! Syracuse lui éleva une statue avec cette inscription : « Autant le soleil l’emporte par son éclat sur les autres astres et la mer sur les fleuves, autant Épicharme l’emporté par sa sagesse sur les autres hommes. »
Ainsi, l’ancienne poésie qui avait vécu d’images, et la nouvelle philosophie, qui vivait d’abstractions, ne pouvaient pas s’entendre. L’une avait fait les Olympiens à la ressemblance de l’homme, l’autre leur enlevait la forme brillante dont ils avaient été revêtus pour les réduire à n’être que des entités métaphysiques. Le dieu philosophique, nouveau Saturne, allait dévorer les dieux des poètes.
L’art eut sa part dans cette œuvre de destruction. Les parodies des dieux étaient reproduites sur des vases peints, qui, circulant partout, remplissaient le rôle de nos journaux de caricature, et popularisaient les scènes irrévérencieuses de l’Olympe que les poètes comiques avaient mises au théâtre. Nos collections en conservent un certain nombre ; un d’eux, à la Vaticane, montre Jupiter à la porte d’Amphitryon. Le dieu, caché sous un masque barbu, tient l’échelle qui lui fera atteindre, comme un vulgaire coureur d’aventures galantes, la fenêtre où Alcmène l’attend. Près de lui Mercure, déguisé en esclave ventru, va faciliter l’amoureuse escalade en l’éclairant de son falot. Un autre vase, au British-Museum, représente Bacchus qui a enivré Vulcain, afin de pouvoir le ramener, malgré lui, dans l’Olympe où il a éprouvé des ennuis. Ailleurs, c’est Neptune, Hercule et Mercure qui pèchent à la ligne pour fournir aux bombances des dieux.
L’introduction des idées nouvelles est souvent accompagnée d’un ébranlement moral qui précède leur venue et dure jusqu’à leur triomphe. Les Erinnyes, personnification du remords qui poursuit incessamment le coupable, avaient joué un grand rôle chez les anciens Grecs ; avec elles disparut la sanction pénale que la religion avait établie pour cette vie et pour l’autre. Alors les vieilles lois étant méprisées et les nouvelles n’étant pas encore établies, les hommes se trouvent suspendus dans le vide, sans autre règle que leur conscience qui chancelle et que leurs passions qui les entraînent. Du même coup, la morale humaine s’affaiblit ; le sentiment du devoir diminue et les liens de la famille se relâchent. Ainsi en fut-il alors pour Athènes. « Nous avons, disait-on en face d’un tribunal, nous avons des courtisanes pour nos plaisirs, des concubines pour partager notre couche, des épouses pour nous donner des enfans légitimes et veiller au soin de la maison. » Est-ce Alcibiade qui parle ainsi ? Non, c’est peut-être le plus grand des orateurs d’Athènes.
II
Cette lutte entre la religion et la philosophie fût restée sans influence fâcheuse sur la cité si, dans le même temps, il ne s’était ouvert des écoles de doute universel et de morale facile, où l’art de parvenir remplaça le vieil et viril enseignement des vertus civiques. Le système d’éducation ne changea pas pour l’enfant ; les anciennes études de grammaire et de musique, les exercices militaires et gymnastiques continuèrent ; mais le jeune homme se trouva enveloppé d’un autre esprit. On a souvent montré le goût d’Athènes pour les arts ; il faut parler de l’art démocratique par excellence, la rhétorique. De celle-ci naquirent deux classes d’hommes, les rhéteurs et les sophistes, qui regardèrent le talent de discourir comme étant à lui-même son moyen et sa fin. Aussi leur unique souci était-il de rendre leurs élèves des parleurs redoutables, tandis que les anciens maîtres ne cherchaient qu’à faire des citoyens et des soldats. Autrefois, on apprenait à agir ; maintenant, on apprend à parler.
C’était une conséquence inévitable du développement des mœurs et des institutions démocratiques. Périclès lui-même n’avait pas dédaigné les entretiens de Protagoras. En de petites cités où tout se fait par la parole, l’éloquence est à la fois une épée et un bouclier ; avec elle on se défend et on attaque ; avec elle on gagne une charge ou un procès, la faveur du public ou l’indulgence des juges. A Athènes, chaque jour un citoyen risquait d’être accusé ou accusateur, et il fallait plaider soi-même. Une accusation bien soutenue mettait en lumière ; un échec avait le double inconvénient d’une défaite et d’une perte sérieuse, car l’accusateur qui ne prouvait pas son dire ou n’obtenait pas, au moins, le cinquième des suffrages, payait une amende de mille drachmes. Savoir parler était donc une nécessité. Pour arriver à la notoriété publique et à la puissance, l’Agora était la route la plus sûre ; comme moyen de parvenir, les exploits militaires ne venaient qu’après les discours. Cet art de bien dire, même sans bien penser, celui de revêtir une opinion fausse des apparences de la vérité et d’éblouir le vulgaire par l’éclat des mots, ce talent de l’avocat qui, au besoin, plaide, avec une conviction momentanée, une cause qu’il sait mauvaise, était fort recherché des jeunes Athéniens, moins curieux à présent de comprendre et de chanter les hymnes des vieux poètes que d’acquérir ce que le Gorgias de Platon appelle le plus grand des biens, à savoir le talent de persuader par sa parole les juges dans les tribunaux, les sénateurs dans le conseil, le peuple dans les assemblées. Aussi accouraient-ils en foule auprès des marchands d’argumens et de subtilités, et payaient-ils à prix d’or leurs leçons. Hippias d’Élis se vantait d’avoir, en Sicile, gagné par ses leçons, dans le court espace de quinze jours, plus de 150 mines, malgré la concurrence de Protagoras, alors au comble de la célébrité. Les sages avaient jadis semé les paroles de sagesse, mais ils ne les vendaient pas ; et Socrate, Platon, s’indignaient de ces marchés que nos sociétés modernes, assises, il est vrai, sur d’autres bases, voient pourtant sans colère.
Rhéteurs qui analysaient les procédés du langage, sophistes qui analysaient les idées morales et politiques, c’était tout un. Les derniers ne formaient pas une école enfermée dans un système particulier. Ils représentaient un certain état des esprits et un des côtés de la philosophie grecque, le scepticisme. Ils ne croyaient à rien, si ce n’est à l’art de bien dire ; préparaient, chacun a sa manière, des orateurs pour les assemblées ou des discours pour les plaideurs, comme nos avocats louent leur parole ou vendent leur science, comme nos maîtres de tout genre la donnent en échange d’un salaire légitime. On croit qu’ils vinrent de Sicile à un certain jour qu’on nomme et qu’on date. On peut le dire pour Gorgias ; mais les sophistes et les rhéteurs ne sont pas un produit artificiel ; ils sortent des entrailles mêmes de la société grecque de ce temps. « Le plus grand des sophistes, a dit Platon, c’est le peuple ; » il voulait dire : c’est la démocratie, qui aime trop les beaux parleurs et a bien rarement la prudence d’Ulysse, lorsqu’il passa près des Sirènes.
Les quatre écoles qui, depuis Thalès, avaient cherché la vérité hors de l’enseignement religieux, par les seuls efforts de l’esprit, n’avaient produit que des hypothèses fondées sur des raisonnemens a priori. La sophistique fut la réaction qui devait inévitablement se produire contre un dogmatisme impérieux, comme le scepticisme philosophique succédera aux affirmations doctrinales de Platon et d’Aristote. Ces oscillations de l’esprit sont d’ordre naturel. Les Ioniens avaient essayé d’expliquer la création par la matière, les Éléates par la pensée, les Pythagoriciens par les nombres, Leucippe et Démocrite par les atomes. Malgré des conceptions puissantes, aucun problème n’avait été résolu, et les systèmes s’étaient brisés les uns contre les autres, sans faire jaillir la lumière. Sur la voie suivie par les philosophes, on ne voyait donc que des ruines, et il y en aura toujours, attendu que, parmi les questions qu’ils agitent, il en est qui dépassent notre intelligence, comme il est des efforts qui sont au-dessus de notre puissance musculaire. C’est l’honneur de l’esprit humain de vouloir pénétrer jusqu’aux principes des choses ; c’est le malheur de sa condition de n’y arriver jamais ; et, quand il se sent vaincu dans cette lutte pour la conquête de la vérité, il s’abandonne parfois à des négations aussi téméraires que l’avaient été les audaces métaphysiques. Ainsi en arriva-t-il en Grèce au temps où nous sommes.
La sophistique, qu’Aristote définit « une sagesse apparente, mais non réelle, » est l’avènement de l’esprit critique. Comme toute puissance nouvelle, elle ne sut ni mesurer, ni ménager ses forces. Avec une méthode à la fois féconde et dangereuse, selon celui qui l’emploie, et qu’elle emprunta aux Éléates, la dialectique, elle prétendait tout analyser ; et elle mit tout en pièces, sans rien reconstituer. Elle ne le pouvait pas, car elle fut et elle resta la négation, arme de guerre bonne pour détruire, qui ne sert pas toujours à édifier. Lorsque Protagoras, de qui nous avons cependant de belles paroles sur la justice et la vertu, disait que « l’homme est la mesure des choses, » (GREC), cela signifiait que toute pensée est vraie pour celui qui la pense, mais seulement à l’instant, où elle se produit dans son esprit ; de sorte que, sur le même sujet, à des momens différens, l’affirmation et la négation ont une valeur égale, d’où il résulte que nul n’a le droit d’établir une loi générale. Il admettait pourtant qu’il y avait des opinions, sinon plus vraies, au moins meilleures que d’autres, et que c’était l’office du sage de les substituer aux plus mauvaises. Thrasymaque de Chalcédoine allait plus loin : il estimait que le juste se détermine par l’utile ; que le droit est toujours au plus fort ; qu’enfin les lois n’ont, été établies par les peuples et par les rois que pour leur avantage particulier. Dans le Gorgias de Platon, Polos d’Agrigente soutenait la thèse que l’intérêt personnel est la mesure de tout bien ; et il vantait le bonheur des rois de Perse et de Macédoine, qui s’étaient élevés au trône par le meurtre et la trahison. Les proscripteurs des habitans de Mélos n’avaient donc pas en de grands efforts d’imagination à faire pour démontrer à ces pauvres gens qu’ils avaient tort de se plaindre qu’Athènes les obligeât à tendre la gorge.
Le peuple, il est vrai, ne philosophait pas. Mais il avait un autre maître, la guerre, qui lui enseignait la morale des bêtes fauves. Aux mesures abominables, plusieurs fois prises en ce temps-là, Thucydide donne pour cause la lutte acharnée que soutenaient Tune contre l’autre Sparte et Athènes, ou l’aristocratie et la démocratie. Entre elles deux, il n’y avait d’autre principe que la force, et un demi-siècle plus tard, Démosthène répétera en gémissant, la sinistre formule : « Aujourd’hui, la force est la mesure du droit. »
De quelque côté que Tinssent ces doctrines, on pense bien que, désastreuses pour l’état, elles l’étaient aussi pour le ciel et qu’elles mettaient Les dieux en très grand péril. Protagoras disait d’eux, dans un de ses ouvrages : « Quant aux dieux, je ne puis savoir s’il y en a ou s’il n’y en a pas, car beaucoup de choses s’y opposent : en particulier, l’obscurité de la question et la brièveté de la vie. » Gorgias soutenait d’abord que rien n’existe ; ensuite, que, si quelque chose existait, il serait impossible de le connaître et d’en ; communiquer à d’autres la connaissance. C’était arriver, par un chemin opposé, au même point que Protagoras, c’est-à-dire à la négation de toute certitude.
Ainsi, rien n’est vrai, mais tout est vraisemblable ; du moins à force d’art on peut donner à tout les apparences de la vérité. Donc, il n’y avait pas de thèse qui ne se pût défendre. Si de telles, doctrines, bouleversement de la raison humaine, ruinaient la vertu, le patriotisme, la religion, elles n’en étaient pas moins, dans les bouches habiles qui les présentaient, fort séduisantes. Elles plaisaient à des esprits amoureux des subtilités ingénieuses et elles étaient utiles au défenseur de toute cause mauvaise. Aussi, chez ce peuple disputeur, eurent-elles de nombreux adeptes qui trouvèrent dans ce métier le moyen de briller et de s’enrichir. C’était à qui de ces prestidigitateurs surpasserait l’autre par l’étrangeté de ses thèses, par la subtilité de ses argumens, par la souplesse et l’éclat de sa parole, par son habileté à traiter sur-le-champ et successivement le oui et le non, le pour et le contre. Dans les écoles, dans les fêtes, dans les jeux publics d’Olympie, partout où beaucoup d’hommes se trouvaient réunis, on voyait aussitôt paraître un sophiste qui, se faisant donner un sujet quelconque, le traitait, quelque frivole ou paradoxal qu’il fût, aux applaudissemens des auditeurs, et ne s’avouait jamais vaincu. « Ces gens-là, dira Platon, on a beau les terrasser, ils se relèvent toujours : l’Hydre de Lerne était un sophiste. »
Mais il ne faut pas faire de la sophistique un attribut particulier de la démocratie. Critias, qui fut un des trente tyrans et un des plus abominables, ne voyait dans les institutions religieuses et dans la croyance aux dieux que l’effet d’une ruse habile. « Il fut un temps, disait-il, où la vie humaine était sans loi, semblable à celle des bêtes et esclave de la violence. Il n’y avait pas alors d’honneur pour les bons, et les supplices n’effrayaient pas encore les méchans. Puis les hommes fondèrent les lois, pour que la justice fût reine et l’injure asservie ; et le châtiment suivit alors le crime. Mais comme les hommes commettaient en secret les violences que la loi réprimait, lorsqu’elles osaient s’exercer à découvert, il se rencontra, je pense, un homme adroit et sage qui, pour imprimer la terreur aux mortels pervers, lorsqu’ils se porteraient à faire, à dire, ou même à penser quelque chose de mauvais, imagina la divinité. Il y a un dieu, dit-il, florissant d’une vie immortelle, qui sait, qui entend, qui voit par la pensée toutes choses, et dont l’attention est toujours éveillée sur la nature mortelle. Il entend tout ce qui se dit parmi les hommes ; il voit tout ce qui s’y fait. Si vous machinez quelque forfait en silence, il n’échappera point aux regards des dieux. A force de répéter de pareils discours, ce sage introduisit le plus heureux des enseignemens, cachant la vérité sous le mensonge. Et pour frapper davantage, pour mieux conduire les esprits, il leur conta que les dieux habitent aux lieux d’où viennent aux hommes les plus grandes terreurs et les plus grands secours de leur vie malheureuse ; aux lieux d’où s’échappent les feux de l’éclair et les terribles retentissemens de la foudre ; où, d’un autre côté, brille la voûte étoilée du ciel, œuvre admirable du temps, ce sage ouvrier, et d’où part la lumière brillante des astres, d’où la pluie pénétrante descend au sein de la terre. C’est ainsi, je pense, que quelque sage parvint à persuader les hommes de l’existence des dieux. »
Athènes eut l’honneur et le triste privilège de devenir le foyer de l’esprit sophistique, dont on retrouve les traces dans les mœurs publiques de quelques-uns de ses citoyens et jusque dans sa littérature. Les tragédies d’Euripide nous en ont déjà fourni la preuve
[ltr][2][/ltr]
; la vie d’Alcibiade en est une autre. Ce personnage fut en effet un sophiste politique, brillant rhéteur en actions, comme les autres l’étaient en paroles ; toujours prêt au oui et au non ; aujourd’hui avec Athènes, demain avec Sparte, Argos ou Tissapherne, indifférent, en un mot, sur ces questions de patrie et de vertu qui passionnaient si fortement les contemporains de Miltiade.
Contre ces doctrines qui détachaient les citoyens de la patrie et jetaient un reflet fâcheux sur les œuvres d’un aussi beau génie qu’Euripide, des protestations s’élevèrent. Il y en eut deux fameuses, l’une au nom du passé, l’autre au nom de l’avenir. Je parle d’Aristophane et de Socrate.
Aristophane combattit Euripide, Cléon, les sophistes et Socrate, en un mot l’esprit nouveau, bon ou mauvais, sans distinction. On a vu déjà que l’Athènes de Périclès et sa démocratie belliqueuse n’avaient pas les sympathies du poète satirique. Dans les Grenouilles, dont l’objet est de montrer combien Euripide est inférieur à Eschyle pour la noblesse des personnages et pour la convenance du style, qui est le même dans la bouche de tous, rois ou esclaves, Aristophane fait dire à Euripide lui-même : « Par Apollon ! en les faisant parler ainsi, je leur prêtais un air plus démocratique ! »
Mais ce furent les sophistes qu’il attaqua le plus violemment dans la personne de Socrate, ne distinguant point en lui l’homme sensé, caché peut-être sous trop d’habiletés de parole. La pièce des Nuées est un pamphlet étincelant d’esprit, mordant, qui porte juste en pleine sophistique, seulement il faudrait substituer le nom d’un de ces saltimbanques en paroles dont nous avons parlé à celui de Socrate, que le poète représente suspendu au-dessus de la terre, et invoquant les déesses tutélaires des sophistes, les Nuées, dont il croit entendre la voix au milieu des brouillards. Le vieux Strepsiade, ruiné par les désordres de son fils, voudrait bien trouver le moyen de ne pas payer les dettes que le prodigue a contractées : pour cela il l’envoie à l’école des sophistes. « Qu’irai-je y apprendre ? demande le fils.
STREPSIADE : — Ils enseignent, dit-on, deux raisonnemens : le juste et l’injuste. Par le moyen du second, on peut gagner les plus mauvaises causes. Si donc tu apprends ce raisonnement injuste, je ne paierai pas une obole de toutes les dettes que j’ai contractées pour toi. » Sur le refus de son fils, le vieillard se rend lui-même chez Socrate, et bientôt il y apprend à ne plus croire aux dieux. Il rencontre son fils et l’entend jurer par Jupiter Olympien. « Voyez, voyez, Jupiter Olympien ! quelle folie ! A ton âge, tu crois à Jupiter ! »
PHIDIPPIDE : — Y a-t-il en cela de quoi rire ?
— Tu n’es qu’un enfant pour admettre de telles vieilleries. Approche pourtant, que je t’instruise ; je vais le dire la chose, et alors tu seras homme ; mais ne va pas le répéter à personne !
— Eh bien ! qu’est-ce ?
— Tu viens de jurer par Jupiter ?
— Oui.
— Vois comme il est bon d’étudier : il n’y a pas de Jupiter, mon cher Phidippide.
— Qui est-ce donc ?
— C’est Tourbillon qui règne ; il a chassé Jupiter
[ltr][3][/ltr]
.
C’est le nous avons changé tout cela de Molière, et cette bonne dupe de Strepsiade rappelle notre bourgeois-gentilhomme, il ne faut pas oublier qu’il a perdu son manteau et ses souliers : insinuation de vol calomnieuse, assurément, contre Socrate, et qui l’était aussi contre les sophistes.
Après cette parodie des nouvelles doctrines qui substituaient à la royauté divine de Jupiter la domination des lois physiques, le poète met en scène le Juste et l’injuste : tous deux se livrent bataille à coups d’argumens ; le Juste trace le tableau de la vie ancienne, qui se passait au milieu des exercices de la palestre et dans-la pratique de la vertu, avec la pudeur, la modération et le respect des vieillards. L’Injuste étale toutes ses séductions, et c’est à fut qu’Aristophane fait demeurer le champ de bataille, comme s’il désespérait désormais de ramener les Athéniens à la justice : « : L’INJUSTE : — Or ça ! dis-moi, quelle espèce de gens sont les orateurs ?
LE JUSTE : — Des infâmes.
— Je le crois ; et nos poètes tragiques ?
— Des infâmes.
— Bien ; et les démagogues ?
— Des infâmes.
— Et les spectateurs, que sont-ils ? Vois quelle est la majorité.
— Attends, je regarde.
— Eh bien ! que vois-tu ?
— Les infâmes sont en majorité. En voilà un que je connais pour tel, celui-là encore, et cet autre avec ses longs cheveux. Qu’as-tu à dire maintenant ?
— Je suis vaincu. O infâmes, je vous en prie, recevez mon manteau ; je passe dans votre camp !
Phidippide se décide enfin à aller à l’école de Socrate.. Mais le bonhomme Strepsiade ne tarde pas à s’en repentir ; on le voit accourir sur la scène, battu par son fils : « Ho ! là, là ! voisins, parens, citoyens, secourez-moi ! On me tue ! Ah ! la tête ! Ah ! la mâchoire ! Scélérat, tu bats ton père ! »
PHIDIPPIDE : — Il est vrai, mon père.
— Vous l’entendez, il avoue qu’il me frappe.
— Sans doute.
— Scélérat ! Voleur ! Parricide !
— Répète les injures ; dis-en mille autres ; sais-tu que j’y prends plaisir ?
— Infâme !
— Tu me couvres de roses.
— Tu bats ton père !
— Et je le prouverai que j’ai en raison de te battre.
— L’impie ! Peut-on jamais avoir raison de battre son père ?
— Je te démontrerai, et tu seras convaincu.
— Je serai convaincu ?
— Rien de plus simple. Dis seulement lequel des deux raisonnemens tu veux que j’emploie.
Plus loin, Phidippide dit, en parlant de la loi qui permet aux pères de battre leurs fils et défend la réciprocité : « N’était-il pas homme comme nous, celui qui porta le premier cette loi, et la fit adopter à ceux de son temps ? Pourquoi ne pourrais-je pas également faire une loi nouvelle qui permette aux fils de battre les pères à leur tour ? Nous vous faisons grâce de tous les coups que nous avons reçus depuis l’établissement de cette loi ; nous voulons bien avoir été battus gratis. Mais vois les coqs et les autres animaux : ils se défendent contre leurs pères, et cependant quelle différence y a-t-il entre eux et nous, si ce n’est qu’ils ne rédigent pas de décrets ? » C’étaient là les raisonnemens favoris des sophistes, il est vrai en d’autres sujets. Enfin le vieillard revient à résipiscence, et, reconnaissant que les sophistes sont des fripons, il court avec un esclave, une torche dans une main, une hache dans l’autre, à l’assaut de l’école de Socrate, qu’il veut démolir et brûler avec tous ses habitans.
On sait par l’affaire de Mélos quel chemin avaient fait ces doctrines, qui donnèrent là un de leurs fruits naturels : la théorie du droit du plus fort ; et l’historien se demande quel pouvait être le patriotisme de ces nouveau-venus qui, ne voyant dans le passé que d’inutiles vieilleries, mettaient leur raison individuelle, tout armée d’argumens spécieux, à la place de la raison collective de la cité, faite du souvenir des joies et des tristesses éprouvées en commun. Un d’entre eux n’a-t-il pas dit que la loi était un tyran, parce qu’elle est une gêne : opposition contre la loi civile qui mettait en péril la loi morale. Ni Lycurgue ni Solon ne parlaient ainsi, et l’on se souvient que Pindare appelait la loi « la reine et impératrice du monde. »
La Grèce avait vécu dix siècles sous un régime municipal qui avait fini par lui donner puissance, gloire et liberté, avec un patriotisme étroit, mais énergique, devant lequel le Mède avait reculé. Et voici des hommes qui minaient le respect dû à la loi, aux divinités poliades, aux croyances des aïeux. Ces nomades, errant de ville en ville, en quête d’un salaire, n’avaient plus de patrie, et ils en détruisaient l’amour dans le cœur de ceux qui en avaient une encore. Les tristes effets de cette révolution morale qui agrandit les idées, mais qui laisse les caractères fléchir à tout vent de passion, ne tarderont pas à se faire sentir : avant deux tiers de siècle, les habitans de ces villes naguère si vivantes ne seront plus que les mornes sujets de l’empire macédonien. Quand la religion part, qu’au moins la patrie reste !
Nous mettons à la charge de la sophistique assez de méfaits pour être obligé de faire aussi la part des services qu’elle a rendus en donnant une direction nouvelle aux méditations philosophiques. Les physiciens des écoles précédentes n’étaient occupés que du cosmos ; les sophistes firent une part à l’étude de l’homme, de ses facultés, de son langage. En aiguisant l’esprit, à force de subtilités, ils le préparèrent pour des travaux plus utiles, et ils commencèrent l’opposition féconde entre le droit traditionnel, qui consacrait souvent des iniquités, et le droit naturel, qui ne pouvait se trouver qu’au fond de la conscience. Ces services sont dus surtout aux premiers sophistes, qu’il faut séparer des vendeurs de paroles, leurs disciples dégénérés, parce qu’ils furent des philosophes et d’habiles dialecticiens que Socrate et Platon respectaient. Chez quelques-uns, on rencontrerait des pensées que n’auraient pas réprouvées les anciens sages. « Tous les animaux, disait Protagoras, ont leurs moyens de défense ; à l’homme, la nature a donné le sens du juste et l’horreur de l’injustice. Ce sont les armes qui le protègent, parce que ces dispositions naturelles l’aident à établir de bonnes institutions. » Elle est de Prodicus, la belle allégorie d’Hercule, sollicité, au moment d’entrer dans la vie active, par la Vertu et la Volupté, et se décidant à suivre la première. Lycophron déclare que la noblesse est un avantage imaginaire ; Alcidamas, que la nature ne fait pas des hommes libres et des hommes esclaves, thèse que les derniers stoïciens reprendront. A travers cette sophistique purifiée par Socrate, on entrevoit un monde nouveau qui s’élève. Ce que le citoyen va perdre, l’homme le gagnera, et la lutte entre le jus civitatis et le jus gentium que les écoles socratiques vont entreprendre sera l’histoire même des progrès de l’humanité.
Aristophane avait attaqué la sophistique avec une vigueur singulière, sans proposer d’autre remède que de fermer les écoles des philosophes et de reculer de trois générations en arrière. Mais lui-même n’a-t-il pas tous les vices de son temps, l’immoralité et l’irréligion ? Le remède véritable n’était pas l’ignorance des anciens jours ; on le pouvait trouver dans la science virile que venait d’inaugurer un homme, et cet homme était celui que je poète avait le plus cruellement attaqué.
 Re: Religion et Philosophie
Re: Religion et Philosophie
III
Socrate naquit, en 469, d’une sage-femme et d’un sculpteur appelé Sophronisque. Il était fort laid, ce qui l’aida à comprendre de bonne heure que la laideur morale seule est repoussante. On dit qu’il exerça d’abord la profession de son père, et Pausanias vit dans la citadelle d’Athènes un groupe représentant les Grâces voilées, qu’on lui attribuait. Quoiqu’il fût pauvre, il abandonna bientôt son art, que peut-être il ne pratiqua jamais, et il se mit à étudier les ouvrages et les systèmes des philosophes, ses contemporains ou ses prédécesseurs. Ces études spéculatives ne l’empêchèrent pas de remplir ceux des devoirs de citoyens dont la loi faisait une obligation : il combattit courageusement à Potidée, à Amphipolis et à Délion ; à Potidée, il sauva Alcibiade blessé ; à Délion, il résista un des derniers et manqua d’être pris. Les généraux disaient que, si tous avaient fait comme lui leur devoir, la bataille n’eût pas été perdue. Indifférent à ce que les hommes considèrent comme des biens nécessaires, il s’appliquait à n’avoir pas de besoins, afin d’être plus libre, vivait de peu, marchait, l’hiver et l’été, pieds nus, couvert d’un misérable manteau ; et la colère des puissans, la haine ou les applaudissemens de la multitude n’avaient pas plus d’effet sur son âme que le chaud ou le froid sur son corps. Siégeant parmi les juges des généraux vainqueurs aux Arginuses, il refusa de conformer son jugement aux passions de la foule. Quand tout pliait sous les trente tyrans, il osa leur désobéir plutôt que de faire une action injuste. Il vécut pauvre et refusa d’être riche ; Alcibiade lui offrait des terres, Charmide des esclaves, le roi de Macédoine, Archélaos, sa faveur ; il n’en voulut point.
Que fit donc cet homme de bien et ce citoyen courageux pour attirer sur lui tant de malveillance de la part de ses contemporains, tant d’admiration de la part de la postérité ?
Le voici. Socrate s’était imposé la tâche de dégager le sens moral autour duquel les sophistes avaient assemblé d’épais nuages. Au souffle énervant et destructeur de leurs doctrines, tout chancelait. L’esprit s’adorait lui-même dans ses plus dangereuses subtilités et étouffait sous un flot de paroles la voix du juge intérieur que la nature a mis en nous. Dans l’homme, les sophistes ne voyaient que ce qui est de l’individu ; Socrate y chercha ce qui est de la nature humaine. Il avait lu au fronton du temple de Delphes : « Connais-toi toi-même ; » ce fut pour lui la science par excellence. Démosthène aussi dira : « Les autels les plus saints sont dans l’âme ; » et le politique comme le philosophe avait raison. Car cette science de nous-même nous révèle les dons que l’humanité a reçus, avec l’obligation de s’en servir : l’intelligence, pour comprendre le bien et le vrai ; la liberté, pour choisir et prendre la route qui y conduit.
Séduit par la grandeur de cette tâche, Socrate se détourna des doctrines purement spéculatives, de la recherche des causes premières, de l’origine et des lois du monde, de la nature des élémens, etc., pour méditer sur nos devoirs. Il soutint que la nature avait mis à notre portée les connaissances de première nécessité, et qu’il n’y avait qu’à ouvrir notre âme pour y lire, en traits ineffaçables, les lois immuables du bon, du vrai, même du beau ; ces lois, qu’il appelait si bien, après Sophocle, lois non écrites, (grec), auxquelles est attachée une sanction inévitable par les maux que leur violation : entraine. En faisant ainsi de l’homme, au contraire de ses prédécesseurs, le centre de toutes les méditations, il créait la vraie philosophie, celle qui devait faire sortir au grand jour les trésors que-la conscience humaine renferme ; il trouvait enfin et élevait au-dessus des erreurs, des préjugés et des injustices de temps et de lieu, la loi naturelle, le seul flambeau humain qui puisse éclairer la route où les sociétés marchent. Montaigne dit très bien, après Cicéron : « Socrate avait ramené du ciel, où elle perdait son temps, la sagesse humaine pour la rendre à l’homme, ouest sa plus juste et plus laborieuse besogne. »
En révélant une justice supérieure ans lois spéciales à chaque état, Socrate montrait qu’il est, pour les sociétés, un idéal dont elles doivent se rapprocher ; mais il demeurait respectueux de l’ordre établi ; il proclamait la sainteté de la famille, et il trouvait pour la mère, pour l’épouse, des mots qui rappellent la femme forte de l’Écriture. Ses plus illustres élèves condamneront le travail manuel ; lui, il aura le courage de dire aux possesseurs d’esclaves : « Parce qu’on est libre, n’y a-t-il donc autre chose à faire que manger et dormir ? »
On a fait de Socrate un profond métaphysicien ; mais le créateur de la philosophie du bon sens ne pouvait l’emprisonner dans un système. On l’a aussi appelé un grand patriote, et l’on veut qu’il se soit proposé de changer les mœurs d’Athènes ; c’est un peu le rôle que Platon est prêt à lui donner. Nous croyons qu’il n’eut point de visées politiques si particulières et que son ambition était plus haute. Indiffèrent à toutes les choses du dehors, comme aucun Grec ne l’avait encore été, au point de n’être sorti volontairement d’Athènes qu’une fois ou deux, il s’occupa du dedans de l’homme et passa ses jours à regarder en lui-même et dans les autres. L’emploi de sa vie fut de gagner quelques âmes à la verte et à la vérité. Muni de deux armes puissantes : une claire et nette intelligence qui lui faisait découvrir l’erreur, une dialectique à la fois subtile et forte qui enlaçait l’adversaire de liens indissolubles, il se donna la mission de poursuivre partout le faux. Et cette mission, il la remplît, durant quarante années, avec la. foi d’un apôtre et le plaisir d’un artiste, se complaisant dans les victoires qu’il remportait sur la ; présomption ou l’ignorance. Ne lui arriva-t-il pas un jour
[ltr][4][/ltr]
d’amener Théodote, la belle hétaïre, à comprendre qu’il y avait pour elle des moyens de rendre sa profession plus lucrative ?
Cet enseignement de tous les instans et avec toutes gens n’était ni théorique ni. apprêté ; il avait lieu au jour le jour, en tous lieux, et selon l’erreur qui se montrait. Assidu sur la place publique, non pour prendre part aux affaires de l’état, il ne s’y mêlait qu’autant qu’il y était obligé par la loi, il épiait au passage toute fausse doctrine pour l’arrêter, la saisir et montrer ce qu’elle cachait, le néant. On voyait se promener par la ville cet homme disgracié de la nature, au nez camus, aux lèvres épaisses, le cou gros et court, le ventre proéminent comme celui d’un Silène, les yeux bombés et à fleur de tête, mais illuminés par le génie. Il allait ça et là, quelquefois distrait et absorbé dans des réflexions profondes, jusqu’à demeurer, dit-on, vingt-quatre heures à la même place
[ltr][5][/ltr]
; le plus souvent abordant l’un ou l’autre de ceux qui passaient, ou entrant dans les boutiques des artisans, et causant avec chacun du sujet qui lui était propre. Il dialoguait toujours. De quelque vérité simple, accordée tout de suite par ses interlocuteurs, il leur faisait tirer des conséquences imprévues et les conduisait invinciblement, sans paraître intervenir lui-même, à des notions dont ils ne s’étaient pas doutés. Sa méthode devint célèbre dans l’antiquité sous le nom d’ironie socratique ; elle apprenait à penser et à s’assurer que l’on pensait juste. Aussi s’appelait-il lui-même, en souvenir du métier de sa mère, l’accoucheur des esprits. Il amenait en effet l’artisan à concevoir, comme de lui-même, des idées plus élevées et plus rationnelles sur son art ; le politique, sur les affaires de l’état ; le sophiste, sur les questions qu’il agitait. Un grain de raillerie assaisonnait toujours ses conversations. Socrate ne se donnait que pour un homme en quête de la vérité, un chercheur, comme il disait ; il feignait d’abord d’avoir grande confiance dans le savoir de son adversaire et de vouloir s’instruire auprès de lui ; peu à peu, les rôles changeaient, et le plus souvent il le réduisait à l’absurde ou au silence. Chose singulière ! ses accusateurs, le peuple, et d’illustres Athéniens le confondirent avec les sophistes. Il se rapprochait d’eux, en effet, par certains procédés de discussion, mais ils n’eurent point de plus grand ennemi. Il se plaisait à les couvrir de confusion en présence de nombreux auditeurs ; car il n’allait jamais seul. A peine paraissait-il qu’un groupe se formait pour le voir pousser dans la controverse les malheureux dont il ruinait les prétentions et les systèmes. Une troupe le suivait toujours : pour la plupart, des jeunes gens que séduisaient son grand sens, sa parole facile et mordante ; ils formaient son école. Autre différence avec les sophistes : il demandait à ses disciples leur amitié, mais il refusait leur argent.
Socrate a eu pour historiens deux de ses élèves, Platon et Xénophon, l’un, philosophe de génie, qui a beaucoup ajouté, précisé, interprété ; l’autre, esprit d’une élévation ordinaire, nous fait entrer dans l’intimité du maître, mais ne se rend pas compte de l’importance de son rôle, et, par le désir de défendre sa mémoire contre l’accusation d’athéisme, il a été conduit à nous représenter un Socrate plus religieux qu’il ne l’était. Ses Mémoires sont une espèce d’évangile socratique : nous y voyons le sage dans son existence de chaque jour, dans cette vie de missionnaire du bon sens, éclairant chacun sur le beau, le bien, le juste, l’utile ; détournant des affaires publiques les jeunes ignorans qui s’y portaient avec une folle ambition, y poussant, au contraire, les hommes capables, qu’une trop grande défiance de leur mérite en détournait, tout en fuyant pour lui-même les charges et les dignités. Il travaillait partout à rétablir la concorde, réconciliait des amis, rapprochait des frères brouillés, et inspirait à son fils les sentimens du devoir à l’égard de cette Xanthippe, qui ne fut pour lui qu’une occasion continuelle de s’exercer à la patience
[ltr][6][/ltr]
. Cette partie active et militante de la vie de Socrate ne semble pas moins admirable que la partie spéculative.
Pour celle-ci, c’est à Platon qu’il faut recourir, car Xénophon ne montre que les côtés pratiques de la doctrine du maître. Il y avait eu, avant Socrate, bien des éclairs de bon sens, et l’esprit de justice, qui est au fond de notre nature, avait plus d’une fois percé au travers de la couche épaisse d’égoïsme dont il est enveloppé. Socrate fut le premier à faire de la morale une science pour donner à l’homme des règles de conduite qui ne dépendissent ni de la tradition ni de la coutume, choses variables et changeantes selon le temps et selon les lieux. Il chercha le roc où il fallait l’asseoir, et l’ayant trouvé dans la conscience, dans le sentiment de la dignité humaine, il y construisit, avec une méthode sévère, nos obligations morales. Pour lui le juste fut celui qui comprenait ce que nous impose la société de nos semblables ; le sage, celui qui savait éviter le mal et faire le bien, de sorte que toutes les vertus tenaient à une parfaite connaissance des choses et que la sagesse était de la science appliquée, par conséquent une vertu qui ne pouvait devenir que le partage de l’aristocratie intellectuelle
[ltr][7][/ltr]
. Vingt siècles avant Descartes, il émettait le principe cartésien qu’il n’y a pas d’ignorance plus honteuse que d’admettre pour vrai ce que l’on ignore, et qu’il n’est pas de bien comparable au plaisir d’être délivré d’une erreur. Ces paroles sont toujours vraies, et c’est ce que la démocratie véritable a compris quand elle a fait de l’instruction publique une des conditions essentielles de son existence.
Fût-ce une concession aux faiblesses du temps et un moyen de gagner plus d’adeptes, ou impuissance à s’élever vers un idéal supérieur, Socrate donna souvent pour but à la science l’utile. Bien qu’il ait dit : « On ne doit jamais commettre d’injustices, même à l’égard de ceux qui nous en font, ni rendre le mal pour le mal, » et tant d’autres généreuses paroles, sa morale se rapproche de l’intérêt bien entendu, lequel, d’ailleurs, n’est pas exclusif des idées de dévoûment et de sacrifice. En portant très haut le sentiment de la dignité de l’âme, en n’admettant pas que l’honnête homme puisse souffrir une tache sur sa conscience, Socrate jetait les bases du temple où les stoïciens établiront leur religion laïque, qui a eu tant d’illustres adeptes.
IV
Comment ce juste put-il être condamné au supplice des traîtres et des assassins ? Il y eut pour cette sentence trois chefs d’accusation : Socrate ne reconnaissait pas les dieux de la république ; il introduisait des divinités nouvelles ; et il corrompait la jeunesse.
Les religions, qui ont la prétention d’être immuables, changent comme toutes les créations des hommes et ne vivent qu’à cette condition. Ces changemens se font, d’un côté, par une lente infiltration d’idées étrangères ; de l’autre, par la révolte de certains esprits qui n’ont plus assez de confiance dans le surnaturel et cherchent à remplacer la croyance aux anciens dieux par une croyance nouvelle. Alors les mouvemens les plus contraires se produisent à la fois dans la même société : l’incrédulité règne en haut
[ltr][8][/ltr]
; en bas, une foi d’autant plus aveugle, et, chez les politiques, une adhésion tout extérieure au culte officiel conservé comme instrumentum regni. On va en même temps aux dernières limites du scepticisme on de la superstition, et surtout l’on va à l’indifférence religieuse. Ainsi, à Rome, en face de Lucrèce écrivant pour la jeune noblesse son poème audacieux, les cultes corrupteurs de l’Asie et de l’Egypte gagnent de proche en proche tous les bas-fonds de la cité. En France, les convulsionnaires sont contemporains de La Mettrie ; à Athènes, tandis qu’Alcibiade ou ses amis bafouent les mystères et qu’Aristophane enlève aux dieux le gouvernement de monde, bien des gens fatigués de leurs anciens protecteurs, qui ne les protègent plus, acceptent les divinités sensuelles que leur apportent les innombrables étrangers accourus des côtes d’Asie au Pirée : une déesse de la Thrace, Cotytto, un dieu phrygien, Sabazios, le Syrien Adonis, et Cybèle, « la Grande Mère, » dont les prêtres éhontés mendiaient par les rues ou pénétraient dans les maisons en y portant leur déesse sur une planchette ; ils expliquaient les songes, vendaient des amulettes et disputaient aux devins la curiosité de ceux qui, ne sachant plus où se prendre pour croire, s’attachaient aux charlatans religieux qui leur versaient l’ivresse du surnaturel. On délaissait les anciens rites : les uns, pour quelques idées élevées qu’ils pouvaient découvrir dans les cultes nouveaux, le plus grand nombre pour la licence des religions orgiastiques de l’Orient, les sortilèges de pieux jongleurs et les prétendues révélations des oracles orphiques.
De tout temps, le droit de s’associer avait existé à Athènes. A chaque divinité correspondait une confrérie qui accomplissait toutes les dévotions requises par son culte : les citoyens seuls pouvaient en faire partie, mais l’usage existait ; les étrangers s’en autorisèrent pour former des associations religieuses, thiases, éranes, orgéons, dans lesquelles furent admis des femmes, des ; affranchis, même des esclaves.
Au milieu de cette promiscuité fermentaient beaucoup d’industries malsaines et de débauches du corps et de l’esprit ; c’était un dissolvant actif pour la cité. Il existait bien une loi punissant de mort ceux qui introduisaient des divinités étrangères ; mais celles-ci se faisaient si modestes en arrivant et elles vivaient si longtemps dans l’ombre, que le monde officiel, ou les dédaignait, ou ne les connaissait pas. Et puis, pour l’exécution de la loi, il fallait qu’un citoyen se chargeât du rôle parfois dangereux d’accusateur. Mais sous le coup des malheurs publics, l’intolérance se réveilla. Les familles sacerdotales, par piété héréditaire et pour ne point perdre le crédit qu’elles devaient à leurs fonctions religieuses, s’entendirent, pour venger leurs dieux, avec le parti conservateur, que ces nouveautés effrayaient, et, malheureusement, la législation d’Athènes autorisait l’action publique d’impiété, (grec), et elle édictait pour le condamné la peine de mort, avec la confiscation des biens, même la privation de sépulture, ce qui était une seconde mort.
Avant la guerre, Anaxagore et Diogène d’Apollonie avaient été seuls frappés ; depuis la peste, les condamnations se multiplièrent. A Samothrace, Diagoras de Mélos avait échappé à la colère des Ga-bires ; à Athènes, il fut proscrit pour avoir divulgué les mystères des grandes déesses, et l’état promit un talent à qui le tuerait, deux à qui le livrerait à la justice. Un ami de Périclès, Protagoras, condamné pour athéisme, put s’enfuir, mais périt dans un naufrage, et ses livres furent brûlés sur la place publique. Son disciple, Prodicus de Céos, par sa belle allégorie d’Hercule au carrefour, mettait le bonheur dans la vertu et non dans les plaisirs ; mais les dieux étaient pour lui une création de l’homme qui avait divinisé les objets de sa terreur ou de sa reconnaissance ; Athènes le condamna à boire la ciguë. On se souvient de l’affaire des hermès, de l’anxiété profonde qu’elle jeta dans la ville, et du grand procès qu’elle amena. Or, Socrate heurtait de front cette intolérance.
Pour lui, il était deux sortes de connaissances : les unes que les hommes peuvent acquérir, les autres que les dieux se sont réservées, et cette séparation existe toujours, car aucun esprit libre n’a encore pénétré dans la région de l’inconnaissable. Mais toujours aussi on a fait sortir de ce domaine, réservé aux dieux, des révélations qu’ils envoient par leurs oracles, leurs prophètes ou leurs représentans sur la terre. Socrate, tout en méprisant, comme l’Hector d’Homère, les signes qu’on tirait du vol des oiseaux, croyait que l’on pouvait recourir aux oracles, à condition de ne les consulter que sur des choses inaccessibles à l’intelligence, telles que l’avenir qui est le secret des dieux, et cette réserve sauvait les droits de la raison, en laissant la sagesse humaine maîtresse d’interpréter les réponses obscures des prêtres à des questions qui étaient de son ressort. Il croyait aussi aux secrets avertissemens que la divinité suscite dans l’âme de ceux qu’elle favorise. Il pensait recevoir beaucoup de ces communications surnaturelles, et ces secrètes impulsions de son esprit lui paraissaient l’œuvre d’un démon qui l’arrêtait lorsqu’il était sur le point d’agir comme il ne le devait point faire. Dans ce démon que Socrate écoutait avec tant de docilité, nous ne verrons que les révélations inconscientes d’un sens moral développé parla plus constante application, et qui s’opéraient en lui sans qu’il sentit le travail instantané par lequel elles étaient produites.
Toutes les grandes religions ont promis des protecteurs surnaturels. Férouers de la Perse, bons génies de la Grèce, anges gardiens des nations chrétiennes, tous sont nés d’un même sentiment de piété et de poésie. Nous avons déjà entendu la voix démoniaque dans l’Iliade d’Homère et dans la Théogonie d’Hésiode ; nous l’avons retrouvée dans la vieille croyance qui donnait pour protecteurs aux vivans les morts purifiés par les rites funèbres. Les philosophes l’ont acceptée lorsque, pour masquer ou justifier des doctrines qu’on aurait pu accuser d’attentat à la religion nationale, ils investissaient les démons des fonctions qu’ils retiraient aux dieux. Les vers dorés, qui couraient partout, peuplaient l’air de ces hôtes du ciel et de la terre ; Pythagore avait enseigné que l’homme vertueux leur devait sa sagesse, et Platon, dans le Banquet, dans le Phédon, affirme ce que Ménandre répétera, que chacun a son démon familier. « Ces génies remplissent, dit-il, l’intervalle qui sépare le ciel de la terre et sont le lien du grand tout. La divinité n’entrant jamais en communication directe avec l’homme, c’est par l’intermédiaire des démons que les dieux s’entretiennent avec lui, pendant la veille ou durant le sommeil. » D’autres passages, épars dans ses livres, expliquent ce que, avec un peu de mysticisme et beaucoup de prudence, il enveloppait de voiles théologiques. « Il faut, disait-il, écouter la droite raison qui est la voix de Dieu nous parlant intérieurement. »
La foule matérialisait davantage la croyance aux démons, qui a toujours fait partie, avec plus ou moins d’intensité, de la vie morale des Hellènes. Aussi n’y avait-il rien dont on pût s’étonner à Athènes dans la prétention que Socrate avouait tout haut qu’il était en communication avec un démon. L’accusation qu’il s’attribuait un génie familier sera le prétexte jeté aux dévots et à la foule populaire ; mais en se combinant avec une autre, celle de ne pas reconnaître les dieux de la cité, elle deviendra très dangereuse. Athènes, ainsi que toute ville grecque, avait une religion d’état, de sorte que le crime d’impiété était un crime politique, et l’on a vu quelles peines il entraînait. Dans sa conduite de tous les jours, Socrate se gardait d’offenser le culte national. Il sacrifiait aux autels publics et dans sa maison ; il faisait aux oracles une part considérable pour les règles de la vie ; il croyait même quelque peu aux présages, sans penser que l’instinct de bêtes privées de raison fût une plus sûre garantie de la vérité que les discours inspirés par la muse philosophique. A ceux qui l’interrogeaient sur la manière d’honorer les dieux, il répondait : « Suivez les coutumes de votre pays
[ltr][9][/ltr]
; » et lui qui provoquait la discussion sur toute chose, il la fuyait sur ces questions. Un jour qu’on lui demanda ce qu’il pensait de la légende de Borée et d’Orithye, il répondit qu’il n’avait pas le temps de mettre d’accord et d’interpréter toutes ces histoires, sa principale affaire étant de s’étudier lui-même. « Je ne serais pas, dit-il, embarrassé de soutenir, en subtilisant, que le vent du nord a jeté Orithye sur les rochers voisins, pendant qu’elle jouait avec Pharmacée, ou qu’elle tomba du haut de l’Aréopage. Ces explications sont fort ingénieuses, mais elles demandent un habile homme, qui se donne beaucoup de peine, sans être après cela très avancé. Ne faudra-t-il pas ensuite expliquer les Hippocentaures, la Chimère, et je vois arriver à la suite les Pégases, les Gorgones et une foule de monstres bizarres ou effrayans. Je n’ai pas tant de loisir. J’en suis encore à me connaître moi-même, comme Apollon le conseille, et je trouve ridicule, dans cette ignorance de soi, de chercher à connaître ce qui est étranger. Je renonce donc à l’étude de toutes ces histoires, et je m’observe moi-même pour démêler si je suis un monstre plus compliqué que Typhon, ou un être plus doux et plus simple dont la nature « quelque chose de divin. » C’était la rupture avec l’ancienne Hellade qui, durant des siècles, avait bercé son imagination de poétiques légendes ; c’était, en même temps, l’avènement d’un esprit nouveau. Le Grec avait jusque-là regardé dans l’univers ; il va désormais regarder dans l’homme, et commencer une des grandes évolutions de l’humanité.
Cette abstention de polémique religieuse n’empêchait pourtant pas Socrate de suivre Anaxagore et de le dépasser. L’Orient et la Grèce n’avaient, sous mille formes, adoré que la nature. Le philosophe de Clazomène avait bien en la gloire de distinguer l’intelligence du monde physique, mais son cosmos n’était encore que de la matière subtilisée ; Socrate mit la philosophie sur la voie où elle devait trouver le dieu moral qui a été celui de l’Occident et de la civilisation, l’Être suprême, ordonnateur et conservateur de l’univers, n’agissant plus dans les affaires humaines, comme le fils de Saturne, selon le caprice de passions toutes terrestres. « Tant que votre esprit, disait-il un jour, est uni à votre corps, il le gouverne à son gré ; il faut donc aussi croire que la sagesse, qui vit dans tout ce qui existe, gouverne ce grand tout comme il lui plaît. Quoi ! votre vue peut s’étendre jusqu’à plusieurs stades, et l’œil de Dieu ne pourra tout embrasser ! Votre esprit peut en même temps s’occuper des événemens d’Athènes, de l’Egypte et de la Sicile, et l’esprit de Dieu ne pourra songer à tout en même temps ! .. Reconnaissez que telle est la grandeur de la divinité qu’elle voit tout d’un seul regard, qu’elle entend tout, est partout, qu’elle porte en même temps ses soins sur toutes les parties de l’univers. »
Malgré l’élévation de pensée que montre ce passage, il ne faudrait pas croire que Socrate ait eu une idée nette du dieu unique et personnel, ni même de la spiritualité et de l’immortalité de l’âme. Le grand dialecticien n’arrivait pas à un dogmatisme aussi précis ; et l’Apologie, le Phédon, qui révèlent ses espérances, montrent aussi ses incertitudes. Ce grand sage n’en sait pas plus que nous sur la mort. Dans le Phédon, par exemple, à côté d’affirmations qui semblent très décisives, on fit des phrases comme celles-ci, que Socrate prononça le jour de sa mort : « J’ai l’espoir de me réunir bientôt à des hommes vertueux, sans toutefois pouvoir l’affirmer entièrement ; mais pour y trouver des dieux amis de l’homme, c’est ce que je puis affirmer, s’il y a quelque chose en ce genre dont on puisse être sûr. — Affranchis de la folie du corps, nous converserons, je l’espère, avec des hommes libres comme nous, et nous connaîtrons par nous-mêmes l’essence des choses ; la vérité n’est que cela peut-être. — Est-il certain que l’âme soit immortelle ? Il me paraît qu’on peut l’assurer convenablement, et que la chose vaut la peine qu’on hasarde d’y croire. C’est un hasard qu’il est beau de courir. C’est une espérance dont il faut s’enchanter soi-même. » Ces incertitudes de Socrate touchant la vie future étaient en contradiction formelle avec la croyance populaire, et ces paroles prudentes s’accordaient avec sa philosophie de l’intérêt. Il espérait sans donner la démonstration de ses espérances : sage distinction entre la loi et la raison. Mais, en voyant tous ces doutes, on comprend que le grand adversaire des sophistes ait comme eux préparé les voies au scepticisme. Il avait beau, en effet, lorsqu’il parlait de la souveraine puissance, dire tantôt Dieu, les dieux, la divinité, même admettre sincèrement des dieux inférieurs, des génies, l’instinct populaire ne s’y trompait pas : dans un pareil système, il n’y avait point de place pour la théologie vulgaire, pour ces faiblesses, ces combats et ces vices des maîtres de l’Olympe, qui légitimaient les faiblesses et les vices de leurs adorateurs.
Que pensait-on aussi de ces paroles : « Ce qu’on entend habituellement par la sainteté n’est qu’un trafic entre l’homme et Dieu, et Dieu seul n’y gagne rien. Dis-moi, Eutyphron, de quelle utilité sont aux dieux nos offrandes et nos prières ? Les bienfaits que nous recevons d’eux sont manifestes ; tous nos biens viennent de leur libéralité. Mais à quoi peut leur servir ce que nous leur offrons. » Et encore : « Comment les dieux auraient-ils plus d’égard à nos offrandes qu’à notre âme ? S’il en était ainsi, les plus coupables pourraient se les rendre propices. Mais non, il n’y a de vraiment justes que ceux qui, en paroles et en actions, s’acquittent de ce qu’ils doivent aux dieux et aux hommes. » C’était la négation du culte national. On avait donc raison de l’accuser d’attaques contre le polythéisme ; mais était-ce là un crime ? Pour nous, assurément non ; pour ses contemporains, oui ; car ne pas avoir la foi de tout le monde équivaut toujours, pour les croyans, à n’en avoir aucune.
Il y avait un autre chef d’accusation, qui fut le plus puissant sur l’esprit des juges : Socrate, comme tous les philosophes de ce temps, n’aimait point la démocratie. On imputait à ses leçons l’immoralité et les crimes de quelques-uns de ses disciples, de ce Critias, le plus cruel des trente tyrans, qui soutenait que la religion était une invention des législateurs pour la police des cités ; de Charmide, un de ses collègues dans le sinistre comité ; de Théramène, un autre des Trente ; d’Alcibiade, qui fut deux fois traître à sa patrie. On lui reprochait d’avoir dit souvent « que c’était folie qu’une fève décidât du choix des chefs de la république, tandis qu’on ne tirait au sort ni un pilote ni un architecte. » — « Les rois et les chefs, disait-il encore, ne sont pas ceux qui portent le sceptre, que le sort ou l’élection de la multitude, que la violence ou la fraude ont favorisés, mais ceux qui sont habiles aux choses du gouvernement. « Il répétait ou on lui prête une autre parole, belle aussi au sens philosophique, mais qui blessait dans une ville où le patriotisme était surexcité par une lutte atroce : « Je ne suis pas d’Athènes, je suis du monde ; » et il enseignait à ses disciples que la grande affaire, pour chacun, était le perfectionnement moral de l’individu, non la préoccupation des intérêts publics. Les ports, les arsenaux, les fortifications, les tributs, lui fait dire Platon dans le Gorgias, tout cela n’est que frivolités. » Ce délaissement de l’activité sociale était l’abandon des idées qui, durant des siècles, avaient fait la vie de la cité, et qu’on retrouve dans les viriles paroles de celui qui fut le dernier Athénien. Pour Démosthène, « déserter le poste marqué par les aïeux est un crime qui mérite la note d’infamie. »
Quoique Socrate eût, en deux circonstances, désobéi aux Trente, il avait probablement été mis au nombre des Trois mille : autre grief aux yeux de ceux qui avaient renversé la tyrannie. On se souvenait de l’affaire des Hermès, où les sacrilèges envers les dieux avaient paru des conspirateurs contre la démocratie, et, parmi les modernes, ses plus zélés défenseurs reconnaissent qu’il y avait dans ses paroles trop peu de ménagement et de respect pour les lois de l’état.
Le tanneur Anytos, homme influent par sa fortune, zélé partisan de la démocratie, et persécuté naguère par les Trente, fut l’accusateur principal. Socrate l’avait blessé en détournant son fils de continuer l’industrie paternelle. Un mauvais poète, Mélétos, et le rhéteur Lycon aidèrent Anytos à soutenir l’affaire. Le tribunal fut celui des héliastes ; cinq cent cinquante-neuf membres étaient présens. Lysias, le plus grand orateur du temps, offrit à Socrate un plaidoyer ; il n’en voulut pas, et se défendit lui-même, avec la hauteur d’un homme qui n’avait nulle envie de marchander sa vie, ni de disputer aux accusateurs et aux infirmités ses soixante-dix ans. A l’accusation de ne pas croire aux dieux que révère la république, et d’introduire des divinités nouvelles, le sage répondit qu’il n’avait jamais cessé de révérer les dieux de la patrie, et de leur offrir des sacrifices dans sa maison et sur les autels publics ; qu’on l’avait entendu maintes fois conseiller à ses amis d’aller consulter les oracles ou d’interroger les augures. Mais quand il parla de son génie, il s’éleva dans l’assemblée des murmures tumultueux. On admettait bien la vague intervention des génies dans les affaires de ce monde : c’était la tradition. Mais on se révoltait à la pensée qu’un homme eût à son service un démon familier qui le guidât dans les actes de sa vie. Cette prétention d’être en communication permanente avec les dieux parut une impiété sacrilège, et, pour une démocratie échappée d’hier à l’oligarchie, la réclamation d’un privilège si contraire à l’égalité semblait ne pouvoir venir que d’un ami de ces grands qu’on venait de précipiter. Cinquante-quatre ans après la mort de Socrate, Eschine attribuait sa condamnation à ses opinions politiques.
Après avoir confessé avec complaisance la divinité qu’il se donnait pour guide, Socrate ajouta : « Je vais vous déplaire bien davantage, en vous rappelant que la Pythie m’a proclamé le plus juste et le plus sage des hommes. » Et, comme pour augmenter à plaisir l’irritation, en faisant l’éloge d’un Spartiate, il ajouta qu’Apollon avait placé Lycurgue bien plus haut encore. Quant au second chef, ses mœurs répondaient d’avance, et il somma les pères de ceux qu’il avait, disait-on, corrompus, de venir déposer contre lui. Il passa légèrement sur tout ce qui regardait la politique, et termina par le serment de désobéir, si on le renvoyait absous, à la condition de répudier la mission qu’il avait reçue au grand profit d’Athènes : celle de chercher pour lui-même et pour les autres la sagesse. « Il faut, dit-il, obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes ; » parole bien grave, qui autorise toutes les révoltes et rompt le lien social, lequel est fait de l’obéissance aux lois de la communauté. Qui, en effet, après ce grand exemple, ne serait pas tenté de se mettre au-dessus de tout droit, en vertu de révélations intérieures ? Évidemment, Socrate trouvait, comme le dit Xénophon, qu’en finissant ainsi, il mourait à propos. Deux cent quatre-vingt-une voix contre deux cent soixante-dix-huit le déclarèrent coupable ; que deux voix se fussent déplacées, et il était acquitté. Mais il n’avait pas convenu à celui qui avait élevé si haut la dignité morale de l’homme de s’abaisser aux moyens employés par les accusés ordinaires pour gagner leurs juges. Il voulait que sa mort fût la sanction de sa vie ; et, dans sa défense, c’était moins à ses juges qu’à la postérité qu’il avait parlé.
Il restait à statuer sur la peine ; Mélétos proposa la mort. Socrate dit : « Athéniens, pour m’être consacré tout entier au service de ma patrie, en travaillant sans relâche à rendre mes concitoyens vertueux, pour avoir négligé, dans cette vue, affaires domestiques, emplois, dignités, je me condamne à être nourri le reste de mes jours dans le Prytanée, aux dépens de la république. » Quatre-vingts juges, que tant de fierté blessa, se réunirent aux deux cent quatre-vingt-un et votèrent la mort.
Ses dernières paroles aux juges, d’après l’Apologie de Platon, montrent une sérénité que Caton d’Utique, avant de se tuer, cherchera pour lui-même dans le Phédon : « De deux choses l’une, dit-il, ou la mort est l’entier anéantissement, ou c’est le passage de l’âme dans un autre lieu. Si tout se détruit, la mort sera une nuit sans rêve et sans conscience de nous-mêmes ; nuit éternelle et heureuse. Si elle est un changement de séjour, quel bonheur d’y rencontrer ceux qu’on a connus et de s’entretenir avec les sages ! Mais il est temps de nous quitter, moi pour mourir, vous pour vivre. A qui de nous est réservé le meilleur sort ? C’est un secret pour tous, excepté pour le dieu. »
Il demeura trente jours en prison, sous la garde des Onze, en attendant le retour de la théorie envoyée à Délos ; car, pendant la durée de ce pèlerinage, les lois défendaient de faire mourir personne. Il passa ce temps à mettre en vers des fables d’Ésope, et surtout à s’entretenir avec ses amis des plus hautes pensées philosophiques, de l’immortalité de l’âme, de la vie future, meilleure que celle-ci. La veille du jour où le vaisseau sacré revint à Athènes, Criton, l’un de ses disciples, lui offrit les moyens de s’enfuir en Thessalie. Il les refusa, évoquant devant lui les lois de la patrie, et l’obligation morale, imposée à tout citoyen légalement condamné, de se soumettre au châtiment prononcé par les juges. Enfin, le dernier jour arriva. Socrate le consacra tout entier à l’entretien que Platon nous a conservé dans le Phédon. Au coucher du soleil, on lui apporta la ciguë ; il la but, ferme et serein, au milieu de ses amis éplorés ; le geôlier lui-même versait des larmes. Quand le froid de la mort eut envahi les jambes et commença à gagner les parties supérieures du corps, Socrate dit, avec ce demi-sourire qui trahit le scepticisme sans montrer le dédain : « Criton, nous devons un coq à Asclépios ; n’oublie pas d’acquitter cette dette. » Il voulait dire que cette mort le délivrait des maux de la vie et qu’il en fallait remercier le dieu guérisseur. Quelques instans après, un léger mouvement du corps annonça que l’âme venait de le quitter (mai ou juin 399).
Les disciples de Socrate, effrayés du coup dont l’intolérance religieuse venait de frapper leur maître, s’enfuirent à Mégare et en d’autres villes. Ils y portaient ses doctrines, qui rayonnèrent sur toutes les contrées où la race grecque habitait, et qui remuèrent, au témoignage d’un d’entre eux, jusqu’à la lourde intelligence des Béotiens. Variées, comme l’homme lui-même, dont l’étude est leur commun point de départ, ces doctrines donnèrent naissance à de nombreux systèmes. Toutes les écoles, tout le mouvement philosophique du monde, viennent de Socrate ; c’est le condamné du tanneur Anytos qui a fondé le second empire d’Athènes : celui de la pensée.
VICTOR DURUY.
[ltr]Aller ↑[/ltr]
Ainsi, au témoignage d’Isocrate (Contre Callimaque) furent volés au Parthénon le Gorgoneion et plusieurs bas-reliefs du casque, du bouclier et de la chaussure de Minerve. Démosthène, Contre Timocratès, 121, rappelle le vol des ailes d’or de la Victoire, et Pausanias, I, XXV, 7, et XIIX, 16, parle du grand vol de Lacharès, qui, au temps de Démétrius, fils d’Antigone, prit les boucliers d’or de l’architrave et tout l’or qui pouvait encore être enleva de la statue de Minerve. On sait ce qui est raconté, à tort ou à raison, de Denys l’ancien, pillant le temple de Proserpine et volant à Esculape sa barbe d’or, à Jupiter son manteau d’or, trop chaud pour l’été, trop froid pour l’hiver. »
[ltr]Aller ↑[/ltr]
Voyez, dans la Revue du 1er octobre 1886, l’étude sur Euripide.
[ltr]Aller ↑[/ltr]
Voir dans les Oiseaux, vers 467 et saiv., la parodie de la théogonie orphique.
[ltr]Aller ↑[/ltr]
Xénophon, Mémoires, III, 11. Socrate parle souvent de l’amitié et d’Éros, mais « le véritable amour, déclare-t-il, est celui où l’on cherche d’une manière désintéressée le plus grand bien de la personne aimée, et non celui où un égoïsme sans scrupules poursuit des ans et emploie des moyens qui inspirent aux deux amis du mépris l’un pour l’autre. » E. Zeller, la Philosophie des Grecs, II, p. 153.
[ltr]Aller ↑[/ltr]
Exagération légendaire qui sert à marquer que souvent il restait plongé dans ses réflexions jusqu’à en oublier le monde extérieur.
[ltr]Aller ↑[/ltr]
Il est possible que Xanthippe ait été calomniée. — Socrate s’était marié non par amour, mais pour accomplir le devoir social imposé à tout citoyen d’Athènes, celui d’avoir des enfans légitimes. Sa femme, chargée des soins du ménage, désirait, comme toutes les mères de famille, voir l’aisance entrer dans la maison, au moins pour ses enfans, et Socrate voulut toujours rester pauvre. Cette misère volontaire, cette vie en apparence inoccupée, n’étaient pas pour adoucir un caractère naturellement difficile. Socrate a été un des hommes qui ont le plus honoré l’humanité, mais il n’a certainement pas été un bon mari, au sens que nous donnons à ce mot, ni même à certains égards comme on le comprenait à Athènes, où la loi et la coutume imposaient à tout citoyen l’obligation de travailler. Lui-même reconnaissait la justice de cette loi, puisqu’il recommande le travail manuel, mais il n’y obéit pas. Il est d’autres reproches qu’on pourrait lui adresser, et qui montreraient combien il était un étranger dans Athènes, un nouveau-venu dans le monde grec ; j’aime mieux laisser ce soin à Zeller, t. III, p. 75-76.
[ltr]Aller ↑[/ltr]
La doctrine socratique aboutissait à cette proposition : la vertu c’est la science ; doctrine au fond très aristocratique, puisque la science n’est le partage que du petit nombre, et, par conséquent, en formelle opposition avec les principes de la constitution athénienne. Si jamais Socrate ne viola ni ne conseilla de violer la loi, il en attaqua sans cesse l’esprit. Même on a cru pouvoir dire qu’il s’irritait de l’égalité entre les citoyens, de la douceur des rapports entre le père et le fils, le mari et la femme, les Athéniens et les étrangers, les maîtres et les esclaves, toutes choses qui ont valu notre sympathie à la législation de Solon, et à Athènes le caractère particulier de son histoire.
[ltr]Aller ↑[/ltr]
Ce mouvement avait commencé depuis deux ou trois générations. Hécatée de Milet trouvait (vers 500) beaucoup de fables ridicules dans la légende et en interprétait d’autres à un point de vue rationaliste. Cerbère devenait un serpent qui habitait une caverne du cap Ténare ; Géryon, un roi d’Épire, riche en troupeaux. Thucydide ne croit pas à la race des héros distincte de celle des hommes qu’Hérodote admettait encore, et s’efforce de ramener les faits de l’âge mythique à la réalité historique, en les dépouillant de tout merveilleux.
[ltr]Aller ↑[/ltr]
Xénophon, Banquet, IV, 3, Platon aussi répète fréquemment, dans la République et dans les Lois, qu’il faut laisser aux dieux le soin de régler par leurs oracles tout ce qui concerne le culte. Dans l’Epinomis ce grand révolutionnaire écrit encore que le législateur ne doit pas changer les sacrifices établis par la tradition, attendu qu’il ne sait rien de ces choses, aucun mortel n’étant capable de les connaître. « C’est Apollon, dit-il ailleurs, qui a établi le culte rendu aux dieux, aux démons et aux héros. Assis sur l’Omphalos, au centre de la terre, il est, pour les hommes, l’interprète de toutes ces questions, a Ce qui ne l’empêchait pas d’écrire au IVe livre des Lois : « Les cérémonies religieuses n’ont de vertu qu’autant que le participant a la conscience pure.
 Re: Religion et Philosophie
Re: Religion et Philosophie
Les Sectes – Philosophie – Religion
Le mot secte a d’abord désigné soit un ensemble d’individus partageant une même doctrine philosophique, religieuse, etc.
soit un groupe plus ou moins important de fidèles qui se sont détachés de l’enseignement officiel d’une Église et qui ont créé leur propre doctrine.
Une secte peut aussi désigner une branche d’une religion, une école particulière.
En ce sens, ce mot n’a rien de péjoratif.
Cependant, ce terme a pris une dimension polémique, et désigne de nos jours un groupe ou une organisation, le plus souvent à connotation religieuse, dont les croyances ou le comportement sont jugés obscurs ou malveillants par le reste de la société.
Généralement, les responsables de ces groupes sont accusés d’une part de brimer les libertés individuelles au sein du groupe ou de manipuler mentalement leurs disciples, afin de s’approprier leurs biens et de les maintenir sous contrôle, et d’autre part d’être une menace pour l’ordre social.

Cette connotation négative de « secte » est récusée par la plupart des groupes visés, ainsi que par certains juristes et sociologues.
Pour dénoncer des activités éventuellement néfastes de certains groupes, l’expression dérive sectaire est devenue récemment la formule officielle de certaines structures gouvernementales comme la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les
dérives sectaires (Miviludes) en France.
Enfin, le mot « sectaire » est passé dans le langage courant et désigne une personne fermée à toute discussion, prompte à rejeter autrui, à le mépriser et à le catégoriser.

Dans le christianisme :
À l’origine, la chrétienté commença comme secte juive.
Divers mouvements récents issus d’un Réveil religieux sont parfois considérés, du fait de leurs position radicales et de leur petit nombre d’adeptes, comme des sectes par les autres mouvements chrétiens et protestants.
Secte et Religion :
La plus grande partie des polémiques autour du terme secte ont leur source dans le fait que ce terme recouvre plusieurs définitions et opinions. On peut observer, suivant les personnes et groupes qui l’utilisent :
Le sens étymologique et sens premier : une branche, le plus souvent dissidente, d’une religion installée.
Le sens positif déclaré par les nouveaux mouvements religieux : groupe d’individus libres exerçant ensemble une activité dans un champ religieux ou spirituel (puisqu’il existe des champs spirituels non religieux, ces champs s’intéressant aux pouvoirs de l’esprit), comme d’autres s’associent dans un domaine artistique, avec son système de croyances ou sa philosophie originale, plus ou moins perfectionné et des adeptes, apparemment, non manipulés mentalement.
Le sens négatif « fort » : toute organisation, y compris les sociétés secrètes, ayant été condamnée pour préjudices envers ses adeptes, manipulés mentalement, ou ayant subi d’autres contraintes.
Le sens négatif « étendu » : toute organisation soupçonnée d’exercer une manipulation mentale sur ses adeptes afin de les exploiter.

Les « 7 mystiques », une ancienne société secrète aux États-Unis
Les deux sens à connotation négative ont été adoptés par les médias et ensuite par la population.
Les militants antireligieux auront tendance à minimiser toute différence entre le terme secte et le terme religion (ou spiritualité) et emploieront parfois le sens négatif étendu.
Les membres ou défenseurs des grandes religions auront, pour certains, tendance à adopter le sens négatif fort, afin de désigner par secte tous les mouvements qu’ils jugent dangereux (et seulement ceux-là) et, pour d’autres, appliqueront de manière générale le sens de nouveau mouvement religieux, plus valorisant pour eux.
Hors du cadre des religions, les défenseurs des libertés spirituelles ont choisi également de le limiter au sens négatif fort à partir de critères objectifs (jugements des tribunaux par exemple), afin d’éviter que la dénomination secte n’entraîne une méfiance injustifiée vis-à-vis de groupes religieux ou philosophiques qui ne pratiquent apparemment pas la manipulation mentale, pas plus, au demeurant, que dans n’importe quel groupement humain.
L’appellation de secte au sens négatif « étendu », est fondée sur la notion de manipulation mentale, difficile à identifier et, plus particulièrement, à distinguer de l’endoctrinement « religieux ».
Selon l’historienne belge Anne Morelli, les grandes religions présentent des caractéristiques qui peuvent laisser penser qu’elles ne diffèrent pas essentiellement des mouvements sectaires.

D’autres auteurs apportent un point de vue différent, en considérant que les « grandes religions » ne peuvent être assimilées aux sectes, en tout ou en partie, parce qu’elles sont reconnues, admises et intégrées à la société.
Toujours selon Anne Morelli, c’est le label décerné par le gouvernement du pays qui les héberge qui donnerait aux groupes religieux la qualification de secte ou non.
Par ailleurs, des communautés appartenant à des religions installées sont également considérées comme des « sectes » (au sens péjoratif du terme) par les mouvements antisectes, ainsi que par les médias comme la Communauté Saint Jean chez les catholiques.
Les Sectes de nos jours
Dans la seconde moitié du XXe siècle apparaissent de nouveaux mouvements (appelés nouveaux mouvements religieux par certains sociologues) qui ne correspondent plus à la typologie classique de Weber et Troeltsch.
Comme causes possibles de leur émergence, on cite la baisse de fréquentation des religions traditionnelles, le désenchantement du monde, et l’effondrement d’idéologies comme le communisme, qui amènent à une perte de valeurs et de repères.
Par ailleurs, certains sociologues et théologiens estiment que le phénomène de mondialisation a permis l’apparition d’un véritable « supermarché du religieux » où le choix des croyances est plus vaste.
Secte Mondial qui regroupe plusieurs sectes en une °°
Dans les années 1980, suite à des scandales qui ont alarmé l’opinion publique, tels que suicides collectifs, affaires politico-financières, polygamie, sorcellerie, ou exercice illégal de la médecine, le terme « secte », utilisé pour désigner certains de ces mouvements, a pris une forte connotation péjorative, devenant synonyme de groupe totalitaire et dangereux, ou en tous cas, de système aliénant et forçant ses adeptes à se placer en position de rupture avec la société et ses normes.
Récemment, certains de ces mouvements investissent le créneau du développement personnel et de la psychothérapie. La Miviludes, dans son rapport de 2009 tire la sonnette d’alarme sur les psychothérapeutes sectaires et a contribué en France à la régulation de la profession en juillet 2010.
Regarder aussi :
– la-franc-maconnerie/
– le-bohemian-club/
– le-ku-klux-klan/
– les-rosicruciens/
– lordi-templi-orientis/
– les-mormons-theologie/
– les-skull-and-bones/

Le mot secte a d’abord désigné soit un ensemble d’individus partageant une même doctrine philosophique, religieuse, etc.
soit un groupe plus ou moins important de fidèles qui se sont détachés de l’enseignement officiel d’une Église et qui ont créé leur propre doctrine.
Une secte peut aussi désigner une branche d’une religion, une école particulière.
En ce sens, ce mot n’a rien de péjoratif.
Cependant, ce terme a pris une dimension polémique, et désigne de nos jours un groupe ou une organisation, le plus souvent à connotation religieuse, dont les croyances ou le comportement sont jugés obscurs ou malveillants par le reste de la société.
Généralement, les responsables de ces groupes sont accusés d’une part de brimer les libertés individuelles au sein du groupe ou de manipuler mentalement leurs disciples, afin de s’approprier leurs biens et de les maintenir sous contrôle, et d’autre part d’être une menace pour l’ordre social.

Cette connotation négative de « secte » est récusée par la plupart des groupes visés, ainsi que par certains juristes et sociologues.
Pour dénoncer des activités éventuellement néfastes de certains groupes, l’expression dérive sectaire est devenue récemment la formule officielle de certaines structures gouvernementales comme la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les

dérives sectaires (Miviludes) en France.
Enfin, le mot « sectaire » est passé dans le langage courant et désigne une personne fermée à toute discussion, prompte à rejeter autrui, à le mépriser et à le catégoriser.

Dans le christianisme :
À l’origine, la chrétienté commença comme secte juive.
Divers mouvements récents issus d’un Réveil religieux sont parfois considérés, du fait de leurs position radicales et de leur petit nombre d’adeptes, comme des sectes par les autres mouvements chrétiens et protestants.
Secte et Religion :
La plus grande partie des polémiques autour du terme secte ont leur source dans le fait que ce terme recouvre plusieurs définitions et opinions. On peut observer, suivant les personnes et groupes qui l’utilisent :
Le sens étymologique et sens premier : une branche, le plus souvent dissidente, d’une religion installée.
Le sens positif déclaré par les nouveaux mouvements religieux : groupe d’individus libres exerçant ensemble une activité dans un champ religieux ou spirituel (puisqu’il existe des champs spirituels non religieux, ces champs s’intéressant aux pouvoirs de l’esprit), comme d’autres s’associent dans un domaine artistique, avec son système de croyances ou sa philosophie originale, plus ou moins perfectionné et des adeptes, apparemment, non manipulés mentalement.
Le sens négatif « fort » : toute organisation, y compris les sociétés secrètes, ayant été condamnée pour préjudices envers ses adeptes, manipulés mentalement, ou ayant subi d’autres contraintes.
Le sens négatif « étendu » : toute organisation soupçonnée d’exercer une manipulation mentale sur ses adeptes afin de les exploiter.

Les « 7 mystiques », une ancienne société secrète aux États-Unis
Les deux sens à connotation négative ont été adoptés par les médias et ensuite par la population.
Les militants antireligieux auront tendance à minimiser toute différence entre le terme secte et le terme religion (ou spiritualité) et emploieront parfois le sens négatif étendu.
Les membres ou défenseurs des grandes religions auront, pour certains, tendance à adopter le sens négatif fort, afin de désigner par secte tous les mouvements qu’ils jugent dangereux (et seulement ceux-là) et, pour d’autres, appliqueront de manière générale le sens de nouveau mouvement religieux, plus valorisant pour eux.
Hors du cadre des religions, les défenseurs des libertés spirituelles ont choisi également de le limiter au sens négatif fort à partir de critères objectifs (jugements des tribunaux par exemple), afin d’éviter que la dénomination secte n’entraîne une méfiance injustifiée vis-à-vis de groupes religieux ou philosophiques qui ne pratiquent apparemment pas la manipulation mentale, pas plus, au demeurant, que dans n’importe quel groupement humain.
L’appellation de secte au sens négatif « étendu », est fondée sur la notion de manipulation mentale, difficile à identifier et, plus particulièrement, à distinguer de l’endoctrinement « religieux ».
Selon l’historienne belge Anne Morelli, les grandes religions présentent des caractéristiques qui peuvent laisser penser qu’elles ne diffèrent pas essentiellement des mouvements sectaires.

D’autres auteurs apportent un point de vue différent, en considérant que les « grandes religions » ne peuvent être assimilées aux sectes, en tout ou en partie, parce qu’elles sont reconnues, admises et intégrées à la société.
Toujours selon Anne Morelli, c’est le label décerné par le gouvernement du pays qui les héberge qui donnerait aux groupes religieux la qualification de secte ou non.
Par ailleurs, des communautés appartenant à des religions installées sont également considérées comme des « sectes » (au sens péjoratif du terme) par les mouvements antisectes, ainsi que par les médias comme la Communauté Saint Jean chez les catholiques.
Les Sectes de nos jours
Dans la seconde moitié du XXe siècle apparaissent de nouveaux mouvements (appelés nouveaux mouvements religieux par certains sociologues) qui ne correspondent plus à la typologie classique de Weber et Troeltsch.
Comme causes possibles de leur émergence, on cite la baisse de fréquentation des religions traditionnelles, le désenchantement du monde, et l’effondrement d’idéologies comme le communisme, qui amènent à une perte de valeurs et de repères.
Par ailleurs, certains sociologues et théologiens estiment que le phénomène de mondialisation a permis l’apparition d’un véritable « supermarché du religieux » où le choix des croyances est plus vaste.
Secte Mondial qui regroupe plusieurs sectes en une °°
Dans les années 1980, suite à des scandales qui ont alarmé l’opinion publique, tels que suicides collectifs, affaires politico-financières, polygamie, sorcellerie, ou exercice illégal de la médecine, le terme « secte », utilisé pour désigner certains de ces mouvements, a pris une forte connotation péjorative, devenant synonyme de groupe totalitaire et dangereux, ou en tous cas, de système aliénant et forçant ses adeptes à se placer en position de rupture avec la société et ses normes.
Récemment, certains de ces mouvements investissent le créneau du développement personnel et de la psychothérapie. La Miviludes, dans son rapport de 2009 tire la sonnette d’alarme sur les psychothérapeutes sectaires et a contribué en France à la régulation de la profession en juillet 2010.
Regarder aussi :
– la-franc-maconnerie/
– le-bohemian-club/
– le-ku-klux-klan/
– les-rosicruciens/
– lordi-templi-orientis/
– les-mormons-theologie/
– les-skull-and-bones/

 Re: Religion et Philosophie
Re: Religion et Philosophie
Russell, logique et réalité
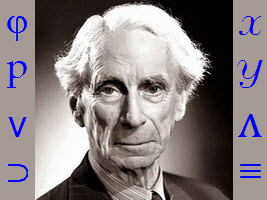 Aucune absurdité logique ne résulte de l'hypothèse que le monde se résume à moi-même, mes pensées, sentiments et sensations, et que le reste n'est qu'illusion. [Mais] un principe général de simplicité nous conduit à adopter la solution naturelle d'objets réels, distincts de nous et de nos sense-data, et dont l'existence ne dépend pas du fait que nous les percevions.
Aucune absurdité logique ne résulte de l'hypothèse que le monde se résume à moi-même, mes pensées, sentiments et sensations, et que le reste n'est qu'illusion. [Mais] un principe général de simplicité nous conduit à adopter la solution naturelle d'objets réels, distincts de nous et de nos sense-data, et dont l'existence ne dépend pas du fait que nous les percevions.
Bertrand Russell, Problèmes de philosophie, 1912
Tout philosophe nous fait un cadeau « empoisonné ». Il permet de voir le monde d'un oeil nouveau, original ; il ouvre notre vision sur une réalité autrement inaccessible à l'esprit. Mais l'univers fantastique qu'il nous offre comporte une limite hors de laquelle cette vision s'effondre ; touchez le boulon sensible et la structure s'écroule. On reconnaît l'honnêteté d'un philosophe lorsqu'il nous donne les clefs de la prison où il nous enferme. La plupart s'aveuglent sur cette limite ; il se battent bec et ongles pour partager leurs conceptions de telle sorte qu'ils s'ensorcellent eux-mêmes en pensant que, hors de leur vision, celle des autres est de piètre valeur. Si Russell n'y échappe pas, il a cependant l'honnêteté intellectuelle de ne pas s'aveugler ; il reconnaît que son approche de la réalité n'est basée que sur un principe général de simplicité ; rien d'autre [2]. C'est pourquoi il gagne mon estime. Mais avant de s'en détourner, pensant que cette illusion ne vaut pas mieux qu'une autre, examinons la grandiose cathédrale dans laquelle il nous enferme.
Le monde de Bertrand Russell est fait de Vérité. Chez lui cette notion ne s'oppose pas au mensonge ; simplement au Faux. Ainsi se définit la logique ; rien de plus. Notre philosophe aime tant la vérité, qu'il a établi que les mathématiques et le langage en général peuvent se réduire à une simple question de logique. Qu'est-ce à dire ? En fait, la logique c'est très simple. Il s'agit d'examiner n'importe quelle proposition et de juger si elle est vraie ou fausse sous l'optique de comparateurs. Et comme tout ce qui est affirmé — sous quelque forme que ce soit — est une proposition, tout est sujet à jugement ; on peut ainsi séparer le vrai du faux. Il ne s'agit pas de savoir si la chose que vous avez en main est bonne, mauvaise, utile, ou que sais-je encore. Cette chose est absolue ; elle existe, ne serait-ce que dans votre seule imagination. Ce qui nous intéresse c'est de la comparer. Ceci est-il plus grand que cela ? égal, équivalent, plus petit que, etc. ? Toute comparaison amène une conclusion simple : oui, non ; vrai, faux. Et dans telle condition (« si... , alors ») c'est vrai, dans telle autre, faux.
En travaillant sur les fondements de la pensée logique, Russell nous a donné un outil symbolique pour comprendre le monde d'une façon archisimple. Si simple que n'importe quelle machine construite avec les seuls concepts vrai et faux ; oui, non ; 0, 1, suffit à tout symboliser. L'ordinateur n'est pas une machine à calculer complexe ; c'est un assemblage complexe d'une multitude d'opérateurs logiques simples.
La pensée rationnelle comporte trois lois formulées dans l'Antiquité par Parménide. Elles sont si simples et familières qu'elles semblent ridicules : [3]
1. La loi d'identité : « Tout ce qui est, est. »
(Ex. : Une pomme est une pomme ; elle n'est pas une poire.)
2. La loi de non-contradiction : « Rien à la fois est et n'est pas. »
(Ex. : Une pomme n'est pas une « non-pomme ».)
3. La loi du tiers exclu : « Toute chose est ou n'est pas. »
(Ex. : Ou bien il y a une pomme ou bien il n'y en a pas.)
En fait, elles constituent à elles trois l'atome de la pensée rationnelle. En langage d'ordinateur on dirait : Il existe 1 ou 0. C'est une pensée binaire, dualiste, comme le taoïsme.
Mais là où la cathédrale Russell devient fascinante, c'est qu'en creusant la logique formelle, il s'est aperçu que Berkeley avait raison. Il reconnaît que rien ne prouve que le monde existe matériellement ; la matière, telle que nous la concevons, n'est peut-être pas matérielle ; logiquement, tout pourrait n'être qu'illusion et rien ne serait différent. Comment ça ? Eh bien le monde ne nous est accessible que par les données de nos sens (sense-data) qui fournissent à notre esprit des informations qui ne subsistent nulle part ailleurs. Ces données sont essentiellement privées. Personne d'autre ne peut y avoir directement accès. Pour que le monde existe tel que nous le concevons — pour que cette conception devienne réalité — il faut au moins deux esprits : un pour le percevoir et un autre pour le vérifier. C'est cette « vérification » qui lui confère sa « réalité ». Par exemple, je vois une pomme. Est-ce que vous la voyez aussi ? Oui ! Alors elle est réelle. Chacun pour soi notre esprit est le seul dépositaire d'une réalité privée. L'autre ne perçoit aucune de mes sensations ; elles sont personnelles. Ce que nous pensons être réel n'est finalement que l'idée que chacun se fait de la réalité dans son propre esprit.
Mais alors, est-ce à dire que le monde n'est qu'illusion ? Pas tout à fait, et c'est là le génie de Russell. Il a vu que la seule réalité qui existe est publique. Qu'est-ce à dire ? Ce que nous percevons comme la matière n'est pas réel puisque chacun la perçoit individuellement et n'a aucun moyen direct de vérifier si ses perceptions sont valables chez les autres. Chacun est prisonnier de ses perceptions, emprisonné dans un corps et sujet aux caprices de ses propres sens. Seule la comparaison avec ce que les autres nous disent de leurs perceptions nous permet d'établir la réalité. Et la valeur de cette réalité dépend du nombre d'individus qui y participent. Plus nombreux sont ceux qui témoignent d'une perception, plus elle a de valeur et plus elle est réelle. C'est pourquoi la réalité est publique et non privée. Personne ne détient la vérité sur la réalité, celle-ci doit faire l'objet d'un consensus. C'est aussi pourquoi, toujours inquiets de ce qui nous arrive, nous vérifions sans cesse avec les autres la validité de nos perceptions. As-tu vu ceci ? As-tu entendu cela ? Vérifier nos perceptions, c'est accéder à la réalité ; voilà le test d'une certitude toute relative.
Par moi-même, je ne suis qu'une boule de sensations irrationnelles, émotionnelles. Les autres — le public — viennent confirmer la réalité du monde. Deux personnes suffisent à créer une réalité publique si elles arrivent à s'entendre — à avoir le même avis sur leurs perceptions privées. Mais cette réalité est bien faible ; un rien l'altère. Un seul avis contraire fragilise la réalité de deux individus. Plus nombreuses sont les personnes à accorder leur consentement sur l'interprétation de leurs perceptions individuelles, plus la réalité est réelle. L'idée que l'on se fait de la réalité sensorielle — nos sense-data — produit alors des conceptions purement intellectuelles ; c'est ce que l'on appelle la réalité culturelle.
Mais alors que devons-nous penser d'une personne qui sait une chose vraie alors que le consensus lui donne tort ? Par exemple, la personne condamnée pour un méfait qu'elle n'a pas commis sait qu'elle a raison ; ou encore, le chercheur qui, comme Copernic, fait la démonstration d'une vérité scientifique alors que la majorité des gens pense autrement. La réalité est en bout de compte une construction issue d'un consensus culturel malléable. Chacun connaît ses raisons — chacun sait qu'il a raison — mais doit aussi trouver sa place dans la réalité consensuelle. Aussi bien dire que chacun doit trouver son équilibre entre deux types de réalité : la privée et la publique. La réalité est flexible et prend la forme de nos croyances alors que la raison exige la juste explication des données perçues par nos sens. On voit donc que raison et réalité sont en lutte permanente. Mais raison et réalité prennent toujours appui quelque part sur la foi ; il s'agit de trouver ce en quoi on veut croire pour trouver comment on accorde raison et réalité.
Le sense-data est privé, mais le réel est public.
Cette vision ouverte par Russell nous entraîne dans un vertige terrible. D'une part, elle nous enferme dans une solitude insupportable — le monde auquel me donnent accès mes sens est personnel et incommunicable — d'autre part, elle abandonne aux autres le monopole de la réalité. Je sens, je vois, j'entends, mais ce sont les autres qui décident de ma réalité lorsque vient le moment de l'exprimer par le langage qui est toujours le langage des autres. Rien d'étonnant que l'on soit tenté de se réfugier dans l'idée que notre propre petit monde intérieur est la seule vérité absolue, et surtout de le réduire à la minuscule dimension du « sens commun ». Déjà Kant avait vu que nous voyons le monde tel que nous sommes, et non pas tel qu'il est. Russell montre qu'il ne nous appartient pas de juger de ce qui est réel puisque la réalité est un concept public.
.
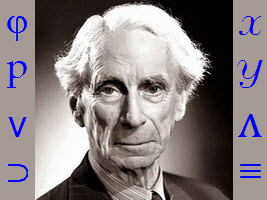 Aucune absurdité logique ne résulte de l'hypothèse que le monde se résume à moi-même, mes pensées, sentiments et sensations, et que le reste n'est qu'illusion. [Mais] un principe général de simplicité nous conduit à adopter la solution naturelle d'objets réels, distincts de nous et de nos sense-data, et dont l'existence ne dépend pas du fait que nous les percevions.
Aucune absurdité logique ne résulte de l'hypothèse que le monde se résume à moi-même, mes pensées, sentiments et sensations, et que le reste n'est qu'illusion. [Mais] un principe général de simplicité nous conduit à adopter la solution naturelle d'objets réels, distincts de nous et de nos sense-data, et dont l'existence ne dépend pas du fait que nous les percevions.Bertrand Russell, Problèmes de philosophie, 1912
Tout philosophe nous fait un cadeau « empoisonné ». Il permet de voir le monde d'un oeil nouveau, original ; il ouvre notre vision sur une réalité autrement inaccessible à l'esprit. Mais l'univers fantastique qu'il nous offre comporte une limite hors de laquelle cette vision s'effondre ; touchez le boulon sensible et la structure s'écroule. On reconnaît l'honnêteté d'un philosophe lorsqu'il nous donne les clefs de la prison où il nous enferme. La plupart s'aveuglent sur cette limite ; il se battent bec et ongles pour partager leurs conceptions de telle sorte qu'ils s'ensorcellent eux-mêmes en pensant que, hors de leur vision, celle des autres est de piètre valeur. Si Russell n'y échappe pas, il a cependant l'honnêteté intellectuelle de ne pas s'aveugler ; il reconnaît que son approche de la réalité n'est basée que sur un principe général de simplicité ; rien d'autre [2]. C'est pourquoi il gagne mon estime. Mais avant de s'en détourner, pensant que cette illusion ne vaut pas mieux qu'une autre, examinons la grandiose cathédrale dans laquelle il nous enferme.
Le monde de Bertrand Russell est fait de Vérité. Chez lui cette notion ne s'oppose pas au mensonge ; simplement au Faux. Ainsi se définit la logique ; rien de plus. Notre philosophe aime tant la vérité, qu'il a établi que les mathématiques et le langage en général peuvent se réduire à une simple question de logique. Qu'est-ce à dire ? En fait, la logique c'est très simple. Il s'agit d'examiner n'importe quelle proposition et de juger si elle est vraie ou fausse sous l'optique de comparateurs. Et comme tout ce qui est affirmé — sous quelque forme que ce soit — est une proposition, tout est sujet à jugement ; on peut ainsi séparer le vrai du faux. Il ne s'agit pas de savoir si la chose que vous avez en main est bonne, mauvaise, utile, ou que sais-je encore. Cette chose est absolue ; elle existe, ne serait-ce que dans votre seule imagination. Ce qui nous intéresse c'est de la comparer. Ceci est-il plus grand que cela ? égal, équivalent, plus petit que, etc. ? Toute comparaison amène une conclusion simple : oui, non ; vrai, faux. Et dans telle condition (« si... , alors ») c'est vrai, dans telle autre, faux.
En travaillant sur les fondements de la pensée logique, Russell nous a donné un outil symbolique pour comprendre le monde d'une façon archisimple. Si simple que n'importe quelle machine construite avec les seuls concepts vrai et faux ; oui, non ; 0, 1, suffit à tout symboliser. L'ordinateur n'est pas une machine à calculer complexe ; c'est un assemblage complexe d'une multitude d'opérateurs logiques simples.
La pensée rationnelle comporte trois lois formulées dans l'Antiquité par Parménide. Elles sont si simples et familières qu'elles semblent ridicules : [3]
1. La loi d'identité : « Tout ce qui est, est. »
(Ex. : Une pomme est une pomme ; elle n'est pas une poire.)
2. La loi de non-contradiction : « Rien à la fois est et n'est pas. »
(Ex. : Une pomme n'est pas une « non-pomme ».)
3. La loi du tiers exclu : « Toute chose est ou n'est pas. »
(Ex. : Ou bien il y a une pomme ou bien il n'y en a pas.)
En fait, elles constituent à elles trois l'atome de la pensée rationnelle. En langage d'ordinateur on dirait : Il existe 1 ou 0. C'est une pensée binaire, dualiste, comme le taoïsme.
Mais là où la cathédrale Russell devient fascinante, c'est qu'en creusant la logique formelle, il s'est aperçu que Berkeley avait raison. Il reconnaît que rien ne prouve que le monde existe matériellement ; la matière, telle que nous la concevons, n'est peut-être pas matérielle ; logiquement, tout pourrait n'être qu'illusion et rien ne serait différent. Comment ça ? Eh bien le monde ne nous est accessible que par les données de nos sens (sense-data) qui fournissent à notre esprit des informations qui ne subsistent nulle part ailleurs. Ces données sont essentiellement privées. Personne d'autre ne peut y avoir directement accès. Pour que le monde existe tel que nous le concevons — pour que cette conception devienne réalité — il faut au moins deux esprits : un pour le percevoir et un autre pour le vérifier. C'est cette « vérification » qui lui confère sa « réalité ». Par exemple, je vois une pomme. Est-ce que vous la voyez aussi ? Oui ! Alors elle est réelle. Chacun pour soi notre esprit est le seul dépositaire d'une réalité privée. L'autre ne perçoit aucune de mes sensations ; elles sont personnelles. Ce que nous pensons être réel n'est finalement que l'idée que chacun se fait de la réalité dans son propre esprit.
Mais alors, est-ce à dire que le monde n'est qu'illusion ? Pas tout à fait, et c'est là le génie de Russell. Il a vu que la seule réalité qui existe est publique. Qu'est-ce à dire ? Ce que nous percevons comme la matière n'est pas réel puisque chacun la perçoit individuellement et n'a aucun moyen direct de vérifier si ses perceptions sont valables chez les autres. Chacun est prisonnier de ses perceptions, emprisonné dans un corps et sujet aux caprices de ses propres sens. Seule la comparaison avec ce que les autres nous disent de leurs perceptions nous permet d'établir la réalité. Et la valeur de cette réalité dépend du nombre d'individus qui y participent. Plus nombreux sont ceux qui témoignent d'une perception, plus elle a de valeur et plus elle est réelle. C'est pourquoi la réalité est publique et non privée. Personne ne détient la vérité sur la réalité, celle-ci doit faire l'objet d'un consensus. C'est aussi pourquoi, toujours inquiets de ce qui nous arrive, nous vérifions sans cesse avec les autres la validité de nos perceptions. As-tu vu ceci ? As-tu entendu cela ? Vérifier nos perceptions, c'est accéder à la réalité ; voilà le test d'une certitude toute relative.
Par moi-même, je ne suis qu'une boule de sensations irrationnelles, émotionnelles. Les autres — le public — viennent confirmer la réalité du monde. Deux personnes suffisent à créer une réalité publique si elles arrivent à s'entendre — à avoir le même avis sur leurs perceptions privées. Mais cette réalité est bien faible ; un rien l'altère. Un seul avis contraire fragilise la réalité de deux individus. Plus nombreuses sont les personnes à accorder leur consentement sur l'interprétation de leurs perceptions individuelles, plus la réalité est réelle. L'idée que l'on se fait de la réalité sensorielle — nos sense-data — produit alors des conceptions purement intellectuelles ; c'est ce que l'on appelle la réalité culturelle.
Mais alors que devons-nous penser d'une personne qui sait une chose vraie alors que le consensus lui donne tort ? Par exemple, la personne condamnée pour un méfait qu'elle n'a pas commis sait qu'elle a raison ; ou encore, le chercheur qui, comme Copernic, fait la démonstration d'une vérité scientifique alors que la majorité des gens pense autrement. La réalité est en bout de compte une construction issue d'un consensus culturel malléable. Chacun connaît ses raisons — chacun sait qu'il a raison — mais doit aussi trouver sa place dans la réalité consensuelle. Aussi bien dire que chacun doit trouver son équilibre entre deux types de réalité : la privée et la publique. La réalité est flexible et prend la forme de nos croyances alors que la raison exige la juste explication des données perçues par nos sens. On voit donc que raison et réalité sont en lutte permanente. Mais raison et réalité prennent toujours appui quelque part sur la foi ; il s'agit de trouver ce en quoi on veut croire pour trouver comment on accorde raison et réalité.
Le sense-data est privé, mais le réel est public.
Cette vision ouverte par Russell nous entraîne dans un vertige terrible. D'une part, elle nous enferme dans une solitude insupportable — le monde auquel me donnent accès mes sens est personnel et incommunicable — d'autre part, elle abandonne aux autres le monopole de la réalité. Je sens, je vois, j'entends, mais ce sont les autres qui décident de ma réalité lorsque vient le moment de l'exprimer par le langage qui est toujours le langage des autres. Rien d'étonnant que l'on soit tenté de se réfugier dans l'idée que notre propre petit monde intérieur est la seule vérité absolue, et surtout de le réduire à la minuscule dimension du « sens commun ». Déjà Kant avait vu que nous voyons le monde tel que nous sommes, et non pas tel qu'il est. Russell montre qu'il ne nous appartient pas de juger de ce qui est réel puisque la réalité est un concept public.
.
 Re: Religion et Philosophie
Re: Religion et Philosophie
Bataille, le mal et l'extase
 L'homme porterait-il en lui l'irréductible négation de ce qui, sous les noms de raison, d'utilité et d'ordre, a fondé l'humanité ?
L'homme porterait-il en lui l'irréductible négation de ce qui, sous les noms de raison, d'utilité et d'ordre, a fondé l'humanité ?
L'existence serait-elle fatalement, en même temps que l'affirmation, la négation de son principe ?
Georges Bataille, L'Érotisme, 1957
Le catéchisme nous apprenait très tôt les sept péchés capitaux.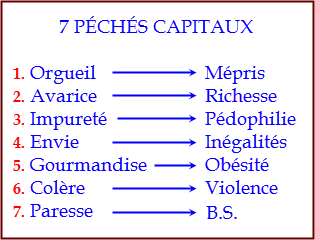 On n'a pas à chercher longtemps pour trouver les équivalents culturels actuels. Chaque société définit le mal et les interdits qui l'accompagnent. Le mal tourne toujours autour des mêmes thèmes. Et si nous avons tant décrié les curés en chaire qui perfusaient leur morale religieuse dans nos esprits chaque dimanche, nous sommes aujourd'hui soumis à une police de la pensée non moins autoritaire puisque chaque média ne semble rien faire d'autre que de mettre en scène les mêmes péchés qui obsédaient jadis nos curés.
On n'a pas à chercher longtemps pour trouver les équivalents culturels actuels. Chaque société définit le mal et les interdits qui l'accompagnent. Le mal tourne toujours autour des mêmes thèmes. Et si nous avons tant décrié les curés en chaire qui perfusaient leur morale religieuse dans nos esprits chaque dimanche, nous sommes aujourd'hui soumis à une police de la pensée non moins autoritaire puisque chaque média ne semble rien faire d'autre que de mettre en scène les mêmes péchés qui obsédaient jadis nos curés.
Georges Bataille a bien vu que le mal fonde l'humanité. Pour le montrer, il propose d'examiner le concept de transgression. Nous savons depuis Nietzsche que la nature se fiche de la morale. Malthus a montré aussi que les populations — qu'elles soient animales ou humaines — ont tendance à se multiplier au-delà des ressources environnementales et que, tôt ou tard, venant à s'épuiser, la pulsion aveugle poussant la vie à foisonner se transformera nécessairement en hécatombe. Comme si la vie voulait la mort, nous savons que l'activité sexuelle est une sorte d'arme de destruction massive. Dès que le petit de l'homme atteint l'âge de se reproduire, il éprouve un sentiment marqué face à la mort. Il sait, ou plutôt on lui apprend, que l'intense extase de l'orgasme est lié au pouvoir de condamner, à terme, sa progéniture à mourir. On abrille le tout dans la magie de « l'amour » et on oublie le dilemme jusqu'à ce que l'effroi de la mort nous rejoigne en fin de vie. Quiconque l'a éprouvé sait qu'aucune vie heureuse ne peut compenser cet instant où, à tout prix, nous voudrions nous soustraire du moment fatidique.
Si Bataille y fut plus sensible qu'un autre, c'est peut-être parce qu'il vécut à une époque riche en hécatombes. Les boucheries de la Première guerre mondiale commencèrent alors qu'il n'avait que 17 ans ; à 42 ans, il est témoin de la Deuxième guerre mondiale ; il meurt à 62 ans en plein essor de la Guerre froide qui promettait l'anéantissement planétaire sous les bombes atomiques.
 La photographie du supplicié chinois obséda Georges Bataille toute sa vie. N'est-elle pas la métaphore fidèle de de ce que chaque humain subit inévitablement ? La vie nous est retirée morceau par morceau. Lentement les décennies nous privent tour à tour de chacune de nos facultés. L'esprit est toujours là, conscient, dans ce corps qui doucement déchoit jusqu'à la mort promise. Mais notre philosophe ne s'arrête pas à ces considérations macabres. Il observe que le jeune écorché chinois (gavé d'opium pour le garder vivant plus longtemps) montre le visage serein de l'extase. Bataille en est profondément troublé. Se peut-il qu'un homme subissant de si atroces sévices puisse accéder à une intense jouissance ? Et de là, à voir dans la torture une expérience érotique et extatique, il n'y a qu'un pas qu'il n'hésite pas à franchir. Ce pas le mène de la transgression à l'érotisme et au sacré.
La photographie du supplicié chinois obséda Georges Bataille toute sa vie. N'est-elle pas la métaphore fidèle de de ce que chaque humain subit inévitablement ? La vie nous est retirée morceau par morceau. Lentement les décennies nous privent tour à tour de chacune de nos facultés. L'esprit est toujours là, conscient, dans ce corps qui doucement déchoit jusqu'à la mort promise. Mais notre philosophe ne s'arrête pas à ces considérations macabres. Il observe que le jeune écorché chinois (gavé d'opium pour le garder vivant plus longtemps) montre le visage serein de l'extase. Bataille en est profondément troublé. Se peut-il qu'un homme subissant de si atroces sévices puisse accéder à une intense jouissance ? Et de là, à voir dans la torture une expérience érotique et extatique, il n'y a qu'un pas qu'il n'hésite pas à franchir. Ce pas le mène de la transgression à l'érotisme et au sacré.
La mort n'est pas, pour notre philosophe, ce qu'en pense Épicure qui nous dit que nous n'avons rien à craindre de la mort puisqu'elle ne peut nous toucher ; quand elle est là, nous n'y sommes plus, et quand nous vivons, elle n'est pas là. Il n'y a pas de coincidence entre l'être et la mort ; nous n'avons donc aucune raison de nous en soucier. Si Bataille parle beaucoup de la mort, la chose réelle en tant que telle ne l'intéresse pas ; il sait que l'on ne peut rien en dire. C'est l'état de la conscience face à la proximité de la mort qui le préoccupe. Il s'intéresse aux états seconds que nous vivons lorsque le danger extrême et la transgression nous portent vers l'extase du moment où nous passons de la vie au trépas, notre dernier contact avec « Dieu », le moment qui intrigue tous les survivants qui en sont témoins puisque l'on ne le vit qu'une seule fois, et qu'ensuite nous ne sommes plus là pour en témoigner.
Si Bataille devient aujourd'hui un philosophe incontournable, c'est qu'il a osé porter un éclairage cru sur les aspects les plus sombres de l'humanité. C'est le seul philosophe assez fort pour nous accompagner dans les questions extrêmes que nous refusons instinctivement d'aborder :
—Pourquoi l'horreur de la torture exerce-t-elle sur nos esprits une telle fascination ?
—Pourquoi le mal est-il inévitable, constitutif de notre humanité, indéracinable ?
—Pourquoi le mal est-il le premier fondement de toute représentation artistique ?
—Pourquoi est-il tant médiatisé ?
—En quoi Dieu est-il aussi sacré que les excréments ?
—Pourquoi l'expression du visage de l'orgasme est-elle la même que celle de l'intense douleur ?
—Pourquoi le mystique s'abstient-il de toute activité sexuelle ?
—Quelle est la nature d'une béatitude plus forte encore que l'orgasme ?
—Pourquoi avez-vous éclaté en sanglots lorsque vous êtes entré dans la salle de torture d'une séance BDSM en même temps que vous éprouviez la plus intense excitation sexuelle à voir la victime humiliée se tordre de douleur ?
—Et, finalement, si Dieu est le plus grand et le plus puissant, pourquoi s'est-il toujours abstenu d'anéantir définitivement le mal ?
 Bataille, philosophe de la transgression, oui, mais surtout philosophe extrême, qui ose nous faire voir que notre humanité se fonde essentiellement sur le mal — inévitable et constitutionnel — qui nous habite. Comme l'enfant du tableau de Balthus, La chambre (1952-1954), il ose tirer le rideau qui cache la lumière sous laquelle apparaît notre humanité dans toute sa nudité.
Bataille, philosophe de la transgression, oui, mais surtout philosophe extrême, qui ose nous faire voir que notre humanité se fonde essentiellement sur le mal — inévitable et constitutionnel — qui nous habite. Comme l'enfant du tableau de Balthus, La chambre (1952-1954), il ose tirer le rideau qui cache la lumière sous laquelle apparaît notre humanité dans toute sa nudité.
.
 L'homme porterait-il en lui l'irréductible négation de ce qui, sous les noms de raison, d'utilité et d'ordre, a fondé l'humanité ?
L'homme porterait-il en lui l'irréductible négation de ce qui, sous les noms de raison, d'utilité et d'ordre, a fondé l'humanité ?L'existence serait-elle fatalement, en même temps que l'affirmation, la négation de son principe ?
Georges Bataille, L'Érotisme, 1957
Le catéchisme nous apprenait très tôt les sept péchés capitaux.
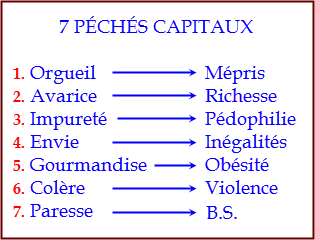 On n'a pas à chercher longtemps pour trouver les équivalents culturels actuels. Chaque société définit le mal et les interdits qui l'accompagnent. Le mal tourne toujours autour des mêmes thèmes. Et si nous avons tant décrié les curés en chaire qui perfusaient leur morale religieuse dans nos esprits chaque dimanche, nous sommes aujourd'hui soumis à une police de la pensée non moins autoritaire puisque chaque média ne semble rien faire d'autre que de mettre en scène les mêmes péchés qui obsédaient jadis nos curés.
On n'a pas à chercher longtemps pour trouver les équivalents culturels actuels. Chaque société définit le mal et les interdits qui l'accompagnent. Le mal tourne toujours autour des mêmes thèmes. Et si nous avons tant décrié les curés en chaire qui perfusaient leur morale religieuse dans nos esprits chaque dimanche, nous sommes aujourd'hui soumis à une police de la pensée non moins autoritaire puisque chaque média ne semble rien faire d'autre que de mettre en scène les mêmes péchés qui obsédaient jadis nos curés.Georges Bataille a bien vu que le mal fonde l'humanité. Pour le montrer, il propose d'examiner le concept de transgression. Nous savons depuis Nietzsche que la nature se fiche de la morale. Malthus a montré aussi que les populations — qu'elles soient animales ou humaines — ont tendance à se multiplier au-delà des ressources environnementales et que, tôt ou tard, venant à s'épuiser, la pulsion aveugle poussant la vie à foisonner se transformera nécessairement en hécatombe. Comme si la vie voulait la mort, nous savons que l'activité sexuelle est une sorte d'arme de destruction massive. Dès que le petit de l'homme atteint l'âge de se reproduire, il éprouve un sentiment marqué face à la mort. Il sait, ou plutôt on lui apprend, que l'intense extase de l'orgasme est lié au pouvoir de condamner, à terme, sa progéniture à mourir. On abrille le tout dans la magie de « l'amour » et on oublie le dilemme jusqu'à ce que l'effroi de la mort nous rejoigne en fin de vie. Quiconque l'a éprouvé sait qu'aucune vie heureuse ne peut compenser cet instant où, à tout prix, nous voudrions nous soustraire du moment fatidique.
Si Bataille y fut plus sensible qu'un autre, c'est peut-être parce qu'il vécut à une époque riche en hécatombes. Les boucheries de la Première guerre mondiale commencèrent alors qu'il n'avait que 17 ans ; à 42 ans, il est témoin de la Deuxième guerre mondiale ; il meurt à 62 ans en plein essor de la Guerre froide qui promettait l'anéantissement planétaire sous les bombes atomiques.
 La photographie du supplicié chinois obséda Georges Bataille toute sa vie. N'est-elle pas la métaphore fidèle de de ce que chaque humain subit inévitablement ? La vie nous est retirée morceau par morceau. Lentement les décennies nous privent tour à tour de chacune de nos facultés. L'esprit est toujours là, conscient, dans ce corps qui doucement déchoit jusqu'à la mort promise. Mais notre philosophe ne s'arrête pas à ces considérations macabres. Il observe que le jeune écorché chinois (gavé d'opium pour le garder vivant plus longtemps) montre le visage serein de l'extase. Bataille en est profondément troublé. Se peut-il qu'un homme subissant de si atroces sévices puisse accéder à une intense jouissance ? Et de là, à voir dans la torture une expérience érotique et extatique, il n'y a qu'un pas qu'il n'hésite pas à franchir. Ce pas le mène de la transgression à l'érotisme et au sacré.
La photographie du supplicié chinois obséda Georges Bataille toute sa vie. N'est-elle pas la métaphore fidèle de de ce que chaque humain subit inévitablement ? La vie nous est retirée morceau par morceau. Lentement les décennies nous privent tour à tour de chacune de nos facultés. L'esprit est toujours là, conscient, dans ce corps qui doucement déchoit jusqu'à la mort promise. Mais notre philosophe ne s'arrête pas à ces considérations macabres. Il observe que le jeune écorché chinois (gavé d'opium pour le garder vivant plus longtemps) montre le visage serein de l'extase. Bataille en est profondément troublé. Se peut-il qu'un homme subissant de si atroces sévices puisse accéder à une intense jouissance ? Et de là, à voir dans la torture une expérience érotique et extatique, il n'y a qu'un pas qu'il n'hésite pas à franchir. Ce pas le mène de la transgression à l'érotisme et au sacré.La mort n'est pas, pour notre philosophe, ce qu'en pense Épicure qui nous dit que nous n'avons rien à craindre de la mort puisqu'elle ne peut nous toucher ; quand elle est là, nous n'y sommes plus, et quand nous vivons, elle n'est pas là. Il n'y a pas de coincidence entre l'être et la mort ; nous n'avons donc aucune raison de nous en soucier. Si Bataille parle beaucoup de la mort, la chose réelle en tant que telle ne l'intéresse pas ; il sait que l'on ne peut rien en dire. C'est l'état de la conscience face à la proximité de la mort qui le préoccupe. Il s'intéresse aux états seconds que nous vivons lorsque le danger extrême et la transgression nous portent vers l'extase du moment où nous passons de la vie au trépas, notre dernier contact avec « Dieu », le moment qui intrigue tous les survivants qui en sont témoins puisque l'on ne le vit qu'une seule fois, et qu'ensuite nous ne sommes plus là pour en témoigner.
Si Bataille devient aujourd'hui un philosophe incontournable, c'est qu'il a osé porter un éclairage cru sur les aspects les plus sombres de l'humanité. C'est le seul philosophe assez fort pour nous accompagner dans les questions extrêmes que nous refusons instinctivement d'aborder :
—Pourquoi l'horreur de la torture exerce-t-elle sur nos esprits une telle fascination ?
—Pourquoi le mal est-il inévitable, constitutif de notre humanité, indéracinable ?
—Pourquoi le mal est-il le premier fondement de toute représentation artistique ?
—Pourquoi est-il tant médiatisé ?
—En quoi Dieu est-il aussi sacré que les excréments ?
—Pourquoi l'expression du visage de l'orgasme est-elle la même que celle de l'intense douleur ?
—Pourquoi le mystique s'abstient-il de toute activité sexuelle ?
—Quelle est la nature d'une béatitude plus forte encore que l'orgasme ?
—Pourquoi avez-vous éclaté en sanglots lorsque vous êtes entré dans la salle de torture d'une séance BDSM en même temps que vous éprouviez la plus intense excitation sexuelle à voir la victime humiliée se tordre de douleur ?
—Et, finalement, si Dieu est le plus grand et le plus puissant, pourquoi s'est-il toujours abstenu d'anéantir définitivement le mal ?
 Bataille, philosophe de la transgression, oui, mais surtout philosophe extrême, qui ose nous faire voir que notre humanité se fonde essentiellement sur le mal — inévitable et constitutionnel — qui nous habite. Comme l'enfant du tableau de Balthus, La chambre (1952-1954), il ose tirer le rideau qui cache la lumière sous laquelle apparaît notre humanité dans toute sa nudité.
Bataille, philosophe de la transgression, oui, mais surtout philosophe extrême, qui ose nous faire voir que notre humanité se fonde essentiellement sur le mal — inévitable et constitutionnel — qui nous habite. Comme l'enfant du tableau de Balthus, La chambre (1952-1954), il ose tirer le rideau qui cache la lumière sous laquelle apparaît notre humanité dans toute sa nudité. .
 Re: Religion et Philosophie
Re: Religion et Philosophie
Leg de Jung : Un monde intérieur où Dieu est bon et mauvais
 L'homme ne peut supporter une vie dénuée de sens.
L'homme ne peut supporter une vie dénuée de sens.
C. G. Jung
Quand j'étais petit, on ne parlait jamais de Dieu sans dire aussi qu'il était « bon » : on le nommait le Bon Dieu, c'était son nom. On ne se demandait pas pourquoi. C'était comme ça. On disait qu'Il avait tout créé, y compris Satan, ange déchu, mais on passait sous silence la responsabilité de Dieu pour sa création. C'est l'homme qui devait être responsable puisqu'il a été créé libre.
Plus tard, quand le Québec a jeté le Bon Dieu avec l'eau du bain, l'Orient taoïste nous a réconciliés avec la dualité Yin-Yang : comme l'Univers est un équilibre de forces opposées, la complémentarité est nécessaire. Lao-tseu nous a donc apaisé l'esprit en expliquant que ces forces sont impersonnelles et qu'il n'y a dans la nature aucune volonté de bien ou mal.
Mais on n'évacue pas une éducation chrétienne comme on change de voiture. L'harmonie sirupeuse du Nouvel-Âge nous laissait sur notre faim. On avait beau se dire que le Diable n'existait pas, et qu'à force de travail « yogatique » nous atteindrions l'illumination, celle-ci ne fournissait que d'éparses étincelles. La promesse d'un paradis post-mortem était remplacée par de trop rares soubresauts extatiques. Et puis la chrétienté ne comportait-elle pas aussi d'alléchantes promesses extatiques ? Je pense à Thérèse d'Avila et au romantique Peace & Love de Jésus-Christ. Nous avions des comptes à régler avec Dieu, une rancune. Nous l'avions rejeté pour incohérence ; la souffrance, passe encore, mais l'absurdité, notre esprit occidental s'y refuse. Comment croire qu'Il soit « bon » après le tremblement de terre de Lisbonne, les cataclysmes naturels et surtout les guerres, toutes menées au nom de Dieu, sans parler des infamies rapportées dans les faits divers et la presse à scandale ? S'il existait un Dieu bon, nul doute qu'Il ne saurait accepter cela sans rien faire. Lao-tseu apportait une solution intéressante puisqu'en dépersonnalisant l'Univers, il proposait une voie apaisante pour l'esprit, mais la religion du Livre n'avait pas dit son dernier mot.
Arrive Jung qui remet Yahvé sur le tapis par le biais de Job [1]. On l'avait oublié celui-là : vous savez, celui contre qui Dieu a envoyé Satan faire toutes les misères du monde sans venir à bout de son allégeance. Job a beau avoir subi les pires sévices, il pourrait se retourner contre son Créateur ; hé bien non ! Le bougre reste fidèle. Il rechigne bien un peu, ose demander pourquoi, mais refuse de mettre en doute ses convictions. Quel être sensé garderait foi en Dieu après la Shoah d'Hitler ?
Jung nous explique que le Bon Dieu n'est pas Dieu ; Il ne serait alors qu'un demi-dieu. En cohérence, nous ne pouvons pas évacuer le côté sombre de Dieu ; c'est pourquoi il faut le craindre autant que l'apprécier. Jung se livre à une véritable psychanalyse de Dieu ; il remet en place ce que des siècles de théologie paresseuse avaient laissé s'étioler.
Jung est un scientifique qui ne jette rien. Il ne se contente pas de nier le monde des esprits comme Freud le fait. Il veut comprendre. Nier n'est pas comprendre. Il refuse de réduire l'âme humaine à la simple pulsion sexuelle ; il en fouille les tréfonds pour nous aider à trouver du sens, et chacun sait ce qu'elle comporte d'incohérences ! Ensuite, il décrit deux mondes en interaction constante : le monde extérieur et le monde intérieur. L'extérieur est régi par une rationalité mathématique, prévisible, d'une causalité incontournable, stable, sécurisant. L'intérieur est le monde de l'âme, des rêves et des symboles ; un monde inquiétant qu'il explore avec d'autres outils que le seul calcul et la causalité rationnelle. Et pour ne pas sombrer dans une vision close sur elle-même, il conçoit la notion d'inconscient collectif ; aussitôt, le religare réapparait, non plus sous forme de religion dogmatique, mais comme une observation incontournable. L'humanité est reliée de l'intérieur par des archétypes communs à tous qu'on retrouve à toute époque partout dans le monde.
Jung nous montre que la réalité du monde intérieur est incontournable puisque, de toute évidence, elle a un effet direct sur le monde extérieur. On a beau nier l'existence de Dieu, des esprits et mépriser toute irrationalité intérieure, n'empêche que c'est toujours à partir de notre conception intérieure du monde que nous agissons sur celui-ci. Votre athéisme n'empêchera pas le croyant de se faire exploser en public. Sa croyance en Dieu est peut-être illusoire, mais l'effet concret est indéniable. Quelque chose dans son esprit a provoqué la pression sur le bouton ; Jung veut pénétrer ce quelque chose.
Revenons à Job. Jung explique que Dieu doit être compris autrement.
Il écrit : « Ceci n'est pas pour dire que Yahvé, à l'égal d'un démiurge gnostique, soit imparfait ou mauvais : Il est chaque qualité dans la totalité de celle-ci ; Il est par conséquent la justice de façon absolue, mais aussi son contraire de manière aussi totale. C'est du moins ainsi qu'il faut se Le représenter si l'on veut dégager une image cohérente de Sa nature. Ce faisant, il nous faut rester conscients du fait que nous ne pouvons qu'esquisser une image anthropomorphique qui, en outre, n'est pas commode à imaginer. Le mode de comportement de l'être divin permet de discerner que Ses différentes propriétés ne sont pas suffisamment en relation les unes avec les autres, de sorte qu'elles déterminent des cassures entre les actes contradictoires qu'elles inspirent : ainsi, Yahvé regrette d'avoir créé des hommes, alors que Son omniscience devait, dès l'origine, savoir ce qui allait advenir des hommes.» [2]
Non pas bon ou mauvais, mais absolument bon et absolument mauvais ; Il engendre la vie, mais aussi la mort ; les joies, mais aussi les peines ; etc. Dieu n'a pas engendré la moitié de la création, mais la création dans toute sa grandeur et son ignominie. Si on l'honore et se tient tranquille, on a des chances pour qu'il reste discret. Pourtant Job n'a rien à se reprocher pourquoi Dieu envoie-t-il Satan lui faire mille misères ? Pour tester sa foi, toujours et encore, comme pour Abraham qui va immoler son fils, Dieu ne cesse d'exiger obéissance et culte ; il exige aussi des preuves ; évidemment, quelle serait la valeur d'une foi qui ne se manifesterait que lorsque tout va bien ?
La conscience du bien et du mal appartient à l'homme ; Jung montre que Dieu est l'inconscience même. « La réflexion et la connaissance résident en lui à côté de l'irréflexion et de l'ignorance de soi-même, comme résident aussi la bonté à côté de la cruauté, et la force créatrice à côté de la volonté de détruire. Tous ces éléments sont présents et aucun ne gêne l'autre. Un tel état mental n'est pensable à nos yeux qu'en l'absence de toute conscience réfléchie, ou bien, si cette conscience existe, cela signifie que la réflexion y est alors occasionnelle, passive, impuissante. Un état semblable, avec des caractéristiques de cette sorte, ne peut se qualifier autrement que d'amoral. » [3]
Si l'homme a besoin de Dieu, Dieu a tout autant besoin de l'homme. Jung fait voir que la conscience et l'inconscient de l'homme fusionnent dans le rêve qui se rattache à l'inconscient collectif par les archétypes qu'on y retrouve. Si Dieu est incomplet, c'est non pas parce qu'il lui manquerait le mal alors qu'il ne serait que bon, mais seulement s'il lui manquait l'homme pour exister. Dieu est l'être qui régit le monde intérieur où chacun est souverain, chacun est Dieu lui-même ; l'homme est la conscience distribuée partout dans le monde, conscience qui agit effectivement. Sans l'homme, Dieu ne pourrait agir sur le monde, et sans Dieu, l'action des hommes serait dispersée, inefficace.
Jung montre ainsi l'équilibre entre monde intérieur et extérieur : deux aspects complémentaires de la réalité. Tant que le monde scientifique s'entête (comme Freud) à ne se cantonner qu'à l'aspect extérieur du monde et voir l'intérieur comme une causalité simple, nous ne pouvons comprendre la totalité. Jung a montré combien le monde intérieur est vaste et peut l'être davantage encore.
Notre époque a extériorisé et confisqué notre monde intérieur dans le « Cloud ». Tous rivés aux petits écrans qui régissent nos vies de manière bien prévisibles, notre intériorité se limite aux médias de masse. Mais le monde intérieur est potentiellement plus vaste encore. Comment le conquérir, le développer, le meubler ? L'Internet est-il obstacle ou prolongement ? De quel monde intérieur voulons-nous ? Voulons-nous le limiter ? Et comment y accéder ?
Jung n'est certainement pas un philosophe facile. De tous ceux que j'ai étudiés, il est celui qui a inventé le plus grand nombre de concepts. Les autres se contentent souvent de tout expliquer d'un seul point de vue relativement simple en produisant un concept génial autour duquel le monde entier vient graviter. Notre philosophe a senti le besoin d'en créer une impressionnante panoplie pour rendre compte de la complexité du conscient et de l'inconscient. Jung est à la fois philosophe, psychiatre, psychologue, médecin, sociologue et théologien ; rien de moins. À le lire, nos pensées foisonnent en tous sens, c'est à croire qu'on perd cohérence ; pourtant l'effet libérateur qu'il provoque ouvre l'esprit sur de fantastiques créations. Peut-être est-ce la raison qu'il soit maintenant passé un peu dans l'oubli. Notre époque s'accommode mal de la libération de la pensée. Son foisonnement inquiète. On aime bien le Copy/Paste sécurisant qui nous tient captifs des liens dont nous faisons la promotion au lieu de nous ingénier laborieusement dans l'originalité.
.
 L'homme ne peut supporter une vie dénuée de sens.
L'homme ne peut supporter une vie dénuée de sens.C. G. Jung
Quand j'étais petit, on ne parlait jamais de Dieu sans dire aussi qu'il était « bon » : on le nommait le Bon Dieu, c'était son nom. On ne se demandait pas pourquoi. C'était comme ça. On disait qu'Il avait tout créé, y compris Satan, ange déchu, mais on passait sous silence la responsabilité de Dieu pour sa création. C'est l'homme qui devait être responsable puisqu'il a été créé libre.
Plus tard, quand le Québec a jeté le Bon Dieu avec l'eau du bain, l'Orient taoïste nous a réconciliés avec la dualité Yin-Yang : comme l'Univers est un équilibre de forces opposées, la complémentarité est nécessaire. Lao-tseu nous a donc apaisé l'esprit en expliquant que ces forces sont impersonnelles et qu'il n'y a dans la nature aucune volonté de bien ou mal.
Mais on n'évacue pas une éducation chrétienne comme on change de voiture. L'harmonie sirupeuse du Nouvel-Âge nous laissait sur notre faim. On avait beau se dire que le Diable n'existait pas, et qu'à force de travail « yogatique » nous atteindrions l'illumination, celle-ci ne fournissait que d'éparses étincelles. La promesse d'un paradis post-mortem était remplacée par de trop rares soubresauts extatiques. Et puis la chrétienté ne comportait-elle pas aussi d'alléchantes promesses extatiques ? Je pense à Thérèse d'Avila et au romantique Peace & Love de Jésus-Christ. Nous avions des comptes à régler avec Dieu, une rancune. Nous l'avions rejeté pour incohérence ; la souffrance, passe encore, mais l'absurdité, notre esprit occidental s'y refuse. Comment croire qu'Il soit « bon » après le tremblement de terre de Lisbonne, les cataclysmes naturels et surtout les guerres, toutes menées au nom de Dieu, sans parler des infamies rapportées dans les faits divers et la presse à scandale ? S'il existait un Dieu bon, nul doute qu'Il ne saurait accepter cela sans rien faire. Lao-tseu apportait une solution intéressante puisqu'en dépersonnalisant l'Univers, il proposait une voie apaisante pour l'esprit, mais la religion du Livre n'avait pas dit son dernier mot.
Arrive Jung qui remet Yahvé sur le tapis par le biais de Job [1]. On l'avait oublié celui-là : vous savez, celui contre qui Dieu a envoyé Satan faire toutes les misères du monde sans venir à bout de son allégeance. Job a beau avoir subi les pires sévices, il pourrait se retourner contre son Créateur ; hé bien non ! Le bougre reste fidèle. Il rechigne bien un peu, ose demander pourquoi, mais refuse de mettre en doute ses convictions. Quel être sensé garderait foi en Dieu après la Shoah d'Hitler ?
Jung nous explique que le Bon Dieu n'est pas Dieu ; Il ne serait alors qu'un demi-dieu. En cohérence, nous ne pouvons pas évacuer le côté sombre de Dieu ; c'est pourquoi il faut le craindre autant que l'apprécier. Jung se livre à une véritable psychanalyse de Dieu ; il remet en place ce que des siècles de théologie paresseuse avaient laissé s'étioler.
Jung est un scientifique qui ne jette rien. Il ne se contente pas de nier le monde des esprits comme Freud le fait. Il veut comprendre. Nier n'est pas comprendre. Il refuse de réduire l'âme humaine à la simple pulsion sexuelle ; il en fouille les tréfonds pour nous aider à trouver du sens, et chacun sait ce qu'elle comporte d'incohérences ! Ensuite, il décrit deux mondes en interaction constante : le monde extérieur et le monde intérieur. L'extérieur est régi par une rationalité mathématique, prévisible, d'une causalité incontournable, stable, sécurisant. L'intérieur est le monde de l'âme, des rêves et des symboles ; un monde inquiétant qu'il explore avec d'autres outils que le seul calcul et la causalité rationnelle. Et pour ne pas sombrer dans une vision close sur elle-même, il conçoit la notion d'inconscient collectif ; aussitôt, le religare réapparait, non plus sous forme de religion dogmatique, mais comme une observation incontournable. L'humanité est reliée de l'intérieur par des archétypes communs à tous qu'on retrouve à toute époque partout dans le monde.
Jung nous montre que la réalité du monde intérieur est incontournable puisque, de toute évidence, elle a un effet direct sur le monde extérieur. On a beau nier l'existence de Dieu, des esprits et mépriser toute irrationalité intérieure, n'empêche que c'est toujours à partir de notre conception intérieure du monde que nous agissons sur celui-ci. Votre athéisme n'empêchera pas le croyant de se faire exploser en public. Sa croyance en Dieu est peut-être illusoire, mais l'effet concret est indéniable. Quelque chose dans son esprit a provoqué la pression sur le bouton ; Jung veut pénétrer ce quelque chose.
Revenons à Job. Jung explique que Dieu doit être compris autrement.
Il écrit : « Ceci n'est pas pour dire que Yahvé, à l'égal d'un démiurge gnostique, soit imparfait ou mauvais : Il est chaque qualité dans la totalité de celle-ci ; Il est par conséquent la justice de façon absolue, mais aussi son contraire de manière aussi totale. C'est du moins ainsi qu'il faut se Le représenter si l'on veut dégager une image cohérente de Sa nature. Ce faisant, il nous faut rester conscients du fait que nous ne pouvons qu'esquisser une image anthropomorphique qui, en outre, n'est pas commode à imaginer. Le mode de comportement de l'être divin permet de discerner que Ses différentes propriétés ne sont pas suffisamment en relation les unes avec les autres, de sorte qu'elles déterminent des cassures entre les actes contradictoires qu'elles inspirent : ainsi, Yahvé regrette d'avoir créé des hommes, alors que Son omniscience devait, dès l'origine, savoir ce qui allait advenir des hommes.» [2]
Non pas bon ou mauvais, mais absolument bon et absolument mauvais ; Il engendre la vie, mais aussi la mort ; les joies, mais aussi les peines ; etc. Dieu n'a pas engendré la moitié de la création, mais la création dans toute sa grandeur et son ignominie. Si on l'honore et se tient tranquille, on a des chances pour qu'il reste discret. Pourtant Job n'a rien à se reprocher pourquoi Dieu envoie-t-il Satan lui faire mille misères ? Pour tester sa foi, toujours et encore, comme pour Abraham qui va immoler son fils, Dieu ne cesse d'exiger obéissance et culte ; il exige aussi des preuves ; évidemment, quelle serait la valeur d'une foi qui ne se manifesterait que lorsque tout va bien ?
La conscience du bien et du mal appartient à l'homme ; Jung montre que Dieu est l'inconscience même. « La réflexion et la connaissance résident en lui à côté de l'irréflexion et de l'ignorance de soi-même, comme résident aussi la bonté à côté de la cruauté, et la force créatrice à côté de la volonté de détruire. Tous ces éléments sont présents et aucun ne gêne l'autre. Un tel état mental n'est pensable à nos yeux qu'en l'absence de toute conscience réfléchie, ou bien, si cette conscience existe, cela signifie que la réflexion y est alors occasionnelle, passive, impuissante. Un état semblable, avec des caractéristiques de cette sorte, ne peut se qualifier autrement que d'amoral. » [3]
Si l'homme a besoin de Dieu, Dieu a tout autant besoin de l'homme. Jung fait voir que la conscience et l'inconscient de l'homme fusionnent dans le rêve qui se rattache à l'inconscient collectif par les archétypes qu'on y retrouve. Si Dieu est incomplet, c'est non pas parce qu'il lui manquerait le mal alors qu'il ne serait que bon, mais seulement s'il lui manquait l'homme pour exister. Dieu est l'être qui régit le monde intérieur où chacun est souverain, chacun est Dieu lui-même ; l'homme est la conscience distribuée partout dans le monde, conscience qui agit effectivement. Sans l'homme, Dieu ne pourrait agir sur le monde, et sans Dieu, l'action des hommes serait dispersée, inefficace.
Jung montre ainsi l'équilibre entre monde intérieur et extérieur : deux aspects complémentaires de la réalité. Tant que le monde scientifique s'entête (comme Freud) à ne se cantonner qu'à l'aspect extérieur du monde et voir l'intérieur comme une causalité simple, nous ne pouvons comprendre la totalité. Jung a montré combien le monde intérieur est vaste et peut l'être davantage encore.
Notre époque a extériorisé et confisqué notre monde intérieur dans le « Cloud ». Tous rivés aux petits écrans qui régissent nos vies de manière bien prévisibles, notre intériorité se limite aux médias de masse. Mais le monde intérieur est potentiellement plus vaste encore. Comment le conquérir, le développer, le meubler ? L'Internet est-il obstacle ou prolongement ? De quel monde intérieur voulons-nous ? Voulons-nous le limiter ? Et comment y accéder ?
Jung n'est certainement pas un philosophe facile. De tous ceux que j'ai étudiés, il est celui qui a inventé le plus grand nombre de concepts. Les autres se contentent souvent de tout expliquer d'un seul point de vue relativement simple en produisant un concept génial autour duquel le monde entier vient graviter. Notre philosophe a senti le besoin d'en créer une impressionnante panoplie pour rendre compte de la complexité du conscient et de l'inconscient. Jung est à la fois philosophe, psychiatre, psychologue, médecin, sociologue et théologien ; rien de moins. À le lire, nos pensées foisonnent en tous sens, c'est à croire qu'on perd cohérence ; pourtant l'effet libérateur qu'il provoque ouvre l'esprit sur de fantastiques créations. Peut-être est-ce la raison qu'il soit maintenant passé un peu dans l'oubli. Notre époque s'accommode mal de la libération de la pensée. Son foisonnement inquiète. On aime bien le Copy/Paste sécurisant qui nous tient captifs des liens dont nous faisons la promotion au lieu de nous ingénier laborieusement dans l'originalité.
.
 Re: Religion et Philosophie
Re: Religion et Philosophie
Agnosie philosophique La philosophie comme 9e sens
 Je me suis soigneusement abstenu de tourner en dérision les actions humaines, de les prendre en pitié ou en haine ; je n’ai voulu que les comprendre.
Je me suis soigneusement abstenu de tourner en dérision les actions humaines, de les prendre en pitié ou en haine ; je n’ai voulu que les comprendre.
Spinoza, Ch. 1, Introduct. 4, 1677
À considérer la perception philosophique comme la vision, celui qui en serait dépourvu souffrirait de carence ontologique comme l'aveugle souffre de cécité. Mais dans un monde où il n'y aurait que des aveugles, celui qui voit ne serait-il pas handicapé ?
Pourtant, chacun est doté du sens philosophique ; pourquoi n'arrivons-nous pas à le développer ? Qu'est-ce qui l'empêche ?
Dans un monde où l'artiste n'aurait jamais eu à portée de vue que l'urinoir ready-made de Duchamp, comment pourrait-il reconnaître la Joconde en tant qu'oeuvre d'art ? Nous habitons un espace culturel restreint ; il faut enrichir nos concepts pour l'étendre, mais comment se convaincre de prendre du large alors que nous sommes habitués au confort de la cécité ? C'est ce dont nous entretient Platon avec l'allégorie de la caverne. Plus près de nous, le film Premier regard (At First Sight) offre une perspective complémentaire en montrant les pénibles étapes à franchir pour recouvrir la vision et pourquoi la confiance (la foi) reste l'ultime recours dans un monde où nous n'arrivons pas à voir tout ce qu'il contient.
Et si le sens philosophique pouvait apporter un gain de perspective à l'échelle qui se révèle en passant du toucher à la vue, tenteriez-vous l'expérience ? Mais au fait, pour quoi faire ? Pourquoi voir plus et sentir davantage ? Peut-être simplement pour être plus. Être est la seule chose que nous soyons ; nous ne sommes que de l'être, rien d'autre. Ne pourrions-nous pas être davantage que l'individu normalisé par l'école et le travailleur docile dont la société a besoin ? Mais comment sortir de l'agnosie philosophique ?
Socrate montre que la première étape de l'augmentation de l'être consiste à reconnaître sa propre ignorance. Descartes ajoute le désir de sortir de la suffisance en affirmant que le bon sens est la chose la mieux partagée au monde puisque personne ne se plaint d'en manquer. Qui se plaint de sa propre ignorance quand tout un chacun ne se plait qu'à discourir narcissiquement sur ses minuscules convictions personnelles stationnaires ? Spinoza montre la clef ultime lorsqu'il nous suggère de ne pas se moquer, ni déplorer, ni détester, mais comprendre.
Bref, chaque fois que je rencontre l'incompréhension 1. Reconnaître que cette incompréhension relève de ma propre ignorance. 2. Désirer augmenter mes connaissances ; non pas pour justifier celles que je possède déjà ; mais chercher le moyen d'inclure ce qui m'apparaît insensé en relevant le défi d'en trouver la cohérence. 3. Résister à la tentation corrosive de la détestation par la confiance dans une perfection plus grande que ma compréhension limitée. 4. Répéter le cycle aussi longtemps que je ne me sens pas en harmonie totale avec le monde.
L'être qui n'a plus besoin d'augmentation est celui qui se sent en parfaite harmonie avec le monde, c'est l'être ultime ; il voit le monde et l'aime tel qu'il est parce qu'il en comprend la perfection. Est-ce un état accessible à l'humain ? Chaque philosophe témoigne de son propre parcours. À chacun de trouver le sien.
.
 Je me suis soigneusement abstenu de tourner en dérision les actions humaines, de les prendre en pitié ou en haine ; je n’ai voulu que les comprendre.
Je me suis soigneusement abstenu de tourner en dérision les actions humaines, de les prendre en pitié ou en haine ; je n’ai voulu que les comprendre.Spinoza, Ch. 1, Introduct. 4, 1677
À considérer la perception philosophique comme la vision, celui qui en serait dépourvu souffrirait de carence ontologique comme l'aveugle souffre de cécité. Mais dans un monde où il n'y aurait que des aveugles, celui qui voit ne serait-il pas handicapé ?
Pourtant, chacun est doté du sens philosophique ; pourquoi n'arrivons-nous pas à le développer ? Qu'est-ce qui l'empêche ?
Dans un monde où l'artiste n'aurait jamais eu à portée de vue que l'urinoir ready-made de Duchamp, comment pourrait-il reconnaître la Joconde en tant qu'oeuvre d'art ? Nous habitons un espace culturel restreint ; il faut enrichir nos concepts pour l'étendre, mais comment se convaincre de prendre du large alors que nous sommes habitués au confort de la cécité ? C'est ce dont nous entretient Platon avec l'allégorie de la caverne. Plus près de nous, le film Premier regard (At First Sight) offre une perspective complémentaire en montrant les pénibles étapes à franchir pour recouvrir la vision et pourquoi la confiance (la foi) reste l'ultime recours dans un monde où nous n'arrivons pas à voir tout ce qu'il contient.
Et si le sens philosophique pouvait apporter un gain de perspective à l'échelle qui se révèle en passant du toucher à la vue, tenteriez-vous l'expérience ? Mais au fait, pour quoi faire ? Pourquoi voir plus et sentir davantage ? Peut-être simplement pour être plus. Être est la seule chose que nous soyons ; nous ne sommes que de l'être, rien d'autre. Ne pourrions-nous pas être davantage que l'individu normalisé par l'école et le travailleur docile dont la société a besoin ? Mais comment sortir de l'agnosie philosophique ?
Socrate montre que la première étape de l'augmentation de l'être consiste à reconnaître sa propre ignorance. Descartes ajoute le désir de sortir de la suffisance en affirmant que le bon sens est la chose la mieux partagée au monde puisque personne ne se plaint d'en manquer. Qui se plaint de sa propre ignorance quand tout un chacun ne se plait qu'à discourir narcissiquement sur ses minuscules convictions personnelles stationnaires ? Spinoza montre la clef ultime lorsqu'il nous suggère de ne pas se moquer, ni déplorer, ni détester, mais comprendre.
Bref, chaque fois que je rencontre l'incompréhension 1. Reconnaître que cette incompréhension relève de ma propre ignorance. 2. Désirer augmenter mes connaissances ; non pas pour justifier celles que je possède déjà ; mais chercher le moyen d'inclure ce qui m'apparaît insensé en relevant le défi d'en trouver la cohérence. 3. Résister à la tentation corrosive de la détestation par la confiance dans une perfection plus grande que ma compréhension limitée. 4. Répéter le cycle aussi longtemps que je ne me sens pas en harmonie totale avec le monde.
L'être qui n'a plus besoin d'augmentation est celui qui se sent en parfaite harmonie avec le monde, c'est l'être ultime ; il voit le monde et l'aime tel qu'il est parce qu'il en comprend la perfection. Est-ce un état accessible à l'humain ? Chaque philosophe témoigne de son propre parcours. À chacun de trouver le sien.
.
 Re: Religion et Philosophie
Re: Religion et Philosophie
Paradoxe juif troublant :
peuple choisi de Dieu
 C’est toi que Jéhovah ton Dieu a choisi pour devenir son peuple.
C’est toi que Jéhovah ton Dieu a choisi pour devenir son peuple.
Deutéronome 7:6
Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort.
Nietzsche
Dans l'aventure juive, n'est-il pas troublant de constater le bénéfice obtenu suite à tant de persécutions ? On ne prétend pas impunément être nation choisie de Dieu. La nature humaine étant ce qu'elle est, provocation et jalousie agissent inévitablement de concert. Pourtant, sans Hitler, les persécutions et toutes les humiliations subies depuis des millénaires, il y a fort à parier que ce peuple n'aurait pas produit tant de génies pour le bénéfice l'humanité dans de si nombreux domaines. Il n'y a qu'à constater la surreprésentation des Juifs dans la liste des prix Nobels.
Nous le savons tous, l'adversité pousse l'humain à se surpasser. On peut ainsi comprendre que le Juif qui assume pleinement son rôle dans l'humanité ne peut tenir rancune à ses persécuteurs pour deux raisons. Premièrement, endossant le rôle de peuple choisi, il savait que ce ne serait pas sans douleur. Ensuite, il savait aussi que ceci, provoquant son génie, lui apporterait une gloire dont on peut dire qu'ils ne l'ont pas volé.
Au bout du compte, les choses s'équilibrent. Pour ma part, je suis heureux que Dieu m'ignore ; je me contente d'une vie moins glorieuse, mais moins houleuse.
Dans sa grande sagesse Moïse avait-il songé qu'on ne devient pas premier de classe sans faire des jaloux, et que lorsque le maître est Dieu lui-même, les conséquences sont extrêmes ? La persécution propulse l'humain vers les sommets ; ceci nous conduit à un troublant paradoxe. Nous voudrions tous être des génies, mais combien accepteraient d'en payer le prix ?
.
peuple choisi de Dieu
 C’est toi que Jéhovah ton Dieu a choisi pour devenir son peuple.
C’est toi que Jéhovah ton Dieu a choisi pour devenir son peuple.Deutéronome 7:6
Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort.
Nietzsche
Dans l'aventure juive, n'est-il pas troublant de constater le bénéfice obtenu suite à tant de persécutions ? On ne prétend pas impunément être nation choisie de Dieu. La nature humaine étant ce qu'elle est, provocation et jalousie agissent inévitablement de concert. Pourtant, sans Hitler, les persécutions et toutes les humiliations subies depuis des millénaires, il y a fort à parier que ce peuple n'aurait pas produit tant de génies pour le bénéfice l'humanité dans de si nombreux domaines. Il n'y a qu'à constater la surreprésentation des Juifs dans la liste des prix Nobels.
Nous le savons tous, l'adversité pousse l'humain à se surpasser. On peut ainsi comprendre que le Juif qui assume pleinement son rôle dans l'humanité ne peut tenir rancune à ses persécuteurs pour deux raisons. Premièrement, endossant le rôle de peuple choisi, il savait que ce ne serait pas sans douleur. Ensuite, il savait aussi que ceci, provoquant son génie, lui apporterait une gloire dont on peut dire qu'ils ne l'ont pas volé.
Au bout du compte, les choses s'équilibrent. Pour ma part, je suis heureux que Dieu m'ignore ; je me contente d'une vie moins glorieuse, mais moins houleuse.
Dans sa grande sagesse Moïse avait-il songé qu'on ne devient pas premier de classe sans faire des jaloux, et que lorsque le maître est Dieu lui-même, les conséquences sont extrêmes ? La persécution propulse l'humain vers les sommets ; ceci nous conduit à un troublant paradoxe. Nous voudrions tous être des génies, mais combien accepteraient d'en payer le prix ?
.
 Re: Religion et Philosophie
Re: Religion et Philosophie
L'islam est une religion de gagnants, pas une religion d'amour
Tout le monde parle de l'islam aujourd'hui. Personne n'a lu le Coran, ou très peu l'ont lu. Très peu ont lu les Hadith du Prophète ; très peu ont lu ce qu'on appelle la Sira, c'est-à-dire la biographie du Prophète. Quand on lit tout ça, on s'aperçoit que ce n'est effectivement pas une religion de paix, de tolérance et d'amour. La chose est clairement dite...
Michel Onfray explique pourquoi l'islam est un problème
L'Islam recommande la fraternité entre les croyants, mais il est impitoyable envers les mécréants. Le Coran recommande expressément de les massacrer (sourate 5:33 et 8:12-19). Mais l'Évangile n'est pas que d'amour. Jésus dit : « N’allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas venu apporter la paix, mais bien le glaive. » (Matthieu 10:34) Non plus que la Bible qui encourage rien de moins que l'extermination des occupants de la Terre promise : « Lorsque le Seigneur votre Dieu vous les aura livrés, vous les ferez tous passer au fil de l'épée, sans qu'il en demeure un seul. Vous ne ferez point d'alliance avec eux, et vous n'aurez aucune compassion d'eux. » (Deutéronome 7:2)
Comment serions-nous alors justifiés de reprocher aux musulmans de ne pas respecter nos principes chrétiens ? L'indignation des Occidentaux qui jugent les principes islamiques à la lumière de la charité chrétienne est difficile à comprendre. Le christianisme est la religion du pardon intégral ; l'islam pardonne aussi, mais donne une large part au châtiment.
L'amour chrétien est spécial ; il est propre au christianisme. On pourrait dire qu'il s'agit d'un amour positivement pervers. En effet, quoi de plus normal que d'aimer ceux qui nous sont sympathiques, qui pensent comme nous, qui sont gentils avec nous. Mais le chrétien adresse son amour spécialement à ceux qui sont détestables. Et plus vous êtes désagréable, plus le chrétien aura de mérite à vous aimer (Matthieu 5:43-48). Voilà sa perversité, mais c'est ainsi qu'il gagne sa place au paradis.
L'Islam recommande une attitude plus normale. L'amour musulman est d'abord une fraternité. On aime ceux qui partagent notre foi en Allah, pas les autres. On doit les tolérer tant qu'ils sont supérieurs en majorité et en force, mais c'est une religion de conquête (sourate 2:190-195 et 9:29-36). Le musulman est appelé à exercer un prosélytisme actif. Sous cet aspect, le Coran offre deux positions : conquérir l'esprit des mécréants sinon, les massacrer. Le saint livre ne précise pas avec exactitude combien de temps le fidèle doit patienter avant de prendre les armes, mais on peut penser que la supériorité en force — décuplée par la foi en Allah — serait le déclencheur ; de plus, l'incitation est grande : tuer un infidèle garantit une place au paradis.
Mais qu'y a-t-il de choquant là-dedans. La religion musulmane, en ce qui concerne les principes de base, n'est-elle pas semblable à toute religion ? Le Coran parle de conquêtes, de propagation de la foi par le combat, mais aussi de paix. On y fait la promotion de l'honnêteté, de l'équité et des bonnes habitudes de vie (éviter l'alcool et tout ce qui nuit à la santé), jeûner de temps en temps, honorer ses parents, bref rien de dommageable. Mais, au contraire du Bouddhisme ou du Christianisme, l'Islam laisse beaucoup moins de place à l'expérimentation « pécheresse » : les consignes sont sévères.
Peut-être est-ce la clef de sa popularité. À mesure que la population s'accroît, les comportements nuisibles deviennent de plus en plus gênants. Dans une ville à faible densité, on peut se permettre davantage de liberté ; là où la population est dense, il faut resserrer les règles. Mais qui a l'autorité de sévir ? Quelle est la légitimité de celui qui dit agir d'après les ordres d'Allah ? Moi, chrétien, puis-je couper la main du voleur musulman ? Est-ce le verset qui fait autorité ou celui qui l'applique ? Comment puis-je être assuré que c'est bien Allah qui me guide quand je punirais ? S'il est aussi miséricordieux que juste, dois-je pencher pour l'indulgence ou le pardon ?
En fait, la loi du plus fort semble l'emporter. Qui osera prétendre que celui qui domine le combat n'est pas sujet à la volonté d'Allah ? En effet, après la guerre, le gagnant n'a-t-il pas eu raison ? Seuls les survivants des conquêtes peuvent écrire l'Histoire. Peut-on alors penser que le seul défaut d'Hitler est d'avoir perdu la guerre ? En fait, ses principes et sa manière de les appliquer ont causé sa perte. S'il avait gagné, il aurait été dans le camp des bons ; mais il était impossible qu'il gagne ; ses actions étaient trop hostiles à la vie, ses manières brutales, inhumaines, mortifères ; voilà une attitude de perdant. On a aimé Napoléon et chaque grand conquérant jusqu'à ce qu'il commence à perdre batailles et terrain.
À l'aube du XXIe siècle, l'Islam entre en mode conquête mondiale : le peuple se reproduit. Il possède les plus abondantes réserves de pétrole. L'Occident ne se reproduit plus, mais achète son pétrole du Moyen-Orient et organise son mode de vie autour de l'automobile. La question n'est pas de savoir si l'islam est une meilleure religion, plus morale que la chrétienne ou qu'aucune autre ; d'un simple point de vue stratégique, l'Occident fait tout pour s'affaiblir, jusqu'à pousser la tolérance à aimer son ennemi, interdire toute discrimination et promouvoir une liberté sans bornes. Mais c'est la liberté même qui est liberticide ; à « scorer » dans ses propres buts, on offre la victoire à l'adversaire sans même livrer bataille.
Nous savons que les Saints Livres contiennent nombre de bons principes et laissent place à quelques débordements fanatiques. Débattre à savoir quelle est la meilleure religion, la plus morale, semble dérisoire. Le « meilleur » peuple n'est pas le plus moral, c'est celui qui survit, c'est-à-dire celui qui offre les meilleures opportunités d'expansion et de longévité. La question de l'heure devrait nous indiquer quel est le Livre qui contient davantage de principes gagnants.
La maxime qui commande de « tendre l'autre joue » a fonctionné en Inde avec Gandhi parce que le pays était occupé par l'Anglais chrétien. Le Mahatma s'est servi de la faille du principe évangélique occidental pour vaincre ; la Bhagavad Gita ne lui aurait été d'aucun secours. Fin renard, il a combattu avec les armes de l'ennemi.
L'Occidental est d'une inconséquence déconcertante. Il ne cesse de dénoncer l'envahissement des musulmans avec des principes chrétiens. Il ouvre les portes toutes grandes à l'immigration sans exiger l'intégration culturelle au nom d'un principe de charité qui affaiblit ses institutions. Le même principe a provoqué un endettement monstre qui plombe son économie avec une généreuse Sécurité Sociale sans contrepartie. Il pense renflouer les coffres en invitant une main-d'oeuvre étrangère à travailler et payer des impôts alors qu'il torpille sa famille en élargissant le mariage hors des normes où la reproduction devrait être le principal motif. Somme toute, l'Occidental veut le beurre, l'argent du beurre et faire payer les autres. Mais l'argent n'est que la force de travail. Comment obtenir des biens et services sans faire d'enfants ? Doit-on blâmer l'idéologie qui fait naître les populations de demain avec de simples principes gagnants ? Quand on regarde l'irresponsabilité des gouvernements que notre chère démocratie s'entête à élire, les interminables scandales de corruption auxquels ils participent et le taxage qui nous fait esclaves d'une économie qui gruge inutilement les ressources de la planète, on finit par penser que c'est d'un changement radical de régime dont nous avons besoin.
L'islam est en pleine croissance, comment pourrions-nous le reprocher aux musulmans ? Nous fumons, buvons, flânons. De leur côté, ils emploient leurs gains à fonder famille, se multiplier, accroître leur force de travail ; sans compter qu'ils participent à notre dette en payant l'impôt lorsqu'ils immigrent chez nous. Doit-on blâmer celui qui applique à sa vie privée les principes gagnants ? Et ceci n'a rien de religieux, si tant est que deux équipes qui s'affrontent n'ont pas besoin d'implorer l'assistance des dieux, mais d'agir simplement en gagnants comme Vladimir Putin invite le Parlement Russe à faire.
.
Tout le monde parle de l'islam aujourd'hui. Personne n'a lu le Coran, ou très peu l'ont lu. Très peu ont lu les Hadith du Prophète ; très peu ont lu ce qu'on appelle la Sira, c'est-à-dire la biographie du Prophète. Quand on lit tout ça, on s'aperçoit que ce n'est effectivement pas une religion de paix, de tolérance et d'amour. La chose est clairement dite...
Michel Onfray explique pourquoi l'islam est un problème
L'Islam recommande la fraternité entre les croyants, mais il est impitoyable envers les mécréants. Le Coran recommande expressément de les massacrer (sourate 5:33 et 8:12-19). Mais l'Évangile n'est pas que d'amour. Jésus dit : « N’allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas venu apporter la paix, mais bien le glaive. » (Matthieu 10:34) Non plus que la Bible qui encourage rien de moins que l'extermination des occupants de la Terre promise : « Lorsque le Seigneur votre Dieu vous les aura livrés, vous les ferez tous passer au fil de l'épée, sans qu'il en demeure un seul. Vous ne ferez point d'alliance avec eux, et vous n'aurez aucune compassion d'eux. » (Deutéronome 7:2)
Comment serions-nous alors justifiés de reprocher aux musulmans de ne pas respecter nos principes chrétiens ? L'indignation des Occidentaux qui jugent les principes islamiques à la lumière de la charité chrétienne est difficile à comprendre. Le christianisme est la religion du pardon intégral ; l'islam pardonne aussi, mais donne une large part au châtiment.
L'amour chrétien est spécial ; il est propre au christianisme. On pourrait dire qu'il s'agit d'un amour positivement pervers. En effet, quoi de plus normal que d'aimer ceux qui nous sont sympathiques, qui pensent comme nous, qui sont gentils avec nous. Mais le chrétien adresse son amour spécialement à ceux qui sont détestables. Et plus vous êtes désagréable, plus le chrétien aura de mérite à vous aimer (Matthieu 5:43-48). Voilà sa perversité, mais c'est ainsi qu'il gagne sa place au paradis.
L'Islam recommande une attitude plus normale. L'amour musulman est d'abord une fraternité. On aime ceux qui partagent notre foi en Allah, pas les autres. On doit les tolérer tant qu'ils sont supérieurs en majorité et en force, mais c'est une religion de conquête (sourate 2:190-195 et 9:29-36). Le musulman est appelé à exercer un prosélytisme actif. Sous cet aspect, le Coran offre deux positions : conquérir l'esprit des mécréants sinon, les massacrer. Le saint livre ne précise pas avec exactitude combien de temps le fidèle doit patienter avant de prendre les armes, mais on peut penser que la supériorité en force — décuplée par la foi en Allah — serait le déclencheur ; de plus, l'incitation est grande : tuer un infidèle garantit une place au paradis.
Mais qu'y a-t-il de choquant là-dedans. La religion musulmane, en ce qui concerne les principes de base, n'est-elle pas semblable à toute religion ? Le Coran parle de conquêtes, de propagation de la foi par le combat, mais aussi de paix. On y fait la promotion de l'honnêteté, de l'équité et des bonnes habitudes de vie (éviter l'alcool et tout ce qui nuit à la santé), jeûner de temps en temps, honorer ses parents, bref rien de dommageable. Mais, au contraire du Bouddhisme ou du Christianisme, l'Islam laisse beaucoup moins de place à l'expérimentation « pécheresse » : les consignes sont sévères.
Peut-être est-ce la clef de sa popularité. À mesure que la population s'accroît, les comportements nuisibles deviennent de plus en plus gênants. Dans une ville à faible densité, on peut se permettre davantage de liberté ; là où la population est dense, il faut resserrer les règles. Mais qui a l'autorité de sévir ? Quelle est la légitimité de celui qui dit agir d'après les ordres d'Allah ? Moi, chrétien, puis-je couper la main du voleur musulman ? Est-ce le verset qui fait autorité ou celui qui l'applique ? Comment puis-je être assuré que c'est bien Allah qui me guide quand je punirais ? S'il est aussi miséricordieux que juste, dois-je pencher pour l'indulgence ou le pardon ?
En fait, la loi du plus fort semble l'emporter. Qui osera prétendre que celui qui domine le combat n'est pas sujet à la volonté d'Allah ? En effet, après la guerre, le gagnant n'a-t-il pas eu raison ? Seuls les survivants des conquêtes peuvent écrire l'Histoire. Peut-on alors penser que le seul défaut d'Hitler est d'avoir perdu la guerre ? En fait, ses principes et sa manière de les appliquer ont causé sa perte. S'il avait gagné, il aurait été dans le camp des bons ; mais il était impossible qu'il gagne ; ses actions étaient trop hostiles à la vie, ses manières brutales, inhumaines, mortifères ; voilà une attitude de perdant. On a aimé Napoléon et chaque grand conquérant jusqu'à ce qu'il commence à perdre batailles et terrain.
À l'aube du XXIe siècle, l'Islam entre en mode conquête mondiale : le peuple se reproduit. Il possède les plus abondantes réserves de pétrole. L'Occident ne se reproduit plus, mais achète son pétrole du Moyen-Orient et organise son mode de vie autour de l'automobile. La question n'est pas de savoir si l'islam est une meilleure religion, plus morale que la chrétienne ou qu'aucune autre ; d'un simple point de vue stratégique, l'Occident fait tout pour s'affaiblir, jusqu'à pousser la tolérance à aimer son ennemi, interdire toute discrimination et promouvoir une liberté sans bornes. Mais c'est la liberté même qui est liberticide ; à « scorer » dans ses propres buts, on offre la victoire à l'adversaire sans même livrer bataille.
Nous savons que les Saints Livres contiennent nombre de bons principes et laissent place à quelques débordements fanatiques. Débattre à savoir quelle est la meilleure religion, la plus morale, semble dérisoire. Le « meilleur » peuple n'est pas le plus moral, c'est celui qui survit, c'est-à-dire celui qui offre les meilleures opportunités d'expansion et de longévité. La question de l'heure devrait nous indiquer quel est le Livre qui contient davantage de principes gagnants.
La maxime qui commande de « tendre l'autre joue » a fonctionné en Inde avec Gandhi parce que le pays était occupé par l'Anglais chrétien. Le Mahatma s'est servi de la faille du principe évangélique occidental pour vaincre ; la Bhagavad Gita ne lui aurait été d'aucun secours. Fin renard, il a combattu avec les armes de l'ennemi.
L'Occidental est d'une inconséquence déconcertante. Il ne cesse de dénoncer l'envahissement des musulmans avec des principes chrétiens. Il ouvre les portes toutes grandes à l'immigration sans exiger l'intégration culturelle au nom d'un principe de charité qui affaiblit ses institutions. Le même principe a provoqué un endettement monstre qui plombe son économie avec une généreuse Sécurité Sociale sans contrepartie. Il pense renflouer les coffres en invitant une main-d'oeuvre étrangère à travailler et payer des impôts alors qu'il torpille sa famille en élargissant le mariage hors des normes où la reproduction devrait être le principal motif. Somme toute, l'Occidental veut le beurre, l'argent du beurre et faire payer les autres. Mais l'argent n'est que la force de travail. Comment obtenir des biens et services sans faire d'enfants ? Doit-on blâmer l'idéologie qui fait naître les populations de demain avec de simples principes gagnants ? Quand on regarde l'irresponsabilité des gouvernements que notre chère démocratie s'entête à élire, les interminables scandales de corruption auxquels ils participent et le taxage qui nous fait esclaves d'une économie qui gruge inutilement les ressources de la planète, on finit par penser que c'est d'un changement radical de régime dont nous avons besoin.
L'islam est en pleine croissance, comment pourrions-nous le reprocher aux musulmans ? Nous fumons, buvons, flânons. De leur côté, ils emploient leurs gains à fonder famille, se multiplier, accroître leur force de travail ; sans compter qu'ils participent à notre dette en payant l'impôt lorsqu'ils immigrent chez nous. Doit-on blâmer celui qui applique à sa vie privée les principes gagnants ? Et ceci n'a rien de religieux, si tant est que deux équipes qui s'affrontent n'ont pas besoin d'implorer l'assistance des dieux, mais d'agir simplement en gagnants comme Vladimir Putin invite le Parlement Russe à faire.
.
 Re: Religion et Philosophie
Re: Religion et Philosophie
[size=130]Quelle est la genèse de la genèse ?[/size]
 La pensée mystico-religieuse est l'unique forme de pensée dont l'humanité a été capable pendant des millénaires.
La pensée mystico-religieuse est l'unique forme de pensée dont l'humanité a été capable pendant des millénaires.
Carlo Rovelli, Anaximandre de Milet, 2009, (p. 152)
L'obsession humaine la plus tenace est sans doute celle de l'origine. Nous sommes habités par l'interrogation permanente qui cherche à expliquer tout ce qui apparaît soudainement comme par magie dans notre champ de perception. Comment suis-je venu au monde ? Comment s'est formé l'Univers ? Quelle est l'origine de la civilisation ? Qui a inventé ceci ou cela ? Qui a écrit tel ou tel texte ? Quel philosophe a créé le concept qui occupe notre pensée ?
Mais au-delà de cette curiosité sur l'origine des choses, une question encore plus fondamentale me hante l'esprit depuis toujours : par quel moyen la réalité est-elle créée ? Quelle est la genèse de la genèse ?
Nous savons par le bouddhisme que le monde tel que nous le percevons n'est qu'illusion, mais comment cette illusion s'y prend-elle pour se présenter avec une telle réalité ? Quelle procédure de déconstruction devons-nous utiliser pour comprendre comment l'humain s'y prend pour établir sa vérité ?
Berkeley nous offre déjà un point de départ intéressant avec l'immatérialisme. Après lui, nous savons que la matière n'a aucune réalité matérielle. Seul l'esprit percevant lui attribue sa réalité. Le verre dans ma main n'a de réalité qu'en fonction de mes sens (ouïe, vue, toucher, etc.), et mes sens sont raccordés au cerveau qui interprète les données sensitives d'après lesquelles se constitue une image mentale de la réalité de ce verre. Celui-ci n'existe que pourvu qu'il y ait un esprit pour faire la synthèse des sensations perçues et lui donner un sens. Dans l'esprit du nourrisson, le verre n'a pas encore de sens. Il ne sert pas à boire avant d'en être instruit. Il en est ainsi pour chacun des objets qui constituent notre environnement. Leur sens, leur utilité et raison d'être n'apparaît pas à première vue.
Ceci est encore plus évident pour le langage. Comment apparaît le sens des mots ? Carlo Rovelli [1] montre que c'est par la répétition. Pour le comprendre, on n'a qu'à se demander quel serait le sens d'un mot qui ne serait prononcé qu'une seule fois ? Par exemple, disons « schlumbachlick ». Ce mot, comme tout mot entendu pour la première fois n'a pas de sens. S'il ne devait jamais être répété, il n'accéderait pas à l'univers sensé. La réalité langagière naît donc de la répétition. C'est parce que nous avons déjà entendu plusieurs fois chacun des mots de la langue, que nous pouvons les employer avec l'assurance que nos interlocuteurs les comprennent. Ceci est évident pour les concepts matériels : maison, voiture, homme, poisson ; ces mots ne présentent aucune difficulté d'interprétation. Dans le langage abstrait, la nécessité de la répétition devient encore plus évidente.
Comment créer Dieu ?
On demande souvent : « Croyez-vous en Dieu ? » Certains y croient, d'autres non. Mais comment cet Être métaphysique parvient-il à recouvrir un sens pour ceux qui y croient ? Pour y croire, l'individu doit avoir été initié au concept. Le mot Dieu, prononcé pour la première fois, est d'abord un vocable neutre, un son sans connotation culturelle, un bruit. Peu à peu, après répétition et mise en contexte, il acquiert un sens. Même l'athée reconnaît un certain sens au mot, mais il refuse d'y prêter attention. Par contre, le croyant qui s'adonne à un rituel où le mot est répété, encore et encore, avec le temps et au fil des répétitions, celui-ci prendra graduellement un sens incontournable. Si pour l'athée Dieu n'est rien, pour le croyant, ce néant, à force d'en parler, de le prier, finit par avoir de la consistance. Affirmer que Dieu n'existe pas ne dit rien sur Dieu sinon qu'on refuse de lui prêter attention ; le concept rejoint la catégorie des chimères. Par contre, le croyant qui a récité encore et encore le Je crois en Dieu, ne peut comprendre l'absurdité de l'athée. Ainsi, la réalité n'est pas tant constituée de choses tangibles que d'un monde qui perd graduellement son aspect mystérieux à force de répéter, par le geste et le langage, les mots qui lui donnent sens ; l'abracadabra génère la réalité. Le culte fonde la réalité religieuse et crée le Dieu tant prié.
Et attention ! connaître le mécanisme n'enlève rien à la magie. Ce n'est pas parce que je sais que Dieu est une création du rituel qu'il est irréel ; au contraire, si je continue à le prier c'est parce que je sais que c'est la seule manière de lui donner une réalité effective dans ma vie ; nous savons que les personnages qui apparaissent à l'écran de télévision ne sont pas dans notre salon, ils n'en ont pas moins une forme de réalité qui convient parfaitement à l'usage qu'on en fait.
Ainsi en est-il de la religion, mais aussi de la réalité politique, culturelle et sociale. La culture est un ensemble de traditions et d'usages communs à un groupe ethnique et géographique. La tradition n'est que répétition. L'idée fortement répandue qui consiste à faire du religieux et du laïque deux mondes séparés nous empêche de voir que la réalité de l'un et l'autre prend son sens essentiellement dans le même type d'activité rituelle. Quelle différence y a-t-il entre le religieux qui assiste régulièrement à la messe et le téléspectateur athée assidu à une série télé ? L'un croit en Dieu, l'autre pas, mais ce faisant, leurs rituels respectifs les renforcent chacun dans un système de valeurs qui s'affermit à l'usage. La question n'est plus : « Dieu existe-t-il ? », mais plutôt : « Par quel rituel votre Dieu parvient-il à l'existence ? »
Crise de foi ! Quelle crise de foi ?
La crise de foi occidentale en est-elle vraiment une ? Si on analyse l'ensemble des valeurs mises en scène dans la culture athée et religieuse, j'y vois beaucoup plus de similarités que de divergences : amour, concorde, honneur, respect de la propriété privée, etc., ces valeurs ne figurent-elles pas autant dans le programme évangélique que profane ? On a du mal à comprendre que le contenu humain, profane et religieux, reste le même. On s'acharne sur les différences accessoires alors que l'un est tout aussi rituel que l'autre ; elles ont pour but l'émergence d'une réalité culturelle commune par la répétition. La question n'est pas : « À quel rituel êtes-vous abonné ? », mais plutôt : « Peut-on vivre hors des rituels qui façonnent nos valeurs ? »
L'Histoire montre une succession de rites s'adaptant à chaque époque et tirée par le développement technologique. L'antique théâtre grec revêtait les mêmes fonctions que la télévision : mettre en scène le registre émotionnel de l'humanité pour présenter un miroir dans lequel elle aime se contempler, et raffermir l'ensemble des valeurs du groupe par la répétition.
Ainsi convergent la sagesse bouddhiste qui voit le monde comme illusion et la modernité, où le rituel publicitaire peuple nos illusions. Depuis l'Ancien Testament en passant par Homère, la Chrétienté et l'Islam, nos rituels contemporains rivalisent pour faire passer l'Univers du néant à la réalité au moyen d'une boucle répétitive sur laquelle le monde se fonde.
« Je suis une boucle étrange » écrivait Douglas Hofstadter. Effectivement, ne sommes-nous pas tout simplement une boucle autoréférente ? Dès lors s'éclaircit la genèse de l'individu. En soi, la personne n'existe pas en tant qu'individu puisque, fondamentalement, nous sommes le même être, c'est-à-dire le même néant cherchant à se dé-néantiser (Sartre). Mais cet individu que nous sommes ne l'est devenu qu'en vertu des répétitions et rituels propres à chacun. Je suis Canadien, Montréalais ; j'appartiens à une collectivité géographique. Je suis français ; j'appartiens à une collectivité culturelle : ceci pour mon être public. Dans le privé, je suis père, mari et amant. Je suis aussi un individu isolé dans mes sensations propres. Mais tout cela participe à créer une réalité illusoire qui ne tient qu'à la pérennité des rituels qui me constituent.
.
 La pensée mystico-religieuse est l'unique forme de pensée dont l'humanité a été capable pendant des millénaires.
La pensée mystico-religieuse est l'unique forme de pensée dont l'humanité a été capable pendant des millénaires.Carlo Rovelli, Anaximandre de Milet, 2009, (p. 152)
L'obsession humaine la plus tenace est sans doute celle de l'origine. Nous sommes habités par l'interrogation permanente qui cherche à expliquer tout ce qui apparaît soudainement comme par magie dans notre champ de perception. Comment suis-je venu au monde ? Comment s'est formé l'Univers ? Quelle est l'origine de la civilisation ? Qui a inventé ceci ou cela ? Qui a écrit tel ou tel texte ? Quel philosophe a créé le concept qui occupe notre pensée ?
Mais au-delà de cette curiosité sur l'origine des choses, une question encore plus fondamentale me hante l'esprit depuis toujours : par quel moyen la réalité est-elle créée ? Quelle est la genèse de la genèse ?
Nous savons par le bouddhisme que le monde tel que nous le percevons n'est qu'illusion, mais comment cette illusion s'y prend-elle pour se présenter avec une telle réalité ? Quelle procédure de déconstruction devons-nous utiliser pour comprendre comment l'humain s'y prend pour établir sa vérité ?
Berkeley nous offre déjà un point de départ intéressant avec l'immatérialisme. Après lui, nous savons que la matière n'a aucune réalité matérielle. Seul l'esprit percevant lui attribue sa réalité. Le verre dans ma main n'a de réalité qu'en fonction de mes sens (ouïe, vue, toucher, etc.), et mes sens sont raccordés au cerveau qui interprète les données sensitives d'après lesquelles se constitue une image mentale de la réalité de ce verre. Celui-ci n'existe que pourvu qu'il y ait un esprit pour faire la synthèse des sensations perçues et lui donner un sens. Dans l'esprit du nourrisson, le verre n'a pas encore de sens. Il ne sert pas à boire avant d'en être instruit. Il en est ainsi pour chacun des objets qui constituent notre environnement. Leur sens, leur utilité et raison d'être n'apparaît pas à première vue.
Ceci est encore plus évident pour le langage. Comment apparaît le sens des mots ? Carlo Rovelli [1] montre que c'est par la répétition. Pour le comprendre, on n'a qu'à se demander quel serait le sens d'un mot qui ne serait prononcé qu'une seule fois ? Par exemple, disons « schlumbachlick ». Ce mot, comme tout mot entendu pour la première fois n'a pas de sens. S'il ne devait jamais être répété, il n'accéderait pas à l'univers sensé. La réalité langagière naît donc de la répétition. C'est parce que nous avons déjà entendu plusieurs fois chacun des mots de la langue, que nous pouvons les employer avec l'assurance que nos interlocuteurs les comprennent. Ceci est évident pour les concepts matériels : maison, voiture, homme, poisson ; ces mots ne présentent aucune difficulté d'interprétation. Dans le langage abstrait, la nécessité de la répétition devient encore plus évidente.
Comment créer Dieu ?
On demande souvent : « Croyez-vous en Dieu ? » Certains y croient, d'autres non. Mais comment cet Être métaphysique parvient-il à recouvrir un sens pour ceux qui y croient ? Pour y croire, l'individu doit avoir été initié au concept. Le mot Dieu, prononcé pour la première fois, est d'abord un vocable neutre, un son sans connotation culturelle, un bruit. Peu à peu, après répétition et mise en contexte, il acquiert un sens. Même l'athée reconnaît un certain sens au mot, mais il refuse d'y prêter attention. Par contre, le croyant qui s'adonne à un rituel où le mot est répété, encore et encore, avec le temps et au fil des répétitions, celui-ci prendra graduellement un sens incontournable. Si pour l'athée Dieu n'est rien, pour le croyant, ce néant, à force d'en parler, de le prier, finit par avoir de la consistance. Affirmer que Dieu n'existe pas ne dit rien sur Dieu sinon qu'on refuse de lui prêter attention ; le concept rejoint la catégorie des chimères. Par contre, le croyant qui a récité encore et encore le Je crois en Dieu, ne peut comprendre l'absurdité de l'athée. Ainsi, la réalité n'est pas tant constituée de choses tangibles que d'un monde qui perd graduellement son aspect mystérieux à force de répéter, par le geste et le langage, les mots qui lui donnent sens ; l'abracadabra génère la réalité. Le culte fonde la réalité religieuse et crée le Dieu tant prié.
Et attention ! connaître le mécanisme n'enlève rien à la magie. Ce n'est pas parce que je sais que Dieu est une création du rituel qu'il est irréel ; au contraire, si je continue à le prier c'est parce que je sais que c'est la seule manière de lui donner une réalité effective dans ma vie ; nous savons que les personnages qui apparaissent à l'écran de télévision ne sont pas dans notre salon, ils n'en ont pas moins une forme de réalité qui convient parfaitement à l'usage qu'on en fait.
Ainsi en est-il de la religion, mais aussi de la réalité politique, culturelle et sociale. La culture est un ensemble de traditions et d'usages communs à un groupe ethnique et géographique. La tradition n'est que répétition. L'idée fortement répandue qui consiste à faire du religieux et du laïque deux mondes séparés nous empêche de voir que la réalité de l'un et l'autre prend son sens essentiellement dans le même type d'activité rituelle. Quelle différence y a-t-il entre le religieux qui assiste régulièrement à la messe et le téléspectateur athée assidu à une série télé ? L'un croit en Dieu, l'autre pas, mais ce faisant, leurs rituels respectifs les renforcent chacun dans un système de valeurs qui s'affermit à l'usage. La question n'est plus : « Dieu existe-t-il ? », mais plutôt : « Par quel rituel votre Dieu parvient-il à l'existence ? »
Crise de foi ! Quelle crise de foi ?
La crise de foi occidentale en est-elle vraiment une ? Si on analyse l'ensemble des valeurs mises en scène dans la culture athée et religieuse, j'y vois beaucoup plus de similarités que de divergences : amour, concorde, honneur, respect de la propriété privée, etc., ces valeurs ne figurent-elles pas autant dans le programme évangélique que profane ? On a du mal à comprendre que le contenu humain, profane et religieux, reste le même. On s'acharne sur les différences accessoires alors que l'un est tout aussi rituel que l'autre ; elles ont pour but l'émergence d'une réalité culturelle commune par la répétition. La question n'est pas : « À quel rituel êtes-vous abonné ? », mais plutôt : « Peut-on vivre hors des rituels qui façonnent nos valeurs ? »
L'Histoire montre une succession de rites s'adaptant à chaque époque et tirée par le développement technologique. L'antique théâtre grec revêtait les mêmes fonctions que la télévision : mettre en scène le registre émotionnel de l'humanité pour présenter un miroir dans lequel elle aime se contempler, et raffermir l'ensemble des valeurs du groupe par la répétition.
Ainsi convergent la sagesse bouddhiste qui voit le monde comme illusion et la modernité, où le rituel publicitaire peuple nos illusions. Depuis l'Ancien Testament en passant par Homère, la Chrétienté et l'Islam, nos rituels contemporains rivalisent pour faire passer l'Univers du néant à la réalité au moyen d'une boucle répétitive sur laquelle le monde se fonde.
« Je suis une boucle étrange » écrivait Douglas Hofstadter. Effectivement, ne sommes-nous pas tout simplement une boucle autoréférente ? Dès lors s'éclaircit la genèse de l'individu. En soi, la personne n'existe pas en tant qu'individu puisque, fondamentalement, nous sommes le même être, c'est-à-dire le même néant cherchant à se dé-néantiser (Sartre). Mais cet individu que nous sommes ne l'est devenu qu'en vertu des répétitions et rituels propres à chacun. Je suis Canadien, Montréalais ; j'appartiens à une collectivité géographique. Je suis français ; j'appartiens à une collectivité culturelle : ceci pour mon être public. Dans le privé, je suis père, mari et amant. Je suis aussi un individu isolé dans mes sensations propres. Mais tout cela participe à créer une réalité illusoire qui ne tient qu'à la pérennité des rituels qui me constituent.
.
 Re: Religion et Philosophie
Re: Religion et Philosophie
Le Moi stable de Mach
 Qui possède cette connexion de sensations ? Qui en fait l'expérience ? Combien de degrés divers, peut avoir la conscience du Moi, et à partir de combien de souvenirs multiples et fortuits est-elle constituée ?
Qui possède cette connexion de sensations ? Qui en fait l'expérience ? Combien de degrés divers, peut avoir la conscience du Moi, et à partir de combien de souvenirs multiples et fortuits est-elle constituée ?
Mach, Analyse des sensations, 1922
Depuis Anaximandre nous avons coutume de penser la réalité comme un assemblage de contraires : bien/mal, beau/laid, haut/bas, etc. Platon, Descartes et à leur suite une lignée soutenue de philosophes nous ont habitués à penser l'humain comme une complémentarité binaire corps/esprit.
Mais voilà qu'au 19e siècle Dieu meurt sans que nous ayons encore mesuré toutes les conséquences. À part les considérations éthiques et religieuses, les tenants de la disparition de Dieu ont eu à reconfigurer l'ontologie humaine à partir de zéro. On a bien essayé de prolonger l'aspect divin de l'esprit en lui attribuant une réalité psychique reconduisant l'ancienne binarité ontologique, mais aujourd'hui, à l'ère des sciences neuronales, l'esprit se confond de plus en plus avec le corps.
Ernst Mach, philosophe mineur du 19e siècle, pourrait bien prendre maintenant le devant de la scène. Il fut en effet le premier penseur du monisme physicaliste avec lequel il fut désormais possible de concevoir l'humain hors du traditionnel tandem corps/esprit. Tout comme Darwin a expliqué la « création du monde » sans avoir recours à l'hypothèse « Dieu », Mach arrive à nous faire comprendre l'humain sans avoir besoin de l'hypothèse que l'esprit est une entité distincte du corps. Bien sûr l'histoire de la philosophie est peuplée de matérialistes et il ne faut pas oublier La Mettrie, noble précurseur. Mais les découvertes de Mach permettent un pas de géant grâce à ses recherches sensorielles.
La conceptualisation philosophique de Mach a le mérite supplémentaire d'expliquer comment se constitue l'individualité que le bouddhisme considère comme une illusion. Il montre par quel processus l'illusion se cristallise en sentiment identitaire.
Mais avant de sauter aux conclusions ontologiques, voyons un peu ce que le physicien propose.
Le corps est constitué de huit types de capteurs sensoriels reliés par les nerfs à une centrale nerveuse — le cerveau — qui intègre les sensations par association et conserve la trace qu'elles laissent dans le système nerveux — qu'on appelle mémoire. La mémoire n'est rien d'autre que la constitution de sensations stables, c'est-à-dire l'uniformité de nos perceptions sensitives et de leurs associations. Ceci constitue le Moi stable. Cette sensation apparait suite à la continuité perceptive.
Par exemple, assis à ma table de cuisine, tout ce que je perçois m'est familier parce que mes sens en captent le contenu de la même manière chaque jour et à chaque instant depuis longtemps. La couleur et la forme des chaises, de la table, du tapis et de tout le reste gardent une persistance continuelle. Ceci constitue ce que j'éprouve comme ma perception ; ceci crée mon sentiment d'identité. La perception de mon corps m'est si familière que chacun des gestes nécessaires pour ramasser les assiettes, jeter les déchets dans la poubelle et ranger dans le lave-vaisselle sont effectués avec la plus grande précision sans que j'aie à considérer ces choses une par une, comme le musicien maîtrise son instrument par la pratique. La persistance du monde et de son contenu est garantie par la perception que j'en ai. Si je bavarde avec un invité au souper, j'ai l'esprit tranquille tant que je perçois le four à micro-ondes à sa place, sur la tablette, dans mon champ de vision. S'il venait qu'à disparaître soudainement ou changer de forme, ou de couleur, mon sentiment d'identité serait menacé. Pire, une panique s'emparerait de moi. L'identité est un sentiment si essentiel et si puissant ; il est à la base de notre stabilité psychique. Le magicien sur scène s'en joue allègrement.
Mon ami est sujet aux mêmes perceptions, mais ses capteurs et ses habitudes de persistances mémorielles sont différents. Pas de beaucoup, mais suffisamment pour qu'il se sente différent du seul fait qu'il occupe à tout moment une autre partie de l'espace et que ses sens ont leur propre calibration. Ne se sent-on pas menacés dans notre identité lorsqu'un autre nous fait voir que ses perceptions sont manifestement différentes ? L'identité crée l'individu, mais sépare du Tout ; elle apporte la liberté, mais isole de l'ensemble. Le « vrai » jumeau vit une situation particulière où la totalité de ses perceptions se reproduit dans une sorte d'écho ontologique qui ajoute une dimension d'hyperréalité : le double garantit ses perceptions et conforte son sentiment d'exister.
Ainsi donc, le sentiment d'identité n'a rien de métaphysique ; il se constitue par la persistance de la perception sensorielle. Le cerveau et le système nerveux associent et gardent les traces de ces associations. Ceci constitue le sentiment du Moi qui n'est rien d'autre que la stabilité perceptive.
Mais en quoi le Moi disqualifie-t-il le concept dualiste corps/esprit ?
Premièrement, à l'évidence, l'esprit n'a aucune réalité effective sans le corps qui le constitue. La mort met fin à son activité tout comme l'appareil s'immobilise lorsqu'on coupe l'alimentation. La dualité corps/esprit est une association de deux entités imaginaires, commodes pour la représentation, mais le Moi ne saurait exister privé du corps. Ceci conforte la vision de Mach dans le monisme physicaliste.
Pour Mach, les sens représentent le seul accès possible au monde. Il va plus loin que Berkeley qui avait besoin de Dieu, et même s'y oppose. Celui-ci affirmait un monisme immatérialiste, c'est-à-dire un pan-spiritualisme. En posant l'esprit comme entité absolue régissant nos perceptions, il montrait que le monde matériel n'a pas d'existence en soi. Mach va plus loin en se débarrassant de l'esprit pour ne conserver que les phénomènes physiques, à commencer par le temps qu'il considère comme un sens à part entière, le premier de tous.
En effet, le temps est la première composante sensorielle dont tous les sens dépendent. La sensitivité est essentiellement changement et, pour que quelque chose change, il faut que le temps s'inscrive dans la perception. Un sens dont la perception n'est soumise à aucun changement ne perçoit rien. Fixez un point immobile et bientôt tout devient noir ; soumettez l'oreille à un bruit continu, nous n'y faisons plus attention ; de même pour l'odeur ; non plus que la main immobile qui touche quoi que ce soit d'inerte pendant plus d'une minute. Bref, les sens ne perçoivent que la variation, et l'attention se fixe naturellement sur la variation de la variation. Et la variation, c'est le temps.
La persistance dans les variations sensorielles crée le sentiment d'identité. Ajoutez à ceci que les traces laissées par les excitations sensorielles dans le système nerveux — incluant le cerveau — constituent la mémoire. Nous n'avons besoin de rien de plus pour expliquer l'être, la vie et le monde. Du coup, Dieu et l'esprit font place à la mémoire dont la constitution sensorielle explique tout.
En complément du monisme physicaliste, Mach nous propose le principe d'économie de la pensée qui répond à la dernière interrogation qui nous vient sur sa conception du monde : comment tout cela peut-il être si simple ? En fait, l'être humain est une chose complexe certes, mais somme toute passablement limitée comparée à l'immense complexité du monde qui l'entoure. L'humain n'a d'autre choix que de réduire le monde à sa mesure ; il produit donc un schéma mental au moyen de ses sensations, et ceci sera pour lui « le monde », et par le fait même son sentiment d'identité : son « Moi ».
.
 Qui possède cette connexion de sensations ? Qui en fait l'expérience ? Combien de degrés divers, peut avoir la conscience du Moi, et à partir de combien de souvenirs multiples et fortuits est-elle constituée ?
Qui possède cette connexion de sensations ? Qui en fait l'expérience ? Combien de degrés divers, peut avoir la conscience du Moi, et à partir de combien de souvenirs multiples et fortuits est-elle constituée ?Mach, Analyse des sensations, 1922
Depuis Anaximandre nous avons coutume de penser la réalité comme un assemblage de contraires : bien/mal, beau/laid, haut/bas, etc. Platon, Descartes et à leur suite une lignée soutenue de philosophes nous ont habitués à penser l'humain comme une complémentarité binaire corps/esprit.
Mais voilà qu'au 19e siècle Dieu meurt sans que nous ayons encore mesuré toutes les conséquences. À part les considérations éthiques et religieuses, les tenants de la disparition de Dieu ont eu à reconfigurer l'ontologie humaine à partir de zéro. On a bien essayé de prolonger l'aspect divin de l'esprit en lui attribuant une réalité psychique reconduisant l'ancienne binarité ontologique, mais aujourd'hui, à l'ère des sciences neuronales, l'esprit se confond de plus en plus avec le corps.
Ernst Mach, philosophe mineur du 19e siècle, pourrait bien prendre maintenant le devant de la scène. Il fut en effet le premier penseur du monisme physicaliste avec lequel il fut désormais possible de concevoir l'humain hors du traditionnel tandem corps/esprit. Tout comme Darwin a expliqué la « création du monde » sans avoir recours à l'hypothèse « Dieu », Mach arrive à nous faire comprendre l'humain sans avoir besoin de l'hypothèse que l'esprit est une entité distincte du corps. Bien sûr l'histoire de la philosophie est peuplée de matérialistes et il ne faut pas oublier La Mettrie, noble précurseur. Mais les découvertes de Mach permettent un pas de géant grâce à ses recherches sensorielles.
La conceptualisation philosophique de Mach a le mérite supplémentaire d'expliquer comment se constitue l'individualité que le bouddhisme considère comme une illusion. Il montre par quel processus l'illusion se cristallise en sentiment identitaire.
Mais avant de sauter aux conclusions ontologiques, voyons un peu ce que le physicien propose.
Le corps est constitué de huit types de capteurs sensoriels reliés par les nerfs à une centrale nerveuse — le cerveau — qui intègre les sensations par association et conserve la trace qu'elles laissent dans le système nerveux — qu'on appelle mémoire. La mémoire n'est rien d'autre que la constitution de sensations stables, c'est-à-dire l'uniformité de nos perceptions sensitives et de leurs associations. Ceci constitue le Moi stable. Cette sensation apparait suite à la continuité perceptive.
Par exemple, assis à ma table de cuisine, tout ce que je perçois m'est familier parce que mes sens en captent le contenu de la même manière chaque jour et à chaque instant depuis longtemps. La couleur et la forme des chaises, de la table, du tapis et de tout le reste gardent une persistance continuelle. Ceci constitue ce que j'éprouve comme ma perception ; ceci crée mon sentiment d'identité. La perception de mon corps m'est si familière que chacun des gestes nécessaires pour ramasser les assiettes, jeter les déchets dans la poubelle et ranger dans le lave-vaisselle sont effectués avec la plus grande précision sans que j'aie à considérer ces choses une par une, comme le musicien maîtrise son instrument par la pratique. La persistance du monde et de son contenu est garantie par la perception que j'en ai. Si je bavarde avec un invité au souper, j'ai l'esprit tranquille tant que je perçois le four à micro-ondes à sa place, sur la tablette, dans mon champ de vision. S'il venait qu'à disparaître soudainement ou changer de forme, ou de couleur, mon sentiment d'identité serait menacé. Pire, une panique s'emparerait de moi. L'identité est un sentiment si essentiel et si puissant ; il est à la base de notre stabilité psychique. Le magicien sur scène s'en joue allègrement.
Mon ami est sujet aux mêmes perceptions, mais ses capteurs et ses habitudes de persistances mémorielles sont différents. Pas de beaucoup, mais suffisamment pour qu'il se sente différent du seul fait qu'il occupe à tout moment une autre partie de l'espace et que ses sens ont leur propre calibration. Ne se sent-on pas menacés dans notre identité lorsqu'un autre nous fait voir que ses perceptions sont manifestement différentes ? L'identité crée l'individu, mais sépare du Tout ; elle apporte la liberté, mais isole de l'ensemble. Le « vrai » jumeau vit une situation particulière où la totalité de ses perceptions se reproduit dans une sorte d'écho ontologique qui ajoute une dimension d'hyperréalité : le double garantit ses perceptions et conforte son sentiment d'exister.
Ainsi donc, le sentiment d'identité n'a rien de métaphysique ; il se constitue par la persistance de la perception sensorielle. Le cerveau et le système nerveux associent et gardent les traces de ces associations. Ceci constitue le sentiment du Moi qui n'est rien d'autre que la stabilité perceptive.
Mais en quoi le Moi disqualifie-t-il le concept dualiste corps/esprit ?
Premièrement, à l'évidence, l'esprit n'a aucune réalité effective sans le corps qui le constitue. La mort met fin à son activité tout comme l'appareil s'immobilise lorsqu'on coupe l'alimentation. La dualité corps/esprit est une association de deux entités imaginaires, commodes pour la représentation, mais le Moi ne saurait exister privé du corps. Ceci conforte la vision de Mach dans le monisme physicaliste.
Pour Mach, les sens représentent le seul accès possible au monde. Il va plus loin que Berkeley qui avait besoin de Dieu, et même s'y oppose. Celui-ci affirmait un monisme immatérialiste, c'est-à-dire un pan-spiritualisme. En posant l'esprit comme entité absolue régissant nos perceptions, il montrait que le monde matériel n'a pas d'existence en soi. Mach va plus loin en se débarrassant de l'esprit pour ne conserver que les phénomènes physiques, à commencer par le temps qu'il considère comme un sens à part entière, le premier de tous.
En effet, le temps est la première composante sensorielle dont tous les sens dépendent. La sensitivité est essentiellement changement et, pour que quelque chose change, il faut que le temps s'inscrive dans la perception. Un sens dont la perception n'est soumise à aucun changement ne perçoit rien. Fixez un point immobile et bientôt tout devient noir ; soumettez l'oreille à un bruit continu, nous n'y faisons plus attention ; de même pour l'odeur ; non plus que la main immobile qui touche quoi que ce soit d'inerte pendant plus d'une minute. Bref, les sens ne perçoivent que la variation, et l'attention se fixe naturellement sur la variation de la variation. Et la variation, c'est le temps.
La persistance dans les variations sensorielles crée le sentiment d'identité. Ajoutez à ceci que les traces laissées par les excitations sensorielles dans le système nerveux — incluant le cerveau — constituent la mémoire. Nous n'avons besoin de rien de plus pour expliquer l'être, la vie et le monde. Du coup, Dieu et l'esprit font place à la mémoire dont la constitution sensorielle explique tout.
En complément du monisme physicaliste, Mach nous propose le principe d'économie de la pensée qui répond à la dernière interrogation qui nous vient sur sa conception du monde : comment tout cela peut-il être si simple ? En fait, l'être humain est une chose complexe certes, mais somme toute passablement limitée comparée à l'immense complexité du monde qui l'entoure. L'humain n'a d'autre choix que de réduire le monde à sa mesure ; il produit donc un schéma mental au moyen de ses sensations, et ceci sera pour lui « le monde », et par le fait même son sentiment d'identité : son « Moi ».
.
 Re: Religion et Philosophie
Re: Religion et Philosophie
La vie éternelle avec Parménide
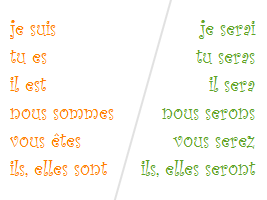 Car l'être est en effet, mais le néant n'est pas.
Car l'être est en effet, mais le néant n'est pas.
Parménide, De la nature, ~-490
L'être ne peut pas mourir, mais il faut d'abord être. C'est la seule condition de l'immortalité. Et pour être immortel il faut le savoir et y consentir (Ieschoua) sinon nous sommes condamnés à mourir, c'est-à-dire souffrir de l'angoisse face à la mort. Tout le monde existe, je veux dire, chacun est doté de l'existence, mais en mesurons-nous toutes les conséquences ? On pense mourir un jour, mais la mort n'est pas un état. Elle n'est rien. Être rien c'est « ne pas être ». Plus encore, ce n'est même pas « rien », puisqu'en disant « rien » on affirme encore quelque chose. Ce n'est même pas le silence puisqu'il faut le bruit pour distinguer. Le « néant » est tout simplement inexprimable ; l'être n'y a pas accès. Être ou ne pas être n'est pas une question ; pour se questionner, il faut d'abord exister.
Déshabillée de toute considération morale abusive comme le péché, la rédemption et le salut, on comprend que la vie éternelle ne tient qu'à l'examen et au consentement à la maxime de Parménide : « L'être est en effet, mais le néant n'est pas. » Cette petite phrase est difficile à comprendre parce que la signification profonde se cache sous une apparente lapalissade. Notre raisonnement s'arrête là où il devrait commencer. Elle n'a rien d'ésotérique, elle est seulement d'une évidence logique qui crève les yeux.
En effet, comme nous existons, nous sommes donc, et l'être que nous sommes ne pourrait pas se trouver dans un état de non-être, puisque celui qui n'est pas un « celui », n'est rien. Ceux qui croient au paradis ne seront donc pas déçus après leur mort ; non pas parce que le paradis existe, mais parce que pour être déçu, il faut être en vie .
.
La mort est donc un état impossible pour soi-même. Épicure l'explique dans le tétrapharmacon qu'il propose comme remède à l'anxiété existentielle : « Le plus effrayant des maux, la mort, ne nous est rien, disais-je : quand nous sommes, la mort n'est pas là, et quand la mort est là, c'est nous qui ne sommes pas ! Elle ne concerne donc ni les vivants ni les trépassés, étant donné que pour les uns, elle n’est point, et que les autres ne sont plus. »
Il ne s'agit pas ici de nier la maladie, l'agonie et la mort. Ces souffrances sont bien réelles et nous ne pouvons y échapper. Mais c'est le tourment du vertige infini éprouvé par l'être face à l'éventualité de l'anéantissement qu'il s'agit de traiter. Ce type de souffrance est parfaitement inutile puisqu'il ne saurait y avoir de coïncidence entre la vie et la mort. Plusieurs philosophes nous montrent comment l'éviter. Socrate et Cicéron prétendent même que là est l'objet de toute la philosophie en affirmant que philosopher, c'est apprendre à mourir.
D'un autre côté, Gorgias nous aide à comprendre le mécanisme de cette logique en l'abordant à revers. Il affirme que rien n'existe. Autrement dit, que l'être est une illusion. Pourquoi ? Parce que si l'être existe, il n'a pas eu de commencement ; l'être ne peut pas être engendré. S'il n'a pas de commencement, il est infini. Or s'il est infini, il n'est nulle part. Pourquoi ? Parce que, infini, il est partout, et que partout est un lieu qui n'existe pas. Si déjà nous n'existons pas, si la vie n'est qu'illusion, alors pourquoi s'inquiéter de disparaître ?
On peut donc conclure de l'être que, soit il existe, soit il n'existe pas. Parménide pose un regard simple sur son état personnel et conclut son existence. Gorgias opte pour l'inexistence en nous invitant à une réflexion semblable à la notion d'illusion connue du bouddhisme sous la terme maya. La science, pour sa part, ne nous est d'aucun secours ; la proposition est indécidable rationnellement (Heisenberg et Gödel). Il faut donc choisir, c'est-à-dire engager notre foi comme le propose Pascal avec son pari.
Bien sûr, il ne s'agit pas d'affirmer la foi chrétienne en la résurrection des corps tel que conçu par le folklore catholique ; non plus que ses dérivés ésotériques qui insultent tous plus ou moins l'intelligence. Il s'agit d'une démarche philosophique lucide qui ne nie rien de la science et garde toujours la porte ouverte aux questionnements. Elle conserve la possibilité de changer d'avis si des lumières plus convaincantes venaient à surgir. Mais, à moins d'éléments nouveaux, le raisonnement se vérifie toujours depuis près de 2 500 ans.
La destinée de l'être suppose maintenant trois possibilités ; ou bien il existe de toute éternité et ne disparaît jamais (Parménide), ou bien il n'est qu'illusion (Gorgias), ou bien il est limité dans le temps (naissance, vie, mort). Pour le philosophe, la dernière semble absurde non parce qu'elle effraie, mais par sa seule incohérence logique ; elle n'est vraie que pour l'observateur et ne dit rien de ce qui advient à l'être qui subit la mortalité [2]. D'autre part, si Gorgias a raison, il n'y a plus rien à dire. Enveloppée dans un immense tourbillon d'illusions, la vie n'est que méprise sur une réalité dont la vérité nous échappe entièrement. Mais cette vision paradoxale ne peut être retenue puisqu'elle mène à l'aporie ; en effet, si tout n'est qu'illusion, la pensée qui l'exprime n'est-elle pas aussi illusoire ? Avec Parménide, l'angoisse face à la mort disparaît, mais nous n'en sommes pas au bout de nos peines pour autant. En effet, si l'être que nous sommes est appelé à changer de forme n'est-il pas inquiétant de penser que nous pourrions être n'importe quoi d'autre selon l'immense variété des fantaisies naturelles ? Être cette fois-ci humain, mais quoi d'autre ensuite ? Surgit alors un autre problème métaphysique pour ceux qui, fatigués de la vie, pensaient se « reposer » après la mort dans un néant indolore.
Au choix, opterions-nous pour la vie éternelle ? Préférerions-nous recommencer encore et encore dans un éternel retour (Nietzsche) une existence sous toutes ses formes avec l'ennui et la douleur (Schopenhauer) qui l'accompagnent ? L'ère de la chrétienté proposait une perspective dont l'Occident s'est accommodé pendant longtemps. Au XIXe siècle, il s'est passé quelque chose qui nous a fait préférer le néant. Mais en quoi cette nouvelle orientation métaphysique serait-elle plus réaliste ou désirable ? Après tout, qui peut savoir ce qui advient à l'être après la mort ? La vie éternelle suggérée par Parménide procède d'une logique béton mais, inversé, le problème rebondit et reste entier. Échapperons-nous à l'angoisse de la néantisation pour gagner une existence éternelle d'ennui et de douleur ?
Être n'est désormais plus la question ; ce sont les conditions d'existence qui importent. Encastré dans un éternel présent, l'être n'a d'autre souci que d'améliorer ses conditions. Les agents d'idéologies politiques socioculturelles marchandes nous sollicitent de toutes parts, mais certains philosophes pensent que l'art pourrait ouvrir une voie plus féconde.
.
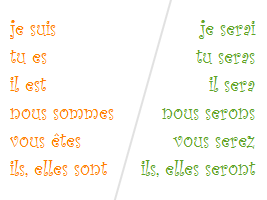 Car l'être est en effet, mais le néant n'est pas.
Car l'être est en effet, mais le néant n'est pas.Parménide, De la nature, ~-490
L'être ne peut pas mourir, mais il faut d'abord être. C'est la seule condition de l'immortalité. Et pour être immortel il faut le savoir et y consentir (Ieschoua) sinon nous sommes condamnés à mourir, c'est-à-dire souffrir de l'angoisse face à la mort. Tout le monde existe, je veux dire, chacun est doté de l'existence, mais en mesurons-nous toutes les conséquences ? On pense mourir un jour, mais la mort n'est pas un état. Elle n'est rien. Être rien c'est « ne pas être ». Plus encore, ce n'est même pas « rien », puisqu'en disant « rien » on affirme encore quelque chose. Ce n'est même pas le silence puisqu'il faut le bruit pour distinguer. Le « néant » est tout simplement inexprimable ; l'être n'y a pas accès. Être ou ne pas être n'est pas une question ; pour se questionner, il faut d'abord exister.
Déshabillée de toute considération morale abusive comme le péché, la rédemption et le salut, on comprend que la vie éternelle ne tient qu'à l'examen et au consentement à la maxime de Parménide : « L'être est en effet, mais le néant n'est pas. » Cette petite phrase est difficile à comprendre parce que la signification profonde se cache sous une apparente lapalissade. Notre raisonnement s'arrête là où il devrait commencer. Elle n'a rien d'ésotérique, elle est seulement d'une évidence logique qui crève les yeux.
En effet, comme nous existons, nous sommes donc, et l'être que nous sommes ne pourrait pas se trouver dans un état de non-être, puisque celui qui n'est pas un « celui », n'est rien. Ceux qui croient au paradis ne seront donc pas déçus après leur mort ; non pas parce que le paradis existe, mais parce que pour être déçu, il faut être en vie
 .
.La mort est donc un état impossible pour soi-même. Épicure l'explique dans le tétrapharmacon qu'il propose comme remède à l'anxiété existentielle : « Le plus effrayant des maux, la mort, ne nous est rien, disais-je : quand nous sommes, la mort n'est pas là, et quand la mort est là, c'est nous qui ne sommes pas ! Elle ne concerne donc ni les vivants ni les trépassés, étant donné que pour les uns, elle n’est point, et que les autres ne sont plus. »
Il ne s'agit pas ici de nier la maladie, l'agonie et la mort. Ces souffrances sont bien réelles et nous ne pouvons y échapper. Mais c'est le tourment du vertige infini éprouvé par l'être face à l'éventualité de l'anéantissement qu'il s'agit de traiter. Ce type de souffrance est parfaitement inutile puisqu'il ne saurait y avoir de coïncidence entre la vie et la mort. Plusieurs philosophes nous montrent comment l'éviter. Socrate et Cicéron prétendent même que là est l'objet de toute la philosophie en affirmant que philosopher, c'est apprendre à mourir.
D'un autre côté, Gorgias nous aide à comprendre le mécanisme de cette logique en l'abordant à revers. Il affirme que rien n'existe. Autrement dit, que l'être est une illusion. Pourquoi ? Parce que si l'être existe, il n'a pas eu de commencement ; l'être ne peut pas être engendré. S'il n'a pas de commencement, il est infini. Or s'il est infini, il n'est nulle part. Pourquoi ? Parce que, infini, il est partout, et que partout est un lieu qui n'existe pas. Si déjà nous n'existons pas, si la vie n'est qu'illusion, alors pourquoi s'inquiéter de disparaître ?
On peut donc conclure de l'être que, soit il existe, soit il n'existe pas. Parménide pose un regard simple sur son état personnel et conclut son existence. Gorgias opte pour l'inexistence en nous invitant à une réflexion semblable à la notion d'illusion connue du bouddhisme sous la terme maya. La science, pour sa part, ne nous est d'aucun secours ; la proposition est indécidable rationnellement (Heisenberg et Gödel). Il faut donc choisir, c'est-à-dire engager notre foi comme le propose Pascal avec son pari.
Bien sûr, il ne s'agit pas d'affirmer la foi chrétienne en la résurrection des corps tel que conçu par le folklore catholique ; non plus que ses dérivés ésotériques qui insultent tous plus ou moins l'intelligence. Il s'agit d'une démarche philosophique lucide qui ne nie rien de la science et garde toujours la porte ouverte aux questionnements. Elle conserve la possibilité de changer d'avis si des lumières plus convaincantes venaient à surgir. Mais, à moins d'éléments nouveaux, le raisonnement se vérifie toujours depuis près de 2 500 ans.
La destinée de l'être suppose maintenant trois possibilités ; ou bien il existe de toute éternité et ne disparaît jamais (Parménide), ou bien il n'est qu'illusion (Gorgias), ou bien il est limité dans le temps (naissance, vie, mort). Pour le philosophe, la dernière semble absurde non parce qu'elle effraie, mais par sa seule incohérence logique ; elle n'est vraie que pour l'observateur et ne dit rien de ce qui advient à l'être qui subit la mortalité [2]. D'autre part, si Gorgias a raison, il n'y a plus rien à dire. Enveloppée dans un immense tourbillon d'illusions, la vie n'est que méprise sur une réalité dont la vérité nous échappe entièrement. Mais cette vision paradoxale ne peut être retenue puisqu'elle mène à l'aporie ; en effet, si tout n'est qu'illusion, la pensée qui l'exprime n'est-elle pas aussi illusoire ? Avec Parménide, l'angoisse face à la mort disparaît, mais nous n'en sommes pas au bout de nos peines pour autant. En effet, si l'être que nous sommes est appelé à changer de forme n'est-il pas inquiétant de penser que nous pourrions être n'importe quoi d'autre selon l'immense variété des fantaisies naturelles ? Être cette fois-ci humain, mais quoi d'autre ensuite ? Surgit alors un autre problème métaphysique pour ceux qui, fatigués de la vie, pensaient se « reposer » après la mort dans un néant indolore.
Au choix, opterions-nous pour la vie éternelle ? Préférerions-nous recommencer encore et encore dans un éternel retour (Nietzsche) une existence sous toutes ses formes avec l'ennui et la douleur (Schopenhauer) qui l'accompagnent ? L'ère de la chrétienté proposait une perspective dont l'Occident s'est accommodé pendant longtemps. Au XIXe siècle, il s'est passé quelque chose qui nous a fait préférer le néant. Mais en quoi cette nouvelle orientation métaphysique serait-elle plus réaliste ou désirable ? Après tout, qui peut savoir ce qui advient à l'être après la mort ? La vie éternelle suggérée par Parménide procède d'une logique béton mais, inversé, le problème rebondit et reste entier. Échapperons-nous à l'angoisse de la néantisation pour gagner une existence éternelle d'ennui et de douleur ?
Être n'est désormais plus la question ; ce sont les conditions d'existence qui importent. Encastré dans un éternel présent, l'être n'a d'autre souci que d'améliorer ses conditions. Les agents d'idéologies politiques socioculturelles marchandes nous sollicitent de toutes parts, mais certains philosophes pensent que l'art pourrait ouvrir une voie plus féconde.
.
Page 3 sur 5 •  1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5 
 Sujets similaires
Sujets similaires» Socrate Naissance De La Philosophie
» """Comment la philosophie peut nous sauver"""
» Islam et philosophie
» La Philosophie de Platon
» Histoire de la Philosophie
» """Comment la philosophie peut nous sauver"""
» Islam et philosophie
» La Philosophie de Platon
» Histoire de la Philosophie
Forum Religion : Le Forum des Religions Pluriel :: ○ Science / Histoire :: Gnose/Philo :: Philosophie
Page 3 sur 5
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum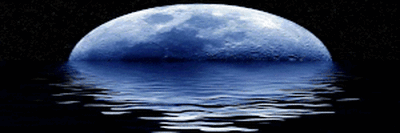
 S'enregistrer
S'enregistrer


