Religion et Philosophie
Forum Religion : Le Forum des Religions Pluriel :: ○ Science / Histoire :: Gnose/Philo :: Philosophie
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 •  1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5
 Religion et Philosophie
Religion et Philosophie
Rappel du premier message :
Religion & philosophie
On a suffisamment remarqué que la religion1 et la philosophie peuvent être rapprochées, notamment par les questions communes qu’elles se posent : celles de la place de l’homme dans la nature, du bien et du mal, et d’autres encore. En outre, quelques théologiens ont “emprunté” aux philosophes certains de leurs concepts et de leurs formes de raisonnement, comme saint Thomas d’Aquin à Aristote. La réciproque existe également, par exemple dans le concept philosophique de Dieu. Enfin, nombre de philosophes se sont réclamés ou se réclament d’une religion particulière. Ce sont là quelques unes des raisons de se demander si une philosophie peut être religieuse ou si une religion peut être philosophique2. Bien que la réponse soit évidemment positive pour beaucoup, nous tenterons de montrer ici que la religion comme la philosophie ne peuvent que se perdre elles-mêmes, c’est-à-dire renoncer à ce qui les caractérise respectivement, dans une telle “union”.
Pour étayer notre réponse, il nous faudra pour commencer déterminer quelques unes des propriétés spécifiques de la religion d’une part, de la philosophie d’autre part.
1. Considérations générales sur la religion et la philosophie
Il semble que la notion de révélation soit la première spécificité de la religion au sens habituel du terme – celui, précisément, de religion révélée3 –, dans la mesure où elle est la condition même de la possibilité d’une religion : aucune ne prétend en effet être une émanation de l’homme seul ; il faut donc qu’un principe extérieur à l’humanité soit en mesure de transmettre à celle-ci, quelle qu’en soit la manière, ce qui définira la religion en question. C’est cette transmission que nous appelons ici révélation.
Quant au principe lui-même, les cas du Bouddhisme et de quelques autres religions orientales suffisent à empêcher qu’on le définisse par le terme de divinité : il y a des religions sans dieu. Mais ces cas ne sont pas vraiment gênants, car on peut se référer plus largement à la notion de sacré ; la religion est alors ce qui met l’homme en rapport avec le sacré4. On peut ajouter que le sacré, bien qu’il se réfère, selon les religions, à des actions, des choses ou des entités fort diverses, doit être caractérisé dans chaque religion comme un absolu. Autrement dit, la sacralités de ce qui est sacré ne peut pas, à l’intérieur d’une religion donnée, être discutée, remise en cause ou a fortiori niée5. Il y a plus encore : l’affirmation de la sacralité de ce qui est sacré se présente comme le fondement de la religion concernée6, fondement qui, justement parce qu’il est indiscutable, n’a pas à être expliqué. Et dans tous les cas, les éventuelles “justifications” théologiques de ce fondement n’appartiennent pas en propre à la religion concernée. Nous voulons dire par là que premièrement, elles sont toujours développées a posteriori, et bien souvent dans un but plus didactique que véritablement religieux. Deuxièmement et en conséquence, elles sont au bout du compte facultatives, au sens où leur absence n’affaiblirait pas la religion en elle-même. Troisièmement, elles sont inutiles pour l’authentique croyant dont la foi n’a nul besoin d’explication. On peut même, d’un certain point de vue, les considérer comme nuisibles pour cette religion, dans la mesure où elles paraissent sous-entendre que le fondement de la religion en question ne va pas de soi. Autrement dit, les justifications rationnelles d’une religion prennent toujours le risque d’être perçues comme des aveux de faiblesse d’une doctrine qui aurait besoin de “se justifier”, au sens péjoratif de l’expression.
Que dire, dès lors, de la philosophie ? Pas plus que pour la religion, nous ne chercherons à la définir mais, ce qui sera ici suffisant, à la caractériser. Il semble que l’on peut dire de la philosophie l’exact opposé de ce qui vient d’être dit de la religion. Reprenons les points l’un après l’autre.
La seule idée de révélation rendra a priori le philosophe, au mieux, perplexe. Que pourrait en dire en effet la raison, pierre de touche de la recevabilité d’une argumentation philosophique ? Descartes ne s’y est pas trompé : « Je révérais notre théologie, et prétendais, autant qu’un autre, à gagner le ciel ; mais ayant appris, comme chose très assurée, que le chemin n’en est pas moins ouvert aux plus ignorants qu’aux plus doctes, et que les vérités révélées, qui y conduisent, sont au-dessus de notre intelligence, je n’eusse osé les soumettre à la faiblesse de mes raisonnements, et je pensais que, pour entreprendre de les examiner, et y réussir, il était besoin d’avoir quelque extraordinaire assistance du ciel, et d’être plus qu’homme. »7 Notons que ces lignes ne contredisent en rien les textes où le même Descartes traite de Dieu, des preuves de son existence, de sa nature, et ainsi de suite, par exemple dans les Méditations, puisqu’il ne s’agit pas alors de vérités révélées, mais bien de vérités rationnelles, donc accessibles au philosophe. Autrement dit, la religion et indirectement le passage ci-dessus traitent du “Dieu des religions”, alors que c’est du “Dieu des philosophes” que Descartes affirme certaines propriétés.
Prenant un exemple de vérité révélée, Spinoza va plus loin : « Quand certaines Églises ajoutent que Dieu a pris une forme humaine, j’ai expressément averti que je ne sais pas ce qu’elles veulent dire ; et même, à dire vrai, affirmer cela ne me paraît pas moins absurde que de dire que le cercle a pris la forme d’un carré. »8
D’une manière générale, nul ne saurait nier que, souvent, les “vérités révélées” déconcertent, pour ne pas dire plus, la raison. Cela ne signifie pas pour autant que, pour cette seule raison, le philosophe doive les rejeter inconditionnellement. Un tel rejet ne se justifie que pour un certain courant philosophique, à savoir le rationalisme9. Mais pour accepter positivement l’idée qu’une révélation, tout en étant manifestement irrationnelle, est source de vérité, il faudra franchir un pas qui, d’après nous, fait sortir de la philosophie. Le philosophe le plus “ouvert” aux religions ne peut donc qu’être réservé quant à l’idée même de révélation. Comment d’ailleurs choisirait-il entre les diverses religions ? Le philosophe ne peut, comme le font la quasi-totalité des croyants, adopter une religion uniquement en fonction de la société à laquelle il appartient par sa naissance et par son éducation10.
Concernant le contenu des dogmes eux-mêmes, le philosophe devra selon nous adopter la même prudence. On peut sans doute s’entendre pour considérer qu’en aucun cas le philosophe n’acceptera une “vérité” qui, sans être évidente en elle-même, ne s’accompagne d’aucune justification théorique. Or nous avons remarqué précédemment que le fondement d’une religion n’est précisément jamais justifié a priori ; quand il l’est a posteriori, ce ne peut donc être que par une personne qui l’a au préalable admis sans une telle justification. Comment le philosophe pourrait-il avaliser cette admission ? Comment pourrait-il ne pas dénoncer la justification a posteriori comme une imposture visant à légitimer philosophiquement une prise de position qui ne fut pas, au départ, philosophique ? Le fondement d’une philosophie ne saurait être lui-même extérieur à la philosophie. Or la religion, et elle s’en félicite, trouve son principe hors de l’humanité, donc hors de la philosophie. Nous reviendrons sur ce point dans la troisième partie de cette étude.
De même, le philosophe ne pourra pas ne pas trouver contraire à la philosophie le refus de remettre en cause ou même seulement de “discuter” de certains dogmes, et singulièrement l’affirmation de la sacralité. On objectera peut-être que les philosophes eux-mêmes considèrent parfois certaines de leurs “vérités” comme indiscutables, sans qu’on leur refuse pour cela le titre de philosophe. La différence, de taille, est que le philosophe produira toujours, même lorsqu’il prétend énoncer une vérité indiscutable, une justification théorique l’accompagnant – ne serait-ce que l’affirmation de son évidence rationnelle, qui ne saurait sérieusement valoir pour les vérités révélées. De plus, il ne refusera jamais de répondre à une éventuelle objection11, pour peu qu’elle soit philosophiquement intelligible, et ne menacera aucun contestataire des flammes de l’enfer.
On peut donc conclure que sans justification théorique, une proposition, quelle qu’elle soit, ne peut prétendre être philosophique. Autrement dit, le sens et la valeur de la philosophie ne résident pas moins dans l’argumentation des thèses que dans les thèses elles-mêmes, ce qui ne saurait raisonnablement se dire de quelque religion que ce soit.
Plus généralement, on pourrait dire que, si la religion est acceptée, elle rend la philosophie, pour une importante partie, inutile. En effet, certains dogmes religieux peuvent être considérés comme des réponses non philosophiques à des questions que se posent aussi les philosophes. Aussi le philosophe qui cherche à répondre, philosophiquement, à ces mêmes questions, entreprend-il une tâche ridicule du point de vue de la religion : sans pouvoir se targuer de la même “infaillibilité” que les religions, car la philosophie n’est qu’humaine – trop humaine ? –, il va chercher des réponses peu fiables – et, de fait, ses “collègues” philosophes ne se priveront pas de les critiquer – alors qu’il en existe déjà, et de beaucoup plus sûres, puisque d’essence bien souvent divine, et en tous cas non sujettes à la faillibilité humaine. Il ne restera donc au philosophe qu’à s’occuper de domaines que la religion a bien voulu négliger, car ne touchant manifestement pas, selon elle, au “salut” de l’homme : l’épistémologie ou l’esthétique par exemple. Mais pour les questions de métaphysique, d’éthique, d’anthropologie au sens large et parfois de politique, le débat doit être considéré, du point de vue religieux, comme clos. A l’opposé, on peut considérer que, du point de vue du philosophe, les questions philosophiques n’ont pour lui de raison d’être que s’il estime qu’elles n’ont pas encore reçu de réponse complète et définitive, émanant d’une religion quelconque, d’un autre philosophe ou de quelque autre source que ce soit. C’est seulement en acceptant cette “vacuité” que la philosophie a un sens.
Au fond, et on le verra mieux dans les deux cas précis étudiés ci-après, pour les philosophes religieux, la philosophie ne peut servir qu’à “redécouvrir” par la raison ce que la foi, par le biais de la révélation, a déjà enseigné. Cette conception de la philosophie comme « servante de la théologie », héritée du Moyen-Âge, ne peut pas disparaître si l’on admet, avant de philosopher, la vérité d’une religion. Et, même si l’on fait mine de se défendre d’adopter une telle conception, on voit mal comment il en serait autrement : « la vérité ne peut contredire la vérité », et si une vérité est admise au préalable – la vérité religieuse –, on sait déjà, avant même de commencer à philosopher, que la deuxième – la vérité philosophique – sera identique à la première ou au moins compatible avec elle ; il reste seulement à trouver des arguments philosophiques pour appuyer cette vérité unique, mais à deux visages. C’est par exemple la position de Jean-Paul II qui ouvre ainsi l’encyclique Fides et ratio : « La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l’esprit humain de s’élever vers la contemplation de la vérité »12. Mais si la métaphore est juste, les deux ailes doivent nécessairement voler de manière concordante. Le chemin et le but étant bien sûr déterminés, dès l’envol, par l’aile de la foi, l’aile de la raison n’a plus qu’à s’y plier…
On pourrait ici nous faire l’objection suivante : certes, si la religion est admise avant que la réflexion philosophique soit engagée, les jeux sont faits, et la philosophie n’en sera pas vraiment une, puisque sa fin, dans les deux sens du terme, est déjà connue, et surtout a été déterminée de l’extérieur de la philosophie. Mais qu’est-ce qui empêche un philosophe de découvrir au préalable, par la philosophie, des vérités dont il remarquera ensuite la conformité avec une religion donnée, adoptant ainsi cette dernière après, et non avant, la naissance de sa réflexion philosophique ? Nous ne pouvons ici qu’acquiescer sur le plan théorique. Si un tel itinéraire de pensée existait, c’est sans hésitation que nous lui accorderions le statut de philosophie. Deux remarques s’imposent toutefois :
– Premièrement, nous ne pouvons manquer de signaler l’extrême difficulté théorique d’un tel cheminement, ainsi que l’impossibilité pratique de vérifier l’ordre de ses étapes, telles qu’elles ont été décrites ci-dessus. Il est en effet indéniable que, dans la quasi-totalité des cas, la religion apparaît bien avant la philosophie dans l’existence d’un individu. Lorsque l’esprit de l’adolescent est suffisamment mûr pour philosopher, la religion y est souvent déjà présente depuis bien longtemps. Il est vrai que certains ont su se dégager de l’influence de l’éducation religieuse qu’ils ont reçue. Mais on voit bien que, sauf exception rarissime, c’est toujours la religion qui précède la philosophie dans l’histoire d’un homme. De qui peut-on donc affirmer qu’il a “redécouvert” dans la religion ce qu’il avait découvert dans la philosophie ?
– Deuxièmement, même si une philosophie parvenait à justifier philosophiquement tous les dogmes voire toutes les pratiques d’une religion donnée, cette philosophie n’aurait qu’une conformité extérieure et même fortuite avec cette religion, puisque la seule justification véritable d’une religion est la révélation et que celle-ci est, par définition, hors de portée de toute justification philosophique. Autrement dit, une telle philosophie ne serait pas vraiment religieuse.
Il faut à présent confronter les analyses générales qui précèdent à des cas concrets qui pourraient sembler les invalider. En premier lieu, pour “tester” notre thèse selon laquelle il ne peut exister de philosophie religieuse, nous étudierons les textes de deux philosophes en accord avec une certaine religion (en l’occurrence le Christianisme). En second lieu, pour vérifier qu’une religion philosophique est impossible, notre attention se portera sur religion particulière dont certains affirment le caractère philosophique.
Une remarque méthodologique s’impose ici. Des exemples, aussi nombreux soient-ils, ne constituent pas des preuves en eux-mêmes. Ils ne jouent ici qu’un rôle d’illustration, en vue de rendre concrète notre thèse.
2. Les philosophies de Leibniz et de Kant sont-elles des philosophies religieuses ?
Les “philosophies religieuses” que nous allons maintenant étudier sont celles de Leibniz et de Kant13. Nous ne prétendons pas ici livrer une analyse intégrale de la philosophie de la religion de ces auteurs, mais seulement indiquer le ou les moments où, selon nous, ils ont “glissé” de l’intérieur à l’extérieur de la philosophie pour tenter de justifier leur croyance religieuse. Un passage du début du Discours de métaphysique de Leibniz suffira à montrer ce que nous considérons comme une “sortie injustifiée” hors de la philosophie, injustifiée en ceci seulement qu’elle prétend prendre place dans une argumentation philosophique, tant dans le problème étudié que dans la méthode adoptée. Cela signifie que, en dehors de son activité philosophique, un philosophe peut fort bien écrire des textes exposant des vérités révélées – ou de la littérature, ou quoi que ce soit… –, à condition qu’il n’affirme ni ne sous-entende qu’il s’agit là de textes philosophiques ; or c’est précisément le cas de l’ouvrage évoqué ici, comme l’indique clairement son titre.
Après avoir défini Dieu comme étant « un être absolument parfait » et expliqué ce qu’on doit entendre par le concept de perfection, Leibniz conclut « que Dieu possédant la sagesse suprême et infinie agit de la manière la plus parfaite » et « que plus on sera éclairé et informé des ouvrages de Dieu, plus on sera disposé à les trouver excellents et entièrement satisfaisants à tout ce qu’on aurait pu souhaiter. » Bien qu’il y ait dans ces lignes matière à de nombreuses objections, nous sommes ici dans la philosophie, précisément parce que ces objections peuvent être elles-mêmes de nature philosophique. Il nous semble en revanche que Leibniz sort de la philosophie lorsqu’il écrit :
« Ainsi, je suis fort éloigné du sentiment de ceux qui soutiennent qu’il n’y a point de règle de bonté et de perfection dans la nature des choses, ou dans les idées que Dieu en a et que les ouvrages de Dieu ne sont bons que pour cette raison formelle que Dieu les a faits. Car si cela était, Dieu sachant qu’il en est l’auteur n’avait que faire de les regarder par après et de les trouver bons, comme le témoigne la sainte écriture. »14
L’importance de l’argument de l’autorité biblique est ici prépondérante : Dieu a regardé ses ouvrages et les a trouvés bons, car c’est ce qu’affirment l’écriture, qualifiée de “sainte” sans justification. Or il nous semble que le philosophe n’est pas tenu de croire a priori en la divinité de l’origine des Écritures. Mais, une fois admise l’autorité de la Bible, le passage ci-dessus ne se prête à aucune objection philosophique : dès lors, il est en quelque sorte “infalsifiable” au sens que Popper donne à ce terme. Aucun débat philosophique n’est plus possible. Le raisonnement de Leibniz, entièrement explicité, est en effet le suivant :
1. La Bible a été inspirée par Dieu.
2. Or Dieu possède toutes les perfections morales, dont celle d’être vérace.
3. Donc la Bible dit la vérité.
4. Or la Bible dit que Dieu, après avoir créé certaines de ses œuvres, vit qu’elles étaient bonnes (par exemple : « Dieu dit : “Que les eaux qui sont sous le ciel s’amassent en une seule masse et qu’apparaisse le continent” et il en fut ainsi. Dieu appela le continent “Terre” et la masse des eaux “mers”, et Dieu vit que cela était bon. »15)
5. Donc Dieu a pu constater, ou plus précisément “vérifier”, la bonté de ses œuvres en les regardant.
6. Donc les choses sont bonnes intrinsèquement, c’est-à-dire que la bonté est en elles-mêmes, et non pas extrinsèquement, c’est-à-dire seulement parce que Dieu en est l’auteur ou la cause.
On peut indifféremment inverser l’ordre des propositions 1. et 2. Il reste que la divinité des Écritures est un pilier de cette démonstration, et donc que sa remise en cause implique celle de tout le raisonnement. Or il semble clair que l’affirmation « La Bible a été inspirée par Dieu » n’est pas et ne peut pas être une thèse philosophique16, c’est-à-dire une affirmation susceptible d’être fondée et contredite par des arguments philosophiques – si du moins on se réfère au sens que Leibniz donne ici au mot “Dieu”, c’est-à-dire au sens religieux.
Nous affirmons donc que le raisonnement de Leibniz extrait du Discours de métaphysique n’est pas, par son fondement, philosophique, et plus généralement que tout système de pensée fondé sur une quelconque révélation, sans que la raison vienne justifier ce fondement17, ne saurait être qualifié de philosophie.
Pour Spinoza en revanche, la question de la divinité des Écritures peut se poser en termes philosophiques, mais en donnant au concept de Dieu un sens qui n’est assurément pas le sens religieux. Lorsqu’il écrit en effet : « (…) la plupart, en vue de comprendre l’Écriture et d’en dégager le vrai sens, posent pour commencer la divine vérité de son texte intégral. (Alors que cette conclusion devrait découler d’un examen sévère de son contenu.) »18, il est clair que l’expression « divine vérité » est quasiment, sous sa plume, un pléonasme, et donc que c’est en examinant le texte biblique lui-même que l’on pourra conclure qu’il dit la vérité – ou non –, et donc qu’il exprime la “divine vérité”. Pour Leibniz, la Bible dit vrai parce que Dieu en est l’auteur19 ; c’est du moins ce qu’on peut supposer en l’absence de toute autre justification.
Dans La religion dans les limites de la simple raison, Kant va tenter de montrer que le Christianisme n’est pas seulement un « religion révélée », étant apparue à une époque et un endroit précis, mais également une « religion naturelle », c’est-à-dire, en droit, universelle et mondiale : chaque homme, quelles que soient son époque et sa société, et pour autant qu’il soit doué de raison, peut reconnaître que les principes moraux enseignés par le Christianisme sont identiques à ceux que sa raison pratique lui dicte. Pour démontrer cette identité, Kant va se livrer à une exégèse détaillée du Sermon sur la montagne20, texte qui contient d’après lui l’essentiel des préceptes moraux du Christianisme. Ce que Kant relève notamment dans le Sermon, c’est qu’il enjoint de suivre l’esprit de la loi plutôt que la lettre. On retrouve ici la distinction faite par Kant dans les Fondements de la métaphysique des mœurs entre “agir par devoir” et “agir conformément au devoir”. Ainsi du fameux passage :
« Vous avez entendu qu’il a été dit : “Tu ne commettras pas l’adultère”. Eh bien ! Moi je vous dis : quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis, dans son cœur, l’adultère avec elle. »21
Kant comprend ces versets comme dénonçant l’hypocrisie d’une conduite extérieure ou plus précisément physique, seulement conforme extérieurement à l’interdiction de l’adultère22 – consistant à ne pas commettre l’acte de l’adultère –, et qui l’enfreint néanmoins si le désir est bien réel. Plus généralement, Kant rappelle que l’enseignement du Christ n’est pas supposé être différent de la loi hébraïque23, mais qu’il a interprété la Loi pour montrer sa conformité à la raison pratique : « Car au pied de la lettre, la loi autorisait exactement le contraire »24 de ce qu’autorise l’interprétation du Christ, dit Kant.
Remarquons que pour parvenir à la conviction que la Bible est en conformité avec la raison pratique, il a fallu tout d’abord que le Christ interprète la loi hébraïque, c’est-à-dire qu’il en révèle l’esprit en la débarrassant d’une lecture « au pied de la lettre », puis que Kant lui-même interprète les paroles du Christ pour montrer qu’elles ne sont qu’une autre formulation, sans doute plus accessible au plus grand nombre, de la loi morale prise en elle-même, énoncée en termes philosophiques.
C’est donc au prix de deux interprétations successives – celle de la loi hébraïque par le Christ puis celle des paroles du Christ par Kant – que l’on parvient à montrer la conformité de l’enseignement biblique avec la raison pratique. Et c’est bien là la première objection que l’on peut faire à Kant : une religion naturelle étant universelle, tout homme doit pouvoir accéder aux vérités qu’elle enseigne. S’il est déjà déconcertant que Dieu transmette aux hommes un texte énonçant une loi morale qu’il a, de toute façon, “inscrite” en tout homme possédant la raison pratique, il est encore plus étonnant que ce texte doive dans certains cas – l’Ancien Testament – “subir” tour à tour deux interprétations, dont le moins que l’on puisse dire est qu’elles ne vont pas de soi25, pour au bout du compte énoncer ce que tous savaient déjà avant ! Si l’on ajoute que le texte d’origine, supposé être inspiré par Dieu, enseigne selon Kant lui-même des choses opposées selon qu’on le prend à la lettre ou qu’on en dégage l’esprit, on comprend difficilement la valeur et la légitimité d’un tel texte. Kant ne cherche-t-il pas plutôt à “asseoir” la légitimité de sa philosophie morale sur l’autorité du Christianisme ? Sur le plan philosophique, qu’importe après tout que la “vraie” morale, que Kant prétend enseigner, soit ou non celle d’une religion institutionnelle, fût-ce la religion dominante ?
On peut également contester la prééminence et même l’exclusivité que Kant accorde au Christianisme en matière de morale : « Mais, suivant la religion morale (et parmi toutes les religions publiques qu’il y eut jamais, seule la religion chrétienne a ce caractère) … »26 Cette affirmation, écrite entre parenthèses, comme semblant si peu contestable qu’elle se passe de justification, a évidemment de quoi choquer par son intolérance. Mais elle déconcerte également celui qui a pris note du fait que le Christianisme n’enseigne en fin de compte rien de plus que le Judaïsme. Si le Christ, selon ses propres paroles, vient pour accomplir la Loi et les Prophètes27, c’est bien qu’il n’y a aucune différence de fond entre le Judaïsme et le Christianisme28. Si différence il y a, ce ne peut pas être une différence telle que le second serait une, ou plutôt “la” religion morale, ce que ne serait pas le premier ! Plus précisément, pour Kant, si le Judaïsme n’est pas une religion morale, c’est parce que, comme toutes les religions sauf le Christianisme, il comporte en lui la recherche des faveurs divines.
Cette délicate question tourne plus ou moins directement autour de ce qu’on appelle la morale de la rétribution, c’est-à-dire une morale qui affirme que les pieux et les justes sont récompensés et que les impies et les méchants sont punis. S’il est incontestable que la Bible hébraïque enseigne parfois une telle morale29, des livres comme ceux de Job30 et de l’Ecclésiaste la condamnent catégoriquement31 – ce dont Kant ne tient pas compte – en remarquant que le juste subit parfois des maux “naturels”, donc d’origine divine, et que la fortune sourit parfois au méchant. Chacun est alors invité à s’en remettre à la sagesse divine sans chercher à en percer les desseins.
Supposons toutefois que cette immoralité du Judaïsme soit fondée ce qui, on le voit, ne va pas de soi. Le plus paradoxal est encore que Kant, en critiquant indirectement la morale juive, condamne nécessairement la Bible hébraïque, où la morale de la rétribution apparaît effectivement. Or cette Bible hébraïque est, quelques différences infimes mises à part, reprise par le Christianisme à son propre compte sous le nom d’Ancien Testament. La recherche des faveurs est-elle présente ou absente des mêmes textes, selon qu’ils sont lus par les Juifs ou par les Chrétiens ? Il y a là encore, semble-t-il, une très forte partialité de Kant en faveur du Christianisme, partialité qu’une véritable neutralité philosophique a priori aurait rendue, selon nous, impossible. Nous affirmons bien que cette neutralité devrait exister a priori, sans qu’elle doive nécessairement se prolonger a posteriori. Mais Kant ne justifie par aucun argument philosophique la suprématie du Christianisme dans le domaine morale. On pourrait d’ailleurs remarquer que le Nouveau Testament n’est pas non plus exempt de passages exprimant une morale de la rétribution32, ce que Kant, là encore, passe sous silence.
Dans la même logique, il écrit : « Il n’existe qu’une religion (vraie) »33. Mais comment le Christianisme pourrait-il être la vraie religion s’il est, selon les paroles de Jésus lui-même, l’accomplissement d’une fausse religion, en l’occurrence le Judaïsme ?
Enfin34, Kant nous semble également faire preuve d’une précipitation suspecte et fort peu philosophique lorsqu’il écrit : « J’admets premièrement la proposition suivante, comme principe n’ayant pas besoin de preuve : Tout ce que l’homme pense pouvoir faire, hormis la bonne conduite, pour se rendre agréable à Dieu est simplement illusion religieuse et faux culte de Dieu »35. Non pas que nous pensions, le lecteur l’aura compris, que bien d’autres comportements sont susceptibles de plaire à Dieu ; mais ce qui est ici affirmé presque explicitement, c’est que la bonne conduite d’un homme le rend agréable à Dieu. Voilà certes une proposition qui aurait selon nous besoin de preuve, si cela était possible. A vrai dire, il peut sembler au contraire que l’idée d’un Dieu sensible aux comportements humains a quelque chose d’irrespectueux, pour ne pas dire d’hérétique, à moins d’affirmer que Kant utilise un langage anthropomorphique, ce que rien ne laisse supposer.
Bien d’autres remarques seraient possibles pour confirmer, avec celles qui précèdent, que Kant fait reposer sa philosophie morale sur un fondement non philosophique, mais bel et bien religieux a priori, donc non argumenté rationnellement.
3. Le Catholicisme est-il une religion philosophique ?
Nous allons à présent examiner un cas de religion prétendant ou pouvant prétendre être philosophique. Si nous choisissons le Catholicisme, ce n’est pas essentiellement parce qu’il est la religion plus répandue dans nos sociétés dites latines, mais surtout parce qu’il s’est doté d’une théologie plus “systématique” que d’autres religions, à la fois par sa “fréquentation” de la philosophie occidentale et par sa structure très hiérarchisée, qui ont permis l’établissement d’une doctrine unifiée et officielle, à l’abri, normalement, de toute contestation interne, ce qui facilite d’ailleurs grandement la recherche des références.
Quelques remarques préalables s’imposent toutefois. Nous avons déjà évoqué l’idée selon laquelle le fondement d’une philosophie ne saurait être “extra-philosophique”. C’est pourquoi la manière dont débute une philosophie est capitale. Notons que ce “début” n’est pas forcément – et, dans les faits, n’est que rarement – premier chronologiquement dans l’œuvre d’un philosophe. Ainsi le doute radical de Descartes est bien le début “logique” de sa philosophie sans apparaître dans ses premières œuvres. Si certains philosophes semblent ne pas s’être particulièrement souciés de ce “début philosophique”, ce ne peut être que parce qu’ils considèrent qu’il n’y a pas à proprement parler à fonder la philosophie, ou encore parce que toute réflexion philosophique peut servir de fondement à la philosophie.
Il ne saurait en aller de même dans une religion, dont le point de départ, à savoir la révélation, est toujours extérieur à la raison et même, plus largement, à l’homme. En fait, nous avons déjà rencontré ce cas de figure dans les textes de Leibniz et de Kant étudiés plus haut, dont nous avons montré qu’ils s’appuyaient sur des données spécifiquement religieuses, donc impossibles à argumenter philosophiquement.
Nous allons retrouver cette extériorité dans le fondement du Catholicisme : « Au point de départ de toute réflexion que l’Église entreprend, il y a la conscience d’être dépositaire d’un message qui a son origine en Dieu même (…). La connaissance qu’elle propose à l’homme ne vient pas de sa propre spéculation, fût-ce la plus élevée, mais du fait d’avoir accueilli la parole de Dieu dans la foi »36. Les choses sont donc claires : les vérités religieuses, auxquelles les hommes peuvent accéder par la révélation, préexistent à toute réflexion humaine. En raison de leur origine divine, elles sont infaillibles. Avant même d’inaugurer la moindre réflexion, le philosophe catholique sait donc vers quoi doit tendre sa philosophie. Celle-ci n’a par conséquent qu’un rôle secondaire de confirmation a posteriori de “vérités” admises comme vraies avant toute intervention de la raison philosophique. C’est donc en toute logique que Jean-Paul II écrit : « L’Église, pour sa part, ne peut qu’apprécier les efforts de la raison pour atteindre des objectifs qui rendent l’existence personnelle toujours plus digne. Elle voit en effet dans la philosophie le moyen de connaître des vérités fondamentales concernant l’existence de l’homme. En même temps, elle considère la philosophie comme une aide indispensable pour approfondir l’intelligence de la foi et pour communiquer la vérité de l’Évangile à ceux qui ne la connaissent pas encore »37. Ce que nous considérons comme contraire à la philosophie dans ces lignes, ce n’est pas, encore une fois, la position elle-même, c’est-à-dire la fonction “évangélisatrice” assignée à la philosophie, mais le fait que cette position soit assignée de l’extérieur de la philosophie, c’est-à-dire sans argumentation rationnelle. Dans la même logique, le pape condamne au terme de son encyclique un certain nombre de courants de pensée : l’éclectisme, l’historicisme, le scientisme, le pragmatisme et le nihilisme38. Ces doctrines sont considérées à la fois comme des « erreurs » et des « dangers ». C’est dire qu’il aurait mieux valu qu’elles ne soient jamais formulées. On ne peut là encore que refuser de qualifier de philosophie une pensée qui se voudrait sans “adversaire”, même intellectuel ; nous estimons en effet que l’esprit critique et l’ouverture à la contestation doivent être des soucis constants du philosophe, conscient qu’il est, et ne peut qu’être, de ne pouvoir se prévaloir d’aucune infaillibilité. Autrement dit, le philosophe a philosophiquement intérêt à être contesté, afin de tester la validité de sa pensée. Au contraire, une doctrine d’origine “surhumaine” ne peut avoir, envers une contestation humaine, qu’une attitude de commisération, d’indifférence, de mépris ou de violence, mais pas véritablement, on ne le voit que trop, d’écoute véritable.
On peut donc admettre que les “vérités religieuses” précèdent toute réflexion philosophique. Mais, objectera-t-on peut-être, la foi dans ces vérités religieuses ne peut-elle pas, quant à elle, être justifiée philosophiquement… ? Pas davantage, comme le reconnaît, là encore, le dogme catholique : « Le motif de croire n’est pas que les vérités révélées apparaissent comme vraies et intelligibles à la lumière de notre raison naturelle »39. Toutefois, pour que la foi soit conforme à la raison, Dieu a mis en œuvre des « preuves extérieures de sa Révélation » : « les miracles du Christ et des saints40, les prophéties, la propagation et la sainteté de l’Église, sa fécondité et sa stabilité ». La raison du philosophe trouvera-t-elle dans cette liste des preuves ou des « signes certains » de la révélation chrétienne ? Accordons au moins que cela n’est pas évident…
Conclusion
L’examen des “philosophies religieuses” de Leibniz et Kant a montré diverses “failles”, non pas en tant qu’erreurs à l’intérieur de leur philosophie, mais précisément en tant que manquements à l’exigence philosophique d’une argumentation rationnelle et donc de refus d’un quelconque argument d’autorité, fût-ce l’autorité de la Bible.
Nous pouvons donc conclure qu’une “philosophie religieuse” est soit extérieure à la religion, si la philosophie “précède” la religion41, soit extérieure à la philosophie si, comme nous croyons l’avoir montré pour les deux cas étudiés, la religion “précède” la philosophie. Cela ne signifie bien entendu pas que le philosophe soit par définition irréligieux. Dans la mesure où il est homme “avant” d’être philosophe, il pourra, comme Leibniz, Kant et beaucoup d’autres, croire en Dieu et même appartenir à une religion précise. Mais il devra renoncer à légitimer sa foi, ses croyances et ses pratiques par des arguments philosophiques, et donc renoncer à intégrer sa religion dans sa philosophie. Il pourra seulement – et même en tant que croyant, il devra probablement – expliquer pourquoi sa philosophie doit forcément laisser une place, hors d’elle (au-dessus, dira-t-il sûrement), à la religion. Il pourra par exemple, à la manière d’un Pascal, essayer de montrer que la raison et donc la philosophie peuvent reconnaître elles-mêmes leurs propres limites : « La dernière démarche de la raison est de reconnaître qu’il y a une infinité de choses qui la surpassent ; elle n’est que faible, si elle ne va jusqu’à connaître cela. »42
Le philosophe peut donc être religieux, mais il ne peut pas l’être en tant que philosophe. La philosophie peut indiscutablement aller jusqu’au déisme ou au théisme, mais le pas qui mène du théisme à une religion révélée est précisément le pas qui fait sortir de la philosophie.
L’hypothèse d’une religion philosophique, du fait du nécessaire fondement non humain de toute religion, est elle aussi, dès le départ, à exclure.
Quant à l’athéisme, il n’est jamais que le refus d’une certaine conception de Dieu ou des dieux. On peut le voir par exemple avec Spinoza qui, tout en démontrant l’existence de Dieu43, peut bien être considéré comme “athée”, au sens où il refuse l’existence d’un Dieu anthropomorphe44. On le voit encore avec Marcel Conche, qui s’attaque précisément à l’idée d’un Dieu à la fois moralement bon et tout-puissant : « Il est indubitable (…) que le supplice des enfants a été, et devait ne pas être, et que Dieu pouvait faire qu’il ne soit pas. Comme Dieu ne s’est pas manifesté dans des circonstances où, moralement, il l’aurait dû, s’il existait, il serait coupable. La notion d’un Dieu coupable et méchant apparaissant contradictoire, il faut conclure que Dieu n’est pas. »45 Nous n’affirmons certes pas que cette argumentation, non plus que les démonstrations de l’existence de Dieu de Spinoza, sont à l’abri de toute contestation, y compris philosophique. Mais nous avons bien là des exemples de raisonnement parfaitement intelligible, que même le plus fervent des croyants peut suivre, pour peu qu’il soit doué de raison. L’athéisme peut donc être philosophique ou, ce qui revient au même, une philosophie peut être athée.
On se méprendrait en voyant dans cette étude une attaque contre les religions en général. Nous avons même indiqué à plusieurs reprises que l’attitude des religieux est très souvent en parfaite cohérence avec leurs convictions. Nous avons uniquement cherché à montrer en quoi religion et philosophie, sans forcément se combattre mutuellement, ne peuvent pas s’unir sans une dangereuse “confusion des genres”. Pour les deux partis, une telle union ne serait donc pas pour le meilleur mais seulement pour le pire…
Marc Anglaret
(écrire à cet auteur)
Commentaire
1 Nous considérerons ici les religions dans leur approximative unité, et plus précisément dans leur rapport à la philosophie.
2 Ces deux questions reviennent, au bout du compte, au même, mais au bout du compte seulement.
3 Nous reviendrons, avec l’examen de la position kantienne, sur la distinction entre religion naturelle et religion révélée.
4 Nous précisons bien qu’il ne s’agit pas là de donner une définition, avec tout ce que cette opération implique, de la religion, mais bien de la distinguer de la philosophie.
5 La question n’est pas ici celle de l’intolérance des religions, fort diverses sur ce point comme sur d’autres, mais celle du statut de l’affirmation de la sacralité au sein même d’une religion. Nous soutenons ici que cette affirmation se présente toujours comme indubitable, au point que toute éventuelle critique à ce sujet doit être considérée comme “déplacée”, dans le meilleur des cas…
6 Nous distinguons ici le fondement d’une religion, c’est-à-dire la ou les croyances, toujours liées au sacré selon nous, sur lesquelles s’appuient les autres croyances, de son principe, qui n’est pas une croyance mais l’origine de sa révélation : par exemple Dieu dans les religions monothéistes.
7 Discours de la méthode, première partie. NRF Gallimard, « La Pléiade », p.130. C’est nous qui soulignons.
8 Lettre LXXIII à Oldenburg (1675). NRF Gallimard, « La Pléiade », p.1283. Ce célèbre passage devrait suffire à éviter toute “récupération” du spinozisme par le Christianisme – ce qui, dans les faits, n’est pas le cas.
9 On objectera que certains philosophes habituellement qualifiés de rationalistes – par exemple Leibniz – admettent les vérités révélées de certaines religions, notamment le Christianisme. Nous étudierons précisément plus loin le cas de Leibniz, en montrant pourquoi il ne peut pas, selon nous, être pleinement considéré comme rationaliste.
10 Il n’a toutefois échappé à personne que, par une étrange coïncidence, les philosophes croyants adoptent dans la quasi-totalité des cas la religion de leur éducation, familiale notamment, et ce pas seulement dans le cas du Christianisme, comme le montrent les cas d’Averroès et de Maïmonide par exemple. Nous ne connaissons pas de contre-exemple sur ce point (Schopenhauer ne peut pas, par exemple, être sérieusement qualifié de “philosophe bouddhiste”, bien qu’il se soit lui-même reconnu dans certaines thèses du Bouddhisme).
11 Nous pensons par exemple aux Objections faites aux Méditations de Descartes, ou à la correspondance de nombre de philosophes.
12 Jean-Paul II, Fides et ratio (la foi et la raison), I, prologue ; lettre encyclique du 14 septembre 1998. Supplément au quotidien « La Croix » du 16 octobre 1998, p.3
13 D’autres philosophies pourraient bien sûr avoir leur place ici, par exemple celle de Hegel. C’est pour ne pas rendre cette étude trop volumineuse que nous avons choisi ces deux exemples, à la fois pour leur relative simplicité et leur représentativité. Par ailleurs, il est certain que l’examen de “philosophies religieuses” non chrétiennes manque à cette étude. Notre quasi-ignorance en la matière est la raison de cette absence.
14 Discours de métaphysique, 1, II. Éditions Vrin, p.26. C’est nous qui soulignons.
15 Genèse, 1, 9 –10. C’est nous qui soulignons.
16 A fortiori ne peut-elle pas être la thèse d’un philosophe rationaliste, qualificatif que l’on attribue souvent à Leibniz.
17 Et pour cause : nous croyons avoir montré plus haut qu’une telle justification est impossible ; au moins devrait-elle être tentée par Leibniz s’il entend se placer dans une perspective philosophique.
18 Spinoza, Traité des autorités théologique et politique, préface. NRF Gallimard, « La Pléiade », p.612
19 Selon Spinoza, au contraire, on pourrait dire que Dieu est l’auteur de la Bible seulement si elle dit vrai (ce qui reste donc à démontrer rationnellement), mais en donnant au mot “Dieu” un sens qui exclut toute révélation : toute la première partie de l’Éthique, intitulée “de Dieu”, est exempte de la moindre allusion biblique ou théologique.
20 Évangile selon Matthieu, chapitres 5 à 7.
21 Évangile selon Matthieu, 5, 27 – 28.
22 Interdiction formulée dans le septième des dix commandements (Exode, 20, 14).
23 Évangile selon Matthieu, 5, 17 : « N’allez pas croire que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. »
24 La religion dans les limites de la simple raison, IV, 1, 1. Éditions Vrin, p.179
25 Puisque dans les deux cas, de nombreux siècles se sont écoulés entre le texte et son interprétation : de la rédaction du Décalogue dans l’Exode à l’interprétation qu’en fait Jésus dans les Évangiles d’une part, de la rédaction des Évangiles à l’interprétation qu’en fait Kant d’autre part.
26 La religion dans les limites de la simple raison, op. cit., I, Remarque générale. p.92. C’est nous qui soulignons.
27 Cf. note 23.
28 … ou plus exactement entre le Judaïsme et l’enseignement de Jésus, car rien dans les paroles de ce dernier n’indique clairement qu’il voulait fonder une nouvelle religion, mais plutôt, comme on l’a dit (note 23), qu’il était venu pour « accomplir » le Judaïsme.
29 Par exemple : « Si le juste ici-bas reçoit son salaire, combien plus le méchant et le pécheur » (Proverbes, 11, 31 ; le terme « salaire » est ici sans ambiguïté). Bien d’autres versets, dans ce livre ou dans d’autres, sont tout aussi explicites.
30 Dans le livre de Job, Yahvé, par l’intermédiaire de Satan, “éprouve” la foi de Job, homme riche et pieux, en détruisant ses biens, en faisant tuer ses serviteurs et ses enfants, puis en le frappant de maladie. Job, conformément aux prédictions de Satan et contre celles de Yahvé, reproche à ce dernier son injustice. La “leçon” du livre, donnée par Yahvé lui-même, est que nul ne doit se permettre de juger son Dieu, et ce même s’il lui semble injuste. Cela dit, Job recouvre à la fin du récit tout ce qu’il a perdu : la morale de la rétribution est confirmée, bien que le propos “officiel” du livre la condamne.
31 Les théologiens appellent cela une « évolution » de la doctrine biblique, terme certes moins brutale que celui de « contradiction »…
32 Par exemple : « C’est qu’en effet le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de son Père, et alors, il rendra à chacun selon sa conduite » (Évangile selon Matthieu, 16, 27).
33 La religion dans les limites de la simple raison, op. cit., III, 1, 5. p.137
34 Il n’y a bien entendu nulle prétention à l’exhaustivité dans ces quelques remarques.
35 La religion dans les limites de la simple raison, op. cit., IV, 2, 2. p.188
36 Jean-Paul II, Fides et ratio, I, 7 ; op. cit., p.5
37 Ibid., I, 5 ; p.4. C’est nous qui soulignons.
38 Ibid., VII, 86 - 90 ; pp.31 - 32.
39 Catéchisme de l’Église Catholique, première partie, chapitre troisième, article I, 3, §156. Mame / Plon, p.44
40 Mais que faire alors de ce verset : « « Il surgira, en effet, des faux Christ et des faux prophètes, qui produiront de grands signes et des prodiges, au point d’abuser, s’il était possible, même les élus. » (Évangile selon Matthieu, 24, 24).
41 On peut ici se reporter aux deux remarques précédant l’analyse de la “philosophie religieuse” de Leibniz, en haut de la page 4.
42 Pascal, Pensées, fragment 267 de l’établissement de Brunschvicg (188 de Lafuma). Garnier-Flammarion, p.266. Concernant les Pensées en général, il est bien malaisé de dire s’il s’agit bien là d’un ouvrage philosophique au sens où nous l’avons expliqué plus haut. En fait, certains fragments le sont sans aucun doute, comme celui du pari (Brunschvicg : 233 ; Lafuma : 418). D’autres ne le sont manifestement pas, comme ceux sur les « preuves de Jésus-Christ » (Brunschvicg : 737 et suivants), qui ne s’adressent pas à la raison, mais bien à la foi éventuelle du lecteur.
43 Éthique, I, proposition 11. NRF Gallimard, « La Pléiade », pp.317 – 319.
44 Appendice de la première partie de l’Éthique et Traité des autorités théologique et politique, surtout les chapitres I à XII.
45 Marcel Conche, Orientation philosophique. I. “La souffrance des enfants comme mal absolu”. P.U.F. p.57
Religion et Philosophie
Religion & philosophie
On a suffisamment remarqué que la religion1 et la philosophie peuvent être rapprochées, notamment par les questions communes qu’elles se posent : celles de la place de l’homme dans la nature, du bien et du mal, et d’autres encore. En outre, quelques théologiens ont “emprunté” aux philosophes certains de leurs concepts et de leurs formes de raisonnement, comme saint Thomas d’Aquin à Aristote. La réciproque existe également, par exemple dans le concept philosophique de Dieu. Enfin, nombre de philosophes se sont réclamés ou se réclament d’une religion particulière. Ce sont là quelques unes des raisons de se demander si une philosophie peut être religieuse ou si une religion peut être philosophique2. Bien que la réponse soit évidemment positive pour beaucoup, nous tenterons de montrer ici que la religion comme la philosophie ne peuvent que se perdre elles-mêmes, c’est-à-dire renoncer à ce qui les caractérise respectivement, dans une telle “union”.
Pour étayer notre réponse, il nous faudra pour commencer déterminer quelques unes des propriétés spécifiques de la religion d’une part, de la philosophie d’autre part.
1. Considérations générales sur la religion et la philosophie
Il semble que la notion de révélation soit la première spécificité de la religion au sens habituel du terme – celui, précisément, de religion révélée3 –, dans la mesure où elle est la condition même de la possibilité d’une religion : aucune ne prétend en effet être une émanation de l’homme seul ; il faut donc qu’un principe extérieur à l’humanité soit en mesure de transmettre à celle-ci, quelle qu’en soit la manière, ce qui définira la religion en question. C’est cette transmission que nous appelons ici révélation.
Quant au principe lui-même, les cas du Bouddhisme et de quelques autres religions orientales suffisent à empêcher qu’on le définisse par le terme de divinité : il y a des religions sans dieu. Mais ces cas ne sont pas vraiment gênants, car on peut se référer plus largement à la notion de sacré ; la religion est alors ce qui met l’homme en rapport avec le sacré4. On peut ajouter que le sacré, bien qu’il se réfère, selon les religions, à des actions, des choses ou des entités fort diverses, doit être caractérisé dans chaque religion comme un absolu. Autrement dit, la sacralités de ce qui est sacré ne peut pas, à l’intérieur d’une religion donnée, être discutée, remise en cause ou a fortiori niée5. Il y a plus encore : l’affirmation de la sacralité de ce qui est sacré se présente comme le fondement de la religion concernée6, fondement qui, justement parce qu’il est indiscutable, n’a pas à être expliqué. Et dans tous les cas, les éventuelles “justifications” théologiques de ce fondement n’appartiennent pas en propre à la religion concernée. Nous voulons dire par là que premièrement, elles sont toujours développées a posteriori, et bien souvent dans un but plus didactique que véritablement religieux. Deuxièmement et en conséquence, elles sont au bout du compte facultatives, au sens où leur absence n’affaiblirait pas la religion en elle-même. Troisièmement, elles sont inutiles pour l’authentique croyant dont la foi n’a nul besoin d’explication. On peut même, d’un certain point de vue, les considérer comme nuisibles pour cette religion, dans la mesure où elles paraissent sous-entendre que le fondement de la religion en question ne va pas de soi. Autrement dit, les justifications rationnelles d’une religion prennent toujours le risque d’être perçues comme des aveux de faiblesse d’une doctrine qui aurait besoin de “se justifier”, au sens péjoratif de l’expression.
Que dire, dès lors, de la philosophie ? Pas plus que pour la religion, nous ne chercherons à la définir mais, ce qui sera ici suffisant, à la caractériser. Il semble que l’on peut dire de la philosophie l’exact opposé de ce qui vient d’être dit de la religion. Reprenons les points l’un après l’autre.
La seule idée de révélation rendra a priori le philosophe, au mieux, perplexe. Que pourrait en dire en effet la raison, pierre de touche de la recevabilité d’une argumentation philosophique ? Descartes ne s’y est pas trompé : « Je révérais notre théologie, et prétendais, autant qu’un autre, à gagner le ciel ; mais ayant appris, comme chose très assurée, que le chemin n’en est pas moins ouvert aux plus ignorants qu’aux plus doctes, et que les vérités révélées, qui y conduisent, sont au-dessus de notre intelligence, je n’eusse osé les soumettre à la faiblesse de mes raisonnements, et je pensais que, pour entreprendre de les examiner, et y réussir, il était besoin d’avoir quelque extraordinaire assistance du ciel, et d’être plus qu’homme. »7 Notons que ces lignes ne contredisent en rien les textes où le même Descartes traite de Dieu, des preuves de son existence, de sa nature, et ainsi de suite, par exemple dans les Méditations, puisqu’il ne s’agit pas alors de vérités révélées, mais bien de vérités rationnelles, donc accessibles au philosophe. Autrement dit, la religion et indirectement le passage ci-dessus traitent du “Dieu des religions”, alors que c’est du “Dieu des philosophes” que Descartes affirme certaines propriétés.
Prenant un exemple de vérité révélée, Spinoza va plus loin : « Quand certaines Églises ajoutent que Dieu a pris une forme humaine, j’ai expressément averti que je ne sais pas ce qu’elles veulent dire ; et même, à dire vrai, affirmer cela ne me paraît pas moins absurde que de dire que le cercle a pris la forme d’un carré. »8
D’une manière générale, nul ne saurait nier que, souvent, les “vérités révélées” déconcertent, pour ne pas dire plus, la raison. Cela ne signifie pas pour autant que, pour cette seule raison, le philosophe doive les rejeter inconditionnellement. Un tel rejet ne se justifie que pour un certain courant philosophique, à savoir le rationalisme9. Mais pour accepter positivement l’idée qu’une révélation, tout en étant manifestement irrationnelle, est source de vérité, il faudra franchir un pas qui, d’après nous, fait sortir de la philosophie. Le philosophe le plus “ouvert” aux religions ne peut donc qu’être réservé quant à l’idée même de révélation. Comment d’ailleurs choisirait-il entre les diverses religions ? Le philosophe ne peut, comme le font la quasi-totalité des croyants, adopter une religion uniquement en fonction de la société à laquelle il appartient par sa naissance et par son éducation10.
Concernant le contenu des dogmes eux-mêmes, le philosophe devra selon nous adopter la même prudence. On peut sans doute s’entendre pour considérer qu’en aucun cas le philosophe n’acceptera une “vérité” qui, sans être évidente en elle-même, ne s’accompagne d’aucune justification théorique. Or nous avons remarqué précédemment que le fondement d’une religion n’est précisément jamais justifié a priori ; quand il l’est a posteriori, ce ne peut donc être que par une personne qui l’a au préalable admis sans une telle justification. Comment le philosophe pourrait-il avaliser cette admission ? Comment pourrait-il ne pas dénoncer la justification a posteriori comme une imposture visant à légitimer philosophiquement une prise de position qui ne fut pas, au départ, philosophique ? Le fondement d’une philosophie ne saurait être lui-même extérieur à la philosophie. Or la religion, et elle s’en félicite, trouve son principe hors de l’humanité, donc hors de la philosophie. Nous reviendrons sur ce point dans la troisième partie de cette étude.
De même, le philosophe ne pourra pas ne pas trouver contraire à la philosophie le refus de remettre en cause ou même seulement de “discuter” de certains dogmes, et singulièrement l’affirmation de la sacralité. On objectera peut-être que les philosophes eux-mêmes considèrent parfois certaines de leurs “vérités” comme indiscutables, sans qu’on leur refuse pour cela le titre de philosophe. La différence, de taille, est que le philosophe produira toujours, même lorsqu’il prétend énoncer une vérité indiscutable, une justification théorique l’accompagnant – ne serait-ce que l’affirmation de son évidence rationnelle, qui ne saurait sérieusement valoir pour les vérités révélées. De plus, il ne refusera jamais de répondre à une éventuelle objection11, pour peu qu’elle soit philosophiquement intelligible, et ne menacera aucun contestataire des flammes de l’enfer.
On peut donc conclure que sans justification théorique, une proposition, quelle qu’elle soit, ne peut prétendre être philosophique. Autrement dit, le sens et la valeur de la philosophie ne résident pas moins dans l’argumentation des thèses que dans les thèses elles-mêmes, ce qui ne saurait raisonnablement se dire de quelque religion que ce soit.
Plus généralement, on pourrait dire que, si la religion est acceptée, elle rend la philosophie, pour une importante partie, inutile. En effet, certains dogmes religieux peuvent être considérés comme des réponses non philosophiques à des questions que se posent aussi les philosophes. Aussi le philosophe qui cherche à répondre, philosophiquement, à ces mêmes questions, entreprend-il une tâche ridicule du point de vue de la religion : sans pouvoir se targuer de la même “infaillibilité” que les religions, car la philosophie n’est qu’humaine – trop humaine ? –, il va chercher des réponses peu fiables – et, de fait, ses “collègues” philosophes ne se priveront pas de les critiquer – alors qu’il en existe déjà, et de beaucoup plus sûres, puisque d’essence bien souvent divine, et en tous cas non sujettes à la faillibilité humaine. Il ne restera donc au philosophe qu’à s’occuper de domaines que la religion a bien voulu négliger, car ne touchant manifestement pas, selon elle, au “salut” de l’homme : l’épistémologie ou l’esthétique par exemple. Mais pour les questions de métaphysique, d’éthique, d’anthropologie au sens large et parfois de politique, le débat doit être considéré, du point de vue religieux, comme clos. A l’opposé, on peut considérer que, du point de vue du philosophe, les questions philosophiques n’ont pour lui de raison d’être que s’il estime qu’elles n’ont pas encore reçu de réponse complète et définitive, émanant d’une religion quelconque, d’un autre philosophe ou de quelque autre source que ce soit. C’est seulement en acceptant cette “vacuité” que la philosophie a un sens.
Au fond, et on le verra mieux dans les deux cas précis étudiés ci-après, pour les philosophes religieux, la philosophie ne peut servir qu’à “redécouvrir” par la raison ce que la foi, par le biais de la révélation, a déjà enseigné. Cette conception de la philosophie comme « servante de la théologie », héritée du Moyen-Âge, ne peut pas disparaître si l’on admet, avant de philosopher, la vérité d’une religion. Et, même si l’on fait mine de se défendre d’adopter une telle conception, on voit mal comment il en serait autrement : « la vérité ne peut contredire la vérité », et si une vérité est admise au préalable – la vérité religieuse –, on sait déjà, avant même de commencer à philosopher, que la deuxième – la vérité philosophique – sera identique à la première ou au moins compatible avec elle ; il reste seulement à trouver des arguments philosophiques pour appuyer cette vérité unique, mais à deux visages. C’est par exemple la position de Jean-Paul II qui ouvre ainsi l’encyclique Fides et ratio : « La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l’esprit humain de s’élever vers la contemplation de la vérité »12. Mais si la métaphore est juste, les deux ailes doivent nécessairement voler de manière concordante. Le chemin et le but étant bien sûr déterminés, dès l’envol, par l’aile de la foi, l’aile de la raison n’a plus qu’à s’y plier…
On pourrait ici nous faire l’objection suivante : certes, si la religion est admise avant que la réflexion philosophique soit engagée, les jeux sont faits, et la philosophie n’en sera pas vraiment une, puisque sa fin, dans les deux sens du terme, est déjà connue, et surtout a été déterminée de l’extérieur de la philosophie. Mais qu’est-ce qui empêche un philosophe de découvrir au préalable, par la philosophie, des vérités dont il remarquera ensuite la conformité avec une religion donnée, adoptant ainsi cette dernière après, et non avant, la naissance de sa réflexion philosophique ? Nous ne pouvons ici qu’acquiescer sur le plan théorique. Si un tel itinéraire de pensée existait, c’est sans hésitation que nous lui accorderions le statut de philosophie. Deux remarques s’imposent toutefois :
– Premièrement, nous ne pouvons manquer de signaler l’extrême difficulté théorique d’un tel cheminement, ainsi que l’impossibilité pratique de vérifier l’ordre de ses étapes, telles qu’elles ont été décrites ci-dessus. Il est en effet indéniable que, dans la quasi-totalité des cas, la religion apparaît bien avant la philosophie dans l’existence d’un individu. Lorsque l’esprit de l’adolescent est suffisamment mûr pour philosopher, la religion y est souvent déjà présente depuis bien longtemps. Il est vrai que certains ont su se dégager de l’influence de l’éducation religieuse qu’ils ont reçue. Mais on voit bien que, sauf exception rarissime, c’est toujours la religion qui précède la philosophie dans l’histoire d’un homme. De qui peut-on donc affirmer qu’il a “redécouvert” dans la religion ce qu’il avait découvert dans la philosophie ?
– Deuxièmement, même si une philosophie parvenait à justifier philosophiquement tous les dogmes voire toutes les pratiques d’une religion donnée, cette philosophie n’aurait qu’une conformité extérieure et même fortuite avec cette religion, puisque la seule justification véritable d’une religion est la révélation et que celle-ci est, par définition, hors de portée de toute justification philosophique. Autrement dit, une telle philosophie ne serait pas vraiment religieuse.
Il faut à présent confronter les analyses générales qui précèdent à des cas concrets qui pourraient sembler les invalider. En premier lieu, pour “tester” notre thèse selon laquelle il ne peut exister de philosophie religieuse, nous étudierons les textes de deux philosophes en accord avec une certaine religion (en l’occurrence le Christianisme). En second lieu, pour vérifier qu’une religion philosophique est impossible, notre attention se portera sur religion particulière dont certains affirment le caractère philosophique.
Une remarque méthodologique s’impose ici. Des exemples, aussi nombreux soient-ils, ne constituent pas des preuves en eux-mêmes. Ils ne jouent ici qu’un rôle d’illustration, en vue de rendre concrète notre thèse.
2. Les philosophies de Leibniz et de Kant sont-elles des philosophies religieuses ?
Les “philosophies religieuses” que nous allons maintenant étudier sont celles de Leibniz et de Kant13. Nous ne prétendons pas ici livrer une analyse intégrale de la philosophie de la religion de ces auteurs, mais seulement indiquer le ou les moments où, selon nous, ils ont “glissé” de l’intérieur à l’extérieur de la philosophie pour tenter de justifier leur croyance religieuse. Un passage du début du Discours de métaphysique de Leibniz suffira à montrer ce que nous considérons comme une “sortie injustifiée” hors de la philosophie, injustifiée en ceci seulement qu’elle prétend prendre place dans une argumentation philosophique, tant dans le problème étudié que dans la méthode adoptée. Cela signifie que, en dehors de son activité philosophique, un philosophe peut fort bien écrire des textes exposant des vérités révélées – ou de la littérature, ou quoi que ce soit… –, à condition qu’il n’affirme ni ne sous-entende qu’il s’agit là de textes philosophiques ; or c’est précisément le cas de l’ouvrage évoqué ici, comme l’indique clairement son titre.
Après avoir défini Dieu comme étant « un être absolument parfait » et expliqué ce qu’on doit entendre par le concept de perfection, Leibniz conclut « que Dieu possédant la sagesse suprême et infinie agit de la manière la plus parfaite » et « que plus on sera éclairé et informé des ouvrages de Dieu, plus on sera disposé à les trouver excellents et entièrement satisfaisants à tout ce qu’on aurait pu souhaiter. » Bien qu’il y ait dans ces lignes matière à de nombreuses objections, nous sommes ici dans la philosophie, précisément parce que ces objections peuvent être elles-mêmes de nature philosophique. Il nous semble en revanche que Leibniz sort de la philosophie lorsqu’il écrit :
« Ainsi, je suis fort éloigné du sentiment de ceux qui soutiennent qu’il n’y a point de règle de bonté et de perfection dans la nature des choses, ou dans les idées que Dieu en a et que les ouvrages de Dieu ne sont bons que pour cette raison formelle que Dieu les a faits. Car si cela était, Dieu sachant qu’il en est l’auteur n’avait que faire de les regarder par après et de les trouver bons, comme le témoigne la sainte écriture. »14
L’importance de l’argument de l’autorité biblique est ici prépondérante : Dieu a regardé ses ouvrages et les a trouvés bons, car c’est ce qu’affirment l’écriture, qualifiée de “sainte” sans justification. Or il nous semble que le philosophe n’est pas tenu de croire a priori en la divinité de l’origine des Écritures. Mais, une fois admise l’autorité de la Bible, le passage ci-dessus ne se prête à aucune objection philosophique : dès lors, il est en quelque sorte “infalsifiable” au sens que Popper donne à ce terme. Aucun débat philosophique n’est plus possible. Le raisonnement de Leibniz, entièrement explicité, est en effet le suivant :
1. La Bible a été inspirée par Dieu.
2. Or Dieu possède toutes les perfections morales, dont celle d’être vérace.
3. Donc la Bible dit la vérité.
4. Or la Bible dit que Dieu, après avoir créé certaines de ses œuvres, vit qu’elles étaient bonnes (par exemple : « Dieu dit : “Que les eaux qui sont sous le ciel s’amassent en une seule masse et qu’apparaisse le continent” et il en fut ainsi. Dieu appela le continent “Terre” et la masse des eaux “mers”, et Dieu vit que cela était bon. »15)
5. Donc Dieu a pu constater, ou plus précisément “vérifier”, la bonté de ses œuvres en les regardant.
6. Donc les choses sont bonnes intrinsèquement, c’est-à-dire que la bonté est en elles-mêmes, et non pas extrinsèquement, c’est-à-dire seulement parce que Dieu en est l’auteur ou la cause.
On peut indifféremment inverser l’ordre des propositions 1. et 2. Il reste que la divinité des Écritures est un pilier de cette démonstration, et donc que sa remise en cause implique celle de tout le raisonnement. Or il semble clair que l’affirmation « La Bible a été inspirée par Dieu » n’est pas et ne peut pas être une thèse philosophique16, c’est-à-dire une affirmation susceptible d’être fondée et contredite par des arguments philosophiques – si du moins on se réfère au sens que Leibniz donne ici au mot “Dieu”, c’est-à-dire au sens religieux.
Nous affirmons donc que le raisonnement de Leibniz extrait du Discours de métaphysique n’est pas, par son fondement, philosophique, et plus généralement que tout système de pensée fondé sur une quelconque révélation, sans que la raison vienne justifier ce fondement17, ne saurait être qualifié de philosophie.
Pour Spinoza en revanche, la question de la divinité des Écritures peut se poser en termes philosophiques, mais en donnant au concept de Dieu un sens qui n’est assurément pas le sens religieux. Lorsqu’il écrit en effet : « (…) la plupart, en vue de comprendre l’Écriture et d’en dégager le vrai sens, posent pour commencer la divine vérité de son texte intégral. (Alors que cette conclusion devrait découler d’un examen sévère de son contenu.) »18, il est clair que l’expression « divine vérité » est quasiment, sous sa plume, un pléonasme, et donc que c’est en examinant le texte biblique lui-même que l’on pourra conclure qu’il dit la vérité – ou non –, et donc qu’il exprime la “divine vérité”. Pour Leibniz, la Bible dit vrai parce que Dieu en est l’auteur19 ; c’est du moins ce qu’on peut supposer en l’absence de toute autre justification.
Dans La religion dans les limites de la simple raison, Kant va tenter de montrer que le Christianisme n’est pas seulement un « religion révélée », étant apparue à une époque et un endroit précis, mais également une « religion naturelle », c’est-à-dire, en droit, universelle et mondiale : chaque homme, quelles que soient son époque et sa société, et pour autant qu’il soit doué de raison, peut reconnaître que les principes moraux enseignés par le Christianisme sont identiques à ceux que sa raison pratique lui dicte. Pour démontrer cette identité, Kant va se livrer à une exégèse détaillée du Sermon sur la montagne20, texte qui contient d’après lui l’essentiel des préceptes moraux du Christianisme. Ce que Kant relève notamment dans le Sermon, c’est qu’il enjoint de suivre l’esprit de la loi plutôt que la lettre. On retrouve ici la distinction faite par Kant dans les Fondements de la métaphysique des mœurs entre “agir par devoir” et “agir conformément au devoir”. Ainsi du fameux passage :
« Vous avez entendu qu’il a été dit : “Tu ne commettras pas l’adultère”. Eh bien ! Moi je vous dis : quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis, dans son cœur, l’adultère avec elle. »21
Kant comprend ces versets comme dénonçant l’hypocrisie d’une conduite extérieure ou plus précisément physique, seulement conforme extérieurement à l’interdiction de l’adultère22 – consistant à ne pas commettre l’acte de l’adultère –, et qui l’enfreint néanmoins si le désir est bien réel. Plus généralement, Kant rappelle que l’enseignement du Christ n’est pas supposé être différent de la loi hébraïque23, mais qu’il a interprété la Loi pour montrer sa conformité à la raison pratique : « Car au pied de la lettre, la loi autorisait exactement le contraire »24 de ce qu’autorise l’interprétation du Christ, dit Kant.
Remarquons que pour parvenir à la conviction que la Bible est en conformité avec la raison pratique, il a fallu tout d’abord que le Christ interprète la loi hébraïque, c’est-à-dire qu’il en révèle l’esprit en la débarrassant d’une lecture « au pied de la lettre », puis que Kant lui-même interprète les paroles du Christ pour montrer qu’elles ne sont qu’une autre formulation, sans doute plus accessible au plus grand nombre, de la loi morale prise en elle-même, énoncée en termes philosophiques.
C’est donc au prix de deux interprétations successives – celle de la loi hébraïque par le Christ puis celle des paroles du Christ par Kant – que l’on parvient à montrer la conformité de l’enseignement biblique avec la raison pratique. Et c’est bien là la première objection que l’on peut faire à Kant : une religion naturelle étant universelle, tout homme doit pouvoir accéder aux vérités qu’elle enseigne. S’il est déjà déconcertant que Dieu transmette aux hommes un texte énonçant une loi morale qu’il a, de toute façon, “inscrite” en tout homme possédant la raison pratique, il est encore plus étonnant que ce texte doive dans certains cas – l’Ancien Testament – “subir” tour à tour deux interprétations, dont le moins que l’on puisse dire est qu’elles ne vont pas de soi25, pour au bout du compte énoncer ce que tous savaient déjà avant ! Si l’on ajoute que le texte d’origine, supposé être inspiré par Dieu, enseigne selon Kant lui-même des choses opposées selon qu’on le prend à la lettre ou qu’on en dégage l’esprit, on comprend difficilement la valeur et la légitimité d’un tel texte. Kant ne cherche-t-il pas plutôt à “asseoir” la légitimité de sa philosophie morale sur l’autorité du Christianisme ? Sur le plan philosophique, qu’importe après tout que la “vraie” morale, que Kant prétend enseigner, soit ou non celle d’une religion institutionnelle, fût-ce la religion dominante ?
On peut également contester la prééminence et même l’exclusivité que Kant accorde au Christianisme en matière de morale : « Mais, suivant la religion morale (et parmi toutes les religions publiques qu’il y eut jamais, seule la religion chrétienne a ce caractère) … »26 Cette affirmation, écrite entre parenthèses, comme semblant si peu contestable qu’elle se passe de justification, a évidemment de quoi choquer par son intolérance. Mais elle déconcerte également celui qui a pris note du fait que le Christianisme n’enseigne en fin de compte rien de plus que le Judaïsme. Si le Christ, selon ses propres paroles, vient pour accomplir la Loi et les Prophètes27, c’est bien qu’il n’y a aucune différence de fond entre le Judaïsme et le Christianisme28. Si différence il y a, ce ne peut pas être une différence telle que le second serait une, ou plutôt “la” religion morale, ce que ne serait pas le premier ! Plus précisément, pour Kant, si le Judaïsme n’est pas une religion morale, c’est parce que, comme toutes les religions sauf le Christianisme, il comporte en lui la recherche des faveurs divines.
Cette délicate question tourne plus ou moins directement autour de ce qu’on appelle la morale de la rétribution, c’est-à-dire une morale qui affirme que les pieux et les justes sont récompensés et que les impies et les méchants sont punis. S’il est incontestable que la Bible hébraïque enseigne parfois une telle morale29, des livres comme ceux de Job30 et de l’Ecclésiaste la condamnent catégoriquement31 – ce dont Kant ne tient pas compte – en remarquant que le juste subit parfois des maux “naturels”, donc d’origine divine, et que la fortune sourit parfois au méchant. Chacun est alors invité à s’en remettre à la sagesse divine sans chercher à en percer les desseins.
Supposons toutefois que cette immoralité du Judaïsme soit fondée ce qui, on le voit, ne va pas de soi. Le plus paradoxal est encore que Kant, en critiquant indirectement la morale juive, condamne nécessairement la Bible hébraïque, où la morale de la rétribution apparaît effectivement. Or cette Bible hébraïque est, quelques différences infimes mises à part, reprise par le Christianisme à son propre compte sous le nom d’Ancien Testament. La recherche des faveurs est-elle présente ou absente des mêmes textes, selon qu’ils sont lus par les Juifs ou par les Chrétiens ? Il y a là encore, semble-t-il, une très forte partialité de Kant en faveur du Christianisme, partialité qu’une véritable neutralité philosophique a priori aurait rendue, selon nous, impossible. Nous affirmons bien que cette neutralité devrait exister a priori, sans qu’elle doive nécessairement se prolonger a posteriori. Mais Kant ne justifie par aucun argument philosophique la suprématie du Christianisme dans le domaine morale. On pourrait d’ailleurs remarquer que le Nouveau Testament n’est pas non plus exempt de passages exprimant une morale de la rétribution32, ce que Kant, là encore, passe sous silence.
Dans la même logique, il écrit : « Il n’existe qu’une religion (vraie) »33. Mais comment le Christianisme pourrait-il être la vraie religion s’il est, selon les paroles de Jésus lui-même, l’accomplissement d’une fausse religion, en l’occurrence le Judaïsme ?
Enfin34, Kant nous semble également faire preuve d’une précipitation suspecte et fort peu philosophique lorsqu’il écrit : « J’admets premièrement la proposition suivante, comme principe n’ayant pas besoin de preuve : Tout ce que l’homme pense pouvoir faire, hormis la bonne conduite, pour se rendre agréable à Dieu est simplement illusion religieuse et faux culte de Dieu »35. Non pas que nous pensions, le lecteur l’aura compris, que bien d’autres comportements sont susceptibles de plaire à Dieu ; mais ce qui est ici affirmé presque explicitement, c’est que la bonne conduite d’un homme le rend agréable à Dieu. Voilà certes une proposition qui aurait selon nous besoin de preuve, si cela était possible. A vrai dire, il peut sembler au contraire que l’idée d’un Dieu sensible aux comportements humains a quelque chose d’irrespectueux, pour ne pas dire d’hérétique, à moins d’affirmer que Kant utilise un langage anthropomorphique, ce que rien ne laisse supposer.
Bien d’autres remarques seraient possibles pour confirmer, avec celles qui précèdent, que Kant fait reposer sa philosophie morale sur un fondement non philosophique, mais bel et bien religieux a priori, donc non argumenté rationnellement.
3. Le Catholicisme est-il une religion philosophique ?
Nous allons à présent examiner un cas de religion prétendant ou pouvant prétendre être philosophique. Si nous choisissons le Catholicisme, ce n’est pas essentiellement parce qu’il est la religion plus répandue dans nos sociétés dites latines, mais surtout parce qu’il s’est doté d’une théologie plus “systématique” que d’autres religions, à la fois par sa “fréquentation” de la philosophie occidentale et par sa structure très hiérarchisée, qui ont permis l’établissement d’une doctrine unifiée et officielle, à l’abri, normalement, de toute contestation interne, ce qui facilite d’ailleurs grandement la recherche des références.
Quelques remarques préalables s’imposent toutefois. Nous avons déjà évoqué l’idée selon laquelle le fondement d’une philosophie ne saurait être “extra-philosophique”. C’est pourquoi la manière dont débute une philosophie est capitale. Notons que ce “début” n’est pas forcément – et, dans les faits, n’est que rarement – premier chronologiquement dans l’œuvre d’un philosophe. Ainsi le doute radical de Descartes est bien le début “logique” de sa philosophie sans apparaître dans ses premières œuvres. Si certains philosophes semblent ne pas s’être particulièrement souciés de ce “début philosophique”, ce ne peut être que parce qu’ils considèrent qu’il n’y a pas à proprement parler à fonder la philosophie, ou encore parce que toute réflexion philosophique peut servir de fondement à la philosophie.
Il ne saurait en aller de même dans une religion, dont le point de départ, à savoir la révélation, est toujours extérieur à la raison et même, plus largement, à l’homme. En fait, nous avons déjà rencontré ce cas de figure dans les textes de Leibniz et de Kant étudiés plus haut, dont nous avons montré qu’ils s’appuyaient sur des données spécifiquement religieuses, donc impossibles à argumenter philosophiquement.
Nous allons retrouver cette extériorité dans le fondement du Catholicisme : « Au point de départ de toute réflexion que l’Église entreprend, il y a la conscience d’être dépositaire d’un message qui a son origine en Dieu même (…). La connaissance qu’elle propose à l’homme ne vient pas de sa propre spéculation, fût-ce la plus élevée, mais du fait d’avoir accueilli la parole de Dieu dans la foi »36. Les choses sont donc claires : les vérités religieuses, auxquelles les hommes peuvent accéder par la révélation, préexistent à toute réflexion humaine. En raison de leur origine divine, elles sont infaillibles. Avant même d’inaugurer la moindre réflexion, le philosophe catholique sait donc vers quoi doit tendre sa philosophie. Celle-ci n’a par conséquent qu’un rôle secondaire de confirmation a posteriori de “vérités” admises comme vraies avant toute intervention de la raison philosophique. C’est donc en toute logique que Jean-Paul II écrit : « L’Église, pour sa part, ne peut qu’apprécier les efforts de la raison pour atteindre des objectifs qui rendent l’existence personnelle toujours plus digne. Elle voit en effet dans la philosophie le moyen de connaître des vérités fondamentales concernant l’existence de l’homme. En même temps, elle considère la philosophie comme une aide indispensable pour approfondir l’intelligence de la foi et pour communiquer la vérité de l’Évangile à ceux qui ne la connaissent pas encore »37. Ce que nous considérons comme contraire à la philosophie dans ces lignes, ce n’est pas, encore une fois, la position elle-même, c’est-à-dire la fonction “évangélisatrice” assignée à la philosophie, mais le fait que cette position soit assignée de l’extérieur de la philosophie, c’est-à-dire sans argumentation rationnelle. Dans la même logique, le pape condamne au terme de son encyclique un certain nombre de courants de pensée : l’éclectisme, l’historicisme, le scientisme, le pragmatisme et le nihilisme38. Ces doctrines sont considérées à la fois comme des « erreurs » et des « dangers ». C’est dire qu’il aurait mieux valu qu’elles ne soient jamais formulées. On ne peut là encore que refuser de qualifier de philosophie une pensée qui se voudrait sans “adversaire”, même intellectuel ; nous estimons en effet que l’esprit critique et l’ouverture à la contestation doivent être des soucis constants du philosophe, conscient qu’il est, et ne peut qu’être, de ne pouvoir se prévaloir d’aucune infaillibilité. Autrement dit, le philosophe a philosophiquement intérêt à être contesté, afin de tester la validité de sa pensée. Au contraire, une doctrine d’origine “surhumaine” ne peut avoir, envers une contestation humaine, qu’une attitude de commisération, d’indifférence, de mépris ou de violence, mais pas véritablement, on ne le voit que trop, d’écoute véritable.
On peut donc admettre que les “vérités religieuses” précèdent toute réflexion philosophique. Mais, objectera-t-on peut-être, la foi dans ces vérités religieuses ne peut-elle pas, quant à elle, être justifiée philosophiquement… ? Pas davantage, comme le reconnaît, là encore, le dogme catholique : « Le motif de croire n’est pas que les vérités révélées apparaissent comme vraies et intelligibles à la lumière de notre raison naturelle »39. Toutefois, pour que la foi soit conforme à la raison, Dieu a mis en œuvre des « preuves extérieures de sa Révélation » : « les miracles du Christ et des saints40, les prophéties, la propagation et la sainteté de l’Église, sa fécondité et sa stabilité ». La raison du philosophe trouvera-t-elle dans cette liste des preuves ou des « signes certains » de la révélation chrétienne ? Accordons au moins que cela n’est pas évident…
Conclusion
L’examen des “philosophies religieuses” de Leibniz et Kant a montré diverses “failles”, non pas en tant qu’erreurs à l’intérieur de leur philosophie, mais précisément en tant que manquements à l’exigence philosophique d’une argumentation rationnelle et donc de refus d’un quelconque argument d’autorité, fût-ce l’autorité de la Bible.
Nous pouvons donc conclure qu’une “philosophie religieuse” est soit extérieure à la religion, si la philosophie “précède” la religion41, soit extérieure à la philosophie si, comme nous croyons l’avoir montré pour les deux cas étudiés, la religion “précède” la philosophie. Cela ne signifie bien entendu pas que le philosophe soit par définition irréligieux. Dans la mesure où il est homme “avant” d’être philosophe, il pourra, comme Leibniz, Kant et beaucoup d’autres, croire en Dieu et même appartenir à une religion précise. Mais il devra renoncer à légitimer sa foi, ses croyances et ses pratiques par des arguments philosophiques, et donc renoncer à intégrer sa religion dans sa philosophie. Il pourra seulement – et même en tant que croyant, il devra probablement – expliquer pourquoi sa philosophie doit forcément laisser une place, hors d’elle (au-dessus, dira-t-il sûrement), à la religion. Il pourra par exemple, à la manière d’un Pascal, essayer de montrer que la raison et donc la philosophie peuvent reconnaître elles-mêmes leurs propres limites : « La dernière démarche de la raison est de reconnaître qu’il y a une infinité de choses qui la surpassent ; elle n’est que faible, si elle ne va jusqu’à connaître cela. »42
Le philosophe peut donc être religieux, mais il ne peut pas l’être en tant que philosophe. La philosophie peut indiscutablement aller jusqu’au déisme ou au théisme, mais le pas qui mène du théisme à une religion révélée est précisément le pas qui fait sortir de la philosophie.
L’hypothèse d’une religion philosophique, du fait du nécessaire fondement non humain de toute religion, est elle aussi, dès le départ, à exclure.
Quant à l’athéisme, il n’est jamais que le refus d’une certaine conception de Dieu ou des dieux. On peut le voir par exemple avec Spinoza qui, tout en démontrant l’existence de Dieu43, peut bien être considéré comme “athée”, au sens où il refuse l’existence d’un Dieu anthropomorphe44. On le voit encore avec Marcel Conche, qui s’attaque précisément à l’idée d’un Dieu à la fois moralement bon et tout-puissant : « Il est indubitable (…) que le supplice des enfants a été, et devait ne pas être, et que Dieu pouvait faire qu’il ne soit pas. Comme Dieu ne s’est pas manifesté dans des circonstances où, moralement, il l’aurait dû, s’il existait, il serait coupable. La notion d’un Dieu coupable et méchant apparaissant contradictoire, il faut conclure que Dieu n’est pas. »45 Nous n’affirmons certes pas que cette argumentation, non plus que les démonstrations de l’existence de Dieu de Spinoza, sont à l’abri de toute contestation, y compris philosophique. Mais nous avons bien là des exemples de raisonnement parfaitement intelligible, que même le plus fervent des croyants peut suivre, pour peu qu’il soit doué de raison. L’athéisme peut donc être philosophique ou, ce qui revient au même, une philosophie peut être athée.
On se méprendrait en voyant dans cette étude une attaque contre les religions en général. Nous avons même indiqué à plusieurs reprises que l’attitude des religieux est très souvent en parfaite cohérence avec leurs convictions. Nous avons uniquement cherché à montrer en quoi religion et philosophie, sans forcément se combattre mutuellement, ne peuvent pas s’unir sans une dangereuse “confusion des genres”. Pour les deux partis, une telle union ne serait donc pas pour le meilleur mais seulement pour le pire…
Marc Anglaret
(écrire à cet auteur)
Commentaire
1 Nous considérerons ici les religions dans leur approximative unité, et plus précisément dans leur rapport à la philosophie.
2 Ces deux questions reviennent, au bout du compte, au même, mais au bout du compte seulement.
3 Nous reviendrons, avec l’examen de la position kantienne, sur la distinction entre religion naturelle et religion révélée.
4 Nous précisons bien qu’il ne s’agit pas là de donner une définition, avec tout ce que cette opération implique, de la religion, mais bien de la distinguer de la philosophie.
5 La question n’est pas ici celle de l’intolérance des religions, fort diverses sur ce point comme sur d’autres, mais celle du statut de l’affirmation de la sacralité au sein même d’une religion. Nous soutenons ici que cette affirmation se présente toujours comme indubitable, au point que toute éventuelle critique à ce sujet doit être considérée comme “déplacée”, dans le meilleur des cas…
6 Nous distinguons ici le fondement d’une religion, c’est-à-dire la ou les croyances, toujours liées au sacré selon nous, sur lesquelles s’appuient les autres croyances, de son principe, qui n’est pas une croyance mais l’origine de sa révélation : par exemple Dieu dans les religions monothéistes.
7 Discours de la méthode, première partie. NRF Gallimard, « La Pléiade », p.130. C’est nous qui soulignons.
8 Lettre LXXIII à Oldenburg (1675). NRF Gallimard, « La Pléiade », p.1283. Ce célèbre passage devrait suffire à éviter toute “récupération” du spinozisme par le Christianisme – ce qui, dans les faits, n’est pas le cas.
9 On objectera que certains philosophes habituellement qualifiés de rationalistes – par exemple Leibniz – admettent les vérités révélées de certaines religions, notamment le Christianisme. Nous étudierons précisément plus loin le cas de Leibniz, en montrant pourquoi il ne peut pas, selon nous, être pleinement considéré comme rationaliste.
10 Il n’a toutefois échappé à personne que, par une étrange coïncidence, les philosophes croyants adoptent dans la quasi-totalité des cas la religion de leur éducation, familiale notamment, et ce pas seulement dans le cas du Christianisme, comme le montrent les cas d’Averroès et de Maïmonide par exemple. Nous ne connaissons pas de contre-exemple sur ce point (Schopenhauer ne peut pas, par exemple, être sérieusement qualifié de “philosophe bouddhiste”, bien qu’il se soit lui-même reconnu dans certaines thèses du Bouddhisme).
11 Nous pensons par exemple aux Objections faites aux Méditations de Descartes, ou à la correspondance de nombre de philosophes.
12 Jean-Paul II, Fides et ratio (la foi et la raison), I, prologue ; lettre encyclique du 14 septembre 1998. Supplément au quotidien « La Croix » du 16 octobre 1998, p.3
13 D’autres philosophies pourraient bien sûr avoir leur place ici, par exemple celle de Hegel. C’est pour ne pas rendre cette étude trop volumineuse que nous avons choisi ces deux exemples, à la fois pour leur relative simplicité et leur représentativité. Par ailleurs, il est certain que l’examen de “philosophies religieuses” non chrétiennes manque à cette étude. Notre quasi-ignorance en la matière est la raison de cette absence.
14 Discours de métaphysique, 1, II. Éditions Vrin, p.26. C’est nous qui soulignons.
15 Genèse, 1, 9 –10. C’est nous qui soulignons.
16 A fortiori ne peut-elle pas être la thèse d’un philosophe rationaliste, qualificatif que l’on attribue souvent à Leibniz.
17 Et pour cause : nous croyons avoir montré plus haut qu’une telle justification est impossible ; au moins devrait-elle être tentée par Leibniz s’il entend se placer dans une perspective philosophique.
18 Spinoza, Traité des autorités théologique et politique, préface. NRF Gallimard, « La Pléiade », p.612
19 Selon Spinoza, au contraire, on pourrait dire que Dieu est l’auteur de la Bible seulement si elle dit vrai (ce qui reste donc à démontrer rationnellement), mais en donnant au mot “Dieu” un sens qui exclut toute révélation : toute la première partie de l’Éthique, intitulée “de Dieu”, est exempte de la moindre allusion biblique ou théologique.
20 Évangile selon Matthieu, chapitres 5 à 7.
21 Évangile selon Matthieu, 5, 27 – 28.
22 Interdiction formulée dans le septième des dix commandements (Exode, 20, 14).
23 Évangile selon Matthieu, 5, 17 : « N’allez pas croire que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. »
24 La religion dans les limites de la simple raison, IV, 1, 1. Éditions Vrin, p.179
25 Puisque dans les deux cas, de nombreux siècles se sont écoulés entre le texte et son interprétation : de la rédaction du Décalogue dans l’Exode à l’interprétation qu’en fait Jésus dans les Évangiles d’une part, de la rédaction des Évangiles à l’interprétation qu’en fait Kant d’autre part.
26 La religion dans les limites de la simple raison, op. cit., I, Remarque générale. p.92. C’est nous qui soulignons.
27 Cf. note 23.
28 … ou plus exactement entre le Judaïsme et l’enseignement de Jésus, car rien dans les paroles de ce dernier n’indique clairement qu’il voulait fonder une nouvelle religion, mais plutôt, comme on l’a dit (note 23), qu’il était venu pour « accomplir » le Judaïsme.
29 Par exemple : « Si le juste ici-bas reçoit son salaire, combien plus le méchant et le pécheur » (Proverbes, 11, 31 ; le terme « salaire » est ici sans ambiguïté). Bien d’autres versets, dans ce livre ou dans d’autres, sont tout aussi explicites.
30 Dans le livre de Job, Yahvé, par l’intermédiaire de Satan, “éprouve” la foi de Job, homme riche et pieux, en détruisant ses biens, en faisant tuer ses serviteurs et ses enfants, puis en le frappant de maladie. Job, conformément aux prédictions de Satan et contre celles de Yahvé, reproche à ce dernier son injustice. La “leçon” du livre, donnée par Yahvé lui-même, est que nul ne doit se permettre de juger son Dieu, et ce même s’il lui semble injuste. Cela dit, Job recouvre à la fin du récit tout ce qu’il a perdu : la morale de la rétribution est confirmée, bien que le propos “officiel” du livre la condamne.
31 Les théologiens appellent cela une « évolution » de la doctrine biblique, terme certes moins brutale que celui de « contradiction »…
32 Par exemple : « C’est qu’en effet le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de son Père, et alors, il rendra à chacun selon sa conduite » (Évangile selon Matthieu, 16, 27).
33 La religion dans les limites de la simple raison, op. cit., III, 1, 5. p.137
34 Il n’y a bien entendu nulle prétention à l’exhaustivité dans ces quelques remarques.
35 La religion dans les limites de la simple raison, op. cit., IV, 2, 2. p.188
36 Jean-Paul II, Fides et ratio, I, 7 ; op. cit., p.5
37 Ibid., I, 5 ; p.4. C’est nous qui soulignons.
38 Ibid., VII, 86 - 90 ; pp.31 - 32.
39 Catéchisme de l’Église Catholique, première partie, chapitre troisième, article I, 3, §156. Mame / Plon, p.44
40 Mais que faire alors de ce verset : « « Il surgira, en effet, des faux Christ et des faux prophètes, qui produiront de grands signes et des prodiges, au point d’abuser, s’il était possible, même les élus. » (Évangile selon Matthieu, 24, 24).
41 On peut ici se reporter aux deux remarques précédant l’analyse de la “philosophie religieuse” de Leibniz, en haut de la page 4.
42 Pascal, Pensées, fragment 267 de l’établissement de Brunschvicg (188 de Lafuma). Garnier-Flammarion, p.266. Concernant les Pensées en général, il est bien malaisé de dire s’il s’agit bien là d’un ouvrage philosophique au sens où nous l’avons expliqué plus haut. En fait, certains fragments le sont sans aucun doute, comme celui du pari (Brunschvicg : 233 ; Lafuma : 418). D’autres ne le sont manifestement pas, comme ceux sur les « preuves de Jésus-Christ » (Brunschvicg : 737 et suivants), qui ne s’adressent pas à la raison, mais bien à la foi éventuelle du lecteur.
43 Éthique, I, proposition 11. NRF Gallimard, « La Pléiade », pp.317 – 319.
44 Appendice de la première partie de l’Éthique et Traité des autorités théologique et politique, surtout les chapitres I à XII.
45 Marcel Conche, Orientation philosophique. I. “La souffrance des enfants comme mal absolu”. P.U.F. p.57
 Re: Religion et Philosophie
Re: Religion et Philosophie
Famille et philosophie
D'un point de vue ontologique, mettre un enfant au monde, c'est condamner un être humain à mort. Ce paradoxe donne à la philosophie une noble tâche depuis le grand Socrate qui nous enseigne que « Philosopher, c'est apprendre à mourir ». Mais si nous sommes des êtres pour la mort, comme le dit Heidegger, qu'en est-il de notre genèse personnelle et de la famille qui nous met au monde? Qu'est-ce que la famille? À quoi sert-elle? Comment la penser? Est-ce qu'elle a muté? Comment était-elle avant? Le modèle chinois est-il enviable?
Notre philosophie occidentale s'intéresse avant tout à l'individu ; mais aussi à la politique, à l'éthique, aux arts et sciences. Mais pour le volet « vivre ensemble » rare sont les philosophes qui ont réfléchi sur la famille. Quelques uns ont réfléchi sur l'éducation, tel Érasme, Rousseau, Helvétius et, plus près de nous, John Dewey, mais il n'existe pas, à ma connaissance, de philosophe phare de la famille en occident à part Freud.
Dans nos archétypes catholiques, la famille se compose, spirituellement de trois entités : Le Père, le Fils et le Saint Esprit. Cette mythologie comporte aussi une complémentarité « pratique » : c'est le trio de la Sainte Famille : Jésus-Marie-Joseph. Un père chaste, une mère vierge et un fils divin : famille dysfonctionnelle, s'il en est : ni frères ni sœurs, ni descendance. Mythe duquel d'ailleurs se distancient les protestants qui ont su mieux lire les évangiles que nos catholiques. Mais, même avec frères et sœurs, ces versets [1] ne nous montrent pourtant pas Jésus comme un modèle de piété filiale. On peut se demander si le Divin Prophète avait vraiment besoin de renier sa propre famille pour donner de l'élan à son schéma familial d'un Divin Père monoparental. N'introduisait-il pas ici le germe de l'éclatement de la famille dans l'esprit de ses adeptes?
Freud a renouvelé nos archétypes familiaux en proposant le complexe d'Œdipe. Nouvelle dysfonctionnalité de la famille où la pédophilie incestueuse est sublimée dans une description des relations où le fils désire plus que toute autre chose tuer son père pour prendre la place dans le lit de sa mère. (J'esquisse vite mais votre temps est précieux.)
Traditionnellement, la famille a toujours bénéficié d'un modèle très haut de gamme. En effet, roi, reine, princes et princesses nous l'ont toujours représentée comme modèle idéal accessible qui nous tire vers le haut. Mais les familles royales très en vue ont connu des bouleversements qui ont terni plus d'une fois leur réputation et l'image grandiose qui s'y rattache. Tyrannie, magouilles et mépris du sujet nous firent douter de la validité du modèle.
La famille traditionnelle a commencé à muter à partir de la Révolution Française, et cette mutation s'est accélérée avec Mai '68, en France, et la Révolution Tranquille au Québec, . En tranchant la tête du roi, on tuait Dieu, ce tyran séculaire pour que naisse l'individu libre. Ici, c'est l'Église qu'on a balancé pour enfin naître à nous-mêmes. Mais qu'a-t-on gagné?
Si nous pouvions jadis clairement situer chaque rapport familial dans une structure large et complexe, (grands-parents, père, mère, fils, fille, cousins, belle-famille etc.), aujourd'hui la famille s'est élargie de telle sorte que toute « dysfonctionnalité » est maintenant reconnue comme une nouvelle forme légitime de celle-ci. Au sens de la loi, une femme se faisant féconder par un spermatozoïde inconnu dont elle ne verra jamais le donneur fonde une famille parfaitement légitime.
Mais qu'est-ce donc qu'une famille? La famille c'est le lien entre le privé et le public. Elle est au cœur des tiraillement existentiels parce qu'elle se situe à la frontière de l'individu et du vivre ensemble. Quand on réfléchit sur l'être, il y a toujours deux pôles qui s'opposent : l'être soi et l'être social. L'être, l'individu, est jeté dans le monde, nous dit Heidegger. Il devra se débrouiller avec sa solitude monadique : naître, vivre, souffrir et mourir seul. Par contre, cet être va constamment être habité par une société qui va le nourrir, l'éduquer, le divertir, le responsabiliser, et le médiatiser.
Si nos philosophes occidentaux ont peu réfléchi sur la famille, Confucius ne cesse d'en parler. Dans les sociétés asiatiques, la famille est d'une importance capitale. Confucius nous a donné le concept de « piété filiale », pivot central de la pensée chinoise où l'existence hors de la famille est inconcevable. Un Chinois sans famille c'est comme un poisson hors de l'eau. Son rapport à la propriété est complètement différent du nôtre face à celle-ci. La famille est la cellule que chacun va nourrir sans compter. Chacun est prêt à travailler, à se saigner à blanc pour donner argent, nourriture, biens et propriété aux siens. Pas seulement père et mère, mais grands-parents, enfants, cousins, tantes et oncles aussi. Dans une famille, la dévotion aux aînés, même après la mort est totale. Chez eux, la piété filiale fonde le sens de l'honneur. (Vous savez, cette notion qui est disparue en Occident en même temps que les classes sociales et la reconnaissance de notre liberté sacrée de pouvoir obéir à nos pulsions primaires.)
L'Occident contraste avec son sens de l'individualité qui a laissé à l'État le soin de s'occuper d'à peu près toutes les fonctions traditionnellement dévolues aux familles. De la naissance à la mort, les responsabilités familiales de jadis sont désormais l'affaire de la société. Médicalisation des naissances, allocations familiales, garderies publiques, éducation nationale, gestion de la compétence professionnelle, sécurité du revenu, pension de vieillesse, pas un domaine qui ne soit resté l'apanage de la famille. Nous avons invité la sécurité sociale à s'infiltrer dans chaque étape de la vie de chacun, nous déresponsabilisant tous de nos devoirs familiaux traditionnels. Avatar de la Révolution Française dont le dernier mot du triptyque de la devise Liberté-Égalité-Fraternité prend maintenant tout son sens. Tous frères et sœurs, notre famille, c'est l'État-mamelle universel.
Pour que la Révolution vive, il faut que le roi meure. Déclarait en substance Robespierre. Après avoir décapité l'archétype de toute notre structure sociale, Dieu est mort et la famille ne cesse depuis de dépérir, ou de muter, c'est comme vous voudrez. Le père est devenu superflu ; la mère remplaçable ; le beau-frère, l'image emblématique dont on se moque. La mère, citoyenne votante comme tout le monde, travaille comme tout le monde et participe à égalité à toutes les fonctions sociales sans affectation particulière si ce n'est que les quelques mois de l'unique grossesse de sa vie où elle est regardée comme vivant un inconvénient médical passager après lequel elle sera délivrée de cette « inégalité » biologique parce que le père prendra le relais des seules tâches familiales restantes : biberon, couches, ménage, épicerie.
Freud est peut être le philosophe qui a le plus contribué à achever la Révolution Française dans nos familles. Diamétralement opposé à tout ce qui avait été pensé jusqu'alors, il nous a inventé un inconscient dans lequel était refoulé tous nos malheurs dont la genèse rendait nos parents seuls responsables. Pour s'en libérer, il fallait conscientiser ces démons intérieurs. Catharsis libératrice incontournable, avec Freud, le XXe siècle passera des années étendu sur le divan à gratter nos souvenirs parentaux, à cracher sur père et mère, à noircir le tableau familial pis que pendre, et pour cause, si on était malheureux, c'était nécessairement dû à ceux qui nous avaient élevés de leurs névroses. Complexe d'Œdipe, sexualité refoulée, fusion malsaine, tout y passe. Si bien qu'on y pense à deux fois maintenant avant de mettre au monde cette chose souffrante que l'on appelle fils ou fille, qui, après l'avoir nourri, langé et soigné, aura honte de porter notre nom, va se croire notre égal en nous appelant par notre prénom, et va bientôt se retourner contre nous pour nous reprocher avec raison d'avoir donné le coup de départ à une vie éprouvante qui va nécessairement mal finir puisque nos enfants vont, bien sûr, un jour tous mourir.
L'Occident n'est pourtant pas sans traditions familiales. De structure patrilinéaire, les familles s'échangeaient jadis les filles à marier et pactisaient ainsi ensemble pour construire des alliances fructueuses. L'époque romantique moderne a cassé le modèle graduellement de générations en générations. Je pense au film Fiddler on the Roof qui a très bien illustré cette mutation. Il y avait d'abord la marieuse qui tâchait de « matcher » les couples au mieux en vue de pérenniser le patrimoine. Il y a eu ensuite le libre choix mutuel du partenaire. Si on allait passer une vie ensemble, 'fallait toujours bien pouvoir choisir le (la) partenaire idéal(e) avec qui, tout au moins, allions-nous pouvoir passer une lune de miel qui nous laisserait des souvenirs idylliques pour aider à traverser la rude vie qui allait suivre. Et enfin, mutation ultime, pouvoir choisir de marier l'étranger, celui d'un autre pays, celui qui pratique une autre religion. Mais ce film, tourné en 1971, n'avait pas encore épuisé toutes les libertés possibles. Il y a ensuite eu le droit de marier son propre sexe. Et, il n'y a pas si longtemps, vivant seul avec mon fils, il était considéré comme mon conjoint aux fins de l'impôt sur le revenu. Certains pensent même élargir encore nos libertés pour permettre de marier une autre nature... chiens chats, arbres etc. Ne riez pas, ne vous indignez pas, pensez que ce ne sera pas nous qui feront l'avenir mais nos enfants. Qui sait ce qu'ils accepteront dans leurs mœurs que nous voyons aujourd'hui comme pervers. N'y a-t-il pas eu jadis des thèses démontant que l'homosexualité était une maladie mentale? (Lire Pierre Daco, Les prodigieuses victoires de la psychologie moderne, Marabout 1969).
Pour reprendre les termes de McLuhan, notre ère de l'électricité a provoqué une immense implosion planétaire. Nous pouvons désormais converser à la vitesse de la lumière avec n'importe qui, où qu'il soit. La famille aussi a implosé. Nous somme tous frères et sœurs sur une petite planète où les médias nous rapprochent tant, que la famille biologique a perdu son sens symbolique.
La famille a muté. faut-il le déplorer? Je pense qu'on devrait plutôt essayer de comprendre où nous en sommes pour ensuite voir comment on peut s'y adapter. Henri Laborit nous disait que pour aller sur la lune, on a besoin de connaître les lois de la gravitation. Quand on connaît ces lois de la gravitation, ça ne veut pas dire qu'on se libère de la gravitation. Ça veut dire qu'on les utilise pour faire autre chose. McLuhan, de manière analogue nous dit en substance que la compagnie IBM, avait manqué le pas sur sa rivale Microsoft parce qu'on n'avait pas compris que ce n'était pas des machines que l'on vendait mais de l'information. Ainsi, si on ne comprend pas la mutation de la famille occidentale, ne va-t-on pas stérilement regretter l'ancienne forme sans voir que nous sommes engagés dans une marche sans retour, et peut-être même pour le meilleur? Hegel ne fait pas qu'opposer thèse à antithèse, il nous fait entrer dans l'histoire en nous montrant que l'une et l'autre mènent à une synthèse. Vers quelle synthèse nous acheminons-nous collectivement? Certains brossent un tableau très noir de la situation. Pourtant, ne vivons-nous pas dans une époque particulièrement opulente où la violence et la criminalité, pour peu que l'on fait taire TV, cinéma, radio et journaux, sont à peu près absentes de notre quotidien? Notre espérance de vie n'a-t-elle pas atteint des sommets historiques? Connaissons-nous seulement la faim? Il est où le problème?

La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver ; mais ils ne purent l'aborder, à cause de la foule. On lui dit : Ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Mais il répondit : « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la mettent en pratique. »
(Bible Online Édition du Millénium © 2002, Bible Louis Segond, 1910, Luc 8 : 19-21, )
et
N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joses, de Jude et de Simon? et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit : « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, et dans sa maison. »
(Ibid., Marc 6 : 3-4)
(Bible Online Édition du Millénium © 2002, Bible Louis Segond, 1910, Luc 8 : 19-21, )
et
N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joses, de Jude et de Simon? et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit : « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, et dans sa maison. »
(Ibid., Marc 6 : 3-4)
 Re: Religion et Philosophie
Re: Religion et Philosophie
Expérience de pensée : Le chat de Schrödinger
 L'esprit nous permet de créer des réalités qui ne peuvent s'observer dans la vie de tous les jours. Ainsi, Schrödinger, physicien autrichien qui s'est intéressé activement à la mécanique quantique (science qui étudie de quoi est faite la matière) a imaginé une expérience impossible qui nous permet de comprendre sa discipline.
L'esprit nous permet de créer des réalités qui ne peuvent s'observer dans la vie de tous les jours. Ainsi, Schrödinger, physicien autrichien qui s'est intéressé activement à la mécanique quantique (science qui étudie de quoi est faite la matière) a imaginé une expérience impossible qui nous permet de comprendre sa discipline.Un peu d'histoire. Les philosophes matérialistes de l'Antiquité, dont Démocrite et Lucrèce, avaient postulé que toute matière pouvait être coupée en deux presque indéfiniment, la limite étant l'atome (du grec atomos, qu'on ne peut diviser). L'atome était, par définition, la plus petite partie de matière insécable. Impossible de diviser l'atome, pensaient-ils. Il était le matériau de base, la brique avec laquelle tout est fabriqué.
On sait que l'atome n'est plus insécable depuis la bombe atomique. On étudie maintenant ses particules : électrons, protons, neutrons, quarks, photons, neutrinos, muons etc. Et comme la physique est une science exacte, elle a besoin d'observer ce qu'elle étudie. Mais voilà, à ces échelles sub-microscopiques, l'observation pose un immense problème. Les particules un peu à la manière des êtres humains, changent d'état lorsqu'on les observe. Tout nu sur une plage isolée à vous faire bronzer, vous aurez un comportement différent que si vous êtes dans la foule où, par exemple, vous revêtirez tout au moins un bikini. Pour les particules, c'est pareil. Ils sont pour ainsi dire influençables. Nos instruments d'observation changent leur état. Les électroniciens le savent bien. En effet, le voltmètre est lui-même un circuit électronique qui déséquilibre le circuit qu'il mesure. Il faut connaître l'impédance du voltmètre pour estimer son influence sur l'exactitude de la lecture.
En fait, les particules ne sont pas vraiment « influençables ». Simplement, leur état nous est inconnu sans les observer. Et cet état est soumis à une sorte de probabilité. Il faut arrêter la pièce lancée pour savoir si elle est côté pile ou face. Mais si son état naturel est de tourner indéfiniment, nous dirons qu'elle a une chance sur deux d'être côté pile ou face à tout moment. Alors que c'est à l'arrêt que l'observation est possible, il faut donc soumettre la particule à un statut particulier pour la voir. Notre regard (la mesure) influence donc le phénomène observé puisqu'il demande à la matière, comme le photographe nous demande de ne plus bouger, de s'arrêter dans une position qui ne lui est pas naturelle pour être vue. Cette torsion de la réalité est analogue à notre sempiternelle volonté de distinguer le corps de l'esprit alors que l'un est impossible sans l'autre. Les particules sont à la fois onde et matière ; la distinction se fait au moment de la mesure.
Venons-en au chat de Schrödinger. Pour une heure, notre physicien a imaginé enfermer un chat dans une boîte avec un compteur Geiger actionnant un marteau qui va briser une fiole renfermant un poison volatile mortel s'il détecte un changement d'état d'une particule atomique enfermée elle aussi avec le chat. Comme la particule a une chance sur deux de changer d'état dans l'heure où commence l'expérience, notre chat a une chance sur deux de vivre ou mourir. Le chat n'est ici qu'un accessoire émotionnel pour susciter notre intérêt intellectuel.
La clef de l'expérience est ici. Comme le chat est enfermé dans une boîte d'acier, il nous est impossible de savoir si, au bout d'une heure, il sera mort ou encore en vie. La seule manière de le savoir est d'ouvrir la boîte. Mais voilà, tant que la boîte reste fermée, le chat peut aussi bien être mort que vivant. Impossible de le savoir sans ouvrir la boîte. L'idée suggérée ici est que l'état du chat, mort ou vivant, dépend de notre observation ; celle-ci va pour ainsi dire créer son état. En quelque sorte, c'est notre observation qui tue ou rend la vie à notre chat. Au bout d'une heure, au moment d'ouvrir la boîte, il y a la même chance qu'il soit mort ou vivant : une chance sur deux. Tant que l'on n'ouvre pas la boîte le chat n'est ni mort, ni vivant, ou il est les deux à la fois. Il en est ainsi des particules subatomiques. Tant qu'on ne le mesure pas, l'objet quantique est indéterminé ; on ne sait pas s'il est onde ou matière.
Cette expérience, sous le regard de la physique quantique, semble nouvelle pourtant elle devient familière si on y réfléchit à la lumière de la question classique suivante : Un arbre qui tombe dans la forêt, fait-il du bruit s'il n'y a personne pour l'entendre? Berkeley l'éclaire de façon magistrale en nous faisant voir comment l'esprit crée ce qu'il observe, alors que, privé de l'observation, tout est possible, y compris une boîte dans laquelle un chat est mort et vivant en même temps.
 Re: Religion et Philosophie
Re: Religion et Philosophie
Énergie libre à libérer
 Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.(Lavoisier, Traité élémentaire de chimie, 1789)
La philosophie est un vaste domaine qui recouvre autant les sciences techniques que la conceptualisation. L'énergie libre est actuellement sujet à controverse. J'y vois donc plusieurs enjeux philosophiques. La première question est : Pourquoi qualifie-t-on cette énergie de « libre » ? Qui donc l'enchaîne et pourquoi? En fait, nombreux sont ceux qui voudraient que Lavoisier se soit trompé, ou encore, pensent que la nature recèle une quantité cachée d'énergie à laquelle nous n'avons pas accès tout simplement parce qu'elle occuperait une dimension encore inexplorée de la nature.
J'assistai jadis à la conférence d'un type qui se présenta sous le nom de Daniel. Il montrait divers montages de bobines faisant tourner des petits moteurs, allumer de petites ampoules et même chauffer légèrement un grille-pain. Aucune source d'énergie n'alimentait ses montages ; que des petites bobines de fil connectées nulle part. Hallucinant ! Le type semblait simple d'esprit, passablement susceptible et s'exprimait dans un langage enfantin. Il était accompagné d'un mentor qui supportait sa démonstration et faisait tampon avec les questions de la salle.
J'étais assis tout près du présentateur et j'ai pu vérifier qu'il n'y avait apparemment pas de « truc magique ». J'avais apporté un voltmètre et il m'avait laissé prendre une ou deux lectures, mais il a vite cessé la collaboration lorsque mes questions sont devenues plus précises. Ses intentions n'avaient visiblement pas pour but de diffuser la technique. Pourquoi ? Je n'en sais rien. La séance d'un peu plus d'une heure m'avait coûté trente dollars. Je suis reparti mystifié et frustré. À quoi sert une telle démonstration si on ne peut en profiter ? Daniel éprouvait un malin plaisir à nous mystifier. J'avais été invité à une démonstration technique, j'assiste à un spectacle de magie. Le prestidigitateur comptait bien se garder le secret pour lui tout seul. Bien sûr, si nous pouvions tous reproduire le phénomène, il ne pourrait plus tirer profit de ses lucratives séances. Nous avions affaire à un type jaloux d'un savoir-pouvoir rentable qui pourtant agissait comme l'Hydro-Québec qu'il dénonçait ?
Une atmosphère de « théorie des complots » planait dans la salle, mais n'avait sur moi aucune emprise. Nous vivons dans un pays où le libre marché permettrait le développement d'une telle technologie. Il existe cependant des règles de sécurité auxquelles il faut se conformer. Électrotechnicien, technologue professionnel et électricien de carrière, je connais les lois qui régissent mon métier et je sais le tort qui pourrait en résulter si tout un chacun jouait à l'apprenti sorcier. Pourtant, rien n'empêcherait de développer quelques petits gadgets pour allumer une lumière ou faire tourner un petit ventilateur ici et là à bas voltage. D'ailleurs, s'il s'agissait d'une technologie facile et peu coûteuse, la Chine n'aurait-elle pas envahi le marché de ces joyeux gadgets ?
 Mais voilà, on nous présente une théorie obscure, on nous fait une démonstration à la Houdini et on nous renvoie chez-nous médusés en nous disant de se mettre sur nos gardes : il y a un complot énergétique. «Saint-Daniel» nous mystifie dans la fosse aux lions des cartels énergétiques ; lions qui, comme dans la mythologie illustrée par Rubens, n'ont que faire de ce martyr bénévole.
Mais voilà, on nous présente une théorie obscure, on nous fait une démonstration à la Houdini et on nous renvoie chez-nous médusés en nous disant de se mettre sur nos gardes : il y a un complot énergétique. «Saint-Daniel» nous mystifie dans la fosse aux lions des cartels énergétiques ; lions qui, comme dans la mythologie illustrée par Rubens, n'ont que faire de ce martyr bénévole.Chacun sait que les piles ordinaires sont rechargeables. L'Internet donne les plans du chargeur gratuitement (cliquer ici). Aucun complot. Pourtant, cela n'excite personne. Qui se donne la peine de recharger ainsi ses piles alcalines ? Les gens continuent d'acheter et jeter leurs batteries « non rechargeables ». Pourquoi ? À vous de me le dire.
* * *
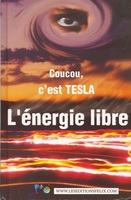 L'énergie est libre et l'a toujours été. Rien de nouveau. Elle se présente sous plusieurs formes : hydroélectrique, photovoltaïque, inductive, capacitive, etc. Le tout est de développer une technologie efficace pour la capter. Le livre Coucou, c'est TESLA – L'énergie libre, écrit par un collectif d'auteurs anonymes (!?) et édité par une maison qui base sa promotion sur la liberté d'opinion garantie par la Déclaration des Droits de l'Homme (appat marketing ?), passe en revue les grandes inventions de Nikola Tesla. Moitié Nouvel-âge, moitié scientifique, cet ouvrage énonce les principales inventions de ce grand chercheur qui a consacré sa vie à essayer d'exploiter une énergie abondante mais cachée.
L'énergie est libre et l'a toujours été. Rien de nouveau. Elle se présente sous plusieurs formes : hydroélectrique, photovoltaïque, inductive, capacitive, etc. Le tout est de développer une technologie efficace pour la capter. Le livre Coucou, c'est TESLA – L'énergie libre, écrit par un collectif d'auteurs anonymes (!?) et édité par une maison qui base sa promotion sur la liberté d'opinion garantie par la Déclaration des Droits de l'Homme (appat marketing ?), passe en revue les grandes inventions de Nikola Tesla. Moitié Nouvel-âge, moitié scientifique, cet ouvrage énonce les principales inventions de ce grand chercheur qui a consacré sa vie à essayer d'exploiter une énergie abondante mais cachée.Si l'énergie est libre, le gros du travail consiste à la capter et transformer de manière à ce qu'elle soit utilisable. Il faut d'abord comprendre les principes physiques en élaborant des théories vérifiables. Pour ce qui nous concerne, il faut comprendre l'énergie électrique et savoir sous quelle forme elle se cache. Tesla a donné son nom à un type de bobine et à l'unité de mesure du champ magnétique, phénomène électrique avec lequel on peut facilement mystifier les gens. Le champ de force invisible agit effectivement et n'est nullement magique ; il est mesurable et produit des effets connus mais, comme il n'est pas visible à l'œil nu, son potentiel de mystification est énorme.
Après ce 10 % d'inspiration, le 90 % de transpiration consiste à l'extraire et l'adapter à nos besoins. Pour ce faire, faudra-t-il investir des quantités énormes de capitaux dans la recherche et le développement de dispositifs sécuritaires qui permettent de l'exploiter ? Tesla a passé sa vie à solliciter des mécènes généreux pour développer les dispositifs de transformation qu'il concevait. Capteurs de foudre, convertisseur de Plauson et bobines électriques en tous genres, le Bureau des brevets ne dérougissait pas et l'envergure de ses projets dépassaient souvent le budget des mécènes.
Qu'en est-il de l'énergie libre ? Assistons-nous à une percée véritablement novatrice ? Tout le baratin qui entoure ces phénomènes ne relève-t-il que d'un glissement philosophique entre la mystification et la théorie des complots? Ignorance et diabolisation ? Avec l'engouement actuel pour l'écologie associée à l'efficacité énergétique, se peut-il que l'on soit encore sujets aux « humaineries » en tout genre qui, par mystification, consistent à exploiter notre ignorance ? Comment pouvons-nous éviter ce get-apens populiste ? Et celui qui dénonce les abus n'est-il pas aussi abuseur potentiel ? J'aimerais bien qu'on me présente le phénomène technique et ses applications en faisant le partage entre l'énergie libre et la fumisterie. L'énergie libre reste encore à libérer.
 Re: Religion et Philosophie
Re: Religion et Philosophie
Qu'est-ce que la philosophie?
La philosophie, ça ne s'enseigne pas, ça se vit. On entre en philosophie comme en on entre en prêtrise ; c'est un sacerdoce à soi-même réservé aux passionnés ; les autres sont des fonctionnaires salariés.
La philosophie n'est pas une matière académique, c'est une manière de vivre, c'est une dette qu'on paye à soi-même ; sinon la vie n'est qu'un flash momentané dans une pièce obscure.
Tout ce que nous vivons peut être éclairé par la philosophie. C'est tout simplement la pensée qui se regarde penser, la vie qui se regarde vivre et qui, biologiquement, s'arrange avec l'idée qu'elle se fait de la biologie (salut Ferré!). La vie lui est indispensable mais elle n'est pas indispensable à la vie. Comme on peut parfaitement vivre sans la vue, on peut parfaitement penser sans savoir que l'on pense. Mais le retour sur soi est un exercice difficile et il faut avoir le cœur bien accroché pour le pratiquer avec d'autres. Nous sommes si sensibles, si facilement meurtrissables.
La philosophie nous fait visiter les planètes des autres. Autant de philosophes, autant de mondes fabuleux qui chaque fois témoignent de l'étroitesse de notre seule position que nous tentons pourtant trop souvent de défendre si farouchement alors qu'elle est si dérisoire, comme n'importe quelle autre d'ailleurs, prise séparément. Mais ajoutée à celles de tous les autres, notre vision devient un univers d'univers fantastiques, C'est, sans drogue, « tripper » à froid ; ne jamais sortir de la réalité parce qu'elle est si vaste que nous ne pourrions désirer aller ailleurs autrement ; parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de se dépayser aussi radicalement.
La philosophie n'exclut aucun. Chacun y a sa place pour autant qu'il la revendique.
La philosophie comme art de se taire
La philosophie comporte une curieuse antinomie : la parole et le silence.
Le philosophe qui parle, argumente, polémique, critique et n'en finit plus de développer des tactiques de réfutation, on le dirait aux prises avec quelque chose d'encombrant dont il ne sait comment se déprendre.
Le philosophe qui cherche à comprendre questionne, s'interroge, écoute et se tait, parce que, une fois qu'il a compris, il n'y a plus rien à dire. Le philosophe accompli a développé l'art de se taire mais son silence est éloquent.
.
 Re: Religion et Philosophie
Re: Religion et Philosophie
Dieu et la mémétique
Comme l'humain se construit des édifices volants (Airbus A380) pour se véhiculer dans l'espace, le gène se construit des organismes vivants pour se véhiculer dans le temps. Ainsi se perpétue-t-il ; il devient en quelque sorte éternel, un peu à la manière Schopenhauer qui nous expliquait que la vie et la mort n'est qu'une vibration de l'espèce...
Le mème – réplicateur culturel d'un langage codé – est à l'esprit ce que le corps est au gène. Ainsi, l'esprit est éternel – ou cherche à le devenir – en se construisant une culture véhiculée par des corps vivants. Une sélection culturelle s'opère pour décider des mèmeplexes qui survivront ou non, à la manière dont la sélection naturelle de Darwin s'opère pour décider de l'évolution des espèces.
Darwin nous démontrait que l'on peut se passer de Dieu pour expliquer la création ; c'est maintenant Dawkins qui nous dit que l'on peut se passer de l'Esprit Saint pour illuminer notre pensée. Le mème est autonome comme l'Esprit du Livre mais il a l'avantage d'être une proposition scientifique qui nous délivre du carcan divin. Si Dieu est un mèmeplexe appelé à disparaître, c'est que la sélection culturelle en a décidé ainsi au profit d'autres mèmeplexes mieux adaptés à l'environnement culturel moderne. C'est, ni plus ni moins, la mort de Dieu annoncée par Nietzsche qui attirait déjà notre attention sur le fait «qu'une pensée vient quand "elle" veut, et non quand "je" veux», comme s'il avait pressenti le concept de « mème ».
Le mème semble désigner ce que l'esprit de la Trinité divine constituait. L'Esprit souffle...où il veut ; il est autonome comme le vent, comme le mème. Je suis toujours étonné de constater à quel point les mêmes concepts de base renaissent d'une époque à l'autre avec la prétention de nouveauté. Comme si nous étions soucieux de réinventer le monde en jetant les outils de nos ancêtres pour les reforger immédiatement avec un narcissisme nous fait croire originaux. Mais bien sûr, il faut la faire agir dans le contexte qui nous est propre, si nous voulons nous réapproprier notre propre pensée. Notre contexte n'est plus religieux, il est maintenant scientifique réinterprétons donc l'univers avec ces nouvelles lunettes... super améliorées.
L'intérêt d'adopter l'hypothèse mémétique réside dans le fait que si celle-ci est mieux adaptée à notre environnement culturel actuel, elle risque de supplanter les autres théories dominantes. Ce faisant, elle pourrait bien contribuer à une meilleure adaptation culturelle à notre époque. En effet, comment peut-on se sentir adapté en continuant à parler de Dieu dans une culture qui l'a fait mourir? Dorénavant, la mémétique nous permettra d'accéder à la « vie éternelle » plus sûrement que la religion. Changeons de véhicule pour mieux nous rendre au paradis de l'idée éternelle. Car, après tout, même si nous avons rejeté les religions qui nous promettaient ‘faussement' de vivre éternellement, il n'en reste pas moins que nous aimerions bien ne jamais mourir.
* * *
Depuis l'invention de la pensée humaine – que d'aucuns situent à l'époque de la Grèce antique – s'opposent déterministes et libre-arbitristes. La mémétique donne maintenant un argument supplémentaire de taille aux déterministes. En effet, cette théorie démontre un déterminisme « actif » qui, de façon analogue aux gènes, poursuit un développement algorithmique dynamique en suivant les trois règles évolutionnistes de base : variation, sélection, transmission. La vie et la pensée s'expliquent désormais sans recourir à la liberté. De plus, cette théorie démontre comment le déterminisme peut être vivant sans avoir besoin du coup de pouce initial du premier moteur immobile d'Aristote.
* * *
Les anciens Grecs vénéraient une multitude de dieux qui les accompagnaient dans leur vie de tous les jours. La première grande mutation idéologique fut le passage du polythéisme au monothéisme. À partir du christianisme, et à la suite du judaïsme, un seul Dieu fut témoin de la pensée humaine. À partir des Lumières, on commença à remettre en question le Dieu unique. Si bien qu'au XIXe siècle, Darwin en vint à démontrer que l'on pouvait parfaitement se passer de Dieu pour expliquer l'origine de la vie sur terre. Parallèlement, un mouvement de romantisme centralisa le point focal de la pensée humaine sur l'individu. Un « je » narcissique prit alors toute la place. Le « moi » tout-puissant commença d'être célébré et, graduellement, on se mit aveuglément à son service. Les Droits de l'homme et la liberté individuelle fut la deuxième grande mutation idéologique, révolution copernicienne de la pensée.
Mais voilà que pointe à l'horizon ce qui pourrait bien devenir la troisième mutation ontologique : la mémétique. De Dieu à l'individu, nous passons maintenant aux mèmes, sorte d'atomes de la pensée qui nous utilisent pour se reproduire. Nous ne pensons plus, nous sommes pensés. Du coup, tout comme Dieu mourut au temps de Darwin, maintenant c'est l'individu qui s'effondre, désormais possédé par une entité sur laquelle son contrôle est illusoire. Un mème aveugle cherche à se multiplier et nous sommes son lieu de culture. Chaque idée se bouscule pour rejoindre la tête du palmarès de notre attention. Bien comprise, cette mécanique aléatoire nous délivre définitivement de la « théorie des complots » puisque aucune intentionnalité n'anime le mème. À l'image des corps biologiques, il ne poursuit qu'un seul but : se reproduire.
* * *
De la planète des dieux, à la planète Dieu, à la planète moi, à la planète mème, la pensée s'est donnée chaque fois une perspective singulière pour comprendre le monde en accordance avec les développements technologiques de l'époque. La roue (dieux), l'écriture (Dieu le verbe), la science (Moi) et les ordinateurs (mèmes) furent, chacun son tour, témoins de chaque mutation idéologique. Est-ce une marche historique? Synthétique? Du coup, notre habitude d'opposer les croyants aux athées s'en trouve bousculée. La thèse et l'antithèse doivent faire place à une nouvelle synthèse. Mais quelle sera l'antithèse du mème?
[1] Pascal Jouxtel, dans Comment les système pondent, (Le Pommier © 2006, p. 318) utilise le terme réplicateur qu'il définit comme suit : « Système de codage d'information porté par un support capable d'interagir avec son environnement pour produire de nouveaux exemplaires d'un code semblable, doués de la même propriété. L'ADN, grâce au système d'administration biochimique qui l'environne, est un réplicateur. Les cristaux d'argile sont des réplicateurs minéraux. Les virus informatiques ont des propriétés de réplicateurs. Les mèmes sont définis comme des réplicateurs culturels. » On pourrait aussi dire « réplicant », emprunté au cinéma états-unien (Blade Runner (1982) ou Replicant (2001)), synonyme de clone à croissance accéléré.
[2] Mèmeplexe : groupe de mèmes qui travaillent ensemble ou « complexe co-adapté de mèmes ».
[3] Nietzsche, Par-delà bien et mal, § 17, 1886.
[4] « Jésus répond: "Je te le dis, c'est la vérité, personne ne peut entrer dans le Royaume de Dieu, s'il ne naît pas d'eau et d'Esprit. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains. Et ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent à l'Esprit Saint. Ne sois pas étonné parce que je t'ai dit: «Vous devez naître de nouveau.» Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit qu'il fait. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est la même chose pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit Saint.» » Évangile de Jean, § 3, versets 5 à 8.
[5] Quoique j'aie souvent l'impression que l'on confonde l'un et l'autre... sans tenir compte de l'enseignement de Karl Popper.
[6] Dans son essai Totalement inhumaine, publié en 2001 aux éditions ‘Les empêcheurs de tourner en rond', Jean-Michel Truong nous dépeint un univers où le mème parvient à se perpétuer en empruntant d'autres véhicules que la vie.
[7] À cet effet, j'avais proposé une solution qui à ce jour n'est pas encore démentie : « Quand on est mort, le temps passe vite ».
 Re: Religion et Philosophie
Re: Religion et Philosophie
Les huit sens...
Nous serions dotés, parait-il de cinq sens : la vue, l'ouïe, l'odorat, le goûter et le toucher. Notre corps en comporte pourtant trois supplémentaires : l'équilibre, la proprioception et le sens du temps. Curieusement, le discours populaire n'en tient jamais compte. Examinons-les.
 Le sixième sens, le sens de l'équilibre, est pourtant bien connu et n'a rien d'ésotérique. Celui-ci nous informe à tout moment de notre rapport à l'espace. Logés dans notre oreille interne, les canaux semi-circulaires sont intégrés au sens de l'ouïe mais les signaux qu'ils captent sont interprétés par le cerveau en comparaison avec la perception visuelle. L'œil et les canaux semi-circulaires informent le cerveau sur la position de la tête dans l'espace et à quelle vitesse notre corps se déplace, accélère, ralentit. Lorsque ces deux sens envoient au cerveau des informations interprétées comme contradictoires, nous ressentons la désagréable sensation d'étourdissement jusqu'à la nausée et le vertige.
Le sixième sens, le sens de l'équilibre, est pourtant bien connu et n'a rien d'ésotérique. Celui-ci nous informe à tout moment de notre rapport à l'espace. Logés dans notre oreille interne, les canaux semi-circulaires sont intégrés au sens de l'ouïe mais les signaux qu'ils captent sont interprétés par le cerveau en comparaison avec la perception visuelle. L'œil et les canaux semi-circulaires informent le cerveau sur la position de la tête dans l'espace et à quelle vitesse notre corps se déplace, accélère, ralentit. Lorsque ces deux sens envoient au cerveau des informations interprétées comme contradictoires, nous ressentons la désagréable sensation d'étourdissement jusqu'à la nausée et le vertige. Le septième sens, la proprioception, est bien connu des danseurs ; il fonctionne en étroite collaboration avec les sens du toucher et de l'équilibre. Il s'agit de l'information que les muscles envoient au cerveau quant à la variation de force nécessaire pour les activer en fonction de l'attraction terrestre.
Le septième sens, la proprioception, est bien connu des danseurs ; il fonctionne en étroite collaboration avec les sens du toucher et de l'équilibre. Il s'agit de l'information que les muscles envoient au cerveau quant à la variation de force nécessaire pour les activer en fonction de l'attraction terrestre.  Il est aussi basé sur les réflexes. En conjonction avec le toucher, il nous informe de la position de chacun de nos membres par rapport au reste du corps. C'est le sens qui nous permet par exemple de nous savonner efficacement dans la douche, même plongé dans l'obscurité, ou encore de positionner correctement notre main pour porter les aliments à la bouche avec les yeux fermés.
Il est aussi basé sur les réflexes. En conjonction avec le toucher, il nous informe de la position de chacun de nos membres par rapport au reste du corps. C'est le sens qui nous permet par exemple de nous savonner efficacement dans la douche, même plongé dans l'obscurité, ou encore de positionner correctement notre main pour porter les aliments à la bouche avec les yeux fermés.Nos sens travaillent toujours en étroite collaboration pour nous renseigner sur notre réalité corporelle. Qu'il y en ait un dont les informations ne concordent pas avec les autres, nous ressentons alors l'inconfort, le doute, l'interrogation.
 Le huitième sens, le sens du temps est plus complexe puisqu'il fait appel à deux notions : la durée et le rythme. Le cerveau, bouclant les informations dont il dispose, parvient à détecter l'écoulement du temps par mémoires comparées. Bien qu'il fournisse une perception subjective inégale d'un individu à l'autre, il produit une information constante sur notre position temporelle. Ne sentons-nous pas, après avoir dormi une, trois ou huit heures, à peu près combien de temps s'est écoulé ? Anesthésié, le cerveau inconscient ne perçoit plus le temps qui, au réveil, semble s'être écoulé à toute vitesse.
Le huitième sens, le sens du temps est plus complexe puisqu'il fait appel à deux notions : la durée et le rythme. Le cerveau, bouclant les informations dont il dispose, parvient à détecter l'écoulement du temps par mémoires comparées. Bien qu'il fournisse une perception subjective inégale d'un individu à l'autre, il produit une information constante sur notre position temporelle. Ne sentons-nous pas, après avoir dormi une, trois ou huit heures, à peu près combien de temps s'est écoulé ? Anesthésié, le cerveau inconscient ne perçoit plus le temps qui, au réveil, semble s'être écoulé à toute vitesse.Le sens du temps a permis au chercheur Michel Siffre de déterminer — dans une caverne coupée de toute référence solaire ou horaire — que le corps a des cycles d'environ vingt-quatre heures et trente minutes. Il peut être gravement compromis lorsque, privé des cycles naturels, on s'oblige à veiller de façon inhabituelle sur de longues périodes. Trois jours sans dormir et les hallucinations commencent, parfois moins. En travaillant de nuit ou sur des quarts variables le cycle circadien rompu peut occasionner de multiples dérèglements dans le sommeil et l'alimentation.
Le cœur est l'horloge du corps, il donne la cadence, il participe à la sensation subjective du temps. Quand le cœur bat rapidement nous agissons plus vite et percevons le monde comme plus lent, et inversement, tranquille, au repos, le rythme cardiaque lent nous donne l'impression que le temps passe vite.
Le sens du temps est aussi généré socialement. Il apparaît sur trois modes : court, moyen et long terme. À long terme, il nous informe sur le groupe d'âge auquel nous appartenons (jeune, le temps est long ; âgé, le temps passe vite) ; à moyen terme, sur notre synchronisation sociale (rendez-vous, cycles communautaires — dont les fêtes — programmation médiatique, etc.) ; à court terme, sur les séquences de coordination — par exemple dans la réalisation d'un projet lorsque nous travaillons en groupe à construire une maison, à fabriquer un meuble ou lorsque nous participons à un sport d'équipe : nous savons dans quel ordre, et à quelle cadence effectuer une opération en fonction des partenaires et de l'avancement du projet.
Dans Les horloges sympathiques : l'organisation sociale au rythme de la syntonisation, Maxime Sainte-Marie pousse plus loin en montrant que le temps n'existe pas puisque nous l'avons toujours confondu avec le rythme.
Le phénomène se produit aussi en biologie. Saviez-vous que dans un couvent les religieuses ont tendance à synchroniser naturellement leurs périodes menstruelles ?. Si les organismes vivants et les assemblages mécaniques communiquent leur rythme aux autres éléments par la structure à laquelle ils appartiennent, nous pouvons alors ajouter le sens du rythme au sens du temps.
Les sens s'émoussent avec l'âge : la vue baisse, l'ouïe diminue, l'équilibre devient instable, la perception du temps s'abrège. Nous éprouvons la sensation que le temps s'écoule de plus en plus rapidement alors que les autres constatent l'inverse : nous ralentissons. Peut-on alors considérer le ralentissement du rythme qui vient avec l'âge comme une perte sensorielle ? Et si le temps est un sens comme un autre la mort, en supprimant tous les sens de l'individu, fait alors disparaître aussi le temps.
Mais peut-être devrons-nous bientôt considérer l'existence d'un neuvième sens. En effet, André Mayer propose, dans Apologie des contraires, l'idée que le genre pourrait être considéré comme un sens à part entière. Se sentir femme ou homme (ou quelque part entre les deux) serait-il lié à une émanation ou configuration corporelle qui en donnerait le sentiment ? Pourrait-on attribuer ce sens, par exemple, à nos organes sexuels ? La nature qui, sous la forme sexuée la plus rudimentaire du mollusque, quoique dépourvue de la vue de l'ouïe et de tous les sens reconnus comme tels, n'en a pas moins la perception de ce qui lui est nécessaire pour se reproduire. Si un sens, par définition, est la faculté par laquelle les êtres animés reçoivent les impressions du monde extérieur, le genre serait-il notre neuvième sens ?
Quoi qu'il en soit, puisque les humains ne sont pas seulement dotés de cinq sens, ne serait-il pas temps d'évoquer nos huit sensquand nous parlons de nos facultés de perception ?

[1] le 2 avril 2012.

[2] Ce que Kant nomme le « sens interne » dans la Critique de la raison pure - Esthétique transcendantale, 2e section, § 6, GF-Flammarion © 2006, pp. 128-129.(Voir L'espace et le temps.)Voir aussi le dossier Le sens du temps dans le magazine Cerveau & Psycho No. 32, mars-avril 2009.
[3] Maxime Sainte-Marie, Les horloges sympathiques, Les cahiers du LANCI, UQÀM 2008.
[4] Ibid. Syntonisation humaine, p. 14.
[5] André Mayer, Apologie des contraires, Éditions Carte blanche © 2008, p. 198.
 Re: Religion et Philosophie
Re: Religion et Philosophie
Religion & philosophie
On a suffisamment remarqué que la religion et la philosophie peuvent être rapprochées, notamment par les questions communes qu’elles se posent : celles de la place de l’homme dans la nature, du bien et du mal, et d’autres encore. En outre, quelques théologiens ont “emprunté” aux philosophes certains de leurs concepts et de leurs formes de raisonnement, comme saint Thomas d’Aquin à Aristote. La réciproque existe également, par exemple dans le concept philosophique de Dieu. Enfin, nombre de philosophes se sont réclamés ou se réclament d’une religion particulière. Ce sont là quelques unes des raisons de se demander si une philosophie peut être religieuse ou si une religion peut être philosophique. Bien que la réponse soit évidemment positive pour beaucoup, nous tenterons de montrer ici que la religion comme la philosophie ne peuvent que se perdre elles-mêmes, c’est-à-dire renoncer à ce qui les caractérise respectivement, dans une telle “union”.
Pour étayer notre réponse, il nous faudra pour commencer déterminer quelques unes des propriétés spécifiques de la religion d’une part, de la philosophie d’autre part.
1. Considérations générales sur la religion et la philosophie
Il semble que la notion de révélation soit la première spécificité de la religion au sens habituel du terme – celui, précisément, de religion révélé –, dans la mesure où elle est la condition même de la possibilité d’une religion : aucune ne prétend en effet être une émanation de l’homme seul ; il faut donc qu’un principe extérieur à l’humanité soit en mesure de transmettre à celle-ci, quelle qu’en soit la manière, ce qui définira la religion en question. C’est cette transmission que nous appelons ici révélation.
Quant au principe lui-même, les cas du Bouddhisme et de quelques autres religions orientales suffisent à empêcher qu’on le définisse par le terme de divinité : il y a des religions sans dieu. Mais ces cas ne sont pas vraiment gênants, car on peut se référer plus largement à la notion de sacré ; la religion est alors ce qui met l’homme en rapport avec le sacré. On peut ajouter que le sacré, bien qu’il se réfère, selon les religions, à des actions, des choses ou des entités fort diverses, doit être caractérisé dans chaque religion comme un absolu. Autrement dit, la sacralités de ce qui est sacré ne peut pas, à l’intérieur d’une religion donnée, être discutée, remise en cause ou a fortiori nié. Il y a plus encore : l’affirmation de la sacralité de ce qui est sacré se présente comme le fondement de la religion concerné, fondement qui, justement parce qu’il est indiscutable, n’a pas à être expliqué. Et dans tous les cas, les éventuelles “justifications” théologiques de ce fondement n’appartiennent pas en propre à la religion concernée. Nous voulons dire par là que premièrement, elles sont toujours développées a posteriori, et bien souvent dans un but plus didactique que véritablement religieux. Deuxièmement et en conséquence, elles sont au bout du compte facultatives, au sens où leur absence n’affaiblirait pas la religion en elle-même. Troisièmement, elles sont inutiles pour l’authentique croyant dont la foi n’a nul besoin d’explication. On peut même, d’un certain point de vue, les considérer comme nuisibles pour cette religion, dans la mesure où elles paraissent sous-entendre que le fondement de la religion en question ne va pas de soi. Autrement dit, les justifications rationnelles d’une religion prennent toujours le risque d’être perçues comme des aveux de faiblesse d’une doctrine qui aurait besoin de “se justifier”, au sens péjoratif de l’expression.
Que dire, dès lors, de la philosophie ? Pas plus que pour la religion, nous ne chercherons à la définir mais, ce qui sera ici suffisant, à la caractériser. Il semble que l’on peut dire de la philosophie l’exact opposé de ce qui vient d’être dit de la religion. Reprenons les points l’un après l’autre.
La seule idée de révélation rendra a priori le philosophe, au mieux, perplexe. Que pourrait en dire en effet la raison, pierre de touche de la recevabilité d’une argumentation philosophique ? Descartes ne s’y est pas trompé : « Je révérais notre théologie, et prétendais, autant qu’un autre, à gagner le ciel ; mais ayant appris, comme chose très assurée, que le chemin n’en est pas moins ouvert aux plus ignorants qu’aux plus doctes, et que les vérités révélées, qui y conduisent, sont au-dessus de notre intelligence, je n’eusse osé les soumettre à la faiblesse de mes raisonnements, et je pensais que, pour entreprendre de les examiner, et y réussir, il était besoin d’avoir quelque extraordinaire assistance du ciel, et d’être plus qu’homme. Notons que ces lignes ne contredisent en rien les textes où le même Descartes traite de Dieu, des preuves de son existence, de sa nature, et ainsi de suite, par exemple dans les Méditations, puisqu’il ne s’agit pas alors de vérités révélées, mais bien de vérités rationnelles, donc accessibles au philosophe. Autrement dit, la religion et indirectement le passage ci-dessus traitent du “Dieu des religions”, alors que c’est du “Dieu des philosophes” que Descartes affirme certaines propriétés.
Prenant un exemple de vérité révélée, Spinoza va plus loin : « Quand certaines Églises ajoutent que Dieu a pris une forme humaine, j’ai expressément averti que je ne sais pas ce qu’elles veulent dire ; et même, à dire vrai, affirmer cela ne me paraît pas moins absurde que de dire que le cercle a pris la forme d’un carré.
D’une manière générale, nul ne saurait nier que, souvent, les “vérités révélées” déconcertent, pour ne pas dire plus, la raison. Cela ne signifie pas pour autant que, pour cette seule raison, le philosophe doive les rejeter inconditionnellement. Un tel rejet ne se justifie que pour un certain courant philosophique, à savoir le rationalisme. Mais pour accepter positivement l’idée qu’une révélation, tout en étant manifestement irrationnelle, est source de vérité, il faudra franchir un pas qui, d’après nous, fait sortir de la philosophie. Le philosophe le plus “ouvert” aux religions ne peut donc qu’être réservé quant à l’idée même de révélation. Comment d’ailleurs choisirait-il entre les diverses religions ? Le philosophe ne peut, comme le font la quasi-totalité des croyants, adopter une religion uniquement en fonction de la société à laquelle il appartient par sa naissance et par son éducation.
Concernant le contenu des dogmes eux-mêmes, le philosophe devra selon nous adopter la même prudence. On peut sans doute s’entendre pour considérer qu’en aucun cas le philosophe n’acceptera une “vérité” qui, sans être évidente en elle-même, ne s’accompagne d’aucune justification théorique. Or nous avons remarqué précédemment que le fondement d’une religion n’est précisément jamais justifié a priori ; quand il l’est a posteriori, ce ne peut donc être que par une personne qui l’a au préalable admis sans une telle justification. Comment le philosophe pourrait-il avaliser cette admission ? Comment pourrait-il ne pas dénoncer la justification a posteriori comme une imposture visant à légitimer philosophiquement une prise de position qui ne fut pas, au départ, philosophique ? Le fondement d’une philosophie ne saurait être lui-même extérieur à la philosophie. Or la religion, et elle s’en félicite, trouve son principe hors de l’humanité, donc hors de la philosophie. Nous reviendrons sur ce point dans la troisième partie de cette étude.
De même, le philosophe ne pourra pas ne pas trouver contraire à la philosophie le refus de remettre en cause ou même seulement de “discuter” de certains dogmes, et singulièrement l’affirmation de la sacralité. On objectera peut-être que les philosophes eux-mêmes considèrent parfois certaines de leurs “vérités” comme indiscutables, sans qu’on leur refuse pour cela le titre de philosophe. La différence, de taille, est que le philosophe produira toujours, même lorsqu’il prétend énoncer une vérité indiscutable, une justification théorique l’accompagnant – ne serait-ce que l’affirmation de son évidence rationnelle, qui ne saurait sérieusement valoir pour les vérités révélées. De plus, il ne refusera jamais de répondre à une éventuelle objection, pour peu qu’elle soit philosophiquement intelligible, et ne menacera aucun contestataire des flammes de l’enfer.
On peut donc conclure que sans justification théorique, une proposition, quelle qu’elle soit, ne peut prétendre être philosophique. Autrement dit, le sens et la valeur de la philosophie ne résident pas moins dans l’argumentation des thèses que dans les thèses elles-mêmes, ce qui ne saurait raisonnablement se dire de quelque religion que ce soit.
Plus généralement, on pourrait dire que, si la religion est acceptée, elle rend la philosophie, pour une importante partie, inutile. En effet, certains dogmes religieux peuvent être considérés comme des réponses non philosophiques à des questions que se posent aussi les philosophes. Aussi le philosophe qui cherche à répondre, philosophiquement, à ces mêmes questions, entreprend-il une tâche ridicule du point de vue de la religion : sans pouvoir se targuer de la même “infaillibilité” que les religions, car la philosophie n’est qu’humaine – trop humaine ? –, il va chercher des réponses peu fiables – et, de fait, ses “collègues” philosophes ne se priveront pas de les critiquer – alors qu’il en existe déjà, et de beaucoup plus sûres, puisque d’essence bien souvent divine, et en tous cas non sujettes à la faillibilité humaine. Il ne restera donc au philosophe qu’à s’occuper de domaines que la religion a bien voulu négliger, car ne touchant manifestement pas, selon elle, au “salut” de l’homme : l’épistémologie ou l’esthétique par exemple. Mais pour les questions de métaphysique, d’éthique, d’anthropologie au sens large et parfois de politique, le débat doit être considéré, du point de vue religieux, comme clos. A l’opposé, on peut considérer que, du point de vue du philosophe, les questions philosophiques n’ont pour lui de raison d’être que s’il estime qu’elles n’ont pas encore reçu de réponse complète et définitive, émanant d’une religion quelconque, d’un autre philosophe ou de quelque autre source que ce soit. C’est seulement en acceptant cette “vacuité” que la philosophie a un sens.
Au fond, et on le verra mieux dans les deux cas précis étudiés ci-après, pour les philosophes religieux, la philosophie ne peut servir qu’à “redécouvrir” par la raison ce que la foi, par le biais de la révélation, a déjà enseigné. Cette conception de la philosophie comme « servante de la théologie », héritée du Moyen-Âge, ne peut pas disparaître si l’on admet, avant de philosopher, la vérité d’une religion. Et, même si l’on fait mine de se défendre d’adopter une telle conception, on voit mal comment il en serait autrement : « la vérité ne peut contredire la vérité », et si une vérité est admise au préalable – la vérité religieuse –, on sait déjà, avant même de commencer à philosopher, que la deuxième – la vérité philosophique – sera identique à la première ou au moins compatible avec elle ; il reste seulement à trouver des arguments philosophiques pour appuyer cette vérité unique, mais à deux visages. C’est par exemple la position de Jean-Paul II qui ouvre ainsi l’encyclique Fides et ratio : « La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l’esprit humain de s’élever vers la contemplation de la vérité ». Mais si la métaphore est juste, les deux ailes doivent nécessairement voler de manière concordante. Le chemin et le but étant bien sûr déterminés, dès l’envol, par l’aile de la foi, l’aile de la raison n’a plus qu’à s’y plier…
On pourrait ici nous faire l’objection suivante : certes, si la religion est admise avant que la réflexion philosophique soit engagée, les jeux sont faits, et la philosophie n’en sera pas vraiment une, puisque sa fin, dans les deux sens du terme, est déjà connue, et surtout a été déterminée de l’extérieur de la philosophie. Mais qu’est-ce qui empêche un philosophe de découvrir au préalable, par la philosophie, des vérités dont il remarquera ensuite la conformité avec une religion donnée, adoptant ainsi cette dernière après, et non avant, la naissance de sa réflexion philosophique ? Nous ne pouvons ici qu’acquiescer sur le plan théorique. Si un tel itinéraire de pensée existait, c’est sans hésitation que nous lui accorderions le statut de philosophie. Deux remarques s’imposent toutefois :
– Premièrement, nous ne pouvons manquer de signaler l’extrême difficulté théorique d’un tel cheminement, ainsi que l’impossibilité pratique de vérifier l’ordre de ses étapes, telles qu’elles ont été décrites ci-dessus. Il est en effet indéniable que, dans la quasi-totalité des cas, la religion apparaît bien avant la philosophie dans l’existence d’un individu. Lorsque l’esprit de l’adolescent est suffisamment mûr pour philosopher, la religion y est souvent déjà présente depuis bien longtemps. Il est vrai que certains ont su se dégager de l’influence de l’éducation religieuse qu’ils ont reçue. Mais on voit bien que, sauf exception rarissime, c’est toujours la religion qui précède la philosophie dans l’histoire d’un homme. De qui peut-on donc affirmer qu’il a “redécouvert” dans la religion ce qu’il avait découvert dans la philosophie ?
– Deuxièmement, même si une philosophie parvenait à justifier philosophiquement tous les dogmes voire toutes les pratiques d’une religion donnée, cette philosophie n’aurait qu’une conformité extérieure et même fortuite avec cette religion, puisque la seule justification véritable d’une religion est la révélation et que celle-ci est, par définition, hors de portée de toute justification philosophique. Autrement dit, une telle philosophie ne serait pas vraiment religieuse.
Il faut à présent confronter les analyses générales qui précèdent à des cas concrets qui pourraient sembler les invalider. En premier lieu, pour “tester” notre thèse selon laquelle il ne peut exister de philosophie religieuse, nous étudierons les textes de deux philosophes en accord avec une certaine religion (en l’occurrence le Christianisme). En second lieu, pour vérifier qu’une religion philosophique est impossible, notre attention se portera sur religion particulière dont certains affirment le caractère philosophique.
Une remarque méthodologique s’impose ici. Des exemples, aussi nombreux soient-ils, ne constituent pas des preuves en eux-mêmes. Ils ne jouent ici qu’un rôle d’illustration, en vue de rendre concrète notre thèse.
2. Les philosophies de Leibniz et de Kant sont-elles des philosophies religieuses ?
Les “philosophies religieuses” que nous allons maintenant étudier sont celles de Leibniz et de Kant. Nous ne prétendons pas ici livrer une analyse intégrale de la philosophie de la religion de ces auteurs, mais seulement indiquer le ou les moments où, selon nous, ils ont “glissé” de l’intérieur à l’extérieur de la philosophie pour tenter de justifier leur croyance religieuse. Un passage du début du Discours de métaphysique de Leibniz suffira à montrer ce que nous considérons comme une “sortie injustifiée” hors de la philosophie, injustifiée en ceci seulement qu’elle prétend prendre place dans une argumentation philosophique, tant dans le problème étudié que dans la méthode adoptée. Cela signifie que, en dehors de son activité philosophique, un philosophe peut fort bien écrire des textes exposant des vérités révélées – ou de la littérature, ou quoi que ce soit… –, à condition qu’il n’affirme ni ne sous-entende qu’il s’agit là de textes philosophiques ; or c’est précisément le cas de l’ouvrage évoqué ici, comme l’indique clairement son titre.
Après avoir défini Dieu comme étant « un être absolument parfait » et expliqué ce qu’on doit entendre par le concept de perfection, Leibniz conclut « que Dieu possédant la sagesse suprême et infinie agit de la manière la plus parfaite » et « que plus on sera éclairé et informé des ouvrages de Dieu, plus on sera disposé à les trouver excellents et entièrement satisfaisants à tout ce qu’on aurait pu souhaiter. » Bien qu’il y ait dans ces lignes matière à de nombreuses objections, nous sommes ici dans la philosophie, précisément parce que ces objections peuvent être elles-mêmes de nature philosophique. Il nous semble en revanche que Leibniz sort de la philosophie lorsqu’il écrit :
« Ainsi, je suis fort éloigné du sentiment de ceux qui soutiennent qu’il n’y a point de règle de bonté et de perfection dans la nature des choses, ou dans les idées que Dieu en a et que les ouvrages de Dieu ne sont bons que pour cette raison formelle que Dieu les a faits. Car si cela était, Dieu sachant qu’il en est l’auteur n’avait que faire de les regarder par après et de les trouver bons, comme le témoigne la sainte écriture. »
L’importance de l’argument de l’autorité biblique est ici prépondérante : Dieu a regardé ses ouvrages et les a trouvés bons, car c’est ce qu’affirment l’écriture, qualifiée de “sainte” sans justification. Or il nous semble que le philosophe n’est pas tenu de croire a priori en la divinité de l’origine des Écritures. Mais, une fois admise l’autorité de la Bible, le passage ci-dessus ne se prête à aucune objection philosophique : dès lors, il est en quelque sorte “infalsifiable” au sens que Popper donne à ce terme. Aucun débat philosophique n’est plus possible. Le raisonnement de Leibniz, entièrement explicité, est en effet le suivant :
1. La Bible a été inspirée par Dieu.
2. Or Dieu possède toutes les perfections morales, dont celle d’être vérace.
3. Donc la Bible dit la vérité.
4. Or la Bible dit que Dieu, après avoir créé certaines de ses œuvres, vit qu’elles étaient bonnes (par exemple : « Dieu dit : “Que les eaux qui sont sous le ciel s’amassent en une seule masse et qu’apparaisse le continent” et il en fut ainsi. Dieu appela le continent “Terre” et la masse des eaux “mers”, et Dieu vit que cela était bon. »)
5. Donc Dieu a pu constater, ou plus précisément “vérifier”, la bonté de ses œuvres en les regardant.
6. Donc les choses sont bonnes intrinsèquement, c’est-à-dire que la bonté est en elles-mêmes, et non pas extrinsèquement, c’est-à-dire seulement parce que Dieu en est l’auteur ou la cause.
On peut indifféremment inverser l’ordre des propositions 1. et 2. Il reste que la divinité des Écritures est un pilier de cette démonstration, et donc que sa remise en cause implique celle de tout le raisonnement. Or il semble clair que l’affirmation « La Bible a été inspirée par Dieu » n’est pas et ne peut pas être une thèse philosophique, c’est-à-dire une affirmation susceptible d’être fondée et contredite par des arguments philosophiques – si du moins on se réfère au sens que Leibniz donne ici au mot “Dieu”, c’est-à-dire au sens religieux.
Nous affirmons donc que le raisonnement de Leibniz extrait du Discours de métaphysique n’est pas, par son fondement, philosophique, et plus généralement que tout système de pensée fondé sur une quelconque révélation, sans que la raison vienne justifier ce fondement, ne saurait être qualifié de philosophie.
Pour Spinoza en revanche, la question de la divinité des Écritures peut se poser en termes philosophiques, mais en donnant au concept de Dieu un sens qui n’est assurément pas le sens religieux. Lorsqu’il écrit en effet : « (…) la plupart, en vue de comprendre l’Écriture et d’en dégager le vrai sens, posent pour commencer la divine vérité de son texte intégral. (Alors que cette conclusion devrait découler d’un examen sévère de son contenu.) », il est clair que l’expression « divine vérité » est quasiment, sous sa plume, un pléonasme, et donc que c’est en examinant le texte biblique lui-même que l’on pourra conclure qu’il dit la vérité – ou non –, et donc qu’il exprime la “divine vérité”. Pour Leibniz, la Bible dit vrai parce que Dieu en est l’auteur ; c’est du moins ce qu’on peut supposer en l’absence de toute autre justification.
Dans La religion dans les limites de la simple raison, Kant va tenter de montrer que le Christianisme n’est pas seulement un « religion révélée », étant apparue à une époque et un endroit précis, mais également une « religion naturelle », c’est-à-dire, en droit, universelle et mondiale : chaque homme, quelles que soient son époque et sa société, et pour autant qu’il soit doué de raison, peut reconnaître que les principes moraux enseignés par le Christianisme sont identiques à ceux que sa raison pratique lui dicte. Pour démontrer cette identité, Kant va se livrer à une exégèse détaillée du Sermon sur la montagne, texte qui contient d’après lui l’essentiel des préceptes moraux du Christianisme. Ce que Kant relève notamment dans le Sermon, c’est qu’il enjoint de suivre l’esprit de la loi plutôt que la lettre. On retrouve ici la distinction faite par Kant dans les Fondements de la métaphysique des mœurs entre “agir par devoir” et “agir conformément au devoir”. Ainsi du fameux passage :
« Vous avez entendu qu’il a été dit : “Tu ne commettras pas l’adultère”. Eh bien ! Moi je vous dis : quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis, dans son cœur, l’adultère avec elle. »
Kant comprend ces versets comme dénonçant l’hypocrisie d’une conduite extérieure ou plus précisément physique, seulement conforme extérieurement à l’interdiction de l’adultère – consistant à ne pas commettre l’acte de l’adultère –, et qui l’enfreint néanmoins si le désir est bien réel. Plus généralement, Kant rappelle que l’enseignement du Christ n’est pas supposé être différent de la loi hébraïque, mais qu’il a interprété la Loi pour montrer sa conformité à la raison pratique : « Car au pied de la lettre, la loi autorisait exactement le contraire » de ce qu’autorise l’interprétation du Christ, dit Kant.
Remarquons que pour parvenir à la conviction que la Bible est en conformité avec la raison pratique, il a fallu tout d’abord que le Christ interprète la loi hébraïque, c’est-à-dire qu’il en révèle l’esprit en la débarrassant d’une lecture « au pied de la lettre », puis que Kant lui-même interprète les paroles du Christ pour montrer qu’elles ne sont qu’une autre formulation, sans doute plus accessible au plus grand nombre, de la loi morale prise en elle-même, énoncée en termes philosophiques.
C’est donc au prix de deux interprétations successives – celle de la loi hébraïque par le Christ puis celle des paroles du Christ par Kant – que l’on parvient à montrer la conformité de l’enseignement biblique avec la raison pratique. Et c’est bien là la première objection que l’on peut faire à Kant : une religion naturelle étant universelle, tout homme doit pouvoir accéder aux vérités qu’elle enseigne. S’il est déjà déconcertant que Dieu transmette aux hommes un texte énonçant une loi morale qu’il a, de toute façon, “inscrite” en tout homme possédant la raison pratique, il est encore plus étonnant que ce texte doive dans certains cas – l’Ancien Testament – “subir” tour à tour deux interprétations, dont le moins que l’on puisse dire est qu’elles ne vont pas de soi, pour au bout du compte énoncer ce que tous savaient déjà avant ! Si l’on ajoute que le texte d’origine, supposé être inspiré par Dieu, enseigne selon Kant lui-même des choses opposées selon qu’on le prend à la lettre ou qu’on en dégage l’esprit, on comprend difficilement la valeur et la légitimité d’un tel texte. Kant ne cherche-t-il pas plutôt à “asseoir” la légitimité de sa philosophie morale sur l’autorité du Christianisme ? Sur le plan philosophique, qu’importe après tout que la “vraie” morale, que Kant prétend enseigner, soit ou non celle d’une religion institutionnelle, fût-ce la religion dominante ?
On peut également contester la prééminence et même l’exclusivité que Kant accorde au Christianisme en matière de morale : « Mais, suivant la religion morale (et parmi toutes les religions publiques qu’il y eut jamais, seule la religion chrétienne a ce caractère) … » Cette affirmation, écrite entre parenthèses, comme semblant si peu contestable qu’elle se passe de justification, a évidemment de quoi choquer par son intolérance. Mais elle déconcerte également celui qui a pris note du fait que le Christianisme n’enseigne en fin de compte rien de plus que le Judaïsme. Si le Christ, selon ses propres paroles, vient pour accomplir la Loi et les Prophètes, c’est bien qu’il n’y a aucune différence de fond entre le Judaïsme et le Christianisme. Si différence il y a, ce ne peut pas être une différence telle que le second serait une, ou plutôt “la” religion morale, ce que ne serait pas le premier ! Plus précisément, pour Kant, si le Judaïsme n’est pas une religion morale, c’est parce que, comme toutes les religions sauf le Christianisme, il comporte en lui la recherche des faveurs divines.
Cette délicate question tourne plus ou moins directement autour de ce qu’on appelle la morale de la rétribution, c’est-à-dire une morale qui affirme que les pieux et les justes sont récompensés et que les impies et les méchants sont punis. S’il est incontestable que la Bible hébraïque enseigne parfois une telle morale, des livres comme ceux de Job et de l’Ecclésiaste la condamnent catégoriquement – ce dont Kant ne tient pas compte – en remarquant que le juste subit parfois des maux “naturels”, donc d’origine divine, et que la fortune sourit parfois au méchant. Chacun est alors invité à s’en remettre à la sagesse divine sans chercher à en percer les desseins.
Supposons toutefois que cette immoralité du Judaïsme soit fondée ce qui, on le voit, ne va pas de soi. Le plus paradoxal est encore que Kant, en critiquant indirectement la morale juive, condamne nécessairement la Bible hébraïque, où la morale de la rétribution apparaît effectivement. Or cette Bible hébraïque est, quelques différences infimes mises à part, reprise par le Christianisme à son propre compte sous le nom d’Ancien Testament. La recherche des faveurs est-elle présente ou absente des mêmes textes, selon qu’ils sont lus par les Juifs ou par les Chrétiens ? Il y a là encore, semble-t-il, une très forte partialité de Kant en faveur du Christianisme, partialité qu’une véritable neutralité philosophique a priori aurait rendue, selon nous, impossible. Nous affirmons bien que cette neutralité devrait exister a priori, sans qu’elle doive nécessairement se prolonger a posteriori. Mais Kant ne justifie par aucun argument philosophique la suprématie du Christianisme dans le domaine morale. On pourrait d’ailleurs remarquer que le Nouveau Testament n’est pas non plus exempt de passages exprimant une morale de la rétribution, ce que Kant, là encore, passe sous silence.
Dans la même logique, il écrit : « Il n’existe qu’une religion (vraie) ». Mais comment le Christianisme pourrait-il être la vraie religion s’il est, selon les paroles de Jésus lui-même, l’accomplissement d’une fausse religion, en l’occurrence le Judaïsme ?
Enfin, Kant nous semble également faire preuve d’une précipitation suspecte et fort peu philosophique lorsqu’il écrit : « J’admets premièrement la proposition suivante, comme principe n’ayant pas besoin de preuve : Tout ce que l’homme pense pouvoir faire, hormis la bonne conduite, pour se rendre agréable à Dieu est simplement illusion religieuse et faux culte de Dieu ». Non pas que nous pensions, le lecteur l’aura compris, que bien d’autres comportements sont susceptibles de plaire à Dieu ; mais ce qui est ici affirmé presque explicitement, c’est que la bonne conduite d’un homme le rend agréable à Dieu. Voilà certes une proposition qui aurait selon nous besoin de preuve, si cela était possible. A vrai dire, il peut sembler au contraire que l’idée d’un Dieu sensible aux comportements humains a quelque chose d’irrespectueux, pour ne pas dire d’hérétique, à moins d’affirmer que Kant utilise un langage anthropomorphique, ce que rien ne laisse supposer.
Bien d’autres remarques seraient possibles pour confirmer, avec celles qui précèdent, que Kant fait reposer sa philosophie morale sur un fondement non philosophique, mais bel et bien religieux a priori, donc non argumenté rationnellement.
3. Le Catholicisme est-il une religion philosophique ?
Nous allons à présent examiner un cas de religion prétendant ou pouvant prétendre être philosophique. Si nous choisissons le Catholicisme, ce n’est pas essentiellement parce qu’il est la religion plus répandue dans nos sociétés dites latines, mais surtout parce qu’il s’est doté d’une théologie plus “systématique” que d’autres religions, à la fois par sa “fréquentation” de la philosophie occidentale et par sa structure très hiérarchisée, qui ont permis l’établissement d’une doctrine unifiée et officielle, à l’abri, normalement, de toute contestation interne, ce qui facilite d’ailleurs grandement la recherche des références.
Quelques remarques préalables s’imposent toutefois. Nous avons déjà évoqué l’idée selon laquelle le fondement d’une philosophie ne saurait être “extra-philosophique”. C’est pourquoi la manière dont débute une philosophie est capitale. Notons que ce “début” n’est pas forcément – et, dans les faits, n’est que rarement – premier chronologiquement dans l’œuvre d’un philosophe. Ainsi le doute radical de Descartes est bien le début “logique” de sa philosophie sans apparaître dans ses premières œuvres. Si certains philosophes semblent ne pas s’être particulièrement souciés de ce “début philosophique”, ce ne peut être que parce qu’ils considèrent qu’il n’y a pas à proprement parler à fonder la philosophie, ou encore parce que toute réflexion philosophique peut servir de fondement à la philosophie.
Il ne saurait en aller de même dans une religion, dont le point de départ, à savoir la révélation, est toujours extérieur à la raison et même, plus largement, à l’homme. En fait, nous avons déjà rencontré ce cas de figure dans les textes de Leibniz et de Kant étudiés plus haut, dont nous avons montré qu’ils s’appuyaient sur des données spécifiquement religieuses, donc impossibles à argumenter philosophiquement.
Nous allons retrouver cette extériorité dans le fondement du Catholicisme : « Au point de départ de toute réflexion que l’Église entreprend, il y a la conscience d’être dépositaire d’un message qui a son origine en Dieu même (…). La connaissance qu’elle propose à l’homme ne vient pas de sa propre spéculation, fût-ce la plus élevée, mais du fait d’avoir accueilli la parole de Dieu dans la foi ». Les choses sont donc claires : les vérités religieuses, auxquelles les hommes peuvent accéder par la révélation, préexistent à toute réflexion humaine. En raison de leur origine divine, elles sont infaillibles. Avant même d’inaugurer la moindre réflexion, le philosophe catholique sait donc vers quoi doit tendre sa philosophie. Celle-ci n’a par conséquent qu’un rôle secondaire de confirmation a posteriori de “vérités” admises comme vraies avant toute intervention de la raison philosophique. C’est donc en toute logique que Jean-Paul II écrit : « L’Église, pour sa part, ne peut qu’apprécier les efforts de la raison pour atteindre des objectifs qui rendent l’existence personnelle toujours plus digne. Elle voit en effet dans la philosophie le moyen de connaître des vérités fondamentales concernant l’existence de l’homme. En même temps, elle considère la philosophie comme une aide indispensable pour approfondir l’intelligence de la foi et pour communiquer la vérité de l’Évangile à ceux qui ne la connaissent pas encore ». Ce que nous considérons comme contraire à la philosophie dans ces lignes, ce n’est pas, encore une fois, la position elle-même, c’est-à-dire la fonction “évangélisatrice” assignée à la philosophie, mais le fait que cette position soit assignée de l’extérieur de la philosophie, c’est-à-dire sans argumentation rationnelle. Dans la même logique, le pape condamne au terme de son encyclique un certain nombre de courants de pensée : l’éclectisme, l’historicisme, le scientisme, le pragmatisme et le nihilisme. Ces doctrines sont considérées à la fois comme des « erreurs » et des « dangers ». C’est dire qu’il aurait mieux valu qu’elles ne soient jamais formulées. On ne peut là encore que refuser de qualifier de philosophie une pensée qui se voudrait sans “adversaire”, même intellectuel ; nous estimons en effet que l’esprit critique et l’ouverture à la contestation doivent être des soucis constants du philosophe, conscient qu’il est, et ne peut qu’être, de ne pouvoir se prévaloir d’aucune infaillibilité. Autrement dit, le philosophe a philosophiquement intérêt à être contesté, afin de tester la validité de sa pensée. Au contraire, une doctrine d’origine “surhumaine” ne peut avoir, envers une contestation humaine, qu’une attitude de commisération, d’indifférence, de mépris ou de violence, mais pas véritablement, on ne le voit que trop, d’écoute véritable.
On peut donc admettre que les “vérités religieuses” précèdent toute réflexion philosophique. Mais, objectera-t-on peut-être, la foi dans ces vérités religieuses ne peut-elle pas, quant à elle, être justifiée philosophiquement… ? Pas davantage, comme le reconnaît, là encore, le dogme catholique : « Le motif de croire n’est pas que les vérités révélées apparaissent comme vraies et intelligibles à la lumière de notre raison naturelle ». Toutefois, pour que la foi soit conforme à la raison, Dieu a mis en œuvre des « preuves extérieures de sa Révélation » : « les miracles du Christ et des saints, les prophéties, la propagation et la sainteté de l’Église, sa fécondité et sa stabilité ». La raison du philosophe trouvera-t-elle dans cette liste des preuves ou des « signes certains » de la révélation chrétienne ? Accordons au moins que cela n’est pas évident…
Conclusion
L’examen des “philosophies religieuses” de Leibniz et Kant a montré diverses “failles”, non pas en tant qu’erreurs à l’intérieur de leur philosophie, mais précisément en tant que manquements à l’exigence philosophique d’une argumentation rationnelle et donc de refus d’un quelconque argument d’autorité, fût-ce l’autorité de la Bible.
Nous pouvons donc conclure qu’une “philosophie religieuse” est soit extérieure à la religion, si la philosophie “précède” la religion, soit extérieure à la philosophie si, comme nous croyons l’avoir montré pour les deux cas étudiés, la religion “précède” la philosophie. Cela ne signifie bien entendu pas que le philosophe soit par définition irréligieux. Dans la mesure où il est homme “avant” d’être philosophe, il pourra, comme Leibniz, Kant et beaucoup d’autres, croire en Dieu et même appartenir à une religion précise. Mais il devra renoncer à légitimer sa foi, ses croyances et ses pratiques par des arguments philosophiques, et donc renoncer à intégrer sa religion dans sa philosophie. Il pourra seulement – et même en tant que croyant, il devra probablement – expliquer pourquoi sa philosophie doit forcément laisser une place, hors d’elle (au-dessus, dira-t-il sûrement), à la religion. Il pourra par exemple, à la manière d’un Pascal, essayer de montrer que la raison et donc la philosophie peuvent reconnaître elles-mêmes leurs propres limites : « La dernière démarche de la raison est de reconnaître qu’il y a une infinité de choses qui la surpassent ; elle n’est que faible, si elle ne va jusqu’à connaître cela. »
Le philosophe peut donc être religieux, mais il ne peut pas l’être en tant que philosophe. La philosophie peut indiscutablement aller jusqu’au déisme ou au théisme, mais le pas qui mène du théisme à une religion révélée est précisément le pas qui fait sortir de la philosophie.
L’hypothèse d’une religion philosophique, du fait du nécessaire fondement non humain de toute religion, est elle aussi, dès le départ, à exclure.
Quant à l’athéisme, il n’est jamais que le refus d’une certaine conception de Dieu ou des dieux. On peut le voir par exemple avec Spinoza qui, tout en démontrant l’existence de Dieu, peut bien être considéré comme “athée”, au sens où il refuse l’existence d’un Dieu anthropomorphe. On le voit encore avec Marcel Conche, qui s’attaque précisément à l’idée d’un Dieu à la fois moralement bon et tout-puissant : « Il est indubitable (…) que le supplice des enfants a été, et devait ne pas être, et que Dieu pouvait faire qu’il ne soit pas. Comme Dieu ne s’est pas manifesté dans des circonstances où, moralement, il l’aurait dû, s’il existait, il serait coupable. La notion d’un Dieu coupable et méchant apparaissant contradictoire, il faut conclure que Dieu n’est pas. » Nous n’affirmons certes pas que cette argumentation, non plus que les démonstrations de l’existence de Dieu de Spinoza, sont à l’abri de toute contestation, y compris philosophique. Mais nous avons bien là des exemples de raisonnement parfaitement intelligible, que même le plus fervent des croyants peut suivre, pour peu qu’il soit doué de raison. L’athéisme peut donc être philosophique ou, ce qui revient au même, une philosophie peut être athée.
On se méprendrait en voyant dans cette étude une attaque contre les religions en général. Nous avons même indiqué à plusieurs reprises que l’attitude des religieux est très souvent en parfaite cohérence avec leurs convictions. Nous avons uniquement cherché à montrer en quoi religion et philosophie, sans forcément se combattre mutuellement, ne peuvent pas s’unir sans une dangereuse “confusion des genres”. Pour les deux partis, une telle union ne serait donc pas pour le meilleur mais seulement pour le pire…
Marc Anglaret
1 Nous considérerons ici les religions dans leur approximative unité, et plus précisément dans leur rapport à la philosophie.
2 Ces deux questions reviennent, au bout du compte, au même, mais au bout du compte seulement.
3 Nous reviendrons, avec l’examen de la position kantienne, sur la distinction entre religion naturelle et religion révélée.
4 Nous précisons bien qu’il ne s’agit pas là de donner une définition, avec tout ce que cette opération implique, de la religion, mais bien de la distinguer de la philosophie.
5 La question n’est pas ici celle de l’intolérance des religions, fort diverses sur ce point comme sur d’autres, mais celle du statut de l’affirmation de la sacralité au sein même d’une religion. Nous soutenons ici que cette affirmation se présente toujours comme indubitable, au point que toute éventuelle critique à ce sujet doit être considérée comme “déplacée”, dans le meilleur des cas…
6 Nous distinguons ici le fondement d’une religion, c’est-à-dire la ou les croyances, toujours liées au sacré selon nous, sur lesquelles s’appuient les autres croyances, de son principe, qui n’est pas une croyance mais l’origine de sa révélation : par exemple Dieu dans les religions monothéistes.
7 Discours de la méthode, première partie. NRF Gallimard, « La Pléiade », p.130. C’est nous qui soulignons.
8 Lettre LXXIII à Oldenburg (1675). NRF Gallimard, « La Pléiade », p.1283. Ce célèbre passage devrait suffire à éviter toute “récupération” du spinozisme par le Christianisme – ce qui, dans les faits, n’est pas le cas.
9 On objectera que certains philosophes habituellement qualifiés de rationalistes – par exemple Leibniz – admettent les vérités révélées de certaines religions, notamment le Christianisme. Nous étudierons précisément plus loin le cas de Leibniz, en montrant pourquoi il ne peut pas, selon nous, être pleinement considéré comme rationaliste.
10 Il n’a toutefois échappé à personne que, par une étrange coïncidence, les philosophes croyants adoptent dans la quasi-totalité des cas la religion de leur éducation, familiale notamment, et ce pas seulement dans le cas du Christianisme, comme le montrent les cas d’Averroès et de Maïmonide par exemple. Nous ne connaissons pas de contre-exemple sur ce point (Schopenhauer ne peut pas, par exemple, être sérieusement qualifié de “philosophe bouddhiste”, bien qu’il se soit lui-même reconnu dans certaines thèses du Bouddhisme).
11 Nous pensons par exemple aux Objections faites aux Méditations de Descartes, ou à la correspondance de nombre de philosophes.
12 Jean-Paul II, Fides et ratio (la foi et la raison), I, prologue ; lettre encyclique du 14 septembre 1998. Supplément au quotidien « La Croix » du 16 octobre 1998, p.3
13 D’autres philosophies pourraient bien sûr avoir leur place ici, par exemple celle de Hegel. C’est pour ne pas rendre cette étude trop volumineuse que nous avons choisi ces deux exemples, à la fois pour leur relative simplicité et leur représentativité. Par ailleurs, il est certain que l’examen de “philosophies religieuses” non chrétiennes manque à cette étude. Notre quasi-ignorance en la matière est la raison de cette absence.
14 Discours de métaphysique, 1, II. Éditions Vrin, p.26. C’est nous qui soulignons.
15 Genèse, 1, 9 –10. C’est nous qui soulignons.
16 A fortiori ne peut-elle pas être la thèse d’un philosophe rationaliste, qualificatif que l’on attribue souvent à Leibniz.
17 Et pour cause : nous croyons avoir montré plus haut qu’une telle justification est impossible ; au moins devrait-elle être tentée par Leibniz s’il entend se placer dans une perspective philosophique.
18 Spinoza, Traité des autorités théologique et politique, préface. NRF Gallimard, « La Pléiade », p.612
19 Selon Spinoza, au contraire, on pourrait dire que Dieu est l’auteur de la Bible seulement si elle dit vrai (ce qui reste donc à démontrer rationnellement), mais en donnant au mot “Dieu” un sens qui exclut toute révélation : toute la première partie de l’Éthique, intitulée “de Dieu”, est exempte de la moindre allusion biblique ou théologique.
20 Évangile selon Matthieu, chapitres 5 à 7.
21 Évangile selon Matthieu, 5, 27 – 28.
22 Interdiction formulée dans le septième des dix commandements (Exode, 20, 14).
23 Évangile selon Matthieu, 5, 17 : « N’allez pas croire que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. »
24 La religion dans les limites de la simple raison, IV, 1, 1. Éditions Vrin, p.179
25 Puisque dans les deux cas, de nombreux siècles se sont écoulés entre le texte et son interprétation : de la rédaction du Décalogue dans l’Exode à l’interprétation qu’en fait Jésus dans les Évangiles d’une part, de la rédaction des Évangiles à l’interprétation qu’en fait Kant d’autre part.
26 La religion dans les limites de la simple raison, op. cit., I, Remarque générale. p.92. C’est nous qui soulignons.
27 Cf. note 23.
28 … ou plus exactement entre le Judaïsme et l’enseignement de Jésus, car rien dans les paroles de ce dernier n’indique clairement qu’il voulait fonder une nouvelle religion, mais plutôt, comme on l’a dit (note 23), qu’il était venu pour « accomplir » le Judaïsme.
29 Par exemple : « Si le juste ici-bas reçoit son salaire, combien plus le méchant et le pécheur » (Proverbes, 11, 31 ; le terme « salaire » est ici sans ambiguïté). Bien d’autres versets, dans ce livre ou dans d’autres, sont tout aussi explicites.
30 Dans le livre de Job, Yahvé, par l’intermédiaire de Satan, “éprouve” la foi de Job, homme riche et pieux, en détruisant ses biens, en faisant tuer ses serviteurs et ses enfants, puis en le frappant de maladie. Job, conformément aux prédictions de Satan et contre celles de Yahvé, reproche à ce dernier son injustice. La “leçon” du livre, donnée par Yahvé lui-même, est que nul ne doit se permettre de juger son Dieu, et ce même s’il lui semble injuste. Cela dit, Job recouvre à la fin du récit tout ce qu’il a perdu : la morale de la rétribution est confirmée, bien que le propos “officiel” du livre la condamne.
31 Les théologiens appellent cela une « évolution » de la doctrine biblique, terme certes moins brutale que celui de « contradiction »…
32 Par exemple : « C’est qu’en effet le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de son Père, et alors, il rendra à chacun selon sa conduite » (Évangile selon Matthieu, 16, 27).
33 La religion dans les limites de la simple raison, op. cit., III, 1, 5. p.137
34 Il n’y a bien entendu nulle prétention à l’exhaustivité dans ces quelques remarques.
35 La religion dans les limites de la simple raison, op. cit., IV, 2, 2. p.188
36 Jean-Paul II, Fides et ratio, I, 7 ; op. cit., p.5
37 Ibid., I, 5 ; p.4. C’est nous qui soulignons.
38 Ibid., VII, 86 - 90 ; pp.31 - 32.
39 Catéchisme de l’Église Catholique, première partie, chapitre troisième, article I, 3, §156. Mame / Plon, p.44
40 Mais que faire alors de ce verset : « « Il surgira, en effet, des faux Christ et des faux prophètes, qui produiront de grands signes et des prodiges, au point d’abuser, s’il était possible, même les élus. » (Évangile selon Matthieu, 24, 24).
41 On peut ici se reporter aux deux remarques précédant l’analyse de la “philosophie religieuse” de Leibniz, en haut de la page 4.
42 Pascal, Pensées, fragment 267 de l’établissement de Brunschvicg (188 de Lafuma). Garnier-Flammarion, p.266. Concernant les Pensées en général, il est bien malaisé de dire s’il s’agit bien là d’un ouvrage philosophique au sens où nous l’avons expliqué plus haut. En fait, certains fragments le sont sans aucun doute, comme celui du pari (Brunschvicg : 233 ; Lafuma : 418). D’autres ne le sont manifestement pas, comme ceux sur les « preuves de Jésus-Christ » (Brunschvicg : 737 et suivants), qui ne s’adressent pas à la raison, mais bien à la foi éventuelle du lecteur.
43 Éthique, I, proposition 11. NRF Gallimard, « La Pléiade », pp.317 – 319.
44 Appendice de la première partie de l’Éthique et Traité des autorités théologique et politique, surtout les chapitres I à XII.
45 Marcel Conche, Orientation philosophique. I. “La souffrance des enfants comme mal absolu”. P.U.F. p.57
[size=130]Antoine Fleyfel, La philosophie et la religion[/size]
 Re: Religion et Philosophie
Re: Religion et Philosophie
Paul et les Épicuriens d’Athènes entre polythéismes athéismes, et monothéismes
Renée Koch Piettr
1
L’épisode néotestamentaire de la rencontre de Paul et des philosophes épicuriens et stoïciens d’Athènes, au chapitre 17 des Actes des Apôtres (v. 16-24), éclaire les relations entre les commencements du christianisme et son environnement intellectuel et religieux dans l’empire romain. L’apôtre Paul y est en effet conduit à expliquer son message en des termes qu’il essaye de rendre compréhensibles à un public d’Athéniens cultivés, en fonction de ce que lui-même croit connaître de ce public. C’est du moins ainsi que Luc, le rédacteur des Actes, tâche de rendre compte de l’épisode, auquel apparemment il n’avait pas assisté
2
Or, cet épisode offre simultanément l’occasion de s’interroger sur les rapports paradoxaux qu’on peut soupçonner entre l’épicurisme et la pratique missionnaire de Paul, ou plus largement entre l’épicurisme et le christianisme naissant. La recherche là-dessus a déjà une assez longue histoire, mais n’a sans doute pas encore trouvé ses marques, ni le ton juste, ni sa conclusion Une sorte de préjugé chrétien paraît y être la règle. Ceux qui s’y risquent rencontrent généralement tout aussitôt deux sortes de réactions indignées :
3
– Du côté de ceux qui abordent l’épicurisme dans la tradition d’un humanisme libertin et d’une philosophie matérialiste, on se récrie : comment peut-on introduire dans la genèse du christianisme ces pères de l’atomisme et d’un hédonisme matérialiste, ces libérateurs de l’humanité, voire ces ancêtres du marxisme dialectique, que furent Épicure ou Lucrèce ? Toutes les religions ne sont-elles pas un « opium du peuple » ?
4
– Du côté des historiens et des théologiens du christianisme, même scandale : comment peut-on oser déceler même un voisinage, encore moins un cousinage contre nature, entre deux doctrines aussi opposées que cet athéisme que l’on reproche couramment à Épicure et aux siens , et la foi chrétienne ? Paul a d’ailleurs mis ses disciples en garde contre la philosophie, ainsi en Col. 2.8 : « Veillez à ce que nul ne mette le grappin sur vous par le moyen de la philosophie, cette creuse duperie qui suit la tradition des hommes, les éléments de l’univers ,et non plus le Christ ».
Épicurisme et christianisme : les raisons d’une comparaison
5
Il y a néanmoins pour les hellénistes de bonnes raisons de conduire une telle exploration, fût-ce, à terme, pour en déjouer l’hypothèse. En voici quelques-unes :
6
Il est arrivé que les Anciens mettent l’épicurisme et le christianisme dans le même sac et les tiennent tous deux pour également abominables et impies, athées : on cite couramment, à ce sujet, un passage d’un opuscule de Lucien de Samosate, Alexandre le faux prophète : cet Alexandre se donna dans la seconde moitié du IIe siècle de notre ère pour le prophète d’un nouveau dieu, le serpent Glycon, enfant du dieu guérisseur Asclépios. Il établit les mystères de ce dieu dans la cité d’Abonotique, sur l’actuelle rive turque de la mer Noire. Or la liturgie de ces mystères commençait par le solennel bannissement des impies, Alexandre lançant un « Dehors, les Chrétiens ! » et la foule en chœur enchaînant par ce répons : « Dehors, les Épicuriens »
7
Ces deux doctrines de salut (en cette vie ou en une autre vie) remontent à un fondateur charismatique dont elles entretiennent la mémoire et le culte. Épicure était salué par ses adeptes comme un dieu sauveur (sôtêr), ce qui n’a d’ailleurs rien de très original durant la période hellénistique, où des rois en particulier purent être pareillement salués (mais notons que le roi séleucide Démétrios Ier Sôter était lui-même un fervent adepte de l’épicurisme ). Elles enseignent notamment, mais diversement, à ne pas craindre la mort .
8
Les Épicuriens, qui paraissent avoir réussi une remarquable intégration dans les sociétés hellénistique et romaine, entretinrent néanmoins dès le début une controverse très vive avec les autres écoles philosophiques, notamment l’école stoïcienne ; ils se rendirent à l’occasion coupables de diverses manœuvres politiques obscures , et furent sporadiquement l’objet d’un rejet et d’un mépris dont l’ampleur est difficile à mesurer, de campagnes de calomnies, notamment (ce n’est pas nouveau) quant à leurs mœurs sexuelles, – et même, pour finir, d’une véritable chasse aux sorcières, avec destruction de leurs écrits, à peu près à l’époque même de la persécution des chrétiens . La différence, c’est que les Épicuriens disparurent quasiment, cependant que le christianisme s’imposait comme la religion dominante dans l’empire romain. Renvoyons au discours de Cicéron Contre Pison, aux pamphlets anti-épicuriens de Plutarque, aux autodafés des écrits épicuriens organisés et encouragés par Alexandre d’Abonotique selon l’opuscule précédemment cité, à quelques anecdotes scandaleuses contées dans Athénée et dans Élien, ce qui nous mène jusqu’à la première moitié du troisième siècle. Mais déjà, les chrétiens eux-mêmes ont pris la relève dans la critique anti-épicurienne (Origène, Lactance), cependant que des connexions troublantes apparaissent pourtant entre les deux courants, par exemple chez un Minucius Félix, qui, originaire d’Afrique, tente de concilier la nouvelle foi avec la tradition philosophique, vers le second ou le troisième siècle. En l’an 367 l’empereur Julien l’Apostat se réjouit de ce que les dieux aient presque anéanti les ouvrages d’Épicure : mais Augustin, né en 354, déclare avoir été, dans sa jeunesse, tenté par la doctrine d’Épicure.
9
On décèle des ressemblances entre l’organisation et le fonctionnement de ces deux sectes (j’emploie le mot secte dans le sens que les Grecs donnaient au mot hairesis, qui a donné hérésie : un choix de doctrine, qui chez les Anciens qualifiait, à partir de l’époque hellénistique, les options philosophiques présentes, en quelque sorte, sur le marché, options qui comportaient toutes une théologie et un mode de vie dont les spécificités allaient jusqu’à régenter l’activité politique, l’habillement et l’alimentation . Par exemple, le recours de Paul à la correspondance épistolaire, tant pour l’élaboration et pour la diffusion de la doctrine que pour la direction spirituelle de communautés nombreuses dispersées dans le monde gréco-romain, n’est pas sans ressemblance avec le réseau de communautés épicuriennes qui restait sans doute très actif à son époque, et fonctionnait par circulation interne d’hommes, de libelles et de lettres, constituant par ailleurs un véritable réseau d’influences présent jusque dans les cercles les plus élevés du pouvoir. La grande vitalité de ce réseau nous est bien connue depuis le vivant d’Épicure jusqu’à notre Alexandre de Lucien : notamment par les textes, toujours en voie de déchiffrement, des papyri de la bibliothèque d’Herculanum, dont le fonds originel appartint à l’Épicurien Philodème, et ceux du portique de l’Épicurien Diogène d’Œnoanda, véritable bibliothèque sur pierre, sur le continent turc à peu près à la hauteur de Rhodes. Le réseau s’auto-finançait par les contributions de ses membres. Pour la diffusion du réseau épicurien, nos informations permettent de tracer un grand fuseau qui va de l’Égypte à la Gaule (on a trouvé une mosaïque épicurienne du iie s. en France, à Autun), en passant par la Syrie, la Mer Noire, la Macédoine, la plaine du Pô pour l’arc Nord d’une part ; Chypre et Rhodes, le Péloponnèse, la Campanie d’autre part pour l’arc Sud du fuseau, la présence en Afrique du Nord restant, pour autant que je sache, incertaine, et dans la péninsule ibérique, sans nul indice.
10
Parmi ces ressemblances, j’en retiendrai trois qui touchent au climat même des communautés, aux comportements et à l’ambiance affective – ce sont des choses qui ne s’inventent pas, et qui se diffusent de manière presque inconsciente :
La comparaison rencontre cependant assez vite ses limites, dans la mesure où chez les Épicuriens le salut est dans l’ascèse spécifique menant à la conversion intellectuelle, et chez les chrétiens dans un avenir eschatologique proche pour tous mais où la conversion les a fait entrer eux-mêmes de plain-pied, et dont ils ne cessent de préparer l’apocalypse, par des encouragements mutuels et des renoncements exaltés. Cette circonstance recommande à l’Épicurien toute la disponibilité nécessaire aux activités de loisir, cependant que la mise en commun régulière d’une part des ressources, voire du travail ,orme la base de l’indépendance alimentaire. Paul, qui vante à l’occasion des bienfaits reçus, et lance de grandes collectes de solidarité, refuse au contraire que l’on soit à la charge de ses frères, et demande à chacun de vivre du travail de ses mains, circonstance peu propice à l’étude. On rencontre enfin des exhortations à l’endurance, au combat moral, à la peine et à la souffrance de l’effort athlétique, qui sont impensables en épicurisme et s’apparentent à la morale stoïcienne .
11
C’est sur ces bases que N. W. De Witt avait cru pouvoir dire qu’en plusieurs passages de ses épîtres Paul s’adressait à d’anciens Épicuriens (notamment parmi les Thessaloniciens et les Corinthiens), en utilisant certains mots-clefs de leur propre langage, dont il pervertit subtilement le sens : « paix et salut », « plénitude », « corruption » et « incorruptibilité », ou l’image d’un « chant de victoire » sur la mort désormais privée de son aiguillon, image déjà présente dans la Sentence vaticane 47 ; cependant que les trois notions phares, « foi, espérance et charité », formeraient ensemble un slogan anti-épicurien caractérisé.
Paul devant l’Aréopage d’Athènes
12
Il n’existe pourtant qu’une seule rencontre explicite entre Paul et les Épicuriens, précisément notre chapitre 17 des Actes des Apôtres. C’est, répétons-le, un témoin indirect qui nous rapporte l’épisode, et peut-être l’arrange-t-il à sa manière.
13
Nous sommes au début des années cinquante de l’ère chrétienne. Paul, lors de sa seconde mission, est à Athènes, attendant d’être rejoint par ses compagnons Silas et Timothée. Il prêche dans la synagogue mais aussi sur la place publique, au premier passant venu. Depuis Socrate et Platon, nous savons que les places d’Athènes grouillent de gens qui n’ont rien de mieux à faire que de bavarder avec jactance, en monopolisant l’écoute des jeunes gens désœuvrés . Ces gens s’appellent des philosophes, et justement il y en avait là – des Épicuriens et des Stoïciens, les autres sectes, en-dehors des Cyniques, ne daignant plus enseigner en pleine rue – qui s’intéressèrent à ce concurrent et, au milieu des quolibets, se trouvèrent néanmoins assez curieux de nouveautés pour désirer l’entendre. On remarquera que, dans la comparaison implicite avec Socrate, c’est pourtant Paul qui tient le rôle du philosophe, puisqu’il est supposé, comme dans l’acte d’accusation de Socrate inculpé de croyance en de nouveaux dieux, enseigner « des dieux étrangers », ou « une doctrine nouvelle. ». Ils « mirent la main sur lui » et l’emmenèrent à l’Aréopage pour l’interroger. Le texte est ambigu : Paul est-il traîné en justice ? Les intentions ne paraissent pas hostiles : on lui offre une tribune plutôt qu’on ne lui oppose un tribunal, pour s’y faire entendre plutôt que juger. Et Paul se met à prêcher « debout au milieu » des Aréopagites , en s’adressant pourtant aux représentants du peuple comme le faisait Socrate, les appelant « Messieurs les Athéniens », « Citoyens d’Athènes ». Il commence en les qualifiant d’une expression bien étrange : « Vous êtes en toutes choses un peu trop superstitieux », mais ce n’est pas pour leur en faire reproche, c’est pour les féliciter d’avoir réservé un autel au « dieu inconnu », un scrupule que la prédication de Paul va révéler plein de sens et de prescience, puisqu’il se serait agi en fait du dieu même que Paul est venu annoncer, un dieu créateur, un dieu vivant comme les hommes – et non une sorte d’« empreinte », de moulage en or, en argent, en marbre, « œuvre de l’art ou de la pensée humains ». Là encore l’expression est intéressante. Elle évoque tant une technique de sculpteur, l’incision, l’empreinte ou le moulage, que le signe écrit, la trace, mais aussi toute la réflexion de la philosophie grecque (Platon, Aristote, les Stoïciens, les Épicuriens) sur le procès de la représentation mentale, envisagé comme une empreinte déposée dans l’âme par les perceptions, fussent-elles par ailleurs perceptions intellectives. L’expression associe donc l’objet-image, et la représentation subjective de la divinité, pour les rejeter tous deux, au nom d’un dieu en effet inconnaissable, puisque c’est par « tâtonnement » aveugle seulement qu’on pourrait le trouver, et le trouver non pas éloigné en vérité, mais « tout proche de chacun et bien existant ». Pour un Grec, voilà qui est déjà totalement étrange, cette négation de la connaissance de dieu par la représentation, ce tâtonnement et cette proximité au lieu d’un emplacement fixe (le sanctuaire, l’astre ou l’Idée) dont il serait possible de se rapprocher ou de s’éloigner, par la distance ou par la pensée. Néanmoins il existait l’idée d’un dieu-monde, ou d’un dieu immanent au monde, dans la pensée philosophique au moins depuis Xénophane, et la formule du v. 28, « C’est en lui qu’il nous est donné de vivre, de nous mouvoir, d’exister », pouvait être agréée par les auditeurs Stoïciens. L’Aréopage pouvait également se sentir en terrain connu lorsque Paul évoque ensuite un mythe du premier homme mêlant la tradition grecque et la Genèse juive : ce dieu est installé non dans l’immuabilité d’un éternel présent, comme les « dieux bienheureux qui toujours sont » des poèmes homériques, ou comme le dieu immobile de Parménide, mais simultanément à la source du devenir et dans le devenir, puisque les hommes sont de sa « race » (genos), comme s’il siégeait aussi dans leur corps, dans leur propre capacité d’engendrement. Deux autres traits, compréhensibles pour des philosophes, s’opposent néanmoins à la piété traditionnelle des Athéniens : ce dieu n’a pas besoin des hommes , mais c’est lui qui a fixé l’espace et le temps de la vie des hommes , alors que les dieux grecs doivent traditionnellement être nourris des sacrifices des hommes, et honorés aux dates et aux lieux que les hommes ont découpés pour eux sur leur territoire et dans leur calendrier. Chez les Grecs, hors récits et expériences d’épiphanies divines, les hommes vont aux dieux et leur assignent leur place, avec leur consentement et parfois à leur demande ; ici c’est le Dieu de Paul qui vient aux hommes, lesquels se trouvent pris dans un dessein général, assignés au destin de la création entière. Mais la fin a dû paraître ubuesque aux oreilles de nos Athéniens : maître du temps, mais engagé lui-même dans le temps, ce dieu a « fixé un jour » pour un jugement qu’il confie à un homme désigné, et en guise de preuve et de gage, parce qu’en effet la créance n’allait pas de soi, il a ressuscité cet homme d’entre les morts, inaugurant du même coup le présent
[ltr].[/ltr]
de l’accomplissement, où tous sont appelés à la conversion et au repentir .
14
Le texte contient ainsi un jeu mi-savant, mi-embrouillé, un jeu d’échos et de contrastes avec la tradition grecque, philosophique surtout, mais aussi de pratique cultuelle. Paul y est campé en philosophe plutôt qu’en prophète. Or c’est bien sur le terrain de la philosophie, et non sur celui des croyances, que christianisme et hellénisme se sont affrontés, et nous en voyons ici les premiers symptômes . Pour les Grecs les Juifs n’avaient pu être acceptés jusque-là, dans leurs étranges coutumes, qu’en tant que philosophes renonçants, pratiquant, par leur refus des nourritures communes, une ascèse comparable à celle des pythagoriciens ou des brahmanes de l’Inde. La qualification philosophique de l’action de Paul est confirmée, plus loin dans les Actes, par le refus de Gallion, proconsul d’Achaïe, de connaître des crimes qui sont reprochés à l’apôtre par ses coreligionnaires juifs. Ces derniers accusent Paul d’impiété . Gallion répond que ce n’est qu’une affaire de raisonnement, de mots, et d’une loi interne à la communauté juive, qui ne relèvent pas de sa juridiction. Depuis Socrate, au moins aux yeux d’un administrateur romain, la philosophie paraît avoir gagné le droit de parler des dieux à son aise et d’importer tous les nouveaux dieux qu’il lui plaira, s’agît-il de la déesse « Résurrection ».
15
Notons d’autre part que, dans cette catéchèse adressée aux Athéniens, l’accent n’est pas mis du tout sur une opposition entre le polythéisme grec et le monothéisme judéo-chrétien, ni même entre le multiple et l’un. Paul dit apporter simplement un dieu de plus, un dieu dont la place était comme en attente, sous les espèces d’un autel anonyme, dans le panthéon des Athéniens. Une telle situation n’est d’ailleurs pas du tout nouvelle dans le panthéon grec : Dionysos par exemple est par définition un dieu qui vient de l’étranger, avec des caractères bizarres . La différence se situe ailleurs, dans l’opposition entre des dieux fabriqués et visibles, et un dieu vivant mais invisible, dans l’opposition entre des statues brillantes et un modeste autel ; l’originalité du message de Paul est dans la dimension temporelle d’une révélation, dans l’accès « tâtonnant » à la connaissance du dieu, dans la sommation, qui lui fait suite, à une conversion spirituelle, et dans le brouillage des repères entre la vie, la mort, et l’éternité divine. Encore n’est-ce pas tout cela qui paraît choquer les Athéniens. Ce qui les offusque, c’est surtout la question de la résurrection des morts, dont ils ont d’ailleurs d’abord compris (ou feint de comprendre) le mot comme le nom propre d’une nouvelle divinité féminine. Inversement, ce qui avait choqué Paul, c’est la multiplicité des images plastiques des dieux à travers la cité.
16
Donc, les Athéniens ont rencontré, malgré toute l’étrangeté des paroles de Paul, un philosophe parmi d’autres philosophes, qui n’agit pas en prophète d’un monothéisme, mais plutôt en apôtre d’une vie nouvelle, une vie métamorphosée par la conversion morale et mentale, et – seule véritable anomalie – par le signe bizarre de la résurrection.
17
L’honneur d’être admis à disputer avec ou contre l’Aréopage, ou plus sûrement avec les Épicuriens et les Stoïciens à l’Aréopage, constituait sans doute un des sommets enviés d’une carrière d’intellectuel dans la Grèce des premiers siècles de notre ère. On en a quelques autres exemples. Paul sachant toujours extraordinairement adapter son langage à son public (c’est vrai même pour l’emploi des langues : Paul est Juif pour les Juifs, Grec pour les Grecs, Romain pour les Romains), il a choisi ici un langage de philosophe. Non pas seulement par ruse et par calcul : si cette histoire est vraie, et non simplement une vignette ajoutée à une légende, Paul se livre sans doute de bonne foi à un exercice de persuasion qui a pu être pour lui, quoi qu’en dise le narrateur de la scène, de la plus haute importance, car il s’adresse à ceux qu’on tenait de son temps pour l’élite des citoyens et des penseurs d’Athènes, voire de tout le monde grec. À travers les paroles de l’apôtre, le Christ devra en quelque sorte pouvoir s’imposer aussi sur ce terrain–là, il devra revêtir les habits de son temps, et se laisser lire dans des mots qui ne sont pas son langage naturel. Des consonances étonnantes, non certes de doctrine, mais de langage, apparaissent, de ce fait, même avec la philosophieépicurienne.. Quel que soit son mépris pour l’incurie bavarde des Athéniens, la chance d’accéder à la tribune de l’Aréopage constitue pour Paul un défi à relever.
Paul et les Épicuriens d’Athènes
18
Parmi les modèles théologiques qui sont à l’arrière-plan du discours de Paul, il convient en effet de ne pas oublier la doctrine épicurienne. Pourquoi accorder ici un privilège à la philosophie épicurienne, et non pas plutôt aux Cyniques, à l’Académie ou au Portique, que chacun cite d’ordinaire abondamment en rapport avec les lettres pauliniennes ? Et cela malgré l’athéisme si souvent reproché aux Épicuriens ? – Paul sans doute les connaissait de près, et il y avait de bonnes raisons à cela.
19
Tarse où Paul grandit était, selon l’opinion de Strabon, une cité de haute culture . Des philosophes de tendances opposées la gouvernèrent alternativement. La douceur de son climat et l’indolence de ses mœurs étaient également célèbres. Paul, qui s’enorgueillit du titre de citoyen romain , devait appartenir à une riche famille juive bien implantée, et il avait sûrement bénéficié de la meilleure éducation, laquelle ne pouvait guère être différente du modèle grec : les archéologues ont même exhumé, lors les fouilles de Sardes en Lydie, un gymnase, assorti de bains, auquel était intégrée une synagogue ! Or, l’environnement syrien et anatolien était le lieu d’une forte implantation épicurienne, dont nous possédons de nombreuses attestations, jusqu’au second et peut-être au troisième siècle de notre ère . Et l’épicurisme avait ceci de particulier, qu’il était répandu, en forme de minorité agissante, dans toutes les couches de la société, et pas seulement dans des cercles intellectuels.
20
Paul n’a donc pas dû avoir trop de mal à se mettre au niveau des Athéniens philosophes, et il a pu retrouver sans peine le ton familier à ce milieu, mêlant les jargons de diverses écoles, veillant à ne pas tomber dans le ridicule devant son auditoire : rien n’aurait dû l’empêcher de recevoir même des honneurs de la part de l’illustre Aréopage. Une comparaison s’impose ici avec une inscription grecque postérieure d’au moins un demi-siècle au passage de Paul à Athènes. Cette inscription provient de la cité de Rhodiapolis, sur la côte sud de l’Anatolie . Le texte date sans doute du règne de Trajan (98-117). Voilà un certain Héraclite, personnage bien extraordinaire. Il s’est fait remarquer par un assemblage unique de talents poétiques et philosophiques, et par son évergétisme, qui lui valurent, outre les éloges de sa patrie, les honneurs des plus grandes cités de la Grèce des lettres, Alexandrie, Rhodes et Athènes. Or à Athènes, il a été félicité, et il s’en vante, à la fois par les philosophes épicuriens et par l’Aréopage. L’Aréopage était un tribunal prestigieux à la fois par son antiquité et par sa composition : y entraient les anciens archontes, chefs annuels de la politique athénienne. Nous savons par exemple qu’un certain Lysiadès, fils de Phèdre l’Épicurien, et sûrement Épicurien lui-même, avait été archonte et par conséquent aréopagite en 50 av. J.-C. Il n’y a pas de raisons que d’autres Épicuriens ne l’aient pas rejoint dans cette position, au fil des ans. Mais sans doute y eut-il tout autant de Stoïciens dans la place, puisque nous connaissons aussi, par le témoignage de Plutarque et par un décret honorifique de l’Aréopage, un philosophe stoïcien, cette fois, nommé Sarapion, qui aurait eu des talents tout semblables à ceux d’Héraclite : sur des sujets philosophiques et sérieux il aurait composé des poèmes dont l’art faisait penser à Homère et à Hésiode plutôt, dit le texte, qu’aux « proférations de la Pythie». On ne sait lequel, d’Héraclite ou de Sarapion, voulut rivaliser avec l’autre, si c’est l’Épicurien ou le Stoïcien qui eut le premier l’honneur d’un décret de l’Aréopage, mais la comparaison de l’art savant de Sarapion avec l’emphase oraculaire suggère une critique d’un prédécesseur – pourquoi pas notre Héraclite épicurien ? Une comparaison d’Épicure avec un prophète apparaît justement chez Lucrèce, qui adopte lui-même un ton inspiré. Notons qu’il est possible que les honneurs accordés par l’Aréopage au poète épicurien Héraclite aient été encouragés par l’influence d’une grande dame épicurienne de son temps, l’impératrice Plotine, épouse de Trajan.
21Nous ne sommes pas encore, avec Paul, au temps de Plotine, mais l’Aréopage a pu être dès son temps investi par des Épicuriens plus ou moins nombreux, car certains éléments du discours de l’apôtre paraissent orientés vers des oreilles épicuriennes. Énumérons les traits qui permettent d’avancer cette thèse.
22
Lorsque Paul reproche aux Aréopagites d’être « un peu trop superstitieux », il emploie un terme qui veut dire « craignant les dieux », et qui peut renvoyer aussi bien au scrupule religieux qu’à la superstition ; or la grande voie du salut épicurien consiste justement à enseigner à ne plus craindre les dieux. Si ce sont des Épicuriens que Paul a en face de lui, l’expression se charge de sens, à la fois flatteuse dans le ton et cinglante sur le fond. Mais par ailleurs les Épicuriens pratiquaient précisément une telle forme mixte de blâme et d’éloge, comme on le voit faire par Épicure lui-même lorsque dans une lettre il vante un geste d’enthousiasme d’un disciple en le qualifiant pourtant de contraire à la doctrine physique. L’expression par laquelle Paul, ensuite, rejette les idoles moulées ou imprimées dans l’âme, peut être une allusion à la doctrine épicurienne de la perception mentale des images divines , soutenue par l’omniprésence de leurs représentations dans la statuaire religieuse. Au lieu de cette pure représentation visuelle et intellective, Paul suggère un autre accès au divin, et cet accès est justement celui qui passe par le sens roi selon les Épicuriens, celui auquel toute connaissance se ramène en dernier ressort : à savoir le toucher, un « tâtonnement » aveugle. De même, c’est par contraste avec la doctrine épicurienne de dieux sans rapport avec les hommes, éloignés dans les intermondes, que prend tout son sens l’indication de la proximité du dieu des chrétiens, cependant que la plénitude de ce dieu chrétien, et son caractère vivant rejoignent, cette fois, l’autarcie et la vie des dieux d’Épicure (la négation du besoin d’autrui, prosdeêsis, se rencontre chez Épicure dans le contexte des dieux ). L’insistance sur la résurrection des morts contredit directement la maxime épicurienne selon laquelle la mort est une fin qui ne nous concerne plus : à la dissolution des liens du corps, agrégat matériel (sustasis) du langage épicurien, le chrétien oppose la recomposition physique du corps après la mort (anastasis). Enfin l’idée d’avoir à changer de mentalité, l’idée d’une conversion (metanoein), est, sous un autre nom (epi-spasmos : l’idée d’une attraction irrésistible vers l’image mentale des dieux dès lors qu’ils sont postulés anthropomorphes) au cœur de la doctrine et sans doute, nous avons pour notre part essayé de le montrer ailleurs, au cœur d’une certaine pratique épicurienne.
23
Il y a lieu de comparer le « parler en langues » des chrétiens envahis par l’esprit saint au cours de leurs réunions, comme les pentecôtistes d’aujourd’hui, et le climat qui devait régner aux réunions festives des Épicuriens
[*]
[ltr]https://www.cairn.info/revue-diogene-2004-1-page-52.htm#no24[/ltr]
, si on le rapporte à la doctrine de l’expression spontanée de la voix de la nature qui serait à l’origine du langage et à laquelle une parole vraie se conforme nécessairement .
[ltr]https://www.cairn.info/revue-diogene-2004-1-page-52.htm#no25[/ltr]
24
Pourquoi serait-ce en des termes parlants pour des Épicuriens que Paul s’est exprimé devant l’Aréopage ? Outre la présence probable, suggérée par le contexte et par les inscriptions que nous citions, d’Épicuriens dans ce Conseil vénérable, la philosophie du Jardin devait être (avec celle, caricaturée et caricaturale, des Cyniques, mais aussi en des formes de syncrétisme à l’œuvre dans la morale stoïcienne qui s’écrit à la même époque avec Sénèque et bientôt avec Musonius Rufus ou Épictète), la doctrine que tout le monde avait le plus de chances de connaître, parce que, comme nous l’avons suggéré, c’était la plus répandue, et aussi la plus facile à approcher, notamment en Syrie où elle s’était implantée dès le troisième siècle av. J.- C. : Paul avait précisément longuement séjourné à Antioche en Syrie. L’épicurisme avait sans doute acquis une image à la fois académique et accessible néanmoins à un public moyen : on se sentait d’autant mieux honoré de pouvoir approcher ces intellectuels-là, qu’on était flatté de réussir à les comprendre, malgré la barrière, assez facile à lever, de leur jargon d’école. Mais Paul, lui, les connaît même trop bien : il est capable de jouer de leurs références, de les tourner à son profit, à la gloire de sa doctrine. Peut-être en a-t-il déjà converti beaucoup, en Syrie comme ailleurs.
25
Dans ces réunions, le partage de la nourriture, la circulation du vin, ont une importance dont la portée symbolique est évidemment très différente d’une secte à l’autre.
La comparaison rencontre cependant assez vite ses limites, dans la mesure où chez les Épicuriens le salut est dans l’ascèse spécifique menant à la conversion intellectuelle, et chez les chrétiens dans un avenir eschatologique proche pour tous mais où la conversion les a fait entrer eux-mêmes de plain-pied, et dont ils ne cessent de préparer l’apocalypse, par des encouragements mutuels et des renoncements exaltés. Cette circonstance recommande à l’Épicurien toute la disponibilité nécessaire aux activités de loisir, cependant que la mise en commun régulière d’une part des ressources, voire du travail .
[ltr]https://www.cairn.info/revue-diogene-2004-1-page-52.htm#no27[/ltr]
26
On comprend, dans ce cas, en quoi Paul a échoué devant l’Aréopage : il n’a pas remporté la couronne ni les honneurs qui furent plus tard décernés à un Héraclite de Rhodiapolis ou à un Sarapion. Il a dû renoncer à se battre sur le terrain des valeurs intellectuelles du monde grec, où d’autres juifs, comme Philon d’Alexandrie, avaient tenté de s’illustrer. À Corinthe, sa prochaine étape, il se résolut à travailler de ses mains pour vivre : la rupture intellectuelle entraînait de facto une rupture sociale, bien plus profonde que la retraite lettrée ou semi-lettrée du Jardin.
27
Ce que nous montre cet exemple, c’est qu’il n’existe pas, à l’époque de la rédaction des Actes, d’opposition massive entre athéisme, polythéisme, monothéisme. Nous voyons ici au travail un essai d’auto-définition religieuse en fonction de l’environnement où le sujet se place. La doctrine naît d’interactions constantes et s’alimente de ce qu’elle nie.
Renée Koch Piettr
1
L’épisode néotestamentaire de la rencontre de Paul et des philosophes épicuriens et stoïciens d’Athènes, au chapitre 17 des Actes des Apôtres (v. 16-24), éclaire les relations entre les commencements du christianisme et son environnement intellectuel et religieux dans l’empire romain. L’apôtre Paul y est en effet conduit à expliquer son message en des termes qu’il essaye de rendre compréhensibles à un public d’Athéniens cultivés, en fonction de ce que lui-même croit connaître de ce public. C’est du moins ainsi que Luc, le rédacteur des Actes, tâche de rendre compte de l’épisode, auquel apparemment il n’avait pas assisté
2
Or, cet épisode offre simultanément l’occasion de s’interroger sur les rapports paradoxaux qu’on peut soupçonner entre l’épicurisme et la pratique missionnaire de Paul, ou plus largement entre l’épicurisme et le christianisme naissant. La recherche là-dessus a déjà une assez longue histoire, mais n’a sans doute pas encore trouvé ses marques, ni le ton juste, ni sa conclusion Une sorte de préjugé chrétien paraît y être la règle. Ceux qui s’y risquent rencontrent généralement tout aussitôt deux sortes de réactions indignées :
3
– Du côté de ceux qui abordent l’épicurisme dans la tradition d’un humanisme libertin et d’une philosophie matérialiste, on se récrie : comment peut-on introduire dans la genèse du christianisme ces pères de l’atomisme et d’un hédonisme matérialiste, ces libérateurs de l’humanité, voire ces ancêtres du marxisme dialectique, que furent Épicure ou Lucrèce ? Toutes les religions ne sont-elles pas un « opium du peuple » ?
4
– Du côté des historiens et des théologiens du christianisme, même scandale : comment peut-on oser déceler même un voisinage, encore moins un cousinage contre nature, entre deux doctrines aussi opposées que cet athéisme que l’on reproche couramment à Épicure et aux siens , et la foi chrétienne ? Paul a d’ailleurs mis ses disciples en garde contre la philosophie, ainsi en Col. 2.8 : « Veillez à ce que nul ne mette le grappin sur vous par le moyen de la philosophie, cette creuse duperie qui suit la tradition des hommes, les éléments de l’univers ,et non plus le Christ ».
Épicurisme et christianisme : les raisons d’une comparaison
5
Il y a néanmoins pour les hellénistes de bonnes raisons de conduire une telle exploration, fût-ce, à terme, pour en déjouer l’hypothèse. En voici quelques-unes :
6
Il est arrivé que les Anciens mettent l’épicurisme et le christianisme dans le même sac et les tiennent tous deux pour également abominables et impies, athées : on cite couramment, à ce sujet, un passage d’un opuscule de Lucien de Samosate, Alexandre le faux prophète : cet Alexandre se donna dans la seconde moitié du IIe siècle de notre ère pour le prophète d’un nouveau dieu, le serpent Glycon, enfant du dieu guérisseur Asclépios. Il établit les mystères de ce dieu dans la cité d’Abonotique, sur l’actuelle rive turque de la mer Noire. Or la liturgie de ces mystères commençait par le solennel bannissement des impies, Alexandre lançant un « Dehors, les Chrétiens ! » et la foule en chœur enchaînant par ce répons : « Dehors, les Épicuriens »
7
Ces deux doctrines de salut (en cette vie ou en une autre vie) remontent à un fondateur charismatique dont elles entretiennent la mémoire et le culte. Épicure était salué par ses adeptes comme un dieu sauveur (sôtêr), ce qui n’a d’ailleurs rien de très original durant la période hellénistique, où des rois en particulier purent être pareillement salués (mais notons que le roi séleucide Démétrios Ier Sôter était lui-même un fervent adepte de l’épicurisme ). Elles enseignent notamment, mais diversement, à ne pas craindre la mort .
8
Les Épicuriens, qui paraissent avoir réussi une remarquable intégration dans les sociétés hellénistique et romaine, entretinrent néanmoins dès le début une controverse très vive avec les autres écoles philosophiques, notamment l’école stoïcienne ; ils se rendirent à l’occasion coupables de diverses manœuvres politiques obscures , et furent sporadiquement l’objet d’un rejet et d’un mépris dont l’ampleur est difficile à mesurer, de campagnes de calomnies, notamment (ce n’est pas nouveau) quant à leurs mœurs sexuelles, – et même, pour finir, d’une véritable chasse aux sorcières, avec destruction de leurs écrits, à peu près à l’époque même de la persécution des chrétiens . La différence, c’est que les Épicuriens disparurent quasiment, cependant que le christianisme s’imposait comme la religion dominante dans l’empire romain. Renvoyons au discours de Cicéron Contre Pison, aux pamphlets anti-épicuriens de Plutarque, aux autodafés des écrits épicuriens organisés et encouragés par Alexandre d’Abonotique selon l’opuscule précédemment cité, à quelques anecdotes scandaleuses contées dans Athénée et dans Élien, ce qui nous mène jusqu’à la première moitié du troisième siècle. Mais déjà, les chrétiens eux-mêmes ont pris la relève dans la critique anti-épicurienne (Origène, Lactance), cependant que des connexions troublantes apparaissent pourtant entre les deux courants, par exemple chez un Minucius Félix, qui, originaire d’Afrique, tente de concilier la nouvelle foi avec la tradition philosophique, vers le second ou le troisième siècle. En l’an 367 l’empereur Julien l’Apostat se réjouit de ce que les dieux aient presque anéanti les ouvrages d’Épicure : mais Augustin, né en 354, déclare avoir été, dans sa jeunesse, tenté par la doctrine d’Épicure.
9
On décèle des ressemblances entre l’organisation et le fonctionnement de ces deux sectes (j’emploie le mot secte dans le sens que les Grecs donnaient au mot hairesis, qui a donné hérésie : un choix de doctrine, qui chez les Anciens qualifiait, à partir de l’époque hellénistique, les options philosophiques présentes, en quelque sorte, sur le marché, options qui comportaient toutes une théologie et un mode de vie dont les spécificités allaient jusqu’à régenter l’activité politique, l’habillement et l’alimentation . Par exemple, le recours de Paul à la correspondance épistolaire, tant pour l’élaboration et pour la diffusion de la doctrine que pour la direction spirituelle de communautés nombreuses dispersées dans le monde gréco-romain, n’est pas sans ressemblance avec le réseau de communautés épicuriennes qui restait sans doute très actif à son époque, et fonctionnait par circulation interne d’hommes, de libelles et de lettres, constituant par ailleurs un véritable réseau d’influences présent jusque dans les cercles les plus élevés du pouvoir. La grande vitalité de ce réseau nous est bien connue depuis le vivant d’Épicure jusqu’à notre Alexandre de Lucien : notamment par les textes, toujours en voie de déchiffrement, des papyri de la bibliothèque d’Herculanum, dont le fonds originel appartint à l’Épicurien Philodème, et ceux du portique de l’Épicurien Diogène d’Œnoanda, véritable bibliothèque sur pierre, sur le continent turc à peu près à la hauteur de Rhodes. Le réseau s’auto-finançait par les contributions de ses membres. Pour la diffusion du réseau épicurien, nos informations permettent de tracer un grand fuseau qui va de l’Égypte à la Gaule (on a trouvé une mosaïque épicurienne du iie s. en France, à Autun), en passant par la Syrie, la Mer Noire, la Macédoine, la plaine du Pô pour l’arc Nord d’une part ; Chypre et Rhodes, le Péloponnèse, la Campanie d’autre part pour l’arc Sud du fuseau, la présence en Afrique du Nord restant, pour autant que je sache, incertaine, et dans la péninsule ibérique, sans nul indice.
10
Parmi ces ressemblances, j’en retiendrai trois qui touchent au climat même des communautés, aux comportements et à l’ambiance affective – ce sont des choses qui ne s’inventent pas, et qui se diffusent de manière presque inconsciente :
- l’agapê chrétienne n’est pas sans rappeler la philia épicurienne, qui régit les relations entre les membres de la secte, et il est même significatif que Paul n’emploie pas ce dernier terme, comme pour marquer sa différence et désigner la communauté chrétienne comme une famille nouvelle, régie par une parenté spirituelle. Il s’agit néanmoins dans les deux cas d’une relation de confiance et d’affection mutuelles qui impliquent la solidarité interne et l’abolition de toutes les hiérarchies sociales externes : pour ce qui concerne les Épicuriens, rois, femmes, esclaves, tout en restant rois, femmes, esclaves, n’en seront pas moins traités, dans les réunions de la secte, avec les égards nécessaires pour ménager les susceptibilités, à égalité avec les autres membres. Il ne s’agit sans doute pas d’une contestation de l’ordre social établi. Mais, un peu comme, à l’intérieur d’une maisonnée, la femme ou l’esclave aussi peuvent jouir d’une confiance et d’une autorité incontestées, nos deux sectes fonctionnent à la manière d’un espace privé. Les différences toutefois demeurent importantes : pour Paul la femme reste soumise à l’homme, même dans l’espace communautaire (quelle que soit par ailleurs la place éminente des femmes parmi ses coreligionnaires), alors que les femmes du temps d’Épicure peuvent même diriger la communauté en son absence ; d’autre part, Paul évoque ou met en œuvre de véritables procès internes, une sorte de gouvernement interne, ainsi qu’une réglementation morale , dont nous n’avons pas d’exemple pour les Épicuriens. Une autre différence, c’est qu’en épicurisme un lien d’amitié privilégié lie le maître à l’élève et est exalté jusqu’à un véritable culte , mais sans la moindre idée de subordination. Au contraire, Paul, qui se dit « serviteur du Christ » agit en chef et en censeur, même quand il témoigne aussi la tendresse d’un grand frère.
- La coexistence des hiérarchies sociales externes et de l’égalité interne est commune aux deux sectes ; mais elle pose aux Épicuriens un certain nombre de problèmes diplomatiques : il faudra quand même tenir compte des susceptibilités de chacun ! D’où la nécessité d’adapter les relations et le langage en fonction des interlocuteurs, même dans l’espace interne. De cela nous avons une bonne connaissance grâce à un traité de Philodème sur la franchise ou liberté de parole (la parrhêsia), dont le principe réglait les relations internes mais exigeait en même temps toute une casuistique : pour affermir la foi dans la doctrine il convenait d’entretenir des relations de franchise entre les membres, qui devaient servir les uns aux autres de confesseurs et s’ouvrir du moindre doute, s’alarmer de la moindre déviance, au besoin en avertissant la communauté entière. Cependant on a des cas d’exclusion pour les Chrétiens, on a même l’idée qu’il faut savoir couper les branches pour assainir l’arbre, alors qu’on n’a qu’un tout petit nombre de cas de transfuges chez les Épicuriens .
- Il y a lieu de comparer le « parler en langues » des chrétiens envahis par l’esprit saint au cours de leurs réunions, comme les pentecôtistes d’aujourd’hui, et le climat qui devait régner aux réunions festives des Épicuriens, si on le rapporte à la doctrine de l’expression spontanée de la voix de la nature qui serait à l’origine du langage et à laquelle une parole vraie se conforme nécessairement,Paul dit que de l’extérieur les réunions des fidèles possédés par l’esprit saint faisaient plutôt mauvais effet, et paraissaient une espèce d’orgie ou de pandémonium. Dans ces réunions, le partage de la nourriture, la circulation du vin, ont une importance dont la portée symbolique est évidemment très différente d’une secte à l’autre.
La comparaison rencontre cependant assez vite ses limites, dans la mesure où chez les Épicuriens le salut est dans l’ascèse spécifique menant à la conversion intellectuelle, et chez les chrétiens dans un avenir eschatologique proche pour tous mais où la conversion les a fait entrer eux-mêmes de plain-pied, et dont ils ne cessent de préparer l’apocalypse, par des encouragements mutuels et des renoncements exaltés. Cette circonstance recommande à l’Épicurien toute la disponibilité nécessaire aux activités de loisir, cependant que la mise en commun régulière d’une part des ressources, voire du travail ,orme la base de l’indépendance alimentaire. Paul, qui vante à l’occasion des bienfaits reçus, et lance de grandes collectes de solidarité, refuse au contraire que l’on soit à la charge de ses frères, et demande à chacun de vivre du travail de ses mains, circonstance peu propice à l’étude. On rencontre enfin des exhortations à l’endurance, au combat moral, à la peine et à la souffrance de l’effort athlétique, qui sont impensables en épicurisme et s’apparentent à la morale stoïcienne .
11
C’est sur ces bases que N. W. De Witt avait cru pouvoir dire qu’en plusieurs passages de ses épîtres Paul s’adressait à d’anciens Épicuriens (notamment parmi les Thessaloniciens et les Corinthiens), en utilisant certains mots-clefs de leur propre langage, dont il pervertit subtilement le sens : « paix et salut », « plénitude », « corruption » et « incorruptibilité », ou l’image d’un « chant de victoire » sur la mort désormais privée de son aiguillon, image déjà présente dans la Sentence vaticane 47 ; cependant que les trois notions phares, « foi, espérance et charité », formeraient ensemble un slogan anti-épicurien caractérisé.
Paul devant l’Aréopage d’Athènes
12
Il n’existe pourtant qu’une seule rencontre explicite entre Paul et les Épicuriens, précisément notre chapitre 17 des Actes des Apôtres. C’est, répétons-le, un témoin indirect qui nous rapporte l’épisode, et peut-être l’arrange-t-il à sa manière.
13
Nous sommes au début des années cinquante de l’ère chrétienne. Paul, lors de sa seconde mission, est à Athènes, attendant d’être rejoint par ses compagnons Silas et Timothée. Il prêche dans la synagogue mais aussi sur la place publique, au premier passant venu. Depuis Socrate et Platon, nous savons que les places d’Athènes grouillent de gens qui n’ont rien de mieux à faire que de bavarder avec jactance, en monopolisant l’écoute des jeunes gens désœuvrés . Ces gens s’appellent des philosophes, et justement il y en avait là – des Épicuriens et des Stoïciens, les autres sectes, en-dehors des Cyniques, ne daignant plus enseigner en pleine rue – qui s’intéressèrent à ce concurrent et, au milieu des quolibets, se trouvèrent néanmoins assez curieux de nouveautés pour désirer l’entendre. On remarquera que, dans la comparaison implicite avec Socrate, c’est pourtant Paul qui tient le rôle du philosophe, puisqu’il est supposé, comme dans l’acte d’accusation de Socrate inculpé de croyance en de nouveaux dieux, enseigner « des dieux étrangers », ou « une doctrine nouvelle. ». Ils « mirent la main sur lui » et l’emmenèrent à l’Aréopage pour l’interroger. Le texte est ambigu : Paul est-il traîné en justice ? Les intentions ne paraissent pas hostiles : on lui offre une tribune plutôt qu’on ne lui oppose un tribunal, pour s’y faire entendre plutôt que juger. Et Paul se met à prêcher « debout au milieu » des Aréopagites , en s’adressant pourtant aux représentants du peuple comme le faisait Socrate, les appelant « Messieurs les Athéniens », « Citoyens d’Athènes ». Il commence en les qualifiant d’une expression bien étrange : « Vous êtes en toutes choses un peu trop superstitieux », mais ce n’est pas pour leur en faire reproche, c’est pour les féliciter d’avoir réservé un autel au « dieu inconnu », un scrupule que la prédication de Paul va révéler plein de sens et de prescience, puisqu’il se serait agi en fait du dieu même que Paul est venu annoncer, un dieu créateur, un dieu vivant comme les hommes – et non une sorte d’« empreinte », de moulage en or, en argent, en marbre, « œuvre de l’art ou de la pensée humains ». Là encore l’expression est intéressante. Elle évoque tant une technique de sculpteur, l’incision, l’empreinte ou le moulage, que le signe écrit, la trace, mais aussi toute la réflexion de la philosophie grecque (Platon, Aristote, les Stoïciens, les Épicuriens) sur le procès de la représentation mentale, envisagé comme une empreinte déposée dans l’âme par les perceptions, fussent-elles par ailleurs perceptions intellectives. L’expression associe donc l’objet-image, et la représentation subjective de la divinité, pour les rejeter tous deux, au nom d’un dieu en effet inconnaissable, puisque c’est par « tâtonnement » aveugle seulement qu’on pourrait le trouver, et le trouver non pas éloigné en vérité, mais « tout proche de chacun et bien existant ». Pour un Grec, voilà qui est déjà totalement étrange, cette négation de la connaissance de dieu par la représentation, ce tâtonnement et cette proximité au lieu d’un emplacement fixe (le sanctuaire, l’astre ou l’Idée) dont il serait possible de se rapprocher ou de s’éloigner, par la distance ou par la pensée. Néanmoins il existait l’idée d’un dieu-monde, ou d’un dieu immanent au monde, dans la pensée philosophique au moins depuis Xénophane, et la formule du v. 28, « C’est en lui qu’il nous est donné de vivre, de nous mouvoir, d’exister », pouvait être agréée par les auditeurs Stoïciens. L’Aréopage pouvait également se sentir en terrain connu lorsque Paul évoque ensuite un mythe du premier homme mêlant la tradition grecque et la Genèse juive : ce dieu est installé non dans l’immuabilité d’un éternel présent, comme les « dieux bienheureux qui toujours sont » des poèmes homériques, ou comme le dieu immobile de Parménide, mais simultanément à la source du devenir et dans le devenir, puisque les hommes sont de sa « race » (genos), comme s’il siégeait aussi dans leur corps, dans leur propre capacité d’engendrement. Deux autres traits, compréhensibles pour des philosophes, s’opposent néanmoins à la piété traditionnelle des Athéniens : ce dieu n’a pas besoin des hommes , mais c’est lui qui a fixé l’espace et le temps de la vie des hommes , alors que les dieux grecs doivent traditionnellement être nourris des sacrifices des hommes, et honorés aux dates et aux lieux que les hommes ont découpés pour eux sur leur territoire et dans leur calendrier. Chez les Grecs, hors récits et expériences d’épiphanies divines, les hommes vont aux dieux et leur assignent leur place, avec leur consentement et parfois à leur demande ; ici c’est le Dieu de Paul qui vient aux hommes, lesquels se trouvent pris dans un dessein général, assignés au destin de la création entière. Mais la fin a dû paraître ubuesque aux oreilles de nos Athéniens : maître du temps, mais engagé lui-même dans le temps, ce dieu a « fixé un jour » pour un jugement qu’il confie à un homme désigné, et en guise de preuve et de gage, parce qu’en effet la créance n’allait pas de soi, il a ressuscité cet homme d’entre les morts, inaugurant du même coup le présent
[ltr].[/ltr]
de l’accomplissement, où tous sont appelés à la conversion et au repentir .
14
Le texte contient ainsi un jeu mi-savant, mi-embrouillé, un jeu d’échos et de contrastes avec la tradition grecque, philosophique surtout, mais aussi de pratique cultuelle. Paul y est campé en philosophe plutôt qu’en prophète. Or c’est bien sur le terrain de la philosophie, et non sur celui des croyances, que christianisme et hellénisme se sont affrontés, et nous en voyons ici les premiers symptômes . Pour les Grecs les Juifs n’avaient pu être acceptés jusque-là, dans leurs étranges coutumes, qu’en tant que philosophes renonçants, pratiquant, par leur refus des nourritures communes, une ascèse comparable à celle des pythagoriciens ou des brahmanes de l’Inde. La qualification philosophique de l’action de Paul est confirmée, plus loin dans les Actes, par le refus de Gallion, proconsul d’Achaïe, de connaître des crimes qui sont reprochés à l’apôtre par ses coreligionnaires juifs. Ces derniers accusent Paul d’impiété . Gallion répond que ce n’est qu’une affaire de raisonnement, de mots, et d’une loi interne à la communauté juive, qui ne relèvent pas de sa juridiction. Depuis Socrate, au moins aux yeux d’un administrateur romain, la philosophie paraît avoir gagné le droit de parler des dieux à son aise et d’importer tous les nouveaux dieux qu’il lui plaira, s’agît-il de la déesse « Résurrection ».
15
Notons d’autre part que, dans cette catéchèse adressée aux Athéniens, l’accent n’est pas mis du tout sur une opposition entre le polythéisme grec et le monothéisme judéo-chrétien, ni même entre le multiple et l’un. Paul dit apporter simplement un dieu de plus, un dieu dont la place était comme en attente, sous les espèces d’un autel anonyme, dans le panthéon des Athéniens. Une telle situation n’est d’ailleurs pas du tout nouvelle dans le panthéon grec : Dionysos par exemple est par définition un dieu qui vient de l’étranger, avec des caractères bizarres . La différence se situe ailleurs, dans l’opposition entre des dieux fabriqués et visibles, et un dieu vivant mais invisible, dans l’opposition entre des statues brillantes et un modeste autel ; l’originalité du message de Paul est dans la dimension temporelle d’une révélation, dans l’accès « tâtonnant » à la connaissance du dieu, dans la sommation, qui lui fait suite, à une conversion spirituelle, et dans le brouillage des repères entre la vie, la mort, et l’éternité divine. Encore n’est-ce pas tout cela qui paraît choquer les Athéniens. Ce qui les offusque, c’est surtout la question de la résurrection des morts, dont ils ont d’ailleurs d’abord compris (ou feint de comprendre) le mot comme le nom propre d’une nouvelle divinité féminine. Inversement, ce qui avait choqué Paul, c’est la multiplicité des images plastiques des dieux à travers la cité.
16
Donc, les Athéniens ont rencontré, malgré toute l’étrangeté des paroles de Paul, un philosophe parmi d’autres philosophes, qui n’agit pas en prophète d’un monothéisme, mais plutôt en apôtre d’une vie nouvelle, une vie métamorphosée par la conversion morale et mentale, et – seule véritable anomalie – par le signe bizarre de la résurrection.
17
L’honneur d’être admis à disputer avec ou contre l’Aréopage, ou plus sûrement avec les Épicuriens et les Stoïciens à l’Aréopage, constituait sans doute un des sommets enviés d’une carrière d’intellectuel dans la Grèce des premiers siècles de notre ère. On en a quelques autres exemples. Paul sachant toujours extraordinairement adapter son langage à son public (c’est vrai même pour l’emploi des langues : Paul est Juif pour les Juifs, Grec pour les Grecs, Romain pour les Romains), il a choisi ici un langage de philosophe. Non pas seulement par ruse et par calcul : si cette histoire est vraie, et non simplement une vignette ajoutée à une légende, Paul se livre sans doute de bonne foi à un exercice de persuasion qui a pu être pour lui, quoi qu’en dise le narrateur de la scène, de la plus haute importance, car il s’adresse à ceux qu’on tenait de son temps pour l’élite des citoyens et des penseurs d’Athènes, voire de tout le monde grec. À travers les paroles de l’apôtre, le Christ devra en quelque sorte pouvoir s’imposer aussi sur ce terrain–là, il devra revêtir les habits de son temps, et se laisser lire dans des mots qui ne sont pas son langage naturel. Des consonances étonnantes, non certes de doctrine, mais de langage, apparaissent, de ce fait, même avec la philosophieépicurienne.. Quel que soit son mépris pour l’incurie bavarde des Athéniens, la chance d’accéder à la tribune de l’Aréopage constitue pour Paul un défi à relever.
Paul et les Épicuriens d’Athènes
18
Parmi les modèles théologiques qui sont à l’arrière-plan du discours de Paul, il convient en effet de ne pas oublier la doctrine épicurienne. Pourquoi accorder ici un privilège à la philosophie épicurienne, et non pas plutôt aux Cyniques, à l’Académie ou au Portique, que chacun cite d’ordinaire abondamment en rapport avec les lettres pauliniennes ? Et cela malgré l’athéisme si souvent reproché aux Épicuriens ? – Paul sans doute les connaissait de près, et il y avait de bonnes raisons à cela.
19
Tarse où Paul grandit était, selon l’opinion de Strabon, une cité de haute culture . Des philosophes de tendances opposées la gouvernèrent alternativement. La douceur de son climat et l’indolence de ses mœurs étaient également célèbres. Paul, qui s’enorgueillit du titre de citoyen romain , devait appartenir à une riche famille juive bien implantée, et il avait sûrement bénéficié de la meilleure éducation, laquelle ne pouvait guère être différente du modèle grec : les archéologues ont même exhumé, lors les fouilles de Sardes en Lydie, un gymnase, assorti de bains, auquel était intégrée une synagogue ! Or, l’environnement syrien et anatolien était le lieu d’une forte implantation épicurienne, dont nous possédons de nombreuses attestations, jusqu’au second et peut-être au troisième siècle de notre ère . Et l’épicurisme avait ceci de particulier, qu’il était répandu, en forme de minorité agissante, dans toutes les couches de la société, et pas seulement dans des cercles intellectuels.
20
Paul n’a donc pas dû avoir trop de mal à se mettre au niveau des Athéniens philosophes, et il a pu retrouver sans peine le ton familier à ce milieu, mêlant les jargons de diverses écoles, veillant à ne pas tomber dans le ridicule devant son auditoire : rien n’aurait dû l’empêcher de recevoir même des honneurs de la part de l’illustre Aréopage. Une comparaison s’impose ici avec une inscription grecque postérieure d’au moins un demi-siècle au passage de Paul à Athènes. Cette inscription provient de la cité de Rhodiapolis, sur la côte sud de l’Anatolie . Le texte date sans doute du règne de Trajan (98-117). Voilà un certain Héraclite, personnage bien extraordinaire. Il s’est fait remarquer par un assemblage unique de talents poétiques et philosophiques, et par son évergétisme, qui lui valurent, outre les éloges de sa patrie, les honneurs des plus grandes cités de la Grèce des lettres, Alexandrie, Rhodes et Athènes. Or à Athènes, il a été félicité, et il s’en vante, à la fois par les philosophes épicuriens et par l’Aréopage. L’Aréopage était un tribunal prestigieux à la fois par son antiquité et par sa composition : y entraient les anciens archontes, chefs annuels de la politique athénienne. Nous savons par exemple qu’un certain Lysiadès, fils de Phèdre l’Épicurien, et sûrement Épicurien lui-même, avait été archonte et par conséquent aréopagite en 50 av. J.-C. Il n’y a pas de raisons que d’autres Épicuriens ne l’aient pas rejoint dans cette position, au fil des ans. Mais sans doute y eut-il tout autant de Stoïciens dans la place, puisque nous connaissons aussi, par le témoignage de Plutarque et par un décret honorifique de l’Aréopage, un philosophe stoïcien, cette fois, nommé Sarapion, qui aurait eu des talents tout semblables à ceux d’Héraclite : sur des sujets philosophiques et sérieux il aurait composé des poèmes dont l’art faisait penser à Homère et à Hésiode plutôt, dit le texte, qu’aux « proférations de la Pythie». On ne sait lequel, d’Héraclite ou de Sarapion, voulut rivaliser avec l’autre, si c’est l’Épicurien ou le Stoïcien qui eut le premier l’honneur d’un décret de l’Aréopage, mais la comparaison de l’art savant de Sarapion avec l’emphase oraculaire suggère une critique d’un prédécesseur – pourquoi pas notre Héraclite épicurien ? Une comparaison d’Épicure avec un prophète apparaît justement chez Lucrèce, qui adopte lui-même un ton inspiré. Notons qu’il est possible que les honneurs accordés par l’Aréopage au poète épicurien Héraclite aient été encouragés par l’influence d’une grande dame épicurienne de son temps, l’impératrice Plotine, épouse de Trajan.
21Nous ne sommes pas encore, avec Paul, au temps de Plotine, mais l’Aréopage a pu être dès son temps investi par des Épicuriens plus ou moins nombreux, car certains éléments du discours de l’apôtre paraissent orientés vers des oreilles épicuriennes. Énumérons les traits qui permettent d’avancer cette thèse.
22
Lorsque Paul reproche aux Aréopagites d’être « un peu trop superstitieux », il emploie un terme qui veut dire « craignant les dieux », et qui peut renvoyer aussi bien au scrupule religieux qu’à la superstition ; or la grande voie du salut épicurien consiste justement à enseigner à ne plus craindre les dieux. Si ce sont des Épicuriens que Paul a en face de lui, l’expression se charge de sens, à la fois flatteuse dans le ton et cinglante sur le fond. Mais par ailleurs les Épicuriens pratiquaient précisément une telle forme mixte de blâme et d’éloge, comme on le voit faire par Épicure lui-même lorsque dans une lettre il vante un geste d’enthousiasme d’un disciple en le qualifiant pourtant de contraire à la doctrine physique. L’expression par laquelle Paul, ensuite, rejette les idoles moulées ou imprimées dans l’âme, peut être une allusion à la doctrine épicurienne de la perception mentale des images divines , soutenue par l’omniprésence de leurs représentations dans la statuaire religieuse. Au lieu de cette pure représentation visuelle et intellective, Paul suggère un autre accès au divin, et cet accès est justement celui qui passe par le sens roi selon les Épicuriens, celui auquel toute connaissance se ramène en dernier ressort : à savoir le toucher, un « tâtonnement » aveugle. De même, c’est par contraste avec la doctrine épicurienne de dieux sans rapport avec les hommes, éloignés dans les intermondes, que prend tout son sens l’indication de la proximité du dieu des chrétiens, cependant que la plénitude de ce dieu chrétien, et son caractère vivant rejoignent, cette fois, l’autarcie et la vie des dieux d’Épicure (la négation du besoin d’autrui, prosdeêsis, se rencontre chez Épicure dans le contexte des dieux ). L’insistance sur la résurrection des morts contredit directement la maxime épicurienne selon laquelle la mort est une fin qui ne nous concerne plus : à la dissolution des liens du corps, agrégat matériel (sustasis) du langage épicurien, le chrétien oppose la recomposition physique du corps après la mort (anastasis). Enfin l’idée d’avoir à changer de mentalité, l’idée d’une conversion (metanoein), est, sous un autre nom (epi-spasmos : l’idée d’une attraction irrésistible vers l’image mentale des dieux dès lors qu’ils sont postulés anthropomorphes) au cœur de la doctrine et sans doute, nous avons pour notre part essayé de le montrer ailleurs, au cœur d’une certaine pratique épicurienne.
23
Il y a lieu de comparer le « parler en langues » des chrétiens envahis par l’esprit saint au cours de leurs réunions, comme les pentecôtistes d’aujourd’hui, et le climat qui devait régner aux réunions festives des Épicuriens
[*]
[ltr]https://www.cairn.info/revue-diogene-2004-1-page-52.htm#no24[/ltr]
, si on le rapporte à la doctrine de l’expression spontanée de la voix de la nature qui serait à l’origine du langage et à laquelle une parole vraie se conforme nécessairement .
[ltr]https://www.cairn.info/revue-diogene-2004-1-page-52.htm#no25[/ltr]
24
Pourquoi serait-ce en des termes parlants pour des Épicuriens que Paul s’est exprimé devant l’Aréopage ? Outre la présence probable, suggérée par le contexte et par les inscriptions que nous citions, d’Épicuriens dans ce Conseil vénérable, la philosophie du Jardin devait être (avec celle, caricaturée et caricaturale, des Cyniques, mais aussi en des formes de syncrétisme à l’œuvre dans la morale stoïcienne qui s’écrit à la même époque avec Sénèque et bientôt avec Musonius Rufus ou Épictète), la doctrine que tout le monde avait le plus de chances de connaître, parce que, comme nous l’avons suggéré, c’était la plus répandue, et aussi la plus facile à approcher, notamment en Syrie où elle s’était implantée dès le troisième siècle av. J.- C. : Paul avait précisément longuement séjourné à Antioche en Syrie. L’épicurisme avait sans doute acquis une image à la fois académique et accessible néanmoins à un public moyen : on se sentait d’autant mieux honoré de pouvoir approcher ces intellectuels-là, qu’on était flatté de réussir à les comprendre, malgré la barrière, assez facile à lever, de leur jargon d’école. Mais Paul, lui, les connaît même trop bien : il est capable de jouer de leurs références, de les tourner à son profit, à la gloire de sa doctrine. Peut-être en a-t-il déjà converti beaucoup, en Syrie comme ailleurs.
25
Dans ces réunions, le partage de la nourriture, la circulation du vin, ont une importance dont la portée symbolique est évidemment très différente d’une secte à l’autre.
La comparaison rencontre cependant assez vite ses limites, dans la mesure où chez les Épicuriens le salut est dans l’ascèse spécifique menant à la conversion intellectuelle, et chez les chrétiens dans un avenir eschatologique proche pour tous mais où la conversion les a fait entrer eux-mêmes de plain-pied, et dont ils ne cessent de préparer l’apocalypse, par des encouragements mutuels et des renoncements exaltés. Cette circonstance recommande à l’Épicurien toute la disponibilité nécessaire aux activités de loisir, cependant que la mise en commun régulière d’une part des ressources, voire du travail .
[ltr]https://www.cairn.info/revue-diogene-2004-1-page-52.htm#no27[/ltr]
26
On comprend, dans ce cas, en quoi Paul a échoué devant l’Aréopage : il n’a pas remporté la couronne ni les honneurs qui furent plus tard décernés à un Héraclite de Rhodiapolis ou à un Sarapion. Il a dû renoncer à se battre sur le terrain des valeurs intellectuelles du monde grec, où d’autres juifs, comme Philon d’Alexandrie, avaient tenté de s’illustrer. À Corinthe, sa prochaine étape, il se résolut à travailler de ses mains pour vivre : la rupture intellectuelle entraînait de facto une rupture sociale, bien plus profonde que la retraite lettrée ou semi-lettrée du Jardin.
27
Ce que nous montre cet exemple, c’est qu’il n’existe pas, à l’époque de la rédaction des Actes, d’opposition massive entre athéisme, polythéisme, monothéisme. Nous voyons ici au travail un essai d’auto-définition religieuse en fonction de l’environnement où le sujet se place. La doctrine naît d’interactions constantes et s’alimente de ce qu’elle nie.
 Re: Religion et Philosophie
Re: Religion et Philosophie
[*]BIBLIOGRAPHIE
Notes
[*]
Renée Koch Piettre est Maître de Conférences à l’École Pratique des Hautes Études, à Paris. Spécialiste des religions de la Grèce ancienne, elle a soutenu une thèse sur le corps des dieux dans les épiphanies des dieux grecs, et fera prochainement paraître un ouvrage intitulé Comment peut-on être dieu ? L’anthropomorphisme divin dans l’épicurisme antique. Elle est co-éditeur d’un volume à paraître sur le sacrifice dans les sociétés de la Méditerranée ancienne, et collabore à plusieurs autres programmes de recherches comparées. Ses recherches s’orientent actuellement vers l’épistémologie des sciences des religions.
1
Voir Actes des Apôtres 17.14-15 : Paul était seul à Athènes. On suppose que le témoin fut Denys l’Aréopagite, qu’il convertit ce jour-là.
2
L’épicurisme a-t-il été absorbé par le christianisme, comme le voulait N. W. De Witt (Epicurus and his Philosophy, 1954 ; St. Paul and Epicurus, 1964) ? W. Schmid, Epicuro e l’epicureismo cristiano, 1984 [1964], démontrait pourtant que les Pères de l’église n’avaient pas une connaissance profonde de l’épicurisme. La comparaison a repris avec par exemple Diskin Clay sur l’organisation de la secte épicurienne, David Konstan sur l’amitié en Grèce (voir le volume collectif édité par John T. Fitzgerald, Friendship, Flattery, and Frankness of Speech : Studies on Friendship in the New Testament World, 1996, ou la publication collective du traité de Philodème « Sur la liberté de parole », Philodemus On Frank Criticism, 1998), Clarence E. Glad sur la psychagogie épicurienne et paulinienne (Paul and Philodemus: Adaptability in Epicurean and Early Christian Psychagogy, 1995). Également Abraham J. Malherbe, Paul and the Thessalonians. The Philosophical tradition of Pastoral Care, 1987 ; Id.., « Hellenistic Moralists and the New Testament », 1992, notamment p. 301-304.
3
Rappelons que Karl Marx avait consacré sa thèse de doctorat à la philosophie de la nature dans l’épicurisme et dans Démocrite.
4
Voir Dirk Obbink, « The atheism of Epicurus », 1989.
5
En grec : stoicheia tou kosmou.. Dans cette expression, si les « éléments » (stoicheia) peuvent faire penser aux atomes (Epicure, Lettre à Pythoclès, 86), le mot kosmos, « l’univers ordonné », est incompatible avec la pensée épicurienne, pour laquelle aucun ordre ne régit l’univers.
6
Lucien, Alexandre le faux prophète, 38.
7
Voir un papyrus d’Herculanum sur la vie de l’Épicurien Philonidès, dont le roi Démétrios Ier suivait quotidiennement les leçons (édité par I. Gallo, 1980).
8
Sur ce plan, les sectes, philosophiques ou religieuses, renchérissent l’une sur l’autre : les Épicuriens resteraient fermes dans leur bonheur « jusque dans le taureau de Phalaris » (un taureau de bronze placé sur un feu), les Stoïciens, acculés à ne plus supporter la douleur, se suicideraient, et les Chrétiens se précipitent au martyre en riant et en chantant. Voir Glen W. Bowersock, Martyrdom and Rome, 1995.
9
Voir par exemple Plutarque, Moralia, 434d ; Athénée, V, 215b.
10
Lucien, Alexandre le faux prophète, 47.
11
Élien, Varia Historia IX, 12, voir Athénée, XII, 547 a ; Élien, fr. 92a-92k dans l’édition de Domingo-Forasté.
12
A. D. Simpson, « Epicureans, Christians, Atheists in the Second Century », 1941.
13
Julien, Épître 89b, I, 2, 169, 15-18 (éd. Bidez). Augustin témoigne à son tour que les Épicuriens ont quasiment disparu à son époque (Épîtres 118, 21).
14
Augustin, Confessions VI, 26.
15
Voir Pierre Hadot, Qu’est-ce que la philosophie antique ?, 1995.
16
Mais voir De Witt, Epicurus…, p. 351 sq.
17
Voir par exemple L. Canfora, « Sulla diffusione dell’epicureismo a Roma », 1993. L’auteur du présent article prépare la parution d’un ouvrage sur l’épicurisme aux éditions Belin (Paris).
18
I Corinthiens 5-7. Voir Glad, Paul and Philodemus, p. 315-332.
19
Voir Diskin Clay, «The Cults of Epicurus», 1986 (voir Paradosis and Survival: Three Chapters in the History of Epicurean Philosophy, 1998).
20
Par exemple, il convenait de savoir que la franchise est beaucoup plus délicate d’utilisation à l’égard des femmes que des hommes, celles-là se montrant souvent très susceptibles.
21
Le mot pistis est utilisé par les Épicuriens aussi, mais avec un sens différent (persuasion, conviction emportée par un discours rationnel).
22
Comme on demandait à Arcésilas, sixième successeur de Platon à l’Académie, « pourquoi les étudiants désertaient les autres écoles pour celle d’Epicure, mais jamais de celle des Épicuriens », Arcésilas répliqua que « les hommes peuvent devenir eunuques, mais les eunuques ne peuvent devenir des hommes » (Diogène Laërce, IV, 43).
23
Plutarque, Moralia, 1098b et 1125b.
24
Lucrèce, V, 1028-1090 ; Épicure, Lettre à Hérodote, 76.
25
I Corinthens 14.
26
Diogène d’Œnoanda, fr. 56 (éd. Smith).
27
Philippiens 4, 12-16.
28
2 Corinthiens 9.
29
2 Timothée 2, 3-6.
30
Voir I Corinthiens 13. Pour les références, on se reportera à l’« Index » de De Witt, Epicurus, s.v. « Paul, Saint ».
31
Voir Platon, Gorgias, 485d. Celse, au second siècle, décrira un comportement tout semblable chez les Chrétiens (Origène, Contre Celse III, 50).
32
Xenôn daimoniôn, v. 18.
33
Kainê didachê, v. 19.
34
epilabomenoi de autou, ibid. Outre la comparution de Socrate devant ses juges, le rédacteur avait peut-être aussi à l’esprit celle de Jésus devant le « Conseil des anciens du peuple, des grands prêtres et des lettrés », le Sanhédrin de Jérusalem, Luc 22.63-71 (Matthieu 26.57-66 ; Marc 14.53-65).
35
On s’est longtemps demandé s’il s’agissait de la colline de ce nom, ou du Conseil de l’Aréopage : il s’agit bien évidemment du Conseil, qui à l’époque de Paul « exerçait… le gouvernement de la cité, … en particulier chargé de contrôler l’éducation donnée aux jeunes », et ne siégeait plus sur la colline mais sans doute « dans les salles du Portique royal, voisin du Portique de Zeus Éleuthérios, sur le bord ouest de l’Agora, au débouché de la voie des Panathénées ». Paul « pouvait attendre de cet examen une autorisation officielle pour enseigner en public » (H. D. Saffrey, Histoire de l’apôtre Paul, 1991, p. 79). Voir aussi N. Hugédé, Saint Paul et la Grèce, 1982, p. 99-154.
36
Ce texte a reçu d’amples commentaires. Renvoyons à E. Norden, Agnostos Theos, 1913, p. 3-140 ; M. Dibelius, Paulus auf dem Areopag, 1939 ; É. des Places, La religion grecque, 1969, p. 329-361 ; J. Dupont, « Le discours à l’Aréopage », Nouvelles Études sur les Actes des Apôtres, 1984, p. 380-423.
37
Andres Athenaioi, v. 22.
38
Kata panta hôs deisidaimonesterous : ou bien « particulièrement religieux » ? (v. 22).
39
Agnôstôi theôi, v. 23. Pour la discussion archéologique concernant cet autel, voir H. Leclercq, « Paul (saint) », Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie, 1938, p. 2605-2608. Pour l’interprétation, voir E. Norden, Agnostos Theos.
40
Charagmati technês kai enthumêseôs anthrôpou, v. 28.
41
Psêlaphêseian, v. 27. Le verbe employé est familier aux utilisateurs de la Bible grecque, la Septante ; Luc l’emploie dans le passage où Jésus ressuscité invite ses disciples à le « palper » (Lc 24.39), mais il est attesté aussi chez des Épicuriens (Épicure et Philodème).
42
Ou makran apo henos hekastou hêmôn huparchonta, v. 27.
43
Voir Diogène Laërce VII, 147, et en général Cicéron, De natura deorum, II.
44
Paul cite à cet endroit un vers d’un poème d’Aratos, originaire comme lui de la ville de Tarse : « Nous sommes de la race de Dieu » (opposer à Pindare, Néméenne VI, 1-3). Ce même vers avait déjà été cité deux siècles plus tôt par l’écrivain alexandrin juif Aristobule. Ce n’est, explique H.D.Saffrey (l.c.), « que l’interprétation juive hellénistique du texte de la Genèse ».
45
L’idée de l’autarcie divine est solidaire de celle de la perfection divine, et elle entre dans toute définition rationnelle du dieu.
46
V. 26. Ces mots peuvent à la rigueur se comprendre à partir de la doctrine de la Providence, telle que la défendaient les Stoïciens.
47
Comme il apparaît dans l’ Hymne homérique à Déméter, ou les Oiseaux d’Aristophane.
48
Ta nun, v. 30.
49
Metanoein, ibid.
50
Avec des accents variés, c’est comme un tel affrontement que les auteurs ont généralement rendu compte du discours de Paul à l’Aréopage. Outre E. Norden, M. Dibelius, É. des Places, J. Dupont, cités supra, voir A. D. Nock, Essays on religion and the Ancient World, I, 1972, p. 63-68 ; Abraham J. Malherbe, Paul and the Popular Philosophers, 1989.
51
Voir Théophraste cité par Porphyre, De l’abstinence II, 26 ; Cléarque cité par Flavius Josèphe, Contre Apion I, 179 ; Mégasthène cité par Clément, Stromates I, 15, 72, 5 (textes cités dans P. Borgeaud, Aux origines de l’histoire des religions, 2004, p. 84-87).
52
« C’est contre la loi que cet homme persuade les gens d’honorer Dieu » (Actes 18.12-16).
53
Les auditeurs de Paul confondent-ils la Résurrection (anastasis en grec) avec une déesse qui ferait couple avec Jésus ?
54
Voir par exemple les Bacchantes d’Euripide.
55
Cette idée d’étrangeté figure au v. 20 dans le mot xenizonta.
56
Voir par ex. Malherbe 1989. Épicure n’est cité qu’en tant que repoussoir, ce qu’il restera en effet largement dans la tradition patristique, voir R. Jungkuntz, « Fathers, Heretics and Epicureans », 1966.
57
Strabon notait que « les habitants de Tarse se sont adonnés avec tant de passion non seulement à la philosophie, mais aussi à l’ensemble des disciplines intellectuelles, qu’ils ont surpassé Athènes, Alexandrie, et tout autre lieu où des philosophes ont dirigé des écoles et donné des cours » (XIV, 5, 12-15, voir John Clayton Lentz, Le portrait de Paul selon Luc dans les Actes des Apôtres, 1998, p. 47.
58
Voir Philostrate, Vie d’Apollonios de Tyane I, 7.
59
Pour un dossier sur la citoyenneté romaine de Paul : John Clayton Lentz, Le portrait de Paul, p. 63-73.
60
A. T. Kraabel, « Paganism and Judaism : the Sardis evidence », dans Paganisme, judaïsme, christianisme, 1978, p. 13-33 ; P. Trebilco, Jewish Communities in Asia Minor, 1986, voir John Clayton Lentz, Le portrait de Paul, p. 51.
61
Wilhelm Crönert, « Die Epikureer in Syrien », 1907 ; M. F. Smith, « An Epicurean Priest from Apamea in Syria », 1996.
62
Voir M. N. Tod, « Sidelights on Greek Philosophers », 1957 ; J. H. Oliver, « The Empress Plotina and the Sacred Thymelic Synod », 1975.
63
Voir A. E. Raubitschek, The School of Hellas, 1991, p. 337-344.
64
Sur les oracles de la Pythie, Moralia 396f, voir 402f.
65
J. H. Oliver, « Imperial Commissioners in Achaia », 1973.
66
On peut penser à l’art de Lucrèce, le poète latin : un poème didactique, un ton oraculaire, sur un hexamètre emprunté à la tradition épique.
67
Lucrèce, III, 14.
68
Celle-ci avait simultanément encouragé aussi le « sacré synode des gens du théâtre », association d’acteurs, d’auteurs dramatiques et autres intellectuels réunis sous le patronage « sacré » de l’empereur : ce « sacré synode » dont nous lisons, justement, dans l’inscription de Rhodiapolis, qu’il y alla lui aussi de ses honneurs envers le poète Héraclite.
69
Emploi du terme aphusiologêtôs, voir Plutarque, Contre Colotès, Moralia 1117 b-f.
70
Qualifiées d’eidôla, voir plus haut dans le texte des Actes le terme kateidôlon décrivant Athènes « pleine d’idoles ».
71
Toute sensation provient, selon les Épicuriens, d’un contact entre des émanations des corps perçus et les organes sensoriels. Voir Lucrèce, IV, pour le détail des processus.
72
Épicure, Lettre à Hérodote, 77 (pas de prosdeêsis tôn plêsion, de « besoin des proches »).
73
Renée Piettre, « La proscynèse de Colotès », 1998. La référence principale est un texte attribué à l’Épicurien Démétrius Lacon, récemment publié sous le titre La forma del dio, par Mariacarolina Santoro, Naples, Bibliopolis 2000.
Résumé
Français
- Borgeaud, P., Aux origines de l’histoire des religions, Paris, Seuil 2004.
- Bowersock, G. W., Martyrdom and Rome, Cambridge, Cambridge University Press 1995.
- Canfora, L., « Sulla diffusione dell’epicureismo a Roma », dans Studi di storia della storiografia romana, Bari, Edipuglia 1993, p. 263-273.
- Clay, D., « The Cults of Epicurus », Cronache Ercolanesi 16, 1986, p. 11-28.
– Paradosis and Survival: Three Chapters in the History of Epicurean Philosophy, Ann Arbor, Michigan, 1998. - Crönert, W., « Die Epikureer in Syrien », Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes in Wien, X, 1907, p. 145-152.
- des Places, É., La religion grecque, Paris, Éd. A. et J. Picard 1969.
- de Witt, N. W., Epicurus and his Philosophy, Minneapolis, University of Minnesota Press 1954.
– St. Paul and Epicurus, Minneapolis, University of Minnesota Press 1954. - Dibelius, M., Paulus auf dem Areopag, SBAW.PH 2, Heidelberg, 1939 (réimpr. Aufsätze zu der Apostelgeschichte, Göttingen, 1951).
- Dupont, J., Nouvelles Études sur les Actes des Apôtres, Paris, 1984.
- Fitzgerald, J. T. (éd.), Friendship, Flattery, and Frankness of Speech : Studies on Friendship in the New Testament World, NovTSup 82, Leyde, Brill 1996.
- Erler, M. (éd.), Epikureismus in der späten Republik und in der Kaiserzeit, Stuttgart, 2000.
- Gallo, I., « Vita di Filonide epicureo (PHerc. 1044) », Frammenti biografici da papiri, II, La biografia dei filosofi, Roma, 1980, p. 23-166.
- Glad, C. E., Paul and Philodemus : Adaptability in Epicurean and Early Christian Psychagogy, NovTSup 81, Leyde, Brill 1995.
– « Frank Speech, Flattery, and Friendship in Philodemus », dans J. T. Fitzgerald (éd.) 1996, p. 21-59. - Hadot, P., Qu’est-ce que la philosophie antique ?, Paris, Gallimard 1995.
- Hugédé, N., Saint Paul et la Grèce, Paris, Les Belles Lettres 1982.
- Jungkuntz, R., « Fathers, Heretics and Epicureans », Journal of Ecclesiastical History 17, 1966, p. 3-10.
- Kraabel, A. T., « Paganism and Judaism : the Sardis evidence », dans Paganisme, judaïsme, christianisme : influences et affrontements dans le monde antique, Mélanges offerts à Marcel Simon, Paris, Éd. De Boccard 1978, p. 13-33.
- Konstan, D., « Friendship, Frankness and Flattery », dans J. T. Fitzgerald (éd.) 1996, p. 7-19.
- Leclercq, H., « Paul (saint) », Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie XIII/2, Paris, Letouzey et Ané 1938, p. 2605-2608.
- Lentz, J. C., Le portrait de Paul selon Luc dans les Actes des Apôtres, Paris, Éd. du Cerf 1998.
- Malherbe, A. J., Paul and the Thessalonians. The Philosophical tradition of Pastoral Care, Philadelphia, Fortress Press 1987.
– Paul and the Popular Philosophers, Minneapolis, Fortress Press 1989.
– « Hellenistic Moralists and the New Testament », Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II.26,1, 1992, p. 267-333. - Nock, A. D., Essays on religion and the Ancient World, ed. Z. Stewart, Cambridge, Mass., Harvard University Press 1972.
- Norden, E., Agnostos Theos, Leipzig – Berlin, Teubner 1913.
- Obbink, D., « The atheism of Epicurus », Greek, Roman and Byzantine Studies 30/2, 1989, p. 187-223.
- Oliver, J. H., « Imperial Commissioners in Achaia », Greek, Roman and Byzantine Studies 14, 1973, p. 390-403.
– « The Empress Plotina and the Sacred Thymelic Synod », Historia 24, 1975, p. 125-128. - Piettre, R., « La proscynèse de Colotès. Une lecture de Plutarque, Moralia 1117b-f », Lalies 18, 1998, p. 185-202.
- Philodemus, On Frank Criticism, Introduction, Traduction et Notes par D. Konstan, D. Clay, C. E. Glad, J. C. Thom, J. Ware, Society of Biblical Literature, Atlanta, Georgia, Scholars Press 1998.
- Raubitschek, A. E., The School of Hellas: Essays on Greek History, Archaeology and Literature, D. Obbink & P.A. Vander Waerdt (éds), New York-Oxford, Oxford University Press 1991, p. 337-344.
- Saffrey, H. D., Histoire de l’apôtre Paul, Paris, Éd. du Cerf 1991.
- Schmid, W., Epicuro e l’epicureismo cristiano, trad. it., Brescia, 1984 (s.v. «Epikur», RAC 5, 1964, 681-819).
- Simpson, A. D., « Epicureans, Christians, Atheists in the Second Century », Transactions and Proceedings of the American Philosophical Association 72, 1941, p. 372-381.
- Smith, M. F., « An Epicurean Priest from Apamea in Syria », Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 112, 1996, p. 120-130.
- Tod, M. N., « Sidelights on Greek Philosophers », Journal of Hellenic Studies 77, 1957, p. 132-141.
- Trebilco, P, Jewish Communities in Asia Minor, (Society for New Testament Studies, Monograph Series, 57), Cambridge, Cambridge University Press 1986.
Notes
[*]
Renée Koch Piettre est Maître de Conférences à l’École Pratique des Hautes Études, à Paris. Spécialiste des religions de la Grèce ancienne, elle a soutenu une thèse sur le corps des dieux dans les épiphanies des dieux grecs, et fera prochainement paraître un ouvrage intitulé Comment peut-on être dieu ? L’anthropomorphisme divin dans l’épicurisme antique. Elle est co-éditeur d’un volume à paraître sur le sacrifice dans les sociétés de la Méditerranée ancienne, et collabore à plusieurs autres programmes de recherches comparées. Ses recherches s’orientent actuellement vers l’épistémologie des sciences des religions.
1
Voir Actes des Apôtres 17.14-15 : Paul était seul à Athènes. On suppose que le témoin fut Denys l’Aréopagite, qu’il convertit ce jour-là.
2
L’épicurisme a-t-il été absorbé par le christianisme, comme le voulait N. W. De Witt (Epicurus and his Philosophy, 1954 ; St. Paul and Epicurus, 1964) ? W. Schmid, Epicuro e l’epicureismo cristiano, 1984 [1964], démontrait pourtant que les Pères de l’église n’avaient pas une connaissance profonde de l’épicurisme. La comparaison a repris avec par exemple Diskin Clay sur l’organisation de la secte épicurienne, David Konstan sur l’amitié en Grèce (voir le volume collectif édité par John T. Fitzgerald, Friendship, Flattery, and Frankness of Speech : Studies on Friendship in the New Testament World, 1996, ou la publication collective du traité de Philodème « Sur la liberté de parole », Philodemus On Frank Criticism, 1998), Clarence E. Glad sur la psychagogie épicurienne et paulinienne (Paul and Philodemus: Adaptability in Epicurean and Early Christian Psychagogy, 1995). Également Abraham J. Malherbe, Paul and the Thessalonians. The Philosophical tradition of Pastoral Care, 1987 ; Id.., « Hellenistic Moralists and the New Testament », 1992, notamment p. 301-304.
3
Rappelons que Karl Marx avait consacré sa thèse de doctorat à la philosophie de la nature dans l’épicurisme et dans Démocrite.
4
Voir Dirk Obbink, « The atheism of Epicurus », 1989.
5
En grec : stoicheia tou kosmou.. Dans cette expression, si les « éléments » (stoicheia) peuvent faire penser aux atomes (Epicure, Lettre à Pythoclès, 86), le mot kosmos, « l’univers ordonné », est incompatible avec la pensée épicurienne, pour laquelle aucun ordre ne régit l’univers.
6
Lucien, Alexandre le faux prophète, 38.
7
Voir un papyrus d’Herculanum sur la vie de l’Épicurien Philonidès, dont le roi Démétrios Ier suivait quotidiennement les leçons (édité par I. Gallo, 1980).
8
Sur ce plan, les sectes, philosophiques ou religieuses, renchérissent l’une sur l’autre : les Épicuriens resteraient fermes dans leur bonheur « jusque dans le taureau de Phalaris » (un taureau de bronze placé sur un feu), les Stoïciens, acculés à ne plus supporter la douleur, se suicideraient, et les Chrétiens se précipitent au martyre en riant et en chantant. Voir Glen W. Bowersock, Martyrdom and Rome, 1995.
9
Voir par exemple Plutarque, Moralia, 434d ; Athénée, V, 215b.
10
Lucien, Alexandre le faux prophète, 47.
11
Élien, Varia Historia IX, 12, voir Athénée, XII, 547 a ; Élien, fr. 92a-92k dans l’édition de Domingo-Forasté.
12
A. D. Simpson, « Epicureans, Christians, Atheists in the Second Century », 1941.
13
Julien, Épître 89b, I, 2, 169, 15-18 (éd. Bidez). Augustin témoigne à son tour que les Épicuriens ont quasiment disparu à son époque (Épîtres 118, 21).
14
Augustin, Confessions VI, 26.
15
Voir Pierre Hadot, Qu’est-ce que la philosophie antique ?, 1995.
16
Mais voir De Witt, Epicurus…, p. 351 sq.
17
Voir par exemple L. Canfora, « Sulla diffusione dell’epicureismo a Roma », 1993. L’auteur du présent article prépare la parution d’un ouvrage sur l’épicurisme aux éditions Belin (Paris).
18
I Corinthiens 5-7. Voir Glad, Paul and Philodemus, p. 315-332.
19
Voir Diskin Clay, «The Cults of Epicurus», 1986 (voir Paradosis and Survival: Three Chapters in the History of Epicurean Philosophy, 1998).
20
Par exemple, il convenait de savoir que la franchise est beaucoup plus délicate d’utilisation à l’égard des femmes que des hommes, celles-là se montrant souvent très susceptibles.
21
Le mot pistis est utilisé par les Épicuriens aussi, mais avec un sens différent (persuasion, conviction emportée par un discours rationnel).
22
Comme on demandait à Arcésilas, sixième successeur de Platon à l’Académie, « pourquoi les étudiants désertaient les autres écoles pour celle d’Epicure, mais jamais de celle des Épicuriens », Arcésilas répliqua que « les hommes peuvent devenir eunuques, mais les eunuques ne peuvent devenir des hommes » (Diogène Laërce, IV, 43).
23
Plutarque, Moralia, 1098b et 1125b.
24
Lucrèce, V, 1028-1090 ; Épicure, Lettre à Hérodote, 76.
25
I Corinthens 14.
26
Diogène d’Œnoanda, fr. 56 (éd. Smith).
27
Philippiens 4, 12-16.
28
2 Corinthiens 9.
29
2 Timothée 2, 3-6.
30
Voir I Corinthiens 13. Pour les références, on se reportera à l’« Index » de De Witt, Epicurus, s.v. « Paul, Saint ».
31
Voir Platon, Gorgias, 485d. Celse, au second siècle, décrira un comportement tout semblable chez les Chrétiens (Origène, Contre Celse III, 50).
32
Xenôn daimoniôn, v. 18.
33
Kainê didachê, v. 19.
34
epilabomenoi de autou, ibid. Outre la comparution de Socrate devant ses juges, le rédacteur avait peut-être aussi à l’esprit celle de Jésus devant le « Conseil des anciens du peuple, des grands prêtres et des lettrés », le Sanhédrin de Jérusalem, Luc 22.63-71 (Matthieu 26.57-66 ; Marc 14.53-65).
35
On s’est longtemps demandé s’il s’agissait de la colline de ce nom, ou du Conseil de l’Aréopage : il s’agit bien évidemment du Conseil, qui à l’époque de Paul « exerçait… le gouvernement de la cité, … en particulier chargé de contrôler l’éducation donnée aux jeunes », et ne siégeait plus sur la colline mais sans doute « dans les salles du Portique royal, voisin du Portique de Zeus Éleuthérios, sur le bord ouest de l’Agora, au débouché de la voie des Panathénées ». Paul « pouvait attendre de cet examen une autorisation officielle pour enseigner en public » (H. D. Saffrey, Histoire de l’apôtre Paul, 1991, p. 79). Voir aussi N. Hugédé, Saint Paul et la Grèce, 1982, p. 99-154.
36
Ce texte a reçu d’amples commentaires. Renvoyons à E. Norden, Agnostos Theos, 1913, p. 3-140 ; M. Dibelius, Paulus auf dem Areopag, 1939 ; É. des Places, La religion grecque, 1969, p. 329-361 ; J. Dupont, « Le discours à l’Aréopage », Nouvelles Études sur les Actes des Apôtres, 1984, p. 380-423.
37
Andres Athenaioi, v. 22.
38
Kata panta hôs deisidaimonesterous : ou bien « particulièrement religieux » ? (v. 22).
39
Agnôstôi theôi, v. 23. Pour la discussion archéologique concernant cet autel, voir H. Leclercq, « Paul (saint) », Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie, 1938, p. 2605-2608. Pour l’interprétation, voir E. Norden, Agnostos Theos.
40
Charagmati technês kai enthumêseôs anthrôpou, v. 28.
41
Psêlaphêseian, v. 27. Le verbe employé est familier aux utilisateurs de la Bible grecque, la Septante ; Luc l’emploie dans le passage où Jésus ressuscité invite ses disciples à le « palper » (Lc 24.39), mais il est attesté aussi chez des Épicuriens (Épicure et Philodème).
42
Ou makran apo henos hekastou hêmôn huparchonta, v. 27.
43
Voir Diogène Laërce VII, 147, et en général Cicéron, De natura deorum, II.
44
Paul cite à cet endroit un vers d’un poème d’Aratos, originaire comme lui de la ville de Tarse : « Nous sommes de la race de Dieu » (opposer à Pindare, Néméenne VI, 1-3). Ce même vers avait déjà été cité deux siècles plus tôt par l’écrivain alexandrin juif Aristobule. Ce n’est, explique H.D.Saffrey (l.c.), « que l’interprétation juive hellénistique du texte de la Genèse ».
45
L’idée de l’autarcie divine est solidaire de celle de la perfection divine, et elle entre dans toute définition rationnelle du dieu.
46
V. 26. Ces mots peuvent à la rigueur se comprendre à partir de la doctrine de la Providence, telle que la défendaient les Stoïciens.
47
Comme il apparaît dans l’ Hymne homérique à Déméter, ou les Oiseaux d’Aristophane.
48
Ta nun, v. 30.
49
Metanoein, ibid.
50
Avec des accents variés, c’est comme un tel affrontement que les auteurs ont généralement rendu compte du discours de Paul à l’Aréopage. Outre E. Norden, M. Dibelius, É. des Places, J. Dupont, cités supra, voir A. D. Nock, Essays on religion and the Ancient World, I, 1972, p. 63-68 ; Abraham J. Malherbe, Paul and the Popular Philosophers, 1989.
51
Voir Théophraste cité par Porphyre, De l’abstinence II, 26 ; Cléarque cité par Flavius Josèphe, Contre Apion I, 179 ; Mégasthène cité par Clément, Stromates I, 15, 72, 5 (textes cités dans P. Borgeaud, Aux origines de l’histoire des religions, 2004, p. 84-87).
52
« C’est contre la loi que cet homme persuade les gens d’honorer Dieu » (Actes 18.12-16).
53
Les auditeurs de Paul confondent-ils la Résurrection (anastasis en grec) avec une déesse qui ferait couple avec Jésus ?
54
Voir par exemple les Bacchantes d’Euripide.
55
Cette idée d’étrangeté figure au v. 20 dans le mot xenizonta.
56
Voir par ex. Malherbe 1989. Épicure n’est cité qu’en tant que repoussoir, ce qu’il restera en effet largement dans la tradition patristique, voir R. Jungkuntz, « Fathers, Heretics and Epicureans », 1966.
57
Strabon notait que « les habitants de Tarse se sont adonnés avec tant de passion non seulement à la philosophie, mais aussi à l’ensemble des disciplines intellectuelles, qu’ils ont surpassé Athènes, Alexandrie, et tout autre lieu où des philosophes ont dirigé des écoles et donné des cours » (XIV, 5, 12-15, voir John Clayton Lentz, Le portrait de Paul selon Luc dans les Actes des Apôtres, 1998, p. 47.
58
Voir Philostrate, Vie d’Apollonios de Tyane I, 7.
59
Pour un dossier sur la citoyenneté romaine de Paul : John Clayton Lentz, Le portrait de Paul, p. 63-73.
60
A. T. Kraabel, « Paganism and Judaism : the Sardis evidence », dans Paganisme, judaïsme, christianisme, 1978, p. 13-33 ; P. Trebilco, Jewish Communities in Asia Minor, 1986, voir John Clayton Lentz, Le portrait de Paul, p. 51.
61
Wilhelm Crönert, « Die Epikureer in Syrien », 1907 ; M. F. Smith, « An Epicurean Priest from Apamea in Syria », 1996.
62
Voir M. N. Tod, « Sidelights on Greek Philosophers », 1957 ; J. H. Oliver, « The Empress Plotina and the Sacred Thymelic Synod », 1975.
63
Voir A. E. Raubitschek, The School of Hellas, 1991, p. 337-344.
64
Sur les oracles de la Pythie, Moralia 396f, voir 402f.
65
J. H. Oliver, « Imperial Commissioners in Achaia », 1973.
66
On peut penser à l’art de Lucrèce, le poète latin : un poème didactique, un ton oraculaire, sur un hexamètre emprunté à la tradition épique.
67
Lucrèce, III, 14.
68
Celle-ci avait simultanément encouragé aussi le « sacré synode des gens du théâtre », association d’acteurs, d’auteurs dramatiques et autres intellectuels réunis sous le patronage « sacré » de l’empereur : ce « sacré synode » dont nous lisons, justement, dans l’inscription de Rhodiapolis, qu’il y alla lui aussi de ses honneurs envers le poète Héraclite.
69
Emploi du terme aphusiologêtôs, voir Plutarque, Contre Colotès, Moralia 1117 b-f.
70
Qualifiées d’eidôla, voir plus haut dans le texte des Actes le terme kateidôlon décrivant Athènes « pleine d’idoles ».
71
Toute sensation provient, selon les Épicuriens, d’un contact entre des émanations des corps perçus et les organes sensoriels. Voir Lucrèce, IV, pour le détail des processus.
72
Épicure, Lettre à Hérodote, 77 (pas de prosdeêsis tôn plêsion, de « besoin des proches »).
73
Renée Piettre, « La proscynèse de Colotès », 1998. La référence principale est un texte attribué à l’Épicurien Démétrius Lacon, récemment publié sous le titre La forma del dio, par Mariacarolina Santoro, Naples, Bibliopolis 2000.
Résumé
Français
Les affinités paradoxales que la recherche a pu pointer entre la « secte » philosophique épicurienne et la secte chrétienne dans les premiers siècles de notre ère sont rappelées puis examinées dans le détail du premier document attestant une rencontre précise entre les deux sectes, le récit des Actes des Apôtres qui montre Paul discutant avec les Épicuriens et les Stoïciens d’Athènes, puis nous restitue le discours de Paul devant l’Aréopage d’Athènes. Il apparaît que Paul se pose en philosophe pour exposer sa doctrine en des termes jusqu’à un certain point compatibles avec une doctrine matérialiste voire polythéiste.
Page 5 sur 5 •  1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5
 Sujets similaires
Sujets similaires» Socrate Naissance De La Philosophie
» """Comment la philosophie peut nous sauver"""
» Islam et philosophie
» La Philosophie de Platon
» Histoire de la Philosophie
» """Comment la philosophie peut nous sauver"""
» Islam et philosophie
» La Philosophie de Platon
» Histoire de la Philosophie
Forum Religion : Le Forum des Religions Pluriel :: ○ Science / Histoire :: Gnose/Philo :: Philosophie
Page 5 sur 5
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum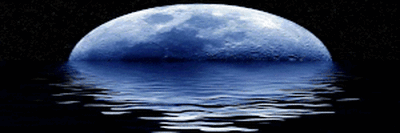
 S'enregistrer
S'enregistrer

