Forum Religion et Art
Page 1 sur 1
 Forum Religion et Art
Forum Religion et Art
Forum Religion et Art
Y-a-t-il nécessairement du religieux dans l'art ?
 Introduction:
Introduction:"La science, l'art, la philosophie, n'ont de valeur qu'en tant qu'elles sont religieuses, c'est-à-dire en tant qu'elles fournissent à l'homme le pain spirituel que les religions lui fournissaient autrefois et qu'elles ne peuvent plus lui donner" (Oeuvres; I; 219). En risquant une telle affirmation, Renan semble faire bien peu de cas soit de la religion, soit de l'art. Car, s'il est possible d'affirmer que la philosophie naquit du déclin des Dieux, et la science de la ruine de la religion -l'une et l'autre sont en effet des disciplines relativement récentes dans l'histoire de l'humanité, et la religion, du moins en Occident,s'est vus très fortement affaiblie par le passage progressif du polythéisme au monothéisme-, il est en revanche plus audacieux, voire aventureux, de subordonner la valeur de l'art à la déchéance de la religion.
Une telle sujétion revient en effet ou bien à alléguer que la religion ne remplit plus son office depuis des millénaires, ou bien que l'art n'a acquis sa valeur que très récemment. Or, l'existence tant des peintures rupestres de la préhistoire, que du Sphinx de la pyramide de Khephren ou de l'Aphrodite de Cnide, nous assure que l'art est une discipline plusieurs fois millénaire, et l'histoire, que le règne de la religion n'est pas encore tout à fait tombé en désuétude.
L'affirmation de Renan est donc fausse si nous la considérons d'un point de vue purement historique: l'art n'est pas ce qui succède à la religion en palliant ses insuffisances.
Mais Renan pose aussi comme un fait que l'art, pour ne nous intéresser qu'à ce dernier, n'a de valeur qu'en tant qu'il est religieux. Or, si nous entendons par "religieux" ce sentiment du sacré, ce rapport à une instance ou valeur supérieure et comme transcendante dont il peut parfois nous sembler faire l'expérience, il faut alors comprendre que l'art n'a de valeur qu'en tant qu'il renvoie à quelque chose d'extérieur à notre raison et qui nous dépasse, qu'en tant qu'il nous fait nous tourner vers un idéal, vers une valeur que nous sommes comme invités à vivre.
Une telle affirmation semble donc poser que pour que l'art existe véritablement, il faut qu'il ait en son essence une part de religieux. Mais y-a-t-il nécessairement du religieux dans l'art? Quelle est la véritable fonction de l'art?
 1ère partie:
1ère partie:L'opinion la plus courante que l'on se fait de la fin que se propose l'art, est qu'elle vise à imiter la nature, c'est-à-dire que l'art aurait pour but et pour fonction d'en rendre au mieux l'essence, l'ordre et l'organisation. C'est ainsi que la valeur de l'oeuvre d'art résulterait essentiellement du degré de ressemblance de la copie au modèle, et que l'artiste ne serait pas créateur mais artisan, technicien plus ou moins doué.
Plus grande serait la perfection de l'illusion, et plus grande serait la valeur de l'oeuvre d'art: les raisins peints par Zeuxis, qui depuis l'Antiquité sont donnés pour modèle de la perfection d'une reproduction sous prétexte que même les pigeons ont eu un jour envie de les goûter, sont la preuve d'une telle perfection.
Pourtant, il est tout à fait impossible que ce soit là la seule et unique valeur de l'art: non seulement rien ne justifie que l'on perde son temps à simplement imiter quelque chose qui existe déjà indépendamment de nous, mais encore, le but qui serait de re-produire un objet de façon parfaitement identique à un modèle est tout à fait impossible à atteindre. L'art, s'il ne se réduisait qu'à cela, n'aurait aucune valeur, et il en aurait d'autant moins que le modèle auquel il se réfère est condamné à disparaître. Qu'en est-il en effet de la valeur d'une pure imitation lorsque l'on ne peut plus la confronter à son modèle?
Il est cependant possible de voir en l'imitation non pas simplement une reproduction fidèle de la forme apparente d'un objet, et que nous nommerons la mauvaise imitation, mais aussi une volonté de retranscrire le principe créateur de l'objet matériel, l'esprit du modèle. Car, par delà les apparences, l'artiste veut aussi retranscrire le vrai, et pour cela, il fait appel à son imagination pour rendre des formes et une atmosphère permettant de faire surgir dans la conscience le sentiment d'un quelque chose qui serait caché derrière les apparences du modèle.
En ce sens, l'art devient la médiation nécessaire à une objectivation par le sujet d'un absolu qui échappe à sa raison, mais qu'il pressent. Ce qui fait alors la valeur d'une oeuvre d'art, ce n'est donc plus la pureté et la régularité des traits qui la composent, mais son degré d'approche de la nature intime de la chose, la façon dont l'artiste a saisit et retranscrit l'essence du modèle, son caractère universel.
Ce qui importe donc dans une oeuvre d'art, ce n'est point sa simple matérialité. Certes, elle reste sensible, mais ce qu'elle présente à notre sensibilité est de l'ordre de l'idéal et non plus de la pure réalité matérielle. Elle tente de retranscrire sur un mode sensible ce qui auparavant était de l'ordre du suprasensible, et, ce faisant, l'art revêt un caractère religieux.
Celui qui reproduit un objet en le peignant ou en le sculptant, ne le fait pas simplement pour imiter la nature; il le fait parce qu'il a conscience de quelque chose d'ultime dans l'être, de sacré, et son désir est d'objectiver cette conscience en l'exprimant dans une oeuvre.
L'art, lorsqu'il est reproduction d'un modèle, contient donc nécessairement une part de religieux, faute de quoi il n'est que caricature d'un objet, mauvaise contre-façon. Mais se limiter à une conception de l'art comme reproduction, bonne ou mauvaise, d'une nature extérieure, se contenter de l'inféoder au "schème de l'imitation", serait une erreur. Car dans une telle optique, aucune place n'est faite, aucune valeur réelle n'est accordée à la création. Or, l'artiste n'est pas simplement imitateur; on le dit aussi créateur. Qu'elle valeur accorderons-nous dès lors à une création sans modèle?
 2ème partie:
2ème partie:Parler des oeuvres d'art comme fruits de la pure créativité humaine, c'est courir le risque de se voir objecter qu'ainsi définies, elles n'ont aucune valeur véritable puisqu'elles échapperaient à une pensée rigoureuse, en ce qu'elles naîtraient d'un imagination chaotique et d'un sentiment particulier, pour agir ensuite sur une autre imagination et produire un autre sentiment.
Mais, une telle affirmation perd de sa force dès lors que l'on s'intéresse aux jugements que les individus portent sur une oeuvre d'art: ceux-ci ne sont pas relatifs. Au contraire, ils apportent la preuve d'un accord, d'une adhésion universelle dans la reconnaissance du beau (que cela soit la beauté dans une imitation ou la beauté dans une création sans modèle objectif).
L'oeuvre d'art, même conçue comme création, même issue d'une imagination et d'une subjectivité particulières, porte en elle de l'universel et revêt une valeur objective.
Kant ne définissait-il pas le goût comme un sens commun et le beau comme "ce qui plaît universellement sans concept" (Critique de la Faculté de Juger)? N'a-t-il pas ajouté un peu plus loin que "la nécessité de l'adhésion universelle, qui est conçue en un jugement de goût, est une nécessité subjective qui, sous la supposition d'un sens commun, est représentée comme objective"?
C'est que la création artistique, là encore, n'acquiert pas sa valeur de l'objet ou de la forme qu'elle revêt, mais de ce qu'elle exprime, par delà le sensible, une universalité. Tout se passe comme si l'art et le jugement qui lui correspond nous ouvrent les portes d'un absolu que la nature nous tait.
Pourtant, l'on peut encore objecter que le sentiment du beau n'a pas besoin de l'art pour exister, et qu'il peut se rencontrer simplement face à la nature; que dans les deux cas, nous retrouvons ce caractère religieux, ce sentiment d'une valeur ou d'une instance à la fois immanente et transcendante de laquelle nous voudrions participer.
Nous répondrons qu'il existe une différence irréductible entre le beau naturel et le beau artistique. Pour cela, nous préciserons tout d'abord que l'on se contente de regarder la nature, alors que l'on contemple une oeuvre d'art, au sens où l'on pose rapidement les yeux sur un objet naturel, au lieu que l'on admire longuement un chef d'oeuvre, non seulement avec les yeux du corps, mais aussi avec les yeux de l'esprit.
Ensuite, nous dirons qu'en tant que création de l'esprit, et donc en tant qu'expression de notre liberté, l'oeuvre d'art est plus élevée que la nature et donc que la beauté qu'elle exprime est plus élevée que la beauté naturelle. Reste cependant encore un problème. Certes, la façon dont nous nous comportons et dont nous réagissons face à une oeuvre d'art laisse à penser que nous en avons une approche quasi-religieuse, qu'il y a forcément du religieux dans notre rapport à l'oeuvre d'art. Mais est-ce suffisant pour pouvoir affirmer qu'il y a nécessairement du religieux dans l'art? Le caractère religieux est-il simplement quelque chose que nous apportons après-coup à l'oeuvre quand nous la réalisons ou la contemplons, ou bien le caractère religieux est-il inclus dans l'essence même de l'art? L'art n'est-il pas nécessairement création et la création nécessairement et essentiellement "religieuse"?
 3ème partie:
3ème partie:Si nous considérons la musique où la poésie, il est évident que nous avons à faire à de pures créations de l'esprit, à de pures expressions de notre intériorité, en ce que ce ne sont pas des entités matérielles, et en ce qu'elles exigent simplement pour exister que l'on mette en elles nos sentiments et notre subjectivité.
A propos de la peinture en revanche, et pour tous les autres arts figuratifs, il semble que l'accusation de simple imitation puisse empêcher qu'on leur accorde le statut de pures créations. Est-ce légitime? Nous répondrons que non et nous nous appuierons pour cela sur l'exemple du portrait.
Pour que le portrait soit lui aussi une véritable oeuvre d'art, il faut non pas seulement qu'il soit proche de la réalité ou forme extérieure du modèle, mais aussi qu'il porte en lui l'empreinte de l'intériorité, de la spiritualité de ce dernier. Or, ceci n'est réalisé que si le peintre réussit à représenter non pas l'image physique, mais l'image du caractère de l'individu, de son essence propre. Cette essence n'étant pas directement visible, elle ne peut être que ressentie par l'auteur. Et pour la rendre dans le portrait, le peintre doit nécessairement devenir créateur, car ce n'est qu'une fois qu'il l'a saisie, travaillée et retranscrite qu'elle peut devenir sensible dans une oeuvre matérielle. Il en va de même en sculpture et en architecture. L'artiste est nécessairement créateur, et l'art création.
Or, qu'est-ce que la création artistique? Comment est-elle possible?
De ce que nous venons de dire, nous pouvons conclure que l'art, aussi bien que ses oeuvres, sont de pures productions de l'esprit et donc, nécessairement, de nature spirituelle. Aussi, les créations de l'art sont des projections de l'esprit dans une extériorité, projections dans lesquelles l'esprit lui-même se retrouve, puisque celles-ci lui appartiennent. Mais la difficulté est de comprendre pourquoi l'esprit produit des oeuvres d'art.
Invoquer le hasard et les circonstances paraît guère satisfaisant, étant donné le besoin qui semble émaner de la création artistique. Il faut par conséquent chercher à quoi correspond ce besoin de création. Nous trouvons alors que l'homme a la conscience de posséder une double existence, l'une matérielle et l'autre spirituelle, mais qu'il ne se reconnaît vraiment que dans la seconde. Aussi tente-t-il de s'approprier le monde extérieur et donc son être matériel en se posant dans l'extériorité, pour pouvoir ensuite intégré l'extériorité dans son intériorité propre.
L'art est donc ce qui permet de traiter et de surmonter l'opposition du subjectif et de l'objectif, dans et par un accès à une suprême unité qui seule peut permettre au sujet d'atteindre la région de la vérité, de la liberté et de la satisfaction.
C'est ainsi que Hegel qualifie la vie dans cette sphère de vie religieuse, car c'est par elle que le sujet prend conscience d'une totalité concrête unique à la fois essence de la nature et essence de lui-même.
 Conclusion:
Conclusion:L'art est donc essentiellement et nécessairement religieux, en ce qu'il révèle à la conscience la vérité dans une unité de l'idée et de l'apparence individuelle. Mais s'il y a nécessairement du religieux en lui, il n'en reste pas moins que l'art est une forme inférieure à la religion, et qu'il faut le dépasser. Car, "même si l'oeuvre d'art représente la vérité, l'esprit, sous la forme sensible d'un objet, et voit dans cette figure de l'absolu la représentation qui lui est adéquate, (...) le recueillement lui est étranger" (Hegel; Esthétique.) Or, seul le recueillement permet au sujet d'intégrer définitivement en lui ce que l'art lui présente encore et malgré tout comme extérieur. Dans l'art, l'identification du sujet et de l'absolu n'est pas encore réalisée, ni la dualité supprimée...
 Re: Forum Religion et Art
Re: Forum Religion et Art
Religions
L’art et le sacré sont intimement liés à toutes les époques. L’homme a toujours conçu avec soin des objets, des décors et des constructions spécifiques pour accompagner ses rites, pratiques et cultes religieux. La part du sacré dans la production artistique d’une société témoigne de l’importance qu’elle accorde à la religion et, par là même, l’éclaire tout entière.
L’art et le sacré sont intimement liés à toutes les époques. L’homme a toujours conçu avec soin des objets, des décors et des constructions spécifiques pour accompagner ses rites, pratiques et cultes religieux. La part du sacré dans la production artistique d’une société témoigne de l’importance qu’elle accorde à la religion et, par là même, l’éclaire tout entière.
 Re: Forum Religion et Art
Re: Forum Religion et Art
Religion
"L’art et les religions vont devenir stériles s’ils ne se parlent pas"
Théologien et professeur d'histoire des religions, François Boespflug décrypte les rapports complexes des religions à l’art, alors que l'Institut des Cultures d'Islam a récemment ouvert à Paris, lieu inédit combinant espaces d'exposition et salle de prière.

© Alain ELORZA/CIRIC
Dans son dernier livre, Le Prophète de l’islam et ses images (Bayard, 2013), il questionne l’interdiction présumée de représenter le prophète Mahomet. Dominicain non arabophone, François Bœspflug n’a pas la prétention d’être islamologue. Il a commencé toutefois à se pencher sur cette question après les affaires des caricatures danoises. En 2006, il publie Caricatures et Dieu ? Pouvoirs et dangers de l’image (Bayard). L’historien, qui est devenu depuis « Monsieur Blasphème », tant les médias font volontiers appel à lui pour les affaires d’images religieuses, nous explique comment les conflits entre art et religion pourraient recréer un dialogue essentiel.
L’idée d’une cohabitation du cultuel et du culturel est-elle novatrice ?
Non, ce mélange est bien plus la règle que l’exception. Les yechiva juives, l’Institut Catholique de Paris : la plupart des institutions religieuses d’exposition et de formation intellectuelle au message et à l’histoire des religions comportent une salle de prière. C'est tout à fait normal : on n’omet ainsi aucun des secteurs dans lesquels la religion s’exprime. Cependant, les lieux où l’art contemporain et la religion dialoguent vraiment, et font plus que de faire ami-ami sont aujourd’hui assez rares. Le père Couturier (1897-1954) fut le grand promoteur d’un renouveau des relations entre l’Église et l’art contemporain. Il est mort en 1954. Et depuis ? Il n’y a plus de lieux de débats approfondis entre l’art contemporain et la religion, conduisant à une confrontation exigeante. La cathédrale d’Évry est à cet égard un exemple très éloquent. D’un côté il y a un musée d’art moderne et de l’autre, le lieu de culte. Les deux institutions sont dans le même bâtiment mais s’ignorent superbement.
Est-ce parce que toutes les religions ont un rapport conflictuel à l’art ?
On peut distinguer clairement des religions iconophiles et des religions iconophobes, hostiles à l’image. Les premières, comme l’hindouisme, le bouddhisme ou le christianisme orthodoxe et latin ont un rapport très positif à la figuration. Les autres, le judaïsme et l’islam surtout, ont un rapport restrictif, abstinent, voire hostile.
Les trois monothéismes abrahamiques ont tous trois hérité du décalogue biblique une méfiance concernant les images cultuelles. On considère que les représentations suscitent une vénération suspecte que les juifs qualifieront d’idolâtrique.
Le christianisme s’est libéré de cette règle avec le dogme de l’Incarnation. Puisque Dieu s’est incarné en Jésus, Dieu fait Homme, l’interdiction de la figuration tombe.
L’islam comme le judaïsme ont conservé une suspicion vis-à-vis des images à cause du risque d’idolâtrie qu’elles comportent. Créer des images, c’est prendre le risque d’un rapport illusoire et fétichiste au divin : une relation où le divin compte moins que son appropriation par l’esprit humain. Pour les juifs et les musulmans, l’homme devant une statue ne peut pas s’empêcher de plier le genou. Seule une élite pourrait faire la différence entre l’art et l’idole ; le petit peuple, lui, va s’y tromper.
La publication des caricatures de Mahomet suscite émoi, protestations, menaces. Les rapports de l’islam à la figuration ont-ils toujours été aussi antagoniques ?
Nous sommes à un moment de l’histoire de l’islam qui correspond à un raidissement. Les musulmans, comme les juifs, ont hérité d’un manque de sympathie pour la figuration comme telle, et pour l’art en général. Or ce qui fut interdit dans le Décalogue n’est pas l’art ni la figuration comme telle, c’est l’image cultuelle. Cependant, il est vrai que la distinction entre ce qui est cultuel et ce qui est culturel était difficile aux débuts des monothéismes. Et elle le reste dans le monde musulman.
À partir du moment où le monde musulman en Europe est dominé par les Ottomans, la liberté que l’on s’accordait en Perse ou en Inde va fléchir. Ensuite, les courants tels que le wahhabisme, les Frères musulmans et le salafisme ont déclaré que, non seulement la représentation du Prophète est interdite et coupable, mais qu’elle n’a jamais existé. Leur position tient alors du déni, au sens psychanalytique du terme : il existe en effet de nombreuse images du Prophète. Il y a encore 20 ans, dans la plupart des cuisines des grandes villes d’Iran, on trouvait des posters du Prophète sous les traits d’un bel homme barbu ou d’un jeune homme adolescent.
Quant à l’art contemporain, je crains que le rapport de l’islam à ce domaine soit quasi-inexistant. D’une part parce qu’il n’y a pas, dans l'islam, d’instance représentative pour instaurer un dialogue, et d’autre part parce que de nombreuses autres questions prioritaires se posent à lui aujourd’hui.
Ainsi l’islam ne serait pas iconoclaste ?
Le Coran n’a pas un mot pour les images. Il condamne les idoles, ce qui ne répond pas à la question de savoir si l'on peut faire des images qui ne soient pas des idoles. Dans quelques passages de la Sunna (« pratique » en arabe ; la Sunna désigne la « loi immuable » de Dieu), cependant, l’idée affleure que celui qui fait des formes, autrement dit l’artiste, qui peint ou sculpte des êtres à souffle, est un blasphémateur, parce qu’il mime l’activité créatrice de Dieu. Au Jugement dernier, il sera mis en demeure d’insuffler la vie aux formes qu’il a dessinées. Comme il en sera incapable, il sera la risée universelle. L’idée que celui qui dessine des êtres vivants à souffle se fait, au fond, le pasticheur de Dieu est aux antipodes de la conception de l’art dans la culture occidentale.
Concernant l’interdiction de représenter Dieu, il en va de même pour la représentation de Yahvé dans le judaïsme et d’Allah dans l’islam que de celle de Dieu le Père dans la religion catholique. La rigueur catholique exigerait de s’en tenir à des images de Dieu christomorphiques. Il est possible de représenter le divin dans la mesure où il est incarné, mais il faut le dépeindre alors comme Dieu incarné, sous les traits de Jésus. La figure d’un Dieu le Père en vieillard est une figure de contrebande. Qu’est-ce qu’on peut montrer de Dieu dans l’islam ? Son nom calligraphié, rien d’autre ?
Chaque année amène de nouvelles controverses sur le respect dû aux religions. L’art moderne est-il nécessairement blasphématoire ?
La provocation et le mépris ne mènent pas très loin pour comprendre les choses. Aujourd’hui, on entend parler de « droit au blasphème ». Le droit d’injurier deviendrait presque un droit sacré. L’art dans le monde occidental procède à un règlement de compte massif, continental, œdipien avec le christianisme. Peut-être l’art en a-t-il besoin ? Mais cela reste une forme de crise d’adolescence, ou d’irritation sénile, de la civilisation.
Pendant longtemps, jusqu’en 1870, le pacte social, qui excluait que la religion catholique, dominante alors, soit si peu que ce soit moquée, a commencé à être remis en question. Avec la Commune de Paris, il y a eu comme une rupture de digue. Félicien Rops (1833-1898) fut le premier peintre à oser jouer avec les représentations religieuses. Il interprète la tentation de saint Antoine comme étant un fantasme sexuel : sur la croix, une femme nue remplace Jésus crucifié. À partir de là, les représentions bricolées, moqueuses, provocantes du crucifix vont foisonner. On explore toutes les limites de l’interdit et du défendu. Depuis 150 ans, Jésus, la Sainte Vierge et saint Joseph ont subi bien pire que le prophète Mahomet. Les chrétiens ont appris à faire le gros dos.
Doit-on s’attendre à ce que la cohabitation entre le centre d’art contemporain de l’ICI Goutte-d’Or et la salle de prière soit problématique ?
La photographie les tire provisoirement d’affaire. Dès son invention, elle a fasciné la plupart des hauts dignitaires musulmans. Ils considéraient sans doute qu'elle ne tenait pas de l’idolâtrie dans la mesure où, dans le cas de ce support, la main humaine ne dessine pas de forme. C’est simplement l’objectif qui prend des formes que Dieu a créées. Entre les formes considérées comme licites en islam (végétaux, minéraux et architectures) et les formes blasphématoires, il y a une sorte de crête. La photo obtient, d'une certaine façon, un droit de passage.
La vraie question est : est-ce qu’ils vont aller au-delà de la photographie et de la calligraphie ? Est-ce qu’ils vont oser, par exemple, montrer des œuvres qui supposent une activité de création de formes, venant de gens qui sont liés à l’islam par un biais ou par un autre ? En réalité, je souhaite à l’ICI Goutte-d’Or un voisinage avec quelques tensions. Comme dans un couple, le fait de se parler, comme de se disputer, est très sain. À l’époque où nous sommes, les religions ne peuvent pas se dispenser de réfléchir aux images qui les expriment au mieux. L’Église ne peut pas perdre, sans grand dommage pour elle, le contact avec l’art contemporain. Et inversement, l’art ne reste vivant que s’il se consacre à de grandes causes. Il s’étiole et s’épuise s’il perd le contact avec les grandes traditions religieuses. L’un et l’autre vont devenir stériles s’ils ne se parlent pas.
"L’art et les religions vont devenir stériles s’ils ne se parlent pas"
Théologien et professeur d'histoire des religions, François Boespflug décrypte les rapports complexes des religions à l’art, alors que l'Institut des Cultures d'Islam a récemment ouvert à Paris, lieu inédit combinant espaces d'exposition et salle de prière.

© Alain ELORZA/CIRIC
Dans son dernier livre, Le Prophète de l’islam et ses images (Bayard, 2013), il questionne l’interdiction présumée de représenter le prophète Mahomet. Dominicain non arabophone, François Bœspflug n’a pas la prétention d’être islamologue. Il a commencé toutefois à se pencher sur cette question après les affaires des caricatures danoises. En 2006, il publie Caricatures et Dieu ? Pouvoirs et dangers de l’image (Bayard). L’historien, qui est devenu depuis « Monsieur Blasphème », tant les médias font volontiers appel à lui pour les affaires d’images religieuses, nous explique comment les conflits entre art et religion pourraient recréer un dialogue essentiel.
L’idée d’une cohabitation du cultuel et du culturel est-elle novatrice ?
Non, ce mélange est bien plus la règle que l’exception. Les yechiva juives, l’Institut Catholique de Paris : la plupart des institutions religieuses d’exposition et de formation intellectuelle au message et à l’histoire des religions comportent une salle de prière. C'est tout à fait normal : on n’omet ainsi aucun des secteurs dans lesquels la religion s’exprime. Cependant, les lieux où l’art contemporain et la religion dialoguent vraiment, et font plus que de faire ami-ami sont aujourd’hui assez rares. Le père Couturier (1897-1954) fut le grand promoteur d’un renouveau des relations entre l’Église et l’art contemporain. Il est mort en 1954. Et depuis ? Il n’y a plus de lieux de débats approfondis entre l’art contemporain et la religion, conduisant à une confrontation exigeante. La cathédrale d’Évry est à cet égard un exemple très éloquent. D’un côté il y a un musée d’art moderne et de l’autre, le lieu de culte. Les deux institutions sont dans le même bâtiment mais s’ignorent superbement.
Est-ce parce que toutes les religions ont un rapport conflictuel à l’art ?
On peut distinguer clairement des religions iconophiles et des religions iconophobes, hostiles à l’image. Les premières, comme l’hindouisme, le bouddhisme ou le christianisme orthodoxe et latin ont un rapport très positif à la figuration. Les autres, le judaïsme et l’islam surtout, ont un rapport restrictif, abstinent, voire hostile.
Les trois monothéismes abrahamiques ont tous trois hérité du décalogue biblique une méfiance concernant les images cultuelles. On considère que les représentations suscitent une vénération suspecte que les juifs qualifieront d’idolâtrique.
Le christianisme s’est libéré de cette règle avec le dogme de l’Incarnation. Puisque Dieu s’est incarné en Jésus, Dieu fait Homme, l’interdiction de la figuration tombe.
L’islam comme le judaïsme ont conservé une suspicion vis-à-vis des images à cause du risque d’idolâtrie qu’elles comportent. Créer des images, c’est prendre le risque d’un rapport illusoire et fétichiste au divin : une relation où le divin compte moins que son appropriation par l’esprit humain. Pour les juifs et les musulmans, l’homme devant une statue ne peut pas s’empêcher de plier le genou. Seule une élite pourrait faire la différence entre l’art et l’idole ; le petit peuple, lui, va s’y tromper.
La publication des caricatures de Mahomet suscite émoi, protestations, menaces. Les rapports de l’islam à la figuration ont-ils toujours été aussi antagoniques ?
Nous sommes à un moment de l’histoire de l’islam qui correspond à un raidissement. Les musulmans, comme les juifs, ont hérité d’un manque de sympathie pour la figuration comme telle, et pour l’art en général. Or ce qui fut interdit dans le Décalogue n’est pas l’art ni la figuration comme telle, c’est l’image cultuelle. Cependant, il est vrai que la distinction entre ce qui est cultuel et ce qui est culturel était difficile aux débuts des monothéismes. Et elle le reste dans le monde musulman.
À partir du moment où le monde musulman en Europe est dominé par les Ottomans, la liberté que l’on s’accordait en Perse ou en Inde va fléchir. Ensuite, les courants tels que le wahhabisme, les Frères musulmans et le salafisme ont déclaré que, non seulement la représentation du Prophète est interdite et coupable, mais qu’elle n’a jamais existé. Leur position tient alors du déni, au sens psychanalytique du terme : il existe en effet de nombreuse images du Prophète. Il y a encore 20 ans, dans la plupart des cuisines des grandes villes d’Iran, on trouvait des posters du Prophète sous les traits d’un bel homme barbu ou d’un jeune homme adolescent.
Quant à l’art contemporain, je crains que le rapport de l’islam à ce domaine soit quasi-inexistant. D’une part parce qu’il n’y a pas, dans l'islam, d’instance représentative pour instaurer un dialogue, et d’autre part parce que de nombreuses autres questions prioritaires se posent à lui aujourd’hui.
Ainsi l’islam ne serait pas iconoclaste ?
Le Coran n’a pas un mot pour les images. Il condamne les idoles, ce qui ne répond pas à la question de savoir si l'on peut faire des images qui ne soient pas des idoles. Dans quelques passages de la Sunna (« pratique » en arabe ; la Sunna désigne la « loi immuable » de Dieu), cependant, l’idée affleure que celui qui fait des formes, autrement dit l’artiste, qui peint ou sculpte des êtres à souffle, est un blasphémateur, parce qu’il mime l’activité créatrice de Dieu. Au Jugement dernier, il sera mis en demeure d’insuffler la vie aux formes qu’il a dessinées. Comme il en sera incapable, il sera la risée universelle. L’idée que celui qui dessine des êtres vivants à souffle se fait, au fond, le pasticheur de Dieu est aux antipodes de la conception de l’art dans la culture occidentale.
Concernant l’interdiction de représenter Dieu, il en va de même pour la représentation de Yahvé dans le judaïsme et d’Allah dans l’islam que de celle de Dieu le Père dans la religion catholique. La rigueur catholique exigerait de s’en tenir à des images de Dieu christomorphiques. Il est possible de représenter le divin dans la mesure où il est incarné, mais il faut le dépeindre alors comme Dieu incarné, sous les traits de Jésus. La figure d’un Dieu le Père en vieillard est une figure de contrebande. Qu’est-ce qu’on peut montrer de Dieu dans l’islam ? Son nom calligraphié, rien d’autre ?
Chaque année amène de nouvelles controverses sur le respect dû aux religions. L’art moderne est-il nécessairement blasphématoire ?
La provocation et le mépris ne mènent pas très loin pour comprendre les choses. Aujourd’hui, on entend parler de « droit au blasphème ». Le droit d’injurier deviendrait presque un droit sacré. L’art dans le monde occidental procède à un règlement de compte massif, continental, œdipien avec le christianisme. Peut-être l’art en a-t-il besoin ? Mais cela reste une forme de crise d’adolescence, ou d’irritation sénile, de la civilisation.
Pendant longtemps, jusqu’en 1870, le pacte social, qui excluait que la religion catholique, dominante alors, soit si peu que ce soit moquée, a commencé à être remis en question. Avec la Commune de Paris, il y a eu comme une rupture de digue. Félicien Rops (1833-1898) fut le premier peintre à oser jouer avec les représentations religieuses. Il interprète la tentation de saint Antoine comme étant un fantasme sexuel : sur la croix, une femme nue remplace Jésus crucifié. À partir de là, les représentions bricolées, moqueuses, provocantes du crucifix vont foisonner. On explore toutes les limites de l’interdit et du défendu. Depuis 150 ans, Jésus, la Sainte Vierge et saint Joseph ont subi bien pire que le prophète Mahomet. Les chrétiens ont appris à faire le gros dos.
Doit-on s’attendre à ce que la cohabitation entre le centre d’art contemporain de l’ICI Goutte-d’Or et la salle de prière soit problématique ?
La photographie les tire provisoirement d’affaire. Dès son invention, elle a fasciné la plupart des hauts dignitaires musulmans. Ils considéraient sans doute qu'elle ne tenait pas de l’idolâtrie dans la mesure où, dans le cas de ce support, la main humaine ne dessine pas de forme. C’est simplement l’objectif qui prend des formes que Dieu a créées. Entre les formes considérées comme licites en islam (végétaux, minéraux et architectures) et les formes blasphématoires, il y a une sorte de crête. La photo obtient, d'une certaine façon, un droit de passage.
La vraie question est : est-ce qu’ils vont aller au-delà de la photographie et de la calligraphie ? Est-ce qu’ils vont oser, par exemple, montrer des œuvres qui supposent une activité de création de formes, venant de gens qui sont liés à l’islam par un biais ou par un autre ? En réalité, je souhaite à l’ICI Goutte-d’Or un voisinage avec quelques tensions. Comme dans un couple, le fait de se parler, comme de se disputer, est très sain. À l’époque où nous sommes, les religions ne peuvent pas se dispenser de réfléchir aux images qui les expriment au mieux. L’Église ne peut pas perdre, sans grand dommage pour elle, le contact avec l’art contemporain. Et inversement, l’art ne reste vivant que s’il se consacre à de grandes causes. Il s’étiole et s’épuise s’il perd le contact avec les grandes traditions religieuses. L’un et l’autre vont devenir stériles s’ils ne se parlent pas.
 Re: Forum Religion et Art
Re: Forum Religion et Art
Art et religion au xx° siècle selon Paulhan et Malraux
par Philippe Gaudin
Cette question sera envisagée du point de vue de deux auteurs, Jean Paulhan au travers de son livre la peinture cubiste, aux origines de l’art moderne[1] et André Malraux au travers de la métamorphose des dieux[2]. Le premier ouvrage n’a donc apparemment pas de relation avec la question posée, d’autant qu’il est consacré seulement à un art particulier, la peinture, dans un moment particulier, celui du cubisme et peut-être même celui de la naissance du cubisme quand Braque et Picasso travaillaient ensemble. Cependant Paulhan fait de ce moment particulier un prisme décisif pour comprendre ce qu’il appelle l’art moderne, c’est-à-dire ce qui s’est passé en peinture pour l’essentiel à la fin du 19° siècle et au début du 20° siècle. Nous verrons en quel sens ce travail peut éclairer la relation entre art et religion au 20° siècle.
L’œuvre de Malraux semble quant à elle plus directement en relation avec notre question si l’on considère avec lui que « longtemps l’art figura les dieux » et qu’il faut prendre la mesure de « l’art mondial », étendu aussi bien dans l’espace que dans le temps, comme une « métamorphose des dieux ». Il faudra donc caractériser la nature même du travail de Malraux qui ne peut se ramener, selon ses propres termes, ni à une histoire de l’art ni à une esthétique. Il faudra ensuite comprendre le sens qu’il donne à l’institution muséale qui a connu une véritable explosion au 20° siècle et la manière dont elle peut éclairer la relation entre art et religion. Il va de soi que cette question engage une certaine conception de l’évolution de la religion au 20° siècle en Europe et qu’en retour le statut de l’art et de l’artiste à cette période éclaire celui de la religion.
Le 20° siècle ne consacre-t-il pas l’image de l’artiste se faisant roi de toutes choses, non plus transcripteur des beautés de la création mais créateur rival de Dieu ? Sa liberté souveraine ne se manifeste-t-elle pas dans le pouvoir de tout détruire et déconstruire et de tout créer et reconstruire selon ses vœux ? Hegel avait sans doute pressenti l’avènement de cette figure qui s’affranchit de toute règle académique, de tout canon et de toute école pour s’affirmer jusqu’à l’incandescence absurde du pur arbitraire qui déclare que tout (ou n’importe quoi) ou rien n’est art par le pur effet divin d’un fiat comminatoire. Règne alors l’humour dans le meilleur des cas, la provocation ou le goût de la profanation le plus souvent, un certain cynisme mêlé de cupidité probablement. Le moment cubiste est sans doute intermédiaire, moment de déconstruction, de déstructuration d’une certaine manière de peindre et même si Braque a pu dire en découvrant les Demoiselles d’Avignon « ce n’est pas un tableau », c’est encore de la peinture. Les cubistes voient le réel et travaillent la peinture autrement que comme une allégeance aux apparences ou aux conventions picturales en vigueur. Ils se font les impies ou les hérétiques d’une manière de voir et de peindre. Et d’ailleurs ils choquent, indignent. Cette situation n’est sans doute pas inédite dans l’histoire et l’on pourrait trouver de multiples exemples de peintres jouant avec la censure ou la subissant durement, tel Botticelli détruisant certaines de ses œuvres sous la pression du religieux Savonarole à Florence. Mais nous subissons sans doute une illusion d’optique à cause de la situation particulière de la naissance de « l’art moderne » à la fin du 19° et début du 20° siècle. Il y eut en effet à cette époque une effervescence artistique considérable multipliant d’une manière inédite dans l’histoire les tendances artistiques ou les personnalités inclassables au point qu’un décalage s’est installé pour un temps (certains diraient durablement !) entre le monde de la création et les institutions d’une part et surtout la sensibilité populaire d’autre part. Qu’on en juge par le nombre « d’ismes » énoncés sans souci chronologique : impressionnisme, symbolisme, pointillisme, fauvisme, cubisme, expressionnisme, dadaïsme, surréalisme, futurisme, suprématisme, abstraction géométrique ou lyrique etc. Toutes tendances qui ont pu en leur temps choquer, scandaliser etc. Cette configuration historique a pu faire croire qu’il était dans l’ordre des choses qu’un artiste soit d’abord incompris ou en « avance sur son temps », expression qui trahit une manière de penser très inadéquate à l’histoire de l’art, comme s’il y avait un progressisme inéluctable où le génie serait en décalage permanent avec la société ou la religion de son temps, comme si le propre du grand art était d’être incompréhensible pour le peuple. L’expression de Hegel selon laquelle « l’art est l’expression de l’esprit du peuple » est sans doute plus vraie dans l’épaisseur historique du point de vue de la nature profonde de l’art et de ses relations avec la société – et notamment la religion – de son temps. Mais pour la période qui nous concerne, nous formulerons l’hypothèse, en nous appuyant sur Paulhan, que la figure de l’artiste moderne est effectivement un prisme révélateur et même annonciateur d’une mutation du religieux en Europe, d’un religieux qui s’émancipe des religions et des Eglises, d’un religieux qui passe d’abord et avant tout par une expérience individuelle, où l’expérience religieuse c’est-à-dire de l’hétéronomie se fait paradoxalement dans celle de la souveraine autonomie de l’originalité irréductible de l’artiste. Etre auteur de sa vie et dans sa vie deviendra sans doute (durablement, passagèrement ?) la nouvelle norme éthique de la modernité. C’est donc en lisant Paulhan que l’on testera cette hypothèse.
Si notre première recherche concerne l’artiste et son statut, la signification morale et spirituelle de son expérience, notre seconde recherche concernera plutôt l’art comme manifestation collective et phénomène d’adhésion populaire, à savoir le musée. Le premier point de vue se situe plutôt du côté de l’artiste tandis que le second se situe plutôt du côté du spectateur. Si la religion eut longtemps un pouvoir englobant sur la société, l’art se mettait au service de ce pouvoir. Notre hypothèse avec Malraux, c’est que l’art mondial de tous les lieux et de tous les temps réalise par lui-même un nouvel englobement culturel via le musée.
Nous nous demanderons enfin d’une manière plus prospective si la question des relations entre art et religion n’est pas appelée à se poser en des termes différents de ceux du 20° siècle et si, après un temps de disjonction et même d’antagonisme entre le religieux et les religions (les Eglises chrétiennes particulièrement), nous ne nous acheminons pas vers une forme de rapprochement nouveau entre eux.
Peinture cubiste et expérience religieuse selon Paulhan
A quoi bon la critique ?
Nous nous proposons pour commencer une courte méditation sur le statut même du discours face aux œuvres d’art. Après tout, le propre des œuvres est de pouvoir dire ce que les mots ne peuvent dire et il convient de faire pour un temps au moins silence devant elles pour les écouter, pour être attentif à ce qu’elles nous disent de singulier dans leur langage irréductible. Il faut donc abandonner la sotte prétention à vouloir mieux dire ce que la peinture par exemple ne nous dirait que d’une manière confuse. Prétention qui est associée à cette représentation erronée du travail des artistes, qui croit qu’ils réalisent après coup ce qu’ils ont d’abord intellectuellement conçu. L’intention préexiste à coup sûr, mais le sens et l’idée de l’œuvre ne naissent qu’au fur et à mesure que l’artiste la réalise et ils restent toujours liés à sa réalité sensible. On raconte qu’une personne se plaignant auprès de Toulouse Lautrec de ne pas comprendre sa peinture, se serait vu répondre : « Mais Madame, la peinture çà ne se comprend pas ; c’est comme la merde, çà se sent ! ». On peut apprécier la vigueur du trait d’esprit mais il ne faudrait pas se laisser entraîner dans une sorte de sensualisme brutal qui voudrait nous contraindre au mutisme total devant l’art. Les œuvres s’adressent en effet tout à la fois à nos sens, nos sentiments et notre esprit. A l’inverse on raconte une autre anecdote d’une personne se plaignant auprès de Picasso de ne pas comprendre sa peinture à laquelle il aurait répondu : « Comprenez-vous le chinois ? Non ? Et bien la peinture c’est comme le chinois, çà s’apprend ! ». Excès intellectualiste inverse qui repose sur la confusion entre langue et langage et ce n’est pas le métier des peintres de parler de la peinture. Une langue est en effet une sémiotique qui organise la correspondance des signifiants et des signifiés d’une manière conventionnelle et suffisamment univoque pour éviter le plus possible les malentendus. Tandis que l’art comme langage produit des signifiés à partir de la force symbolique des signifiants. Un lion en peinture sera toujours tout à la fois le signe désignant un tel animal et l’impression de force qu’il dégage, là où le mot « lion » ne sera que le signe de l’animal.
Le rôle de la critique n’est donc pas d’être comme le doublon de l’œuvre pour parler à sa place et devenir l’étiquette que l’on scrute à la place du tableau que l’on n’a même pas pris la peine de regarder. Son rôle est plutôt de nous faire comprendre comment et pourquoi la peinture nous parle tant, nous émeut tant à partir d’un ensemble « de formes et de couleurs en un certain ordre assemblées ». C’est à cette condition que le discours sur l’œuvre prolonge le bonheur qu’elle nous procure et approfondit non seulement la connaissance de celle-ci mais encore celle que nous pouvons prendre de nous-mêmes. En ce sens il y a peut être une analogie à faire entre l’expérience artistique et l’expérience religieuse. Elle tient au fait qu’il y a une intelligence sensible et une sensibilité intelligente. Le sentiment peut faire connaître au sens où Pascal dit que Dieu est sensible au cœur, comme nous sommes affectés par la beauté, au sens le plus noble et le moins pathologique du terme. La relation art et religion concerne largement les contenus culturels de la représentation sous des aspects à peu près infinis mais il ne faut pas oublier cette intimité formelle et essentielle qu’il faut garder présente à l’esprit pour comprendre l’approche de la peinture cubiste par Paulhan.
Le cubisme comme ascèse religieuse
Comment donc Paulhan peut-il faire un rapprochement entre peinture cubiste et religion et pourquoi y voit-il « les sources de l’art moderne » ? Sa première idée est de voir dans la genèse du cubisme une sorte d’ascèse moderne de la peinture qui vise à se priver systématiquement de tout ce qui jusqu’à présent « faisait peinture », de tout ce qui permet de faire illusion, de rivaliser avec les apparences. Citons : « L’art désormais ne redoute rien tant que de sembler parfait »[3] ; « l’univers entier se disloque comme s’il avait perdu son maître de cérémonies et notre monde s’effondre, on n’y croit plus » ; « …la peinture désormais rompt toute relation avec les dieux et les déités, avec les grands personnages (et même les petits) et les couchers de soleil. »[4]. Paulhan ne diagnostique rien moins qu’un renversement du sens de la peinture par rapport à l’héritage de la Renaissance. Avant le spectateur allait vers le tableau comme on s’approche d’une fenêtre pour y voir le spectacle du monde, après c’est la toile qui vient vers le spectateur et l’interroge ; des images, des chocs passent, le sens vient ensuite. Il ne s’agit plus de penser le réel ou d’y démontrer quelque chose mais de le montrer. On passe de la représentation à la présentation. Comme si la peinture énonçait un simple « il y a », se faisait l’écho de la question de l’être. Comme si l’on passait de la question du comment (comment faire un chef d’œuvre ? par exemple) à celle du pourquoi qui s’appliquerait alors à l’art et au monde. Nous pourrions ajouter ce commentaire – que ne fait pas Paulhan – en montrant l’analogie avec ce que dit Leibniz au début de son Discours sur l’origine radicale des choses. Une fois posé, dit-il, le principe de raison selon lequel rien n’est sans raison, la première des questions qui se pose est : pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas plutôt rien ? La seconde est : pourquoi les choses sont-elles ainsi et non pas autrement ? Cette dernière question concerne les étants et le discours des sciences, la première concerne l’être et le discours proprement métaphysique. Comme si à certaines époques, la question de l’être ne faisant pas problème, le souci de l’art se concentrait sur les étants et les différentes manières d’en faire briller la beauté ; comme si à d’autres époques (le début du xx° siècle par exemple) ce souci portait sur l’existence même des choses et de l’homme. Citons Paulhan : « Il est des époques heureuses, où l’artiste n’a souci que d’embellir la vie et de veiller à ce qu’ nous apercevions clairement du monde toutes les grâces et les charmes – les passages divins… Il peut en toute quiétude s’inquiéter de noblesse ou de beauté : d’esthétique. Mais tout se passe comme s’il était aussi d’autres époques plus sombres, où l’existence même du monde se voit par l’homme mise en doute : où il s’agit moins pour nous de trouver au monde mille vertus que d’y croire comme une brute. Des périodes infortunées, où ce n’est pas seulement le philosophe, mais le peintre et l’homme de la rue, qui se demandent ce qu’ils ont bien pu venir faire sur la terre, et d’abord s’ils y sont vraiment. »[5].
C’est à partir de cette dimension existentielle et métaphysique de l’art que Paulhan nous donne son interprétation : « Bref, l’aventure cubiste offrait tous les traits d’un réveil religieux »[6]. Il fait une analogie entre ce qui s’est passé en peinture à cette époque et les cérémonies primitives, les « …grandes fêtes de la rénovation, au début d’un cycle d’années, où chacun se purge solennellement par le jeûne, la confession, l’ascétisme, l’oubli des péchés comme des actions d’éclat et, en tout cas, des habitudes du cycle passé : à la voirie, la politesse, les convenances, les bonnes manières ! »[7]. A la place de l’ancienne peinture « …voici un monde disloqué, où les plans se chevauchent et les surfaces se morcellent et les courbes se boursoufflent : d’où viennent la négligence et le chaos, les yeux sans front, le sexe à la place des lèvres, les plan en ébullition (où les objets soudain transparents s’échangent et de confondent) ; et le couteau, le paquet de tabac, le quignon de pain prennent soudain la dignité qui, jusque-là, revenait de droit aux Sabines, aux forêts de l’aurore, à la célèbre figure humaine. »[8]. Faut-il s’étonner que ce réveil religieux passe par l’art ? Non répond Paulhan car « l’art a eu de tout temps partie liée avec la religion… On sait, depuis Plotin et Michel-Ange, qu’il n’est pas d’art authentique qui n’exprime une religion »[9]. L’effet de privation des anciens procédés et des anciens charmes, ce travail ascétique donc, aboutit à ce que recherchent les mystiques, le contact avec une réalité sinon ultime au moins plus profonde. Mais en temps de crise c’est par l’art que ce travail, cette plongée doivent se faire, alors qu’en d’autres périodes l’art met en formes et magnifie cette expérience religieuse qui a lieu ailleurs. Ce qui fait dire à Paulhan : « Mais la peinture moderne brise avec tant d’évocations ou d’idéaux, et le plus exact qu’il en faille dire est qu’elle cesse de représenter le sacré pour l’être »[10]. Voilà ce qui nous semble sa thèse majeure. L’art comme expérience du sacré au temps où il a déserté les religions et, plus exactement en Europe au xx° siècle, les Eglises chrétiennes. Comme si le siècle passé se caractérisait par une migration du religieux hors de la religion et comme si l’art de serviteur de la religion qu’il fut toujours, devenait pour un temps la religion de substitution.
Un espace donné à éprouver et non à représenter
Quel fut, selon Paulhan, le moyen pictural clef qui déclencha la révolution de ce qu’il appelle l’art moderne ? C’est la technique du « papier collé ». C’est un geste technique extrêmement simple mais révélateur d’un changement profond de mentalité. Au lieu de chercher à imiter la profondeur, à suggérer l’espace, il faut partir du principe qu’ils nous sont donnés. Lorsque Braque et plus tard Picasso collent des morceaux de papier peint ou de journal sur une toile, ils révèlent l’existence de l’étendue de même que la possibilité de la profondeur. C’est un chemin pour échapper à ce qui peut être considéré comme deux formes de mensonge : l’espace sans profondeur de l’impressionnisme ou l’exagération de l’expressionnisme. On voit bien le sens philosophique et spirituel que l’on peut donner à cette démarche ; comme s’il fallait à l’instar de la phénoménologie de Husserl, « revenir aux choses mêmes » ; comme s’il fallait à l’instar des mystiques, recevoir la vérité après s’être dépouillé de la vanité des artifices. Le papier collé est la nouvelle « machine à voir » de la peinture. On se souvient de ces canevas orthonormés au travers desquels les hommes de la Renaissance voyaient le réel s’organiser dans une perspective piégée par des repères cartésiens avant la lettre. La représentation en perspective n’est effectivement pas la vérité du réel mais le salut de l’apparence qu’il prend quand on le ramène à l’image qu’en perçoit le sujet quand il se fait centre du monde. Or le papier collé ne veut pas faire voir le visible tel qu’il nous apparaît, mais rendre visible ce qui ne se dévoile pas ordinairement au regard ! Tentative impossible et métaphysique alors même qu’elle est aux antipodes de l’intellectualisme : voir le monde hors de notre présence, accéder au réel par la peinture au lieu de se le représenter. D’ailleurs les caractéristiques du papier collé sont significatives : moyens pauvres (objets usuels, chutes et rebuts), anonymat. En effet, il est très intéressant de noter que l’art moderne qui consacre ordinairement la souveraineté de l’artiste, ait pu naître dans des œuvres qui ne sont souvent pas signées ou qui ont été faites à plusieurs mains, où celles de Braque et Picasso par exemple, sont indiscernables.
Quelle leçon fondamentale retenir de Paulhan ? Il s’agit bien sûr d’une interprétation très personnelle, d’un moment très circonscrit dans le temps, celui de la naissance du cubisme et d’un art particulier, la peinture. Nous retiendrons surtout que ces analyses vont à l’encontre d’une sorte de lieu commun sur l’art moderne selon lequel il serait compliqué, intellectuel et ne s’adresserait plus à la sensibilité. On confond généralement la capacité à reconnaître un personnage (les yeux à la place des yeux, la bouche à la place de la bouche…) ou un paysage (le ciel, la terre, la mer, les arbres…) avec la prétendue simplicité de la représentation. Ce sont les tableaux renaissants qui sont pleins de cubes, de cônes, de triangles et de carrés et obéissent ainsi à un art complexe de la composition ! Les premières toiles cubistes, les papiers collés veulent au contraire nous ramener au monde et ramener le monde sur la toile dans sa brutalité, sa misère et sa sourde beauté. Les anciens étaient dans un cosmos théocentré, les renaissants dans un cosmos anthropocentré, les contemporains sont dans un chaos qui occupe le centre pour avoir trop longtemps abusé du divin et de l’humain dans l’art. En ce sens, l’art est bien au xx° siècle, la revanche du monde sensible et de la sensibilité au moment où la science et la technique triomphent. Ces deux dernières considèrent le réel comme un objet de conceptualisation, de mesure et de maîtrise ; le premier le considère comme le lieu et l’événement d’une rencontre déconcertante où le sujet et l’objet sont indiscernables. Dans cette rencontre, du point de vue du spectateur aussi sans doute mais surtout du point de vue de l’artiste, il s’agit d’éprouver soi même ce qui est tout autre que soi. Comme si l’artiste moderne manifestait rigoureusement la lancinante et structurelle tension du sujet humain : vouloir s’affirmer et se nier tout à la fois.
C’est d’ailleurs sur ce point de l’affirmation/négation de l’artiste que l’on peut faire un lien entre Paulhan et Malraux. Citons Paulhan qui cite Malraux : « Je ne sache pas d’écrivain qui pose plus fortement l’énigme de l’art moderne qu’André Malraux, lorsqu’il écrit : Parent de tous les styles sacrés et étranger à tous les autres, notre style pictural semble celui d’une religion qu’il ignore »[11]. Mais il ajoute juste après : « Mais peut-être Malraux va-t-il un peu vite en besogne, lorsqu’il ajoute… qu’un nouveau sujet apparaît : la présence dominatrice du peintre lui-même ». En effet Paulhan voit dans la peinture moderne une volonté de retrait des peintres devant la peinture elle-même. Mais il reconnaît un peu plus loin qu’« il fait en quelque sorte partie des tableaux cubistes qu’ils donnent le sentiment – et d’abord au peintre lui-même – qu’en effet ce peintre s’est abandonné à son seul caprice et à sa fantaisie, mais aussi, mais à la fois que ce caprice l’a mis en accord avec ce qu’il est dans la peinture et dans le monde même de plus vaste et d’universel »[12]. Et Paulhan revient ensuite, à partir de cette dernière affirmation, sur ce qui est au cœur de sa thèse : « Qui ne songerait ici que c’est un des principaux caractères – et comme le centre même – du Sacré, que le sentiment qu’éprouve l’esprit religieux, de se confier à ce qu’il éprouve en lui de plus intime et secret. Mais dans le même temps, par la voie même de ce secret, d’être porté jusqu’à la Divinité et de s’abandonner à elle »[13]. En ce sens l’expérience artistique est le lieu du sacré (et à certaines époques plus que d’autres) à partir duquel le divin peut se rencontrer.
Art et religion au xx° siècle selon Malraux
Le surgissement de l’art mondial
C’est bien sur ce terrain de l’intelligence du sacré que l’on doit chercher à comprendre la tentative de Malraux, notamment dans son livre La métamorphose des dieux. Cette tentative est originale à plus d’un titre. Non seulement parce que c’est celle d’un écrivain qui deviendra ministre de la culture et aura la capacité d’agir à ce titre pour les musées et la culture en général, mais aussi parce que Malraux n’est ni un philosophe, ni un historien de l’art, ni un historien tout court, ni un esthéticien. Il écrit en effet que son travail « n’a pour objet ni une histoire de l’art, ni une esthétique mais bien la signification que prend la présence d’une éternelle réponse que pose à l’homme sa part d’éternité, lorsqu’elle surgit dans la première civilisation consciente d’ignorer la signification de l’homme »[14]. Les œuvres de toutes les civilisations, aussi bien dans l’axe du temps que dans celui de l’espace, surgissent pour la première fois ensemble au xx° siècle. Cela ne fut possible bien sûr qu’à la faveur de conditions matérielles de possibilité : le monde entier parcouru par des voyageurs et des collectionneurs ramenant et rassemblant des œuvres de tous les continents, y compris des œuvres relevant de ce qu’on appelle aujourd’hui les « arts premiers » (il n’est d’ailleurs pas anodin que les artistes « modernes » chers à Paulhan aient été aussi de grands amateurs de ces arts). Le décollage de l’institution muséale date certes de la fin du 18° siècle au moment où les œuvres vont migrer des églises et des châteaux (voir la création du musée du Louvre en 1793 à partir des collections royales) et cela fait beau temps qu’il y a une circulation des œuvres et des artistes mais cela reste vrai à l’intérieur d’ères culturelles données comme celle de l’Europe. La nouveauté, encore une fois, tient à la mondialisation du phénomène et à son universalisation jusqu’aux cultures réputées « primitives ». Malraux veut penser « l’art mondial » et veut comprendre la signification de son surgissement au xx° siècle du point de vue de ses conditions de possibilité spirituelles et pas seulement matérielles. Toutes ces œuvres existaient auparavant, mais on ne les avait encore jamais vues, quand bien même elles auraient pu croiser notre regard ! Malraux se veut le révélateur et le théoricien de cette révolution du regard qui est en fait une conversion de l’esprit. Si la raison d’être de l’art fut longtemps de « figurer les dieux », qu’advient-il de l’art quand les dieux ont fui ? Cette question vaut pour l’art moderne et la réponse de Paulhan consiste à dire qu’il devient en lui-même expérience du sacré et nous pourrions ajouter, pour que puisse être accueilli de nouveaux dieux ou, à nouveau, le divin. C’est d’ailleurs en ce sens qu’il faut comprendre la citation de Malraux que fait Paulhan quand il parle du style pictural moderne qui serait celui d’une religion qu’il ignore. Mais si la question que nous posons a des effets contemporains et prospectifs, elle a aussi, massivement, des effets rétrospectifs. Rien moins que le surgissement de toutes les œuvres du passé comme œuvres d’art. Non que tous les ustensiles ou objets artisanaux soient des œuvres d’art, mais au sens où tous les objets qui ne peuvent se réduire par leur forme ou leur fonction à une utilité technique immédiate apparaissent sous le sceau commun et récemment universel de l’art. Cela pose bien sûr la question épineuse de savoir ce qu’est une œuvre d’art ! Au premier sens du terme, cela signifie qu’elle est née de mains d’homme ou d’une technique quelconque et non un produit de la nature. A partir de là on distingue classiquement les ouvrages d’art des œuvres d’art au sens des « beaux-arts ». Comme s’il était suffisant et évident de définir l’œuvre d’art par sa beauté qui devient alors sa seule « finalité sans fin » car non asservie à l’utilité immédiate. En fait cette distinction des sphères d’activité (économique, politique, culturelle, artistique, religieuse etc.) est un produit récent des sociétés développées, désenchantées comme dirait Max Weber. La sphère de la recherche désintéressée de la beauté fut longtemps « englobée » dans une culture, elle-même inséparable du religieux. Sans aller chercher aussi loin que dans les sociétés premières, pensons simplement, au titre d’une métaphore de cet englobement, aux corps de métiers et à l’ensemble d’une société et d’un peuple tendus vers l’édification des cathédrales gothiques. En ce sens, les œuvres d’art sont les œuvres les plus utiles, les plus nécessaires, d’un point de vue anthropologique et social car c’est à travers elles que les hommes ont dit l’essence de leur humanité et de leurs relations entre eux-mêmes comme avec le monde. Ces considérations qui semblent bien théoriques se trouvaient au centre d’enjeux fort concrets et pratiques lorsqu’il s’est agi de transférer une partie des collections du Musée de l’homme au Musée des arts premiers qu’on appelle dans un parti pris fort courageux « Musée du quai Branly ». Ce n’est donc pas par la beauté qu’il faut définir l’œuvre d’art selon Malraux mais par le fait que c’est un objet « qui a un présent » et de ce fait même une incontestable présence. Un masque africain ou une statue grecque peuvent vous faire penser au bois ou au marbre dans lesquels ils ont été sculptés, aux techniques employées, à leur région d’origine ou à leur époque, à ce qu’ils représentent ; si vous êtes savant, vous pourrez expliquer quelles étaient leurs fonctions religieuses et la place de ces fonctions dans la vie sociale. Mais l’essentiel n’est pas là : il est dans le fait que vous êtes devant des objets qui vous parlent, qui vous touchent, vous émeuvent ou vous effrayent indépendamment de toute ces déterminations dont nous venons de parler et ceci du seul fait qu’elles sont, là, devant vous et que vous vous sentez, vous, là, devant elles. L’œuvre a été faite dans le passé, mais elle n’est pas qu’un témoignage du passé, elle témoigne d’un présent et sa puissance éprouvée malgré le temps témoigne d’une transcendance au cœur du monde sensible.
L’art est donc pour Malraux la réponse de l’éternité au temps, la résistance dont la vie de l’homme peut se montrer capable face à la mort. Mais dans ce combat métaphysique qui revient sans cesse et à chaque génération, il arrive un moment, historique, où il y a une prise de conscience – encore une fois, matérielle et spirituelle – de l’unité de ce combat et de ses victoires. Malraux a tenté de rendre intelligible «… le monde, pour la première fois victorieux du temps des images que la création humaine a opposée au temps »[15]. Le xx° siècle est donc interprété comme le moment de cette victoire, de cette conversion du regard qui nous découvre l’unité profonde de ce qui semblait si hétérogène : « Notre monde de l’art, c’est le monde dans lequel un crucifix roman et la statue égyptienne d’un mort peuvent devenir de œuvres présentes…Aucune civilisation avant la nôtre, n’a connu le monde de l’art créé par des artistes pour qui l’idée d’art n’existait pas »[16]. Nous sommes maintenant en mesure de bien comprendre la manière dont Malraux définit son travail et du même coup son époque quand il parle de « … la présence d’une éternelle réponse à la question que pose à l’homme sa part d’éternité lorsqu’elle surgit dans la première civilisation consciente d’ignorer la signification de l’homme ». Comment conscience et connaissance peuvent-elles cohabiter avec ignorance ? De quel agnosticisme est-il question lorsque qu’il parle de la première civilisation consciente d’ignorer la signification de l’homme ? Cela signifie que nous ne sommes plus au temps d’une religion à la fois particulière et englobante qui offre et, de fait, impose à tous un sens général. On peut d’ailleurs faire une stricte analogie entre ce qui s’est passé pour les arts et pour les religions à la fin du 19° siècle. La religion a été mise à distance, critiquée et du coup, alors même qu’elle se constituait comme objet de science (non au sens de la théologie mais au sens des sciences sociales, philologiques etc.), elle surgit comme un phénomène universel appartenant à l’histoire de l’humanité. Le propre de l’art moderne est de se vouloir moderne, de rompre avec toutes les habitudes de tout bouleverser et même de choquer ; et pourtant, le xx° siècle est celui du musée, de la culture institutionnalisée, de la formidable présence du passé de l’art comme de celle d’un art qu’on est bien obligé de déclarer officiel à cause des financements publics. La civilisation moderne avait besoin de se déprendre des certitudes métaphysiques et religieuses pour pouvoir reconnaître les autres civilisations et, ce faisant, ressusciter leurs œuvres sacrées.
Le musée
Le lieu de cette reconnaissance est le musée. Nous sommes là devant un phénomène collectif majeur qui va bien au-delà de l’existence de quelques grands musées dans le monde. Il s’agit de toute une culture muséale à laquelle participe le phénomène des grandes expositions, des centres d’art et de culture qui se trouvent maintenant dans la plupart des villes moyennes en Europe par exemple. Si l’art a longtemps figuré les dieux et que les dieux ont cessé d’être des dieux pour nous, il nous reste tout de même la figure des dieux, c’est-à-dire les œuvres d’art. Comment ne pas voir nos musées comme de modernes temples dédiés à ce moderne culte de l’art mondial ? Malheur à celui qui s’en prendrait à un chef-d’œuvre, forme moderne de la profanation et du blasphème ! On pourrait faire sans doute une sociologie religieuse de tout cela, avec les grands spécialistes conservateurs (le corps des prêtres) et le peuple soumis qui se presse des heures dans des queues interminables pour enfin ne rien voir à cause de la foule, les pèlerinages périodiques qui nous obligent à marcher trente kilomètres par jour à Florence ou ailleurs et à passer notre vie dans les églises non pour y prier mais pour sacrifier à la présence des œuvres d’art… Religion savante et populaire à la fois avec catéchisme des scolaires traînés bon gré mal gré dans les lieux saints.
Au terme de ce parcours avec Paulhan et Malraux, il semble bien que l’art (du point de vue de l’artiste comme du spectateur) fut au xx° siècle le refuge et le salut du sacré en temps de détresse religieuse, quand « Dieu est mort » et qu’il y a une disjonction entre le religieux et les religions, même si l’on trouvera quelques grands artistes explicitement religieux et de notables tentatives de rapprochement entre l’art moderne et l’Eglise catholique par exemple. C’est à la faveur de cette disjonction que l’art a pu être une « religion de substitution » comme d’ailleurs le choix longtemps dominant de valeurs réactionnaires par la religion sur le plan social et politique fut le pain béni d’un socialisme, également religion de substitution, et qui prétendait, lui au moins, réaliser une fraternité prônée par la piété mais bafouée dans les faits. Cette disjonction du religieux et de la religion (si on s’en tient au christianisme et à l’Europe), du sacré et de Dieu a sans doute produit le meilleur : un art moderne prodigieusement libre, riche et puissant et la découverte non moins prodigieuse – aux antipodes de tout ethnocentrisme – de l’art de toutes les époques et civilisations passées. N’a-t-elle pas produit aussi le pire, c’est-à-dire un art qui au lieu de s’affranchir de règles académiques étouffantes parce qu’il est vivant, a produit une sorte de règle inversée où le laid et le répugnant deviennent le beau, la pseudo-provocation un conformisme et où la posture de la rupture pour la rupture trahit le fait qu’on a rien à dire ? L’art, nouveau sacré privé du divin devient alors une idole bouffie, dont on ne peut à l’instar du veau d’or que mesurer le prix. Nous avons insisté avec Malraux sur le fait que le regard moderne avait un formidable effet rétrospectif, tentons maintenant quelques hypothèses prospectives. A la faveur de l’épuisement des religions de substitution, les religions que l’on croyait mortes se réveillent de leur léthargie moderne et se révèleront de plus en plus comme des puissances de proposition postmodernes. Ce réveil prend parfois l’allure d’un cauchemar fondamentaliste et violent qui n’est qu’un désir régressif de se rendormir et de ne pas affronter la nécessité de dire d’une façon absolument neuve un message cependant intemporel. Si le style des modernes semblait être celui d’une religion qu’ils ignoraient, les grands artistes du xx° siècle ne furent point seulement le refuge de l’expérience religieuse mais encore les sentinelles et les guetteurs du Dieu qui revient et qui vient.
[1] Jean Paulhan, la peinture cubiste les sources de l’art moderne, Denoël Gonthier 1970
[2] André Malraux, la métamorphose des dieux, Gallimard 1957. Nous ferons référence à l’édition revue et augmentée de 1977, en trois tomes : le surnaturel, l’irréel, l’intemporel.
[3] Jean Paulhan, la peinture cubiste, Denoël Gonthier, 1970, p.15.
[4] Ibid, p.21
[5] Ibid, p.186-187.
[6] Ibid, p.41.
[7] Ibid, p.35.
[8] Ibid, p.36-37
[9] Ibid, p.42.
[10] Ibid.
[11] Ibid, p.175.
[12] Ibid, p.177.
[13] Ibid, p.178.
[14] André Malraux, la métamorphose des dieux, Gallimard, 1977, p.35.
[15] Ibid.
[16] Ibid, p.3.
 Re: Forum Religion et Art
Re: Forum Religion et Art
[size=24]La religion de l’art : un paradigme philosophique de la modernité[/size]
Jean-Marie Schaeffer
p. 195-207
PDF 897kSignaler ce documenthttps://rgi.revues.org/470https://rgi.revues.org/470https://rgi.revues.org/470https://rgi.revues.org/470
« Moeyasuku mata kieyasuki hotaru kana » (Chine, 1660-1688).
A la mémoire de Nishimura Kento.
Pour Reiko.
I
1Le 19 novembre 1937 Valéry donne une conférence intitulée Nécessité de la poésie. Il évoque ses débuts de poète à la fin du xixe siècle : « J’ai vécu dans un milieu de jeunes gens pour lesquels l’art et la poésie étaient une sorte de nourriture essentielle dont il fût impossible de se passer ; et même quelque chose de plus : un aliment surnaturel. A cette époque, nous avons eu (...) la sensation immédiate qu’il s’en fallait de fort peu qu’une sorte de culte, de religion d’espèce nouvelle, naquît et donnât forme à tel état d’esprit, quasi mystique, qui régnait alors et qui nous était inspiré ou communiqué par notre sentiment très intense de la valeur universelle des émotions de l’Art. Quand on se reporte à la jeunesse de l’époque, (...) on observe que toutes les conditions d’une formation, d’une création presque religieuse, étaient alors absolument réunies. En effet, à ce moment-là régnait une sorte de désenchantement des théories philosophiques, un dédain des promesses de la science, qui avaient été fort mal interprétées par nos prédécesseurs et aînés, qui étaient des écrivains réalistes et naturalistes. Les religions avaient subi les assauts de la critique philologique et philosophique. La métaphysique semblait exterminée par les analyses de Kant. »1
2L’exaltation artistique décrite ici rétrospectivement par Valéry n’était pas limitée à la France symboliste. Ainsi en 1880 Matthew Arnold écrit-il dans The Study of Poetry : « L’humanité découvrira chaque jour davantage que nous devons nous tourner vers la poésie afin qu’elle interprète la vie pour nous et que nous y trouvions consolation et soutien. Sans la poésie notre science sera incomplète ; et la plupart des choses qui de nos jours passent pour être de la religion ou de la philosophie seront remplacées par la poésie. (...) Car c’est avec justesse et en toute vérité que Wordsworth appelle la poésie (...) « la respiration et l’âme supérieure de toute connaissance » : notre religion, (...) notre philosophie (...), que sont-elles sinon l’ombre, le rêve et l’illusion de la connaissance réelle ? »2
3Valéry décrit la situation du xixe siècle finissant, mais sa référence à Kant pointe vers la fin d’un autre siècle, le xviiie. C’est à la même époque que nous renvoie Arnold, puisqu’il cite Wordsworth pour donner plus de poids à sa conception de la poésie. Ce n’est pas un hasard, car le symbolisme du xixe siècle finissant n’a fait que rejouer un drame vieux d’un siècle, celui de la révolution romantique (plus précisément du romantisme théorique de Iéna) : mêmes protagonistes (la religion, la philosophie, les sciences, l’Art — ou son paradigme idéal : la poésie), même action (crise des fondements philosophiques et plus largement spirituels), même conclusion (l’Art — ou la poésie — comme compensation). D’ailleurs l’époque symboliste n’a pas été la dernière résurgence de cette crise : les avant-gardes artistiques de la première moitié du xxe siècle en sont une manifestation non moins virulente. Et il n’est pas sûr qu’en cette fin du xxe siècle la situation ait fondamentalement changé : pour prendre un exemple particulièrement significatif, récemment encore le regretté Joseph Beuys — un des grands ancêtres de la génération artistique actuelle — a repris les théories anthroposophiques (qui elles-mêmes plongent leurs racines dans la tradition romantique) pour soutenir que l’art a une fonction religieuse et qu’il est la « production originaire », « la production de tout le reste »3.
4Contrairement à ce qu’il pourrait sembler, la conception en question ne saurait être réduite à une simple autoreprésentation un peu hyperbolique du monde de l’art. Nous la trouvons aussi et d’abord chez des philosophes. Ainsi chez Hegel, selon qui l’art révèle « le Divin, les intérêts les plus élevés de l’homme, les vérités les plus fondamentales de l’Esprit »4. Il est intéressant de noter que lorsqu’il expose cette thèse, dans les années 20 du xixe siècle, il ne se sent guère obligé de la légitimer : en l’avançant il se sait en accord avec la plupart de ses contemporains cultivés. Et, lorsque Martin Heidegger écrit en 1935 : « Toujours, quand l’entier de l’étant en tant que lui-même requiert la fondation dans l’ouvert, l’art parvient à son essence historiale en tant qu’instauration. Elle [= l’ouverture de l’étant] s’impose dans l’œuvre ; cette imposition est accomplie par l’art »5, il ne dit pas autre chose que Hegel un siècle avant, aux différences de vocabulaire près. Lui non plus ne se sent pas obligé de fournir une légitimation circonstanciée ; il se sait en accord, non seulement avec beaucoup de ses contemporains, mais surtout avec des prédécesseurs prestigieux : Hegel bien entendu, mais aussi déjà Hölderlin, Novalis ou le jeune Schelling, ensuite Schopenhauer ou le jeune Nietzsche. C’est qu’à l’origine la thèse fait partie d’une stratégie philosophique — mais qui s’est ensuite imposée au monde de l’art ; autant de noms allemands aussi : c’est que par son origine et par ses formulations théoriques les plus prestigieuses (et les plus influentes), il s’agit bien d’une tradition allemande — mais qui a ensuite essaimé dans toute l’Europe.
5Ce qui est en jeu dans cette tradition peut se résumer en une formule toute simple : l’art est un savoir extatique, c’est-à-dire qu’il révèle des vérités transcendantes, inaccessibles aux activités cognitives profanes. La thèse implique une sacralisation de l’art qui, de ce fait, se trouve opposé aux autres activités humaines considérées comme intrinsèquement aliénées. Elle présuppose aussi une théorie de l’être : si l’art est un savoir extatique, c’est qu’il existe deux sortes de réalité, celle, apparente, à laquelle l’homme a accès à l’aide de ses sens et de son intellect raisonneur, et celle, cachée, qui ne s’ouvre qu’à l’art (et éventuellement, la philosophie). Enfin, elle s’accompagne d’une conception spécifique du discours sur les arts : il doit fournir une légitimation philosophique de la fonction extatique de l’art. Ce qui revient à dire que l’art, lui, doit se légitimer philosophiquement.
6La théorie spéculative de l’Art — c’est le nom qu’on peut donner à cette conception — combine donc une thèse objectale (concernant les arts) avec une thèse méthodologique (concernant l’étude des arts). Théorie spéculative, parce dans les formes diverses qu’elle revêt au fil du temps elle est toujours déduite d’une métaphysique générale (qu’elle soit systématique, généalogique ou existentielle) qui fonde ce qui est en réalité non pas une définition descriptive mais une définition évaluative des arts (puisque les œuvres doivent se légitimer philosophiquement)6 ; théorie de l’Art, avec un grand A, parce que au-delà des œuvres et des genres, elle projette une entité transcendante censée fonder la diversité des pratiques artistiques et dont le représentant paradigmatique est en général l’art verbal, la poésie.
II
7Lorsqu’elle naît à la fin du xviiie siècle, la théorie spéculative de l’Art est d’abord et avant tout la réponse à une double crise spirituelle, celle des fondements religieux de la réalité humaine et celle des fondements transcendants de la philosophie. Les deux crises sont liées aux Lumières et elles atteignent leur apogée — intellectuelle — en Allemagne avec le criticisme kantien. La réponse à cette double crise sera ce qu’on appelle la « révolution romantique » : c’est elle qui est à l’origine de la théorie spéculative de l’Art et qui va donc déterminer pour une large part l’auto-représentation de la Modernité artistique.
8La révolution romantique est le lieu d’un bouleversement fondamental, d’un changement radical dans la façon de concevoir le monde et le rapport de l’homme à ce monde, ceci au niveau de la sensibilité la plus individuelle et la plus privée aussi bien qu’à celui de la vision globale de l’existence humaine. Ce bouleversement se condense certes dans le domaine esthétique, mais c’est à son caractère généralisé que la révolution romantique doit d’être une étape majeure dans l’histoire de la culture occidentale, au même titre que la Renaissance ou l’âge des Lumières.
9Certes, sa naissance résulte de la conjugaison de multiples facteurs sociaux, politiques et intellectuels. Ainsi, elle est sans doute liée notamment à l’émancipation des artistes, c’est-à-dire à l’introduction de plus en plus manifeste de la logique du marché dans la circulation de la culture artistique et littéraire7 : le remplacement des liens de dépendance personnelle par la sanction anonyme et imprévisible du marché devait amener fatalement les artistes et écrivains à se poser des questions sur le statut de leur activité. La Révolution française est un autre facteur important : l’éclatement des structures féodales qu’elle accélère, d’abord salué puis très vite déploré par les romantiques allemands, n’est pas pour rien dans la double caractéristique paradoxale qui caractérise leurs textes, à savoir une célébration du subjectivisme le plus radical combinée à une nostalgie, de plus en plus envahissante, déplorant la destruction des structures sociales intégrées, réputées « organiques ». Lorsque Novalis, dans l’envol mystique de Foi et amour (1798), encense le jeune couple royal de Prusse, ou lorsque, dans La chrétienté et l’Europe (1800), il se fait le chantre de l’Eglise du Moyen Age et de la Contre-Réforme, l’homme qui parle est le même que celui qui dans ses fragments littéraires défend les conceptions poétologiques les plus innovatrices8. Sa conception radicale de la poésie va de pair avec une théorie sociale dont on a pu dire que non seulement elle était conservatrice, mais encore que par son culte de l’unité, de l’Etat et de la hiérarchie elle annonçait les idéologies totalitaires du xxe siècle9.
10Tous ces facteurs ont un même centre secret, qui est double : d’une part l’expérience d’une désorientation existentielle, sociale, politique, culturelle et religieuse, d’autre part la nostalgie irrépressible d’une (ré)intégration harmonieuse et organique de tous les aspects d’une réalité désormais vécue comme discordante, dispersée et désenchantée. Car, le maître-mot de l’idéologie romantique est sans conteste la notion d’« Unité ». Elle n’est pas conçue comme un principe abstrait, mais comme une force vivante et vivifiante, âme d’un Univers organique où tout est vie. En fait, elle est de nature théologique : les vicissitudes des errances intellectuelles de Friedrich Schlegel à travers le panthéisme antique, le spinozisme puis le catholicisme sont révélatrices non pas tant dans ce qui les distingue, mais dans ce qui les unit, à savoir l’exigence d’une vision théologique de l’Univers. S’il est vrai que le romantisme est une religion de l’art, il est tout autant la théorie d’un art théologique : la sacralisation de l’art est indissociable de sa fonction religieuse.
11Cette obsession de l’Unité est profondément philosophique et théologique, et c’est bien primordialement ainsi qu’elle est problématisée par Friedrich Schlegel, Novalis, ou encore Hölderlin et — bien entendu — les têtes pensantes de l’idéalisme objectif, Schelling et Hegel. On touche ici à la motivation la plus profonde de la révolution romantique (et idéaliste) : la crise de l’ontologie philosophique et de la théologie rationnelle — « déconstruites » de manière radicale par Kant. Autrement dit, la naissance de la théorie spéculative de l’Art est bien la réponse à un problème philosophico-théologique : comment sauver l’accès à l’Etre absolu et à un fondement ultime de la réalité, alors que le criticisme vient de verrouiller l’ontologie et de limiter le domaine du savoir aux formes et catégories subjectives ainsi qu’aux objets phénoménaux, la question de l’hen kai pan — de l’être et de Dieu — n’ayant plus que le statut d’une Idée de la raison, inaccessible à toute spéculation théorique.
12D’une certaine manière, le romantisme accepte ce verdict kantien : en effet la thèse philosophique centrale des romantiques de Iéna (mais aussi du jeune Schelling) est l’idée que la philosophie est un discours impossible : elle ne saurait être le lieu d’épanouissement de l’onto-théologie. Mais ils ont une solution de rechange, qui n’est autre chose que la théorie spéculative de l’Art, c’est-à-dire la thèse que c’est la poésie, et plus généralement l’Art, qui va remplacer le discours philosophique défaillant. Ainsi Novalis dira : « La forme accomplie des sciences doit être poétique »10, et « Toute science devient poésie — après être devenue philosophie »11. Ce passage qui mène des sciences à la philosophie et enfin à la poésie est le passage du discours comme représentation (et donc comme séparé de ce qu’il représente) à la création pure, absolument libre : « L’art de la poésie n’est sans doute rien d’autre que l’usage gratuit, actif, productif de nos organes — et il se pourrait que la pensée ne fût pas autre chose — en sorte que la pensée et la poésie seraient une seule et même chose (...). »12 Ainsi la poétisation de la philosophie se ramène à l’idée d’une pensée absolument libre, c’est-à-dire non dépendante de quelque impression sensible qui s’imposerait à nous de l’extérieur et qui échapperait à notre juridiction — autrement dit, la poésie réalise l’intuition intellectuelle de l’hen kai pan désormais interdite à la discursivité philosophique.
13On le voit, cet apparent congé donné au discours philosophique est paradoxalement l’œuvre d’une variante de ce même discours philosophique. C’est que l’impulsion philosophique romantique est bicéphale, distendue entre un héritage méthodologique, qui, lui, reste criticiste, et la nouvelle ontologie théologique. Les deux impulsions se situent à des niveaux différents : l’ontologie théologique fonctionne comme une vérité évidente dont la nature discursive est du même coup méconnue ; la méthodologie criticiste quant à elle est censée représenter la discursivité philosophique comme telle. L’ontologie moniste (l’Univers conçu comme hen kai pan) fonctionne comme pôle référentiel « naturalisé » qui est vécu comme non énonçable dans l’horizon de la discursivité philosophique commandée par le dualisme du sujet et de l’objet, et donc par l’impossibilité d’énoncer leur unité absolue. Friedrich Schlegel, par exemple, exprime cette non-coïncidence entre le contenu idéal de la philosophie et sa forme discursive en distinguant entre l’esprit philosophique et sa lettre — lettre toujours déchue par rapport à l’esprit qu’elle veut incarner13. Novalis de son côté, s’inspirant largement des théories néo-platoniciennes, affirme que la réalité fondamentale est accessible uniquement à travers une extase qui échappe à la discursivité rationnelle, puisque cette dernière présuppose toujours la dualité entre un sujet qui énonce et un objet sur lequel porte renonciation. Seule la création poétique accède à une contemplation extatique dans laquelle le poète est à la fois sujet et objet, moi et monde.
III
14Il ne faudrait pas sous-estimer la spécificité du romantisme par rapport aux développements philosophiques ultérieurs de la théorie spéculative de l’Art. Elle réside dans le double agencement dont j’ai parlé : non seulement l’Art est doté d’une fonction ontologique, mais encore il est la seule présentation possible de l’ontologie, de la métaphysique spéculative. En effet, sur ce point précis, les philosophes succédant aux romantiques ne seront pas tous d’accord (ils se différencient en cela des artistes : comme en témoignent les textes de Valéry et de Arnold cités en ouverture, les artistes ont tendance à reprendre la position romantique, c’est-à-dire à verser la philosophie plutôt du côté de la doxa, ou du moins de la placer en-dessous de l’art). Ainsi Schelling et Hegel, après avoir partagé dans leur jeunesse la conception romantique d’un dépassement de la philosophie par l’Art, réinstaureront très vite la philosophie dans ses droits spéculatifs. Dans l’Esthétique de Hegel par exemple, l’Art est appelé à être dépassé par la philosophie, figure ultime de l’Esprit : d’où la thèse de la fin de l’art. Il n’en continuera pas moins à être investi d’une fonction de révélation ontologique, simplement son rapport au discours philosophique sera pensé différemment. Cette solution idéaliste sera d’ailleurs à son tour remise en question : Schopenhauer, Nietzsche ou Heidegger reprendront à nouveaux frais le problème de la relation hiérarchique entre l’Art et la philosophie. Le jeune Nietzsche par exemple retrouvera en gros les positions romantiques, c’est-à-dire qu’il réservera la révélation ontologique ultime à l’art (dans sa forme dionysiaque)14, alors que Heidegger postulera un dialogue entre les deux activités.
15Un des aspects les plus fascinants de la théorie spéculative de l’Art réside dans sa capacité de survivre à l’abandon de l’onto-théologie romantique, donc de continuer à se développer même en l’absence des racines théologiques qui seules pourtant semblent pouvoir la doter d’une certaine plausibilité : n’est-il pas étonnant de voir Nietzsche, esprit pourtant sceptique à l’égard de tous les « arrière-mondes », ou Heidegger, penseur de la finitude de l’homme, reprendre les théorèmes centraux d’une conception de l’Art qui ne saurait avoir de sens qu’à l’intérieur d’une vision positivement théologique de l’être ? En fait, sa survivance à l’intérieur d’une tradition philosophique qui sur bien des points rejette le spiritualisme romantique est moins paradoxale qu’il n’y paraît : l’Art continue à avoir une fonction compensatoire, même lorsque ses relations avec la philosophie sont moins conflictuelles que chez les romantiques. Car, s’il est vrai qu’avec l’idéalisme objectif la philosophie reprend le flambeau de l’Absolu en sorte que l’Art ne doit plus remplacer la philosophie, le discours en doxique (notamment la science) et la réalité commune continueront à être des figures du désenchantement et de l’aliénation — autrement dit, la motivation profonde ayant donné naissance à la théorie spéculative de l’Art continuera à être agissante. Ainsi l’art sera toujours censé contrebalancer l’invasion de la culture moderne par les savoirs scientifiques : l’idéalisme objectif de Schelling et de Hegel, le pessimisme gnoséologique de Schopenhauer, le vitalisme du jeune Nietzsche ou l’existentialisme heideggérien s’opposent tous explicitement au discours scientifique « positiviste » et tentent de le dévaloriser. La compensation s’exerce aussi à l’égard de la réalité quotidienne, sociale, historique : si pour Novalis la poésie devait « romantiser » la vie, Hegel soutiendra que l’Art réalise la relève de l’étantité empirique dans l’Idéal ; pour le jeune Nietzsche, lecteur de Schopenhauer, l’art dionysiaque déchire le voile de la maya et nous délivre de la tyrannie de la Volonté ; chez Heidegger la poésie nous pousse hors de notre être-là inauthentique vers une écoute du « dict » de l’être. On voit bien que ce qui unifie toutes ces figures, au-delà de leurs différences indéniables, est toujours de l’ordre de la nostalgie d’une vie « authentique », non désacralisée et non aliénée.
16Bien entendu, la sacralisation, sinon de l’Art, du moins de la poésie, n’est pas une invention romantique : la figure du poète comme interprète de la voix mantique, comme prophète ou vates, donc comme intermédiaire entre la parole divine et les hommes, se trouve déjà chez certains auteurs grecs ou latins, à commencer par Pindare, Démocrite et Platon. Elle sera d’ailleurs reprise par le christianisme naissant, le topos de l’invocation des Muses étant remplacé par une invocation à Dieu : sous cette forme, la thèse de la fonction médiatrice de la poésie resurgira de temps en temps au Moyen Age. Quant à la Renaissance, on sait avec quelle force elle réactivera la figure antique du poète inspiré par les Muses15.
17Cela dit, il existe une différence abyssale entre la révolution romantique et les sacralisations antérieures de la poésie. D’une part, l’exaltation romantique de la poésie s’insère dans une perspective entièrement commandée par une ontologie théologique dont la présentation est exigée alors même qu’elle est déclarée impossible à l’intérieur de la discursivité philosophique. Elle est la réponse à une crise philosophique, et plus largement existentielle, ce qui n’est pas le cas au Moyen Age. En deuxième lieu, la sacralisation de la poésie, sa détermination comme species divina loquendi est mise en avant dans un contexte historique qui, lui, est largement désacralisé, ce qui en change totalement la portée et interdit notamment qu’elle soit référée à une fonction institutionnellement liturgique (si l’on excepte les Chants spirituels de Novalis qui font effectivement partie intégrante de la musique sacrée luthérienne). Nous retrouvons ici la caractéristique fondamentale de la sacralisation romantique de la poésie : elle remplit une fonction compensatoire face à la crise du Weltbild — et notamment de la théologie et métaphysique dogmatiques — induite par les Lumières, fonction absente chez les défenseurs antérieurs de la poésie, par exemple ceux du Moyen Age latin (pour qui il s’agissait certes de se hisser au même niveau que la philosophie dans la hiérarchie des sept arts, mais ceci dans le cadre d’une vision théologique du monde jamais mise en question).
IV
18Si la théorie spéculative de l’Art n’était qu’une tradition philosophique locale, l’intérêt de son étude actuelle serait sans doute limité. Mais on sait qu’elle a investi de larges secteurs du monde de l’art occidental du xixe et du xxe siècle et que ce faisant elle a pour une large part influencé — et déformé, ajouterai-je pour ma part — la manière dont nous voyons les arts. L’histoire de cet étonnant succès reste à écrire, et je devrai me contenter ici en guise de conclusion de quelques indications dispersées.
19Le romantisme occupe bien entendu une place à part, puisqu’il a été, de naissance, à la fois une théorie philosophique et une autoreprésentation du monde artistique ; si les frères Schlegel ne sont que des poètes occasionnels et médiocres, Novalis est un bon poète, alors que Hölderlin, autre chantre de la religion esthétique, est un des plus grands poètes, non seulement allemands mais européens. En fait, la plupart des grands acteurs du romantisme allemand sont bicéphales : ainsi les peintres Runge et Carus sont des penseurs romantiques tout autant que des artistes16. Par ailleurs, la plupart, sinon tous les mouvements romantiques européens, empruntent leur bagage théorique aux Allemands, essentiellement aux frères Schlegel et à Schelling : Mme de Staël pour l’Europe entière, Coleridge pour l’Angleterre, Victor Cousin pour la France, Manzoni pour l’Italie sont parmi les médiateurs essentiels. De ce fait, la théorie spéculative de l’Art s’est étendue en même temps que le romantisme européen et on la retrouve, sous une forme plus ou moins abâtardie, chez la plupart des artistes romantiques17. Encore l’influence directe du romantisme théorique sur les arts et sur la réflexion artistique ne cesse-t-elle pas avec la fin des mouvements romantiques : Arnold (comme nous avons pu le voir), plus tard les écrivains de l’expressionisme allemand ou Rilke, encore plus près de nous Maurice Blanchot — autant d’écrivains et de critiques qui se ressourceront directement aux écrits des Iénaens.
20Le destin historique de l’esthétique hégélienne a été différent : son influence directe sur la vie artistique de son époque a certainement été plus faible que celle du mouvement romantique ; mais à travers son rayonnement universitaire (qui continue de nos jours) et à travers le marxisme, l’effet à retardement de ses conceptions n’en a été que plus grand. Que l’esthétique hégélienne ait souvent attiré les professeurs n’est pas étonnant : après tout, elle est un exposé universitaire et sa charpente systématique — son caractère clos et « complet » — en font un cursus commode. Quant au marxisme, aussi étrange que cela puisse paraître, vu le déterminisme sociologique très cru qu’il professe en général, il a réussi à développer sa propre variante de la théorie spéculative : l’Art (ou du moins le « grand Art », c’est-à-dire l’art du passé ainsi que l’art réaliste-socialiste) est supposé dévoiler la réalité sociale ultime du monde humain. On connaît la fortune historique de l’affirmation d’Engels selon laquelle les œuvres de Balzac dévoilent de manière impitoyable la structure de la société de l’époque : à son corps défendant Balzac montre le caractère inéluctable du triomphe (provisoire) de la bourgeoisie et la faillite historique de l’aristocratie, classe à laquelle allaient pourtant ses sympathies. Il faut ajouter que la sacralisation de l’art se retrouve aussi — et avec bien plus de force — chez les marxistes critiques, par exemple chez Benjamin18 ou Adorno. La Théorie esthétique d’Adorno, une des défenses les plus émouvantes et les plus courageuses de la tradition artistique moderniste, est aussi une reformulation ambitieuse de la théorie spéculative dans la perspective de la « dialectique négative ». La fonction compensatoire de l’Art y est particulièrement forte : l’Art est « l’écriture inconsciente de l’histoire », protestation irréductible contre une réalité globalement mauvaise, mais aussi promesse d’une réconciliation utopique. En fait, Adorno reprend la plupart des thèmes de la tradition spéculative. Il défend notamment une conception très radicale de la réductibilité des arts à leur « vérité » philosophique : « La philosophie et l’art convergent dans leur contenu de vérité : la vérité de l’œuvre d’art qui se déploie progressivement n’est pas autre chose que celle du concept philosophique (...) Le contenu de vérité des œuvres n’est pas ce qu’elles signifient, mais ce qui décide de la fausseté ou de la vérité de l’œuvre en soi ; seule cette vérité de l’œuvre en soi est commensurable à l’interprétation philosophique et coïncide, tout au moins quant à l’idée, avec la vérité philosophique (...) la véritable expérience esthétique doit devenir philosophie ou bien elle n’existe pas. »19
21L’influence de Schopenhauer sur l’esthétique moderne est généralement sous-estimée, notamment en France où, pour des raisons complexes, ce philosophe a souvent mauvaise presse, s’il n’est pas tout simplement méprisé. De ce fait, on oublie trop facilement que durant la deuxième moitié du xixe siècle, alors même que Hegel sombrait dans un oubli temporaire, la philosophie schopenhauerienne a entrepris une triomphale carrière européenne. Or, le pessimisme schopenhauerien est inconcevable sans la compensation que procure l’extase esthétique, véritable rédemption qui permet à l’homme d’échapper aux malheurs de la volonté de vivre : aussi n’est-ce pas un hasard si c’est surtout l’idée du salut par l’art qui a retenu l’attention des lecteurs et plus généralement du public. Ainsi les thèses centrales de son esthétique se retrouvent-elles chez certains des artistes les plus importants de la deuxième moitié du xixe et du début du xxe siècle : chez Wagner, bien entendu, mais aussi chez Huysmans, Gauguin et les Nabis, Proust20 ou encore Malévitch21. On ne saurait donc surestimer l’importance historique prodigieuse qui a été celle de la variante schopenhauerienne de la sacralisation de l’Art.
22Dans un premier temps, l’influence de Nietzsche a prolongé celle de Schopenhauer, mais sa réinterprétation affirmative de la notion de volonté creusera vite un fossé entre sa théorie de l’Art de celle de son maître. Son esthétique de la volonté de puissance jouera un rôle central dans la plupart des mouvements d’avant-garde du début du siècle : l’activisme artistico-politique de l’expressionnisme, du futurisme, du néoplasticisme ou encore du constructivisme doit beaucoup à la conception nietzschéenne de l’Art comme expression d’une force vitale élémentaire. A des degrés divers, on retrouve ainsi l’héritage nietzschéen, explicite ou implicite, chez Le Corbusier, van Doesburg, Mondrian22, les représentants du Bauhaus, Mies van der Rohe, etc23. L’idée, si centrale dans les projets des avant-gardes des années 20, d’une esthétisation de la réalité, découle, elle aussi, au moins en partie, de la théorie nietzschéenne de la volonté de puissance, réinterprétée comme « volonté de forme ».
23Cela dit, le lien des mouvements d’avant-garde avec la tradition de la théorie spéculative de l’Art ne saurait être limité à l’influence nietzschéenne. Leur impulsion utopique fondamentale, à la fois d’ordre spirituel et esthétique, réactualise tout autant le moment originaire de la sacralisation de l’Art, à savoir les rêves du romantisme iénaen : le projet même d’une avant-garde artistique, projet éminemment historiaste, voire eschatologique, plonge ses racines au plus profond de la tradition que nous avons analysée. Le messianisme utopique est en effet indissociable des variantes les plus radicales de la théorie spéculative de l’Art. J’ai dit que le culte romantique de l’Unité était celui d’une Unité défaillante, d’une Unité à (r)établir : grâce à la doctrine historiciste, l’histoire se transforme en cheminement vers le Salut. Les avant-gardes artistiques du xxe siècle reprennent le même schéma historiciste, simplement ils remplacent le Salut religieux par celui du communisme (les avant-gardes russes et allemandes par exemple) ou du fascisme (les futuristes italiens).
24Quant à Heidegger, le dernier en date des grands théoriciens de la théorie spéculative de l’Art, il est sans doute inutile, du moins en France, de rappeler son importance dans la réflexion actuelle sur les arts et notamment sur la poésie. Son influence passe à la fois directement à travers ses écrits, mais tout autant, sinon plus, à travers la reprise de ses idées par des philosophes (le déconstructivisme de Derrida exacerbe l’idée heideggérienne d’un dialogue entre la pensée et l’Art) mais aussi par des écrivains — tel Maurice Blanchot24 — ou des poètes — tel René Char.
25On pourrait allonger indéfiniment cette liste des artistes et auteurs du xxe siècle qui se situent dans la descendance de la théorie spéculative de l’Art. Mais je voulais simplement montrer que la sacralisation de la poésie et de l’Art a peu ou prou teinté une grande partie de la vie artistique et littéraire moderne et moderniste, constituant en quelque sorte l’horizon d’attente esthétique du monde de l’art occidental depuis bientôt deux cents ans. La confusion et le désenchantement, qu’on dit régner dans le domaine de la création et de la pensée artistiques et critiques depuis une dizaine d’années, ne sont peut-être que des signes de la lente agonie de ce paradigme spéculatif de l’Art et de la difficulté que nous rencontrons à le remplacer par une nouvelle vision des arts qui rende justice à leur importance humaine sans verser dans l’exaltation philosophico-mystique qui a accompagné leur destin moderniste.
Notes
1 Paul Valéry, Propos sur la poésie, in Œuvres, I, Gallimard, 1957, p. 1381.
2 M. Arnold, The study of Poetry, reproduit dans D. J. Enright, E. de Chickera (éd.), English Critical Texts, Oxford UP, 1962, p. 260-261.
3 Voir Joseph Beuys et Volker Harlan : Qu’est-ce que l’art ?, L’Arche, 1992, notamment p. 20. Beuys et Harlan vont jusqu’à reprendre la théologie schlégelienne de la nouvelle mythologie (exposée dans l’Entretien sur la poésie de 1800), affirmant : « Le mythique devrait, après transformation, être intégré dans la pensée moderne et consciente d’elle-même de l’individu libre » (Beuys) et «... la peinture future peut fonder une sorte de nouvelle mythologie » (Harlan, op. cit., p. 153 et 218).
4 Esthétique, Ed. Flammarion, 1979, t. I, p. 20.
5 M. Heidegger, L’origine de l’œuvre d’art, in Chemins qui ne mènent nulle part, Gallimard, 1962, p. 68 ( = Der Ursprung des Kunstwerkes, in Holzwege, Francfort-sur-le-Main, V. Klostermann Verlag, 6e éd., 1980, p. 63).
6 Heidegger, par exemple, limitera sa conception de la poésie à ce qu’il appelle « le poème valide » (das gültige Gedicht), c’est-à-dire en fait le poème qui se prête à une traduction philosophique : d’où le privilège qu’il accorde à Hölderlin, poète-philosophe par excellence. Adorno de son côté — et malgré son rejet de Heidegger — le rejoindra sur ce point, lorsqu’il dira que la philosophie et l’art convergent dans leur contenu de vérité.
7 Friedrich Schlegel a ainsi mené pendant longtemps la vie instable et aléatoire d’un écrivain « libre » avec le manque de sécurité financière et statutaire qui est lié à cette activité. N’oublions pas non plus que la grande aventure éditoriale du romantisme de Iéna, la revue Athenaeum, a été interrompue en 1800 pour des raisons essentiellement financières, liées au manque à gagner de l’éditeur commercial. Voir à ce propos la postface de E. Behler à la réimpression des livraisons de la revue romantique, dans Athenaeum. Eine Zeitschrift, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1973, t. III, p. 5-64.
8 Voir Novalis, Schriften, ed. P. Kluckhohn et R. Samuel, Stuttgart, Kohlhammer Verlag, t. II, 1960, p. 485-499 et t. III, 3e éd., 1983, p. 507-524.
9 Voir H. W. Kuhn, Der Apokalyptiker und die Politik. Studien zur Staatsphilosophie des Novalis, Freiburg, 1961, p. 150, et F. C. Snell, Die Tragödie des deutschen Liberalismus, Stuttgart, 1953, p. 53 et s.
10 Schriften, III, p. 527.
11 Ibid., p. 396.
12 Ibid., p. 406. Dans le même fragment Novalis qualifie de « penseur goethéen » cette union du poète et du philosophe.
13 Voir Friedrich Schlegel, Kritische Ausgabe, Paderborn, Schöningh Verlag, 1959, t. III, p. 99.
14 La conception que Nietzsche défend dans les écrits de sa « maturité » est plus complexe, puisqu’il y rejette le fondement ontologique sur lequel s’est élevé la théorie spéculative de l’Art. Ne pouvant l’analyser ici, je renvoie à L’art de l’âge moderne, p. 289-296.
15 Ainsi chez Pindare nous lisons : « Prophétise Muse, et je serai ton interprète » (fr. 137, reproduit dans D. A. Russell et M. Winterbottom (éd.), Ancient Literary Criticism, Oxford Uni-versity Press, 1972, p. 4). Ou encore chez Démocrite : « Tout ce que le poète écrit en étant possédé (enthousiasmas) et sous inspiration (pneuma) divine est beau », fr. B 18 dans Diels/Kranz, Fragmente der Vorsokratiker, Weidmannsche Verlagsbuchhandlung, Berlin, 1960, t. 2, p. 146. Les passages de Platon (dans l’Ion et le Phèdre) sont trop célèbres pour qu’on les reproduise ici. Notons simplement que dans l’Ion il compare explicitement l’inspiration poétique aux délires des Corybantes et aux Bacchantes et affirme que la Divinité, leur ayant ravi l’esprit, les fait vaticiner et les transforme en devins (Ion, 534). Mais cette valorisation des poètes est très ambiguë, puisqu’elle permet en même temps à Platon de leur dénier toute technè, tout art. Pour le Moyen Age, voir P. Klopsch, Einführung in die Dichtungslehren des lateinischen Mittelalters, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1980, p. 20-36, et E. R. Curtius, La littérature latine et le Moyen Age latin, PUF, 1956, t. 1, notamment p. 343 et s.
16 Runge a développé une métaphysique des couleurs, dans laquelle les trois « couleurs originaires » (Urfarben) sont des analogues de la Trinité ; quant à Carus, il soutient que la beauté (visuelle) est « le sentiment (Empfindung) de la présence de l’être divin dans la nature, et ceci de la même manière que la vérité est la connaissance de cet être divin » (Neun Briefe über Landschaftsmalerei, cité d’après Gerard Eimer, Caspar David Friedrich. Auge und Landschaft, Insel Verlag, 1974, p. 172).
17 Les filiations sont souvent complexes : la théorie romantique de l’imagination, par exemple, passe de Coleridge (Biographia Literaria) à Poe (voir notamment « The Poetic Principie »), puis de celui-ci à Baudelaire (voir les « Notes nouvelles » précédant la traduction des Nouvelles Histoires extraordinaires).
18 A propos de Benjamin, voir Rainer Rochlitz, Le désenchantement de l’art. La philosophie de Walter Benjamin, Gallimard, 1992, p. 61-132.
19 Voir Th. W. Adorno, Théorie esthétique, trad. M. Jimenez, Klincksieck, 1974.
20 Anne Henry, Marcel Proust. Théories pour une esthétique, Klincksieck, 1983, soutient que l’esthétique proustienne n’a pas seulement une dette à l’égard de Schopenhauer, notamment en ce qui concerne la théorie de la musique et l’idée de la fonction rédemptrice de l’art (p. 46 et s.), mais aussi à l’égard de Schelling (p. 82 et s.).
21 La théorie du « monde sans objet » de Malévitch s’inspire explicitement de la conception schopenhauerienne selon laquelle dans la vision esthétique la scission entre le sujet et l’objet n’est plus pertinente. Voir par exemple Kasimir Malévitch, La lumière et la couleur, Ed. L’Age d’Homme, 1981, p. 59-100, ainsi que les notes introductives du traducteur Jean-Claude Marcadé (p. 49 et 59).
22 Mondrian plus près de nous, et Beuys témoignent d’ailleurs encore d’une autre filiation à travers laquelle s’est transmise la philosophie romantique : celle de l’anthroposophie de Rudolph Steiner.
23 Voir à ce propos Jürgen Krause, Märtyrer und Prophet. Studien zum Nietzsche Kult in der bildenden Kunst der Jahrhundertwende, Berlin, Walter de Gruyter, 1984. L’importance de Nietzsche n’a pas été moindre dans le domaine littéraire allemand : il suffit de penser au jeune Thomas Mann ou aux poètes expressionnistes.
24 « La littérature et l’expérience originelle », texte dont on connaît l’influence multiforme sur les conceptions de la littérature en France, est un démarquage des théories heideggériennes (y compris au niveau du vocabulaire et du style). Ajoutons que par la multiplicité de ses sources (outre Heidegger et Nietzsche, il faut ajouter Novalis, Hölderlin et Rilke) et par sa cohérence interne, l’œuvre critique de Blanchot est sans conteste une des reformulations contemporaines les plus ambitieuses de la théorie spéculative de l’Art. Voir Maurice Blanchot, L’espace littéraire (1955), Gallimard, coll. « Idées », p. 279-338.
Pour citer cet article
Référence électronique
Jean-Marie Schaeffer, « La religion de l’art : un paradigme philosophique de la modernité », Revue germanique internationale [En ligne], 2 | 1994, mis en ligne le 26 septembre 2011, consulté le 06 juin 2016. URL : http://rgi.revues.org/470
Jean-Marie Schaeffer
p. 195-207
Texte intégralRésumés
FrançaisDeutschEnglish
Depuis à peu près deux siècles notre conception des arts est fondée sur une sacralisation de l’œuvre d’art : l’art est une force de révélation ontologique, une connaissance extatique qui nous « sauve » de l’existence inauthentique et aliénée qui est notre lot quotidien. Cette théorie spéculative de l’Art, développée par le romantisme en réponse à la crise de l’ontologie rationaliste provoquée par le criticisme kantien, postule une identité d’essence entre art et philosophie. Reprise et développée par les grands philosophes de la tradition idéaliste allemande, de Hegel à Heidegger, cette conception, qui dote l’art d’une fonction de compensation, s’est répandue peu à peu dans le monde de l’art et a joué un rôle central dans la logique du modernisme artistique. La crise actuelle des discours de légitimation artistique est peut-être le signe de son essoufflement historique.
PDF 897kSignaler ce documenthttps://rgi.revues.org/470https://rgi.revues.org/470https://rgi.revues.org/470https://rgi.revues.org/470
« Moeyasuku mata kieyasuki hotaru kana » (Chine, 1660-1688).
A la mémoire de Nishimura Kento.
Pour Reiko.
I
- 1 Paul Valéry, Propos sur la poésie, in Œuvres, I, Gallimard, 1957, p. 1381.
1Le 19 novembre 1937 Valéry donne une conférence intitulée Nécessité de la poésie. Il évoque ses débuts de poète à la fin du xixe siècle : « J’ai vécu dans un milieu de jeunes gens pour lesquels l’art et la poésie étaient une sorte de nourriture essentielle dont il fût impossible de se passer ; et même quelque chose de plus : un aliment surnaturel. A cette époque, nous avons eu (...) la sensation immédiate qu’il s’en fallait de fort peu qu’une sorte de culte, de religion d’espèce nouvelle, naquît et donnât forme à tel état d’esprit, quasi mystique, qui régnait alors et qui nous était inspiré ou communiqué par notre sentiment très intense de la valeur universelle des émotions de l’Art. Quand on se reporte à la jeunesse de l’époque, (...) on observe que toutes les conditions d’une formation, d’une création presque religieuse, étaient alors absolument réunies. En effet, à ce moment-là régnait une sorte de désenchantement des théories philosophiques, un dédain des promesses de la science, qui avaient été fort mal interprétées par nos prédécesseurs et aînés, qui étaient des écrivains réalistes et naturalistes. Les religions avaient subi les assauts de la critique philologique et philosophique. La métaphysique semblait exterminée par les analyses de Kant. »1
- 2 M. Arnold, The study of Poetry, reproduit dans D. J. Enright, E. de Chickera (éd.), English Critic (...)
2L’exaltation artistique décrite ici rétrospectivement par Valéry n’était pas limitée à la France symboliste. Ainsi en 1880 Matthew Arnold écrit-il dans The Study of Poetry : « L’humanité découvrira chaque jour davantage que nous devons nous tourner vers la poésie afin qu’elle interprète la vie pour nous et que nous y trouvions consolation et soutien. Sans la poésie notre science sera incomplète ; et la plupart des choses qui de nos jours passent pour être de la religion ou de la philosophie seront remplacées par la poésie. (...) Car c’est avec justesse et en toute vérité que Wordsworth appelle la poésie (...) « la respiration et l’âme supérieure de toute connaissance » : notre religion, (...) notre philosophie (...), que sont-elles sinon l’ombre, le rêve et l’illusion de la connaissance réelle ? »2
- 3 Voir Joseph Beuys et Volker Harlan : Qu’est-ce que l’art ?, L’Arche, 1992, notamment p. 20. Beuys (...)
3Valéry décrit la situation du xixe siècle finissant, mais sa référence à Kant pointe vers la fin d’un autre siècle, le xviiie. C’est à la même époque que nous renvoie Arnold, puisqu’il cite Wordsworth pour donner plus de poids à sa conception de la poésie. Ce n’est pas un hasard, car le symbolisme du xixe siècle finissant n’a fait que rejouer un drame vieux d’un siècle, celui de la révolution romantique (plus précisément du romantisme théorique de Iéna) : mêmes protagonistes (la religion, la philosophie, les sciences, l’Art — ou son paradigme idéal : la poésie), même action (crise des fondements philosophiques et plus largement spirituels), même conclusion (l’Art — ou la poésie — comme compensation). D’ailleurs l’époque symboliste n’a pas été la dernière résurgence de cette crise : les avant-gardes artistiques de la première moitié du xxe siècle en sont une manifestation non moins virulente. Et il n’est pas sûr qu’en cette fin du xxe siècle la situation ait fondamentalement changé : pour prendre un exemple particulièrement significatif, récemment encore le regretté Joseph Beuys — un des grands ancêtres de la génération artistique actuelle — a repris les théories anthroposophiques (qui elles-mêmes plongent leurs racines dans la tradition romantique) pour soutenir que l’art a une fonction religieuse et qu’il est la « production originaire », « la production de tout le reste »3.
- 4 Esthétique, Ed. Flammarion, 1979, t. I, p. 20.
- 5 M. Heidegger, L’origine de l’œuvre d’art, in Chemins qui ne mènent nulle part, Gallimard, 1962, p. (...)
4Contrairement à ce qu’il pourrait sembler, la conception en question ne saurait être réduite à une simple autoreprésentation un peu hyperbolique du monde de l’art. Nous la trouvons aussi et d’abord chez des philosophes. Ainsi chez Hegel, selon qui l’art révèle « le Divin, les intérêts les plus élevés de l’homme, les vérités les plus fondamentales de l’Esprit »4. Il est intéressant de noter que lorsqu’il expose cette thèse, dans les années 20 du xixe siècle, il ne se sent guère obligé de la légitimer : en l’avançant il se sait en accord avec la plupart de ses contemporains cultivés. Et, lorsque Martin Heidegger écrit en 1935 : « Toujours, quand l’entier de l’étant en tant que lui-même requiert la fondation dans l’ouvert, l’art parvient à son essence historiale en tant qu’instauration. Elle [= l’ouverture de l’étant] s’impose dans l’œuvre ; cette imposition est accomplie par l’art »5, il ne dit pas autre chose que Hegel un siècle avant, aux différences de vocabulaire près. Lui non plus ne se sent pas obligé de fournir une légitimation circonstanciée ; il se sait en accord, non seulement avec beaucoup de ses contemporains, mais surtout avec des prédécesseurs prestigieux : Hegel bien entendu, mais aussi déjà Hölderlin, Novalis ou le jeune Schelling, ensuite Schopenhauer ou le jeune Nietzsche. C’est qu’à l’origine la thèse fait partie d’une stratégie philosophique — mais qui s’est ensuite imposée au monde de l’art ; autant de noms allemands aussi : c’est que par son origine et par ses formulations théoriques les plus prestigieuses (et les plus influentes), il s’agit bien d’une tradition allemande — mais qui a ensuite essaimé dans toute l’Europe.
5Ce qui est en jeu dans cette tradition peut se résumer en une formule toute simple : l’art est un savoir extatique, c’est-à-dire qu’il révèle des vérités transcendantes, inaccessibles aux activités cognitives profanes. La thèse implique une sacralisation de l’art qui, de ce fait, se trouve opposé aux autres activités humaines considérées comme intrinsèquement aliénées. Elle présuppose aussi une théorie de l’être : si l’art est un savoir extatique, c’est qu’il existe deux sortes de réalité, celle, apparente, à laquelle l’homme a accès à l’aide de ses sens et de son intellect raisonneur, et celle, cachée, qui ne s’ouvre qu’à l’art (et éventuellement, la philosophie). Enfin, elle s’accompagne d’une conception spécifique du discours sur les arts : il doit fournir une légitimation philosophique de la fonction extatique de l’art. Ce qui revient à dire que l’art, lui, doit se légitimer philosophiquement.
- 6 Heidegger, par exemple, limitera sa conception de la poésie à ce qu’il appelle « le poème valide » (...)
6La théorie spéculative de l’Art — c’est le nom qu’on peut donner à cette conception — combine donc une thèse objectale (concernant les arts) avec une thèse méthodologique (concernant l’étude des arts). Théorie spéculative, parce dans les formes diverses qu’elle revêt au fil du temps elle est toujours déduite d’une métaphysique générale (qu’elle soit systématique, généalogique ou existentielle) qui fonde ce qui est en réalité non pas une définition descriptive mais une définition évaluative des arts (puisque les œuvres doivent se légitimer philosophiquement)6 ; théorie de l’Art, avec un grand A, parce que au-delà des œuvres et des genres, elle projette une entité transcendante censée fonder la diversité des pratiques artistiques et dont le représentant paradigmatique est en général l’art verbal, la poésie.
II
7Lorsqu’elle naît à la fin du xviiie siècle, la théorie spéculative de l’Art est d’abord et avant tout la réponse à une double crise spirituelle, celle des fondements religieux de la réalité humaine et celle des fondements transcendants de la philosophie. Les deux crises sont liées aux Lumières et elles atteignent leur apogée — intellectuelle — en Allemagne avec le criticisme kantien. La réponse à cette double crise sera ce qu’on appelle la « révolution romantique » : c’est elle qui est à l’origine de la théorie spéculative de l’Art et qui va donc déterminer pour une large part l’auto-représentation de la Modernité artistique.
8La révolution romantique est le lieu d’un bouleversement fondamental, d’un changement radical dans la façon de concevoir le monde et le rapport de l’homme à ce monde, ceci au niveau de la sensibilité la plus individuelle et la plus privée aussi bien qu’à celui de la vision globale de l’existence humaine. Ce bouleversement se condense certes dans le domaine esthétique, mais c’est à son caractère généralisé que la révolution romantique doit d’être une étape majeure dans l’histoire de la culture occidentale, au même titre que la Renaissance ou l’âge des Lumières.
- 7 Friedrich Schlegel a ainsi mené pendant longtemps la vie instable et aléatoire d’un écrivain « lib (...)
- 8 Voir Novalis, Schriften, ed. P. Kluckhohn et R. Samuel, Stuttgart, Kohlhammer Verlag, t. II, 1960, (...)
- 9 Voir H. W. Kuhn, Der Apokalyptiker und die Politik. Studien zur Staatsphilosophie des Novalis, Fre (...)
9Certes, sa naissance résulte de la conjugaison de multiples facteurs sociaux, politiques et intellectuels. Ainsi, elle est sans doute liée notamment à l’émancipation des artistes, c’est-à-dire à l’introduction de plus en plus manifeste de la logique du marché dans la circulation de la culture artistique et littéraire7 : le remplacement des liens de dépendance personnelle par la sanction anonyme et imprévisible du marché devait amener fatalement les artistes et écrivains à se poser des questions sur le statut de leur activité. La Révolution française est un autre facteur important : l’éclatement des structures féodales qu’elle accélère, d’abord salué puis très vite déploré par les romantiques allemands, n’est pas pour rien dans la double caractéristique paradoxale qui caractérise leurs textes, à savoir une célébration du subjectivisme le plus radical combinée à une nostalgie, de plus en plus envahissante, déplorant la destruction des structures sociales intégrées, réputées « organiques ». Lorsque Novalis, dans l’envol mystique de Foi et amour (1798), encense le jeune couple royal de Prusse, ou lorsque, dans La chrétienté et l’Europe (1800), il se fait le chantre de l’Eglise du Moyen Age et de la Contre-Réforme, l’homme qui parle est le même que celui qui dans ses fragments littéraires défend les conceptions poétologiques les plus innovatrices8. Sa conception radicale de la poésie va de pair avec une théorie sociale dont on a pu dire que non seulement elle était conservatrice, mais encore que par son culte de l’unité, de l’Etat et de la hiérarchie elle annonçait les idéologies totalitaires du xxe siècle9.
10Tous ces facteurs ont un même centre secret, qui est double : d’une part l’expérience d’une désorientation existentielle, sociale, politique, culturelle et religieuse, d’autre part la nostalgie irrépressible d’une (ré)intégration harmonieuse et organique de tous les aspects d’une réalité désormais vécue comme discordante, dispersée et désenchantée. Car, le maître-mot de l’idéologie romantique est sans conteste la notion d’« Unité ». Elle n’est pas conçue comme un principe abstrait, mais comme une force vivante et vivifiante, âme d’un Univers organique où tout est vie. En fait, elle est de nature théologique : les vicissitudes des errances intellectuelles de Friedrich Schlegel à travers le panthéisme antique, le spinozisme puis le catholicisme sont révélatrices non pas tant dans ce qui les distingue, mais dans ce qui les unit, à savoir l’exigence d’une vision théologique de l’Univers. S’il est vrai que le romantisme est une religion de l’art, il est tout autant la théorie d’un art théologique : la sacralisation de l’art est indissociable de sa fonction religieuse.
11Cette obsession de l’Unité est profondément philosophique et théologique, et c’est bien primordialement ainsi qu’elle est problématisée par Friedrich Schlegel, Novalis, ou encore Hölderlin et — bien entendu — les têtes pensantes de l’idéalisme objectif, Schelling et Hegel. On touche ici à la motivation la plus profonde de la révolution romantique (et idéaliste) : la crise de l’ontologie philosophique et de la théologie rationnelle — « déconstruites » de manière radicale par Kant. Autrement dit, la naissance de la théorie spéculative de l’Art est bien la réponse à un problème philosophico-théologique : comment sauver l’accès à l’Etre absolu et à un fondement ultime de la réalité, alors que le criticisme vient de verrouiller l’ontologie et de limiter le domaine du savoir aux formes et catégories subjectives ainsi qu’aux objets phénoménaux, la question de l’hen kai pan — de l’être et de Dieu — n’ayant plus que le statut d’une Idée de la raison, inaccessible à toute spéculation théorique.
- 10 Schriften, III, p. 527.
- 11 Ibid., p. 396.
- 12 Ibid., p. 406. Dans le même fragment Novalis qualifie de « penseur goethéen » cette union du poète (...)
12D’une certaine manière, le romantisme accepte ce verdict kantien : en effet la thèse philosophique centrale des romantiques de Iéna (mais aussi du jeune Schelling) est l’idée que la philosophie est un discours impossible : elle ne saurait être le lieu d’épanouissement de l’onto-théologie. Mais ils ont une solution de rechange, qui n’est autre chose que la théorie spéculative de l’Art, c’est-à-dire la thèse que c’est la poésie, et plus généralement l’Art, qui va remplacer le discours philosophique défaillant. Ainsi Novalis dira : « La forme accomplie des sciences doit être poétique »10, et « Toute science devient poésie — après être devenue philosophie »11. Ce passage qui mène des sciences à la philosophie et enfin à la poésie est le passage du discours comme représentation (et donc comme séparé de ce qu’il représente) à la création pure, absolument libre : « L’art de la poésie n’est sans doute rien d’autre que l’usage gratuit, actif, productif de nos organes — et il se pourrait que la pensée ne fût pas autre chose — en sorte que la pensée et la poésie seraient une seule et même chose (...). »12 Ainsi la poétisation de la philosophie se ramène à l’idée d’une pensée absolument libre, c’est-à-dire non dépendante de quelque impression sensible qui s’imposerait à nous de l’extérieur et qui échapperait à notre juridiction — autrement dit, la poésie réalise l’intuition intellectuelle de l’hen kai pan désormais interdite à la discursivité philosophique.
- 13 Voir Friedrich Schlegel, Kritische Ausgabe, Paderborn, Schöningh Verlag, 1959, t. III, p. 99.
13On le voit, cet apparent congé donné au discours philosophique est paradoxalement l’œuvre d’une variante de ce même discours philosophique. C’est que l’impulsion philosophique romantique est bicéphale, distendue entre un héritage méthodologique, qui, lui, reste criticiste, et la nouvelle ontologie théologique. Les deux impulsions se situent à des niveaux différents : l’ontologie théologique fonctionne comme une vérité évidente dont la nature discursive est du même coup méconnue ; la méthodologie criticiste quant à elle est censée représenter la discursivité philosophique comme telle. L’ontologie moniste (l’Univers conçu comme hen kai pan) fonctionne comme pôle référentiel « naturalisé » qui est vécu comme non énonçable dans l’horizon de la discursivité philosophique commandée par le dualisme du sujet et de l’objet, et donc par l’impossibilité d’énoncer leur unité absolue. Friedrich Schlegel, par exemple, exprime cette non-coïncidence entre le contenu idéal de la philosophie et sa forme discursive en distinguant entre l’esprit philosophique et sa lettre — lettre toujours déchue par rapport à l’esprit qu’elle veut incarner13. Novalis de son côté, s’inspirant largement des théories néo-platoniciennes, affirme que la réalité fondamentale est accessible uniquement à travers une extase qui échappe à la discursivité rationnelle, puisque cette dernière présuppose toujours la dualité entre un sujet qui énonce et un objet sur lequel porte renonciation. Seule la création poétique accède à une contemplation extatique dans laquelle le poète est à la fois sujet et objet, moi et monde.
III
- 14 La conception que Nietzsche défend dans les écrits de sa « maturité » est plus complexe, puisqu’il (...)
14Il ne faudrait pas sous-estimer la spécificité du romantisme par rapport aux développements philosophiques ultérieurs de la théorie spéculative de l’Art. Elle réside dans le double agencement dont j’ai parlé : non seulement l’Art est doté d’une fonction ontologique, mais encore il est la seule présentation possible de l’ontologie, de la métaphysique spéculative. En effet, sur ce point précis, les philosophes succédant aux romantiques ne seront pas tous d’accord (ils se différencient en cela des artistes : comme en témoignent les textes de Valéry et de Arnold cités en ouverture, les artistes ont tendance à reprendre la position romantique, c’est-à-dire à verser la philosophie plutôt du côté de la doxa, ou du moins de la placer en-dessous de l’art). Ainsi Schelling et Hegel, après avoir partagé dans leur jeunesse la conception romantique d’un dépassement de la philosophie par l’Art, réinstaureront très vite la philosophie dans ses droits spéculatifs. Dans l’Esthétique de Hegel par exemple, l’Art est appelé à être dépassé par la philosophie, figure ultime de l’Esprit : d’où la thèse de la fin de l’art. Il n’en continuera pas moins à être investi d’une fonction de révélation ontologique, simplement son rapport au discours philosophique sera pensé différemment. Cette solution idéaliste sera d’ailleurs à son tour remise en question : Schopenhauer, Nietzsche ou Heidegger reprendront à nouveaux frais le problème de la relation hiérarchique entre l’Art et la philosophie. Le jeune Nietzsche par exemple retrouvera en gros les positions romantiques, c’est-à-dire qu’il réservera la révélation ontologique ultime à l’art (dans sa forme dionysiaque)14, alors que Heidegger postulera un dialogue entre les deux activités.
15Un des aspects les plus fascinants de la théorie spéculative de l’Art réside dans sa capacité de survivre à l’abandon de l’onto-théologie romantique, donc de continuer à se développer même en l’absence des racines théologiques qui seules pourtant semblent pouvoir la doter d’une certaine plausibilité : n’est-il pas étonnant de voir Nietzsche, esprit pourtant sceptique à l’égard de tous les « arrière-mondes », ou Heidegger, penseur de la finitude de l’homme, reprendre les théorèmes centraux d’une conception de l’Art qui ne saurait avoir de sens qu’à l’intérieur d’une vision positivement théologique de l’être ? En fait, sa survivance à l’intérieur d’une tradition philosophique qui sur bien des points rejette le spiritualisme romantique est moins paradoxale qu’il n’y paraît : l’Art continue à avoir une fonction compensatoire, même lorsque ses relations avec la philosophie sont moins conflictuelles que chez les romantiques. Car, s’il est vrai qu’avec l’idéalisme objectif la philosophie reprend le flambeau de l’Absolu en sorte que l’Art ne doit plus remplacer la philosophie, le discours en doxique (notamment la science) et la réalité commune continueront à être des figures du désenchantement et de l’aliénation — autrement dit, la motivation profonde ayant donné naissance à la théorie spéculative de l’Art continuera à être agissante. Ainsi l’art sera toujours censé contrebalancer l’invasion de la culture moderne par les savoirs scientifiques : l’idéalisme objectif de Schelling et de Hegel, le pessimisme gnoséologique de Schopenhauer, le vitalisme du jeune Nietzsche ou l’existentialisme heideggérien s’opposent tous explicitement au discours scientifique « positiviste » et tentent de le dévaloriser. La compensation s’exerce aussi à l’égard de la réalité quotidienne, sociale, historique : si pour Novalis la poésie devait « romantiser » la vie, Hegel soutiendra que l’Art réalise la relève de l’étantité empirique dans l’Idéal ; pour le jeune Nietzsche, lecteur de Schopenhauer, l’art dionysiaque déchire le voile de la maya et nous délivre de la tyrannie de la Volonté ; chez Heidegger la poésie nous pousse hors de notre être-là inauthentique vers une écoute du « dict » de l’être. On voit bien que ce qui unifie toutes ces figures, au-delà de leurs différences indéniables, est toujours de l’ordre de la nostalgie d’une vie « authentique », non désacralisée et non aliénée.
- 15 Ainsi chez Pindare nous lisons : « Prophétise Muse, et je serai ton interprète » (fr. 137, reprodu (...)
16Bien entendu, la sacralisation, sinon de l’Art, du moins de la poésie, n’est pas une invention romantique : la figure du poète comme interprète de la voix mantique, comme prophète ou vates, donc comme intermédiaire entre la parole divine et les hommes, se trouve déjà chez certains auteurs grecs ou latins, à commencer par Pindare, Démocrite et Platon. Elle sera d’ailleurs reprise par le christianisme naissant, le topos de l’invocation des Muses étant remplacé par une invocation à Dieu : sous cette forme, la thèse de la fonction médiatrice de la poésie resurgira de temps en temps au Moyen Age. Quant à la Renaissance, on sait avec quelle force elle réactivera la figure antique du poète inspiré par les Muses15.
17Cela dit, il existe une différence abyssale entre la révolution romantique et les sacralisations antérieures de la poésie. D’une part, l’exaltation romantique de la poésie s’insère dans une perspective entièrement commandée par une ontologie théologique dont la présentation est exigée alors même qu’elle est déclarée impossible à l’intérieur de la discursivité philosophique. Elle est la réponse à une crise philosophique, et plus largement existentielle, ce qui n’est pas le cas au Moyen Age. En deuxième lieu, la sacralisation de la poésie, sa détermination comme species divina loquendi est mise en avant dans un contexte historique qui, lui, est largement désacralisé, ce qui en change totalement la portée et interdit notamment qu’elle soit référée à une fonction institutionnellement liturgique (si l’on excepte les Chants spirituels de Novalis qui font effectivement partie intégrante de la musique sacrée luthérienne). Nous retrouvons ici la caractéristique fondamentale de la sacralisation romantique de la poésie : elle remplit une fonction compensatoire face à la crise du Weltbild — et notamment de la théologie et métaphysique dogmatiques — induite par les Lumières, fonction absente chez les défenseurs antérieurs de la poésie, par exemple ceux du Moyen Age latin (pour qui il s’agissait certes de se hisser au même niveau que la philosophie dans la hiérarchie des sept arts, mais ceci dans le cadre d’une vision théologique du monde jamais mise en question).
IV
18Si la théorie spéculative de l’Art n’était qu’une tradition philosophique locale, l’intérêt de son étude actuelle serait sans doute limité. Mais on sait qu’elle a investi de larges secteurs du monde de l’art occidental du xixe et du xxe siècle et que ce faisant elle a pour une large part influencé — et déformé, ajouterai-je pour ma part — la manière dont nous voyons les arts. L’histoire de cet étonnant succès reste à écrire, et je devrai me contenter ici en guise de conclusion de quelques indications dispersées.
- 16 Runge a développé une métaphysique des couleurs, dans laquelle les trois « couleurs originaires » (...)
- 17 Les filiations sont souvent complexes : la théorie romantique de l’imagination, par exemple, passe (...)
19Le romantisme occupe bien entendu une place à part, puisqu’il a été, de naissance, à la fois une théorie philosophique et une autoreprésentation du monde artistique ; si les frères Schlegel ne sont que des poètes occasionnels et médiocres, Novalis est un bon poète, alors que Hölderlin, autre chantre de la religion esthétique, est un des plus grands poètes, non seulement allemands mais européens. En fait, la plupart des grands acteurs du romantisme allemand sont bicéphales : ainsi les peintres Runge et Carus sont des penseurs romantiques tout autant que des artistes16. Par ailleurs, la plupart, sinon tous les mouvements romantiques européens, empruntent leur bagage théorique aux Allemands, essentiellement aux frères Schlegel et à Schelling : Mme de Staël pour l’Europe entière, Coleridge pour l’Angleterre, Victor Cousin pour la France, Manzoni pour l’Italie sont parmi les médiateurs essentiels. De ce fait, la théorie spéculative de l’Art s’est étendue en même temps que le romantisme européen et on la retrouve, sous une forme plus ou moins abâtardie, chez la plupart des artistes romantiques17. Encore l’influence directe du romantisme théorique sur les arts et sur la réflexion artistique ne cesse-t-elle pas avec la fin des mouvements romantiques : Arnold (comme nous avons pu le voir), plus tard les écrivains de l’expressionisme allemand ou Rilke, encore plus près de nous Maurice Blanchot — autant d’écrivains et de critiques qui se ressourceront directement aux écrits des Iénaens.
- 18 A propos de Benjamin, voir Rainer Rochlitz, Le désenchantement de l’art. La philosophie de Walter (...)
- 19 Voir Th. W. Adorno, Théorie esthétique, trad. M. Jimenez, Klincksieck, 1974.
20Le destin historique de l’esthétique hégélienne a été différent : son influence directe sur la vie artistique de son époque a certainement été plus faible que celle du mouvement romantique ; mais à travers son rayonnement universitaire (qui continue de nos jours) et à travers le marxisme, l’effet à retardement de ses conceptions n’en a été que plus grand. Que l’esthétique hégélienne ait souvent attiré les professeurs n’est pas étonnant : après tout, elle est un exposé universitaire et sa charpente systématique — son caractère clos et « complet » — en font un cursus commode. Quant au marxisme, aussi étrange que cela puisse paraître, vu le déterminisme sociologique très cru qu’il professe en général, il a réussi à développer sa propre variante de la théorie spéculative : l’Art (ou du moins le « grand Art », c’est-à-dire l’art du passé ainsi que l’art réaliste-socialiste) est supposé dévoiler la réalité sociale ultime du monde humain. On connaît la fortune historique de l’affirmation d’Engels selon laquelle les œuvres de Balzac dévoilent de manière impitoyable la structure de la société de l’époque : à son corps défendant Balzac montre le caractère inéluctable du triomphe (provisoire) de la bourgeoisie et la faillite historique de l’aristocratie, classe à laquelle allaient pourtant ses sympathies. Il faut ajouter que la sacralisation de l’art se retrouve aussi — et avec bien plus de force — chez les marxistes critiques, par exemple chez Benjamin18 ou Adorno. La Théorie esthétique d’Adorno, une des défenses les plus émouvantes et les plus courageuses de la tradition artistique moderniste, est aussi une reformulation ambitieuse de la théorie spéculative dans la perspective de la « dialectique négative ». La fonction compensatoire de l’Art y est particulièrement forte : l’Art est « l’écriture inconsciente de l’histoire », protestation irréductible contre une réalité globalement mauvaise, mais aussi promesse d’une réconciliation utopique. En fait, Adorno reprend la plupart des thèmes de la tradition spéculative. Il défend notamment une conception très radicale de la réductibilité des arts à leur « vérité » philosophique : « La philosophie et l’art convergent dans leur contenu de vérité : la vérité de l’œuvre d’art qui se déploie progressivement n’est pas autre chose que celle du concept philosophique (...) Le contenu de vérité des œuvres n’est pas ce qu’elles signifient, mais ce qui décide de la fausseté ou de la vérité de l’œuvre en soi ; seule cette vérité de l’œuvre en soi est commensurable à l’interprétation philosophique et coïncide, tout au moins quant à l’idée, avec la vérité philosophique (...) la véritable expérience esthétique doit devenir philosophie ou bien elle n’existe pas. »19
- 20 Anne Henry, Marcel Proust. Théories pour une esthétique, Klincksieck, 1983, soutient que l’esthéti (...)
- 21 La théorie du « monde sans objet » de Malévitch s’inspire explicitement de la conception schopenha (...)
21L’influence de Schopenhauer sur l’esthétique moderne est généralement sous-estimée, notamment en France où, pour des raisons complexes, ce philosophe a souvent mauvaise presse, s’il n’est pas tout simplement méprisé. De ce fait, on oublie trop facilement que durant la deuxième moitié du xixe siècle, alors même que Hegel sombrait dans un oubli temporaire, la philosophie schopenhauerienne a entrepris une triomphale carrière européenne. Or, le pessimisme schopenhauerien est inconcevable sans la compensation que procure l’extase esthétique, véritable rédemption qui permet à l’homme d’échapper aux malheurs de la volonté de vivre : aussi n’est-ce pas un hasard si c’est surtout l’idée du salut par l’art qui a retenu l’attention des lecteurs et plus généralement du public. Ainsi les thèses centrales de son esthétique se retrouvent-elles chez certains des artistes les plus importants de la deuxième moitié du xixe et du début du xxe siècle : chez Wagner, bien entendu, mais aussi chez Huysmans, Gauguin et les Nabis, Proust20 ou encore Malévitch21. On ne saurait donc surestimer l’importance historique prodigieuse qui a été celle de la variante schopenhauerienne de la sacralisation de l’Art.
- 22 Mondrian plus près de nous, et Beuys témoignent d’ailleurs encore d’une autre filiation à travers (...)
- 23 Voir à ce propos Jürgen Krause, Märtyrer und Prophet. Studien zum Nietzsche Kult in der bildenden (...)
22Dans un premier temps, l’influence de Nietzsche a prolongé celle de Schopenhauer, mais sa réinterprétation affirmative de la notion de volonté creusera vite un fossé entre sa théorie de l’Art de celle de son maître. Son esthétique de la volonté de puissance jouera un rôle central dans la plupart des mouvements d’avant-garde du début du siècle : l’activisme artistico-politique de l’expressionnisme, du futurisme, du néoplasticisme ou encore du constructivisme doit beaucoup à la conception nietzschéenne de l’Art comme expression d’une force vitale élémentaire. A des degrés divers, on retrouve ainsi l’héritage nietzschéen, explicite ou implicite, chez Le Corbusier, van Doesburg, Mondrian22, les représentants du Bauhaus, Mies van der Rohe, etc23. L’idée, si centrale dans les projets des avant-gardes des années 20, d’une esthétisation de la réalité, découle, elle aussi, au moins en partie, de la théorie nietzschéenne de la volonté de puissance, réinterprétée comme « volonté de forme ».
23Cela dit, le lien des mouvements d’avant-garde avec la tradition de la théorie spéculative de l’Art ne saurait être limité à l’influence nietzschéenne. Leur impulsion utopique fondamentale, à la fois d’ordre spirituel et esthétique, réactualise tout autant le moment originaire de la sacralisation de l’Art, à savoir les rêves du romantisme iénaen : le projet même d’une avant-garde artistique, projet éminemment historiaste, voire eschatologique, plonge ses racines au plus profond de la tradition que nous avons analysée. Le messianisme utopique est en effet indissociable des variantes les plus radicales de la théorie spéculative de l’Art. J’ai dit que le culte romantique de l’Unité était celui d’une Unité défaillante, d’une Unité à (r)établir : grâce à la doctrine historiciste, l’histoire se transforme en cheminement vers le Salut. Les avant-gardes artistiques du xxe siècle reprennent le même schéma historiciste, simplement ils remplacent le Salut religieux par celui du communisme (les avant-gardes russes et allemandes par exemple) ou du fascisme (les futuristes italiens).
- 24 « La littérature et l’expérience originelle », texte dont on connaît l’influence multiforme sur le (...)
24Quant à Heidegger, le dernier en date des grands théoriciens de la théorie spéculative de l’Art, il est sans doute inutile, du moins en France, de rappeler son importance dans la réflexion actuelle sur les arts et notamment sur la poésie. Son influence passe à la fois directement à travers ses écrits, mais tout autant, sinon plus, à travers la reprise de ses idées par des philosophes (le déconstructivisme de Derrida exacerbe l’idée heideggérienne d’un dialogue entre la pensée et l’Art) mais aussi par des écrivains — tel Maurice Blanchot24 — ou des poètes — tel René Char.
25On pourrait allonger indéfiniment cette liste des artistes et auteurs du xxe siècle qui se situent dans la descendance de la théorie spéculative de l’Art. Mais je voulais simplement montrer que la sacralisation de la poésie et de l’Art a peu ou prou teinté une grande partie de la vie artistique et littéraire moderne et moderniste, constituant en quelque sorte l’horizon d’attente esthétique du monde de l’art occidental depuis bientôt deux cents ans. La confusion et le désenchantement, qu’on dit régner dans le domaine de la création et de la pensée artistiques et critiques depuis une dizaine d’années, ne sont peut-être que des signes de la lente agonie de ce paradigme spéculatif de l’Art et de la difficulté que nous rencontrons à le remplacer par une nouvelle vision des arts qui rende justice à leur importance humaine sans verser dans l’exaltation philosophico-mystique qui a accompagné leur destin moderniste.
Notes
1 Paul Valéry, Propos sur la poésie, in Œuvres, I, Gallimard, 1957, p. 1381.
2 M. Arnold, The study of Poetry, reproduit dans D. J. Enright, E. de Chickera (éd.), English Critical Texts, Oxford UP, 1962, p. 260-261.
3 Voir Joseph Beuys et Volker Harlan : Qu’est-ce que l’art ?, L’Arche, 1992, notamment p. 20. Beuys et Harlan vont jusqu’à reprendre la théologie schlégelienne de la nouvelle mythologie (exposée dans l’Entretien sur la poésie de 1800), affirmant : « Le mythique devrait, après transformation, être intégré dans la pensée moderne et consciente d’elle-même de l’individu libre » (Beuys) et «... la peinture future peut fonder une sorte de nouvelle mythologie » (Harlan, op. cit., p. 153 et 218).
4 Esthétique, Ed. Flammarion, 1979, t. I, p. 20.
5 M. Heidegger, L’origine de l’œuvre d’art, in Chemins qui ne mènent nulle part, Gallimard, 1962, p. 68 ( = Der Ursprung des Kunstwerkes, in Holzwege, Francfort-sur-le-Main, V. Klostermann Verlag, 6e éd., 1980, p. 63).
6 Heidegger, par exemple, limitera sa conception de la poésie à ce qu’il appelle « le poème valide » (das gültige Gedicht), c’est-à-dire en fait le poème qui se prête à une traduction philosophique : d’où le privilège qu’il accorde à Hölderlin, poète-philosophe par excellence. Adorno de son côté — et malgré son rejet de Heidegger — le rejoindra sur ce point, lorsqu’il dira que la philosophie et l’art convergent dans leur contenu de vérité.
7 Friedrich Schlegel a ainsi mené pendant longtemps la vie instable et aléatoire d’un écrivain « libre » avec le manque de sécurité financière et statutaire qui est lié à cette activité. N’oublions pas non plus que la grande aventure éditoriale du romantisme de Iéna, la revue Athenaeum, a été interrompue en 1800 pour des raisons essentiellement financières, liées au manque à gagner de l’éditeur commercial. Voir à ce propos la postface de E. Behler à la réimpression des livraisons de la revue romantique, dans Athenaeum. Eine Zeitschrift, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1973, t. III, p. 5-64.
8 Voir Novalis, Schriften, ed. P. Kluckhohn et R. Samuel, Stuttgart, Kohlhammer Verlag, t. II, 1960, p. 485-499 et t. III, 3e éd., 1983, p. 507-524.
9 Voir H. W. Kuhn, Der Apokalyptiker und die Politik. Studien zur Staatsphilosophie des Novalis, Freiburg, 1961, p. 150, et F. C. Snell, Die Tragödie des deutschen Liberalismus, Stuttgart, 1953, p. 53 et s.
10 Schriften, III, p. 527.
11 Ibid., p. 396.
12 Ibid., p. 406. Dans le même fragment Novalis qualifie de « penseur goethéen » cette union du poète et du philosophe.
13 Voir Friedrich Schlegel, Kritische Ausgabe, Paderborn, Schöningh Verlag, 1959, t. III, p. 99.
14 La conception que Nietzsche défend dans les écrits de sa « maturité » est plus complexe, puisqu’il y rejette le fondement ontologique sur lequel s’est élevé la théorie spéculative de l’Art. Ne pouvant l’analyser ici, je renvoie à L’art de l’âge moderne, p. 289-296.
15 Ainsi chez Pindare nous lisons : « Prophétise Muse, et je serai ton interprète » (fr. 137, reproduit dans D. A. Russell et M. Winterbottom (éd.), Ancient Literary Criticism, Oxford Uni-versity Press, 1972, p. 4). Ou encore chez Démocrite : « Tout ce que le poète écrit en étant possédé (enthousiasmas) et sous inspiration (pneuma) divine est beau », fr. B 18 dans Diels/Kranz, Fragmente der Vorsokratiker, Weidmannsche Verlagsbuchhandlung, Berlin, 1960, t. 2, p. 146. Les passages de Platon (dans l’Ion et le Phèdre) sont trop célèbres pour qu’on les reproduise ici. Notons simplement que dans l’Ion il compare explicitement l’inspiration poétique aux délires des Corybantes et aux Bacchantes et affirme que la Divinité, leur ayant ravi l’esprit, les fait vaticiner et les transforme en devins (Ion, 534). Mais cette valorisation des poètes est très ambiguë, puisqu’elle permet en même temps à Platon de leur dénier toute technè, tout art. Pour le Moyen Age, voir P. Klopsch, Einführung in die Dichtungslehren des lateinischen Mittelalters, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1980, p. 20-36, et E. R. Curtius, La littérature latine et le Moyen Age latin, PUF, 1956, t. 1, notamment p. 343 et s.
16 Runge a développé une métaphysique des couleurs, dans laquelle les trois « couleurs originaires » (Urfarben) sont des analogues de la Trinité ; quant à Carus, il soutient que la beauté (visuelle) est « le sentiment (Empfindung) de la présence de l’être divin dans la nature, et ceci de la même manière que la vérité est la connaissance de cet être divin » (Neun Briefe über Landschaftsmalerei, cité d’après Gerard Eimer, Caspar David Friedrich. Auge und Landschaft, Insel Verlag, 1974, p. 172).
17 Les filiations sont souvent complexes : la théorie romantique de l’imagination, par exemple, passe de Coleridge (Biographia Literaria) à Poe (voir notamment « The Poetic Principie »), puis de celui-ci à Baudelaire (voir les « Notes nouvelles » précédant la traduction des Nouvelles Histoires extraordinaires).
18 A propos de Benjamin, voir Rainer Rochlitz, Le désenchantement de l’art. La philosophie de Walter Benjamin, Gallimard, 1992, p. 61-132.
19 Voir Th. W. Adorno, Théorie esthétique, trad. M. Jimenez, Klincksieck, 1974.
20 Anne Henry, Marcel Proust. Théories pour une esthétique, Klincksieck, 1983, soutient que l’esthétique proustienne n’a pas seulement une dette à l’égard de Schopenhauer, notamment en ce qui concerne la théorie de la musique et l’idée de la fonction rédemptrice de l’art (p. 46 et s.), mais aussi à l’égard de Schelling (p. 82 et s.).
21 La théorie du « monde sans objet » de Malévitch s’inspire explicitement de la conception schopenhauerienne selon laquelle dans la vision esthétique la scission entre le sujet et l’objet n’est plus pertinente. Voir par exemple Kasimir Malévitch, La lumière et la couleur, Ed. L’Age d’Homme, 1981, p. 59-100, ainsi que les notes introductives du traducteur Jean-Claude Marcadé (p. 49 et 59).
22 Mondrian plus près de nous, et Beuys témoignent d’ailleurs encore d’une autre filiation à travers laquelle s’est transmise la philosophie romantique : celle de l’anthroposophie de Rudolph Steiner.
23 Voir à ce propos Jürgen Krause, Märtyrer und Prophet. Studien zum Nietzsche Kult in der bildenden Kunst der Jahrhundertwende, Berlin, Walter de Gruyter, 1984. L’importance de Nietzsche n’a pas été moindre dans le domaine littéraire allemand : il suffit de penser au jeune Thomas Mann ou aux poètes expressionnistes.
24 « La littérature et l’expérience originelle », texte dont on connaît l’influence multiforme sur les conceptions de la littérature en France, est un démarquage des théories heideggériennes (y compris au niveau du vocabulaire et du style). Ajoutons que par la multiplicité de ses sources (outre Heidegger et Nietzsche, il faut ajouter Novalis, Hölderlin et Rilke) et par sa cohérence interne, l’œuvre critique de Blanchot est sans conteste une des reformulations contemporaines les plus ambitieuses de la théorie spéculative de l’Art. Voir Maurice Blanchot, L’espace littéraire (1955), Gallimard, coll. « Idées », p. 279-338.
Pour citer cet article
Référence électronique
Jean-Marie Schaeffer, « La religion de l’art : un paradigme philosophique de la modernité », Revue germanique internationale [En ligne], 2 | 1994, mis en ligne le 26 septembre 2011, consulté le 06 juin 2016. URL : http://rgi.revues.org/470
 Re: Forum Religion et Art
Re: Forum Religion et Art
L'art et la vie spirituelle.
Par Urgyen Sangharakshita.
(1/8) >
« L'art est l'organisation d'impressions sensorielles qui exprime la sensibilité de l'artiste et communique à son public un sens des valeurs qui peut changer leur vie ». A l'aide de sa propre définition, Sangharakshita explore la pertinence de l'art et de l'artiste pour l'évolution personnelle et spirituelle de l'homme.

Le Bouddha, par Odilon Redon
Par « art » nous entendons tous les arts. Nous prenons ce terme pour couvrir la peinture, la sculpture, la poésie, la musique, l'architecture, etc. Et par « vie spirituelle » nous entendons tout le processus de l'évolution supérieure. A ce propos, je dois avouer que je ne suis pas très heureux avec ce mot, « spirituel ». Quand j'étais en train de noter la liste des titres pour ces lectures, j'ai beaucoup hésité avant d'écrire ce mot, spirituel, et l'art et la vie spirituelle, parce que je sais que pour beaucoup de gens le mot spirituel a une mauvaise connotation. Quand on parle de vie spirituelle, les gens commencent à penser aux esprits, au spiritisme, aux tables tournantes, aux voix de l'au-delà, aux formes et aux apparitions. Alors, je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'il vaut mieux éviter le mot spirituel. Mais malheureusement, il n'y a pas dans le langage courant de terme équivalent à ce mot, « spirituel ». J'ai pensé que peut-être nous pourrions commencer à populariser le terme « méta-biologique », que j'ai déjà utilisé. Je sais que c'est un peu long, méta-biologique, mais au moins cela a le mérite de couvrir toutes les manifestations supérieures de l'esprit humain : non seulement l'art, mais aussi la religion et la philosophie.
Donc, quand nous parlons de l'art et de la vie spirituelle, ou de l'art et de l'évolution supérieure, nous ne suggérons pas que ce soient vraiment deux choses séparées. Ce n'est pas que vous avez l'art d'un côté et la vie spirituelle de l'autre, l'art ici et la vie spirituelle là, unis plutôt superficiellement par ce petit mot, « et ». Ce n'est pas que l'art et la religion soient dans une relation superficielle. On peut même aller jusqu'à dire que l'art est inclus dans la vie spirituelle, que les arts sont juste un aspect particulier de l'évolution supérieure, ou une manifestation de celle-ci. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que l'on ne peut pas vivre une vie spirituelle, que l'on ne peut pas participer à l'évolution supérieure de l'humanité, sans être artiste. Cela ne veut pas dire ça ; mais cela veut dire qu'on ne peut pas être un artiste sans participer au même temps à la vie spirituelle, à l'évolution supérieure. Dans la mesure où l'on est artiste, où l'on est un véritable artiste, un artiste authentique, de n'importe quelle discipline, on participe à l'évolution supérieure de l'homme.
Maintenant, je suis sûr que cette idée n'est pas évidente pour la plupart des gens. On pourrait la voir comme une glorification inutile de l'artiste, et même on pourrait ne pas être d'accord du tout. Nous savons que généralement les gens n'ont que peu d'estime pour l'art et pour l'artiste. En vérité, ils ne les considèrent pas trop, pas en comparaison avec d'autres choses vraiment importantes, d'autres activités réellement importantes. Beaucoup de gens ont tendance à avoir un regard méprisant sur les arts et sur l'artiste, et à penser que l'artiste s'occupe de choses plutôt triviales, et pas du « vrai travail d'homme ». Dans ce contexte, je me souviens d'une petite histoire, provenant je crois de l'autobiographie de Sir Osbert Sitwell, qui est une longue œuvre en plusieurs tomes, très longue, mais qui contient quelques très bonnes histoires très bien racontées. Peut-être savez-vous que les Sitwell étaient une de ces très très brillantes familles dans laquelle pratiquement chacun semble être un génie ; tous vos frères, sœurs, tantes, cousins, oncles etc. sont des génies - cela doit être une manière merveilleuse de grandir. Vous avez donc Osbert et Sacheverell et la célèbre Edith, vivant tous ensemble, quand ils étaient jeunes, dans cette vaste et vielle demeure familiale délabrée ; l'un vit dans une aile, l'autre dans une autre aile, séparés par un kilomètre de couloirs, et avec beaucoup de domestiques. Alors, relate Osbert Sitwell, un beau matin il voulait communiquer avec sa sœur Edith dans son aile à elle. Il sonne donc pour appeler une femme de chambre, lui donne une petite note et lui dit : « Donnez ce papier à ma sœur, si elle n'est pas occupée. Mais si elle fait quelque chose, ne le lui donnez pas, ne la dérangez pas, revenez juste tout de suite et dites-le moi. » Un quart d'heure plus tard, après la traversée de tous ces couloirs, dans un sens et puis dans l'autre, la femme de chambre revient. Et Sir Osbert lui demande : « Lui avez-vous donné le message ? » Elle répond : « Oui, bien sûr. » « Ma sœur ne faisait donc rien ? » « Oh non, elle ne faisait rien du tout, elle était juste en train d'écrire. » Voilà donc l'attitude qu'ont très souvent les gens quand vous êtes en train d'écrire ou de peindre, ou si vous faites autre chose de cette sorte : réellement, vous ne faites rien.
A la lumière de cette sorte de malentendu courant sur le thème des arts en général, essayons donc d'aller un peu plus en profondeur dans ce sujet entier, et essayons de voir de quelle façon, ou dans quel sens l'art fait partie de la vie spirituelle, de l'évolution supérieure de l'homme. Et comment aussi l'artiste est, en fait, l'homme nouveau. Cela va nécessiter de considérer la question de ce qu'est l'art. Mais mettons cela de côté pour le moment et allons observer l'artiste en tant qu'homme nouveau, considérer l'artiste comme partageant les caractéristiques de l'homme nouveau.
L'homme nouveau se distingue par cinq caractéristiques. Il y en a sûrement beaucoup d'autres, mais apparemment celles-ci sont les plus clairement reconnaissables. Ces caractéristiques sont la prise de conscience de soi, la vraie individualité, la créativité, la solitude et une fréquente impopularité. Faisons donc une pause avant de rentrer dans la question de ce qu'est l'art et regardons brièvement comment on peut appliquer ces cinq caractéristiques de l'homme nouveau à l'artiste, qu'il soit poète, peintre, sculpteur, musicien ou autre.
‘The Higher Evolution’ © Sangharakshita, 1969, traduction © Centre Bouddhiste Triratna, 2002.
(1/8) >
Par Urgyen Sangharakshita.
(1/8) >
« L'art est l'organisation d'impressions sensorielles qui exprime la sensibilité de l'artiste et communique à son public un sens des valeurs qui peut changer leur vie ». A l'aide de sa propre définition, Sangharakshita explore la pertinence de l'art et de l'artiste pour l'évolution personnelle et spirituelle de l'homme.

Le Bouddha, par Odilon Redon
Par « art » nous entendons tous les arts. Nous prenons ce terme pour couvrir la peinture, la sculpture, la poésie, la musique, l'architecture, etc. Et par « vie spirituelle » nous entendons tout le processus de l'évolution supérieure. A ce propos, je dois avouer que je ne suis pas très heureux avec ce mot, « spirituel ». Quand j'étais en train de noter la liste des titres pour ces lectures, j'ai beaucoup hésité avant d'écrire ce mot, spirituel, et l'art et la vie spirituelle, parce que je sais que pour beaucoup de gens le mot spirituel a une mauvaise connotation. Quand on parle de vie spirituelle, les gens commencent à penser aux esprits, au spiritisme, aux tables tournantes, aux voix de l'au-delà, aux formes et aux apparitions. Alors, je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'il vaut mieux éviter le mot spirituel. Mais malheureusement, il n'y a pas dans le langage courant de terme équivalent à ce mot, « spirituel ». J'ai pensé que peut-être nous pourrions commencer à populariser le terme « méta-biologique », que j'ai déjà utilisé. Je sais que c'est un peu long, méta-biologique, mais au moins cela a le mérite de couvrir toutes les manifestations supérieures de l'esprit humain : non seulement l'art, mais aussi la religion et la philosophie.
Donc, quand nous parlons de l'art et de la vie spirituelle, ou de l'art et de l'évolution supérieure, nous ne suggérons pas que ce soient vraiment deux choses séparées. Ce n'est pas que vous avez l'art d'un côté et la vie spirituelle de l'autre, l'art ici et la vie spirituelle là, unis plutôt superficiellement par ce petit mot, « et ». Ce n'est pas que l'art et la religion soient dans une relation superficielle. On peut même aller jusqu'à dire que l'art est inclus dans la vie spirituelle, que les arts sont juste un aspect particulier de l'évolution supérieure, ou une manifestation de celle-ci. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que l'on ne peut pas vivre une vie spirituelle, que l'on ne peut pas participer à l'évolution supérieure de l'humanité, sans être artiste. Cela ne veut pas dire ça ; mais cela veut dire qu'on ne peut pas être un artiste sans participer au même temps à la vie spirituelle, à l'évolution supérieure. Dans la mesure où l'on est artiste, où l'on est un véritable artiste, un artiste authentique, de n'importe quelle discipline, on participe à l'évolution supérieure de l'homme.
Maintenant, je suis sûr que cette idée n'est pas évidente pour la plupart des gens. On pourrait la voir comme une glorification inutile de l'artiste, et même on pourrait ne pas être d'accord du tout. Nous savons que généralement les gens n'ont que peu d'estime pour l'art et pour l'artiste. En vérité, ils ne les considèrent pas trop, pas en comparaison avec d'autres choses vraiment importantes, d'autres activités réellement importantes. Beaucoup de gens ont tendance à avoir un regard méprisant sur les arts et sur l'artiste, et à penser que l'artiste s'occupe de choses plutôt triviales, et pas du « vrai travail d'homme ». Dans ce contexte, je me souviens d'une petite histoire, provenant je crois de l'autobiographie de Sir Osbert Sitwell, qui est une longue œuvre en plusieurs tomes, très longue, mais qui contient quelques très bonnes histoires très bien racontées. Peut-être savez-vous que les Sitwell étaient une de ces très très brillantes familles dans laquelle pratiquement chacun semble être un génie ; tous vos frères, sœurs, tantes, cousins, oncles etc. sont des génies - cela doit être une manière merveilleuse de grandir. Vous avez donc Osbert et Sacheverell et la célèbre Edith, vivant tous ensemble, quand ils étaient jeunes, dans cette vaste et vielle demeure familiale délabrée ; l'un vit dans une aile, l'autre dans une autre aile, séparés par un kilomètre de couloirs, et avec beaucoup de domestiques. Alors, relate Osbert Sitwell, un beau matin il voulait communiquer avec sa sœur Edith dans son aile à elle. Il sonne donc pour appeler une femme de chambre, lui donne une petite note et lui dit : « Donnez ce papier à ma sœur, si elle n'est pas occupée. Mais si elle fait quelque chose, ne le lui donnez pas, ne la dérangez pas, revenez juste tout de suite et dites-le moi. » Un quart d'heure plus tard, après la traversée de tous ces couloirs, dans un sens et puis dans l'autre, la femme de chambre revient. Et Sir Osbert lui demande : « Lui avez-vous donné le message ? » Elle répond : « Oui, bien sûr. » « Ma sœur ne faisait donc rien ? » « Oh non, elle ne faisait rien du tout, elle était juste en train d'écrire. » Voilà donc l'attitude qu'ont très souvent les gens quand vous êtes en train d'écrire ou de peindre, ou si vous faites autre chose de cette sorte : réellement, vous ne faites rien.
A la lumière de cette sorte de malentendu courant sur le thème des arts en général, essayons donc d'aller un peu plus en profondeur dans ce sujet entier, et essayons de voir de quelle façon, ou dans quel sens l'art fait partie de la vie spirituelle, de l'évolution supérieure de l'homme. Et comment aussi l'artiste est, en fait, l'homme nouveau. Cela va nécessiter de considérer la question de ce qu'est l'art. Mais mettons cela de côté pour le moment et allons observer l'artiste en tant qu'homme nouveau, considérer l'artiste comme partageant les caractéristiques de l'homme nouveau.
L'homme nouveau se distingue par cinq caractéristiques. Il y en a sûrement beaucoup d'autres, mais apparemment celles-ci sont les plus clairement reconnaissables. Ces caractéristiques sont la prise de conscience de soi, la vraie individualité, la créativité, la solitude et une fréquente impopularité. Faisons donc une pause avant de rentrer dans la question de ce qu'est l'art et regardons brièvement comment on peut appliquer ces cinq caractéristiques de l'homme nouveau à l'artiste, qu'il soit poète, peintre, sculpteur, musicien ou autre.
‘The Higher Evolution’ © Sangharakshita, 1969, traduction © Centre Bouddhiste Triratna, 2002.
(1/8) >
 Re: Forum Religion et Art
Re: Forum Religion et Art
Hegel. Art et Religion dans La Phénoménologie
Biblio : Hegel, Phénoménologie de l’Esprit, « La Religion », trad Hyppolite, Aubier-Montaigne, II, 203-290. Jean Hyppolyte, Structure et genèse de la « Phénoménologie de l’esprit » de Hegel, Aubier-Montaigne, 511-549. Bernard Teyssèdre, L’Esthétique de Hegel, PUF. Gérard Bras, Hegel et l’art, PUF, « Philosophies ».
***
Chez Baumgarten, l’Esthétique était une partie, selon lui alors ignorée, de la réflexion philosophique : la connaissance de la perfection sensible, à la fois claire et confuse. Chez Kant, l’Esthétique est un domaine du système de la philosophie, lien entre les deux incommensurables de la Nature et de la Liberté, et par conséquent nécessaire à l’unité et à la cohésion du tout. Chez Hegel, l’Esthétique est plutôt un moment de l’accomplissement de l’Idée de philosophie, non un domaine distinct mais un moment qui doit être aboli et dépassé pour que la réalisation de l’Esprit parvienne à sa fin. Hegel n’emploie pas le mot d’Esthétique, qu’il refuse en accord avec son ami Schelling, dont il passa longtemps pour l’élève (jusqu’en 1807, année de la parution de La Phénoménologie de l’Esprit) : l’Esthétique enracine en effet la connaissance de l’art dans une philosophie de la sensation, c'est-à-dire dans l’étude d’une faculté subjective et incapable par elle-même de produire un concept. Le criticisme kantien, ou plutôt ce qu’ont fait de lui ses héritiers, sombre selon Schelling et Hegel dans un subjectivisme facile qui, prenant prétexte de l’impossibilité de la métaphysique dogmatique, s’empresse de renoncer à toute recherche de la vérité. Inversement, Hegel accorde à l’art la valeur d’une véritable connaissance philosophique : l’Idée se matérialise dans l’œuvre et l’art propose au penseur une véritable philosophie, mais encore inconsciente et muette. C’est alors la tâche de la réflexion de formuler explicitement le moment conceptuel qui s’incarne dans l’œuvre d’art. Aussi faut-il parler d’une véritable « philosophie de l’art », selon Hegel et Schelling (tel est en effet le titre d’un cours que Schelling prononce à Iéna pendant l’hiver 1802-1803), et nullement d’Esthétique, comme le faisait Baumgarten influencé par le sensualisme et le scepticisme qui dominaient au milieu du XVIIIe siècle. C’est à partir de Schelling en effet que l’art devient l’objet d’une Kunstwissenschaft, « science de l’art » (le philosophe), et non plus histoire (l’historien), ni description (l’antiquaire), ni appréciation critique (le critique, ou l’homme de goût). L’art sera donc pour Hegel l’objet d’une connaissance philosophique (et même la plus haute, puisqu’elle met en jeu l’Absolu, c'est-à-dire le cercle de la conscience de soi) et nullement d’une simple analyse psychologique de nos sensations. Kant procède à une analyse du sentiment esthétique ; Hegel développe le mouvement dialectique de l’Idée du Beau. C’est ainsi qu’on passe d’une analyse esthétique de l’art qui, au XVIIIe siècle, est un hédonisme, ou réflexion sur le plaisir sensible, à une philosophie de l’art, qui déchiffre l’histoire de l’art comme la révélation progressive de l’Absolu, et tend par conséquent à identifier l’art à la religion. Il n’est plus alors question d’éprouver un sentiment de plaisir, mais d’accéder à la connaissance de la vérité. L’art n’est plus l’objet d’une jouissance, il est l’enjeu d’une révélation.
Il est nécessaire, pour comprendre la philosophie hégélienne de l’art, de la situer dans l’ensemble du système, dont elle est un moment nécessaire. Seul l’Esprit est l’Absolu (deabsolvere, qui a le pouvoir de délier, de se dégager de toute aliénation, ce qui donc est parfait et ne se rapporte qu’à soi-même) : l’Esprit est en effet conscience, et la conscience est poussée par le désir de réaliser son égalité avec elle-même, c'est-à-dire de devenir conscience de soi. Cependant, la parfaite égalité de la conscience de soi ne saurait être pour Hegel immédiate : tel est le cas par exemple chez Descartes, selon lequel la pensée se reconnaît immédiatement pensante dans l’évidence du cogito. L’immédiateté de cette unité condamne, selon Hegel, la pensée à l’abstraction : et en effet, l’âme ne peut réussir cette parfaite coïncidence de soi avec soi-même qu’après avoir effectué le vide hyperbolique du doute, et s’être ainsi privé de tout savoir effectif. Pour que la conscience de soi se réalise donc concrètement, et non abstraitement, il faut qu’elle renonce à l’immédiateté de l’égalité avec soi-même et qu’elle accepte de se perdre dans le terme qui s’oppose à elle, qui la nie et lui fait obstacle : le monde. Ainsi, pour se retrouver lui-même, il est nécessaire que l’Esprit commence à se perdre dans le monde, pour se connaître lui-même, il faut qu’il commence par se mesurer à l’obstacle du monde. Ce n’est donc ni dans la tour d’ivoire de l’entendement abstrait, ni dans la cellule de la méditation cartésienne, que l’Esprit peut atteindre l’absolu de l’égalité avec soi-même, ou conscience de soi, mais au contraire en s’engageant dans le monde et en surmontant l’obstacle qui l’arrache à sa pure intériorité et le contraint à manifester (phénoménologie) sa force et à faire la preuve de sa liberté.
Dès lors, la philosophie hégélienne, qui est l’histoire de la révélation à l’esprit de sa propre vérité, se dissocie en deux moments fondamentaux : en premier lieu, l’esprit se mesure au monde et apprend à se connaître en se réalisant dans l’expérience. Il réussit ainsi à surmonter la différence et à se retrouver lui-même par le mouvement de la libération (dialectique de la maîtrise et de la servitude), par l’observation, en ordonnant la nature selon les catégories de l’entendement, par la moralité, en soumettant ses actions à une loi inconditionnée, enfin par le droit en maîtrisant son engagement dans l’Histoire. En chacun de ces moments, l’Esprit se connaît par la médiation d’une situation ou d’une expérience particulières, mais non par ce qu’il est essentiellement. Cette histoire de l’Esprit aliéné au monde, qui est le détour nécessaire par lequel l’Esprit doit passer pour parvenir à la conscience de soi, est ce que Hegel nomme sa Phénoménologie. C’est seulement après avoir accompli ce parcours de formation, ou d’initiation, que l’Esprit deviendra enfin lui-même, savoir pur qui se reconnaît lui-même dans le mouvement du concept et cesse en conséquence de se chercher dans le monde. Alors la Phénoménologie, qui est l’odyssée de l’esprit aliéné dans le monde, laisse la place à la Logique, ou Savoir Absolu, qui est l’esprit se connaissant lui-même par le développement dialectique de la science. L’idée hégélienne de la phénoménologie, par laquelle l’esprit s’achemine vers la connaissance de lui-même en surmontant son aliénation dans le monde, doit beaucoup aux romans d’apprentissage (Bildungsroman) dont le modèle demeure, pour la littérature allemande, Les années d’apprentissage de Wilhelm Meister, qui occupa Gœthe de 1788 à 1795. Wilhelm Meister, que Gœthe avait d’abord voulu nommer Wilhelm Schüler, choisit de suivre une troupe de comédiens avant de s’en affranchir et de devenir adulte en s’installant dans le monde véritable, et en en acceptant les responsabilités. De même, l’esprit se cherche en premier lieu dans le monde des apparences avant de se trouver lui-même dans le développement dialectique de la science. L’apprentissage est toujours celui de la conscience de soi, c'est-à-dire de la liberté. C’est ainsi que La phénoménologie de l’Esprit est le roman d’apprentissage de la conscience, ou bien encore l’éducation sentimentale de la raison..
L’art, qui représente symboliquement l’idée dans la matière élaborée, est un moment de la phénoménologie et non de la logique : le concept n’est pas en effet dans l’œuvre d’art reconnu comme concept, comme c’est le cas pour la science, il est exprimé sous la forme d’une apparence sensible, il est représenté mais non encore pensé. L’œuvre est en effet le symbole de l’idée, elle est le concept encore inconscient objectivé dans la matière, l’esprit qui se représente à lui-même par la médiation de l’apparence esthétique. L’allégorie est la traduction, ou l’illustration, d’une idée consciente dans une forme adéquate ; le symbole est la représentation inconsciente d’une idée qui ne se connaît pas encore elle-même et s’achemine vers la conscience de soi en se réalisant sous la forme d’une matière travaillée en vue de sa seule apparence. L’art est ainsi pour Hegel une philosophie non encore consciente d’elle-même.
Cependant, si l’art relève bien du développement de la phénoménologie de l’esprit, il n’en est pas le thème constant mais seulement un moment particulier. Ce moment est pour Hegel celui de la religion. Dans tous les autres moments de la phénoménologie, l’esprit se connaît lui-même en tant qu’il se détermine par un aliénation particulière : dans la connaissance de la nature, l’esprit se connaît comme entendement logique et analytique, dans la moralité, l’esprit se connaît comme conscience, dans le droit seulement il commence à se connaître comme esprit, c'est-à-dire comme liberté gouvernant le monde, monde qui est cependant chaque fois une situation historique et unique. C’est seulement dans la religion que l’esprit approche du savoir absolu, c'est-à-dire de la conscience de soi de l’esprit comme esprit universel : les successives figures de la divinité représentent l’absolu, c'est-à-dire la conscience de soi, dans sa forme la plus universelle, comme pur esprit et non comme conscience engagée dans le monde. Les images des dieux sont donc les images par lesquelles la conscience se représente à elle-même son essence la plus pure et la plus universelle. Elles ne sont cependant que des images et non encore des concepts, des représentations sensibles et non encore des développements dialectiques : tel est le moment de l’art, l’œuvre ayant pour fonction de manifester dans le monde sensible une forme symbolique en laquelle vient se réfléchir l’absoluité de la conscience de soi, la représentation des dieux n’étant que l’expression imaginaire de la perfection de la conscience de soi qui donne à l’homme l’accès à la vie de l’esprit. C’est ainsi que le dernier chapitre de la Phénoménologie de l’esprit (ou du moins celui qui précède le dernier chapitre intitulé « Le Savoir absolu », chapitre qu’il faut considérer comme une introduction à La Science de la logique plutôt que comme un épisode de La Phénoménologie de l’esprit) s’intitule « La Religion ». L’art, sous le nom de « religion esthétique » en est un moment nécessaire. On mesure à cela le chemin parcouru depuis le XVIIIe siècle : l’art était autrefois l’occasion d’un plaisir sensible ; il est maintenant une révélation du divin. La religion selon Hegel exprime l’esprit d’un peuple sous sa forme la plus haute et la plus universelle, esprit de l’hellénisme, du judaïsme ou du christianisme, qu’elle représente de façon concrète et vivante dans les mythes, dans les rites et dans les œuvres de l’art. A cette religion concrète, qui s’incarne dans l’art, Hegel oppose volontiers la religion abstraite et sans âme du déisme des Aufklärer. En élevant l’art à la hauteur spirituelle de la religion, Hegel est bien le fils de son temps. Déjà Schleiermacher, dans ses Discours sur la religion (1799) réduisait la religion au sentiment religieux qui était, selon lui, « une intuition d’univers », parlait de la religion comme d’une musique sacrée, évoquait de mystérieuses affinités entre l’art et la religion et considérait les prêtres comme des artistes qui savent faire communier les hommes dans l’intuition de l’univers qui les rassemble. En 1802, Chateaubriand publie L’Esprit du christianisme qui s’efforce de rétablir la grandeur de la religion catholique contre les critiques que le rationalisme des Lumières avait dirigées contre elle, non par des arguments théologiques, mais esthétiques : la beauté des rites nous inspire un frisson sacré que la science est incapable de ressentir, et le génie du christianisme est surtout poétique et artistique comme le montre par exemple l’architecture sublime des cathédrales gothiques, art méprisé par le rationalisme du XVIIIe siècle. C’est cet esthétisme religieux qui conduira certains romantiques allemands à se détourner de l’iconoclasme protestant pour se convertir au catholicisme, subissant l’attrait de la poésie médiévale, le charme de la Madone Sixtine de Raphaël à la Galerie de Dresde révélant bien souvent aux contemporains ce que peut être un art religieux. Tout semble se passer comme si l’art prenait la place de la religion, les musées qui se constituent alors étant comme les temples où l’on conserve les reliques de l’Absolu. Ainsi a-t-on remarqué combien le commerce de l’art s’apparente de nos jours à ce qu’était le commerce des reliques pendant le Moyen Age.
Cependant, l’art ne s’identifie pas selon Hegel à la religion, il n’est qu’un moment de son développement dialectique : la religion est en premier lieu religion naturelle qui croit rencontrer le divin dans la beauté du spectacle de la nature. C’est ainsi que l’esprit s’incarne d’abord dans le pur éclat de la lumière (l’ancienne Perse, mazdéisme et religion de Zoroastre), puis dans les plantes et les animaux (religion de l’Inde, les grands textes du brahmanisme venant tout juste d’être traduits en ce début du XIXe siècle), enfin dans des formes géométriques nées de l’ingéniosité du travail humain, artisanat privé d’esprit et non encore art véritable : tels sont les temples colossaux de l’Égypte ancienne (que Hegel connaît surtout par Hérodote) ou bien encore les pyramides. Ces œuvres, selon Hegel, n’expriment aucune pensée mais seulement la perfection du savoir-faire artisanal ; aussi ne sont-elles jamais aussi grandes que dans l’art funéraire (pyramides et hypogées), car elles expriment l’habileté mécanique d’un esprit non encore vivant. Aussi ne faut-il pas s’étonner si le moment de l’art égyptien appartient à la religion naturelle : l’homme n’y est artisan que par un instinct naturel et non parce qu’il est doué d’esprit, et les Égyptiens ont construit leurs pyramides de la même façon que les abeilles fabriquent leurs alvéoles.
C’est dans le second moment que l’art devient pleinement humain, et qu’il se réalise enfin dans toute sa plénitude : la religion esthétique réussit le parfait équilibre entre l’Idée et sa réalisation dans l’œuvre matérielle. La cité antique, rassemblée sous ses lois, unie par les mêmes dieux, forme une communauté harmonieuse qui est comme l’âge d’or de l’humanité et sa véritable jeunesse. Elle donne lieu à un art serein, « olympien », dans des figures idéales qui incarnent l’esprit du tout. L’architecture et la sculpture expriment alors la perfection de cette belle individualité sans subjectivité (Hegel aime à souligner que les statues grecques sont sans regard, et que le sculpteur n’a pas marqué le cercle de la pupille), et qu’aucun secret, qu’aucune intériorité ne vient tourmenter. L’art grec est alors aux yeux de Hegel, comme quelques années plus tôt à ceux de Winckelmann, non un art parmi d’autres, mais l’essence réalisée de l’art en général. Perfection de la représentation esthétique du divin, qui attribue à l’art grec un génie apollinien et nullement dionysiaque, et le place ainsi sous le patronage de l’Apollon du Belvédère qu’on tenait alors pour la plus sublime sculpture de l’Antiquité. L’épopée, la tragédie puis enfin la comédie vont progressivement précipiter les dieux olympiens, inhumains à force de perfection et de beauté, dans l’inquiétude de l’histoire. En s’éloignant de l’âge d’or de la Grèce, l’esprit perd de son innocence et de sa naïveté, et se pose la question inquiète de son salut.
Le troisième et dernier moment de la phénoménologie religieuse de l’esprit est la religion révélée qui culmine dans le christianisme. L’art grec a montré comment, contrairement à ce qu’enseignaient les religions du despotisme oriental, il était possible de tailler dans le marbre une image qui ne soit pas indigne du divin. Or, cette image a la forme, certes idéalisée, de l’humanité, et prépare ainsi la voie au dieu fait homme. Pourtant, tandis que les dieux grecs, que leur beauté sans faute rend impersonnels, sont pure apparence qu’aucune subjectivité ne trouble, le dieu chrétien s’incarne dans le corps de l’homme mais prend aussi avec lui le fardeau de la subjectivité, de la réflexion toujours inachevée, de l’inquiétude inapaisée de la conscience. Les dieux grecs sont sans intériorité, le dieu chrétien exprime, sous sa forme la plus haute, par la Passion, le tourment de la conscience malheureuse qui se cherche dans le monde sans jamais se retrouver, sans trouver le lieu de sa réconciliation, où elle pourrait enfin coïncider avec elle-même et se reposer dans la paix. L’art chrétien exprimera donc cette subjectivité tourmentée et à la recherche de son Salut que le stoïcisme des Anciens, qui ne reconnaissaient pour divine que la sérénité de l’égalité d’âme, avait voulu ignorer. A l’Apollon du Belvédère succède l’atroce crucifié qu’imagine Grünewald en 1515 pour le célèbre polyptyque d’Isenheim.
Le christianisme représente donc symboliquement, dans la figure du Christ, l’exil de l’esprit qui ne se reconnaît pas dans le monde et pleure dans cette vallée de larmes l’innocence du paradis perdu. L’histoire est alors ce Calvaire de l’esprit qu’il lui faut parcourir pour parvenir à l’âge logique, où il se connaîtra sans médiation sensible par la science, c'est-à-dire par le développement dialectique du pur concept. Le christianisme est alors l’ultime figure de la phénoménologie de l’esprit qui, parvenu à la conscience de soi, renonce à sa représentation figurée, c'est-à-dire à l’art, et se convertit à la science. Le Christ est ainsi supprimé et renaît dans l’idée de la communauté humaine, dont l’Église est la représentation symbolique. L’esprit des peuples qui, comme le Christ de l’Évangile, est présent parmi ceux qui se rassemblent en son nom, est désormais la véritable réalisation de l’Absolu dans l’histoire. Quant au mythe chrétien, il exprimait sous une forme dogmatique la vérité de la philosophie hégélienne qui conduit tout ce processus à la conscience de lui-même : c’est ainsi que le dogme de la trinité exprime la vérité du dévelopement dialectique du concept, selon les trois moments de la thèse, de l’antithèse et de la synthèse, et que la mort et la résurrection du Christ expriment la figure du dépassement (aufhebung), à la fois suppression et conservation, qui est au cœur du processus dialectique. Dès lors l’art et la religion disparaissent ensemble. Prend fin l’âge de la représentation (phénoménologie) où l’esprit ne se connaissait que par la médiation d’une image et commence l’âge logique où l’esprit se connaît directement lui-même par le pur développement du concept.
 Re: Forum Religion et Art
Re: Forum Religion et Art

La religion dans l’art italien

L’art , contrairement à ce que l’on pourrait penser, n’a pas toujours été un outil de divertissement. En effet, les souverains puissants comme Louis XIV ou Soliman se servirent de ce média pour instiller au peuple une foi inébranlable en leur puissance, et les plier à leur volonté. Le domaine de la Religion se sert également, et de manière allègre, de ces méthodes pour mieux contrôler les masses populaires, et la période de la Renaissance, de par son explosion sur le plan des nouveaux procédés artistiques, est une époque particulièrement riche dans les représentations religieuses en art, que ce soit en art pictural ou en sculpture. C’est le but de ce blog de présenter et d’analyser brièvement les représentations de la religion dans l’art italien de la Renaissance, qui se séparent en deux parties majeures: les représentations de la religion chrétienne et les représentations de la mythologie romaine dans tous les domaines de l’art.
MISE EN CONTEXTE
La Renaissance fut une époque incroyablement propice pour les artistes de l’Italie, puisque cette dernière fut marquée par le retour des anciens savoirs grecs, qui furent perdus au cours du Moyen Âge en Occident, mais conservés dans l’Empire Byzantin. Toutefois, en 1453, lors de la chute de ce dernier, les savants de Constantinople se dirigèrent vers les grandes villes côtières d’Italie, comme Venise ou Rome, et transmirent les anciennes techniques aux artistes et aux autres professions, et c’est pour cela que l’on peut remarquer plusieurs similitudes entre la grande statuaire grecque et les sculptures de la Renaissance, ou bien le retour des mathématiques en peinture, avec la perspective. Aussi, les artistes purent profiter d’un temps de relatives paix, et d’une grande consommation des arts par les mécènes (riches nobles payant des artistes pour obtenir des oeuvres), ou par de simples clients passant des commandes, leur pemirent de développer de nouvelles techniques bien à eux, comme le sfumato, aussi connu sous le nom de clair-obscur. Cela consiste en une représentation, à l’aide de superposition de couches de mêmes couleurs, des effets de lumière caractéristique du crépuscule.Tous ces procédés se retrouvent bien évidemment dans les oeuvres religieuses, qu’importe le sujet, qu’il soit chrétien ou mythologique.[1]
Ce vidéo présente, afin de vous familiariser aux œuvres de la Renaissance, quelques artistes de ce courant ainsi que leurs créations. Il y a également certains écrivains ayant marqué la Renaissance italienne ou non. Bien que ces derniers ne soient pas réellement en lien avec le sujet principal du travail, ils permettent une connaissance générale approfondie de ce courant et des personnes l’ayant marqué.
LES REPRÉSENTATIONS DE LA RELIGION CHRÉTIENNE
À la Renaissance, cette religion se retrouve dans la plupart des pièces artistiques produites, puisque le Vatican, lieu de culte par excellence de la religion catholique (une des versions de la religion chrétienne), était l’un des plus grands mécènes de cette époque, payant de nombreux artistes pour créer les plus belles oeuvres à l’image de la religion. Cela augmentait ainsi leur prestige et leur capacité de contrôle social. Également, la religion chrétienne est très importante dans la société italienne, et ce, depuis la Rome de l’Antiquité, lorsque l’empereur Théodose déclara cette religion comme celle de l’État[2], et ce statut restera longtemps en Italie. Cela explique l’importance de cette religion aujourd’hui ainsi que la présence du siège de la religion, le Vatican, à Rome.
LA PIETÀ

Dans l’art chrétien, de nombreux thèmes sont récurrents, notamment celui de la crucifixion et des événements se passant immédiatement après. Michel-Ange ne fait pas exception à la règle, avec La Pietà, l’une de ces sculptures les plus connues. Dans celle-ci (à droite), on peut voir Marie, la Vierge, en train de tenir son fils, le Christ, dans ses bras, après qu’il fut décroché de sa croix. Il est bien évidemment mort. On peut remarquer que la Vierge semble observer le corps de son fils avec une acceptation de la volonté divine, tandis que Jésus arbore un visage paisible, pour les mêmes raisons.
Une des caractéristiques frappantes de cette sculpture se trouve être l’apparente jeunesse de la mère de Jésus, qui semble plus jeune que son fils. Cet effet, que Michel-Ange a fait volontairement, viendrait montrer la symbolique de la Vierge, qui par cet état de pureté, vieillit moins vite que les femmes non-chaste, comme l’exprime Dante Alighieri: « Vierge mère, fille de ton fils ». Cette idéalisation de la beauté, et non pas de la douleur, et un thème récurrent dans l’oeuvre de Michel-Ange. Également, le Christ est représenté comme ayant l’âge de sa mort, pour montrer le fait qu’il est mort en acceptant la nature mortelle de l’homme. Cette sculpture se trouve à être un triangle, pour représenter la Sainte Trinité, concept récurrent de la religion chrétienne.
Cette sculpture présente également quelques éléments étranges dans sa composition. En effet, elle est considérée non finito, car elle ne présente pas certaines caractéristiques, notamment à cause de la qualité, un peu plus faible, du bloc de marbre dans lequel Michel-Ange a taillé l’intégralité de La Pietà, et à cause de l’effet recherché, comme la taille magnifiée de la Vierge, ainsi que la position de ses genoux, placés de manière désaxée pour assurer l’équilibre et le support de Jésus. Outre cela, les autres aspects techniques sont incroyables, tels que le niveau de détails des visages ou les riches drapés de la robe de Marie, ce qui fait de cette sculpture l’une des oeuvres de Michel-Ange les plus connues, sculptée entre 1498 et 1499 pour la basilique Saint-Pierre de Rome.[3]
LA CRÉATION D’ADAM

Cette fresque, également l’une des oeuvres les plus connues de Michel-Ange, fait partie de la voûte de la chapelle Sixtine, au Vatican, et représente l’une des étapes de la Genèse, livre de la Bible relatant les événements de la création du monde. Dans cette oeuvre, on peut observer Adam, couché sur la Terre nouvellement créée, nu, tendant la main vers celle de Dieu, volant dans les airs entouré d’un immense drap et de personnages divers, vraisemblablement des anges. Le contact de leur deux index symbolise la passation de l’âme divine à Adam, lors de sa création.
Cette fresque, à l’image des autres oeuvres de Michel-Ange, possèdent une forte imagerie religieuse. En effet, on peut facilement remarquer, dans l’aura de tissus entourant Dieu, de nombreux personnages, dont une femme. Mystérieuse, son identité n’est pas connue avec précision, mais on peut croire que ce serait une représentation de Lilith, première femme, dans le mythe, d’Adam, ou bien Ève, avant leurs créations respectives. Également, on peut remarquer un petit chérubin touché par la main gauche de Dieu, qui peut être interprété comme l’âme divine d’Adam, prête à être transférée dans le corps mortel (même la position du chérubin imite celle d’Adam)[4]

Un aspect remarquable de cette fresque se trouve à être l’interprétation anatomique de la position des personnages. En effet, le personnage de Dieu, entouré de son drap, viendrait montrer une vue en coupe d’un cerveau humain, comme le montre l’image adjacente (en anglais). Michel-Ange considérait probablement que son talent provenait de son intellect, cadeau de Dieu. Cette découverte fut faite par un médecin américain en 1990, Frank Lynn Meshberger, et ferait revêtir à cette fresque un autre sens, celui du don de l’intellect, étant donné les connections synaptiques, sous entendu par l’espace séparant Adam et son Créateur. [5]
VOYAGE EN ITALIE
VISITE DES ÉGLISES À ROME

Vendredi le 21 juin, mes collègues et moi-même avons rejoint plusieurs professeurs pour participer à une visite de 3 églises, relativement différentes les unes des autres. La première, une certaine Santa Maria sur la piazza Del Popolo, était définitivement très caractéristique du style baroque, qui s’est surtout développé vers la fin du 16e siècle, et ce, à cause de nombreux aspects, telle que la présence de riches décorations, très superficielles, avec beaucoup de fioritures, probablement dans le but de montrer la puissance et la grandeur de la religion chrétienne. Dans cette église, on a pu également voir des toiles du Caravage, magnifiques, qui font un peu la renommée de l’église, avec de superbes fresques de Pinturicchio, probablement l’un des « grands maîtres les plus sous-estimés de cette époque », pour citer la personne qui nous a guidé
Ensuite, nous avons visité, San Carlo alle Quattro Fontane, qui fut la plus surprenante : en effet, elle fut bâtie durant le 17e siècle par Francesco Borromini, qui se suicidât peu de temps après, son œuvre n’étant pas ou peu reconnu. Sa particularité principale réside dans le mouvement artistique auquel il appartient : à cheval entre le rococo et le baroque. En effet, elle conserve la sobriété des couleurs du baroque, ainsi que les thèmes religieux, évidemment, (à l’inverse des couleurs pastelles et des thèmes de la vie courante, deux éléments chers au rococo), tout en se dirigeant vers l’extravagance des motifs rococo. Tous ses éléments se retrouvent dans la couleur blanche, prédominante dans toute la nef, ainsi que les tableaux affichés, qui présentent des scènes religieuses. L’aspect rococo se voit particulièrement dans la coupole, recouverte de motifs complexes, presque psychédéliques, qui illustre magnifiquement bien l’esthétique extravagante rococo.

Plus tard, j’ai visité l’église Santa Maria Novella de Florence, magnifique cloître des Bénédictins. Sa construction s’amorça au début 1300 et se termina à la mi-14e, si l‘on ne compte pas la façade, créée en 1470 par León Battista Alberti. Cette église est fort particulière dans le domaine de l’art religieux. En effet, elle est ornée d’œuvres du 14e au 16e siècle, ce qui permet d’illustrer l’évolution de l’art religieux à perfection. Les œuvres du 14e, la fin du Moyen-âge, ne possèdent aucun type de perspective, concept apparaissant à la Renaissance, tous les personnages ont la même expression faciale, et semblent se piétiner les uns les autres, car

on représente plusieurs scènes différentes sans les séparer. Ensuite, dans les œuvres du 15e, un type de perspective
est visible, dans les tableaux de la fin du siècle surtout, mais les œuvres sont toujours très chargées de personnages, et les vitraux comme les tableaux présentent le même genre d’expression faciale.
est visible, dans les tableaux de la fin du siècle surtout, mais les œuvres sont toujours très chargées de personnages, et les vitraux comme les tableaux présentent le même genre d’expression faciale.

Finalement, les œuvres du 16e sont toutes à fait différentes : elles présentent une perspective certaine, très claire, malgré le chargement des œuvres en personnage. Mais, ici, tous les personnages ont une expression faciale qui leur est propre : les visages, comme les personnages, ne sont plus du tout statiques, l’œuvre semble prendre vie et être plus réaliste.
LES REPRÉSENTATIONS DE LA MYTHOLOGIE
À l’époque de la Renaissance, un important retour aux éléments caractérisant les Grecs et les Romains se produit. En effet, en ce qui concerne plus particulièrement les arts, une redécouverte de la mythologie s’effectue. Il est d’ailleurs important de noter que la mythologie romaine est très semblable à celle des Grecs, puisque lors de la conquête de la Grèce par l’Empire romain, ces derniers se sont appropriés leur mythologie, modifiant simplement les noms et certaines caractéristiques des Dieux. Parmi les plus connus se trouvent d’ailleurs Zeus, dont le nom fut modifié pour Jupiter, Poséidon qui prit le nom de Neptune, et Athéna qui obtient le nom de Minerve. Ils ont toutefois gardé leurs principales caractéristiques, donc Jupiter est toujours le roi des Dieux et est marié avec l’équivalent romain de a femme grecque, mais son caractère est beaucoup plus axé sur la guerre et le combat. Les Dieux grecs, quant à eux, avaient plutôt un caractère lié au domaine intellectuel et à la réflexion. Cela constitue donc des éléments importants qui ont été modifiés à travers l’évolution de l’histoire dans le temps.
LA NAISSANCE DE VÉNUS
Les Dieux sont donc beaucoup représentés dans les différents arts de la Renaissance à Rome. Une des plus connues, en ce qui concerne plus précisément la peinture, est sans conteste La naissance de Vénus, tableau réalisé par Botticelli. Celui-ci a représenté la déesse romaine Vénus lors de sa naissance. Selon la légende, elle serait tout simplement sortie de la mer dans un coquillage, complètement nue. Sa présence serait
due à un Titan, Ouranos, le grand-père des Dieux. En effet, lorsque son fils Chronos, père de la majorité des Dieux du Parthénon, l’a découpé en morceau, il aurait lancé son phallus dans l’océan. Cette action aurait donc mené à la naissance de la déesse de l’amour, représentée dans cette peinture célèbre.
Cette peinture a été effectuée en 1485 et est aujourd’hui conservée à la Galerie des Offices à Florence. Le support utilisé est la peinture tempera, bien qu’à l’époque de la Renaissance, cette technique était de plus en plus remplacée par de la peinture à l’huile. La tempera est composée de pigments broyés, de jaune d’œuf ou de la caséine (protéine du lait), ainsi qu’un peu d’eau. L’utilisation de l’œuf était plus populaire que celle de la protéine de lait. Léonardo De Vinci utilisait d’ailleurs également cette technique pour réaliser ses œuvres.
La tempera est appliquée par petites touches sur des panneaux en bois, et ce, à l’aide d’un gesso, soit une fine couche de plâtre mélangée à de la colle. Cette technique permet de créer un grand éventail de couleurs, d’ombres et de lumières, puisqu’elle s’éclaircit en séchant, tout en donnant un fini mat et en diminuant l’oxydation de l’huile, faisant ainsi en sorte que les peintures ont toujours leur aspect brillant, et ce, plus de cinq cents ans après leur création. La tempera possède également d’autres aspects positifs, soit son adhérence à toutes les surfaces et la possibilité qu’ont les artistes à peindre par-dessus leurs couches précédentes, car elles deviennent insolubles. [6]
MERCURE ENLEVANT PSYCHE
Cette autre représentation divine, cette fois-ci en sculpture, est moins connue, mais très intéressante. Elle a été créée en 1593, est faite de bronze et est aujourd’hui conservée au Musée du Louvre à Paris. L’oeuvre représente le messager Mercure, dont le nom grec est Hermès, amenant Psyché, une mortelle, vers l’Olympe, le lieu sacré des Dieux. [7] Celle-ci doit y retrouver son amant nommé Cupidon, le Dieu romain de l’amour. Elle y recevra également son immortalité de la part de Jupiter, car elle a réussi avec succès les différentes épreuves que Vénus, jalouse de l’amour entre Psyché et Cupidon, lui a fait subir.
Il est possible de reconnaître les deux personnages grâce à des caractéristiques qui leur sont propres. Par exemple, Mercure porte son célèbre pétase (casque à ailettes) et a, à ses pieds, ses non moins connues chaussures ailées. Elles permettent au messager des Dieux de se déplacer rapidement et, dans le cas présent, d’amener Psyché jusqu’à l’Olympe. Cette dernière, quant à elle, est caractérisée par le vase qu’elle porte gracieusement, faisant allusion à l’une des terribles épreuves qu’elle a subies.
ALLÉGORIE
Cette sculpture, grâce au contexte et à la ville où elle a été réalisée, soit celui intellectuel de la ville de Prague, est considérée comme une allégorie. Les deux personnages représentent l’Art et le Génie, le premier concept étant attribué à Mercure, tandis que le second est associé à Psyché. Le sculpteur tenait alors à insinuer que l’Art amène le Génie, et ce, jusqu’à l’immortalité.
ANALYSE SUPPLÉMENTAIRE
L’image adjacente présente une oeuvre d’Agnolo Bronzino, artiste florentin, en expliquant les différents symboles que l’on peut voir dans la toile, datant de 1546. Un fichier fort intéressant.
ITALIE
En ce qui concerne plus particulièrement la partie terrain, soit le voyage organisé en Italie, celui-ci a permis de découvrir de nouvelles œuvres toujours en lien avec le sujet.

Une œuvre particulièrement intéressante est la représentation à la manière de l’art contemporain de la statue de la Vénus de Milot. Celle-ci est présente dans un ancien temple en ruine situé près du Colisée, à Rome. Contrairement à son habitude, la statue est placée dos au public, avec de nombreux vêtements situés devant elle. Par cette action, l’artiste a voulu créer un lien évident entre la modernité et la période plus ancienne dans laquelle figure la déesse romaine de l’amour, soit Vénus. Cette sculpture illustre également que la mythologie romaine dans l’art est toujours présente et importante aujourd’hui, et ce, malgré les nombreux siècles qui ont passé depuis ses années de gloire.

Cette peinture est une représentation précise de l’art religieux à l’époque de la Renaissance. En effet, elle comprend les trois caractéristiques définissant les œuvres de cette époque. La première est l’effet de profondeur, mis en valeur à un point de fuite situé au centre de l’œuvre. Celui-ci guide le regard de l’observateur vers la basilique, prédominante à l’arrière-plan. La deuxième caractéristique est la perspective, soit le fait que l’artiste peintre ait représenté des objets et des personnes en trois dimensions et qui semblent réels. Pour ce qui est du dernier élément caractérisant la toile, celui-ci est l’harmonie de la peinture. En effet, un exemple caractérisant l’harmonie est sans conteste le nombre égal de personnages situés des deux côtés de la peinture, créant équilibre et harmonie.
Il est possible d’observer cette œuvre artistique de Cosimo Rosseli, intitulée Le Sermon sur la montagne, au musée du Vatican, à Rome.

Toujours dans la perspective de la mythologie romaine, cette statue représente le Dieu du vin, soit Bacchus. Cette œuvre est à la fois intéressante étant donné la représentation de ce Dieu, du mouvement qu’il semble opérer et des nombreux détails caractérisant cette sculpture faite de marbre, mais également à cause de la feuille qui cache sa nudité. Cet élément n’était pas présent lors de la création de l’œuvre, il a été ajouté lors de la montée du catholicisme. Bien que l’œuvre originale n’ait pas été faite lors de l’époque en lien avec ce blog, cette reproduction a été créée lors de la Renaissance, ce qui explique sa présence.

En lien avec le christiannisme, un obélisque, représentant plus particulièrement la mythologie égyptienne, a été volé et placé volontairement au centre de la place Saint-Pierre de Rome, au Vatican. Cela a été fait par l’Église afin d’illustrer la supériorité du christianisme sur les religions païennes comme celle égyptienne. Il est alors possible d’assister à l’utilisation de l’art comme outil de propagande, et ce, afin d’agrandir le pouvoir de la religion chrétienne. La grandeur ainsi que la splendeur de ce monument viennent ajouter l’effet escompté pour mettre de l’avant la puissance et le règne de l’idéologie de religion chrétienne.

Cette réplique exécutée lors de la Renaissance présente la déesse romaine de la chasse prénommée Diane. Il est possible de la reconnaître aisément grâce à l’arc et à la flèche qu’elle tient, tout comme le chien qui l’accompagne. La sculpture permet de constater que même certains Dieux moins connus étaient représentés en sculpture.
Cette sculpture est également présente au musée du Vatican à Rome.
LA GALERIE DES OFFICES
Lors du séjour, il a été possible de visiter un important musée comprenant un grand nombre d’œuvres, dont certaines en lien avec le présent blog, soit des peintures et des sculptures religieuses. La majeure partie des œuvres en lien avec la religion chrétienne était en peinture. Il était possible de les reconnaître grâce à l’auréole qui entourait certains personnages, principalement la Vierge Marie et Jésus, mais également plusieurs Saints présents dans les Évangiles et dans la Bible. Il y avait également certaines représentations faites en sculpture, et celles-ci étaient reconnaissables principalement grâce aux titres donnés aux œuvres.
En ce qui concerne la mythologie, principalement romaine étant donné le lieu de l’exposition, soit à Florence en Italie, celle-ci était, contrairement à la religion chrétienne, beaucoup plus présente en sculpture. Cela est principalement dû au moment où les représentations ont été conçues. Il a toutefois été possible de voir certaines peintures représentant l’ancienne religion italienne, comme La chute d’Icare et Fortuna. La célèbre représentation de Botticelli, soit la Naissance de Vénus, précédemment analysée était également présente. À ce sujet, il est possible de constater que les photos qu’il est possible de trouver sur Internet ne rendent pas justice à la beauté de cette œuvre. En effet, il est difficile de bien voir les délicats traits qui composent le visage de la déesse.
Il est important de noter que la prise de photos était formellement interdite lors de cette visite. Les photos concernant donc ce sujet proviennent donc de différents sites Internet.
DIEUX
Voici une rapide énumération des Dieux romains vus dans ce blog ou très importants en Italie autrefois, permettant ainsi de mieux saisir leur rôle dans la vie de ce peuple.
Diane : Déesse de la chasse, souvent représentée avec un arc et une flèche.
Junon : Femme et sœur de Jupiter. Déesse du mariage et est souvent représentée avec une peau de chèvre sur les épaules. Certains mythes la considèrent également comme l’une des principales protectrice de Rome.
Jupiter : Roi des Dieux, contrôle la foudre et son domaine est le ciel. Il est le fils de Saturne.
Mercure : Messager des Dieux et Dieu des voyageurs et des commerçants. Il est reconnaissable grâce à son casque, ses chaussures ailées et au caducée qu’il tient.
Saturne : Titan ayant été découpé en morceau par son fils Jupiter. Ce dernier sauvait alors ses cinq frères et soeurs qui avaient été avalés par leur père dans leur jeunesse.
Vénus : Déesse de l’amour et de la séduction très utilisée dans les œuvres de la Renaissance. Sa naissance serait due à sa sortie de l’eau sur un coquillage.
Références
[1] LEFEBVRE, Claire. Notes distribués dans le cours Les arts visuels en Occident, Collège Lionel-Groulx, session Hiver 2013
[2] BENZ, Ernst Wilhelm et coll. « Christianity », Encyclopaedia Brittanica, [en ligne], http://www.britannica.com.ezp.clg.qc.ca/EBchecked/topic/115240/Christianity (Page consultée le 4 juin 2013)
[3] VASSELIN, Martine. « Michel-Ange (1475-1564) », Encyclopædia Universalis, [en ligne], http://www.universalis-edu.com.ezp.clg.qc.ca/encyclopedie/michel-ange/ (Page consultée le 15 mai 2013)
[4] BLECH, Benjamin et DOLINER, ROY. Les secrets de la chapelle Sixtine, Michel Lafon, Paris, 2008, 325 p.
[5] MESHBERGER, Frank Lynn. « An Interpretation of Michelangelo’s Creation of Adam Based on Neuroanatomy », Journal of the american medical association, No.14, Vol. 264, Octobre 1990, [en ligne], http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=383532#References (page consultée le 4 juin 2013)
[6] MONIER, Fabienne. La peinture a tempera pour les nuls, [En ligne], [http://peinture-tempera.over-blog.com/pages/la-peinture-a-tempera-pour-les-nuls-2397939.html] (page consultée le 10 mai 2013)
[7] MONTALBETTI, Valérie. Mercure enlevant Psyche – Musée du Louvres, [En ligne], 2010, [http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/mercure-enlevant-psyche] (page consultée le 10 mai 2013)
 Sujets similaires
Sujets similaires» Forum Religion et Sociologie
» Forum Religion et Musique
» Forum Guerre et religion
» Forum Religion et Meurtre
» Forum - Religion et Médecine - forum religion et médecine
» Forum Religion et Musique
» Forum Guerre et religion
» Forum Religion et Meurtre
» Forum - Religion et Médecine - forum religion et médecine
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum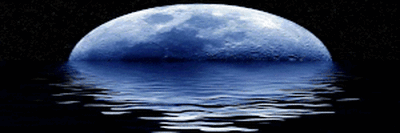
 S'enregistrer
S'enregistrer
 [/ltr]
[/ltr]















































