Forum Religion et Politique
Forum Religion : Le Forum des Religions Pluriel :: ○ Babylone la Grande :: Babylone :: La "Politique"
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 •  1, 2, 3
1, 2, 3 
 Forum Religion et Politique
Forum Religion et Politique
Rappel du premier message :
Forum Religion et Politique
Le religieux face au politique
La société a-t-elle besoin du religieux ? Oui sans doute. Mais ce religieux est disséminé, vécu « à la carte » par l’individu. Quant au politique, il gère mais ne mobilise plus les citoyens. D’où la même relative faiblesse de l’Etat et des Eglises, le même déclin du militantisme.
Le partage entre religion et politique, tel qu’il a été pensé depuis deux siècles, en France surtout, correspond à deux visions de base (certes en elles-mêmes très différenciées) du religieux et de ce qu’il représente pour la société politique. Cette dualité joue aussi quand nous évaluons les rapports entre lien social et religion – y compris dans l’Europe politique en train de naître, qui hésite entre les deux conceptions. L’une de ces visions est davantage sociologique, et l’autre politique. Sans être totalement exclusives l’une de l’autre, elles impliquent des options différentes sur la place du religieux dans la société. Or l’une et l’autre sont remises en question par la situation nouvelle faite aux démocraties et aux religions dans les sociétés dites postmodernes.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Thèse sociologique : la religion a un contenu substantiel pour la société
Toute une tradition sociologique, bien qu’agnostique ou athée, a insisté sur le rôle des religions pour les sociétés. Elle s’est opposée ainsi à une tradition rationaliste qui culmine au XVIIIe siècle, selon laquelle “la religion, et en particulier le christianisme, est un fatras de superstitions dont seuls les êtres auxquels font défaut les Lumières et la raison ont besoin”. L’émancipation selon les philosophes impliquait que la religion disparaisse afin que les sociétés et les Etats soient enfin rendus à eux-mêmes, à la maîtrise de l’ici-bas [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour la plupart des sociologues du XIXe siècle, au contraire, l’Etat et la société sont sinon menacés dans leur existence, du moins affectés dans la qualité et la cohésion de cette existence, par le recul de la religion. A leurs yeux, celle-ci n’est pas d’abord constituée de connaissances et de convictions intellectuelles vraies ou fausses, ni d’institutions chargées de les produire, de les répandre et de les surveiller, mais de sentiments et d’aspirations, de valeurs et d’incitations morales, de rites et de cérémonies, de comportements et de règles de vie, de solidarités communautaires et extra-communautaires. Bref, la religion a un contenu substantiel. Tocqueville, pourtant sévère envers les instances catholiques, s’interroge sur l’utilité de la religion – catholicisme compris – pour vitaliser la démocratie [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Max Weber, pour qui la religion implique avant tout des “systèmes de règlement de la vie” [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a tenté de montrer les liens entre éthique protestante et esprit du capitalisme. Pour Georg Simmel, les “théories sociales ne peuvent pas éviter de reconnaître le rôle effectif du sentiment religieux dans les mouvements des sociétés, même modernes” [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. De même Durkheim : «Les religions doivent être l’expression de la conscience collective». Il est vrai qu’il s’agit pour lui avant tout de cette «religion» qui constitue la communauté morale de la République laïque [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Une autre perspective, plus conservatrice, ajoute qu’un fondement transcendant est nécessaire pour faire contrepoids à la caducité des choses humaines et leur donner un socle d’éternité. Elle réclame une restauration, fût-elle autoritaire, du rôle de la religion dans la cité politique. Mais plus largement, les sociologues s’interrogent avant tout sur le sens et les conséquences socio-politiques de la faiblesse et du recul de la religion, sur ce qui peut tisser le lien social “après” la religion, ou sur les substituts de cette dernière qui apparaissent sur la scène sociale (le sport de masse, par exemple). Ce n’est sans doute pas un hasard si ces sociologues sont souvent issus de pays anglo-saxons, où la sécularisation s’est propagée sans avoir à mettre en œuvre la laïcisation volontariste dont la France notamment est le théâtre lors de la Révolution et à partir de la fin du XIXe siècle. Mais on peut comprendre que cette vision plus «interne» du religieux et de sa place sociale puisse séduire le catholicisme [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Elle peut même apporter de l’eau à son moulin. C’est l’une des raisons, à mon sens, qui fait que des religieux auraient quelque motif de trouver minimal ou insuffisant un enseignement neutre d’histoire des religions en termes de simples connaissances religieuses : non qu’ils veuillent un enseignement confessionnel voire prosélyte, mais ils ont le sentiment que le fait religieux réduit à des idées et des événements est profondément tronqué.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Thèse politique : la société peut se passer du religieux
En sens inverse, chez les “laïques à la française”, même partisans du compromis et de la paix avec l’Eglise catholique, on veut ignorer ces réflexions sur le rôle social de la religion. Ils se sont au départ, diversement certes, inscrits dans la lignée des philosophes antireligieux, même si, par la suite, les lois laïques sont devenues avant tout un mode de gestion de la séparation et de la pluralité des religions au sein de l’Etat [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Dans cette perspective, la religion comme telle n’a aucun rôle structurant pour la société. Elle n’a pas de légitimité publique ni d’utilité sociale que l’Etat puisse reconnaître. Elle doit rester confinée dans la vie privée et sa visibilité publique rester minimale. L’Etat, situé hors et au dessus de la pluralité religieuse, garantit la liberté égale de toutes les religions, sans en reconnaître aucune. Les individus peuvent alors de plein droit vivre leurs engagements et leurs convictions dans la Cité humaine, ils apporter à titre personnel leur pierre dans l’espace public, agir dans l’intérêt général, mais les associations qu’ils constituent, les assemblées religieuses auxquelles ils participent, les travaux et les solidarités qu’ils organisent, les croyances qu’ils partagent n’ont pas de pertinence sociale ou politique reconnue par l’Etat.
Les aspects anticléricaux ou antireligieux qui ont présidé à la naissance de ce modèle n’ont pas toujours disparu dans les milieux laïcs militants. Ils persistent sous la forme d’une mésestime ou, au minimum, d’une méfiance [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. De son côté, l’Eglise catholique a fini par s’accommoder du partage laïc en France – par l’accepter globalement avec des réserves et des exceptions (comme l’enseignement privé). Des catholiques le défendent farouchement au nom de la fidélité à l’Evangile : le christianisme n’a nul besoin de reconnaissances étatiques, que ce soit comme fondement du lien social ou comme partenaire reconnu “utile” dans la sphère publique, et cette déliaison est au contraire liberté pour agir et apporter sa pierre sociale, caritative, éthique…, au bien commun [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Contrainte de ne compter que sur elle-même, sur sa vitalité spirituelle et son imagination, l’Eglise catholique a en fin de compte bénéficié de la laïcité française.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Une tension féconde
J’ai parlé indifféremment du religieux, de la religion et des religions. En fait, l’évocation du catholicisme rappelle que nous sommes dans le domaine chrétien, et que la tension dont il est question est avant tout inscrite dans l’histoire de l’Occident. Jean-Claude Eslin l’exprime dans les termes suivants : “Les prophètes et le Christ ont introduit une dualité dans l’histoire occidentale, et les formes d’unité se sont reconstituées autrement, laborieusement. La dualité des principes opposée à toute réduction à l’unité sous quelque prétexte que ce soit constitue, semble-t-il, la racine du dynamisme de l’Occident dans l’histoire. […] La dualité des principes peut être mise en cause par l’affaiblissement interne de l’un des principes, quand par exemple les expressions religieuses s’affaiblissent, (…) quand le pouvoir spirituel, au fil des guerres de religion, des divisions de la chrétienté ou de sa responsabilité dans les catastrophes du XXe siècle, semble s’être perdu lui-même. L’Etat tend alors, en dépit de tous les regrets et de toutes les larmes versées, et de tous les désirs de réappropriation de la société civile, à devenir un pôle unique de légitimité, ce qui est pour lui la pente naturelle. Il arrive aussi que ce soit le principe politique qui devienne trop faible, et la dualité est alors mise en cause au profit de l’Eglise qui assume des fonctions qui ne sont pas les siennes”. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Faiblesse du pôle religieux…
Qui dit faiblesse du religieux doit préciser ce dont il est question. La faiblesse n’est pas l’absence, car d’un certain point de vue, on devrait plutôt insister sur l’omniprésence du religieux au “temps des religions sans Dieu” [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Faiblesse veut dire avant tout éclatement et dissémination du religieux. Sous l’effet de l’individualisme, les appartenances se dissolvent ou se relâchent, et la religion est vécue “à la carte” [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] dans l’ensemble de ses dimensions (pratiques cultuelles et éthiques, croyances…). Dès 1994, plus de deux tiers des individus interrogés se disaient d'accord avec la formule : “De nos jours, chacun doit définir sa religion indépendamment des Eglises” [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Les sociologues ont analysé les nombreuses facettes de ce nouvel univers des croyances, où règnent le religieux “buissonnier”, le religieux “bricolé”, le religieux “hors appartenance”, les “croyances flottantes”, le tout assorti d’un fort relativisme. Les intérêts continués pour la question religieuse sont souvent liés à la réalisation de soi “dans le monde” : on espère d’eux un “plus”, des atouts pour affronter la vie, un mieux être, une aide implicitement ou explicitement de nature thérapeutique [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Dans cette évolution, l’Eglise catholique devient elle-même un groupe minoritaire, si l’on entend par là non seulement le noyau des catholiques pratiquants fidèles, pour l’essentiel, à la doctrine catholique et aux directives éthiques du pape et des évêques, mais tout simplement les Français qui se disent catholiques.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
… et du pôle politique
Mais peut-on dire que nous nous trouvons seulement devant un christianisme «malade» face à un politique dont la légitimité serait intacte ? C’est plutôt l’inverse qui est vrai – et préoccupant : alors que, du point du administratif, financier, matériel, les Etats sont des machines énormes avec des capacités d’intervention inégalées, nombre d’observateurs insistent sur la carence proprement politique des démocraties européennes, sur leur déficit symbolique et sur le manque de responsabilité politique de leur société civile. Selon Marcel Gauchet, une raison essentielle de cet affaissement est précisément la chute de tension entre l’Etat et l’Eglise, du fait que l’autonomie de la société politique a cessé d’être un combat : les Eglises et les croyants ont eux-mêmes intériorisé l’idée qu’il «est devenu incongru ou grotesque de mêler l’idée de Dieu à la norme de la société des hommes… L’autonomie l’a emporté; elle règne sans avoir à s’affirmer en face d’un repoussoir fort de l’épaisseur des siècles, et cela change tout» [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. La laïcité s’est elle-même laïcisée ou sécularisée. L’Etat laïc avec ses références «sacrées» (la Révolution, la République, la patrie…) a perdu de son aura. La citoyenneté active en démocratie et l’engagement républicain qu’elle présupposait se sont affaissés eux aussi. Prospère la vague d’individualisme conquérante qui emporte tout sur son passage dans les dernières décennies du XXe siècle. “L’accent fondamental s’est déplacé de l’exercice de la souveraineté des citoyens vers la garantie des droits de l’individu”, pour lequel le politique est incapable de “proposer un horizon intellectuel sensé” [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Il se contente donc de gérer au jour le jour – ce qui n’est pas méprisable, mais en soi peu mobilisateur.
Marcel Gauchet voit dans cette évolution la «neutralisation terminale de l’Etat et le sacre de la société civile», mais en un sens bien précis : «Tout ce qui relève de l’explication ultime, de la prise de position sur le sens de l’aventure humaine se trouve renvoyé du côté des individus – le collectif ne représentant plus, comme il le représentait tout le temps où il était présupposé comme la porte de l’autonomie, un enjeu métaphysique suffisant en lui-même.(…) Rien des raisons suprêmes ne se décrète au niveau commun; celui-ci ne contient pas en soi et par soi de solution au problème de la destinée. Seules des convictions singulières sont habilitées à se prononcer sur les matières de dernier ressort, y compris à propos de l’autonomie, y compris à propos du sens de l’existence en commun» [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. L’autonomie de la société civile s’est transformée en sacre des individus. Il en résulte concrètement une affirmation sans précédent de ses droits privés et de la demande face à l’Etat, une généralisation de l’idée de marché ou une société de marché généralisée à l’ensemble des sphères de la vie, une extension considérable du droit dans les relations sociales, l’apparition massive de la «démocratie d’opinion»…
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
L’engagement individuel oui, mais où sont les militants ?
A partir de cette double situation de faiblesse, on doit évaluer la fécondité ou non des rapports mutuels entre politique et religieux. Car devant cette nouvelle donne, aussi bien la vision sociologique que la vision laïque-politique du religieux se trouvent en porte-à-faux : en effet, les deux présupposaient à la fois une puissance quantitative et une vitalité qualitative du christianisme, des Eglises protestantes et catholiques en particulier. Ce sont les conséquences d’une rupture par rapport à une situation de monopole de la régulation religieuse dans les pays européens, qu’il faut évaluer.
La question concerne avant tout les apports que, comme forces collectives et institutionnelles, les religions et le politique peuvent encore s’offrir mutuellement. Car après tout, à titre individuel, une latitude considérable est laissée à tout un chacun pour des engagements et des initiatives dans la société ou dans le cadre de sa communauté religieuse. Rien n’empêche le chrétien d’être individuellement, pour reprendre la belle expression de Michel Camdessus, «au service du bien public». Dans une société avide de transparence et curieuse, précisément, des raisons et des valeurs privées qui motivent des engagements publics, on connaît ces motifs davantage qu’en d’autres temps, et cette publicité est davantage acceptée par la société pluraliste.
De surcroît, la liberté de choix et d’engagement religieux est garantie, peut-être mieux qu’autrefois (on pense à l’aide à l’enseignement privé sous contrat, ou aux avantages fiscaux liés à des dons pour des fondations et des œuvres, aux subventions publiques en faveur d’objectifs, de travaux, de bâtiments religieux…). Tout au plus peut-on déplorer la faiblesse croissante des engagements militants. Mais on est renvoyé alors à l’affaiblissement des religions, elles-mêmes gagnées par l’individualisme : dans la société comme dans l’Eglise, les individus engagés ne sont pas légion. C’est le consommateur qui triomphe. L’individualisme et ses conséquences entraînent avec eux la fin de l’ère des militants.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Faiblesse collective des religions historiques
Mais la situation véritablement nouvelle est créée par la faiblesse des grandes religions instituées et la fin du monopole religieux de fait qu’elles exerçaient jusqu’à présent dans la société, et qui les faisaient reconnaître comme de «grandes familles spirituelles» de référence, y compris par l’Etat laïc qui avait en fin de compte instauré de multiples compromis dits et non dits avec elles. Juridiquement, elles disposent certes d’avantages qui les rapprochent des «cultes reconnus» (cf. les émissions religieuses sur les chaînes publiques le dimanche matin). On peut penser aussi à des recours ponctuels, mais symboliquement importants, aux religions de la tradition sur la scène publique. Recours caritatif et social : au début des années 80, devant le surgissement des «nouvelles pauvretés», le gouvernement socialiste a fait appel aux organisations caritatives (Secours catholique, Cimade…). En 1995, un appel similaire concernait la présence d’associations chrétiennes dans les quartiers en difficulté. Recours pour une médiation diplomatique (Nouvelle Calédonie). Recours pour la réflexion éthique (Comité national d’éthique). Recours, contesté certes, à l’Eglise catholique pour organiser les funérailles religieuses nationales (et internationales) du président de la République défunt, mais plus ordinairement, présence quasi «officielle» de ministres du culte lors des cérémonies de funérailles collectives pour les victimes de catastrophes [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Ces «attentions» ne sont pas rien. Pourtant, elles n’ont d’égale que l’indifférence des politiques à l’avis des religions - notamment de l’Eglise catholique – sur des décisions qui engagent la marche de la société sur le long cours : décisions économiques et sociales (pour la politique familiale, par exemple), lois qui autorisent de nouvelles libertés personnelles pour des individus ou des catégories sociales (lois accordant à chacun et de plus en plus tôt la libre disposition de son corps...). A l’époque de la «démocratie d’opinion», le politique est ou se croit obligé de suivre et de reconnaître juridiquement les évolutions de la société. «Sacre de la société civile», qui passe outre l’opposition, ni unanime ni identique certes, des grandes familles spirituelles : mais celles-ci dénoncent la rupture du lien social qui résulte de ces lois individualistes.
L’Etat répondrait sans doute que l’Eglise a toute liberté pour se faire entendre dans l’espace public ou faire jouer ses relais au Parlement. L’argument est quelque peu hypocrite. Les dirigeants politiques savent fort bien qu’ils peuvent se passer de l’assentiment de l’Eglise : ses propres fidèles ne la suivent pas sur ces points comme sur d’autres, ce qui rend fragile sa légitimité sur ces questions. Par ailleurs, par une confusion en partie voulue, ces lois individualistes sont souvent revendiquées et votées au nom des «droits de l’homme», de l’égalité et de la justice pour des «victimes» [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Ce label évite de se situer au niveau de l’éthique fondamentale où voudraient se situer les grandes familles religieuses.
Quant au lien social, éventuellement menacé par ces lois, les dirigeants politiques actuels, confrontés à une société pluraliste, préfèrent compter davantage sur les ajustements sociaux de l’Etat-providence et sur une vision procédurale du social que sur des valeurs fondamentales partagées. Certains gouvernements semblent avoir déjà tiré les leçons de cet état de fait : à en croire le cardinal Simonis, archevêque d’Utrecht, «les choses sont allées si loin [en Hollande, où les liens Eglise/Etat étaient plus forts qu’en France] que la croyance chrétienne et l’Eglise n’ont plus aucune signification publique pour le gouvernement. Le gouvernement voit seulement dans ses citoyens des individus, qu’ils soient croyants ou non».
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Les grandes religions en porte-à-faux
Cette nouvelle situation interroge les traditions religieuses. Elles insistent elles-mêmes sur leur apport théorique et pratique à la société civile. Elle se veulent participantes de l’intérêt général. Mais cette prétention n’est-elle pas aujourd’hui démentie par leur faiblesse croissante ? Elles deviennent simplement les groupes les plus importants parmi toutes les dénominations religieuses existantes, et elles ne sont donc plus coextensives aux sociétés européennes. Il y aura des «communautés confessantes», bien ancrées dans la foi et aussi dans le réel, mais plus nombreuses encore risquent d’être, à raison même de la demande de sens et de «spiritualité» dans des sociétés qui en semblent dépourvues, les communautés nouvelles fortement axées sur l’expérience et la vie spirituelle (charismatiques, évangéliques, pentecôtistes…). S’accroîtra aussi, dans le cadre des religions de la tradition, la part des «pèlerins», c’est-à-dire de ces croyants à la pratique intermittente mais intense, participant à des moments forts mais ponctuels [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Loin de moi de mépriser ces modes d’affiliation, mais les formes et surtout la force de leur implication dans le devenir des sociétés civiles n’ont pas de réponse évidente : ils seront une «goutte d’eau dans la mer» [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Les politiques qui se passent de l’instance religieuse ne sont nullement antireligieux : ils entérinent une situation qu’ils n’ont pas les moyens d’inverser - à supposer même qu’ils aient des convictions à ce sujet... Là aussi s’impose en effet le sacre de la société civile, avec le triomphe de l’individu : chacun peut dire à l’Etat : «C’est mon choix» (et mon droit, y compris avec des conformismes incroyables sous couleur de nouveauté). La société civile fait loi pour la sphère politique comme pour la sphère religieuse [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Je suis perplexe dès lors sur la capacité réelle des religions instituées à créer du «lien social» et à jouer un rôle important dans la formation et l’expression de l’esprit public [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Des individus, chrétiens et autres, certainement, à la mesure de leur place, de leurs responsabilités et de leurs initiatives dans la société. Des « communautés confessantes » et des groupes spirituels ayant une belle vitalité, peut-être, mais ponctuellement et de façon limitée [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Questions nouvelles à la laïcité
De nouvelles questions sont aussi posées à la tradition laïque. Officiellement, elle n’aurait que faire du déclin des religions historiques. Cependant, je l’ai dit, d’une part, de nombreux compromis et des quasi-reconnaissances officielles ont été passés avec ces religions instituées, même si – on l’a vu tout récemment – l’idée d’un héritage religieux de l’Europe inscrite dans un texte officiel paraît impossible à accepter. D’autre part et surtout, le nouveau paysage religieux n’a pas grand chose qui puisse réjouir un laïc conséquent : phénomènes d’irrationalité de toutes sortes (en tout cas selon les critères de la raison des Lumières), absence de régulation d’un religieux tributaire de l’offre et de la demande, présence obsédante du phénomène sectaire.
Par rapport à ce dernier, en particulier, la République laïque se trouve en porte-à-faux. Répondant en partie à la demande de la société civile, les gouvernements ont depuis plusieurs années entrepris une véritable croisade anti-sectes.
On peut cependant se demander si les politiques de droite et de gauche qui poursuivent les sectes ne contreviennent pas à l’esprit de la laïcité « à la française », qui ne reconnaît aucun culte ni aucune association religieuse mais permet à tous, au nom de la liberté d’opinion et d’association, d’exister. En réalité, là encore, la société civile commande, car c’est en elle que les individus, obsédés par les droits de l’homme, la tolérance, les victimes, les dangers qui menacent les enfants, les bonnes affaires d’autrui qui paraissent louches…, requièrent que les responsables politiques combattent l’existence même des sectes, considérées comme des groupes criminels avant tout délit constitué. Le respect du pluralisme peut aller loin, mais ici il trouve ses limites : il s’arrête aux portes de ceux qui sont censés ne pas jouer le jeu – et que la rumeur stigmatise comme telles. Ce faisant, la République laïque s’intéresse bel et bien, et quoi qu’elle en dise, au contenu des croyances et aux pratiques des groupes religieux.
En sens inverse, au nom de l’égalité laïque et démocratique de traitement des associations cultuelles, des groupes sectaires réclament des mesures juridiques semblables à celles dont profitent les grands groupes religieux. Une demande qui paraît exorbitante à l’opinion publique et qui est stigmatisée par la plupart des médias. Le Conseil d’Etat et certains magistrats, au cours de procès intentés à des sectes, se sont montrés plus ouverts que l’opinion publique à cette égalité de droits [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. D’autres pays européens, même lorsqu’ils ont des cultes reconnus par la Constitution, accordent un traitement juridique plus favorable à des groupes minoritaires, mettant là comme en d’autres domaines le droit en accord avec l’état des mœurs.
Paradoxalement, avec la lutte antisectes, la République laïque tend à donner par comparaison une meilleure image des grandes religions. Mais c’est une apparence : quand les grandes religions résistent à l’opinion commune, elles sont sévèrement jugées; et sur des affaires sensibles (comme récemment la pédophilie), le droit a tendance, conformément à la demande sociale là encore, à ne plus leur reconnaître de spécificité.
Il est difficile d’espérer que les évolutions religieuses analysées par les sociologues, avec des arguments de poids, puissent s’infléchir dans les décennies qui viennent. C’est d’autant plus impensable qu’au-delà des aspects sociologiques, le christianisme européen, et particulièrement le catholicisme, font l’objet, dans des milieux culturels limités, mais influents, d’un incroyable ressentiment, d’un rejet viscéral, où se mêlent inextricablement des raisons récentes – la fureur contre une certaine résistance à l’individualisme, en particulier à la permissivité dans les comportements sexuels - et anciennes. Une forme de culpabilité s’expulse sans doute dans ces ressentiments… mais laissons ces interprétations de psychanalyse collective. En tout cas, dans ce contexte, la parole des Eglises en Europe - la catholique surtout – n’est pas seulement affaiblie : elles est aussi fortement délégitimée dans l’espace public.
Pour autant, l’avenir n’est pas écrit : est-il impensable que de nouvelles générations, dans une ou deux décennies, ressentent le désir de retrouver la mémoire de leurs origines et de renouer avec un héritage mis sous le boisseau par la génération de leurs pères ? Il se passerait alors pour le christianisme ce qui – dans une mesure qu’il ne faut certes pas enjoliver – est arrivé au judaïsme : il y a quelques décennies, on le croyait tellement «assimilé» que beaucoup, y compris dans ses propres rangs, comptaient sur sa disparition à terme. C’est le contraire qui s’est produit : on a assisté, en passant par une histoire tragique certes, à une renaissance depuis deux ou trois décennies – renaissance réelle malgré des aspects ambigus (identitaires, par exemple). Cette renaissance est-elle exclue pour le christianisme ?
Dans l’immédiat, si on se place dans la perspective du « lien social », la question qui se pose à lui pourrait se formuler ainsi : que faire par rapport à l’individualisme conquérant ? Jusqu’à présent, aucune réponse satisfaisante n’a été apportée par les Eglises à cette question. Les religions en général, et le christianisme en particulier, ne peuvent pas être le simple envers de cet individualisme, les champions de l’engagement et de la solidarité, les créateurs de communautés qui se font les détracteurs de la liberté personnelle des modernes. En sens inverse, chacun sent bien que l’aplatissement pur et simple devant les requêtes des individus n’a pas davantage de sens. Les Eglises n’ont pas encore appris à combiner heureusement le «je» de l’individu et le «nous» du collectif ou de la communauté.
On pourrait aussi se demander : étant acquis que les croyants doivent peu ou prou être au «service du bien public», que signifie cette expression quand il s’agit de groupes religieux ? «Favoriser le lien social», avec l’idée implicite de se couler dans les projets constructifs de l’Etat gestionnaire, est-il la meilleure façon d’y répondre ? La question se pose dès lors que les groupes religieux ne sont plus renvoyés à des fonctions de structuration, ou de subsidiarité, ou de suppléance (fussent-elles implicites, comme en France). Non pas qu’il faille renoncer à ces fonctions, mais il faut peut-être renoncer à penser qu’elles sont seules essentielles ou utiles. Ce qui peut être utile aussi, c’est la capacité de création de sens et d’écarts pratiques propres, sans lien immédiat avec l’Etat et l’intérêt général. Ce sont aussi des voies (et des voix) divergentes, à l’écart des conformismes consuméristes et libéral-libertaires de la société civile, y compris des dérives du «victimisme» - ceci dans le cadre du droit commun certes, mais avec des utopies et des formes de vie qui ne sont pas nécessairement congruentes avec celles des majorités «loft-storisées». Le risque, c’est la secte, ou d’être traité de secte. Mais s’il faut sortir de la vision sociologique qui assigne aux religions uniquement un rôle substantiel dans l’Etat, il faut aussi inciter l’Etat laïc à admettre que des croyants puissent ne pas être des bien-pensants dans la société civile postmoderne.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Robert A. Nisbet, La tradition sociologique, coll. Quadrige, Puf, 1996, p. 277.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Cf. parmi beaucoup d’autres, Danièle Hervieu-Léger et Jean-Paul Willaime, Sociologies et religion. Approchesclassiques, Puf, 2001, ch. 2. Cf. aussi Pierre Bréchon, Les grands courants de la sociologie, Presses Universitaires de Grenoble, 2001.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Danièle Hervieu-Léger et Jean-Paul Willaime, id., p. 70.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Id., p. 112.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Pierre Bréchon, id., p. 69.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]L’ouvrage récent, Le religieux des sociologues. Trajectoires personnelles et débats scientifiques, L’Harmattan, 1997, où s’expriment les sociologues de la religion d’aujourd’hui, ne dément pas, me semble-t-il, ce qui précède : malgré la diversité des points de vue, l’intérêt pour la dynamique interne des religions est manifeste.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Là aussi, parmi beaucoup, cf. Jean Boussinesq, «Laïcité au pluriel», Projet n° 225, p. 7-15. J. Boussinesq met en lumière de façon très convaincante la «philosophie libérale au bon sens du mot» qui préside à nos institutions laïques. Mais on ne peut oublier entièrement le contexte de la «guerre des deux France», qui a littéralement produit deux religions mimétiques et antagonistes ; cf. Jean-Paul Willaime, «Laïcité et religion en France», dans Identités religieuses en Europe, sous la direction de G. Davie et D. Hervieu-Léger, La Découverte, 1996, p. 158-163.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]On en trouve des traces dans le livre édité par la Ligue de l’Enseignement, Vers un humanisme laïque du IIIe millénaire. Réflexions pour un humanisme laïque renouvelé, Le Cherche Midi Editeur, 2000.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Paul Valadier, op. cit., p. 88-90. Cf. aussi René Rémond, «La laïcité», ch. 4 du livre collectif Les grandesinventions du christianisme, Bayard Editions, 2000, p. 97-116.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Jean-Claude Eslin, Dieu et le pouvoir. Théologie et politique en Occident, Seuil, 1999, p. 260.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Titre du numéro spécial d’ Esprit de juin 1997, qui contient enquêtes et analyses sur ce thème.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Cf. Jean-Louis Schlegel, Religions à la carte, Hachette, 1995. De nombreux livres ont décrit ces dernières années la nouvelle situation religieuse. Cf. récemment, sous la dir. de Pierre Bréchon, Les valeurs des Français. Evolutions de 1980 à 2000, Armand Colin, 2000, ch. 7 (Yves Lambert : «Développement du hors piste et de la randonnée», p. 129-153). Pour une approche européenne, cf. Identités religieuses en Europe, op. cit.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Selon Yves Lambert, dans Futuribles, janvier 2001, «Le devenir de la religion en Occident», p. 38; dans le même sens, l’article qui suit, de Pierre Bréchon, «L’évolution du religieux».
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Cf. B. Ugeux, Guérir à tout prix ?, L’Atelier, 2000, ou Jean Vernette et Claire Moncelon, Les nouvellesthérapies, Presses de la Renaissance, 1999.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]La religion dans la démocratie. Parcours de la laïcité, coll. Le Débat, Gallimard, 1998.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Marcel Gauchet, dans Projet n° 225, op. cit., p. 44.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Marcel Gauchet, La Religion dans la démocratie, op. cit., p. 76-77.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Mais à rapprocher des cellules d’aide psychologique convoquées pour permettre aux survivants et aux familles d’affronter la mort et le deuil : au prêtre le culte, au «psy» le soutien spirituel, dans un contexte où la crise de la foi en l’au-delà rend la mort plus difficile à affronter. Il s’agit d’une sécularisation de la situation de catastrophe.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Sur la «société victimale», ressort essentiel du social dans la société civile d’aujourd’hui, cf. Antoine Garapon et Denis Salas, La République pénalisée, Hachette, 1996.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Cf. D. Hervieu-Léger, Le Pèlerin et le converti, Flammarion, 1999.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]C’est le terme qu’employait naguère Michel de Certeau pour dire le sort – accepté par lui – du croyant dans la société moderne : cf. (avec Jean-Marie Domenach), Le Christianisme éclaté, Seuil, 1974, p. 79-89.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Pour plusieurs lois récentes (parité, PACS…), le gouvernement – Monsieur Jospin en premier – ainsi que les parlementaires ont semblé plutôt réticents au départ, en tout cas sur l’extension de ces lois. Ils les ont avalisées sous la pression de lobbies à la fois puissants et habiles, et devant une opinion publique passéiste.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Comme dit Jean Weydert dans Projet n° 240, op. cit., p. 98.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Je pense à une communauté comme Sant’ Egidio, fondée par des laïcs italiens dans les années 70 (40000 membres aujourd’hui), qui a proposé sa médiation dans le domaine politique (entre islamistes et pouvoir algérien notamment).
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Récemment, en Allemagne, la Cour fédérale constitutionnelle de Karlsruhe a donné raison, contre la Cour fédérale administrative de Berlin, aux Témoins de Jéhovah, qui réclamaient le statut juridique des autres communautés religieuses (celui de «corporations de droit public»). En France, ce statut a été refusé jusqu’à présent aux Témoins (et à d’autres groupes «sectaires» qui le demandent).
Le religieux face au politique
La société a-t-elle besoin du religieux ? Oui sans doute. Mais ce religieux est disséminé, vécu « à la carte » par l’individu. Quant au politique, il gère mais ne mobilise plus les citoyens. D’où la même relative faiblesse de l’Etat et des Eglises, le même déclin du militantisme.
Le partage entre religion et politique, tel qu’il a été pensé depuis deux siècles, en France surtout, correspond à deux visions de base (certes en elles-mêmes très différenciées) du religieux et de ce qu’il représente pour la société politique. Cette dualité joue aussi quand nous évaluons les rapports entre lien social et religion – y compris dans l’Europe politique en train de naître, qui hésite entre les deux conceptions. L’une de ces visions est davantage sociologique, et l’autre politique. Sans être totalement exclusives l’une de l’autre, elles impliquent des options différentes sur la place du religieux dans la société. Or l’une et l’autre sont remises en question par la situation nouvelle faite aux démocraties et aux religions dans les sociétés dites postmodernes.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Thèse sociologique : la religion a un contenu substantiel pour la société
Toute une tradition sociologique, bien qu’agnostique ou athée, a insisté sur le rôle des religions pour les sociétés. Elle s’est opposée ainsi à une tradition rationaliste qui culmine au XVIIIe siècle, selon laquelle “la religion, et en particulier le christianisme, est un fatras de superstitions dont seuls les êtres auxquels font défaut les Lumières et la raison ont besoin”. L’émancipation selon les philosophes impliquait que la religion disparaisse afin que les sociétés et les Etats soient enfin rendus à eux-mêmes, à la maîtrise de l’ici-bas [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour la plupart des sociologues du XIXe siècle, au contraire, l’Etat et la société sont sinon menacés dans leur existence, du moins affectés dans la qualité et la cohésion de cette existence, par le recul de la religion. A leurs yeux, celle-ci n’est pas d’abord constituée de connaissances et de convictions intellectuelles vraies ou fausses, ni d’institutions chargées de les produire, de les répandre et de les surveiller, mais de sentiments et d’aspirations, de valeurs et d’incitations morales, de rites et de cérémonies, de comportements et de règles de vie, de solidarités communautaires et extra-communautaires. Bref, la religion a un contenu substantiel. Tocqueville, pourtant sévère envers les instances catholiques, s’interroge sur l’utilité de la religion – catholicisme compris – pour vitaliser la démocratie [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Max Weber, pour qui la religion implique avant tout des “systèmes de règlement de la vie” [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a tenté de montrer les liens entre éthique protestante et esprit du capitalisme. Pour Georg Simmel, les “théories sociales ne peuvent pas éviter de reconnaître le rôle effectif du sentiment religieux dans les mouvements des sociétés, même modernes” [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. De même Durkheim : «Les religions doivent être l’expression de la conscience collective». Il est vrai qu’il s’agit pour lui avant tout de cette «religion» qui constitue la communauté morale de la République laïque [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Une autre perspective, plus conservatrice, ajoute qu’un fondement transcendant est nécessaire pour faire contrepoids à la caducité des choses humaines et leur donner un socle d’éternité. Elle réclame une restauration, fût-elle autoritaire, du rôle de la religion dans la cité politique. Mais plus largement, les sociologues s’interrogent avant tout sur le sens et les conséquences socio-politiques de la faiblesse et du recul de la religion, sur ce qui peut tisser le lien social “après” la religion, ou sur les substituts de cette dernière qui apparaissent sur la scène sociale (le sport de masse, par exemple). Ce n’est sans doute pas un hasard si ces sociologues sont souvent issus de pays anglo-saxons, où la sécularisation s’est propagée sans avoir à mettre en œuvre la laïcisation volontariste dont la France notamment est le théâtre lors de la Révolution et à partir de la fin du XIXe siècle. Mais on peut comprendre que cette vision plus «interne» du religieux et de sa place sociale puisse séduire le catholicisme [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Elle peut même apporter de l’eau à son moulin. C’est l’une des raisons, à mon sens, qui fait que des religieux auraient quelque motif de trouver minimal ou insuffisant un enseignement neutre d’histoire des religions en termes de simples connaissances religieuses : non qu’ils veuillent un enseignement confessionnel voire prosélyte, mais ils ont le sentiment que le fait religieux réduit à des idées et des événements est profondément tronqué.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Thèse politique : la société peut se passer du religieux
En sens inverse, chez les “laïques à la française”, même partisans du compromis et de la paix avec l’Eglise catholique, on veut ignorer ces réflexions sur le rôle social de la religion. Ils se sont au départ, diversement certes, inscrits dans la lignée des philosophes antireligieux, même si, par la suite, les lois laïques sont devenues avant tout un mode de gestion de la séparation et de la pluralité des religions au sein de l’Etat [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Dans cette perspective, la religion comme telle n’a aucun rôle structurant pour la société. Elle n’a pas de légitimité publique ni d’utilité sociale que l’Etat puisse reconnaître. Elle doit rester confinée dans la vie privée et sa visibilité publique rester minimale. L’Etat, situé hors et au dessus de la pluralité religieuse, garantit la liberté égale de toutes les religions, sans en reconnaître aucune. Les individus peuvent alors de plein droit vivre leurs engagements et leurs convictions dans la Cité humaine, ils apporter à titre personnel leur pierre dans l’espace public, agir dans l’intérêt général, mais les associations qu’ils constituent, les assemblées religieuses auxquelles ils participent, les travaux et les solidarités qu’ils organisent, les croyances qu’ils partagent n’ont pas de pertinence sociale ou politique reconnue par l’Etat.
Les aspects anticléricaux ou antireligieux qui ont présidé à la naissance de ce modèle n’ont pas toujours disparu dans les milieux laïcs militants. Ils persistent sous la forme d’une mésestime ou, au minimum, d’une méfiance [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. De son côté, l’Eglise catholique a fini par s’accommoder du partage laïc en France – par l’accepter globalement avec des réserves et des exceptions (comme l’enseignement privé). Des catholiques le défendent farouchement au nom de la fidélité à l’Evangile : le christianisme n’a nul besoin de reconnaissances étatiques, que ce soit comme fondement du lien social ou comme partenaire reconnu “utile” dans la sphère publique, et cette déliaison est au contraire liberté pour agir et apporter sa pierre sociale, caritative, éthique…, au bien commun [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Contrainte de ne compter que sur elle-même, sur sa vitalité spirituelle et son imagination, l’Eglise catholique a en fin de compte bénéficié de la laïcité française.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Une tension féconde
J’ai parlé indifféremment du religieux, de la religion et des religions. En fait, l’évocation du catholicisme rappelle que nous sommes dans le domaine chrétien, et que la tension dont il est question est avant tout inscrite dans l’histoire de l’Occident. Jean-Claude Eslin l’exprime dans les termes suivants : “Les prophètes et le Christ ont introduit une dualité dans l’histoire occidentale, et les formes d’unité se sont reconstituées autrement, laborieusement. La dualité des principes opposée à toute réduction à l’unité sous quelque prétexte que ce soit constitue, semble-t-il, la racine du dynamisme de l’Occident dans l’histoire. […] La dualité des principes peut être mise en cause par l’affaiblissement interne de l’un des principes, quand par exemple les expressions religieuses s’affaiblissent, (…) quand le pouvoir spirituel, au fil des guerres de religion, des divisions de la chrétienté ou de sa responsabilité dans les catastrophes du XXe siècle, semble s’être perdu lui-même. L’Etat tend alors, en dépit de tous les regrets et de toutes les larmes versées, et de tous les désirs de réappropriation de la société civile, à devenir un pôle unique de légitimité, ce qui est pour lui la pente naturelle. Il arrive aussi que ce soit le principe politique qui devienne trop faible, et la dualité est alors mise en cause au profit de l’Eglise qui assume des fonctions qui ne sont pas les siennes”. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Faiblesse du pôle religieux…
Qui dit faiblesse du religieux doit préciser ce dont il est question. La faiblesse n’est pas l’absence, car d’un certain point de vue, on devrait plutôt insister sur l’omniprésence du religieux au “temps des religions sans Dieu” [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Faiblesse veut dire avant tout éclatement et dissémination du religieux. Sous l’effet de l’individualisme, les appartenances se dissolvent ou se relâchent, et la religion est vécue “à la carte” [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] dans l’ensemble de ses dimensions (pratiques cultuelles et éthiques, croyances…). Dès 1994, plus de deux tiers des individus interrogés se disaient d'accord avec la formule : “De nos jours, chacun doit définir sa religion indépendamment des Eglises” [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Les sociologues ont analysé les nombreuses facettes de ce nouvel univers des croyances, où règnent le religieux “buissonnier”, le religieux “bricolé”, le religieux “hors appartenance”, les “croyances flottantes”, le tout assorti d’un fort relativisme. Les intérêts continués pour la question religieuse sont souvent liés à la réalisation de soi “dans le monde” : on espère d’eux un “plus”, des atouts pour affronter la vie, un mieux être, une aide implicitement ou explicitement de nature thérapeutique [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Dans cette évolution, l’Eglise catholique devient elle-même un groupe minoritaire, si l’on entend par là non seulement le noyau des catholiques pratiquants fidèles, pour l’essentiel, à la doctrine catholique et aux directives éthiques du pape et des évêques, mais tout simplement les Français qui se disent catholiques.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
… et du pôle politique
Mais peut-on dire que nous nous trouvons seulement devant un christianisme «malade» face à un politique dont la légitimité serait intacte ? C’est plutôt l’inverse qui est vrai – et préoccupant : alors que, du point du administratif, financier, matériel, les Etats sont des machines énormes avec des capacités d’intervention inégalées, nombre d’observateurs insistent sur la carence proprement politique des démocraties européennes, sur leur déficit symbolique et sur le manque de responsabilité politique de leur société civile. Selon Marcel Gauchet, une raison essentielle de cet affaissement est précisément la chute de tension entre l’Etat et l’Eglise, du fait que l’autonomie de la société politique a cessé d’être un combat : les Eglises et les croyants ont eux-mêmes intériorisé l’idée qu’il «est devenu incongru ou grotesque de mêler l’idée de Dieu à la norme de la société des hommes… L’autonomie l’a emporté; elle règne sans avoir à s’affirmer en face d’un repoussoir fort de l’épaisseur des siècles, et cela change tout» [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. La laïcité s’est elle-même laïcisée ou sécularisée. L’Etat laïc avec ses références «sacrées» (la Révolution, la République, la patrie…) a perdu de son aura. La citoyenneté active en démocratie et l’engagement républicain qu’elle présupposait se sont affaissés eux aussi. Prospère la vague d’individualisme conquérante qui emporte tout sur son passage dans les dernières décennies du XXe siècle. “L’accent fondamental s’est déplacé de l’exercice de la souveraineté des citoyens vers la garantie des droits de l’individu”, pour lequel le politique est incapable de “proposer un horizon intellectuel sensé” [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Il se contente donc de gérer au jour le jour – ce qui n’est pas méprisable, mais en soi peu mobilisateur.
Marcel Gauchet voit dans cette évolution la «neutralisation terminale de l’Etat et le sacre de la société civile», mais en un sens bien précis : «Tout ce qui relève de l’explication ultime, de la prise de position sur le sens de l’aventure humaine se trouve renvoyé du côté des individus – le collectif ne représentant plus, comme il le représentait tout le temps où il était présupposé comme la porte de l’autonomie, un enjeu métaphysique suffisant en lui-même.(…) Rien des raisons suprêmes ne se décrète au niveau commun; celui-ci ne contient pas en soi et par soi de solution au problème de la destinée. Seules des convictions singulières sont habilitées à se prononcer sur les matières de dernier ressort, y compris à propos de l’autonomie, y compris à propos du sens de l’existence en commun» [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. L’autonomie de la société civile s’est transformée en sacre des individus. Il en résulte concrètement une affirmation sans précédent de ses droits privés et de la demande face à l’Etat, une généralisation de l’idée de marché ou une société de marché généralisée à l’ensemble des sphères de la vie, une extension considérable du droit dans les relations sociales, l’apparition massive de la «démocratie d’opinion»…
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
L’engagement individuel oui, mais où sont les militants ?
A partir de cette double situation de faiblesse, on doit évaluer la fécondité ou non des rapports mutuels entre politique et religieux. Car devant cette nouvelle donne, aussi bien la vision sociologique que la vision laïque-politique du religieux se trouvent en porte-à-faux : en effet, les deux présupposaient à la fois une puissance quantitative et une vitalité qualitative du christianisme, des Eglises protestantes et catholiques en particulier. Ce sont les conséquences d’une rupture par rapport à une situation de monopole de la régulation religieuse dans les pays européens, qu’il faut évaluer.
La question concerne avant tout les apports que, comme forces collectives et institutionnelles, les religions et le politique peuvent encore s’offrir mutuellement. Car après tout, à titre individuel, une latitude considérable est laissée à tout un chacun pour des engagements et des initiatives dans la société ou dans le cadre de sa communauté religieuse. Rien n’empêche le chrétien d’être individuellement, pour reprendre la belle expression de Michel Camdessus, «au service du bien public». Dans une société avide de transparence et curieuse, précisément, des raisons et des valeurs privées qui motivent des engagements publics, on connaît ces motifs davantage qu’en d’autres temps, et cette publicité est davantage acceptée par la société pluraliste.
De surcroît, la liberté de choix et d’engagement religieux est garantie, peut-être mieux qu’autrefois (on pense à l’aide à l’enseignement privé sous contrat, ou aux avantages fiscaux liés à des dons pour des fondations et des œuvres, aux subventions publiques en faveur d’objectifs, de travaux, de bâtiments religieux…). Tout au plus peut-on déplorer la faiblesse croissante des engagements militants. Mais on est renvoyé alors à l’affaiblissement des religions, elles-mêmes gagnées par l’individualisme : dans la société comme dans l’Eglise, les individus engagés ne sont pas légion. C’est le consommateur qui triomphe. L’individualisme et ses conséquences entraînent avec eux la fin de l’ère des militants.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Faiblesse collective des religions historiques
Mais la situation véritablement nouvelle est créée par la faiblesse des grandes religions instituées et la fin du monopole religieux de fait qu’elles exerçaient jusqu’à présent dans la société, et qui les faisaient reconnaître comme de «grandes familles spirituelles» de référence, y compris par l’Etat laïc qui avait en fin de compte instauré de multiples compromis dits et non dits avec elles. Juridiquement, elles disposent certes d’avantages qui les rapprochent des «cultes reconnus» (cf. les émissions religieuses sur les chaînes publiques le dimanche matin). On peut penser aussi à des recours ponctuels, mais symboliquement importants, aux religions de la tradition sur la scène publique. Recours caritatif et social : au début des années 80, devant le surgissement des «nouvelles pauvretés», le gouvernement socialiste a fait appel aux organisations caritatives (Secours catholique, Cimade…). En 1995, un appel similaire concernait la présence d’associations chrétiennes dans les quartiers en difficulté. Recours pour une médiation diplomatique (Nouvelle Calédonie). Recours pour la réflexion éthique (Comité national d’éthique). Recours, contesté certes, à l’Eglise catholique pour organiser les funérailles religieuses nationales (et internationales) du président de la République défunt, mais plus ordinairement, présence quasi «officielle» de ministres du culte lors des cérémonies de funérailles collectives pour les victimes de catastrophes [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Ces «attentions» ne sont pas rien. Pourtant, elles n’ont d’égale que l’indifférence des politiques à l’avis des religions - notamment de l’Eglise catholique – sur des décisions qui engagent la marche de la société sur le long cours : décisions économiques et sociales (pour la politique familiale, par exemple), lois qui autorisent de nouvelles libertés personnelles pour des individus ou des catégories sociales (lois accordant à chacun et de plus en plus tôt la libre disposition de son corps...). A l’époque de la «démocratie d’opinion», le politique est ou se croit obligé de suivre et de reconnaître juridiquement les évolutions de la société. «Sacre de la société civile», qui passe outre l’opposition, ni unanime ni identique certes, des grandes familles spirituelles : mais celles-ci dénoncent la rupture du lien social qui résulte de ces lois individualistes.
L’Etat répondrait sans doute que l’Eglise a toute liberté pour se faire entendre dans l’espace public ou faire jouer ses relais au Parlement. L’argument est quelque peu hypocrite. Les dirigeants politiques savent fort bien qu’ils peuvent se passer de l’assentiment de l’Eglise : ses propres fidèles ne la suivent pas sur ces points comme sur d’autres, ce qui rend fragile sa légitimité sur ces questions. Par ailleurs, par une confusion en partie voulue, ces lois individualistes sont souvent revendiquées et votées au nom des «droits de l’homme», de l’égalité et de la justice pour des «victimes» [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Ce label évite de se situer au niveau de l’éthique fondamentale où voudraient se situer les grandes familles religieuses.
Quant au lien social, éventuellement menacé par ces lois, les dirigeants politiques actuels, confrontés à une société pluraliste, préfèrent compter davantage sur les ajustements sociaux de l’Etat-providence et sur une vision procédurale du social que sur des valeurs fondamentales partagées. Certains gouvernements semblent avoir déjà tiré les leçons de cet état de fait : à en croire le cardinal Simonis, archevêque d’Utrecht, «les choses sont allées si loin [en Hollande, où les liens Eglise/Etat étaient plus forts qu’en France] que la croyance chrétienne et l’Eglise n’ont plus aucune signification publique pour le gouvernement. Le gouvernement voit seulement dans ses citoyens des individus, qu’ils soient croyants ou non».
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Les grandes religions en porte-à-faux
Cette nouvelle situation interroge les traditions religieuses. Elles insistent elles-mêmes sur leur apport théorique et pratique à la société civile. Elle se veulent participantes de l’intérêt général. Mais cette prétention n’est-elle pas aujourd’hui démentie par leur faiblesse croissante ? Elles deviennent simplement les groupes les plus importants parmi toutes les dénominations religieuses existantes, et elles ne sont donc plus coextensives aux sociétés européennes. Il y aura des «communautés confessantes», bien ancrées dans la foi et aussi dans le réel, mais plus nombreuses encore risquent d’être, à raison même de la demande de sens et de «spiritualité» dans des sociétés qui en semblent dépourvues, les communautés nouvelles fortement axées sur l’expérience et la vie spirituelle (charismatiques, évangéliques, pentecôtistes…). S’accroîtra aussi, dans le cadre des religions de la tradition, la part des «pèlerins», c’est-à-dire de ces croyants à la pratique intermittente mais intense, participant à des moments forts mais ponctuels [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Loin de moi de mépriser ces modes d’affiliation, mais les formes et surtout la force de leur implication dans le devenir des sociétés civiles n’ont pas de réponse évidente : ils seront une «goutte d’eau dans la mer» [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Les politiques qui se passent de l’instance religieuse ne sont nullement antireligieux : ils entérinent une situation qu’ils n’ont pas les moyens d’inverser - à supposer même qu’ils aient des convictions à ce sujet... Là aussi s’impose en effet le sacre de la société civile, avec le triomphe de l’individu : chacun peut dire à l’Etat : «C’est mon choix» (et mon droit, y compris avec des conformismes incroyables sous couleur de nouveauté). La société civile fait loi pour la sphère politique comme pour la sphère religieuse [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Je suis perplexe dès lors sur la capacité réelle des religions instituées à créer du «lien social» et à jouer un rôle important dans la formation et l’expression de l’esprit public [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Des individus, chrétiens et autres, certainement, à la mesure de leur place, de leurs responsabilités et de leurs initiatives dans la société. Des « communautés confessantes » et des groupes spirituels ayant une belle vitalité, peut-être, mais ponctuellement et de façon limitée [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Questions nouvelles à la laïcité
De nouvelles questions sont aussi posées à la tradition laïque. Officiellement, elle n’aurait que faire du déclin des religions historiques. Cependant, je l’ai dit, d’une part, de nombreux compromis et des quasi-reconnaissances officielles ont été passés avec ces religions instituées, même si – on l’a vu tout récemment – l’idée d’un héritage religieux de l’Europe inscrite dans un texte officiel paraît impossible à accepter. D’autre part et surtout, le nouveau paysage religieux n’a pas grand chose qui puisse réjouir un laïc conséquent : phénomènes d’irrationalité de toutes sortes (en tout cas selon les critères de la raison des Lumières), absence de régulation d’un religieux tributaire de l’offre et de la demande, présence obsédante du phénomène sectaire.
Par rapport à ce dernier, en particulier, la République laïque se trouve en porte-à-faux. Répondant en partie à la demande de la société civile, les gouvernements ont depuis plusieurs années entrepris une véritable croisade anti-sectes.
On peut cependant se demander si les politiques de droite et de gauche qui poursuivent les sectes ne contreviennent pas à l’esprit de la laïcité « à la française », qui ne reconnaît aucun culte ni aucune association religieuse mais permet à tous, au nom de la liberté d’opinion et d’association, d’exister. En réalité, là encore, la société civile commande, car c’est en elle que les individus, obsédés par les droits de l’homme, la tolérance, les victimes, les dangers qui menacent les enfants, les bonnes affaires d’autrui qui paraissent louches…, requièrent que les responsables politiques combattent l’existence même des sectes, considérées comme des groupes criminels avant tout délit constitué. Le respect du pluralisme peut aller loin, mais ici il trouve ses limites : il s’arrête aux portes de ceux qui sont censés ne pas jouer le jeu – et que la rumeur stigmatise comme telles. Ce faisant, la République laïque s’intéresse bel et bien, et quoi qu’elle en dise, au contenu des croyances et aux pratiques des groupes religieux.
En sens inverse, au nom de l’égalité laïque et démocratique de traitement des associations cultuelles, des groupes sectaires réclament des mesures juridiques semblables à celles dont profitent les grands groupes religieux. Une demande qui paraît exorbitante à l’opinion publique et qui est stigmatisée par la plupart des médias. Le Conseil d’Etat et certains magistrats, au cours de procès intentés à des sectes, se sont montrés plus ouverts que l’opinion publique à cette égalité de droits [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. D’autres pays européens, même lorsqu’ils ont des cultes reconnus par la Constitution, accordent un traitement juridique plus favorable à des groupes minoritaires, mettant là comme en d’autres domaines le droit en accord avec l’état des mœurs.
Paradoxalement, avec la lutte antisectes, la République laïque tend à donner par comparaison une meilleure image des grandes religions. Mais c’est une apparence : quand les grandes religions résistent à l’opinion commune, elles sont sévèrement jugées; et sur des affaires sensibles (comme récemment la pédophilie), le droit a tendance, conformément à la demande sociale là encore, à ne plus leur reconnaître de spécificité.
Il est difficile d’espérer que les évolutions religieuses analysées par les sociologues, avec des arguments de poids, puissent s’infléchir dans les décennies qui viennent. C’est d’autant plus impensable qu’au-delà des aspects sociologiques, le christianisme européen, et particulièrement le catholicisme, font l’objet, dans des milieux culturels limités, mais influents, d’un incroyable ressentiment, d’un rejet viscéral, où se mêlent inextricablement des raisons récentes – la fureur contre une certaine résistance à l’individualisme, en particulier à la permissivité dans les comportements sexuels - et anciennes. Une forme de culpabilité s’expulse sans doute dans ces ressentiments… mais laissons ces interprétations de psychanalyse collective. En tout cas, dans ce contexte, la parole des Eglises en Europe - la catholique surtout – n’est pas seulement affaiblie : elles est aussi fortement délégitimée dans l’espace public.
Pour autant, l’avenir n’est pas écrit : est-il impensable que de nouvelles générations, dans une ou deux décennies, ressentent le désir de retrouver la mémoire de leurs origines et de renouer avec un héritage mis sous le boisseau par la génération de leurs pères ? Il se passerait alors pour le christianisme ce qui – dans une mesure qu’il ne faut certes pas enjoliver – est arrivé au judaïsme : il y a quelques décennies, on le croyait tellement «assimilé» que beaucoup, y compris dans ses propres rangs, comptaient sur sa disparition à terme. C’est le contraire qui s’est produit : on a assisté, en passant par une histoire tragique certes, à une renaissance depuis deux ou trois décennies – renaissance réelle malgré des aspects ambigus (identitaires, par exemple). Cette renaissance est-elle exclue pour le christianisme ?
Dans l’immédiat, si on se place dans la perspective du « lien social », la question qui se pose à lui pourrait se formuler ainsi : que faire par rapport à l’individualisme conquérant ? Jusqu’à présent, aucune réponse satisfaisante n’a été apportée par les Eglises à cette question. Les religions en général, et le christianisme en particulier, ne peuvent pas être le simple envers de cet individualisme, les champions de l’engagement et de la solidarité, les créateurs de communautés qui se font les détracteurs de la liberté personnelle des modernes. En sens inverse, chacun sent bien que l’aplatissement pur et simple devant les requêtes des individus n’a pas davantage de sens. Les Eglises n’ont pas encore appris à combiner heureusement le «je» de l’individu et le «nous» du collectif ou de la communauté.
On pourrait aussi se demander : étant acquis que les croyants doivent peu ou prou être au «service du bien public», que signifie cette expression quand il s’agit de groupes religieux ? «Favoriser le lien social», avec l’idée implicite de se couler dans les projets constructifs de l’Etat gestionnaire, est-il la meilleure façon d’y répondre ? La question se pose dès lors que les groupes religieux ne sont plus renvoyés à des fonctions de structuration, ou de subsidiarité, ou de suppléance (fussent-elles implicites, comme en France). Non pas qu’il faille renoncer à ces fonctions, mais il faut peut-être renoncer à penser qu’elles sont seules essentielles ou utiles. Ce qui peut être utile aussi, c’est la capacité de création de sens et d’écarts pratiques propres, sans lien immédiat avec l’Etat et l’intérêt général. Ce sont aussi des voies (et des voix) divergentes, à l’écart des conformismes consuméristes et libéral-libertaires de la société civile, y compris des dérives du «victimisme» - ceci dans le cadre du droit commun certes, mais avec des utopies et des formes de vie qui ne sont pas nécessairement congruentes avec celles des majorités «loft-storisées». Le risque, c’est la secte, ou d’être traité de secte. Mais s’il faut sortir de la vision sociologique qui assigne aux religions uniquement un rôle substantiel dans l’Etat, il faut aussi inciter l’Etat laïc à admettre que des croyants puissent ne pas être des bien-pensants dans la société civile postmoderne.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Robert A. Nisbet, La tradition sociologique, coll. Quadrige, Puf, 1996, p. 277.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Cf. parmi beaucoup d’autres, Danièle Hervieu-Léger et Jean-Paul Willaime, Sociologies et religion. Approchesclassiques, Puf, 2001, ch. 2. Cf. aussi Pierre Bréchon, Les grands courants de la sociologie, Presses Universitaires de Grenoble, 2001.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Danièle Hervieu-Léger et Jean-Paul Willaime, id., p. 70.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Id., p. 112.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Pierre Bréchon, id., p. 69.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]L’ouvrage récent, Le religieux des sociologues. Trajectoires personnelles et débats scientifiques, L’Harmattan, 1997, où s’expriment les sociologues de la religion d’aujourd’hui, ne dément pas, me semble-t-il, ce qui précède : malgré la diversité des points de vue, l’intérêt pour la dynamique interne des religions est manifeste.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Là aussi, parmi beaucoup, cf. Jean Boussinesq, «Laïcité au pluriel», Projet n° 225, p. 7-15. J. Boussinesq met en lumière de façon très convaincante la «philosophie libérale au bon sens du mot» qui préside à nos institutions laïques. Mais on ne peut oublier entièrement le contexte de la «guerre des deux France», qui a littéralement produit deux religions mimétiques et antagonistes ; cf. Jean-Paul Willaime, «Laïcité et religion en France», dans Identités religieuses en Europe, sous la direction de G. Davie et D. Hervieu-Léger, La Découverte, 1996, p. 158-163.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]On en trouve des traces dans le livre édité par la Ligue de l’Enseignement, Vers un humanisme laïque du IIIe millénaire. Réflexions pour un humanisme laïque renouvelé, Le Cherche Midi Editeur, 2000.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Paul Valadier, op. cit., p. 88-90. Cf. aussi René Rémond, «La laïcité», ch. 4 du livre collectif Les grandesinventions du christianisme, Bayard Editions, 2000, p. 97-116.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Jean-Claude Eslin, Dieu et le pouvoir. Théologie et politique en Occident, Seuil, 1999, p. 260.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Titre du numéro spécial d’ Esprit de juin 1997, qui contient enquêtes et analyses sur ce thème.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Cf. Jean-Louis Schlegel, Religions à la carte, Hachette, 1995. De nombreux livres ont décrit ces dernières années la nouvelle situation religieuse. Cf. récemment, sous la dir. de Pierre Bréchon, Les valeurs des Français. Evolutions de 1980 à 2000, Armand Colin, 2000, ch. 7 (Yves Lambert : «Développement du hors piste et de la randonnée», p. 129-153). Pour une approche européenne, cf. Identités religieuses en Europe, op. cit.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Selon Yves Lambert, dans Futuribles, janvier 2001, «Le devenir de la religion en Occident», p. 38; dans le même sens, l’article qui suit, de Pierre Bréchon, «L’évolution du religieux».
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Cf. B. Ugeux, Guérir à tout prix ?, L’Atelier, 2000, ou Jean Vernette et Claire Moncelon, Les nouvellesthérapies, Presses de la Renaissance, 1999.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]La religion dans la démocratie. Parcours de la laïcité, coll. Le Débat, Gallimard, 1998.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Marcel Gauchet, dans Projet n° 225, op. cit., p. 44.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Marcel Gauchet, La Religion dans la démocratie, op. cit., p. 76-77.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Mais à rapprocher des cellules d’aide psychologique convoquées pour permettre aux survivants et aux familles d’affronter la mort et le deuil : au prêtre le culte, au «psy» le soutien spirituel, dans un contexte où la crise de la foi en l’au-delà rend la mort plus difficile à affronter. Il s’agit d’une sécularisation de la situation de catastrophe.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Sur la «société victimale», ressort essentiel du social dans la société civile d’aujourd’hui, cf. Antoine Garapon et Denis Salas, La République pénalisée, Hachette, 1996.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Cf. D. Hervieu-Léger, Le Pèlerin et le converti, Flammarion, 1999.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]C’est le terme qu’employait naguère Michel de Certeau pour dire le sort – accepté par lui – du croyant dans la société moderne : cf. (avec Jean-Marie Domenach), Le Christianisme éclaté, Seuil, 1974, p. 79-89.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Pour plusieurs lois récentes (parité, PACS…), le gouvernement – Monsieur Jospin en premier – ainsi que les parlementaires ont semblé plutôt réticents au départ, en tout cas sur l’extension de ces lois. Ils les ont avalisées sous la pression de lobbies à la fois puissants et habiles, et devant une opinion publique passéiste.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Comme dit Jean Weydert dans Projet n° 240, op. cit., p. 98.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Je pense à une communauté comme Sant’ Egidio, fondée par des laïcs italiens dans les années 70 (40000 membres aujourd’hui), qui a proposé sa médiation dans le domaine politique (entre islamistes et pouvoir algérien notamment).
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Récemment, en Allemagne, la Cour fédérale constitutionnelle de Karlsruhe a donné raison, contre la Cour fédérale administrative de Berlin, aux Témoins de Jéhovah, qui réclamaient le statut juridique des autres communautés religieuses (celui de «corporations de droit public»). En France, ce statut a été refusé jusqu’à présent aux Témoins (et à d’autres groupes «sectaires» qui le demandent).
 Re: Forum Religion et Politique
Re: Forum Religion et Politique
... I à XV montrent tout d’abord que pour l’exercice de la piété, il est nécessaire d’admettre le libre exercice de la raison. Le propre des religions est d’affirmer cependant que les Écritures sont issues d’une Révélation surnaturelle. A quoi Spinoza répond que, certes, parce que Dieu est présent en toutes choses, il « peut communiquer aux hommes immédiatement, car, sans employer de moyens corporels d’aucune sorte, il communique son essence à notre âme ». Mais « pour qu’un homme perçût par l’âme seule des choses qui ne sont point contenues dans les premiers fondements de notre connaissance et n’en peuvent être déduites, il serait nécessaire que son âme fût de beaucoup supérieure à l’âme humaine ». Il est raisonnable de penser que l’intellect humain ne peut par ses propres forces sonder la complexité inouïe de la création. Il est toute aussi raisonnable de penser que ceux qui sont nommé prophètes ont été grands surtout par leur imagination. « Personne n’a reçu de révélation de Dieu sans le secours de l’imagination, c’est-à-dire sans le secours de paroles et d’images, et en conséquence pour prophétiser, point n’est besoin d’une pensée plus parfaite, mais d’une imagination plus vive ». « On voit, par suite, pourquoi les Prophètes ont presque toujours perçu et enseigné toutes choses sous forme de parabole et d’énigmes et pourquoi ils ont donné des choses spirituelles une expression corporelle ». Mais bien sûr, « la simple imagination n’enveloppe pas de sa nature la certitude, ainsi que le fait toute idée claire et distincte, mais qu’il faut nécessairement qu’à l’imagination s’ajoute quelque chose qui est le raisonnement ». Preuve en est que les prophètes n’étaient pas certains de la révélation à moins qu’il ne s’y ajoute quelque signe, comme on le voit souvent dans la Bible. La « certitude » provenant des signes n’est pas une certitude mathématique, mais seulement une certitude morale . « Les signes ont été en conséquence adaptés aux opinions et à la capacité du prophète ». Il est indéniable qu’une Révélation parle dans le langage d’une époque historique donnée. De là suit que les prophètes ont pu ignorer « les choses de pure spéculation qui ne se rapportent pas à la charité et à l’usage de la vie ». Nous pouvons donc, quand bien même nous admettrions une autorité de l’Écriture, croire suivant notre propre examen. Pour terminer, puisque la philosophie est précisément libre examen, on conclura sans peine que « le but de la Philosophie est uniquement la vérité, celui de la Foi, … l’obéissance et la piété ». ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) Il est absurde de penser que la liberté de juger est impie. Il est parfaitement justifier d’admettre une [url=http://www.philosophie-spiritualite.com/cours/religio1.htm#th%C3%A9ologie rationnelle]théologie rationnelle[/url] qui soit distincte de l’autorité de la Révélation qui porte elle davantage sur la piété dans les œuvres que sur les [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
3) Nous avons vu que de fait l’institution de l’[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] suppose l’existence des conflits, car si les hommes vivaient dans l’[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et une concorde parfaite, l’État deviendrait inutile. « Chaque homme se définit non par la saine raison, mais par le désir et la puissance ». Cependant, « il n’est est pas moins vrai, personne n’en peut douter, qu’il est beaucoup plus utile aux hommes de vivre suivant les lois et les injonctions de la raison, lesquelles tendent uniquement, …à ce qui est réellement [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] aux hommes ». « Pour vivre dans la sécurité et le mieux possible les hommes ont dû nécessairement aspirer à s’unir en un corps et ont fait par là que le droit que chacun avait de Nature sur toutes choses appartint à la collectivité et fût déterminé non plus par la force et l’appétit de l’individu mais par la puissance et la volonté [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ensemble ». Il faut donc dans l’État que l’individu transfère à la société la puissance qui lui appartient, de sorte qu’elle seule devienne la puissance du [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) Cela ne veut pas dire que le sujet doit pour autant devenir un [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Non. « La liberté n’est qu’à celui qui de son entier consentement vit sous la seule conduite de la raison ».
Ce qui s’ensuit est exposé en titre au chapitre XX : "dans une libre République, il est permis à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]chacun de penser ce qu'il veut et de dire ce qu'il pense".» D’autre part, il doit être clair désormais que l’État doit conserver autorité en ce qui concerne la religion sous la forme d’institutions et d’organisation du culte. ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) La tolérance que l’État rend possible suppose que le droit ne soit inféodé par aucune autre autorité que celle de l’État. Il est hors de question d’admettre entre les murs d’une association religieuse un espace de non-droit, sous le seul prétexte que la foi ne relève que de la croyance individuelle. En tant que citoyen, chacun conserve des droits identiques et si des crimes étaient commis sous couvert d’une autorité religieuse sans être poursuivis, c’est que l’État ne jouerait pas le rôle qui est le sien. ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) Les « affaires » de pédophilie, d’abus sexuel, dans l’Église concernent directement l’État. Spinoza reconnaît clairement que l’État a un droit de regard. La religion, même si on ne la considère qu’en tant que [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], sans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ni [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], n’abolit pas le statut du citoyen. La religion est censée ajouter au statut du citoyen celui de fidèle, ce qui doit être possible sans contradiction.
C. Désarmer les religions Cela n’enlève pourtant rien au fait que même dans un État de droit dans lequel la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] est prise au sérieux, nous ne pouvons empêcher qu’en amont de tous nos comportements il y ait toujours des croyances. Que nos croyances soient [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], elles se traduisent par des conduites ; qu’on le veuille ou non, que l’on s‘en afflige ou que l’on s’en réjouisse, les mythes culturels d’une société conservent une permanence dans l’[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Et nos [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] enveloppent une idée de Dieu. Aussi bien, la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] que nous nous donnons du [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] conserve toujours une connotation religieuse. En dernière analyse, c’est sur ce terrain, cette fois psychologique, que nous devons chercher.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]---------------1) On pourrait aller chercher Max Weber pour justifier l’idée que dans nos sociétés démocratiques, le seul facteur de légitimation du pouvoir politique est la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], non la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Chacun observera cependant que malgré tout le charisme demeure extrêmement influent dans l’exercice et la reconnaissance du pouvoir. En toute honnêteté, il faudra aussi reconnaître que nous n’avons pas dépouillé entièrement le pouvoir politique de son aura sacrée. Si autrefois le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] était souverain « de droit divin » et « représentant de Dieu sur Terre », nous continuons nous aussi à attendre le Messie dans les élections, au point que cela en devient ridicule. Voyez l’élection d’Obama aux États-Unis. Et nous continuons à projeter toute une [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] religieuse sur le pouvoir politique, avec toutes sortes de sottises sur ceux qui sont « du conseil de Dieu » et autres sornettes du même acabit. Mais c’est ainsi. Nous projetons inconsciemment à partir de nos mythes culturels notre idée de Dieu sur le pouvoir politique. Et ce n’est pas seulement le fait de l’[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. C’est aussi le fait des philosophes qui pensent la question politique. Nous ne pouvons pas penser le pouvoir, sans avoir en tête une représentation (peut être fausse ou même absurde) du pouvoir absolu, au sens du pourvoir de l’[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. L’[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] hégélien ne peut pas être compris indépendamment d’une représentation de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] que Hegel prétend avoir emprunté au christianisme. Avec la montée au Calvaire des peuples dans l’[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], le Sacrifice et la Rédemption. La manière dont Spinoza légitime le pouvoir politique n’est en aucune façon séparable d’une idée de Dieu comme identique à la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], qui trouve son exposition complète dans la première partie de l’Éthique. Idée de Dieu bien plus modeste assurément, mais bien présente et profonde. Inversement, même si les religions prétendent que Dieu a fait l’homme à son image, il est facile de leur retourner le compliment en montrant qu’elles se sont ingéniées pendant des siècles à inventer un Dieu fait à l’image de l’homme et même de l’homme de la pire espèce qui soit ! ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien])
2) Ceci nous amène vers l’enjeu du livre de Jean-Marie Muller Désarmer les Dieux. Le croyant doit avoir l’honnêteté de relire ses propres textes sans rien dissimuler et reconnaître qu’ils [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]comportent beaucoup de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Non pas que la violence soit celle d’hommes mauvais parce qu’ils se seraient éloignés de Dieu, mais bien parce qu’elle est imputée directement à Dieu. Dans la Bible, Moïse s’adresse Israël en ces termes « Lorsque Yahvé t’auras fait entrer ans le pays dont tu vas prendre possession, des nations nombreuses tomberont devant toi. … Yahvé ton Dieu te les livreras et tu les battras » Dt 7, 1-2. Le plus souvent, Israël devra les combattre jusqu’à les détruire : « Tu dévoreras donc tous ces peuples que Yahvé ton Dieu te livre, ton œil sera sans pitié et tu ne serviras pas leurs dieux : car tu y serais pris au piège… Ne tremble donc pas devant eux, car au milieu de toi est Yahvé ton Dieu, Dieu grand et redoutable. C’est peu à peu que Yahvé ton Dieu détruira ces nations devant toi ; tu ne pourras pas les exterminer sur le champ, de peur que les bêtes sauvages ne se multiplient à ton détriment, mais Yahvé ton dieu te les livrera, et elles resteront en proie à de grands troubles jusqu’à ce qu’elles soient détruites. Il livrera leurs rois et ton pouvoir et tu effaceras leur nom de dessous les cieux : nul ne tiendra devant toi, jusqu’à ce que tu les aies exterminés », (Dt 7, 16-24). Moïse précise les règles selon lesquelles Israël doit faire la guerre : « Lorsque tu t’approcheras d’une ville pour la combattre, tu lui proposera la paix. Si elle accepte et t’ouvre ses portes, tout le peuple qui s’y trouve te devra la corvée et le travail. Mais si elle refuse la paix et livre combat, tu l’assiègeras. Yahvé ton Dieu la livrera à ton pouvoir, et tu en passeras tous les mâles au fil de l’épée. Toutefois les femmes, les enfants, le bétail, tut ce qui se trouve dans la ville, toutes ses dépouilles, tu les prendras comme butin. Tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que Yahvé ton Dieu t’auras livrés. C’est ainsi que tu traiteras les villes éloignées de toi, qui n’appartiennent pas à ces nations-ci. Quant aux villes de ces peuples que Yahvé ton Dieu te donne en héritage, tu n’en laisseras subsister rien de vivant. Oui, tu les voueras à l’anathème… ainsi que l’a commandé Yahvé ton Dieu, afin qu’ils ne vous apprennent pas à pratiquer toutes ces abominations qu’ils pratiquent envers leurs dieux » (Dt 20, 10-18). Dieu est donc représenté comme un chef de guerre exigeant le carnage, la soumission et ne supportant pas la rivalité avec les dieux d’un autre culte que le sien. Celui qui croit dans sa parole doit donc fermement ancrer en lui la croyance : c’est « mon » Dieu et non pas le « vôtre ». Dans le livre de Josué, Yahvé apparaît même comme un fin stratège, rusé et impitoyablement cruel : «Josué s’empara de Maqqéda et la fit passer, ainsi que son roi, au fil de l’épée, il les voua à l’anathème avec tout ce qui se trouvait là de vivant, il ne laissa pas de survivant ; il traita le roi de Maqqéda comme il avait traité le roi de Jéricho…Il ne laissa pas un survivant et voua tout être animé à l’anathème, comme Yahvé, le Dieu d’Israël l’avait ordonné ».
Vérification faite avec les moyens de l’[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], le plus souvent, comme dans le cas de la ville de Jéricho, on ne trouve en fait aucune trace de destruction. Les fouilles de la cité d’Aï par exemple montrent qu’elle n’était pas habitée au moment de la conquête présumée. En conclusion, pour les archéologues Finkelstein et Silberman, le récit biblique ne peut être qu’une sorte de « chanson de geste », « un mirage [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ». « Le livre de Josué présente une épopée dont le message est à la fois théologique, politique et militaire ». Il est impossible de prendre le texte au niveau littéral, il est indispensable d’en faire une [url=http://www.philosophie-spiritualite.com/cours/histoire1.htm#m%C3%A9thode critique]critique historique[/url]. Si l’imagination de la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] s’en mêle, il est donc complètement erroné de prendre au pied de la lettre la représentation de Dieu qui s’y trouve. Le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] derrière lequel se barricade le fondamentalisme est absurde. On n’a pas à lire un texte religieux comme un [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Un « dieu des armées », c’est toujours excitant pour galvaniser les foules et les mener au combat, c’est très bien pour le folklore et le cinéma, cela fait des images saignantes pour nourrir le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], mais cela n’a pas grand-chose à voir avec Dieu. Les textes religieux sont aussi des livres humains et Humain, trop humain, comme dit Nietzsche. Comme le précise dit Jean-Marie Muller, « quand la part d’humanité impute à Dieu autant d’inhumanité, que reste-t-il de la part de divinité ? » Est-ce que c’est Dieu qui a parlé aux hommes ou bien les hommes qui ont fait parler Dieu ? « Je pense qu’il faut avoir l’audace de répondre à cette question par l’affirmative. Il ne s’agit donc que de paroles humaines. Trop humaines ». Soyons assez honnête pour reconnaître que la plupart des religions ont poussé à l’extrême l’idéologie d’un dieu guerrier. Il faut savoir rompre avec le stéréotype d'un dieu violent. ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien])
..
_________________________________________________________________________________________________________________
b) Les Évangiles n’échappent pas non plus à cette ambiguïté. Jésus reprend en effet à maintes reprises les prophéties [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] de l’Ancien Testament. Certainement sous l’influence de l’enseignement de Jean-Baptiste dont il a été le disciple. Par trois fois le texte des Évangiles laisse entendre que le Royaume de Dieu doit descendre sur la terre dans la génération des premiers disciples. Ce qui ne s’est pas produit à la grande déception des fidèles. A quoi les érudits répondent que ces trois logia, proviendraient non pas de Jésus mais des préoccupations de l’Église primitive. N’empêche qu’il y a bien dans le texte : « Quand à la date de ce jour, ou à l’heure, personne ne les connaît, ni les anges dans le ciel, ne le Fils, personne que le Père (Mc, 13, 32.) ». Le jour de l’avènement du Fils de l’homme sera un jour de destruction comparable au déluge : « De même, comme il advint aux jours de Lot ; on mangeait, buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait ; mais le jour où Lot sortit de Sodome, Dieu fit pleuvoir du ciel du feu et du souffre, et il les fit tous périr » Lc 17, 28-29). Jésus annonce que la proclamation de la venue du Royaume de Dieu sera précédée de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] très violentes. « Vous aurez à entendre parler de guerres et de rumeurs de guerres ; voyez, ne vous alarmez pas : car il faut que cela arrive. Mais ce n’est pas encore la fin. On se dressera, en effet, nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura par endroit des famines et des tremblements de terre » Mt 24, 6-7. Le commentaire de Jean-Marie Muller : « Mauvaise nouvelle ! Mais pourquoi donc faut-il que toutes ces violences et ces catastrophes arrivent ? S’agirait-il d’un châtiment de Dieu ? ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) Certes Jésus savait que les hommes sont prompts à faire des guerres, mais faut-il vraiment que ces guerres arrivent ? Certainement non ! Les guerres arrivent parce que les hommes désertent la sagesse pour courir vers la folie, mais ces guerres ne devraient pas arriver». Toute la question tient dans ce « faut-il ». Or la lecture la plus facile de ce « il faut », la lecture de la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] va bien sûr y voir la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et à partir du moment où on voir la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] comme légitimée par la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]volonté de Dieu, elle a reçu une entière [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Il existe dès lors une violence qui est bonne car voulue par Dieu, ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) que l’on opposera de manière hypocrite à la « mauvaise violence » des hommes.
Mais l’exégèse chrétienne se doit de gommer ces textes, pour ne retenir dans l’Enseignement de Jésus que la parole de l’amour. Elle oppose à l’Ancien Testament le Nouveau Testament en disant que Jésus dans de très nombreux passages de l’Évangile rompt avec la tradition, notamment en abrogeant la loi du Talion. ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) Ce qui est exact, mais pas pour une raison de démarcation avec une forme antérieure de religion ou même une autre religion tout court. Nous sommes bien d’accord, il faut voir dans le cœur de l’enseignement de Jésus un enseignement de sagesse. Mais la raison en est plus générale et transcende son seul enseignement. La seule manière de rendre justice [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]aux textes religieux est de retrouver ce qu’ils peuvent contenir de paroles de sagesse et non d’exhortation à la folie. Bref, il s’agit d’accorder plus d’attention au sens spirituel et intemporel des textes sacrés qu’à leur signification historique proprement dite. Dès l’instant où nous touchons ce qu’il peut y avoir de sagesse dans les Écritures, nous retrouvons un ordre intemporel de vérité qui n’appartient en propre à personne et qui peut se retrouver sous une autre forme et dans un autre langage, dans une autre Écriture. Le rejet de la loi du Talion dans les Évangiles est exprimé d’une manière extrêmement forte jusqu’au retournement complet : « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous diffament. A qui te frappe sur une joue, présente encore l’autre ; à qui enlève ton manteau, ne refuse pas ta tunique… Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre de retour » (Lc 6, 27s). ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) Il ne peut y avoir de sagesse dans la poursuite de la vengeance, car elle ne fait qu’alimenter le feu de la violence. Il y a une sagesse de l’amour qui met fin à la violence et donne sans attendre de retour. Cela s’appelle aussi comme vertu la bonté, comme cela s’appelle aussi compassion. Quiconque prétend que l’on ne trouve nulle part ailleurs la sagesse de l’amour est ignorant ou menteur. Ce serait par exemple faire l’impasse sur le bouddhisme. A moins que… à moins que l’on ne campe dans la position de l’exclusivisme en matière de vérité. Ce qui est la meilleure façon de préparer l’affrontement.
3) Étant donné la place qu’occupent dans nos mythes culturels la représentation de Dieu, il ne faut surtout pas croire qu’elle peut être prise à la légère ni que l’on puisse facilement s’en débarrasser. Même [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], le pourfendeur du christianisme, dit qu’en définitive, ce qu’il nomme « la mort de dieu » ne concerne que le dieu moral. ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) Celui des courbettes, des génuflexions, des prières bigotes, des grands alléluias émotionnels. Celui qu’on invoque pour que fleurisse le commerce ou dont on a besoin pour bénir les fantassins et les colonnes de blindés. Le dieu de la volonté de puissance, des bondieuseries, des repentances, de la culpabilité sourde et maladive, du péché de la chair où parle la honte de n’être qu’humain. Mais tout cela justement, ce n’est encore que de l’humain, pensée tortueuse de l’humain. Ce n’est pas le sens de l’Infini et du Sacré, ce n’est pas la Vie et le mystère de cet « amour infini qui nous monte dans l’âme », selon les mots de Rimbaud.
Il faut accepter de le voir en face : la représentation de Dieu qui donne licence aux hommes de se harnacher pour la guerre est un sous-produit bâtard de l’ego humain. Rien d’autre. Il faut reconnaître sur ce point la profondeur du Bouddhisme qui a au moins la pudeur sur la question de Dieu de laisser un Silence. Le mot « Dieu » a tellement été surchargé de projections fantasques et d’anthropomorphismes grossiers qu’il vaudrait mieux éviter de l’employer. Les religions sont-elles prêtes à renoncer à la théologie du dieu guerrier pour une théologie de l’humilité ? Peuvent-elles seulement accepter l’idée que nous ne pouvons pas avec un intellect humain sonder l’Englobant ? Et si nous admettons l’inadéquation des constructions mentales de
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]------------------------------ la théologie, comment peut-on encore avoir une prétention exclusive sur la vérité ? ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien])
Cette prétention d’où vient-elle ? « Nous possédons la vérité ». Cela veut dire quoi ce « nous » ? On sait bien que l’intégrisme est lié à un repli identitaire, mais personne ne se demande sérieusement ce que cela veut implique. C’est pourtant la clé. Admettons un instant l’existence d’une religion sans spiritualité, sans humilité profonde, sans travail sur soi. Bref, juste une [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] imposant l’obéissance. L’ego a besoin pour se sentir lui-même de s’identifier à quelque chose. L’ego a besoin de s’opposer à un autre ego pour se sentir différent, meilleur et très supérieur à un autre. L’ego seul, plongé dans les ténèbres et l’incertitude se trouve énormément renforcé et agrandi quand il peut se fondre dans une communauté qui lui apporte en retour un sens élevé de son identité. Si Dieu est avec moi, je me sens tout de suite très important ! Et puis désormais, il y a nous, les croyants, et il y a eux, les impies, ceux qui ne croient pas. C’est au niveau religieux que le processus d’identification de l’ego gagne le plus de puissance. L’[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] est de la même nature que l’ego individuel, mais c’est un ego agrandi. L’ego par nature ne peut exister que dans la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], dans l’opposition à un autre ego vis-à-vis duquel il s’affirme et se sent lui-même. Il y a donc nous, les musulmans, les hindous, les chrétiens, les juifs etc. et eux les musulmans, les hindous, les chrétiens, les juifs etc. L’ego a besoin d’un ennemi pour se sentir exister. Sans ennemi qui serais-je « moi » comme différent ? Que deviendrait mon identité ? Si la paix était complète, moi pourrait-il subsister ? Si sentiment profond de l’unité de la vie était vivant, que deviendraient mes divisions religieuses ? Je me sens davantage chrétien s’il y a des non-chrétiens. Un ennemi, cela me renvoie à mon identité en tant qu’ego. L’identité religieuse est extrêmement puissante. Mises au service de l’ego, les religions sont des puissances de division extraordinaires. En vérité, je ne peux me sentir chrétien, juif, musulman que face à un autre, à un athée, un païen, un mécréant, un adorateur de faux dieux etc. Nous avons raison, et eux ils ont tort. Nous sommes les justes, les véridiques et les purs, eux les injustes, les menteurs, les impurs, ils sont par principe dans l’erreur et le péché. Nous sommes donc les uns et les autres par avance armés au moyen de nos croyances respectives. Et qu’importe le dogme qui va servir d’étendard, … ils fonctionnent tous de la même manière.
Inversement, une religion qui comporte une véritable spiritualité, implique nécessairement un travail sur soi qui réduit l’ego et ses prétentions. C’est là le hic. Le croyant est-il prêt à entrer dans cette voie?
Nous avons donc ce résultat très bien formulé par Eckhart Tolle : ou bien la religion vous reconduit à la spiritualité, ou brutalement elle vous en éloigne. C’est tout l’un ou tout l’autre. Ou bien vous creusez le puits de votre religion et vous trouvez la même eau de la sagesse que votre voisin a trouvé en creusant un autre puits ; ou bien vous n’avez que haine et mépris pour tout idée de spiritualité, vous n’avez alors de tolérance que du bout des lèvres. Parce que vous vous êtes fait de la religion une conception exclusivement [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Il ne vous reste alors qu’à lancer une fatwa islamique ou une malédiction chrétienne contre tout ce qui ne vous ressemble pas, par exemple contre le yoga, le zen et à vous enfermer à double tour dans votre Église. Cela vous donnera un immense sentiment de supériorité, une inflation immense de l’ego et vous ne douterez plus de rien. Vous serez intimement persuadé de disposer des normes absolues du [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], votre adhésion au [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sera aussi inconditionnelle qu’intransigeante. Vous serez prêt à devenir un martyr. Ce qui est au bout du compte pour l’ego une sublime gratification. Une divine confirmation de sa valeur. (Ou de son incurable stupidité ?) Seulement, parvenu à ce point, ce n’est plus de la religion, c’est de l’intégrisme.
Un esprit authentiquement religieux est pacifique car il a approché et pressenti le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Ce qui veut dire le mot religion est dès lors entendu dans un sens spirituel, comme lien renouvelé entre l’homme est l’Esprit, et non comme une appartenance identitaire et dogmatique à une communauté. Si la religion est capable de reconnaître la présence de l’Esprit, elle est assez mûre pour se débarrasser du fatras de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et d’[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui s’est accumulé dans la représentation de Dieu. Cependant, c’est une véritable mutation, une mutation si considérable qu’il n’est pas certain que les hommes soit disant « religieux » soient prêts à faire le saut, ce qui reviendrait carrément à changer le paradigme de la religion qui a eu cours jusqu’à présent.
 Re: Forum Religion et Politique
Re: Forum Religion et Politique
Impact des religions sur le politique et l’économie
"Traité de civilisations comparées" (extraits comparatistes 5).
, par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
A quelques variantes près, toutes les religions ont été des instruments de centralisation du pouvoir politique et de contrôle social. Excepté peut-être l’animisme africain qui, compte tenu de la diversité de ses croyances, est peu efficace pour un pouvoir centralisé. Le taoïsme chinois incarne un esprit libertaire, mais aussi des dérives nationalistes dans les périodes de crise. Le protestantisme combine la liberté temporelle (luttes pour les libertés civiles et religieuses) et la contrainte spirituelle (doctrine de la prédestination). Volontairement ou non, hindouisme, bouddhisme, catholicisme, islam et christianisme orthodoxe ont été des instruments efficaces de domination et de contrôle social. La relation entre religion et économie est également forte. Toutes les grandes religions ont tenté de contenir l’économie en dehors des sphères de pouvoir et elles ont instauré une primauté des valeurs spirituelles sur les valeurs matérielles, tout en ne dédaignant pas d’acquérir des richesses. Une exception avec le protestantisme, qui fait de la réussite terrestre un signe de la grâce céleste. Cette relation entre économie et spiritualité a créé un marché du religieux aux Etats-Unis avec des comportements de consommateurs des croyants et des stratégies d’entreprise des Eglises.
Africains. L’animisme est une des religions qui, compte tenu de la diversité des forces occultes sur laquelle elle est fondée, n’a pas pu être utilisée comme doctrine d’assujettissement politique des peuples. D’autant que les pouvoirs centraux apparaissent tardivement en Afrique. Néanmoins, l’animisme a tout de même joué un rôle de contrôle social dans les sociétés en renforçant l’ordre par la peur de sanctions surnaturelles. En Afrique, c’est la pénétration de l’Islam, puis du christianisme, qui a façonné les doctrines pour accompagner la centralisation du pouvoir, en permettant aussi bien à des despotes qu’à des réformateurs d’englober les diversités ethniques et culturelles. De par son sens de la coopération et de négociation avec les forces de l’invisible, l’animisme est une doctrine qui favorise la décentralisation et permet aux sociétés africaines de coexister sans s’amalgamer. De même, dans le domaine de l’économie, il a permis aux sociétés traditionnelles de développer chacune leur mode de vie (cueillette, chasse, agriculture, élevage, commerce, artisanat) sans se fondre dans une évolution uniforme. Aujourd’hui, l’animisme est naturellement le véhicule de l’économie parallèle dans laquelle il favorise : le sens de l’initiative individuelle dans une économie en difficulté, et le sens de l’adaptation à des micro-marchés.
Indiens. Après les conquêtes, en légitimant religieusement le système des castes, l’hindouisme permet aux Aryens de dominer politiquement les peuples vaincus en les assujettissant comme castes inférieures. Dans un deuxième temps, il permet d’intégrer l’ensemble des nouveaux envahisseurs en intégrant toutes leurs religions et tous leurs dieux. La théorie de la réincarnation permet de donner une consolation aux castes inférieures, qui gardent l’espoir d’accéder aux castes supérieures dans une prochaine vie. Comme cet espoir ne peut se réaliser que si les hommes se conduisent en respectant les devoirs de leur caste, l’hindouisme est une excellente doctrine du maintien de l’ordre social. Enfin, en affirmant être devenue la seule religion capable d’intégrer tous les dieux et toutes les croyances, l’intégrisme hindouiste actuel se dote d’une vocation universelle et impérialiste qui s’exerce, pour l’instant, dans un nationalisme raciste et anti-musulman. Du point de vue économique, l’hindouisme permet d’instaurer une division du travail et une logique de coopération des castes, mais ses idéaux d’étude et d’ascèse spirituelle relativisent les valeurs économiques. L’Assemblée des castes, qui était gardienne des coutumes et régulatrice des conflits, a toujours été un excellent outil de contrôle social.
Asiatiques. En Chine, le taoïsme est un animisme polythéiste qui est l’expression des traditions populaires paysannes. Pendant les invasions des Mongols, des Mandchous, des Japonais et des Occidentaux, il deviendra une idéologie de résistance aux envahisseurs pour des sociétés secrètes (Turbans Jaunes, Lotus Blanc, Boxers) qui ont développé des doctrines égalitaires. Le taoïsme véhicule aussi une idéologie rousseauiste, libertaire et anti-juridique, selon laquelle les efforts pour gouverner les hommes ne font qu’aggraver leurs défauts et augmenter le désordre dans la société. La philosophie de la non-action consiste à laisser chacun développer sa nature propre et à laisser la société trouver seule son équilibre. L’homme et la société doivent se développer sans droit ni loi car plus on crée de lois, plus on crée de possibilités de transgression. Le bouddhisme et sa doctrine de refus de l’ego ont donné une philosophie communautaire qui s’applique à l’organisation économique des monastères. Le management bouddhiste consiste à renforcer les liens entre les membres de la communauté par des méthodes de formation du consensus et de l’unanimité dans la prise de décision. Cette tradition d’unanimité fait passer la force des liens entre les hommes avant l’efficacité dans la production des richesses.
Latins. Le christianisme conteste initialement les hiérarchies instituées car "les premiers sont les derniers". Puis, le christianisme devenu religion d’Etat de l’Empire Romain, Eusèbe de Césarée crée une doctrine impérialiste : l’Eglise légitime le pouvoir de l’Empereur sur terre : bras séculier dont la mission est de convertir les barbares. Saint Augustin fait évoluer la doctrine politique de l’Eglise vers la séparation des pouvoirs, car chaque échec temporel entraîne une perte de crédibilité religieuse. Tout pouvoir vient de Dieu mais la nature de ce pouvoir, dans la cité terrestre, dépend des hommes qui sont punis ou récompensés par la Providence, selon leur conduite. Ainsi l’Eglise reste l’arbitre des pouvoirs sans être remise en cause par ses échecs. Le christianisme façonne une hiérarchie sacerdotale, l’autorité spirituelle suprême du Pape et l’Etat du Vatican, qui sera l’arbitre des puissances européennes. D’un point de vue économique, le christianisme prêche le dénuement et inverse les valeurs d’effort et de travail des sociétés antiques où la réussite attestait la faveur des dieux. Entre le Ve et le XVe siècle, l’Eglise fait du riche "l’intendant des biens de Dieu", dont la fortune est recevable s’il l’utilise pour le bien commun. En condamnant l’usure et le commerce, l’Eglise impose une modération des mœurs économiques.
Anglo-Saxons. Le protestantisme est initialement un mouvement de révolte politique contre l’autorité ecclésiastique de Rome. Mais cette révolte sera récupérée par la noblesse protestante qui rétablit l’ordre militairement après la Réforme et par la dictature puritaine des pasteurs. L’héritage de la tradition anglo-saxonne des libertés civiles persiste cependant dans l’organisation ecclésiastique des Eglises et des sectes protestantes qui sont fédérées sans être hiérarchisées, ni soumises à une autorité spirituelle unique. Du point de vue économique, la thèse de la prédestination et le fait qu’on puisse s’assurer de son salut par la réussite et la richesse que Dieu accorde à Ses élus, entraînent une forte interdépendance entre religion et économie (Max Weber). Le protestantisme devient une morale du capitalisme, matérialisée à travers l’épargne qui sert à la fois à construire le Royaume de Dieu et à investir dans le développement de la révolution industrielle. Cette fusion entre la religion et l’économie a fait de l’Amérique contemporaine le plus gros marché religieux du monde (sur un marché concurrentiel mondial). Notamment pour ses sectes fondamentalistes qui s’exportent très bien dans les régions les plus pauvres du monde. Elles y proposent une doctrine du salut par la réussite économique et sociale qui convainc sans férir.
Musulmans. L’Islam est d’emblée une religion d’Etat, qui permet à Mahomet de réunir les tribus bédouines divisées dans l’Oumma, la communauté des Croyants. Mais, comme l’empire musulman est multinational, la religion doit refléter la diversité des peuples et des coutumes ; l’Islam ne possède donc pas d’autorité ecclésiastique habilitée à énoncer des dogmes. Les ulémas, théologiens ou juristes, sont habilités à interpréter les textes mais n’exercent aucun magister spirituel. Le seul critère universel d’orthodoxie des dogmes est le consensus des croyants. L’Islam est donc d’emblée une religion politique et les mosquées servent aux cours de justice et à annoncer les décisions politiques. L’Islam traditionnel instaure une modération des mœurs économiques en disqualifiant la fortune, en contrôlant les prix et les marchés, ainsi qu’en nationalisant une grande partie de la propriété foncière et des industries. La fusion du religieux, du politique et de l’économie provoque un ralentissement du développement des pays musulmans où l’initiative privée est freinée par des critères religieux, sauf pour les puissants. Aujourd’hui encore, la faiblesse en nombre de la bourgeoisie freine le développement, pendant que "la malédiction des ressources" (naturelles et énergétiques) alimente les caisses de l’Etat.
Slaves. La conversion collective au christianisme orthodoxe est décidée de manière autoritaire par Vladimir, Prince de Kiev (Xe siècle), pour instaurer une religion d’Etat et un pouvoir absolutiste. L’orthodoxie donne une légitimation religieuse au pouvoir du Tsar, représentant de Dieu sur terre. L’absolutisme ancre son emprise sur les âmes avec facilité car, pour l’orthodoxie, toute tentative de compréhension de la providence divine est pure vanité de l’esprit. Enfin, un idéal de non-résistance à l’autorité vient compléter la panoplie qui permet à l’autocratie tsariste de s’imposer. L’orthodoxie a également été le véhicule des réformes autoritaires pour la modernisation de la Russie. En revanche, l’héritage du polythéisme slave et du chamanisme asiatique a servi d’idéologie populaire de résistance aux tentatives de modernisation par décrets. Sur le plan économique, l’orthodoxie est en phase avec les idéaux collectivistes de la société slave antique et les valeurs de justice sociale qui ouvriront la voie au communisme. Malgré les persécutions religieuses, le communisme avait repris les idéaux chrétiens de justice sociale. Aujourd’hui, la Russie reste déchirée entre deux tendances : le capitalisme d’Etat qui creuse les inégalités ; les valeurs de justice sociale qui sont reprises par tous les partis d’opposition, communistes et extrême droite en tête !
"Traité de civilisations comparées" (extraits comparatistes 5).
, par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
A quelques variantes près, toutes les religions ont été des instruments de centralisation du pouvoir politique et de contrôle social. Excepté peut-être l’animisme africain qui, compte tenu de la diversité de ses croyances, est peu efficace pour un pouvoir centralisé. Le taoïsme chinois incarne un esprit libertaire, mais aussi des dérives nationalistes dans les périodes de crise. Le protestantisme combine la liberté temporelle (luttes pour les libertés civiles et religieuses) et la contrainte spirituelle (doctrine de la prédestination). Volontairement ou non, hindouisme, bouddhisme, catholicisme, islam et christianisme orthodoxe ont été des instruments efficaces de domination et de contrôle social. La relation entre religion et économie est également forte. Toutes les grandes religions ont tenté de contenir l’économie en dehors des sphères de pouvoir et elles ont instauré une primauté des valeurs spirituelles sur les valeurs matérielles, tout en ne dédaignant pas d’acquérir des richesses. Une exception avec le protestantisme, qui fait de la réussite terrestre un signe de la grâce céleste. Cette relation entre économie et spiritualité a créé un marché du religieux aux Etats-Unis avec des comportements de consommateurs des croyants et des stratégies d’entreprise des Eglises.
Africains. L’animisme est une des religions qui, compte tenu de la diversité des forces occultes sur laquelle elle est fondée, n’a pas pu être utilisée comme doctrine d’assujettissement politique des peuples. D’autant que les pouvoirs centraux apparaissent tardivement en Afrique. Néanmoins, l’animisme a tout de même joué un rôle de contrôle social dans les sociétés en renforçant l’ordre par la peur de sanctions surnaturelles. En Afrique, c’est la pénétration de l’Islam, puis du christianisme, qui a façonné les doctrines pour accompagner la centralisation du pouvoir, en permettant aussi bien à des despotes qu’à des réformateurs d’englober les diversités ethniques et culturelles. De par son sens de la coopération et de négociation avec les forces de l’invisible, l’animisme est une doctrine qui favorise la décentralisation et permet aux sociétés africaines de coexister sans s’amalgamer. De même, dans le domaine de l’économie, il a permis aux sociétés traditionnelles de développer chacune leur mode de vie (cueillette, chasse, agriculture, élevage, commerce, artisanat) sans se fondre dans une évolution uniforme. Aujourd’hui, l’animisme est naturellement le véhicule de l’économie parallèle dans laquelle il favorise : le sens de l’initiative individuelle dans une économie en difficulté, et le sens de l’adaptation à des micro-marchés.
Indiens. Après les conquêtes, en légitimant religieusement le système des castes, l’hindouisme permet aux Aryens de dominer politiquement les peuples vaincus en les assujettissant comme castes inférieures. Dans un deuxième temps, il permet d’intégrer l’ensemble des nouveaux envahisseurs en intégrant toutes leurs religions et tous leurs dieux. La théorie de la réincarnation permet de donner une consolation aux castes inférieures, qui gardent l’espoir d’accéder aux castes supérieures dans une prochaine vie. Comme cet espoir ne peut se réaliser que si les hommes se conduisent en respectant les devoirs de leur caste, l’hindouisme est une excellente doctrine du maintien de l’ordre social. Enfin, en affirmant être devenue la seule religion capable d’intégrer tous les dieux et toutes les croyances, l’intégrisme hindouiste actuel se dote d’une vocation universelle et impérialiste qui s’exerce, pour l’instant, dans un nationalisme raciste et anti-musulman. Du point de vue économique, l’hindouisme permet d’instaurer une division du travail et une logique de coopération des castes, mais ses idéaux d’étude et d’ascèse spirituelle relativisent les valeurs économiques. L’Assemblée des castes, qui était gardienne des coutumes et régulatrice des conflits, a toujours été un excellent outil de contrôle social.
Asiatiques. En Chine, le taoïsme est un animisme polythéiste qui est l’expression des traditions populaires paysannes. Pendant les invasions des Mongols, des Mandchous, des Japonais et des Occidentaux, il deviendra une idéologie de résistance aux envahisseurs pour des sociétés secrètes (Turbans Jaunes, Lotus Blanc, Boxers) qui ont développé des doctrines égalitaires. Le taoïsme véhicule aussi une idéologie rousseauiste, libertaire et anti-juridique, selon laquelle les efforts pour gouverner les hommes ne font qu’aggraver leurs défauts et augmenter le désordre dans la société. La philosophie de la non-action consiste à laisser chacun développer sa nature propre et à laisser la société trouver seule son équilibre. L’homme et la société doivent se développer sans droit ni loi car plus on crée de lois, plus on crée de possibilités de transgression. Le bouddhisme et sa doctrine de refus de l’ego ont donné une philosophie communautaire qui s’applique à l’organisation économique des monastères. Le management bouddhiste consiste à renforcer les liens entre les membres de la communauté par des méthodes de formation du consensus et de l’unanimité dans la prise de décision. Cette tradition d’unanimité fait passer la force des liens entre les hommes avant l’efficacité dans la production des richesses.
Latins. Le christianisme conteste initialement les hiérarchies instituées car "les premiers sont les derniers". Puis, le christianisme devenu religion d’Etat de l’Empire Romain, Eusèbe de Césarée crée une doctrine impérialiste : l’Eglise légitime le pouvoir de l’Empereur sur terre : bras séculier dont la mission est de convertir les barbares. Saint Augustin fait évoluer la doctrine politique de l’Eglise vers la séparation des pouvoirs, car chaque échec temporel entraîne une perte de crédibilité religieuse. Tout pouvoir vient de Dieu mais la nature de ce pouvoir, dans la cité terrestre, dépend des hommes qui sont punis ou récompensés par la Providence, selon leur conduite. Ainsi l’Eglise reste l’arbitre des pouvoirs sans être remise en cause par ses échecs. Le christianisme façonne une hiérarchie sacerdotale, l’autorité spirituelle suprême du Pape et l’Etat du Vatican, qui sera l’arbitre des puissances européennes. D’un point de vue économique, le christianisme prêche le dénuement et inverse les valeurs d’effort et de travail des sociétés antiques où la réussite attestait la faveur des dieux. Entre le Ve et le XVe siècle, l’Eglise fait du riche "l’intendant des biens de Dieu", dont la fortune est recevable s’il l’utilise pour le bien commun. En condamnant l’usure et le commerce, l’Eglise impose une modération des mœurs économiques.
Anglo-Saxons. Le protestantisme est initialement un mouvement de révolte politique contre l’autorité ecclésiastique de Rome. Mais cette révolte sera récupérée par la noblesse protestante qui rétablit l’ordre militairement après la Réforme et par la dictature puritaine des pasteurs. L’héritage de la tradition anglo-saxonne des libertés civiles persiste cependant dans l’organisation ecclésiastique des Eglises et des sectes protestantes qui sont fédérées sans être hiérarchisées, ni soumises à une autorité spirituelle unique. Du point de vue économique, la thèse de la prédestination et le fait qu’on puisse s’assurer de son salut par la réussite et la richesse que Dieu accorde à Ses élus, entraînent une forte interdépendance entre religion et économie (Max Weber). Le protestantisme devient une morale du capitalisme, matérialisée à travers l’épargne qui sert à la fois à construire le Royaume de Dieu et à investir dans le développement de la révolution industrielle. Cette fusion entre la religion et l’économie a fait de l’Amérique contemporaine le plus gros marché religieux du monde (sur un marché concurrentiel mondial). Notamment pour ses sectes fondamentalistes qui s’exportent très bien dans les régions les plus pauvres du monde. Elles y proposent une doctrine du salut par la réussite économique et sociale qui convainc sans férir.
Musulmans. L’Islam est d’emblée une religion d’Etat, qui permet à Mahomet de réunir les tribus bédouines divisées dans l’Oumma, la communauté des Croyants. Mais, comme l’empire musulman est multinational, la religion doit refléter la diversité des peuples et des coutumes ; l’Islam ne possède donc pas d’autorité ecclésiastique habilitée à énoncer des dogmes. Les ulémas, théologiens ou juristes, sont habilités à interpréter les textes mais n’exercent aucun magister spirituel. Le seul critère universel d’orthodoxie des dogmes est le consensus des croyants. L’Islam est donc d’emblée une religion politique et les mosquées servent aux cours de justice et à annoncer les décisions politiques. L’Islam traditionnel instaure une modération des mœurs économiques en disqualifiant la fortune, en contrôlant les prix et les marchés, ainsi qu’en nationalisant une grande partie de la propriété foncière et des industries. La fusion du religieux, du politique et de l’économie provoque un ralentissement du développement des pays musulmans où l’initiative privée est freinée par des critères religieux, sauf pour les puissants. Aujourd’hui encore, la faiblesse en nombre de la bourgeoisie freine le développement, pendant que "la malédiction des ressources" (naturelles et énergétiques) alimente les caisses de l’Etat.
Slaves. La conversion collective au christianisme orthodoxe est décidée de manière autoritaire par Vladimir, Prince de Kiev (Xe siècle), pour instaurer une religion d’Etat et un pouvoir absolutiste. L’orthodoxie donne une légitimation religieuse au pouvoir du Tsar, représentant de Dieu sur terre. L’absolutisme ancre son emprise sur les âmes avec facilité car, pour l’orthodoxie, toute tentative de compréhension de la providence divine est pure vanité de l’esprit. Enfin, un idéal de non-résistance à l’autorité vient compléter la panoplie qui permet à l’autocratie tsariste de s’imposer. L’orthodoxie a également été le véhicule des réformes autoritaires pour la modernisation de la Russie. En revanche, l’héritage du polythéisme slave et du chamanisme asiatique a servi d’idéologie populaire de résistance aux tentatives de modernisation par décrets. Sur le plan économique, l’orthodoxie est en phase avec les idéaux collectivistes de la société slave antique et les valeurs de justice sociale qui ouvriront la voie au communisme. Malgré les persécutions religieuses, le communisme avait repris les idéaux chrétiens de justice sociale. Aujourd’hui, la Russie reste déchirée entre deux tendances : le capitalisme d’Etat qui creuse les inégalités ; les valeurs de justice sociale qui sont reprises par tous les partis d’opposition, communistes et extrême droite en tête !
 Re: Forum Religion et Politique
Re: Forum Religion et Politique
RELIGION ET POLITIQUE EN GRECE ANCIENNE |
| Le rapport entre politique et religion en Grèce ancienne peut se résumer en un mot : INTERPÉNETRATION . La religion imprègne la cité, par exemple… - Dans la fondation de la cité : Quand on fonde une colonie (cas le mieux connu), le fondateur est le chef d'une expédition militaire mais aussi religieuse. Le rôle de l'oracle de Delphes a été récemment recadré : les textes souvent tardifs, littéraires et pittoresques insistent sur un aspect quasi touristique. En fait, les fondateurs viennent chercher une caution politico-militaire de leur volonté après avoir effectué des voyages de reconnaissance. - Dans l'organisation de la cité : L'assemblée des citoyens à Athènes commence par le sacrifice d'un porcelet. On verse son sang pour délimiter un espace sacré. Les citoyens font alors un sacrifice à Zeus, protecteur de l'ordre social. Les bouleutes, héliastes et archontes prêtent serment à leur entrée dans la fonction. Par ce serment, ils promettent de faire leur devoir ; les dieux « ancestraux » (les plus reconnus) sont garants de leur sincérité, la sanction éventuelle étant religieuse. Les responsables ont une emprise sur la religion, par exemple… - A travers la compétence des institutions. Le rôle des prêtres est important mais limité : ils veillent au bon déroulement des rites. En revanche, ils n'interviennent pas dans les procédures religieuses. Socrate a été accusé d'impiété mais son cas est présenté aux archontes et jugé par l'héliée, tribunal populaire, non par les prêtres. L'assemblée des citoyens délibère fréquemment et d'une manière prioritaire des affaires sacrées : consultation des oracles pour les affaires de la cité, construction de temples, révision des lois sacrées, introduction de nouveaux dieux (comme Pan, dieu d'Arcadie, qui a été si favorable à Athènes à Marathon)… - A travers les lieux symboliques. L'agora est le symbole même de cette osmose entre le religieux et le politique. C'est un lieu pur : on se purifie à l'entrée de la place grâce à deux vases remplis d'eau posés à l'entrée. C'est là, ainsi que sur l'acropole, que les responsables prêtent serment. - En temps de guerre. On sacrifie sur le champ de bataille. On doit même attendre le présage divin pour agir. On ne doit pas passer outre un présage défavorable. Le stratège devant obéir au devin, une collusion est possible entre les deux mais semble rare. En fait, le stratège peut tirer partie d'une interprétation douteuse. D'après Hérodote, la pythie consultée avant Salamine, conseille une première fois de fuir, mais une deuxième fois de donner à Athéna un rempart de bois . Le politique Thémistocle en fait bon usage, transformant ce rempart en navires. Les responsables politiques peuvent-ils utiliser la religion à des fins politiques ? Le Parthénon n'est pas vraiment un temple. Il a certes été construit pour honorer la déesse Athéna mais son but est surtout d'affirmer la puissance d'Athènes. Aucun autel n'est érigé devant la façade, les sacrifices n'y ont donc pas lieu. D'ailleurs, la procession des Panathénées se dirige vers l'Erechthéion et non vers le Parthénon. La statue colossale de Phidias, recouverte de plaques d'or (détachables !) est une offrande somptueuse mais n'est pas une statue de culte. On a pu dire que le Parthénon a une forme de temple et une fonction de trésor. |
| En conclusion, on constate que l'impact du religieux dans la vie politique est évident ; de la même manière, les responsables politiques ont une réelle emprise sur le religieux et ce à tous les niveaux. |
 Re: Forum Religion et Politique
Re: Forum Religion et Politique
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Politique et religion dans la Rome antique
Quelle place pour la liberté de culte dans une religion d’État ?
À Rome, l’État ne se mêle pas de la vie religieuse privée des citoyens, même si les dieux font partie de la communauté et vivent parmi eux. Et la religion romaine accepte la pluralité des approches tant qu’on ne lui impose pas la transcendance. Dans cet essai, John Scheid restitue à la religion romaine sa teneur immanente et physique.
Des dieux parmi les hommes
Henri-Irénée Marrou a écrit que l’historien doit toujours savoir quel est le sens des mots qu’il emploie. Religion et politique sont deux termes qui nous sont si familiers que nous pourrions présumer qu’ils ont le même sens à Rome que chez nous. Or un anèr politikos n’est pas un homme politique, mais un homme qui a le sens de la collectivité, de la vie en cité. Appliqué à la vie publique, le terme « politique » désigne plutôt « le » politique que « la » politique. Au XIXe siècle, on se plaisait à assimiler les Grecs et les Romains à des bourgeois contemporains, mais cette représentation a fait long feu.
Plus éloignée encore de notre vocabulaire est la notion de religion. Ce terme qui, d’après les Romains, renvoie tantôt au scrupule envers les règles rituelles, tantôt au lien des humains avec les dieux, n’a en effet rien à voir avec notre concept de religion, qui implique la Révélation, la transcendance, la Création et le Créateur ainsi que la préoccupation de l’individu pour le salut de son âme immortelle. La religion romaine ne connaissait ni Révélation ni livre sacré ou dogme, et les services religieux ne comportaient ni lecture de textes sacrés ni sermon. Aucune instruction religieuse n’existait, si ce n’est l’assistance passive à un rite célébré à la maison par le chef de famille ou sur le forum par un magistrat. L’homme n’est pas la créature d’un dieu, et la notion de créateur ne joue même aucun rôle dans la religion. C’est pour cette raison qu’une notion comme la « religiosité », chère à Friedrich Schleiermacher, qui était censée représenter une attitude religieuse universelle, n’est pas pertinente pour Rome, même si les historiens du XIXe et d’une bonne partie du XXe ont admis ce point de vue originaire de la théologie protestante. Les dieux romains sont créés comme les humains, et se trouvent dans ce monde comme ceux-ci, mais n’apparaissent nulle part comme leurs créateurs. Aussi les relations entre dieux et humains sont-elles différentes dans le monde romain. Dans ce que les Romains désignent comme les relations religieuses ou déterminées par la religio – ce sens de relation avec et d’obligation à l’égard des dieux –, il n’est pas question de la vie métaphysique, mais uniquement de la vie physique. Les Grecs comme les Romains, dans le culte comme dans la spéculation, considéraient que l’on ne pouvait rien savoir de la nature des dieux, de leur vie propre, celle qu’ils menaient dans l’au-delà, et l’objectif ultime des mortels n’était pas de rejoindre les dieux dans cet au-delà. Il y avait, certes, des cercles de philosophes qui recherchaient cette union et cette familiarité avec les immortels – que recherchaient aussi dans un autre but ceux qui pratiquaient la magie –, mais ils étaient très peu nombreux. Dans l’ensemble, les Romains ne posaient pas ces questions dans la pratique religieuse ancestrale. Ils apprendront à partir du IIe siècle de notre ère à connaître des religions fondées sur la recherche de l’au-delà, mais ce dont je parlerai est antérieur à ces contacts et à la diffusion de ces idées.
Pour les Romains, tous les êtres forment des communautés, politiques ou privées. Et, sur terre, les dieux font partie de ces communautés, quelles qu’elles soient. Pour se rendre compte de la distance qui sépare la religiosité de type chrétien de la piété romaine, il suffit de considérer que ce sont les humains qui installent les dieux dans une communauté, et non les dieux qui choisissent cette communauté. Un dieu peut se manifester aux humains et demander à être entendu et accueilli, mais il a besoin de l’assentiment de la communauté humaine pour y être admis. En fait, ce sont dans chaque cas les autorités terrestres qui sont les interlocuteurs des dieux : magistrats annuels, prêtres, pères de famille ou présidents annuels d’associations, etc. La question des liens entre politique et religion peut être abordée de plusieurs points de vue, selon la collectivité considérée : la famille, le quartier, l’association professionnelle ou bien la cité.
Un État indifférent aux religions
Pour évaluer la place et le poids du religieux dans la vie publique et dans l’État, il faut se concentrer sur la vie publique, car c’est celle que nous connaissons le mieux. L’État ne se mêle pas de la vie religieuse privée des citoyens. L’autorité religieuse des familles est aux mains du père de famille, qui sert à la fois de célébrant et de prêtre. Tous les services religieux familiaux sont célébrés par lui, éventuellement flanqué de son épouse, ou bien par ceux auxquels il délègue ce pouvoir, par exemple l’esclave régisseur d’un de ses domaines. Ni les prêtres ni les magistrats romains n’ont compétence pour interférer dans la vie religieuse – tant que l’ordre public est préservé. Et, si ce n’est pas le cas, l’intervention ne se fera pas pour des raisons religieuses, mais pour des raisons d’ordre public. Il y a parfois des points de contact entre les prêtres et les familles, comme à propos du cadastre religieux ou celui des cimetières. Si un particulier fait en son nom une offrande dans un lieu de culte public, c’est-à-dire appartenant à la cité, cette offrande sera juridiquement privée, et n’aura pas le caractère d’un bien public. L’objet offert sera respecté tant que la collectivité n’aura pas besoin du lieu où il est dressé ; sinon, les prêtres décideront de l’enlever. Le cadastre des nécropoles est géré par les pontifes, même si ceux-ci ne peuvent, de par leur fonction de prêtre, participer ès qualité à un enterrement ou à un culte funéraire. Ces cultes sont célébrés par les pères ou fils de famille. Il est donc faux de considérer que les pontifes, par exemple, s’occupent de la pratique religieuse des citoyens comme les prêtres chrétiens le font. La religion romaine n’est pas une religion universelle, qui se célèbre à l’identique partout et pour tous. À Rome chaque culte est particulier, et ceux qui ne relèvent pas de la responsabilité directe de la cité échappent au contrôle des prêtres. C’est pour cette raison que nous parlons de religions de Rome au pluriel. Il n’y a pas de religion romaine au singulier.
« Public » est un terme ambigu, comme le mot religion. En latin, cet adjectif signifie la même chose que le génitif de peuple, populus. Ce qui est « public », publicus, est ce qui appartient au peuple, ce qui relève du peuple. Et le Populus, le Peuple, c’est ce que nous devrions appeler l’État. L’État romain est le Populus, ou mieux : le S(enatus) P(opulus)Q(ue) R(omanus), le « Sénat et le Peuple romain », ou encore la res publica populi Romani, « la chose publique du Peuple romain ». Il faut donc éviter d’opposer public et privé, comme on l’a fait depuis le XIXe siècle, comme ce qui se passe « en public » et ce qui se passe dans l’intimité familiale. De même que des actes publics peuvent se dérouler dans des maisons privées, des actions privées peuvent se dérouler dans les espaces publics. Ce qui compte pour les distinguer c’est l’implication de l’État, ou du Peuple, pour parler latin.
Comme toutes les communautés terrestres, l’État, la République du Peuple romain, possède des partenaires divins : Jupiter, Junon, Minerve, Mars et ainsi de suite. L’histoire de l’arrivée à Rome de ces dieux peut être différente : les dieux peuvent être là depuis toujours ou bien avoir été admis à une date récente. Tous ont cependant la même mission : participer à la vie politique, c’est-à-dire institutionnelle, des citoyens romains et les aider dans les aléas de la vie terrestre. Les interlocuteurs dans la collectivité des citoyens sont avant tout les magistrats romains : les consuls, les préteurs, les édiles, plus tard aussi l’empereur, bref ceux qui possèdent le pouvoir exécutif. La plupart des services religieux sont célébrés par les magistrats annuels, et les décisions religieuses, y compris celles qui relèvent de la théologie, sont prises par les mêmes magistrats conseillés par le Sénat. Pour cette raison, on a pu écrire que la fonction sacerdotale était plus diffusée dans la société que dans une religion de type chrétien. Tous les dépositaires d’autorité l’exercent à des degrés divers. Les prêtres étaient en fait des spécialistes du droit sacré qui avaient aussi certaines tâches rituelles. Ainsi les pontifes étaient les spécialistes des fêtes et des cultes ancestraux, des biens divins et de la conduite des prêtres, et célébraient un certain nombre de vieilles fêtes. Ils participaient également aux rites de consécration par lequel un consul – qui était en fait l’acteur – transférait un bien de la propriété humaine dans la catégorie du sacré, sacrum, encore un mot qui ne cesse de donner lieu à des malentendus. Par cet acte de droit sacré, l’objet consacré entre dans la catégorie des « biens qui n’appartiennent à personne » (res nullius), comme le sont les biens publics tels le forum, les basiliques, ou les bains publics. Ces biens sacrés sont mis à la disposition exclusive de la divinité concernée. À Rome, le sacré est donc une catégorie juridique, et non la manifestation terrestre d’une réalité transcendantale.
Des dieux citoyens
Les prêtres contrôlaient la légalité des consécrations publiques. Chaque collège sacerdotal avait également un domaine de compétence à propos duquel il assistait de ses conseils les magistrats et le Sénat : les augures s’occupaient de la consultation des dieux, obligatoire avant chaque décision publique importante ; ils avaient aussi le privilège de contrôler le déroulement des assemblées du peuple, de se prononcer sur les signes menaçants qu’ils auraient décelés, et même d’ajourner purement et simplement l’assemblée pour cette raison. Car ces actes divinatoires témoignaient de la participation des dieux, et notamment du plus politique d’entre eux, Jupiter, aux décisions publiques et de leur assentiment avec la décision prise. Sans cette légitimation, ce que les Romains qualifient d’auspices favorables, aucun acte public important ne pouvait exister. Et comme il s’agit aussi de politique au sens actuel, il était de bonne guerre de se servir de l’assentiment divin pour imposer sa volonté. Autrement dit, les rites étaient une arme politique. De la même manière que la prise des auspices par l’observation de poulets divinatoires donnait presque toujours un signe favorable, le droit d’obnuntiatio (c’est-à-dire d’opposition par l’annonce d’un signe divinatoire contraire) permettait de bloquer les processus de décision en cas de conflit sérieux. Les antagonistes disposaient donc chacun d’une arme divinatoire dans le débat politique. Comme l’annonce d’un signe contraire, par exemple celle d’un coup de tonnerre par temps serein alors qu’il n’y avait eu aucun éclair, le côté mécanique de la procédure de prise des auspices par les poulets consistait davantage dans une prière qui faisait participer les dieux dans le sens voulu à la prise de décision qu’à une observation empirique.
Voilà pourquoi on a pu parler de religion politique, et qualifier la religion romaine de décadente. Mais il s’agit d’un malentendu. On est loin en effet de la « religiosité » du XIXe siècle. Certes, certains hommes politiques romains ont exagéré. Mais les faits les mieux connus se sont produits en des temps de crise aiguë, en temps de guerre civile larvée ou ouverte. Ce jeu résidait dans la nature même de l’institution religieuse. De cette façon, les dieux participaient au jeu politique. Pour être pieux, il suffisait d’avoir raison, c’est-à-dire de ne pas rencontrer une catastrophe après les décisions prises de cette manière. Car les dieux avaient toujours la possibilité de faire savoir que la limite du respect élémentaire était dépassée et de manifester leur toute-puissance. Au fond, ils participaient à la vie politique comme le faisait le peuple romain, c’est-à-dire de façon généralement passive. L’histoire prouve qu’aucune loi romaine présentée à l’assemblée ne fut rejetée : autant dire que lorsque le consul qui présentait une loi sentait dans les meetings qui précédaient le vote qu’elle rencontrerait une forte opposition, il la retirait sans laisser à la majorité le droit de s’exprimer. Et lorsque l’on votait pour un projet ou pour élire un magistrat, le vote s’arrêtait dès que la majorité des unités de vote, les centuries, était atteinte - dans ce système censitaire, seule l’élite sociale votait donc de façon efficace (chaque centurie possédait une voix). Les magistrats annuels avaient donc un pouvoir presque absolu, tant à l’égard des citoyens qu’à l’égard des dieux. C’est dans cette concentration du pouvoir que réside sans doute l’un des secrets de la solidité du pouvoir romain, qui n’était pas pour autant une dictature ou une monarchie. Ce principe explique aussi que le peuple se soit parfois soulevé, ait fait sécession, ou que les dieux aient permis le désastre de Cannes ou du Lac Trasimène pendant la Deuxième Guerre Punique.
Néanmoins, après ces conflits, la concorde entre citoyens et la pax deorum, la « paix avec les dieux », s’établissaient à nouveau. Le système lui-même n’était pas mis en cause. Du moins du point de vue religieux. Car les dieux, que j’ai appelés « dieux citoyens » en m’inspirant d’une formule de Tertullien (dii municipes, c’est-à-dire « dieux concitoyens »), correspondaient dans leur relative passivité à l’image que les Romains se faisaient d’eux. Ils voulaient être honorés sur terre, des honneurs qui devaient affecter tous les domaines de la vie et, sur le forum notamment, les débats politiques. Le culte était l’expression de cette demande et de cet intérêt. En même temps, les dieux ne voulaient pas terroriser les humains ou, plus justement, les Romains n’acceptaient pas d’être terrorisés par eux. Cette arrogance humaine est peut-être le résultat de l’impérialisme triomphant des Romains, mais le fait est là : les dieux doivent respecter le pacte social de la cité - personne ne peut y châtier ou maltraiter un citoyen sans jugement. Un citoyen romain ne pouvait être humilié par quiconque, fût-il Jupiter. L’unique chose que les citoyens concédaient parfois, à l’invitation des consuls et du Sénat, était de faire le tour des temples et d’y fléchir le genou devant la divinité titulaire du lieu en signe de remerciement ou de supplication selon le contexte.
Dieux et citoyens, des partenaires dans la cité
Il existe un beau mythe sur les relations idéales entre les Romains et leur dieu suprême Jupiter. Il se place au début de l’histoire romaine. Romulus a fondé Rome, mais la ville et ses partenaires divins sont encore sauvages et ne respectent aucune règle. Le successeur de Romulus, le sage Numa, instaure la justice entre les humains et la religion à l’égard des dieux (on note que la religion donne aux dieux ce qui leur revient, c’est une relation équivalente à la justice). Mais Jupiter continue de terroriser les Romains. Le roi Numa, qui est dans la tradition romaine le modèle de l’homme d’État, juste, réfléchi, calme et intrépide, affronte le Tout-puissant pour lui demander ce qu’il lui faut faire pour l’apaiser. Jupiter, qui ce jour-là est facétieux, lui tend un piège qui tourne autour du sacrifice humain : la mise à mort, sans faute constatée et sans jugement, d’un concitoyen sur la simple revendication d’un autre. Le roi ne se laisse pas impressionner malgré sa terreur et neutralise toutes les demandes de Jupiter : il transforme les demandes terribles du dieu souverain en rites anodins effectués à l’aide de végétaux ou de poissons. Jupiter met un terme à l’affrontement en exprimant sa satisfaction devant ce petit homme capable de dialoguer avec les dieux, c’est-à-dire sans se laisser détourner des grands principes du régime de la cité, et il lui envoie un gage de son soutien futur. Ce dialogue et le comportement des deux interlocuteurs représentent la justification des consultations divinatoires et de la manière dont les Romains traitaient leurs dieux. Ce genre de spéculations ou de récits nous laisse entrevoir quel était, aux yeux des Romains, la nature du lien avec les dieux que le mot religio exprimait : un lien de proximité qui permettait à des mortels d’avoir des partenaires divins, et aussi un certain nombre de garanties qui leur permettaient de conserver leur liberté. Car le fondement de l’édifice de la cité consistait dans la liberté à l’intérieur et à l’extérieur. Ne faisons pas de la société et de l’État romains une démocratie et une démocratie modèle. C’était un régime oligarchique et censitaire, comme la plupart des cités grecques, ce qui ne les empêchait pas de respecter un certain nombre de règles fondamentales, dont la liberté. Leur religion était déterminée par leur conception de la liberté, qui n’admettait ni l’humiliation ni la soumission d’un concitoyen tant qu’il n’avait pas été accusé formellement et condamné.
Ce que le culte public exprimait quotidiennement, la vie de famille ou la vie administrative des associations de tout genre le traduisait également. Partout, la religion appartenait aux conduites collectives déterminées par les principes du politique. Par la religion, le citoyen, le membre d’une famille, ou le membre d’une association trouvait une place dans l’ordre des choses, une place qui en faisait un partenaire terrestre des dieux, et le protégeait contre toute intervention des immortels. Il n’était pas obligé de se soumettre aveuglément à une divinité. En outre, les religions des Romains n’exigeaient aucun acte de foi explicite, et il n’existait aucune sorte de contrôle. Il n’existait pas de clergé analogue à celui des religions chrétiennes ou de l’islam. Les prêtres de Rome étaient en tout autour de deux cents, et la plupart d’entre eux avaient comme seule tâche de célébrer une seule fête. Les pontifes, qui étaient certainement les plus importants des prêtres, étaient au nombre d’une vingtaine au début de notre ère, quand le nombre des citoyens dépassait les quatre millions ! Les religions romaines étaient ritualistes et la seule « foi », si l’on veut, consistait à pratiquer, du moins à ne pas refuser la pratique ou à ne pas entraver celle-ci. C’est ce type de refus qui déclenchait au IIe et surtout à partir du IIIe siècle les pogroms anti-chrétiens et la répression des autorités.
La pratique religieuse, garantie de la liberté de conscience
On pourrait donc dire que la pratique religieuse garantissait la liberté des consciences. Les Romains pouvaient penser de leurs dieux et de la religion ce qu’ils voulaient, mais pas lors de la pratique. Ils en discutaient dans des réunions, dans des débats, ils lisaient des livres. Mais c’était là une activité culturelle, qui n’avait aucune conséquence religieuse. Ce n’est que s’ils refusaient la tradition religieuse ancestrale de la cité, de la famille, du quartier etc., qu’un problème se posait. Ou alors quand ils détournaient la pratique pour exercer un contrôle sur les esprits, comme ce fut le cas lors du scandale des Bacchanales, ces groupes dionysiaques utilisant la terreur et la mise en scène pour capter les esprits des jeunes. Ou encore quand des sorciers prétendaient contraindre les dieux et les mettre à leur service pour aider leurs clients et nuire à leurs ennemis.
Une telle manière de concevoir la relation avec les dieux et le comportement religieux personnel a pu être développée par l’impérialisme romain, qui forçait les Romains à cohabiter avec des individus et des communautés, ayant la citoyenneté romaine ou non, dans les mêmes structures politiques et sociales. La question religieuse était simplifiée par le fait que chacun devait avoir ses partenaires divins, les honorer de sa manière, et aussi participer aux hommages à l’égard de ceux des Romains si l’individu devenait citoyen romain. Mais ce n’était pas seulement un effet secondaire de l’impérialisme romain, mais un élément même de la tradition civique romaine. Et, au-delà, la plupart des systèmes religieux du monde romain correspondaient à ce modèle, dont il faut chercher l’origine dans la pensée de la cité, de la polis, qui commence au VIIIe siècle avant notre ère et se diffuse ensuite dans le monde méditerranéen. L’appartenance de la plupart des cités et communautés du monde romain au même univers religieux a eu pour conséquence que la cohabitation religieuse ne posait aucun problème dans l’Empire romain. En tout cas avant la diffusion de communautés religieuses qui refusaient ce type de cohabitation et se fondaient sur une autre interprétation du monothéisme juif. Les premiers chrétiens n’ont pas tous suivi une voie radicale, et vivaient avec les autres communautés comme les communautés juives le firent dans les grandes villes du monde romain – malgré les terribles soulèvements en Judée. Ce n’est qu’au moment où une partie de l’élite romaine choisit d’enrôler le nouveau dieu dans des conflits politiques qu’une évolution qui allait transformer le monde commença.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Politique et religion dans la Rome antique
Quelle place pour la liberté de culte dans une religion d’État ?
À Rome, l’État ne se mêle pas de la vie religieuse privée des citoyens, même si les dieux font partie de la communauté et vivent parmi eux. Et la religion romaine accepte la pluralité des approches tant qu’on ne lui impose pas la transcendance. Dans cet essai, John Scheid restitue à la religion romaine sa teneur immanente et physique.
Des dieux parmi les hommes
Henri-Irénée Marrou a écrit que l’historien doit toujours savoir quel est le sens des mots qu’il emploie. Religion et politique sont deux termes qui nous sont si familiers que nous pourrions présumer qu’ils ont le même sens à Rome que chez nous. Or un anèr politikos n’est pas un homme politique, mais un homme qui a le sens de la collectivité, de la vie en cité. Appliqué à la vie publique, le terme « politique » désigne plutôt « le » politique que « la » politique. Au XIXe siècle, on se plaisait à assimiler les Grecs et les Romains à des bourgeois contemporains, mais cette représentation a fait long feu.
Plus éloignée encore de notre vocabulaire est la notion de religion. Ce terme qui, d’après les Romains, renvoie tantôt au scrupule envers les règles rituelles, tantôt au lien des humains avec les dieux, n’a en effet rien à voir avec notre concept de religion, qui implique la Révélation, la transcendance, la Création et le Créateur ainsi que la préoccupation de l’individu pour le salut de son âme immortelle. La religion romaine ne connaissait ni Révélation ni livre sacré ou dogme, et les services religieux ne comportaient ni lecture de textes sacrés ni sermon. Aucune instruction religieuse n’existait, si ce n’est l’assistance passive à un rite célébré à la maison par le chef de famille ou sur le forum par un magistrat. L’homme n’est pas la créature d’un dieu, et la notion de créateur ne joue même aucun rôle dans la religion. C’est pour cette raison qu’une notion comme la « religiosité », chère à Friedrich Schleiermacher, qui était censée représenter une attitude religieuse universelle, n’est pas pertinente pour Rome, même si les historiens du XIXe et d’une bonne partie du XXe ont admis ce point de vue originaire de la théologie protestante. Les dieux romains sont créés comme les humains, et se trouvent dans ce monde comme ceux-ci, mais n’apparaissent nulle part comme leurs créateurs. Aussi les relations entre dieux et humains sont-elles différentes dans le monde romain. Dans ce que les Romains désignent comme les relations religieuses ou déterminées par la religio – ce sens de relation avec et d’obligation à l’égard des dieux –, il n’est pas question de la vie métaphysique, mais uniquement de la vie physique. Les Grecs comme les Romains, dans le culte comme dans la spéculation, considéraient que l’on ne pouvait rien savoir de la nature des dieux, de leur vie propre, celle qu’ils menaient dans l’au-delà, et l’objectif ultime des mortels n’était pas de rejoindre les dieux dans cet au-delà. Il y avait, certes, des cercles de philosophes qui recherchaient cette union et cette familiarité avec les immortels – que recherchaient aussi dans un autre but ceux qui pratiquaient la magie –, mais ils étaient très peu nombreux. Dans l’ensemble, les Romains ne posaient pas ces questions dans la pratique religieuse ancestrale. Ils apprendront à partir du IIe siècle de notre ère à connaître des religions fondées sur la recherche de l’au-delà, mais ce dont je parlerai est antérieur à ces contacts et à la diffusion de ces idées.
Pour les Romains, tous les êtres forment des communautés, politiques ou privées. Et, sur terre, les dieux font partie de ces communautés, quelles qu’elles soient. Pour se rendre compte de la distance qui sépare la religiosité de type chrétien de la piété romaine, il suffit de considérer que ce sont les humains qui installent les dieux dans une communauté, et non les dieux qui choisissent cette communauté. Un dieu peut se manifester aux humains et demander à être entendu et accueilli, mais il a besoin de l’assentiment de la communauté humaine pour y être admis. En fait, ce sont dans chaque cas les autorités terrestres qui sont les interlocuteurs des dieux : magistrats annuels, prêtres, pères de famille ou présidents annuels d’associations, etc. La question des liens entre politique et religion peut être abordée de plusieurs points de vue, selon la collectivité considérée : la famille, le quartier, l’association professionnelle ou bien la cité.
Un État indifférent aux religions
Pour évaluer la place et le poids du religieux dans la vie publique et dans l’État, il faut se concentrer sur la vie publique, car c’est celle que nous connaissons le mieux. L’État ne se mêle pas de la vie religieuse privée des citoyens. L’autorité religieuse des familles est aux mains du père de famille, qui sert à la fois de célébrant et de prêtre. Tous les services religieux familiaux sont célébrés par lui, éventuellement flanqué de son épouse, ou bien par ceux auxquels il délègue ce pouvoir, par exemple l’esclave régisseur d’un de ses domaines. Ni les prêtres ni les magistrats romains n’ont compétence pour interférer dans la vie religieuse – tant que l’ordre public est préservé. Et, si ce n’est pas le cas, l’intervention ne se fera pas pour des raisons religieuses, mais pour des raisons d’ordre public. Il y a parfois des points de contact entre les prêtres et les familles, comme à propos du cadastre religieux ou celui des cimetières. Si un particulier fait en son nom une offrande dans un lieu de culte public, c’est-à-dire appartenant à la cité, cette offrande sera juridiquement privée, et n’aura pas le caractère d’un bien public. L’objet offert sera respecté tant que la collectivité n’aura pas besoin du lieu où il est dressé ; sinon, les prêtres décideront de l’enlever. Le cadastre des nécropoles est géré par les pontifes, même si ceux-ci ne peuvent, de par leur fonction de prêtre, participer ès qualité à un enterrement ou à un culte funéraire. Ces cultes sont célébrés par les pères ou fils de famille. Il est donc faux de considérer que les pontifes, par exemple, s’occupent de la pratique religieuse des citoyens comme les prêtres chrétiens le font. La religion romaine n’est pas une religion universelle, qui se célèbre à l’identique partout et pour tous. À Rome chaque culte est particulier, et ceux qui ne relèvent pas de la responsabilité directe de la cité échappent au contrôle des prêtres. C’est pour cette raison que nous parlons de religions de Rome au pluriel. Il n’y a pas de religion romaine au singulier.
« Public » est un terme ambigu, comme le mot religion. En latin, cet adjectif signifie la même chose que le génitif de peuple, populus. Ce qui est « public », publicus, est ce qui appartient au peuple, ce qui relève du peuple. Et le Populus, le Peuple, c’est ce que nous devrions appeler l’État. L’État romain est le Populus, ou mieux : le S(enatus) P(opulus)Q(ue) R(omanus), le « Sénat et le Peuple romain », ou encore la res publica populi Romani, « la chose publique du Peuple romain ». Il faut donc éviter d’opposer public et privé, comme on l’a fait depuis le XIXe siècle, comme ce qui se passe « en public » et ce qui se passe dans l’intimité familiale. De même que des actes publics peuvent se dérouler dans des maisons privées, des actions privées peuvent se dérouler dans les espaces publics. Ce qui compte pour les distinguer c’est l’implication de l’État, ou du Peuple, pour parler latin.
Comme toutes les communautés terrestres, l’État, la République du Peuple romain, possède des partenaires divins : Jupiter, Junon, Minerve, Mars et ainsi de suite. L’histoire de l’arrivée à Rome de ces dieux peut être différente : les dieux peuvent être là depuis toujours ou bien avoir été admis à une date récente. Tous ont cependant la même mission : participer à la vie politique, c’est-à-dire institutionnelle, des citoyens romains et les aider dans les aléas de la vie terrestre. Les interlocuteurs dans la collectivité des citoyens sont avant tout les magistrats romains : les consuls, les préteurs, les édiles, plus tard aussi l’empereur, bref ceux qui possèdent le pouvoir exécutif. La plupart des services religieux sont célébrés par les magistrats annuels, et les décisions religieuses, y compris celles qui relèvent de la théologie, sont prises par les mêmes magistrats conseillés par le Sénat. Pour cette raison, on a pu écrire que la fonction sacerdotale était plus diffusée dans la société que dans une religion de type chrétien. Tous les dépositaires d’autorité l’exercent à des degrés divers. Les prêtres étaient en fait des spécialistes du droit sacré qui avaient aussi certaines tâches rituelles. Ainsi les pontifes étaient les spécialistes des fêtes et des cultes ancestraux, des biens divins et de la conduite des prêtres, et célébraient un certain nombre de vieilles fêtes. Ils participaient également aux rites de consécration par lequel un consul – qui était en fait l’acteur – transférait un bien de la propriété humaine dans la catégorie du sacré, sacrum, encore un mot qui ne cesse de donner lieu à des malentendus. Par cet acte de droit sacré, l’objet consacré entre dans la catégorie des « biens qui n’appartiennent à personne » (res nullius), comme le sont les biens publics tels le forum, les basiliques, ou les bains publics. Ces biens sacrés sont mis à la disposition exclusive de la divinité concernée. À Rome, le sacré est donc une catégorie juridique, et non la manifestation terrestre d’une réalité transcendantale.
Des dieux citoyens
Les prêtres contrôlaient la légalité des consécrations publiques. Chaque collège sacerdotal avait également un domaine de compétence à propos duquel il assistait de ses conseils les magistrats et le Sénat : les augures s’occupaient de la consultation des dieux, obligatoire avant chaque décision publique importante ; ils avaient aussi le privilège de contrôler le déroulement des assemblées du peuple, de se prononcer sur les signes menaçants qu’ils auraient décelés, et même d’ajourner purement et simplement l’assemblée pour cette raison. Car ces actes divinatoires témoignaient de la participation des dieux, et notamment du plus politique d’entre eux, Jupiter, aux décisions publiques et de leur assentiment avec la décision prise. Sans cette légitimation, ce que les Romains qualifient d’auspices favorables, aucun acte public important ne pouvait exister. Et comme il s’agit aussi de politique au sens actuel, il était de bonne guerre de se servir de l’assentiment divin pour imposer sa volonté. Autrement dit, les rites étaient une arme politique. De la même manière que la prise des auspices par l’observation de poulets divinatoires donnait presque toujours un signe favorable, le droit d’obnuntiatio (c’est-à-dire d’opposition par l’annonce d’un signe divinatoire contraire) permettait de bloquer les processus de décision en cas de conflit sérieux. Les antagonistes disposaient donc chacun d’une arme divinatoire dans le débat politique. Comme l’annonce d’un signe contraire, par exemple celle d’un coup de tonnerre par temps serein alors qu’il n’y avait eu aucun éclair, le côté mécanique de la procédure de prise des auspices par les poulets consistait davantage dans une prière qui faisait participer les dieux dans le sens voulu à la prise de décision qu’à une observation empirique.
Voilà pourquoi on a pu parler de religion politique, et qualifier la religion romaine de décadente. Mais il s’agit d’un malentendu. On est loin en effet de la « religiosité » du XIXe siècle. Certes, certains hommes politiques romains ont exagéré. Mais les faits les mieux connus se sont produits en des temps de crise aiguë, en temps de guerre civile larvée ou ouverte. Ce jeu résidait dans la nature même de l’institution religieuse. De cette façon, les dieux participaient au jeu politique. Pour être pieux, il suffisait d’avoir raison, c’est-à-dire de ne pas rencontrer une catastrophe après les décisions prises de cette manière. Car les dieux avaient toujours la possibilité de faire savoir que la limite du respect élémentaire était dépassée et de manifester leur toute-puissance. Au fond, ils participaient à la vie politique comme le faisait le peuple romain, c’est-à-dire de façon généralement passive. L’histoire prouve qu’aucune loi romaine présentée à l’assemblée ne fut rejetée : autant dire que lorsque le consul qui présentait une loi sentait dans les meetings qui précédaient le vote qu’elle rencontrerait une forte opposition, il la retirait sans laisser à la majorité le droit de s’exprimer. Et lorsque l’on votait pour un projet ou pour élire un magistrat, le vote s’arrêtait dès que la majorité des unités de vote, les centuries, était atteinte - dans ce système censitaire, seule l’élite sociale votait donc de façon efficace (chaque centurie possédait une voix). Les magistrats annuels avaient donc un pouvoir presque absolu, tant à l’égard des citoyens qu’à l’égard des dieux. C’est dans cette concentration du pouvoir que réside sans doute l’un des secrets de la solidité du pouvoir romain, qui n’était pas pour autant une dictature ou une monarchie. Ce principe explique aussi que le peuple se soit parfois soulevé, ait fait sécession, ou que les dieux aient permis le désastre de Cannes ou du Lac Trasimène pendant la Deuxième Guerre Punique.
Néanmoins, après ces conflits, la concorde entre citoyens et la pax deorum, la « paix avec les dieux », s’établissaient à nouveau. Le système lui-même n’était pas mis en cause. Du moins du point de vue religieux. Car les dieux, que j’ai appelés « dieux citoyens » en m’inspirant d’une formule de Tertullien (dii municipes, c’est-à-dire « dieux concitoyens »), correspondaient dans leur relative passivité à l’image que les Romains se faisaient d’eux. Ils voulaient être honorés sur terre, des honneurs qui devaient affecter tous les domaines de la vie et, sur le forum notamment, les débats politiques. Le culte était l’expression de cette demande et de cet intérêt. En même temps, les dieux ne voulaient pas terroriser les humains ou, plus justement, les Romains n’acceptaient pas d’être terrorisés par eux. Cette arrogance humaine est peut-être le résultat de l’impérialisme triomphant des Romains, mais le fait est là : les dieux doivent respecter le pacte social de la cité - personne ne peut y châtier ou maltraiter un citoyen sans jugement. Un citoyen romain ne pouvait être humilié par quiconque, fût-il Jupiter. L’unique chose que les citoyens concédaient parfois, à l’invitation des consuls et du Sénat, était de faire le tour des temples et d’y fléchir le genou devant la divinité titulaire du lieu en signe de remerciement ou de supplication selon le contexte.
Dieux et citoyens, des partenaires dans la cité
Il existe un beau mythe sur les relations idéales entre les Romains et leur dieu suprême Jupiter. Il se place au début de l’histoire romaine. Romulus a fondé Rome, mais la ville et ses partenaires divins sont encore sauvages et ne respectent aucune règle. Le successeur de Romulus, le sage Numa, instaure la justice entre les humains et la religion à l’égard des dieux (on note que la religion donne aux dieux ce qui leur revient, c’est une relation équivalente à la justice). Mais Jupiter continue de terroriser les Romains. Le roi Numa, qui est dans la tradition romaine le modèle de l’homme d’État, juste, réfléchi, calme et intrépide, affronte le Tout-puissant pour lui demander ce qu’il lui faut faire pour l’apaiser. Jupiter, qui ce jour-là est facétieux, lui tend un piège qui tourne autour du sacrifice humain : la mise à mort, sans faute constatée et sans jugement, d’un concitoyen sur la simple revendication d’un autre. Le roi ne se laisse pas impressionner malgré sa terreur et neutralise toutes les demandes de Jupiter : il transforme les demandes terribles du dieu souverain en rites anodins effectués à l’aide de végétaux ou de poissons. Jupiter met un terme à l’affrontement en exprimant sa satisfaction devant ce petit homme capable de dialoguer avec les dieux, c’est-à-dire sans se laisser détourner des grands principes du régime de la cité, et il lui envoie un gage de son soutien futur. Ce dialogue et le comportement des deux interlocuteurs représentent la justification des consultations divinatoires et de la manière dont les Romains traitaient leurs dieux. Ce genre de spéculations ou de récits nous laisse entrevoir quel était, aux yeux des Romains, la nature du lien avec les dieux que le mot religio exprimait : un lien de proximité qui permettait à des mortels d’avoir des partenaires divins, et aussi un certain nombre de garanties qui leur permettaient de conserver leur liberté. Car le fondement de l’édifice de la cité consistait dans la liberté à l’intérieur et à l’extérieur. Ne faisons pas de la société et de l’État romains une démocratie et une démocratie modèle. C’était un régime oligarchique et censitaire, comme la plupart des cités grecques, ce qui ne les empêchait pas de respecter un certain nombre de règles fondamentales, dont la liberté. Leur religion était déterminée par leur conception de la liberté, qui n’admettait ni l’humiliation ni la soumission d’un concitoyen tant qu’il n’avait pas été accusé formellement et condamné.
Ce que le culte public exprimait quotidiennement, la vie de famille ou la vie administrative des associations de tout genre le traduisait également. Partout, la religion appartenait aux conduites collectives déterminées par les principes du politique. Par la religion, le citoyen, le membre d’une famille, ou le membre d’une association trouvait une place dans l’ordre des choses, une place qui en faisait un partenaire terrestre des dieux, et le protégeait contre toute intervention des immortels. Il n’était pas obligé de se soumettre aveuglément à une divinité. En outre, les religions des Romains n’exigeaient aucun acte de foi explicite, et il n’existait aucune sorte de contrôle. Il n’existait pas de clergé analogue à celui des religions chrétiennes ou de l’islam. Les prêtres de Rome étaient en tout autour de deux cents, et la plupart d’entre eux avaient comme seule tâche de célébrer une seule fête. Les pontifes, qui étaient certainement les plus importants des prêtres, étaient au nombre d’une vingtaine au début de notre ère, quand le nombre des citoyens dépassait les quatre millions ! Les religions romaines étaient ritualistes et la seule « foi », si l’on veut, consistait à pratiquer, du moins à ne pas refuser la pratique ou à ne pas entraver celle-ci. C’est ce type de refus qui déclenchait au IIe et surtout à partir du IIIe siècle les pogroms anti-chrétiens et la répression des autorités.
La pratique religieuse, garantie de la liberté de conscience
On pourrait donc dire que la pratique religieuse garantissait la liberté des consciences. Les Romains pouvaient penser de leurs dieux et de la religion ce qu’ils voulaient, mais pas lors de la pratique. Ils en discutaient dans des réunions, dans des débats, ils lisaient des livres. Mais c’était là une activité culturelle, qui n’avait aucune conséquence religieuse. Ce n’est que s’ils refusaient la tradition religieuse ancestrale de la cité, de la famille, du quartier etc., qu’un problème se posait. Ou alors quand ils détournaient la pratique pour exercer un contrôle sur les esprits, comme ce fut le cas lors du scandale des Bacchanales, ces groupes dionysiaques utilisant la terreur et la mise en scène pour capter les esprits des jeunes. Ou encore quand des sorciers prétendaient contraindre les dieux et les mettre à leur service pour aider leurs clients et nuire à leurs ennemis.
Une telle manière de concevoir la relation avec les dieux et le comportement religieux personnel a pu être développée par l’impérialisme romain, qui forçait les Romains à cohabiter avec des individus et des communautés, ayant la citoyenneté romaine ou non, dans les mêmes structures politiques et sociales. La question religieuse était simplifiée par le fait que chacun devait avoir ses partenaires divins, les honorer de sa manière, et aussi participer aux hommages à l’égard de ceux des Romains si l’individu devenait citoyen romain. Mais ce n’était pas seulement un effet secondaire de l’impérialisme romain, mais un élément même de la tradition civique romaine. Et, au-delà, la plupart des systèmes religieux du monde romain correspondaient à ce modèle, dont il faut chercher l’origine dans la pensée de la cité, de la polis, qui commence au VIIIe siècle avant notre ère et se diffuse ensuite dans le monde méditerranéen. L’appartenance de la plupart des cités et communautés du monde romain au même univers religieux a eu pour conséquence que la cohabitation religieuse ne posait aucun problème dans l’Empire romain. En tout cas avant la diffusion de communautés religieuses qui refusaient ce type de cohabitation et se fondaient sur une autre interprétation du monothéisme juif. Les premiers chrétiens n’ont pas tous suivi une voie radicale, et vivaient avec les autres communautés comme les communautés juives le firent dans les grandes villes du monde romain – malgré les terribles soulèvements en Judée. Ce n’est qu’au moment où une partie de l’élite romaine choisit d’enrôler le nouveau dieu dans des conflits politiques qu’une évolution qui allait transformer le monde commença.
 Re: Forum Religion et Politique
Re: Forum Religion et Politique
Religion et politique aux États-Unis
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Les attitudes religieuses et politiques sont historiquement corrélées dans la plupart des pays occidentaux. La nouvelle enquête de Pew Research Center permet de mesurer l’ampleur de cette corrélation et son évolution aux Etats-Unis. Dans ce pays, cette corrélation demeure très forte et elle a même eu tendance à s’accroître dans la période récente, c’est-à-dire entre 2015 et l’enquête précédente menée en 2006.
Tandis qu’aujourd’hui 37% de l’ensemble des personnes interrogées se disent proches des Républicains et 44% proches des Démocrates, ces proportions sont respectivement de 43% et 40% chez les chrétiens de 26% et 64% chez les juifs, de 17% et 62% chez les musulmans et de 15% et 69% chez les personnes sans religion. L’écart entre les personnes de confession chrétienne et les autres est essentiellement dû aux protestants évangélistes, les catholiques se situant, eux, dans la moyenne de l’échantillon.
De telles différences se retrouvent à propos des attitudes à l’égard de la conception du rôle de l’Etat. Les enquêtés étant incités à choisir entre un Etat plus développé offrant plus de services et pour un Etat moins développé offrant moins de services, ce sont les évangélistes qui créent la polarisation avec le reste de la population, étant particulièrement hostiles à un Etat actif dans le champ social. Or, non seulement ce groupe est l’un des plus hostiles à ce type d’Etat mais encore il est l’un de ceux où, entre 2006 et 2015, cette hostilité a le plus fortement augmenté (de 16 points contre 7 pour l’ensemble des Américains). C’est cette radicalisation des évangélistes, mais aussi des mormons et des orthodoxes, qui explique l’augmentation de la polarisation politique entre les Républicains et les Démocrates dans cette période. Ainsi, tandis que le choix pour un Etat peu actif dans le domaine social a augmenté de 17 points chez les Républicains, il n’a augmenté que d’un point chez les Démocrates.
Nous trouvons confirmation de ce clivage de nature religieuse à propos de l’aide gouvernementale aux plus pauvres. Les différences entre les groupes est du même ordre que vu précédemment avec une polarisation entre des évangélistes majoritairement hostiles à une telle aide et les non chrétiens largement favorables. Cette polarisation ne concerne pas uniquement la politique sociale. Elle s’étend également à la question de l’opportunité des régulations en matière d’environnement. Seuls les évangélistes y sont opposés dans leur majorité, les athées y étant les plus favorables. Du coup, la polarisation entre Républicains et Démocrates s’accroît fortement. Ainsi, tandis que le soutien aux régulations environnementales chute de treize points chez les Républicains, il augmente de trois chez les Démocrates (72% contre 39%).
On retrouve une telle corrélation à propos des attitudes à l’égard de l’accroissement de l’immigration. Tandis que les évangélistes sont partagés sur la question de savoir si cette augmentation est une bonne chose ou pas, les autres groupes sont clairement favorables à l’immigration.
On ne s’étonnera pas de constater que ce clivage entre les évangélistes et les autres groupes est particulièrement net à propos de la question du rapport entre science et religion. Seuls les évangélistes n’adhèrent pas à la théorie de l’évolution. Pour eux, la vérité sur la création du monde demeure celle inscrite dans la Bible.
Il est intéressant de constater que ce phénomène d’accroissement de la polarisation en fonction des attitudes religieuses ne concerne pas les valeurs du libéralisme culturel. Si, par exemple, les catholiques, les juifs et les athées demeurent nettement plus nombreux que les évangélistes et les musulmans à estimer que l’homosexualité devrait être acceptée dans la société, cette acceptation progresse néanmoins fortement dans tous les groupes. De même, mais en sens contraire, on ne mesure d’augmentation significative des opinions favorables à la légalisation totale de l’avortement dans aucun des groupes.
La polarisation politique actuelle aux Etats-Unis étant largement liée à la diversité des affiliations religieuses, il convient de s’interroger sur les changements démographiques qui ont pu affecter les différents groupes pour tenter de prévoir l’évolution à venir du rapport des forces politiques dans ce pays. Les évolutions mesurées entre les deux enquêtes sont ici du plus grand intérêt. Rappelons d’abord que les Etats-Unis sont l’un des pays occidentaux où l’affiliation des citoyens à une religion est la plus générale. 77% déclarent aujourd’hui une affiliation religieuse et 80% déclarent qu’ils croient en Dieu. Cependant, en l’espace d’une dizaine d’années s’est produite une baisse de six points des personnes ayant une affiliation religieuse. L’essentiel de cette baisse s’explique presqu’uniquement par le processus du renouvellement des générations. Une analyse de cohortes montre en effet que la proportion des personnes qui se rattachent à une religion, par leurs attitudes et leurs comportements, diminue régulièrement des générations plus anciennes au plus jeunes. Prenons l’exemple de la prière quotidienne: 67% des membres de la génération la plus ancienne prient tous les jours contre 39% de ceux de la génération la plus jeune. Nous retrouvons les mêmes écarts entre les différentes générations à propos de l’assistance à l’office religieux chaque semaine ou de l’affirmation selon laquelle la religion sert de boussole pour juger du bien et du mal ou bien qu’elle représente quelque chose d’important dans la vie de la personne interrogée. Nul doute qu’est ici à l’œuvre une lente mais véritable mutation de la société américaine. Néanmoins, cette baisse des pratiques religieuses ou du besoin de religion ne va pas jusqu’à s’accompagner d’une baisse significative de la croyance en Dieu… ou à l’Enfer. Si les générations les plus âgées sont massivement croyantes (92%), les plus jeunes le sont presque autant (82%). Et ces dernières croient autant à l’Enfer que les plus anciennes (56%). Comme si l’éloignement de la religion se traduisait d’abord par l’abandon des pratiques et le moindre besoin personnel de la religion et non pas par le rejet de la croyance elle-même. Nonobstant, il apparaît bien qu’il existe une tendance historique à l’affaiblissement de la religiosité au sein de la société américaine comme dans les autres sociétés occidentales, même si l’immense masse des Américains demeure croyante.
La diminution des personnes ayant une affiliation religieuse a des implications directes sur l’évolution de la composition des sympathisants du Parti démocrate. Pour la première fois, les personnes sans affiliation religieuse y constituent le groupe le plus important (28%). En revanche, chez les sympathisants républicains, les Evangélistes demeurent le groupe le plus nombreux (38%). C’est donc l’opposition entre ces deux groupes, non affiliés et évangélistes qui structure de manière croissante la polarisation politique actuelle aux Etats-Unis.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Les attitudes religieuses et politiques sont historiquement corrélées dans la plupart des pays occidentaux. La nouvelle enquête de Pew Research Center permet de mesurer l’ampleur de cette corrélation et son évolution aux Etats-Unis. Dans ce pays, cette corrélation demeure très forte et elle a même eu tendance à s’accroître dans la période récente, c’est-à-dire entre 2015 et l’enquête précédente menée en 2006.
Tandis qu’aujourd’hui 37% de l’ensemble des personnes interrogées se disent proches des Républicains et 44% proches des Démocrates, ces proportions sont respectivement de 43% et 40% chez les chrétiens de 26% et 64% chez les juifs, de 17% et 62% chez les musulmans et de 15% et 69% chez les personnes sans religion. L’écart entre les personnes de confession chrétienne et les autres est essentiellement dû aux protestants évangélistes, les catholiques se situant, eux, dans la moyenne de l’échantillon.
De telles différences se retrouvent à propos des attitudes à l’égard de la conception du rôle de l’Etat. Les enquêtés étant incités à choisir entre un Etat plus développé offrant plus de services et pour un Etat moins développé offrant moins de services, ce sont les évangélistes qui créent la polarisation avec le reste de la population, étant particulièrement hostiles à un Etat actif dans le champ social. Or, non seulement ce groupe est l’un des plus hostiles à ce type d’Etat mais encore il est l’un de ceux où, entre 2006 et 2015, cette hostilité a le plus fortement augmenté (de 16 points contre 7 pour l’ensemble des Américains). C’est cette radicalisation des évangélistes, mais aussi des mormons et des orthodoxes, qui explique l’augmentation de la polarisation politique entre les Républicains et les Démocrates dans cette période. Ainsi, tandis que le choix pour un Etat peu actif dans le domaine social a augmenté de 17 points chez les Républicains, il n’a augmenté que d’un point chez les Démocrates.
Nous trouvons confirmation de ce clivage de nature religieuse à propos de l’aide gouvernementale aux plus pauvres. Les différences entre les groupes est du même ordre que vu précédemment avec une polarisation entre des évangélistes majoritairement hostiles à une telle aide et les non chrétiens largement favorables. Cette polarisation ne concerne pas uniquement la politique sociale. Elle s’étend également à la question de l’opportunité des régulations en matière d’environnement. Seuls les évangélistes y sont opposés dans leur majorité, les athées y étant les plus favorables. Du coup, la polarisation entre Républicains et Démocrates s’accroît fortement. Ainsi, tandis que le soutien aux régulations environnementales chute de treize points chez les Républicains, il augmente de trois chez les Démocrates (72% contre 39%).
On retrouve une telle corrélation à propos des attitudes à l’égard de l’accroissement de l’immigration. Tandis que les évangélistes sont partagés sur la question de savoir si cette augmentation est une bonne chose ou pas, les autres groupes sont clairement favorables à l’immigration.
On ne s’étonnera pas de constater que ce clivage entre les évangélistes et les autres groupes est particulièrement net à propos de la question du rapport entre science et religion. Seuls les évangélistes n’adhèrent pas à la théorie de l’évolution. Pour eux, la vérité sur la création du monde demeure celle inscrite dans la Bible.
Il est intéressant de constater que ce phénomène d’accroissement de la polarisation en fonction des attitudes religieuses ne concerne pas les valeurs du libéralisme culturel. Si, par exemple, les catholiques, les juifs et les athées demeurent nettement plus nombreux que les évangélistes et les musulmans à estimer que l’homosexualité devrait être acceptée dans la société, cette acceptation progresse néanmoins fortement dans tous les groupes. De même, mais en sens contraire, on ne mesure d’augmentation significative des opinions favorables à la légalisation totale de l’avortement dans aucun des groupes.
La polarisation politique actuelle aux Etats-Unis étant largement liée à la diversité des affiliations religieuses, il convient de s’interroger sur les changements démographiques qui ont pu affecter les différents groupes pour tenter de prévoir l’évolution à venir du rapport des forces politiques dans ce pays. Les évolutions mesurées entre les deux enquêtes sont ici du plus grand intérêt. Rappelons d’abord que les Etats-Unis sont l’un des pays occidentaux où l’affiliation des citoyens à une religion est la plus générale. 77% déclarent aujourd’hui une affiliation religieuse et 80% déclarent qu’ils croient en Dieu. Cependant, en l’espace d’une dizaine d’années s’est produite une baisse de six points des personnes ayant une affiliation religieuse. L’essentiel de cette baisse s’explique presqu’uniquement par le processus du renouvellement des générations. Une analyse de cohortes montre en effet que la proportion des personnes qui se rattachent à une religion, par leurs attitudes et leurs comportements, diminue régulièrement des générations plus anciennes au plus jeunes. Prenons l’exemple de la prière quotidienne: 67% des membres de la génération la plus ancienne prient tous les jours contre 39% de ceux de la génération la plus jeune. Nous retrouvons les mêmes écarts entre les différentes générations à propos de l’assistance à l’office religieux chaque semaine ou de l’affirmation selon laquelle la religion sert de boussole pour juger du bien et du mal ou bien qu’elle représente quelque chose d’important dans la vie de la personne interrogée. Nul doute qu’est ici à l’œuvre une lente mais véritable mutation de la société américaine. Néanmoins, cette baisse des pratiques religieuses ou du besoin de religion ne va pas jusqu’à s’accompagner d’une baisse significative de la croyance en Dieu… ou à l’Enfer. Si les générations les plus âgées sont massivement croyantes (92%), les plus jeunes le sont presque autant (82%). Et ces dernières croient autant à l’Enfer que les plus anciennes (56%). Comme si l’éloignement de la religion se traduisait d’abord par l’abandon des pratiques et le moindre besoin personnel de la religion et non pas par le rejet de la croyance elle-même. Nonobstant, il apparaît bien qu’il existe une tendance historique à l’affaiblissement de la religiosité au sein de la société américaine comme dans les autres sociétés occidentales, même si l’immense masse des Américains demeure croyante.
La diminution des personnes ayant une affiliation religieuse a des implications directes sur l’évolution de la composition des sympathisants du Parti démocrate. Pour la première fois, les personnes sans affiliation religieuse y constituent le groupe le plus important (28%). En revanche, chez les sympathisants républicains, les Evangélistes demeurent le groupe le plus nombreux (38%). C’est donc l’opposition entre ces deux groupes, non affiliés et évangélistes qui structure de manière croissante la polarisation politique actuelle aux Etats-Unis.
 Re: Forum Religion et Politique
Re: Forum Religion et Politique
L’instrumentalisation des religions dans l’arène politique et dans les conflits géopolitiques est vieille comme le monde
Interview de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] par Bernard Strainchamps (10 décembre 2012)
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Georges Corm
Georges Corm, est économiste de profession, spécialiste du Moyen-Orient et de la Méditerranée, consultant auprès d’organismes internationaux et d’institutions financières. Il a été ministre des finances du Liban durant les années 1999 – 2000.
Pourriez-vous nous donner votre définition de la laïcité ?
La laïcité est une éthique de comportement des citoyens dans la sphère publique en vertu de laquelle l’identité religieuse ou ethnique d’un individu est gardée dans la sphère privée et n’est pas exploitée ou discutée dans la sphère publique à des fins politiques. Elle est aussi une éthique de la pensée en vertu de laquelle le citoyen accepte la diversité d’opinions sur tout ce qui concerne la vie de la cité et refuse tout dogmatisme, fanatisme pour rester ouvert au dialogue constructif sur la meilleure façon de réaliser le bien public.
Un Liban ou une Egypte laïque (voire un territoire regroupant les israéliens et les palestiniens), est-ce du domaine du possible ?
Le monde arabe a connu une grande période libérale depuis la fin du XIXè siècle et durant toute la première moitié du XXè siècle. Des parlements ont fonctionné dans le cadre du multipartisme et d’une liberté d’opinion de plus en plus affirmée, en parallèle avec un mouvement féministe actif. C’était aussi une époque de réforme religieuse islamique très importante ou de nombreux hommes de religion développaient des approches laïques de la vie politique.
Cette période a été close par la succession de coups d’Etat à partir des années cinquante du siècle passé. Mais auparavant déjà les autorités coloniales intervenaient abruptement dans la vie politique locale, suspendant facilement les parlements élus ou pesant de tout leur poids dans la constitution des gouvernements. Par ailleurs, l’émergence de l’Etat d’Israël en 1948, comme Etat basé sur une identité religieuse, n’a pas manqué d’influencer la situation interne des pays arabes voisins où les tenants d’un Islam conservateur et rigoriste, voire d’un rétablissement du califat, ne sont plus apparus aussi réactionnaires ou dangereux. La force et la puissance de l’Etat d’Israël ont été interprétée par les milieux conservateurs comme prouvant le fait qu’une société doit se définir par sa religion.
Après la défaite des armées arabes en 1967 face à Israël et avec la montée en puissance financière des pétromonarchies des pays de la Péninsule arabique pratiquant le rigorisme islamique, notamment l’Arabie saoudite, on a assisté à un recul de l’idéologie nationaliste arabe laïque à une montée des mouvements politiques islamistes soutenus par ces pétromonarchies.
Vous êtes historien. Les livres dédiés à des études historiques se vendent bien. Mais on dirait que cela ne sert à rien. Avez-vous une idée sur la question ?
L’un de mes amis diplomate français qui vantait mon ouvrage « Le Proche-Orient éclaté » et me félicitait du vaste public qui le lisait, notamment chez les diplomates, et à qui je faisais la réflexion que ce livre n’avait pas d’impact sur les décideurs politiques et les responsables de la diplomatie, m’a répondu avec malice et finesse : « Imaginez-vous ce que ce serait si votre livre n’était pas lu » !
En fait, je pense que la politique et surtout la géopolitique ne sont guère fait de raison, mais de passion. Les leçons de l’Histoire n’ont jamais empêché que les mêmes erreurs soient refaites qui entraînent le malheur, les conflits et les guerres dévastatrices.
Vous démontrez que la vision binaire de la guerre des civilisations est un non sens. Et pourtant, elle est en train de se mettre en place…
Elle s’est mise en place comme substitut à la vision prédominante pendant la Guerre froide en vertu de laquelle tout était analysé comme la lutte entre des démocraties libérales et le régime totalitaire de l’URSS et de ses alliés. L’URSS disparu cette vision s’est effondrée, privant les Etats-Unis de sa position de chef du monde libre. La thèse de Huntington est venue combler le vide et redonner aux Etats-Unis une mission hégémonique et salvatrice pour le monde.
Elle a acquis de la crédibilité avec beaucoup de facilité pour trois raisons essentielles. La première tient aux attentats du 11 septembre 2001 à New York et Washington attribués à la nébuleuse « Al Quaëda », cette armée de combattants jihadistes utilisés par les Etats-Unis lors de la guerre d’Afghanistan contre l’occupant soviétique. Cette armée avait été entraînée et endoctriné par l’Arabie saoudite et le Pakistan avec la bénédiction américaine. La seconde tient à la rhétorique intensive de George Bush fils accusant un prétendu « islamo-fascisme » de vouloir rétablir un califat musulman et asservir le monde. La troisième raison est le poids des traditions de l’anthropologie coloniale fortement teinté des théories racistes du XIXè siècle, qui n’a vu le monde que comme un affrontement entre races, notamment la prétendue opposition entre sémites et aryens, et entre communautés ethniques et religieuses. Dans cette optique, toutes les occupations et violences coloniales étaient justifiées par le fait de vouloir faire profiter les peuples de la supériorité de la civilisation occidentale et de faire triompher celle-ci, parce que civilisation du progrès et du bien être.
L’instrumentalisation des religions dans le bassin méditerranéen servirait en fait les intérêts des trois grandes puissances : Etats-Unis, Chine et Russie. Les politiques locaux n’ont-ils aucune vision à long terme ?
L’instrumentalisation des religions dans l’arène politique et dans les conflits géopolitiques est vieille comme le monde. Elle sert aussi bien l’ambition des hommes de religion que celle des hommes politiques. N’oublions pas que les Etats-Unis eux-mêmes se définissent comme une nation de croyants et que le dollar américain porte comme slogan « In God we trust », mais aussi qu’ils envoient de nombreux prédicateurs religieux de par le monde. Quant à l’instrumentalisation des religions en Méditerranée et au Moyen-Orient, elle est d’autant plus facile que c’est la terre d’origine des trois religions monothéistes, mais aussi qu’il s’agit d’un carrefour géographique très stratégique et qui abrite une part importante des réserves énergétiques mondiales. De plus, on y trouve des Etats ou des régimes politiques de création récente qui prétendent parler au nom de ces trois monothéismes : l’Arabie saoudite (1932), dont la constitution est censée être le Coran – qui pourtant ne préconise aucun régime politique – et qui est l’Etat qui abrite les principaux lieux saints musulmans ; l’Etat des Juifs (Israël) créé en 1948 et qui n’a d’ailleurs pas lui aussi de constitution; le régime de la République islamique d’Iran (1979) et, un peu plus loin en Asie, le Pakistan qui est né en 1947 de la sécession d’une partie des musulmans Indous et qui se définit comme l’Etat « des Purs ». Israël, l’Arabie saoudite et le Pakistan sont étroitement inféodés aux Etats-Unis, puissance impériale mondiale, cependant que l’Iran islamique s’oppose à cette hégémonie. Il a été jugé pratique dans ce cas d’opposer un axe dit « chiite » avec sa tête l’Iran et comprenant le régime syrien et le Hezbollah libanais, qui serait source du « mal » et de la subversion, à un axe sunnite qui serait modéré et bon élève de l’Occident.
Evidemment, tout cela relève du délire, très loin des réalités des conflits qui n’ont que des causes profanes banales, mais cela confirme la thèse débilitante du choc des civilisations. Cette dernière permet d’obscurcir les enjeux des conflits qui déchirent cette région du monde et qui tournent essentiellement autour de problèmes d’hégémonie internationale et régionale, de contrôle des routes des approvisionnements énergétiques et de saisie de la rente que procure ces ressources, de la protection de l’existence de l’Etat d’Israël et de sa politique de colonisation de tout le territoire palestinien. Par ailleurs, en dehors de la Turquie et de l’Iran qui chacun prétend à un rôle régional hégémonique, et à l’exception de l’Egypte, les Etats arabes sont nés d’un découpage souvent artificiel effectué à l’issue de la Première guerre mondiale par les deux grandes puissances coloniales, la France et la Grande Bretagne. Leur légitimité est faible et l’absence d’industrialisation a maintenu des particularismes régionaux, ethniques ou religieux, richesse culturelle certes, mais aussi fragmentation à l’intérieur même d’Etats structurellement faibles. La manipulation des groupes ethniques ou religieux est une grande tradition du colonialisme dans cette région. Les notabilités locales y trouvent leur avantage. Mais en réalité, à l’intérieur de chaque communauté, il y a des comportements et des opinions très diverses, voire contradictoire. C’est donc une grave erreur de penser qu’il y a des comportements homogènes et compacts à l’intérieur des communautés ethniques ou religieuses. C’est ce que fait malheureusement l’anthropologie ethnique ou religieuse et ce dont use et abuse les politiques des puissances occidentales et les médias. Ce faisant, cela consolide la domination des éléments les plus extrémistes et ambitieux dans ces communautés, par ce qu’ils sont consacrés représentants exclusifs de leur communauté et qu’ils sont sous l’influence des puissances extérieures.
Les révoltes arabes ont tenté de secouer ces formes de domination internes, liées à l’extérieur, mais encore une fois l’alliance des démocraties occidentales avec les pétromonarchies, comme dans les années 50 et 60 du siècle passé, contribue à faire avorter l’aspect libertaire et nationaliste de ces révoltes, en soutenant les mouvances islamiques conservatrices dans le jeu politique local. Mais rien n’est encore joué. L’avenir peut réserver de nombreuses surprises dans un climat qui se détériore un peu partout dans la région.
Interview de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] par Bernard Strainchamps (10 décembre 2012)
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Georges Corm
Georges Corm, est économiste de profession, spécialiste du Moyen-Orient et de la Méditerranée, consultant auprès d’organismes internationaux et d’institutions financières. Il a été ministre des finances du Liban durant les années 1999 – 2000.
Pourriez-vous nous donner votre définition de la laïcité ?
La laïcité est une éthique de comportement des citoyens dans la sphère publique en vertu de laquelle l’identité religieuse ou ethnique d’un individu est gardée dans la sphère privée et n’est pas exploitée ou discutée dans la sphère publique à des fins politiques. Elle est aussi une éthique de la pensée en vertu de laquelle le citoyen accepte la diversité d’opinions sur tout ce qui concerne la vie de la cité et refuse tout dogmatisme, fanatisme pour rester ouvert au dialogue constructif sur la meilleure façon de réaliser le bien public.
Un Liban ou une Egypte laïque (voire un territoire regroupant les israéliens et les palestiniens), est-ce du domaine du possible ?
Le monde arabe a connu une grande période libérale depuis la fin du XIXè siècle et durant toute la première moitié du XXè siècle. Des parlements ont fonctionné dans le cadre du multipartisme et d’une liberté d’opinion de plus en plus affirmée, en parallèle avec un mouvement féministe actif. C’était aussi une époque de réforme religieuse islamique très importante ou de nombreux hommes de religion développaient des approches laïques de la vie politique.
Cette période a été close par la succession de coups d’Etat à partir des années cinquante du siècle passé. Mais auparavant déjà les autorités coloniales intervenaient abruptement dans la vie politique locale, suspendant facilement les parlements élus ou pesant de tout leur poids dans la constitution des gouvernements. Par ailleurs, l’émergence de l’Etat d’Israël en 1948, comme Etat basé sur une identité religieuse, n’a pas manqué d’influencer la situation interne des pays arabes voisins où les tenants d’un Islam conservateur et rigoriste, voire d’un rétablissement du califat, ne sont plus apparus aussi réactionnaires ou dangereux. La force et la puissance de l’Etat d’Israël ont été interprétée par les milieux conservateurs comme prouvant le fait qu’une société doit se définir par sa religion.
Après la défaite des armées arabes en 1967 face à Israël et avec la montée en puissance financière des pétromonarchies des pays de la Péninsule arabique pratiquant le rigorisme islamique, notamment l’Arabie saoudite, on a assisté à un recul de l’idéologie nationaliste arabe laïque à une montée des mouvements politiques islamistes soutenus par ces pétromonarchies.
Vous êtes historien. Les livres dédiés à des études historiques se vendent bien. Mais on dirait que cela ne sert à rien. Avez-vous une idée sur la question ?
L’un de mes amis diplomate français qui vantait mon ouvrage « Le Proche-Orient éclaté » et me félicitait du vaste public qui le lisait, notamment chez les diplomates, et à qui je faisais la réflexion que ce livre n’avait pas d’impact sur les décideurs politiques et les responsables de la diplomatie, m’a répondu avec malice et finesse : « Imaginez-vous ce que ce serait si votre livre n’était pas lu » !
En fait, je pense que la politique et surtout la géopolitique ne sont guère fait de raison, mais de passion. Les leçons de l’Histoire n’ont jamais empêché que les mêmes erreurs soient refaites qui entraînent le malheur, les conflits et les guerres dévastatrices.
Vous démontrez que la vision binaire de la guerre des civilisations est un non sens. Et pourtant, elle est en train de se mettre en place…
Elle s’est mise en place comme substitut à la vision prédominante pendant la Guerre froide en vertu de laquelle tout était analysé comme la lutte entre des démocraties libérales et le régime totalitaire de l’URSS et de ses alliés. L’URSS disparu cette vision s’est effondrée, privant les Etats-Unis de sa position de chef du monde libre. La thèse de Huntington est venue combler le vide et redonner aux Etats-Unis une mission hégémonique et salvatrice pour le monde.
Elle a acquis de la crédibilité avec beaucoup de facilité pour trois raisons essentielles. La première tient aux attentats du 11 septembre 2001 à New York et Washington attribués à la nébuleuse « Al Quaëda », cette armée de combattants jihadistes utilisés par les Etats-Unis lors de la guerre d’Afghanistan contre l’occupant soviétique. Cette armée avait été entraînée et endoctriné par l’Arabie saoudite et le Pakistan avec la bénédiction américaine. La seconde tient à la rhétorique intensive de George Bush fils accusant un prétendu « islamo-fascisme » de vouloir rétablir un califat musulman et asservir le monde. La troisième raison est le poids des traditions de l’anthropologie coloniale fortement teinté des théories racistes du XIXè siècle, qui n’a vu le monde que comme un affrontement entre races, notamment la prétendue opposition entre sémites et aryens, et entre communautés ethniques et religieuses. Dans cette optique, toutes les occupations et violences coloniales étaient justifiées par le fait de vouloir faire profiter les peuples de la supériorité de la civilisation occidentale et de faire triompher celle-ci, parce que civilisation du progrès et du bien être.
L’instrumentalisation des religions dans le bassin méditerranéen servirait en fait les intérêts des trois grandes puissances : Etats-Unis, Chine et Russie. Les politiques locaux n’ont-ils aucune vision à long terme ?
L’instrumentalisation des religions dans l’arène politique et dans les conflits géopolitiques est vieille comme le monde. Elle sert aussi bien l’ambition des hommes de religion que celle des hommes politiques. N’oublions pas que les Etats-Unis eux-mêmes se définissent comme une nation de croyants et que le dollar américain porte comme slogan « In God we trust », mais aussi qu’ils envoient de nombreux prédicateurs religieux de par le monde. Quant à l’instrumentalisation des religions en Méditerranée et au Moyen-Orient, elle est d’autant plus facile que c’est la terre d’origine des trois religions monothéistes, mais aussi qu’il s’agit d’un carrefour géographique très stratégique et qui abrite une part importante des réserves énergétiques mondiales. De plus, on y trouve des Etats ou des régimes politiques de création récente qui prétendent parler au nom de ces trois monothéismes : l’Arabie saoudite (1932), dont la constitution est censée être le Coran – qui pourtant ne préconise aucun régime politique – et qui est l’Etat qui abrite les principaux lieux saints musulmans ; l’Etat des Juifs (Israël) créé en 1948 et qui n’a d’ailleurs pas lui aussi de constitution; le régime de la République islamique d’Iran (1979) et, un peu plus loin en Asie, le Pakistan qui est né en 1947 de la sécession d’une partie des musulmans Indous et qui se définit comme l’Etat « des Purs ». Israël, l’Arabie saoudite et le Pakistan sont étroitement inféodés aux Etats-Unis, puissance impériale mondiale, cependant que l’Iran islamique s’oppose à cette hégémonie. Il a été jugé pratique dans ce cas d’opposer un axe dit « chiite » avec sa tête l’Iran et comprenant le régime syrien et le Hezbollah libanais, qui serait source du « mal » et de la subversion, à un axe sunnite qui serait modéré et bon élève de l’Occident.
Evidemment, tout cela relève du délire, très loin des réalités des conflits qui n’ont que des causes profanes banales, mais cela confirme la thèse débilitante du choc des civilisations. Cette dernière permet d’obscurcir les enjeux des conflits qui déchirent cette région du monde et qui tournent essentiellement autour de problèmes d’hégémonie internationale et régionale, de contrôle des routes des approvisionnements énergétiques et de saisie de la rente que procure ces ressources, de la protection de l’existence de l’Etat d’Israël et de sa politique de colonisation de tout le territoire palestinien. Par ailleurs, en dehors de la Turquie et de l’Iran qui chacun prétend à un rôle régional hégémonique, et à l’exception de l’Egypte, les Etats arabes sont nés d’un découpage souvent artificiel effectué à l’issue de la Première guerre mondiale par les deux grandes puissances coloniales, la France et la Grande Bretagne. Leur légitimité est faible et l’absence d’industrialisation a maintenu des particularismes régionaux, ethniques ou religieux, richesse culturelle certes, mais aussi fragmentation à l’intérieur même d’Etats structurellement faibles. La manipulation des groupes ethniques ou religieux est une grande tradition du colonialisme dans cette région. Les notabilités locales y trouvent leur avantage. Mais en réalité, à l’intérieur de chaque communauté, il y a des comportements et des opinions très diverses, voire contradictoire. C’est donc une grave erreur de penser qu’il y a des comportements homogènes et compacts à l’intérieur des communautés ethniques ou religieuses. C’est ce que fait malheureusement l’anthropologie ethnique ou religieuse et ce dont use et abuse les politiques des puissances occidentales et les médias. Ce faisant, cela consolide la domination des éléments les plus extrémistes et ambitieux dans ces communautés, par ce qu’ils sont consacrés représentants exclusifs de leur communauté et qu’ils sont sous l’influence des puissances extérieures.
Les révoltes arabes ont tenté de secouer ces formes de domination internes, liées à l’extérieur, mais encore une fois l’alliance des démocraties occidentales avec les pétromonarchies, comme dans les années 50 et 60 du siècle passé, contribue à faire avorter l’aspect libertaire et nationaliste de ces révoltes, en soutenant les mouvances islamiques conservatrices dans le jeu politique local. Mais rien n’est encore joué. L’avenir peut réserver de nombreuses surprises dans un climat qui se détériore un peu partout dans la région.
 Re: Forum Religion et Politique
Re: Forum Religion et Politique
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Résumé : La modernité est vue comme une grande rupture dans l’histoire de l’humanité, qui est venue bouleverser le paysage aussi bien politique que religieux. Selon Max Weber, le monde moderne subirait un processus de « désenchantement ». Le sens magique disparaîtrait. En outre la modernité instaurerait une signification de l’être humain saisi hors de tout conditionnement culturel et l’image d’une autorité, ou d’un pouvoir, toujours en quête de sa légitimité. Une modernité « à l’état pur » supposerait ainsi l’évacuation totale de toute croyance de nature religieuse, l’élimination de toute référence à une force transcendante pourvoyeuse de certitudes.
Mots-clés : Martyr ; Modernité ; Politique ; Religieux ; Religion ; Sacré ; Violence ; Weber.
Abstract : Modernity is seen as a great rupture in the history of humanity, which came to disrupt the landscapes in both the religious and political settings. According to Max Weber, the modern world would be undergoing a process of “disenchantment”. The sense of magic would be disappearing. Furthermore, modernity would set a significance of the human being that does not entail cultural conditioning, and the image of an authority or a power, always in quest of its own legitimacy. Modernity in its “pure state” would also suppose the total evacuation of any religious-related belief, the elimination of all references to a transcendental force providing certainty.
Keywords : Martyr ; Modernity ; Politics ; Religious ; Religion ; Sacred ; Violence ; Weber.
Introduction
La modernité est vue comme une grande rupture dans l'histoire de l'humanité, qui est venue bouleverser le paysage aussi bien politique que religieux. Selon Max Weber, le monde moderne subirait un processus de « désenchantement ». Le sens magique disparaîtrait. En outre la modernité instaurerait une signification de l'être humain saisi hors de tout conditionnement culturel et l'image d'une autorité, ou d'un pouvoir, toujours en quête de sa légitimité. Une modernité « à l'état pur » supposerait ainsi l'évacuation totale de toute croyance de nature religieuse, l'élimination de toute référence à une force transcendante pourvoyeuse de certitudes.
Sens et enjeux du « renouveau » religieux
La modernité serait dès lors le lieu de la différenciation, ou de l'émancipation du politique à l'égard du religieux. Or, parallèlement, on assiste depuis le milieu des années soixante-dix au développement d'une série de mouvements religieux dans des aires culturelles diverses, qui le plus souvent ont en commun la critique du fondement séculier de la modernité.
Les nouveaux paysages qui se dessinent se caractérisent notamment par une inflation des productions victimaires qui vient contrarier une vision moderne qui l'exclut et qui promeut le respect du sujet individuel, la solidarité, la tolérance, la rationalité, soit « l'exclusion de la passion et du tragique du champ des relations humaines »[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/sup]. Ces mouvements provoquent la recherche de nouvelles réponses politiques écrites dans une syntaxe religieuse. Ils entraînent un redéploiement et une nouvelle représentation du rapport à la mort en général, et à la mort sacrée en particulier. Ce rapport se sécularise, se politise, revêt une signification actuelle, en relation avec ces nouvelles représentations du religieux.
Or la mort sacrée, les valeurs sacrificielles, renvoient d'abord et surtout à la figure du martyr. D'origine essentiellement religieuse[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/sup], cette figure intéresse le politique au plus haut point, lequel va s'efforcer d'en faire un opérateur symbolique efficace.
Origine, évolution et extension du phénomène du martyr
Le terme de martyr fut appliqué aux chrétiens des premiers siècles, qui eurent à affronter la persécution et la mort pour la défense de leur foi. Il a été conçu et imaginé en réponse à des pressions sociales, religieuses et politiques complexes.
Le contexte des guerres de Religion conduit à infléchir le sens du phénomène du martyr. A la fin du 16e siècle, on assiste à des tentatives d'assimilation ou tout au moins de conciliation entre la figure du stoïcien et celle du martyr : ce que les héros ont souffert pour leur patrie ou pour la vertu, les martyrs l'ont enduré pour Dieu et pour la foi. La cause était différente mais la constance était la même. « Les causes seulement manquaient à leurs martyres »[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/sup], écrit Agrippa d'Aubigné à propos des héros stoïciens et en référence à la doctrine augustinienne du martyre selon laquelle l'essentiel en la matière réside dans une juste cause. Aussi le martyr de la cause réformée, parce qu'il se bat en même temps pour sa foi et pour les libertés de son Église, réunit les figures désormais complémentaires du martyr chrétien et du héros païen.
Dans son ouvrage Rome et le martyre, Glen W. Bowersock rappelle l'extension du concept de martyr auprès des populations musulmanes, avec la conquête de la Palestine au 7e siècle. C'est après la conquête musulmane de la Palestine au 7e siècle que la notion de témoin (chahid) en vient à signifier explicitement la mort sacrée, en référence à la notion grecque de marturos et à sa double signification comme témoin et martyr. Reste qu'il y a dans le cas du martyr musulman une différence fondamentale qu'il conviendrait de souligner d'emblée : la justification du martyre en islam se fonderait sur la sourate Repentir, selon laquelle le principe consiste à « tuer ou se faire tuer dans la voie d'Allah ». Autrement dit, la violence ne provient pas exclusivement du côté de l'adversaire mais elle est assumée par le croyant qui y recourt en toute légitimité selon les préceptes de sa foi. Sur ce point, la signification est tout autre dans le christianisme où la violence physique est à sens unique. Le martyre musulman est fortement lié à cette autre notion séminale qu'est le djihad, ou guerre sainte. La différence majeure entre la notion de djihad dans l'islam et celle de croisade dans le christianisme réside dans leur fondement théologique : présent dans l'islam, il est absent du christianisme.
L'extension du concept de martyr du christianisme à l'islam nous interroge sur l'existence d'un terrain commun aux divers usages du martyr, qui déterminerait le sens de cette figure indépendamment de tout positionnement religieux déterminé. Partant, se pose la question de la légitimité que la figure du martyr procurerait à la cause défendue par la victime - d'où une interrogation sur l'extension de son usage en dehors du champ religieux au sens strict du terme. Autrement dit, cela suppose l'existence de ressorts anthropologiques différents et complémentaires que la référence au martyr activerait, ce qui pourrait concourir à la fois à la production du religieux et à celle de valeurs et de représentations intéressant au plus haut point le politique. Cette capacité mobilisatrice de la figure du martyr reposerait donc sur des données anthropologiques structurelles, qui permettraient au martyr de passer sans difficulté de la sphère du religieux à celle du politique.
1ère partie : Les ressorts anthropologiques structurels du martyr comme figure sacrificielle
Le sacrifice : place et fonction
Selon René Girard, le sacrifice fonde l'ordre social et toutes les institutions, qui sont d'origine religieuse, conservent les traces de ces origines sacrificielles. Le sacrifice est un acte social, et c'est la violence qui constitue le cœur véritable et l'âme secrète du sacré. Dans cette perspective, la théologie du sacrifice est primordiale. Il faut retrouver les rapports conflictuels que le sacrifice et sa théologie dissimulent et apaisent tout à la fois. Le sacrifice suprême ne se limite pas à un simple processus intellectuel, à une opération absolue ou extrême qui porte sur un objet interne dont le but est d'instaurer un rapport de contiguïté que le sacrifice romprait par la destruction de la victime - une fois le rapport entre l'homme et la divinité assuré par la sacralisation de cette dernière. Le sacrifice ne se limite pas à chercher l'instauration d'une connexion souhaitée entre deux domaines initialement séparés. Son but n'est pas uniquement d'obtenir qu'une divinité lointaine comble les vœux humains en reliant d'abord les domaines (initialement séparés), puis en abolissant le terme connectant. Le sacrifice polarise des germes de dissension partout répandus et les dissipe en leur proposant un assouvissement partiel. Le sacrifice consiste à expulser la violence originelle de la condition humaine en la projetant sur une victime choisie, le bouc-émissaire. La société cherche à détourner vers une victime relativement indifférente, une victime « sacrifiable », une violence qui risque de frapper ses propres membres, ceux qu'elle entend à tout prix protéger. Le sacrifice religieux est une violence fondatrice de la communauté dans la mesure où il exprime la violence commune de tous contre un seul, et cela dans le but de se délivrer de la violence originelle et de créer un ordre humain, pacifié. Le sacrifice restaure l'harmonie de la société et renforce son unité. Le religieux primitif domestique la violence, il la règle, l'ordonne, la canalise, afin de l'utiliser contre toute forme de violence intolérable. Il définit une combinaison particulière de violence et de non-violence. Mais cette violence originelle expulsée est toujours là, prête à revenir. La quasi-totalité de ces sociétés devaient, jusqu'à présent, défendre leur survie les armes à la main et, pour ce faire, susciter chez leurs membres l'acceptation de l'éventualité de l'offrande de leur propre vie. Sans doute croyaient-elles que les ancêtres ou les dieux combattaient à leurs côtés, en échange du sacrifice renouvelé des victimes. Mais leurs membres devaient être prêts à se sacrifier pour elles. La victime consentante se trouvait récompensée dans l'Au-delà. Mais elle l'était également par l'échange d'une existence quotidienne, profane, contre une immortalité de gloire dans la mémoire des survivants et des descendants. Elle se trouvait conditionnée à cette fin héroïque par le discours sacrificiel associé à sa socialisation de base, mythes et légendes véhiculant des modèles offerts à l'identification du sujet. Dans cette perspective, seront alors dits religieux tous les phénomènes liés à la remémoration, à la commémoration et à la perpétuation d'une unanimité toujours enracinée, en dernière instance, dans un sacrifice. « Vous ne voyez pas qu'il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse. »[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/sup]
Cette phrase que Jean place dans la bouche du grand prêtre Caïphe, au cours du débat qui aboutit à la décision de faire mourir Jésus, montre l'impératif de limiter au maximum la violence et de n'y recourir, s'il le faut, qu'à la dernière extrémité pour éviter une violence plus grande. Caïphe incarne la raison politique. En dépouillant les communautés traditionnelles de leurs prétentions à gérer la destinée de leurs membres, l'État moderne a dévalorisé à son profit cet ordre victimaire antérieur. S'identifiant à l'émergence de la raison triomphant du pathos médiéval, barbare ou sauvage, l'État moderne tire sa légitimité de la volonté du peuple souverain, ce qui a pu favoriser l'émergence du sujet individuel, libre de ses choix. Ce « citoyen » a néanmoins reconnu à son État un monopole de gestion de la violence à l'intérieur de son territoire, dans le cadre du droit établi et surtout le droit de gérer, sous couvert d'une volonté librement consentie, l'offrande de sa vie en cas de guerre : « mourir pour la patrie est le sort le plus beau et le plus digne d'envie. » L'État sacrificateur gère le « martyre » éventuel de ses mandants et défenseurs et entretient le culte, commémore les grands héros, honore les victimes exemplaires.
Sacrifice, violence et sacré : la résurgence des passions victimaires
La violence sacrée persiste de fait aujourd'hui. Les martyrs viennent vivifier des communautés politiques, favoriser leur consolidation, susciter une passion victimaire propice à leur mobilisation, leur permettant ainsi d'affronter des communautés rivales. La résurgence et la généralisation des violences, qui sont engendrées par la réapparition d'affirmations nationalistes face à des États dont le monopole de la violence physique légitime est contesté de toutes parts, contraint donc à tenir compte d'un fait qui apparaît incontournable : le sacrifice suprême est d'abord une pratique politique essentielle[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/sup]. Une polis ne peut exister qu'à partir du moment où ses membres sont prêts à donner leur vie pour elle. Le sacrifice ou le martyre du citoyen est la condition sine qua non d'une nation. Le sacrifice suprême supporte dès lors un rapport d'alliance au sens fort du terme. Les martyrs sont les agents les plus dramatiques d'une mise en récits de la nation, et celle-ci n'existe jamais aussi concrètement qu'à travers eux qui, en mourant pour elle, apportent la preuve de son existence. Les « nations sans États » revendiquent d'ailleurs précisément le droit d'appeler leurs membres au « sacrifice suprême » et fondent leur stratégie de survie sur celui-ci. Tel fut le cas, par exemple, du peuple igbo au sein du Biafra ou des Croates de l'ex-Yougoslavie et des Kurdes de Turquie.
Le sacrifice suprême est un geste politique fondateur. Il s'explique à un premier niveau en termes d'efficacité pragmatique. Un sacrifice relève toujours d'une institution ; c'est un fait collectif rassemblant des communautés conscientes d'assister à un acte fondateur. La mort acceptée a une valeur d'attestation, qui est susceptible de fortifier la communauté « croyante ». Au Mali, l'immolation conduit à libérer la force vitale contenue dans le sang ; ce sang nourrit la divinité mais celle-ci va faire bénéficier à son tour, dans le même mouvement, le sacrifiant et la collectivité d'une part de sa force. Le mot « dogon », qui correspond à « sacrifice », signifie « faire revivre ». Ce rite fait revivre à la fois les divinités et les hommes qui ont perdu une part de leur force vitale. Le sacrifice ne profite donc pas uniquement au sacrifiant et il réalise à la fois l'ordre social et l'ordre cosmique[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/sup]. Cette idée se retrouverait également dans le christianisme, dans la mesure où le martyr imiterait la mort rédemptrice du Christ. L'idée que la souffrance acceptée des saints-martyrs a une valeur rédemptrice est explicite dans la théologie catholique de la « réparation » ou de la « spiritualité victimale ». Un saint-victime peut prendre sur lui les péchés d'une communauté et se donner comme substitut des pécheurs à la colère divine. L'idée d'une victime substitutive contribue ainsi à la construction d'une communauté de bénéficiaires supposés du sacrifice.
Le sacrifice suprême s'inscrit d'une part dans l'ordre du don, au sens où l'entend Marcel Mauss, c'est-à-dire un phénomène social basé sur un échange permanent entre partenaires de prestations à caractère symbolique, base du rituel social qui fonde le jeu des interrelations au sein des sociétés traditionnelles. Le don de soi s'inscrit d'autre part dans le cadre du processus de communication avec le sacré. Le sacrifice suprême en tant que tel est tout à la fois don de soi et sacralisation du sujet sans interposition d'un intermédiaire entre sa personne et le sacré, dont les référents varient entre celui de la patrie et celui d'un Dieu que cet acte réjouit et qu'il récompense. Le sujet qui accepte une mort immédiate et tragique, ou sa simple éventualité, ne la conçoit pas comme une fin définitive mais comme un rite de passage d'une vie médiocre et dérisoire à une « vraie vie ». Et il est précisément sacralisé du fait de son intimité avec la mort, au même titre qu'une victime sacrificielle. Sa propre destruction assure sa promotion à un état de sacralité qui l'isole de ses contemporains ; le sujet du sacrifice suprême passe directement dans le domaine du sacré. Aussi l'être sacralisé rend d'une part possible une médiation privilégiée entre l'humain et le divin ; et, d'autre part, il intervient dans l'organisation collective du sacré, en particulier lorsque des groupes sociaux ont besoin d'une puissance pour garantir et galvaniser une protestation ou une révolte sociale. Le charisme sacré est alors étendu de la sphère religieuse à l'ensemble de l'environnement sociopolitique.
Le sacrifice suprême est enfin la pierre angulaire du tissu social. La capacité au sacrifice suprême a cette propriété essentielle de créer un rapport interpersonnel qui engage et maintient les individus dans une relation de réciprocité continue. Le sentiment d'appartenance à la communauté a un caractère dynamique, interactionniste et social. Cette situation a deux types de conséquences. Tout d'abord, la reconnaissance dans le passé de valeurs ou de références (nationales, par exemple) toujours d'actualité leur confèrent une sorte de transcendance, au moins dans la mesure où leur dimension temporelle excède la durée de la vie humaine. Le culte commun d'un « grand ancêtre », tout en pouvant revêtir la forme d'un devoir de reconnaissance, suggère une sorte de parenté entre ceux qui se reconnaissent ses « descendants ». Prenons l'exemple de la mort de Jan Palach[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/sup]. Son martyre trouve un précédent dans la mort de Jan Hus au bûcher, le 6 juillet 1458[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/sup]. Les deux noms surgissent côte à côte presque automatiquement. D'après ce que nous savons de l'éducation de Jan Palach, on vénérait chez lui Jan Hus et Jan Zizka comme modèles. Le précédent ne serait donc pas fortuit mais voulu. Jan Palach avait d'ailleurs lui-même évoqué la force de l'exemple des grandes figures de l'histoire tchèque. La mort de Jan Palach offre ainsi une illustration particulièrement explicite de cette donnée essentielle selon laquelle la communauté refigure le martyr à son tour. Le suicide par le feu de l'étudiant tchèque n'est pas le geste isolé d'un individu exalté ; comme il a pu lui-même le revendiquer, c'est la conclusion d'une action concertée. La communauté inaugure et poursuit une tradition de figuration en cherchant à être à l'image de ce qu'elle transmet. La tradition est la promotion au présent pour l'avenir de cette mémoire de l'action. C'est à ce titre que le martyr peut être convoqué par une communauté comme figure d'avenir.
2nde partie : de la transposition du martyr de la sphère du religieux à celle du politique
Le religieux comme lieu possible d'une instrumentalisation politique
Le politique, comme le religieux, est une essence, une activité originaire et sui generis : il a sa logique propre et ses propres présupposés. Mais il n'est pas séparable des autres activités humaines. Jusqu'aux temps modernes, dans la plupart des sociétés humaines, les rapports du politique et du religieux furent des rapports de subordination ; la politique était subordonnée à la religion. A notre époque, au contraire, la politique tend à être l'instance suprême qui entre avec la religion dans un rapport de substitution où elle devient le nouveau support du sacré et du religieux. Ce faisant, le politique usurpe des fonctions et des rôles qui sont spécifiquement religieux ; le politique devient politique de salut. Toutefois, la politique reste dans le domaine du relatif et de l'immanent ; elle ne fait que « mimer » la religion sans la supprimer pour autant. C'est pourquoi le politique va s'efforcer de mobiliser ces structures religieuses et ces ressorts anthropologiques. Il va se montrer susceptible de s'approprier des symboles religieux et de les attirer à son profit.
Force est de noter une dialectique entre le thème religieux et le thème national ; tout se passe comme s'il y avait détournement de l'imaginaire religieux. Le vocabulaire est en règle générale emprunté au discours religieux, même lorsqu'il s'applique à des domaines comme le patriotisme nationaliste. Le religieux n'est plus ici qu'un prête-nom. D'ailleurs, il ne faut pas nécessairement une religion pour devenir martyr. Il suffit qu'il y ait sacralisation d'une cause - celle-ci étant le plus souvent nationale. En effet, là où se manifeste la prétention de mourir pour une cause sacrée, c'est-à-dire qui dépasse les désirs personnels au sein d'une totalité imaginaire, nationale ou mondiale, alors la figure du martyr est envisageable. Ainsi, par exemple, le martyr libanais tire-t-il son origine d'une motivation politico-religieuse qui s'inscrit dans une représentation chiite sous l'obédience du Hezbollah, d'une volonté de lutte nationale, que ce soit dans le cadre d'un parti politique national ou du parti communiste. Le martyr du Hezbollah est un martyr milicien qui a subi une « libanisation », alors que le Hezbollah l'avait auparavant islamisé. Après 1990, le Hezbollah est passé d'un statut de milice à un statut de résistance. Alors qu'on ne parlait auparavant que de la voie de Dieu, se développe l'expression « mourir sur la voie de la nation ». Que l'on considère également le cas des « Tigres » tamouls, on se rend compte que ce mouvement, qui n'est pas d'inspiration religieuse, comporte le plus grand nombre de morts pour la cause. Un reportage publié en l'an 2000 par un journaliste de la Far Eastern Economic Review[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/sup] avait décrit les itinéraires de quelques jeunes gens se préparant à devenir des martyrs de la cause tamoule. « C'est le plus grand sacrifice que je puisse faire, expliquait l'un d'eux. Le seul moyen par lequel nous puissions obtenir notre territoire national est par les armes. C'est la seule manière de nous faire entendre. Même si nous mourons. »
L'auteur de l'article soulignait qu'il y avait dans cette attitude un mélange de frustration accumulée et de pression psychologique : les jeunes sont sensibles à la propagande permanente des Tigres, qui exalte les actes des héros de la cause. Le discours des chefs tamouls met l'accent sur l'héroïsme, la noblesse et la gloire de l'acte de sacrifice de soi. « Nous combattons et sacrifions nos vies pour l'amour d'une noble cause, à savoir la liberté humaine. Nous sommes des combattants de la liberté. »[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/sup]
Chaque martyr revêt ainsi une grande valeur du point de vue de la propagande, enclenchant une sorte de réaction en chaîne.
Une autre condition essentielle doit être réunie pour rendre politiquement et socialement opérante la figure du martyr : la présence dans le groupe d'une structure mythique de type millénariste, c'est-à-dire du thème de la régénération et du salut. C'est bien sûr dans les religions prophétiques que la thématique millénariste se manifeste le plus nettement. La force du mythe est proportionnelle à la fragilité des édifices sociaux. Elle traduit à la fois ce qui mine l'ordre et ce qui promet de la reconstituer. C'est cette ambivalence essentielle qui justifierait les sollicitations contradictoires dont le mythe est l'objet dans un espace politique entretenant la tension entre fonction d'intégration et fonction de subversion. La frustration extrême engendrée par un déséquilibre ne peut déboucher sur l'aspiration millénariste sans que soit présente dans le groupe cette structure mythique de l'espoir. Enfin, un messie est toujours nécessaire pour cristalliser l'attente collective. Son pouvoir est de type « charismatique » (Max Weber), c'est-à-dire fondé sur un rayonnement personnel et la dévotion du groupe « effervescent » de ses disciples. La religion fournit des substituts parentaux et assure l'intégration sociale, elle est principe de légitimation de l'ordre social. Le cas iranien montre comment la mort revêt un nouveau sens politique et se fonde sur le désespoir consécutif à l'écroulement inavoué de l'utopie révolutionnaire. La jonction entre le politique et le religieux se révélant impossible ici-bas, les jeunes tentent alors de la réaliser dans la mort. Dans ses versions modernisées et radicales, le martyr exprime cette situation limite : avènement difficile d'un processus d'individuation, échec des formes laïques de modernisation qui ont accru l'aspiration à l'autonomie sans lui apporter une satisfaction effective, et choix de la mort violente devant le constat de l'impossible réalisation de soi, accompagnée de la mise à mort de ceux que le martyr identifie comme les causes de son malheur. Le martyre oscille entre le suicide, la mise à mort d'autrui, la démission et l'affirmation de soi. Mourir sert alors de succédané à l'ambition déçue de vivre pleinement l'utopie révolutionnaire. Le martyr dans cette perspective se donne pour tâche de transformer la totalité. Ceci s'effectue par le biais d'une recréation du passé à l'aune de l'espérance projetée dans le futur.
Les formes d'instrumentalisation politique du martyr religieux
Cette logique politique du sacrifice n'a pu toutefois aboutir de manière durable que dans deux secteurs privilégiés : la « nation-ethnie » et la communauté confessionnelle.
Martyre et nations : usages nationalistes de la figure du martyr
Les « nations-ethnies » ont l'avantage d'offrir à leurs membres, et aux minorités activistes qui s'emploient à les mobiliser, tout un corpus de mythes, de rituels victimaires constamment revivifiés par les cérémonies commémoratives, les récits éducatifs, le folklore. Ce sont des éléments essentiels de la socialisation de l'enfant, exaltant les figures de martyrs offertes à l'identification des héritiers.
Un autre avantage de ce cadre social est de se fonder sur un imaginaire de durée étendue, voire d'éternité, basé sur la croyance selon laquelle les martyrs d'antan se réincarnent symboliquement de manière quasi-biologique dans ceux d'aujourd'hui, lesquels transmettront cet héritage à leurs descendants pour que, de génération en génération, de victime consentante en victime consentante, la lignée se perpétue et avec elle l'être collectif « éternel » qu'elle constitue. La victime volontaire entre dans le panthéon de la communauté, laquelle lui offre en échange une gloire éternelle. C'est au prix de cette gloire flamboyante que le sujet moderne en vient à consentir son auto-sacrifice. De tels processus ne sont ni automatiques ni immédiats. Il faut y convertir des sujets réticents, invités à privilégier l'identité ethno-nationaliste en question sur toute autre. A cet effet, il est souvent indispensable pour les meneurs de disposer de premiers martyrs, lesquels incarnent les grandes figures mythiques et suscitent des processus d'identification, ainsi que des réactions vindicatives à l'encontre de leurs bourreaux. Or ces victimes ne peuvent être produites, en principe, que par l'adversaire désigné comme persécuteur. Un cycle de provocation-répression peut alors s'engager.
La sacralisation de l'idée-force de nation, illustrée par la mythologie nationaliste (différente de la signification territoriale et ethnique de la patrie-terre des ancêtres), vient de la représentation que les individus se font de l'être collectif qu'ils constituent à travers l'histoire, une fois que la sacralité religieuse ne leur permet plus de se situer dans la mouvance des dieux. La communauté nationale se dote d'une personnalité historique à l'aide de mythes d'origine, de héros fondateurs, qu'elle commémore régulièrement par des fêtes chargées de régénérer la vie collective. La nation unifie les différences entre groupes et communautés partielles et développe une puissance messianique ; elle s'oppose dès lors aux autres nations comme un monde sacré s'oppose à un monde profane, voir à l'impur. Pour M.Rodinson[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/sup], l'idéologie nationaliste « tend à identifier les compétitions, conflits et luttes de groupe avec les autres à l'éternel combat du bien et du mal ». De même, en tant que force transcendante, elle peut exiger de ses membres un dévouement et un sacrifice inconditionnels, au même titre que les puissances invisibles dans la sphère du religieux. Enfin, l'avenir de la nation ne résulte pas essentiellement d'un projet rationnel mais se confond avec une mission sacrée, inscrite depuis ses origines dans un héritage à défendre, un corps de valeurs à répéter fidèlement. L'explosion des nationalismes a donc permis l'extension à l'échelle planétaire de véritables religions séculières, dans lesquelles la nation sert de foyer de transmutation de la symbolique religieuse.
Martyre et communautés : usages politico-confessionnels de la figure du martyr
Il existe un second champ d'application du « retour des martyrs » qui réside dans certaines mobilisations politico-confessionnelles. Elles sont fondées sur les mêmes stratégies victimaires que les mouvements ethno-nationalistes, avec lesquelles elles se confondent souvent et par rapport auxquels elles peuvent constituer des alternatives. Les courants contemporains de « revanche de Dieu » s'inscrivent en effet dans une sphère de recommunautarisation ambiguë, qui débouchent sur des représentations collectives indéniablement politiques - qu'il s'agisse de mouvements de « rejudaïsation », de « réhindouisation », de « rechristianisation » ou de « réislamisation »... Ces appels font signe vers la production de passions victimaires exaspérées par le rappel des martyrs d'antan, proposés comme pôles d'identification. Leur force mobilisatrice est étroitement liée à l'impact du modèle sacrificiel véhiculé par les patrimoines religieux. Par le court-circuit victimaire, le croyant « fanatisé » insouciant de sa vie achète à bon compte une paix et un bonheur éternels : le sacrifice du martyr lui apparaît comme la voie royale par laquelle le croyant peut accéder à une éternité dont l'éclat qu'on lui fait miroiter éclipse les avantages d'une vie terrestre dévalorisée.
C'est au sein de l'islam, soumis à des courants de politisation se réclamant de modèles fondés sur la non-séparation du politique et du religieux, que la dimension sacrificielle est aujourd'hui la plus exaltée. Ces courants véhiculent l'imaginaire mobilisateur d'un « djihad » entendu dans son acception la plus agressive, ainsi que du martyr, l'un et l'autre étroitement mêlés. C'est au sein de l'ensemble chiite, édifié sur le martyr des imams descendant du calife Ali, et notamment de son fils Husein, assassiné par son rival Yazid à Karbala, le 10 octobre 680, que le culte du sacrifice est le plus vivant. Chaque année, l'anniversaire de la tragédie de Karbala est célébré par des foules en deuil, dans un concert de flagellations publiques. Cette vision victimaire a été revivifiée par un clergé dressé contre un régime impie assimilé à celui du bourreau Yazid, débouchant sur la « révolution islamique » de 1979 et l'édification d'une République islamique porteuse d'un projet de réislamisation armée d'extension planétaire. Cette politique a remis en vigueur le modèle du martyr rédempteur, bientôt actualisé par les islamistes libanais ou afghans et surtout par les massacres résultant du conflit Irak-Iran (1980-1988), au cours desquels des dizaines de milliers de combattants ont été engagés dans des productions victimaires massives. Un des principaux promoteurs de ce mouvement, Ali Shari'ati, a avancé une idéologie qui substitue au deuil de Karbala une conception plus active et exaltante, fondée sur l'identification du martyr contemporain à l'imam Husein. Ce massacre ne doit pas être perçu comme un événement passé dont on porte le deuil mais comme un idéal présent. Dans cette vision, la mort au combat est exaltée par opposition à la mort « noire » subie et non choisie, qui prend par surprise. Le militant, lui, choisit sa mort. Il sait pourquoi il meurt. Il retrouve la « tradition de mourir » en s'offrant au sacrifice.
Conclusion
Le « renouveau » religieux renvoie à l'expression d'une sensibilité qui compose avec le désir de croire et d'espérer, de donner sens à une souffrance, d'arrimer le fil fragile de la vie à une quête spirituelle sans cesse renouvelée, de valoriser l'existence, de ritualiser une période difficile. Cette sensibilité n'est pas sans lien avec l'imaginaire religieux des mythes anciens, des systèmes de croyances organisés, des récits merveilleux, des rituels complexes des sociétés traditionnelles. Les religions monothéistes, en se constituant comme des systèmes politiques et éthiques, ont contribué à enfoncer dans l'oubli les formes originelles de la vie religieuse : la jouissance du sacré sous la forme de l'enchantement.
La distinction entre sacré et profane a enlisé la compréhension de la dimension religieuse des activités humaines dans une dialectique dont il faudrait s'affranchir. Au lieu d'opposer le sacré au profane, il serait plus à propos de se demander pourquoi est sacré ce qui est communément considéré comme sacré. Le sacré est une notion qui permet aux humains d'exprimer l'angoissante jouissance de l'intensité excessive ou des limites indépassables d'une situation donnée vécue dans des dispositions particulières. Les conduites d'autodestruction liées à la pratique de la violence nous informent sur le travail du sens et donc sur la présence d'un sujet qui se transforme pour se mettre à l'épreuve dans la violence.
La religion ne disparaît pas, elle se transforme. La thèse des déplacements des expériences du sacré permet de rendre compte de ces transformations. Chacun ne peut être vraiment lui-même que s'il refait personnellement l'histoire de l'humanité. Chaque individu s'autoproclame producteur de sens. Dans le paradigme de la religion personnelle, chacun redéfinit ce qu'il considère comme sacré et profane à partir de l'idée qu'il se fait de ces notions et de ses propres expériences de vie. Lorsque l'individu ne se sent plus protégé sous un abri symbolique ou lorsqu'il se sent meurtri par un ordre mortifère, il n'est pas étonnant qu'il devienne le héros de sa propre histoire, qui est alors instaurée par une transgression. Jean-François Lyotard a relevé l'incrédulité à l'égard des métarécits. Il y a certes incrédulité, mais les « récits » n'ont pas disparu pour autant. A contrario, ils ne cessent de proliférer. Il existe en effet des solutions de rechange à l'incrédulité en face des « grands » récits. Il s'agit des récits, de moindre envergure, qui visent à promouvoir des valeurs et des idéaux locaux ou particuliers. Toute action est porteuse d'un « récit » qui rassemble les individus autour d'emblèmes, de croyances, de pratiques et de discours que l'on peut qualifier de « prêts-à-utiliser »[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/sup]. L'effritement des grands récits laisse aujourd'hui l'individu seul avec lui-même, sans repère dans une culture qui ne lui offre plus de signifiants communs incontestables. Or il est difficile de concevoir une société qui se dispenserait de croyances communes. Le sujet doit alors s'engager lui-même dans un travail de recomposition de la croyance. Pour cela, il fait appel, selon les termes de Danièle Hervieu-Léger, aux traditions constituées des religions historiques. « Celles-ci fonctionnent comme capital de symboles, mobilisables notamment lorsque les projections séculières de l'accomplissement de l'histoire (les idéologies du progrès dans leurs différentes variantes) sont mises en question. » [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/sup] La croyance renvoie à un espace imaginaire qui dépasse notre rationalité et notre logique. La mise en situation du sujet dans la trame de sa vie est telle qu'il fait constamment l'expérience du manque de sens, du besoin métaphysique qu'il cherche naturellement à combler en se donnant des représentations qui rendent acceptable cette expérience. La notion de « récit » reste le mot clé pour comprendre ce qui motive les individus à embrasser une cause commune.
Les mythes et les symboles enracinés dans la mémoire humaine remplissent cette fonction de lui rappeler, sous un mode imagé, les limites des conditions d'existence qu'il partage avec autrui. Les martyrs sont moins les témoins d'une croyance déterminée que de la terrible propension des hommes à verser le sang pour refaire le sens et l'unité de leur communauté.
La résurgence et le repositionnement aujourd'hui de la figure du martyr religieux en politique est une des multiples manifestations du redéploiement des rapports entre politique et religion. C'est sur un relatif épuisement du politique que se construit le recours contemporain au sens. La pertinence de la religion ne tiendrait plus en un en-soi mais à un instrument de repositionnement du politique au sens.
Bibliographie
ALEXANDRIE (Clément d'). Les Stromates, IV e édition, A. van de Hoek, Paris : Cerf, 2001.
AUBIGNE (Agrippa d'). Tragiques, Paris : Gallimard,coll. « Poésies », 1995.
ANTIOCHE (Ignace d'). Martyre de Polycarpe, Lettres aux églises, Paris : Cerf, 1975.
BALLADUR (Edouard). Jeanne d'Arc et la France, le mythe du sauveur, Paris : Fayard, 2003.
BAUDRILLARD (Jean). L'échange symbolique et la mort, Paris : Gallimard, 1976, 347 p. : notes bibliogr.
BERGER (Peter, L.). [sous la direction de] Le réenchantement du monde, Paris : Bayard, 2001, 184p.
BOWERSOCK (Glen). Martyrdom and Rome, Cambridge University Press, 1995, 148 p.
BROWN (Peter). L'autorité et le sacré : aspects de la christianisation dans le monde romain, Paris : Noêsis, 1998, 166 p. : notes bibliogr., index.
CAILLOIS (Roger). L'homme et le sacré, Paris : Gallimard, 1950, 254p. ; bibliogr.
CAZENEUVE (Jean). Et si plus rien n'était sacré, Paris : Perrin, 1991, 231p.
CENTLIVRES (Pierre). [sous la direction de] Saints, sainteté et martyre, Neuchâtel : éditions de l'Institut d'ethnologie, Actes du colloque de Neuchâtel, 27-28 novembre 1997.
[sous la direction de Pierre Centlivres, Daniel Fabre et Françoise Zonabend ; textes réunis par Claudie Voizenat et Eva julien] La fabrique des héros, Paris : éditions de la Maison des sciences de l'Homme, 1998, 318 p. : bibliographie.
CONGAR (Yves). « Sainteté », in Encyclopaedia Universalis. Paris, 1995.
C.R.D.P. de Franche Comté et C.R.D.P. de Basse Normandie, Histoire des religions. Pour enseigner les origines de la chrétienté, 1996.
DELVALLE (Alexandre). Le totalitarisme islamiste à l'assaut des démocraties, Paris : éditions des Syrtes, 2002, 453 p.
DENIS (Jeffrey). Jouissance du sacré : religion et post-modernité, Paris : Colin, 1998, 167 p.
ELIADE (Mircea). Le sacré et le profane, Paris : Gallimard, 1995.
GAUCHET (Marcel). La religion dans la démocratie, Paris : Gallimard, 1998, 127 p.
GIBBON, (E.). Decline and Fall of the Roman Empire
GILSON (Etienne). L'Esprit de la philosophie médiévale
GIRARD (René). La violence et le sacré, Paris : Grasset, 1972, 451 p. : bibliogr.
Le bouc émissaire, Paris : Grasset,1982, 298p. : notes bibliogr.
GRIAULE (M.). « Remarques sur les mécanismes du sacrifice dogon », in Journal des sociétés africanistes, vol.X, 1940.
GRISE (Y.). Le suicide dans la Rome antique. Montréal/Paris : Les Belles Lettres, 1983.
GUYONNET (Paul). « Du sacré en politique », Cahiers internationaux de sociologie, 1997 (01/07) 44ème année. Vol.102, p.161-181.
KANTOROWICZ (Ernst). Mourir pour la patrie : et autres textes, Paris : P.U.F., 1984, 141p. ; traduction de l'anglais et de l'allemand ; notes bibliogr.
KHOSROKHAVAR (Farhad). L'islamisme et la mort : le martyr révolutionnaire en Iran, Paris : L'Harmattan, 1995. - 424 p. : notes bibliogr.
Les nouveaux martyrs d'Allah, Paris : Flammarion, 2002, 367 p. : notes bibliographiques, annexes.
LABERTHONNIERE (LE P.). « Témoignage du martyr », in Annales de philosophie chrétienne, 1906.
LACAN (Jacques). Séminaire XI, Les quatres conceptsfondamentaux de la psychanalyse, Paris : Seuil, 1964. 255 p.
LEMPERT. Critique de la pensée sacrificielle, Paris : éditions du Seuil, 2000, 235 p. : bibliogr.
LIPOVETSKY (Gilles). Le crépuscule du devoir : l'éthique indolore des nouveaux temps démocratiques, Paris : Gallimard, 292 p. : notes bibliogr.
MARION (Jean-Luc). Prolégomènes à la charité, Editions de la différence, 1986.
MAUSS (Marcel). Les fonctions sociales du sacré, Paris : éditions de Minuit, 1970, 635 p. : notes bibliogr., index.
NICOLAS (Guy). « Stratégies victimaires », in Culture et Conflit, n°8, hiver 1992-1993.
Du don rituel au sacrifice suprême, Paris : Découverte, 1996 ; Paris : 1996.
NIETZSCHE (Frederic). Œuvres philosophiques complètes, tome VIII, Gallimard, 1974.
RASPAIL (Jean), « Les malheurs d'une héroïne condamnée aux malentendus », in Le Figaro Littéraire (Le débat de la semaine), 15 mai 2003.
RENCONTRES INTERNATIONALES DE GENEVE, GIRARD (René), DE BAECQUE (Antoine), WIEVIORKA (Michel). Violences d'aujourd'hui violences de toujours : textes des conférences et débats/ XXXVIII rencontres internationales de Genève, Lausanne : L'Age d'homme, 1999, 286 p. : notes bibliogr.
RICHIR (Marc). Du sublime en politique, Paris : Payot, 1991, 485 p.
RODINSON (M), « Nation et idéologies », in Encyclopaedia Universalis, 1995.
SIRONNEAU (Jean-Pierre). Le retour du mythe, Grenoble : P.U.F., 1980 ; notes : aiR-bnf.
Sécularisation et religions politiques, La Haye ; Paris ; New-York : Mouton, 1982, résumé en anglais ; bibliogr. ; index.
TESSIER. Déplacements du sacré dans la société moderne : culture, politique, économie, écologie, Montréal : Bellarmin, 1994, 218p. : notes bibliogr.
VACANT (A.) et MANGENOT (E.). « Martyre », in Dictionnaire de théologie catholique, tome X., Paris, 1928.
WUNENBURGER (Jean-Jacques). Le sacré, Paris : P.U.F. (que sais-je ?), 1981, 127 p. bibliogr.
Notes
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Nicolas Guy, « Stratégies victimaires », Culture et Conflit, n°8, hiver 1992-1993.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Ibid, livre IV, v.798.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Dans sa déclaration pour « le jour des héros » du 27 novembre 2001.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Rodinson M., « Nation et idéologie », Encyclopaedia Universalis, t. XI, 1995.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Voir ici encore les chansons de geste, qui répondent exemplairement à cette fonction.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Hervieu-Léger Danièle, La religion comme mémoire, Paris : Le Cerf, 1993, p. 10.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le Martyr : du religieux au politique
Résumé : La modernité est vue comme une grande rupture dans l’histoire de l’humanité, qui est venue bouleverser le paysage aussi bien politique que religieux. Selon Max Weber, le monde moderne subirait un processus de « désenchantement ». Le sens magique disparaîtrait. En outre la modernité instaurerait une signification de l’être humain saisi hors de tout conditionnement culturel et l’image d’une autorité, ou d’un pouvoir, toujours en quête de sa légitimité. Une modernité « à l’état pur » supposerait ainsi l’évacuation totale de toute croyance de nature religieuse, l’élimination de toute référence à une force transcendante pourvoyeuse de certitudes.
Mots-clés : Martyr ; Modernité ; Politique ; Religieux ; Religion ; Sacré ; Violence ; Weber.
Abstract : Modernity is seen as a great rupture in the history of humanity, which came to disrupt the landscapes in both the religious and political settings. According to Max Weber, the modern world would be undergoing a process of “disenchantment”. The sense of magic would be disappearing. Furthermore, modernity would set a significance of the human being that does not entail cultural conditioning, and the image of an authority or a power, always in quest of its own legitimacy. Modernity in its “pure state” would also suppose the total evacuation of any religious-related belief, the elimination of all references to a transcendental force providing certainty.
Keywords : Martyr ; Modernity ; Politics ; Religious ; Religion ; Sacred ; Violence ; Weber.
Introduction
La modernité est vue comme une grande rupture dans l'histoire de l'humanité, qui est venue bouleverser le paysage aussi bien politique que religieux. Selon Max Weber, le monde moderne subirait un processus de « désenchantement ». Le sens magique disparaîtrait. En outre la modernité instaurerait une signification de l'être humain saisi hors de tout conditionnement culturel et l'image d'une autorité, ou d'un pouvoir, toujours en quête de sa légitimité. Une modernité « à l'état pur » supposerait ainsi l'évacuation totale de toute croyance de nature religieuse, l'élimination de toute référence à une force transcendante pourvoyeuse de certitudes.
Sens et enjeux du « renouveau » religieux
La modernité serait dès lors le lieu de la différenciation, ou de l'émancipation du politique à l'égard du religieux. Or, parallèlement, on assiste depuis le milieu des années soixante-dix au développement d'une série de mouvements religieux dans des aires culturelles diverses, qui le plus souvent ont en commun la critique du fondement séculier de la modernité.
Les nouveaux paysages qui se dessinent se caractérisent notamment par une inflation des productions victimaires qui vient contrarier une vision moderne qui l'exclut et qui promeut le respect du sujet individuel, la solidarité, la tolérance, la rationalité, soit « l'exclusion de la passion et du tragique du champ des relations humaines »[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/sup]. Ces mouvements provoquent la recherche de nouvelles réponses politiques écrites dans une syntaxe religieuse. Ils entraînent un redéploiement et une nouvelle représentation du rapport à la mort en général, et à la mort sacrée en particulier. Ce rapport se sécularise, se politise, revêt une signification actuelle, en relation avec ces nouvelles représentations du religieux.
Or la mort sacrée, les valeurs sacrificielles, renvoient d'abord et surtout à la figure du martyr. D'origine essentiellement religieuse[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/sup], cette figure intéresse le politique au plus haut point, lequel va s'efforcer d'en faire un opérateur symbolique efficace.
Origine, évolution et extension du phénomène du martyr
Le terme de martyr fut appliqué aux chrétiens des premiers siècles, qui eurent à affronter la persécution et la mort pour la défense de leur foi. Il a été conçu et imaginé en réponse à des pressions sociales, religieuses et politiques complexes.
Le terme de martyr se trouve donc à la croisée de deux manières très différentes de vivre ce que nous appelons la « religion ». Il reste néanmoins, et ce dès l'origine, fortement lié au contexte historique et culturel de l'Empire romain. Ce dernier avait en effet, au début du christianisme, une religion d'État. Quiconque s'affirmait chrétien rejetait cette religion et était considéré comme « païen », impie par les responsables de la religion officielle. Il mourait pour défendre sa foi en Jésus-Christ et parce qu'il refusait de renier cette foi. En témoigne la mort de Polycarpe, évêque de Smyrne, brûlé vif au stade, à l'occasion des célébrations du culte impérial vers 150. Les persécutions eurent ainsi un motif religieux et politique, le christianisme apparaissant comme une force révolutionnaire dans l'ordre des valeurs qui étaient celles du paganisme gréco-latin. Aux yeux des autorités romaines, la dimension profanatoire du refus de sacrifier à l'empereur se doublait d'une autre, destinée celle-ci à propager le christianisme par le prosélytisme.« Les chrétiens ne croient pas quelque chose, ils croient en quelqu'un, Jésus-Christ, et de cette foi ils veulent témoigner. C'est le sens du mot martur. Les autorités romaines ne situent pas la religion à ce niveau ; c'est pour eux une affaire civique. Le malentendu fondamental et non explicité porte sur le terme religio, entendu d'un côté en un sens rituel, civique, "institué", de l'autre au sens d'engagement, de façon de vivre et de mourir. »[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/sup]
Le contexte des guerres de Religion conduit à infléchir le sens du phénomène du martyr. A la fin du 16e siècle, on assiste à des tentatives d'assimilation ou tout au moins de conciliation entre la figure du stoïcien et celle du martyr : ce que les héros ont souffert pour leur patrie ou pour la vertu, les martyrs l'ont enduré pour Dieu et pour la foi. La cause était différente mais la constance était la même. « Les causes seulement manquaient à leurs martyres »[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/sup], écrit Agrippa d'Aubigné à propos des héros stoïciens et en référence à la doctrine augustinienne du martyre selon laquelle l'essentiel en la matière réside dans une juste cause. Aussi le martyr de la cause réformée, parce qu'il se bat en même temps pour sa foi et pour les libertés de son Église, réunit les figures désormais complémentaires du martyr chrétien et du héros païen.
Dans son ouvrage Rome et le martyre, Glen W. Bowersock rappelle l'extension du concept de martyr auprès des populations musulmanes, avec la conquête de la Palestine au 7e siècle. C'est après la conquête musulmane de la Palestine au 7e siècle que la notion de témoin (chahid) en vient à signifier explicitement la mort sacrée, en référence à la notion grecque de marturos et à sa double signification comme témoin et martyr. Reste qu'il y a dans le cas du martyr musulman une différence fondamentale qu'il conviendrait de souligner d'emblée : la justification du martyre en islam se fonderait sur la sourate Repentir, selon laquelle le principe consiste à « tuer ou se faire tuer dans la voie d'Allah ». Autrement dit, la violence ne provient pas exclusivement du côté de l'adversaire mais elle est assumée par le croyant qui y recourt en toute légitimité selon les préceptes de sa foi. Sur ce point, la signification est tout autre dans le christianisme où la violence physique est à sens unique. Le martyre musulman est fortement lié à cette autre notion séminale qu'est le djihad, ou guerre sainte. La différence majeure entre la notion de djihad dans l'islam et celle de croisade dans le christianisme réside dans leur fondement théologique : présent dans l'islam, il est absent du christianisme.
L'extension du concept de martyr du christianisme à l'islam nous interroge sur l'existence d'un terrain commun aux divers usages du martyr, qui déterminerait le sens de cette figure indépendamment de tout positionnement religieux déterminé. Partant, se pose la question de la légitimité que la figure du martyr procurerait à la cause défendue par la victime - d'où une interrogation sur l'extension de son usage en dehors du champ religieux au sens strict du terme. Autrement dit, cela suppose l'existence de ressorts anthropologiques différents et complémentaires que la référence au martyr activerait, ce qui pourrait concourir à la fois à la production du religieux et à celle de valeurs et de représentations intéressant au plus haut point le politique. Cette capacité mobilisatrice de la figure du martyr reposerait donc sur des données anthropologiques structurelles, qui permettraient au martyr de passer sans difficulté de la sphère du religieux à celle du politique.
1ère partie : Les ressorts anthropologiques structurels du martyr comme figure sacrificielle
Le sacrifice : place et fonction
Selon René Girard, le sacrifice fonde l'ordre social et toutes les institutions, qui sont d'origine religieuse, conservent les traces de ces origines sacrificielles. Le sacrifice est un acte social, et c'est la violence qui constitue le cœur véritable et l'âme secrète du sacré. Dans cette perspective, la théologie du sacrifice est primordiale. Il faut retrouver les rapports conflictuels que le sacrifice et sa théologie dissimulent et apaisent tout à la fois. Le sacrifice suprême ne se limite pas à un simple processus intellectuel, à une opération absolue ou extrême qui porte sur un objet interne dont le but est d'instaurer un rapport de contiguïté que le sacrifice romprait par la destruction de la victime - une fois le rapport entre l'homme et la divinité assuré par la sacralisation de cette dernière. Le sacrifice ne se limite pas à chercher l'instauration d'une connexion souhaitée entre deux domaines initialement séparés. Son but n'est pas uniquement d'obtenir qu'une divinité lointaine comble les vœux humains en reliant d'abord les domaines (initialement séparés), puis en abolissant le terme connectant. Le sacrifice polarise des germes de dissension partout répandus et les dissipe en leur proposant un assouvissement partiel. Le sacrifice consiste à expulser la violence originelle de la condition humaine en la projetant sur une victime choisie, le bouc-émissaire. La société cherche à détourner vers une victime relativement indifférente, une victime « sacrifiable », une violence qui risque de frapper ses propres membres, ceux qu'elle entend à tout prix protéger. Le sacrifice religieux est une violence fondatrice de la communauté dans la mesure où il exprime la violence commune de tous contre un seul, et cela dans le but de se délivrer de la violence originelle et de créer un ordre humain, pacifié. Le sacrifice restaure l'harmonie de la société et renforce son unité. Le religieux primitif domestique la violence, il la règle, l'ordonne, la canalise, afin de l'utiliser contre toute forme de violence intolérable. Il définit une combinaison particulière de violence et de non-violence. Mais cette violence originelle expulsée est toujours là, prête à revenir. La quasi-totalité de ces sociétés devaient, jusqu'à présent, défendre leur survie les armes à la main et, pour ce faire, susciter chez leurs membres l'acceptation de l'éventualité de l'offrande de leur propre vie. Sans doute croyaient-elles que les ancêtres ou les dieux combattaient à leurs côtés, en échange du sacrifice renouvelé des victimes. Mais leurs membres devaient être prêts à se sacrifier pour elles. La victime consentante se trouvait récompensée dans l'Au-delà. Mais elle l'était également par l'échange d'une existence quotidienne, profane, contre une immortalité de gloire dans la mémoire des survivants et des descendants. Elle se trouvait conditionnée à cette fin héroïque par le discours sacrificiel associé à sa socialisation de base, mythes et légendes véhiculant des modèles offerts à l'identification du sujet. Dans cette perspective, seront alors dits religieux tous les phénomènes liés à la remémoration, à la commémoration et à la perpétuation d'une unanimité toujours enracinée, en dernière instance, dans un sacrifice. « Vous ne voyez pas qu'il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse. »[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/sup]
Cette phrase que Jean place dans la bouche du grand prêtre Caïphe, au cours du débat qui aboutit à la décision de faire mourir Jésus, montre l'impératif de limiter au maximum la violence et de n'y recourir, s'il le faut, qu'à la dernière extrémité pour éviter une violence plus grande. Caïphe incarne la raison politique. En dépouillant les communautés traditionnelles de leurs prétentions à gérer la destinée de leurs membres, l'État moderne a dévalorisé à son profit cet ordre victimaire antérieur. S'identifiant à l'émergence de la raison triomphant du pathos médiéval, barbare ou sauvage, l'État moderne tire sa légitimité de la volonté du peuple souverain, ce qui a pu favoriser l'émergence du sujet individuel, libre de ses choix. Ce « citoyen » a néanmoins reconnu à son État un monopole de gestion de la violence à l'intérieur de son territoire, dans le cadre du droit établi et surtout le droit de gérer, sous couvert d'une volonté librement consentie, l'offrande de sa vie en cas de guerre : « mourir pour la patrie est le sort le plus beau et le plus digne d'envie. » L'État sacrificateur gère le « martyre » éventuel de ses mandants et défenseurs et entretient le culte, commémore les grands héros, honore les victimes exemplaires.
Sacrifice, violence et sacré : la résurgence des passions victimaires
La violence sacrée persiste de fait aujourd'hui. Les martyrs viennent vivifier des communautés politiques, favoriser leur consolidation, susciter une passion victimaire propice à leur mobilisation, leur permettant ainsi d'affronter des communautés rivales. La résurgence et la généralisation des violences, qui sont engendrées par la réapparition d'affirmations nationalistes face à des États dont le monopole de la violence physique légitime est contesté de toutes parts, contraint donc à tenir compte d'un fait qui apparaît incontournable : le sacrifice suprême est d'abord une pratique politique essentielle[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/sup]. Une polis ne peut exister qu'à partir du moment où ses membres sont prêts à donner leur vie pour elle. Le sacrifice ou le martyre du citoyen est la condition sine qua non d'une nation. Le sacrifice suprême supporte dès lors un rapport d'alliance au sens fort du terme. Les martyrs sont les agents les plus dramatiques d'une mise en récits de la nation, et celle-ci n'existe jamais aussi concrètement qu'à travers eux qui, en mourant pour elle, apportent la preuve de son existence. Les « nations sans États » revendiquent d'ailleurs précisément le droit d'appeler leurs membres au « sacrifice suprême » et fondent leur stratégie de survie sur celui-ci. Tel fut le cas, par exemple, du peuple igbo au sein du Biafra ou des Croates de l'ex-Yougoslavie et des Kurdes de Turquie.
Le sacrifice suprême est un geste politique fondateur. Il s'explique à un premier niveau en termes d'efficacité pragmatique. Un sacrifice relève toujours d'une institution ; c'est un fait collectif rassemblant des communautés conscientes d'assister à un acte fondateur. La mort acceptée a une valeur d'attestation, qui est susceptible de fortifier la communauté « croyante ». Au Mali, l'immolation conduit à libérer la force vitale contenue dans le sang ; ce sang nourrit la divinité mais celle-ci va faire bénéficier à son tour, dans le même mouvement, le sacrifiant et la collectivité d'une part de sa force. Le mot « dogon », qui correspond à « sacrifice », signifie « faire revivre ». Ce rite fait revivre à la fois les divinités et les hommes qui ont perdu une part de leur force vitale. Le sacrifice ne profite donc pas uniquement au sacrifiant et il réalise à la fois l'ordre social et l'ordre cosmique[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/sup]. Cette idée se retrouverait également dans le christianisme, dans la mesure où le martyr imiterait la mort rédemptrice du Christ. L'idée que la souffrance acceptée des saints-martyrs a une valeur rédemptrice est explicite dans la théologie catholique de la « réparation » ou de la « spiritualité victimale ». Un saint-victime peut prendre sur lui les péchés d'une communauté et se donner comme substitut des pécheurs à la colère divine. L'idée d'une victime substitutive contribue ainsi à la construction d'une communauté de bénéficiaires supposés du sacrifice.
Le sacrifice suprême s'inscrit d'une part dans l'ordre du don, au sens où l'entend Marcel Mauss, c'est-à-dire un phénomène social basé sur un échange permanent entre partenaires de prestations à caractère symbolique, base du rituel social qui fonde le jeu des interrelations au sein des sociétés traditionnelles. Le don de soi s'inscrit d'autre part dans le cadre du processus de communication avec le sacré. Le sacrifice suprême en tant que tel est tout à la fois don de soi et sacralisation du sujet sans interposition d'un intermédiaire entre sa personne et le sacré, dont les référents varient entre celui de la patrie et celui d'un Dieu que cet acte réjouit et qu'il récompense. Le sujet qui accepte une mort immédiate et tragique, ou sa simple éventualité, ne la conçoit pas comme une fin définitive mais comme un rite de passage d'une vie médiocre et dérisoire à une « vraie vie ». Et il est précisément sacralisé du fait de son intimité avec la mort, au même titre qu'une victime sacrificielle. Sa propre destruction assure sa promotion à un état de sacralité qui l'isole de ses contemporains ; le sujet du sacrifice suprême passe directement dans le domaine du sacré. Aussi l'être sacralisé rend d'une part possible une médiation privilégiée entre l'humain et le divin ; et, d'autre part, il intervient dans l'organisation collective du sacré, en particulier lorsque des groupes sociaux ont besoin d'une puissance pour garantir et galvaniser une protestation ou une révolte sociale. Le charisme sacré est alors étendu de la sphère religieuse à l'ensemble de l'environnement sociopolitique.
Le sacrifice suprême est enfin la pierre angulaire du tissu social. La capacité au sacrifice suprême a cette propriété essentielle de créer un rapport interpersonnel qui engage et maintient les individus dans une relation de réciprocité continue. Le sentiment d'appartenance à la communauté a un caractère dynamique, interactionniste et social. Cette situation a deux types de conséquences. Tout d'abord, la reconnaissance dans le passé de valeurs ou de références (nationales, par exemple) toujours d'actualité leur confèrent une sorte de transcendance, au moins dans la mesure où leur dimension temporelle excède la durée de la vie humaine. Le culte commun d'un « grand ancêtre », tout en pouvant revêtir la forme d'un devoir de reconnaissance, suggère une sorte de parenté entre ceux qui se reconnaissent ses « descendants ». Prenons l'exemple de la mort de Jan Palach[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/sup]. Son martyre trouve un précédent dans la mort de Jan Hus au bûcher, le 6 juillet 1458[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/sup]. Les deux noms surgissent côte à côte presque automatiquement. D'après ce que nous savons de l'éducation de Jan Palach, on vénérait chez lui Jan Hus et Jan Zizka comme modèles. Le précédent ne serait donc pas fortuit mais voulu. Jan Palach avait d'ailleurs lui-même évoqué la force de l'exemple des grandes figures de l'histoire tchèque. La mort de Jan Palach offre ainsi une illustration particulièrement explicite de cette donnée essentielle selon laquelle la communauté refigure le martyr à son tour. Le suicide par le feu de l'étudiant tchèque n'est pas le geste isolé d'un individu exalté ; comme il a pu lui-même le revendiquer, c'est la conclusion d'une action concertée. La communauté inaugure et poursuit une tradition de figuration en cherchant à être à l'image de ce qu'elle transmet. La tradition est la promotion au présent pour l'avenir de cette mémoire de l'action. C'est à ce titre que le martyr peut être convoqué par une communauté comme figure d'avenir.
2nde partie : de la transposition du martyr de la sphère du religieux à celle du politique
Le religieux comme lieu possible d'une instrumentalisation politique
Le politique, comme le religieux, est une essence, une activité originaire et sui generis : il a sa logique propre et ses propres présupposés. Mais il n'est pas séparable des autres activités humaines. Jusqu'aux temps modernes, dans la plupart des sociétés humaines, les rapports du politique et du religieux furent des rapports de subordination ; la politique était subordonnée à la religion. A notre époque, au contraire, la politique tend à être l'instance suprême qui entre avec la religion dans un rapport de substitution où elle devient le nouveau support du sacré et du religieux. Ce faisant, le politique usurpe des fonctions et des rôles qui sont spécifiquement religieux ; le politique devient politique de salut. Toutefois, la politique reste dans le domaine du relatif et de l'immanent ; elle ne fait que « mimer » la religion sans la supprimer pour autant. C'est pourquoi le politique va s'efforcer de mobiliser ces structures religieuses et ces ressorts anthropologiques. Il va se montrer susceptible de s'approprier des symboles religieux et de les attirer à son profit.
Force est de noter une dialectique entre le thème religieux et le thème national ; tout se passe comme s'il y avait détournement de l'imaginaire religieux. Le vocabulaire est en règle générale emprunté au discours religieux, même lorsqu'il s'applique à des domaines comme le patriotisme nationaliste. Le religieux n'est plus ici qu'un prête-nom. D'ailleurs, il ne faut pas nécessairement une religion pour devenir martyr. Il suffit qu'il y ait sacralisation d'une cause - celle-ci étant le plus souvent nationale. En effet, là où se manifeste la prétention de mourir pour une cause sacrée, c'est-à-dire qui dépasse les désirs personnels au sein d'une totalité imaginaire, nationale ou mondiale, alors la figure du martyr est envisageable. Ainsi, par exemple, le martyr libanais tire-t-il son origine d'une motivation politico-religieuse qui s'inscrit dans une représentation chiite sous l'obédience du Hezbollah, d'une volonté de lutte nationale, que ce soit dans le cadre d'un parti politique national ou du parti communiste. Le martyr du Hezbollah est un martyr milicien qui a subi une « libanisation », alors que le Hezbollah l'avait auparavant islamisé. Après 1990, le Hezbollah est passé d'un statut de milice à un statut de résistance. Alors qu'on ne parlait auparavant que de la voie de Dieu, se développe l'expression « mourir sur la voie de la nation ». Que l'on considère également le cas des « Tigres » tamouls, on se rend compte que ce mouvement, qui n'est pas d'inspiration religieuse, comporte le plus grand nombre de morts pour la cause. Un reportage publié en l'an 2000 par un journaliste de la Far Eastern Economic Review[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/sup] avait décrit les itinéraires de quelques jeunes gens se préparant à devenir des martyrs de la cause tamoule. « C'est le plus grand sacrifice que je puisse faire, expliquait l'un d'eux. Le seul moyen par lequel nous puissions obtenir notre territoire national est par les armes. C'est la seule manière de nous faire entendre. Même si nous mourons. »
L'auteur de l'article soulignait qu'il y avait dans cette attitude un mélange de frustration accumulée et de pression psychologique : les jeunes sont sensibles à la propagande permanente des Tigres, qui exalte les actes des héros de la cause. Le discours des chefs tamouls met l'accent sur l'héroïsme, la noblesse et la gloire de l'acte de sacrifice de soi. « Nous combattons et sacrifions nos vies pour l'amour d'une noble cause, à savoir la liberté humaine. Nous sommes des combattants de la liberté. »[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/sup]
Chaque martyr revêt ainsi une grande valeur du point de vue de la propagande, enclenchant une sorte de réaction en chaîne.
Une autre condition essentielle doit être réunie pour rendre politiquement et socialement opérante la figure du martyr : la présence dans le groupe d'une structure mythique de type millénariste, c'est-à-dire du thème de la régénération et du salut. C'est bien sûr dans les religions prophétiques que la thématique millénariste se manifeste le plus nettement. La force du mythe est proportionnelle à la fragilité des édifices sociaux. Elle traduit à la fois ce qui mine l'ordre et ce qui promet de la reconstituer. C'est cette ambivalence essentielle qui justifierait les sollicitations contradictoires dont le mythe est l'objet dans un espace politique entretenant la tension entre fonction d'intégration et fonction de subversion. La frustration extrême engendrée par un déséquilibre ne peut déboucher sur l'aspiration millénariste sans que soit présente dans le groupe cette structure mythique de l'espoir. Enfin, un messie est toujours nécessaire pour cristalliser l'attente collective. Son pouvoir est de type « charismatique » (Max Weber), c'est-à-dire fondé sur un rayonnement personnel et la dévotion du groupe « effervescent » de ses disciples. La religion fournit des substituts parentaux et assure l'intégration sociale, elle est principe de légitimation de l'ordre social. Le cas iranien montre comment la mort revêt un nouveau sens politique et se fonde sur le désespoir consécutif à l'écroulement inavoué de l'utopie révolutionnaire. La jonction entre le politique et le religieux se révélant impossible ici-bas, les jeunes tentent alors de la réaliser dans la mort. Dans ses versions modernisées et radicales, le martyr exprime cette situation limite : avènement difficile d'un processus d'individuation, échec des formes laïques de modernisation qui ont accru l'aspiration à l'autonomie sans lui apporter une satisfaction effective, et choix de la mort violente devant le constat de l'impossible réalisation de soi, accompagnée de la mise à mort de ceux que le martyr identifie comme les causes de son malheur. Le martyre oscille entre le suicide, la mise à mort d'autrui, la démission et l'affirmation de soi. Mourir sert alors de succédané à l'ambition déçue de vivre pleinement l'utopie révolutionnaire. Le martyr dans cette perspective se donne pour tâche de transformer la totalité. Ceci s'effectue par le biais d'une recréation du passé à l'aune de l'espérance projetée dans le futur.
Les formes d'instrumentalisation politique du martyr religieux
Cette logique politique du sacrifice n'a pu toutefois aboutir de manière durable que dans deux secteurs privilégiés : la « nation-ethnie » et la communauté confessionnelle.
Martyre et nations : usages nationalistes de la figure du martyr
Les « nations-ethnies » ont l'avantage d'offrir à leurs membres, et aux minorités activistes qui s'emploient à les mobiliser, tout un corpus de mythes, de rituels victimaires constamment revivifiés par les cérémonies commémoratives, les récits éducatifs, le folklore. Ce sont des éléments essentiels de la socialisation de l'enfant, exaltant les figures de martyrs offertes à l'identification des héritiers.
Un autre avantage de ce cadre social est de se fonder sur un imaginaire de durée étendue, voire d'éternité, basé sur la croyance selon laquelle les martyrs d'antan se réincarnent symboliquement de manière quasi-biologique dans ceux d'aujourd'hui, lesquels transmettront cet héritage à leurs descendants pour que, de génération en génération, de victime consentante en victime consentante, la lignée se perpétue et avec elle l'être collectif « éternel » qu'elle constitue. La victime volontaire entre dans le panthéon de la communauté, laquelle lui offre en échange une gloire éternelle. C'est au prix de cette gloire flamboyante que le sujet moderne en vient à consentir son auto-sacrifice. De tels processus ne sont ni automatiques ni immédiats. Il faut y convertir des sujets réticents, invités à privilégier l'identité ethno-nationaliste en question sur toute autre. A cet effet, il est souvent indispensable pour les meneurs de disposer de premiers martyrs, lesquels incarnent les grandes figures mythiques et suscitent des processus d'identification, ainsi que des réactions vindicatives à l'encontre de leurs bourreaux. Or ces victimes ne peuvent être produites, en principe, que par l'adversaire désigné comme persécuteur. Un cycle de provocation-répression peut alors s'engager.
La sacralisation de l'idée-force de nation, illustrée par la mythologie nationaliste (différente de la signification territoriale et ethnique de la patrie-terre des ancêtres), vient de la représentation que les individus se font de l'être collectif qu'ils constituent à travers l'histoire, une fois que la sacralité religieuse ne leur permet plus de se situer dans la mouvance des dieux. La communauté nationale se dote d'une personnalité historique à l'aide de mythes d'origine, de héros fondateurs, qu'elle commémore régulièrement par des fêtes chargées de régénérer la vie collective. La nation unifie les différences entre groupes et communautés partielles et développe une puissance messianique ; elle s'oppose dès lors aux autres nations comme un monde sacré s'oppose à un monde profane, voir à l'impur. Pour M.Rodinson[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/sup], l'idéologie nationaliste « tend à identifier les compétitions, conflits et luttes de groupe avec les autres à l'éternel combat du bien et du mal ». De même, en tant que force transcendante, elle peut exiger de ses membres un dévouement et un sacrifice inconditionnels, au même titre que les puissances invisibles dans la sphère du religieux. Enfin, l'avenir de la nation ne résulte pas essentiellement d'un projet rationnel mais se confond avec une mission sacrée, inscrite depuis ses origines dans un héritage à défendre, un corps de valeurs à répéter fidèlement. L'explosion des nationalismes a donc permis l'extension à l'échelle planétaire de véritables religions séculières, dans lesquelles la nation sert de foyer de transmutation de la symbolique religieuse.
Martyre et communautés : usages politico-confessionnels de la figure du martyr
Il existe un second champ d'application du « retour des martyrs » qui réside dans certaines mobilisations politico-confessionnelles. Elles sont fondées sur les mêmes stratégies victimaires que les mouvements ethno-nationalistes, avec lesquelles elles se confondent souvent et par rapport auxquels elles peuvent constituer des alternatives. Les courants contemporains de « revanche de Dieu » s'inscrivent en effet dans une sphère de recommunautarisation ambiguë, qui débouchent sur des représentations collectives indéniablement politiques - qu'il s'agisse de mouvements de « rejudaïsation », de « réhindouisation », de « rechristianisation » ou de « réislamisation »... Ces appels font signe vers la production de passions victimaires exaspérées par le rappel des martyrs d'antan, proposés comme pôles d'identification. Leur force mobilisatrice est étroitement liée à l'impact du modèle sacrificiel véhiculé par les patrimoines religieux. Par le court-circuit victimaire, le croyant « fanatisé » insouciant de sa vie achète à bon compte une paix et un bonheur éternels : le sacrifice du martyr lui apparaît comme la voie royale par laquelle le croyant peut accéder à une éternité dont l'éclat qu'on lui fait miroiter éclipse les avantages d'une vie terrestre dévalorisée.
C'est au sein de l'islam, soumis à des courants de politisation se réclamant de modèles fondés sur la non-séparation du politique et du religieux, que la dimension sacrificielle est aujourd'hui la plus exaltée. Ces courants véhiculent l'imaginaire mobilisateur d'un « djihad » entendu dans son acception la plus agressive, ainsi que du martyr, l'un et l'autre étroitement mêlés. C'est au sein de l'ensemble chiite, édifié sur le martyr des imams descendant du calife Ali, et notamment de son fils Husein, assassiné par son rival Yazid à Karbala, le 10 octobre 680, que le culte du sacrifice est le plus vivant. Chaque année, l'anniversaire de la tragédie de Karbala est célébré par des foules en deuil, dans un concert de flagellations publiques. Cette vision victimaire a été revivifiée par un clergé dressé contre un régime impie assimilé à celui du bourreau Yazid, débouchant sur la « révolution islamique » de 1979 et l'édification d'une République islamique porteuse d'un projet de réislamisation armée d'extension planétaire. Cette politique a remis en vigueur le modèle du martyr rédempteur, bientôt actualisé par les islamistes libanais ou afghans et surtout par les massacres résultant du conflit Irak-Iran (1980-1988), au cours desquels des dizaines de milliers de combattants ont été engagés dans des productions victimaires massives. Un des principaux promoteurs de ce mouvement, Ali Shari'ati, a avancé une idéologie qui substitue au deuil de Karbala une conception plus active et exaltante, fondée sur l'identification du martyr contemporain à l'imam Husein. Ce massacre ne doit pas être perçu comme un événement passé dont on porte le deuil mais comme un idéal présent. Dans cette vision, la mort au combat est exaltée par opposition à la mort « noire » subie et non choisie, qui prend par surprise. Le militant, lui, choisit sa mort. Il sait pourquoi il meurt. Il retrouve la « tradition de mourir » en s'offrant au sacrifice.
Conclusion
Le « renouveau » religieux renvoie à l'expression d'une sensibilité qui compose avec le désir de croire et d'espérer, de donner sens à une souffrance, d'arrimer le fil fragile de la vie à une quête spirituelle sans cesse renouvelée, de valoriser l'existence, de ritualiser une période difficile. Cette sensibilité n'est pas sans lien avec l'imaginaire religieux des mythes anciens, des systèmes de croyances organisés, des récits merveilleux, des rituels complexes des sociétés traditionnelles. Les religions monothéistes, en se constituant comme des systèmes politiques et éthiques, ont contribué à enfoncer dans l'oubli les formes originelles de la vie religieuse : la jouissance du sacré sous la forme de l'enchantement.
La distinction entre sacré et profane a enlisé la compréhension de la dimension religieuse des activités humaines dans une dialectique dont il faudrait s'affranchir. Au lieu d'opposer le sacré au profane, il serait plus à propos de se demander pourquoi est sacré ce qui est communément considéré comme sacré. Le sacré est une notion qui permet aux humains d'exprimer l'angoissante jouissance de l'intensité excessive ou des limites indépassables d'une situation donnée vécue dans des dispositions particulières. Les conduites d'autodestruction liées à la pratique de la violence nous informent sur le travail du sens et donc sur la présence d'un sujet qui se transforme pour se mettre à l'épreuve dans la violence.
La religion ne disparaît pas, elle se transforme. La thèse des déplacements des expériences du sacré permet de rendre compte de ces transformations. Chacun ne peut être vraiment lui-même que s'il refait personnellement l'histoire de l'humanité. Chaque individu s'autoproclame producteur de sens. Dans le paradigme de la religion personnelle, chacun redéfinit ce qu'il considère comme sacré et profane à partir de l'idée qu'il se fait de ces notions et de ses propres expériences de vie. Lorsque l'individu ne se sent plus protégé sous un abri symbolique ou lorsqu'il se sent meurtri par un ordre mortifère, il n'est pas étonnant qu'il devienne le héros de sa propre histoire, qui est alors instaurée par une transgression. Jean-François Lyotard a relevé l'incrédulité à l'égard des métarécits. Il y a certes incrédulité, mais les « récits » n'ont pas disparu pour autant. A contrario, ils ne cessent de proliférer. Il existe en effet des solutions de rechange à l'incrédulité en face des « grands » récits. Il s'agit des récits, de moindre envergure, qui visent à promouvoir des valeurs et des idéaux locaux ou particuliers. Toute action est porteuse d'un « récit » qui rassemble les individus autour d'emblèmes, de croyances, de pratiques et de discours que l'on peut qualifier de « prêts-à-utiliser »[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/sup]. L'effritement des grands récits laisse aujourd'hui l'individu seul avec lui-même, sans repère dans une culture qui ne lui offre plus de signifiants communs incontestables. Or il est difficile de concevoir une société qui se dispenserait de croyances communes. Le sujet doit alors s'engager lui-même dans un travail de recomposition de la croyance. Pour cela, il fait appel, selon les termes de Danièle Hervieu-Léger, aux traditions constituées des religions historiques. « Celles-ci fonctionnent comme capital de symboles, mobilisables notamment lorsque les projections séculières de l'accomplissement de l'histoire (les idéologies du progrès dans leurs différentes variantes) sont mises en question. » [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/sup] La croyance renvoie à un espace imaginaire qui dépasse notre rationalité et notre logique. La mise en situation du sujet dans la trame de sa vie est telle qu'il fait constamment l'expérience du manque de sens, du besoin métaphysique qu'il cherche naturellement à combler en se donnant des représentations qui rendent acceptable cette expérience. La notion de « récit » reste le mot clé pour comprendre ce qui motive les individus à embrasser une cause commune.
Les mythes et les symboles enracinés dans la mémoire humaine remplissent cette fonction de lui rappeler, sous un mode imagé, les limites des conditions d'existence qu'il partage avec autrui. Les martyrs sont moins les témoins d'une croyance déterminée que de la terrible propension des hommes à verser le sang pour refaire le sens et l'unité de leur communauté.
La résurgence et le repositionnement aujourd'hui de la figure du martyr religieux en politique est une des multiples manifestations du redéploiement des rapports entre politique et religion. C'est sur un relatif épuisement du politique que se construit le recours contemporain au sens. La pertinence de la religion ne tiendrait plus en un en-soi mais à un instrument de repositionnement du politique au sens.
Bibliographie
ALEXANDRIE (Clément d'). Les Stromates, IV e édition, A. van de Hoek, Paris : Cerf, 2001.
AUBIGNE (Agrippa d'). Tragiques, Paris : Gallimard,coll. « Poésies », 1995.
ANTIOCHE (Ignace d'). Martyre de Polycarpe, Lettres aux églises, Paris : Cerf, 1975.
BALLADUR (Edouard). Jeanne d'Arc et la France, le mythe du sauveur, Paris : Fayard, 2003.
BAUDRILLARD (Jean). L'échange symbolique et la mort, Paris : Gallimard, 1976, 347 p. : notes bibliogr.
BERGER (Peter, L.). [sous la direction de] Le réenchantement du monde, Paris : Bayard, 2001, 184p.
BOWERSOCK (Glen). Martyrdom and Rome, Cambridge University Press, 1995, 148 p.
BROWN (Peter). L'autorité et le sacré : aspects de la christianisation dans le monde romain, Paris : Noêsis, 1998, 166 p. : notes bibliogr., index.
CAILLOIS (Roger). L'homme et le sacré, Paris : Gallimard, 1950, 254p. ; bibliogr.
CAZENEUVE (Jean). Et si plus rien n'était sacré, Paris : Perrin, 1991, 231p.
CENTLIVRES (Pierre). [sous la direction de] Saints, sainteté et martyre, Neuchâtel : éditions de l'Institut d'ethnologie, Actes du colloque de Neuchâtel, 27-28 novembre 1997.
[sous la direction de Pierre Centlivres, Daniel Fabre et Françoise Zonabend ; textes réunis par Claudie Voizenat et Eva julien] La fabrique des héros, Paris : éditions de la Maison des sciences de l'Homme, 1998, 318 p. : bibliographie.
CONGAR (Yves). « Sainteté », in Encyclopaedia Universalis. Paris, 1995.
C.R.D.P. de Franche Comté et C.R.D.P. de Basse Normandie, Histoire des religions. Pour enseigner les origines de la chrétienté, 1996.
DELVALLE (Alexandre). Le totalitarisme islamiste à l'assaut des démocraties, Paris : éditions des Syrtes, 2002, 453 p.
DENIS (Jeffrey). Jouissance du sacré : religion et post-modernité, Paris : Colin, 1998, 167 p.
ELIADE (Mircea). Le sacré et le profane, Paris : Gallimard, 1995.
GAUCHET (Marcel). La religion dans la démocratie, Paris : Gallimard, 1998, 127 p.
GIBBON, (E.). Decline and Fall of the Roman Empire
GILSON (Etienne). L'Esprit de la philosophie médiévale
GIRARD (René). La violence et le sacré, Paris : Grasset, 1972, 451 p. : bibliogr.
Le bouc émissaire, Paris : Grasset,1982, 298p. : notes bibliogr.
GRIAULE (M.). « Remarques sur les mécanismes du sacrifice dogon », in Journal des sociétés africanistes, vol.X, 1940.
GRISE (Y.). Le suicide dans la Rome antique. Montréal/Paris : Les Belles Lettres, 1983.
GUYONNET (Paul). « Du sacré en politique », Cahiers internationaux de sociologie, 1997 (01/07) 44ème année. Vol.102, p.161-181.
KANTOROWICZ (Ernst). Mourir pour la patrie : et autres textes, Paris : P.U.F., 1984, 141p. ; traduction de l'anglais et de l'allemand ; notes bibliogr.
KHOSROKHAVAR (Farhad). L'islamisme et la mort : le martyr révolutionnaire en Iran, Paris : L'Harmattan, 1995. - 424 p. : notes bibliogr.
Les nouveaux martyrs d'Allah, Paris : Flammarion, 2002, 367 p. : notes bibliographiques, annexes.
LABERTHONNIERE (LE P.). « Témoignage du martyr », in Annales de philosophie chrétienne, 1906.
LACAN (Jacques). Séminaire XI, Les quatres conceptsfondamentaux de la psychanalyse, Paris : Seuil, 1964. 255 p.
LEMPERT. Critique de la pensée sacrificielle, Paris : éditions du Seuil, 2000, 235 p. : bibliogr.
LIPOVETSKY (Gilles). Le crépuscule du devoir : l'éthique indolore des nouveaux temps démocratiques, Paris : Gallimard, 292 p. : notes bibliogr.
MARION (Jean-Luc). Prolégomènes à la charité, Editions de la différence, 1986.
MAUSS (Marcel). Les fonctions sociales du sacré, Paris : éditions de Minuit, 1970, 635 p. : notes bibliogr., index.
NICOLAS (Guy). « Stratégies victimaires », in Culture et Conflit, n°8, hiver 1992-1993.
Du don rituel au sacrifice suprême, Paris : Découverte, 1996 ; Paris : 1996.
NIETZSCHE (Frederic). Œuvres philosophiques complètes, tome VIII, Gallimard, 1974.
RASPAIL (Jean), « Les malheurs d'une héroïne condamnée aux malentendus », in Le Figaro Littéraire (Le débat de la semaine), 15 mai 2003.
RENCONTRES INTERNATIONALES DE GENEVE, GIRARD (René), DE BAECQUE (Antoine), WIEVIORKA (Michel). Violences d'aujourd'hui violences de toujours : textes des conférences et débats/ XXXVIII rencontres internationales de Genève, Lausanne : L'Age d'homme, 1999, 286 p. : notes bibliogr.
RICHIR (Marc). Du sublime en politique, Paris : Payot, 1991, 485 p.
RODINSON (M), « Nation et idéologies », in Encyclopaedia Universalis, 1995.
SIRONNEAU (Jean-Pierre). Le retour du mythe, Grenoble : P.U.F., 1980 ; notes : aiR-bnf.
Sécularisation et religions politiques, La Haye ; Paris ; New-York : Mouton, 1982, résumé en anglais ; bibliogr. ; index.
TESSIER. Déplacements du sacré dans la société moderne : culture, politique, économie, écologie, Montréal : Bellarmin, 1994, 218p. : notes bibliogr.
VACANT (A.) et MANGENOT (E.). « Martyre », in Dictionnaire de théologie catholique, tome X., Paris, 1928.
WUNENBURGER (Jean-Jacques). Le sacré, Paris : P.U.F. (que sais-je ?), 1981, 127 p. bibliogr.
Notes
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Nicolas Guy, « Stratégies victimaires », Culture et Conflit, n°8, hiver 1992-1993.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] L'origine du culte des saints provient du culte rendu par les communautés chrétiennes à leurs membres morts martyrs, dès la fin du 2e siècle ; il repose sur la croyance dans l'intercession efficace de ceux qui ont donné leur vie pour suivre l'enseignement du Christ ou qui, du moins, ont renoncé aux valeurs temporelles.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] C.R.D.P. de Franche-Comté et C.R.D.P. de Basse-Normandie, Histoire des religions. Pour enseigner les origines de la chrétienté, 1996, p. 144-145.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Ibid, livre IV, v.798.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Le sacrifice suprême repose sur un régime contraignant à la base duquel figurent les trois obligations liées de donner, de recevoir et de rendre, dégagées par Marcel Mauss. Mais cette loi, loin de régir un processus réversif immédiat, commande à un cycle étendu dans le temps et l'espace, unissant les partenaires au sein de réseaux durables qui dépassent le cadre de leurs échanges binaires ponctuels. Le sacrifice suprême supporte dès lors un rapport d'alliance au sens fort du terme. Le don ouvre une faille que le contre-don immédiat annule tout en en appelant un autre.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Griaule M., « Remarques sur les mécanismes du sacrifice dogon », in Journal des sociétés africanistes, vol.X, 1940.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Jan Palach était un étudiant tchèque de la Faculté de Lettres qui, le 16 janvier 1969, s'est immolé par le feu sur la place Wenceslas à Prague, au pied du Musée national, pour dénoncer l'oppression soviétique. Le nom de Jan Palach est alors devenu le symbole de la résistance tchécoslovaque.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Le martyre de Jan Hus, mort sur le bûcher des hérétiques, déclencha les guerres hussites et fit de la Réforme une révolution nationale. Né en Bohême en 1369, Jan Hus est ordonné prêtre et devient Doyen puis Recteur de l'université de Prague. Il s'interroge sur les conséquences pratiques de l'obéissance au Christ, prononce des sermons contre les erreurs du catholicisme et se consacre à la réforme de l'Église. Il est excommunié en 1411 puis à nouveau en 1412. Le conflit avec Rome s'exacerbe avec sa critique de la vente des indulgences. Alors que la Bohême est menacée d'une croisade en 1414, Hus se rend avec un sauf-conduit du roi Sigismond au concile de Constance mais il y est condamné et brûlé vif comme hérétique. Ses disciples le considèrent comme un patriote et un martyr de la foi et sa mort déclenche une révolution religieuse, politique et sociale qui secoue la Bohême et la Moravie pendant des décennies.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Article paru à l'origine dans « Foreign Policy », septembre/octobre.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Dans sa déclaration pour « le jour des héros » du 27 novembre 2001.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Rodinson M., « Nation et idéologie », Encyclopaedia Universalis, t. XI, 1995.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Voir ici encore les chansons de geste, qui répondent exemplairement à cette fonction.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Hervieu-Léger Danièle, La religion comme mémoire, Paris : Le Cerf, 1993, p. 10.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
 Re: Forum Religion et Politique
Re: Forum Religion et Politique
La conscience religieuse en politique
Les questions religieuses suscitent l’embarras dans l’espace public français.
L’idée s’est répandue que ce sujet relève d’une sphère purement privée. La suspicion médiatique nourrit la frilosité des politiques pour qui la religion n’a donc pas de place dans la vie politique, laïcité oblige.
Il semble urgent de retourner la question avant que cette méprise n’engendre des ruptures plus dommageables encore. La crise identitaire que connaît actuellement la France, nous engage à redire que les identités sont avant tout le fait de cultures. Un européen est identifié comme tel non pas tant à partir de son appartenance territoriale à un Etat d’Europe, mais à partir de la culture de son pays. Or la culture est de près ou de loin, la manière dont une personne élabore un sens à l’existence, pense la vie et la mort et l’exprime de différentes manières. La culture est toujours ce par quoi une société répond à une question, laquelle est spirituelle. Notre perte d’identité relèverait donc d’une surdité spirituelle. En d’autres termes, nous ne nous posons plus assez de – bonnes – questions pour savoir qui nous sommes, pourquoi et comment vivre ensemble.
Comme toujours, pour ne pas avoir à répondre à une question, il est préférable que la question ne nous soit pas posée. L’effort d’élaboration d’une réponse est plus ou moins difficile selon la question et selon l’éveil de la conscience. Nous sommes exactement dans cette situation en ce qui concerne la place des religions dans la conscience politique en France. Le temps est venu de sortir la vie politique du scientisme désorienté qui l’empêche de déployer de véritables projets d’avenir. La vie spirituelle des politiques ne sera demain plus une honte, puisqu’elle alimentera les débats des questions essentielles à tout citoyen. Il y a en effet des questions que l’on ne peut faire mine de ne pas entendre.
La raison, libérée de la foi, a conduit au manque d’investissement pour former les consciences religieuses comme nous le faisons pour la santé et l’éducation. Ainsi la France et ses dirigeants sont-ils livrés à une très grande fragilité en matière d’expression religieuse cohérente. Et pourtant tout électeur croit quelque chose ; il croit avant tout – et même un peu - en celui pour qui il vote. La dimension religieuse des sociétés humaines est un invariant. Qu’elles soient athées ou religieuses au sens classique du terme, c’est par la foi que l’homme rend compte de la cohérence du monde et de sa propre histoire depuis sa conception jusqu’à sa mort. Nous n’avons plus aujourd’hui en France, de l’école à l’hémicycle, de ressource pour faire face à la question religieuse telle qu’elle se pose partout dans le monde. Le génie d’un peuple ne se mesure pas au nombre de start-up, mais au dynamisme qui naît de sa quête d’absolu, à l’idéal qui anime son engagement.
Comme le constatait le cardinal Lustiger en regrettant le manque d’investissement en matière religieuse, « il est plus facile d’intégrer les structures d’internet que les structures de la pensée et de la foi ». Or, internet ne supplantera jamais les aspirations spirituelles des hommes, ni ne remplacera l’effort de questionnement individuel. L’opulence matérielle même en crise, ne peut anéantir les attentes spirituelles. A quel titre la vie spirituelle échappe-t-elle à ce point à nos débats ? N’a-t-on pas trop vite oublié que nous sommes des êtres « d’esprit » ? Cette dimension de nous-mêmes est actuellement trop refoulée, et resurgit dans une désolante consommation de stupéfiants censée la faire oublier.
Sans un effort dans ce domaine, les discours politiques continueront à affirmer un principe d’« identité française » en réaction aux transformations de la société : immigration, religion… mais peu se risqueront à en rappeler les sources. C’est une entreprise périlleuse car elle oblige à une analyse spirituelle. Il faudrait se convaincre que le rejet de l’étranger restera sans effet quant à la restauration de notre propre identité. C’est ailleurs que se trouve la clé de l’identité : dans le dynamisme qui porte une société vers son idéal, vers une finalité qu’elle a d’abord conçu comme vérité à suivre ! « Comment la France peut-elle rester elle-même dans un monde ouvert, comment réussir l’unité dans la diversité ? » s’interrogeait l’ancien premier ministre, Alain Juppé (Le monde, 6 mai 2014).
Les discours politiques n’exonèrent pas leurs auteurs de l’effort nécessaire de rendre compte de ce que nous sommes, de « nos principes républicains fondamentaux » que l’histoire a façonné et qui nous unissent. Nous sommes bien face à une « crise des narrations », à une paresse du « verbe » qui refuse de penser une diversité et donc une rencontre. Avec quelles ressources pourrons-nous expliquer les structures de pensée de la culture européennes à ceux qui naissent ou arrivent en France et en Europe ? Si vous n’avez rien à partager, on vous prendra même ce que vous avez et pensez vous préserver pour vous.
Les repères culturels et religieux des « autres » ne pourront qu’inexorablement s’imposer à ceux qui n’auront pas pris la peine de cultiver leur héritage. Nous le constatons déjà à travers la manière largement admise de penser la religion en France à partir des paradigmes de l’Islam, comme si l’Europe n’avait pas un héritage philosophique et religieux apte à interroger les fondements des autres religions. Il est toujours possible de dénoncer l’immigration et les religions mais il serait plus judicieux de s’interroger sur nos propres représentations du monde, et faire l’effort de penser notre héritage – fut-il parfois sombre – pour respirer une heureuse gratitude à l’égard de ce monde présent. L’amour (et donc la quête) de la vérité a été en Europe, le projet de développement humain le plus puissant.
La pensée religieuse en France depuis une trentaine d’années se réduit globalement à ce que relayent les médias. Elle est celle d’un observateur pour qui les religions sont prises comme un tout et ne se distinguent pas les unes des autres. Or, le contenu de la foi est déterminant par rapport à l’attitude elle-même des croyants. Si notre société se trouve en prise avec des attitudes religieuses prescriptives qu’elle ne sait pas décrypter, n’est-ce pas le signe qu’il est temps de réinvestir la formation spirituelle ?
Par exemple, il est devenu très commun et commode de parler des « religions du livre » pour désigner l’Islam, le Judaïsme et le Christianisme. Or, cette expression politiquement acceptable est née dans l’Islam pour parler des deux religions historiques qui la précèdent. Elle est un critère de dénomination propre à l’Islam. Le Christianisme ne s’est jamais appelé une religion du livre, puisqu’il est en sa racine une religion de la personne, le Christ. Ce genre d’expressions largement relayé par les médias, seule source autorisée d’éducation religieuse, indique que l’ignorance ouvre peu à peu mais très surement la voie à une interprétation musulmane des questions religieuses. Des chrétiens eux-mêmes, peu formés à leur propre religion, sont enclins à vouloir affirmer la visibilité de leurs pratiques par effet de concurrence, de résonnance médiatique et d’impact sur le web.
Imperceptiblement, la religion se pense donc à la manière musulmane. A cela rien ne s’oppose puisque nous n’avons finalement plus chez nous de perception claire de notre héritage. Nous avons des valeurs, mais elles ne tiennent pas sans leurs fondements. Nous nous targuons des beaux fruits de la devise républicaine, mais nous n’irriguons plus les racines de l’arbre. Il est très surprenant de vouloir affirmer notre souveraineté, notre identité nationale et barrant la route aux étrangers (essentiellement aux religions étrangères, car nous acceptons volontiers leurs dollars), alors que nous sommes déjà devenus étrangers à notre propre histoire spirituelle. Les corps intermédiaires (familles, écoles, institutions) perdent de leur autorité parce qu’ils ne savent plus dire le passé et la raison de croire « en la valeur intrinsèque de l’avenir ».
La présence inégalement répartie de l’Islam en Europe, ses déchirements aux Moyen-Orient, le conflit Israélo-arabe, la prégnance du fondamentalisme hindou, sont autant de questions que l’histoire nous pose aujourd’hui, et c’est une chance ! Mais nous feignons de ne pas entendre cet appel à la réflexion. L’Islam mondial traverse en ce moment une crise terrible et personne ne devrait se désintéresser. L’effort que les dirigeants politiques doivent produire en matière de formation religieuse est essentiel. Dans notre société devenue sans religion, la classe politique ne peut se contenter de la seule religion des équilibres financiers, religion de « Mamon », cette idole de l’argent, divinité des sociétés modernes.
L’effort de formation et d’éducation dans les écoles est un enjeu décisif pour l’avenir, car c’est par l’esprit que se forme l’homme et selon l’exigence de cohérence des structures de pensées que se construit un avenir de paix et d’authentique fraternité. Le problème est accentué par le fait que le contexte politique français n’autorise pas ses représentants à investir ce champ de la vie des citoyens. Or, comme le remarquait récemment Jan-Wermer Müller, Professeur à l’université de sciences politiques de Princeton (New Jersey) « Au cours des dix dernières années, nous avons été contraints d'admettre que la religion représente une force politique plus grande que nous ne le pensions. » Le Monde, 3 mai 2014.
Il est probable qu’il y ait demain en France une prime gagnante à ceux qui auront la liberté de s’approprier ces questions parce qu’elles se posent dans le monde. Présider aux destinées des peuples suppose de revenir à la racine de leurs aspirations les plus profondes et pour cela de comprendre ce qu’est l’homme. Il se pourrait alors que le Christ - en dépit des contradictions de ses témoins à travers l’histoire - n’ait pas fini d’offrir les ressources dont dispose son Eglise pour que naisse un monde plus humain ce temps, une civilisation de l’amour.
Les questions religieuses suscitent l’embarras dans l’espace public français.
L’idée s’est répandue que ce sujet relève d’une sphère purement privée. La suspicion médiatique nourrit la frilosité des politiques pour qui la religion n’a donc pas de place dans la vie politique, laïcité oblige.
Il semble urgent de retourner la question avant que cette méprise n’engendre des ruptures plus dommageables encore. La crise identitaire que connaît actuellement la France, nous engage à redire que les identités sont avant tout le fait de cultures. Un européen est identifié comme tel non pas tant à partir de son appartenance territoriale à un Etat d’Europe, mais à partir de la culture de son pays. Or la culture est de près ou de loin, la manière dont une personne élabore un sens à l’existence, pense la vie et la mort et l’exprime de différentes manières. La culture est toujours ce par quoi une société répond à une question, laquelle est spirituelle. Notre perte d’identité relèverait donc d’une surdité spirituelle. En d’autres termes, nous ne nous posons plus assez de – bonnes – questions pour savoir qui nous sommes, pourquoi et comment vivre ensemble.
Comme toujours, pour ne pas avoir à répondre à une question, il est préférable que la question ne nous soit pas posée. L’effort d’élaboration d’une réponse est plus ou moins difficile selon la question et selon l’éveil de la conscience. Nous sommes exactement dans cette situation en ce qui concerne la place des religions dans la conscience politique en France. Le temps est venu de sortir la vie politique du scientisme désorienté qui l’empêche de déployer de véritables projets d’avenir. La vie spirituelle des politiques ne sera demain plus une honte, puisqu’elle alimentera les débats des questions essentielles à tout citoyen. Il y a en effet des questions que l’on ne peut faire mine de ne pas entendre.
La raison, libérée de la foi, a conduit au manque d’investissement pour former les consciences religieuses comme nous le faisons pour la santé et l’éducation. Ainsi la France et ses dirigeants sont-ils livrés à une très grande fragilité en matière d’expression religieuse cohérente. Et pourtant tout électeur croit quelque chose ; il croit avant tout – et même un peu - en celui pour qui il vote. La dimension religieuse des sociétés humaines est un invariant. Qu’elles soient athées ou religieuses au sens classique du terme, c’est par la foi que l’homme rend compte de la cohérence du monde et de sa propre histoire depuis sa conception jusqu’à sa mort. Nous n’avons plus aujourd’hui en France, de l’école à l’hémicycle, de ressource pour faire face à la question religieuse telle qu’elle se pose partout dans le monde. Le génie d’un peuple ne se mesure pas au nombre de start-up, mais au dynamisme qui naît de sa quête d’absolu, à l’idéal qui anime son engagement.
Comme le constatait le cardinal Lustiger en regrettant le manque d’investissement en matière religieuse, « il est plus facile d’intégrer les structures d’internet que les structures de la pensée et de la foi ». Or, internet ne supplantera jamais les aspirations spirituelles des hommes, ni ne remplacera l’effort de questionnement individuel. L’opulence matérielle même en crise, ne peut anéantir les attentes spirituelles. A quel titre la vie spirituelle échappe-t-elle à ce point à nos débats ? N’a-t-on pas trop vite oublié que nous sommes des êtres « d’esprit » ? Cette dimension de nous-mêmes est actuellement trop refoulée, et resurgit dans une désolante consommation de stupéfiants censée la faire oublier.
Sans un effort dans ce domaine, les discours politiques continueront à affirmer un principe d’« identité française » en réaction aux transformations de la société : immigration, religion… mais peu se risqueront à en rappeler les sources. C’est une entreprise périlleuse car elle oblige à une analyse spirituelle. Il faudrait se convaincre que le rejet de l’étranger restera sans effet quant à la restauration de notre propre identité. C’est ailleurs que se trouve la clé de l’identité : dans le dynamisme qui porte une société vers son idéal, vers une finalité qu’elle a d’abord conçu comme vérité à suivre ! « Comment la France peut-elle rester elle-même dans un monde ouvert, comment réussir l’unité dans la diversité ? » s’interrogeait l’ancien premier ministre, Alain Juppé (Le monde, 6 mai 2014).
Les discours politiques n’exonèrent pas leurs auteurs de l’effort nécessaire de rendre compte de ce que nous sommes, de « nos principes républicains fondamentaux » que l’histoire a façonné et qui nous unissent. Nous sommes bien face à une « crise des narrations », à une paresse du « verbe » qui refuse de penser une diversité et donc une rencontre. Avec quelles ressources pourrons-nous expliquer les structures de pensée de la culture européennes à ceux qui naissent ou arrivent en France et en Europe ? Si vous n’avez rien à partager, on vous prendra même ce que vous avez et pensez vous préserver pour vous.
Les repères culturels et religieux des « autres » ne pourront qu’inexorablement s’imposer à ceux qui n’auront pas pris la peine de cultiver leur héritage. Nous le constatons déjà à travers la manière largement admise de penser la religion en France à partir des paradigmes de l’Islam, comme si l’Europe n’avait pas un héritage philosophique et religieux apte à interroger les fondements des autres religions. Il est toujours possible de dénoncer l’immigration et les religions mais il serait plus judicieux de s’interroger sur nos propres représentations du monde, et faire l’effort de penser notre héritage – fut-il parfois sombre – pour respirer une heureuse gratitude à l’égard de ce monde présent. L’amour (et donc la quête) de la vérité a été en Europe, le projet de développement humain le plus puissant.
La pensée religieuse en France depuis une trentaine d’années se réduit globalement à ce que relayent les médias. Elle est celle d’un observateur pour qui les religions sont prises comme un tout et ne se distinguent pas les unes des autres. Or, le contenu de la foi est déterminant par rapport à l’attitude elle-même des croyants. Si notre société se trouve en prise avec des attitudes religieuses prescriptives qu’elle ne sait pas décrypter, n’est-ce pas le signe qu’il est temps de réinvestir la formation spirituelle ?
Par exemple, il est devenu très commun et commode de parler des « religions du livre » pour désigner l’Islam, le Judaïsme et le Christianisme. Or, cette expression politiquement acceptable est née dans l’Islam pour parler des deux religions historiques qui la précèdent. Elle est un critère de dénomination propre à l’Islam. Le Christianisme ne s’est jamais appelé une religion du livre, puisqu’il est en sa racine une religion de la personne, le Christ. Ce genre d’expressions largement relayé par les médias, seule source autorisée d’éducation religieuse, indique que l’ignorance ouvre peu à peu mais très surement la voie à une interprétation musulmane des questions religieuses. Des chrétiens eux-mêmes, peu formés à leur propre religion, sont enclins à vouloir affirmer la visibilité de leurs pratiques par effet de concurrence, de résonnance médiatique et d’impact sur le web.
Imperceptiblement, la religion se pense donc à la manière musulmane. A cela rien ne s’oppose puisque nous n’avons finalement plus chez nous de perception claire de notre héritage. Nous avons des valeurs, mais elles ne tiennent pas sans leurs fondements. Nous nous targuons des beaux fruits de la devise républicaine, mais nous n’irriguons plus les racines de l’arbre. Il est très surprenant de vouloir affirmer notre souveraineté, notre identité nationale et barrant la route aux étrangers (essentiellement aux religions étrangères, car nous acceptons volontiers leurs dollars), alors que nous sommes déjà devenus étrangers à notre propre histoire spirituelle. Les corps intermédiaires (familles, écoles, institutions) perdent de leur autorité parce qu’ils ne savent plus dire le passé et la raison de croire « en la valeur intrinsèque de l’avenir ».
La présence inégalement répartie de l’Islam en Europe, ses déchirements aux Moyen-Orient, le conflit Israélo-arabe, la prégnance du fondamentalisme hindou, sont autant de questions que l’histoire nous pose aujourd’hui, et c’est une chance ! Mais nous feignons de ne pas entendre cet appel à la réflexion. L’Islam mondial traverse en ce moment une crise terrible et personne ne devrait se désintéresser. L’effort que les dirigeants politiques doivent produire en matière de formation religieuse est essentiel. Dans notre société devenue sans religion, la classe politique ne peut se contenter de la seule religion des équilibres financiers, religion de « Mamon », cette idole de l’argent, divinité des sociétés modernes.
L’effort de formation et d’éducation dans les écoles est un enjeu décisif pour l’avenir, car c’est par l’esprit que se forme l’homme et selon l’exigence de cohérence des structures de pensées que se construit un avenir de paix et d’authentique fraternité. Le problème est accentué par le fait que le contexte politique français n’autorise pas ses représentants à investir ce champ de la vie des citoyens. Or, comme le remarquait récemment Jan-Wermer Müller, Professeur à l’université de sciences politiques de Princeton (New Jersey) « Au cours des dix dernières années, nous avons été contraints d'admettre que la religion représente une force politique plus grande que nous ne le pensions. » Le Monde, 3 mai 2014.
Il est probable qu’il y ait demain en France une prime gagnante à ceux qui auront la liberté de s’approprier ces questions parce qu’elles se posent dans le monde. Présider aux destinées des peuples suppose de revenir à la racine de leurs aspirations les plus profondes et pour cela de comprendre ce qu’est l’homme. Il se pourrait alors que le Christ - en dépit des contradictions de ses témoins à travers l’histoire - n’ait pas fini d’offrir les ressources dont dispose son Eglise pour que naisse un monde plus humain ce temps, une civilisation de l’amour.
 Re: Forum Religion et Politique
Re: Forum Religion et Politique
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
POLITIQUE ET RELIGION DANS LA PENSEE GRECQUE
Un lunch débat organisé à l’Université de Liège le 27 mars 2012
par le Groupe Ethique Sociale et l’Union des étudiants catholiques
En faisant prévaloir, selon les préceptes de son Fondateur, les droits et devoirs de la personne humaine sur ceux de la collectivité publique, le christianisme a bouleversé profondément l’ordre des valeurs dans la cité antique. Est-ce à dire qu’un abîme les sépare ou que, pour reprendre l’expression de l’historien André Piganiol, les chrétiens l’ont « assassinée » ?
A fortiori, des concepts modernes comme neutralité, pluralisme ou laïcité ne sont-ils pas anachroniques et inopérants pour qualifier les relations entre le politique et le religieux dans la cité antique ? Les cités grecques ont toujours imbriqué la politique et la religion.
La puissance publique était-elle totalitaire sur ce point (comme sur d’autres) ? Quels liens unissent exactement la religion, les mœurs et les convenances sociales de l’antiquité ? Jusqu’où la vie religieuse était-elle encadrée par le pouvoir politique ? L’impiété était-elle admise ? Pourquoi Socrate fut-il condamné ?
Comment les Grecs ont-ils concilié l’essor de la philosophie et les mythes du polythéisme ? La raison qui engendre la morale a-t-elle transformé l’image des dieux ? Pour les Grecs, existe-t-il une morale et un droit naturels fondés sur la raison, la nature, l’intuition, voire la providence ? Ceux-ci ont-ils transformé l’image des dieux ?
Les dieux sont-ils justes ? La loi naturelle vient-elle des dieux ou s’impose-t-elle à eux aussi par une fatalité immuable ? L’Antigone de Sophocle est-elle l’illustration tragique de cette loi et ou du devoir d’agir selon sa conscience individuelle face aux décisions du pouvoir politique ?
Ces questions et bien d’autres de la même veine ne sont pas anachroniques et rejoignent l’éternel débat qui, aujourd’hui encore, interpelle les sociétés humaines sur les rapports entre la foi et la raison, la morale sociale, l’ordre et la liberté.
Quelle réponse les cités grecques y ont-elles apporté ? Tel est le cœur du propos tenu à l’Université de Liège par le Professeur André Motte (1) le mardi 27 mars 2012, à l’invitation du groupe Ethique sociale et de l’Union des étudiants catholiques de Liège (2), associés au Forum de conférences « Calpurnia »
| Résumé : La mentalité de la Grèce antique est profondément étrangère à toute idée de neutralité religieuse, de sécularisation ou de laïcité de l’Etat, même si des germes de ces concepts peuvent être découverts ça et là (la pensée grecque n’est pas une pensée unique). Hors les dieux, pas de cité grecque : ils sont au fondement de celle-ci, le politique et le religieux sont étroitement imbriqués, la religion antique est anhistorique, ethnique et civique. Même une cité « démocratique », comme Athènes au siècle de Périclès, est une société holistique : le citoyen est fait pour la cité et non l’inverse. La liberté individuelle, d’opinion ou de croyance y trouve ses limites. Mais, le polythéisme citoyen de l’antiquité n’est pas un système clos par un magistère ou une caste sacerdotale susceptible de rivaliser avec le pouvoir de l’Etat. Des philosophes et des poètes ont pu s’en distancier et, parfois, du complexe lui-même qu’il forme avec la politique. À cet égard, la critique la plus radicale est celle de Socrate, se réclamant d’un « δαίμων » qui place sa conscience –religieuse- au-dessus du pouvoir de la cité. Mais la plupart des philosophes, même agnostiques ou athées prétendus, n’iront pas jusque là. Au fil des siècles d’ailleurs l’impiété, qui porte atteinte à la justice dans la cité, sera toujours plus sévèrement réprimée. Aucune trace de rejet de la religion civique, ni chez Platon, ni chez Aristote. Au contraire. La cité des Lois de Platon sacralise tout ce qui est important, dans un régime aux allures théocratiques et Aristote, considérant l’excellence des dieux, énonce en premier, dans l’ordre des magistratures de la cité, la fonction sacerdotale, dont il précise qu’elle n’est pas proprement politique. Mais c’est là un simple distinguo méthodologique. En toutes matières, Aristote aimait classer les genres et les espèces – ici, la métaphysique, l’éthique, la politique…, sans qu’on puisse nécessairement faire de lui un précurseur de la laïcité. Bref, quels que soient les mérites des penseurs grecs, jamais ils n’ont réellement menacé cette totalité fusionnelle des pouvoirs civils et religieux que les chrétiens ont ensuite répudiée, en théorie du moins. La longévité de cette alliance n’illustre-t-elle pas la difficulté pour le politique à s’auto-fonder sans prendre appui sur une forme de transcendance et, lorsqu’il s’y risque, ne provoque-t-il pas lui-même le développement de religions puissamment structurées, comme si Dieu avait alors besoin d’un autre César pour être servi ? A cette première question, l’orateur en joint une autre : où s’arrêtent exactement les limites que l’on peut légitimement imposer à la liberté d’expression ? Les défenseurs des droits de la personne humaine s’offusquent de la condamnation de Socrate par l’Héliée pour un délit qualifié d’opinion, mais qu’en est-il encore de nos jours pour d’autres délits de même nature ? |
Voici le texte intégral de l’exposé du professeur Motte :
Mais que diable la Grèce vient-elle faire dans cette galère ! J’imagine qu’une question semblable a dû agiter certains d’entre vous quand vous avez pris connaissance du programme de ces conférences. « Pourquoi donc faire place à une Grèce vieille de plus de deux mille ans dans une réflexion sur le thème, si typiquement moderne, de la neutralité étatique et du pluralisme ? ». Si telle a été votre réaction, non seulement je vous comprends bien, mais je vais commencer par abonder dans votre sens. Je pense, en effet, que vouloir projeter dans la Grèce antique ces deux notions, ou encore celles de laïcité et de sécularisation, c’est risquer de commettre un grave anachronisme. Il n’est en effet, à ma connaissance, aucune cité grecque qui, à un quelconque moment de son histoire, aurait cherché à faire en sorte que lepolitique et le religieux ne soient plus logés à la même enseigne. J’ajoute que, sous ce rapport, l’évolution s’est faite, dans l’Antiquité, au rebours de la nôtre puisque, dès l’époque des royautés issues d’Alexandre et jusqu’à la fin de l’Empire romain, on voit les souverains et les empereurs non seulement prendre parfois le titre de grand prêtre, de souverain pontife (pontifex maximus), mais se faire vénérer à l’égal des dieux. Et c’est un empereur romain qui, un beau jour, a décidé que le christianisme serait dorénavant la seule religion officielle de l’Empire et a interdit les autres cultes. Non, l’Antiquité n’a pas été l’antichambre de la laïcité, au sens le plus large que nous donnons à ce terme. Le modèle « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu », n’est ni grec, ni romain.
J’entends dès lors le plus audacieux d’entre vous m’objecter : « S’il en est bien ainsi, cher Monsieur, qu’êtes-vous donc venu faire? ». Eh bien tout simplement traiter du sujet annoncé, à savoir les rapports entre politique et religion dans la pensée grecque. Remarquez bien la nuance : le titre ne dit pas « dans l’histoire des cités grecques », dans ce qui a donc été la réalité de leur pratique politique, mais bien dans la pensée que des Grecs ont exprimée sur ce sujet. Or si on examine certains courants intellectuels que l’Antiquité a vu se développer, il est des conceptions dans lesquelles on trouverait peut-être des germes qui, bien des siècles après, ont pu porter des fruits dans le sens d’une sécularisation du politique. Pour le prouver, il faudrait parcourir toute l’histoire des idées politiques depuis le Moyen Âge jusqu’aujourd’hui pour y guetter la réapparition de ces semences : je n’en ai évidemment ni le temps, ni du reste la compétence, et je me bornerai donc à tenter de les débusquer dans leur terre originelle. Mais réfléchir sur la pensée politique et religieuse des Grecs, peut nous aider à prendre quelque distance par rapport à la situation qui est la nôtre et aux problèmes qu’elle nous pose, et pareille démarche n’est peut-être pas inutile. Or la Grèce nous offre un terreau particulièrement riche et propice à ce type de réflexion, non que nous ayons à la prendre pour modèle, mais parce que nous sommes à la fois proches et éloignés d’elle. Les Grecs ne sont pas pour nous comme des Chinois ou des Martiens et nous n’avons donc pas trop de peine à les comprendre. Mais ils sont en même temps bien différents de nous. Ce n’est donc pas un abîme qui nous sépare, mais une vallée pluriséculaire dans laquelle nous allons essayer de nous glisser pour découvrir comment les Grecs ont fonctionné en suivant un modèle tout autre que le nôtre, et avec quelles difficultés. Pareille démarche n’est-elle pas de nature à éclairer un peu notre propre lanterne ? Ce sera à vous d’en juger.
Mon exposé comprendra trois parties. Je ferai voir tout d’abord l’étroite imbrication du politique et du religieux qui caractérise les cités grecques et je m’efforcerai de comprendre pourquoi ce système a persisté si longtemps. Je montrerai ensuite comment, très tôt, des poètes et des philosophes ont su prendre des distances vis-à-vis des traditions religieuses. Je risquerai enfin quelques conclusions.
L’étroite imbrication du politique et du religieux dans les cités grecques
la procession des Panathénées (fragment)
Naissance de la politique. Dans les petites cités qui ont commencé à se former sur le sol hellène à partir du 8e siècle avant notre ère, pour constituer bien vite une pléiade de petits états politiquement autonomes, les Grecs vont expérimenter toutes sortes de régimes politiques, depuis la royauté ou la tyrannie la plus sévère jusqu’à la démocratie la plus extrême en passant par différentes formes d’oligarchie et, parfois aussi, bien sûr, d’anarchie. Ils ont ainsi imaginé et organisé des manières nouvelles de vivre ensemble au sein de petites entités, créé des institutions, remodelé des anciennes, forgé des idéaux de vie commune, fixé des principes d’action. Bref, c’est dans ces petites cités (polis) qu’a émergé et s’est développé ce que nous appelons aujourd’hui la politique, un « art de parvenir à des décisions grâce à la discussion publique et puis d’obéir à ces décisions comme condition nécessaire pour une existence sociale civilisée ». Cette définition, que j’emprunte à l’historien anglais M.I. Finley, trouve sans doute son illustration la plus accomplie dans le régime démocratique que plusieurs cités ont mis progressivement en œuvre et qui assure à leurs citoyens la participation aux affaires publiques la plus large qu’on puisse concevoir, puisque, je vous le rappelle, il s’agit d’une démocratie directe : les citoyens n’élisent pas des représentants, mais sont tous sont invités à participer à l’assemblée du peuple, à y prendre donc la parole, à y voter les lois, à y élire aussi certains magistrats, quand ils ne sont pas tirés au sort . Par ce dernier procédé, tout citoyen peut être aussi invité à siéger dans un des tribunaux populaires. Outre le principe d’égalité, un autre principe fondamental caractérise donc ce système, c’est l’alternance entre gouvernants et gouvernés.
Le régime démocratique n’a pas été ici qu’une simple technique de gouvernement, mais il était lié à une conception optimiste de l’homme. Les Grecs avaient une conscience très vive du progrès considérable que représente une cité régie par des lois, et donc soustraite à l’arbitraire d’un seul ou de quelques-uns et, ce qui plus est en démocratie, une cité dont les citoyens peuvent faire plein usage de leur liberté politique et concourir au devenir de la communauté. L’idéal humain de solidarité citoyenne, d’ouverture, d’harmonie sociale aussi, prôné par les défenseurs de la démocratie est remarquablement exposé dans l’éloge de ce régime que Thucydide (II, 35-47) prête à son ami Périclès. Cet historien est loin d’être un partisan fanatique d’une démocratie aussi radicale que celle de sa cité d’Athènes, mais je relève cette remarque qu’il fait en parlant d’elle : il lui fallait, dit-il, ce régime afin que les pauvres aient un refuge et les riches un frein (il est bien dommage que pareil souci ne mobilise plus guère nos démocraties libérales d’aujourd’hui !). Durant les deux siècles qu’a duré ce régime, Athènes n’a pas connu de troubles sociaux importants. Et que dire de l’exceptionnelle efflorescence culturelle – littéraire, artistique et philosophique – que cette cité a suscitée au cours de cette période ? Ce n’est à Sparte que l’on doit cela !
« Hors des dieux, pas de cité grecque ? ». A toutes les époques, et quel que soit d’ailleurs le régime politique, l’idée de dissocier le religieux du politique eût été impensable pour les habitants des cités, tant les dieux leur semblaient être au fondement même de celles-ci. Voici tout juste dix ans, dans cette université, Marcel Detienne, un brillant spécialiste de la religion grecque ancienne, a inauguré une chaire Francqui sur le thème « Les dieux du politique dans les cité grecques » par une leçon intitulée « Hors les dieux, pas de cité grecque ? ». Il avait bien ajouté un point d’interrogation, mais la question n’était que rhétorique, car les dieux sont, en Grèce ancienne, partie intégrante et constitutive des cités. Pour comprendre cela, il faut se souvenir tout d’abord que la religion grecque n’est pas due à un fondateur, mais qu’elle est une religion ethnique, ce qui veut dire qu’à l’origine, les premiers habitants des petites cités n’ont pas été des voyageurs sans bagages, mais les héritiers lointains d’une population indo-européenne de langue grecque qui, durant les siècles antérieurs, au gré de ses pérégrinations et de contacts avec d’autres cultures, s’était déjà forgé des mythes, avait élu des divinités et leur rendait des cultes. En sorte qu’existe en Grèce un fond religieux commun à toutes les cités et que des sanctuaires panhelléniques spécialisés, comme Olympie et Delphes, ont pu voir le jour, alors que, dans le même temps, les cités s’activaient pour se créer aussi des traditions, mythiques et cultuelles, qui leur soient propres. Une autre caractéristique, en effet, de cette religion, c’est précisément qu’elle est essentiellement civique, entendons par là qu’elle fait corps avec les institutions de la cité et qu’elle s’adresse à l’ensemble des citoyens, quitte à permettre selon les âges, selon les métiers, selon les quartiers, des dévotions et des pratiques particulières ; existent aussi des cultes privés, souvent importés, mais c’est là un phénomène assez marginal, et souvent, lorsque ces cultes récoltent quelque succès, la cité finit par les intégrer dans son calendrier.
Chaque cité aspire à se doter d’une histoire sainte qui, pour expliquer ses origines, fait intervenir un héros, voire une divinité. Ainsi à Athènes, l’histoire voulait qu’Athéna se soit trouvée en concurrence avec Poseidon pour la possession de l’Attique. Ayant été l’heureuse élue, elle devint naturellement la divinité qu’on appelle « poliade », c’est-à-dire protectrice attitrée de la cité. Point n’est besoin d’un acte de foi pour devenir dévot d’Athéna : on naît tel, et tout citoyen digne de ce nom se doit évidemment de prendre part au culte rendu à la déesse, notamment à la grande fête bien connue des Panathénées qui rassemble toutes les forces vives de la cité et fait parcourir en procession les trois hauts lieux du territoire : le cimetière où, chaque année, hommage est rendu aux soldats morts pour la patrie, l’agora où gît notamment le prytanée, qui est, au sens propre, le foyer de la cité, car y brûle un feu perpétuel voué à la déesse Hestia, l’acropole enfin, espace intégralement sacré où la déesse poliade est vénérée dans pas moins de trois temples.
Les dieux grecs, très jaloux des égards qui leur sont dus par les hommes, sont certes censés protéger la cité, mais ils sont capables aussi de châtier cités ou individus qui viendraient à les négliger, en provoquant des catastrophes naturelles, des pestilences, des famines, des défaites militaires, etc. Pressentir leur volonté est donc très important, et on y parvient en consultant les oracles et les devins, démarches qui ne sont pas l’apanage des individus, mais qu’accomplissent aussi les cités chaque fois qu’elles entreprennent une action de quelque importance.
Je m’arrête, mais vous avez compris que, pour la mentalité antique, chercher à mettre les dieux entre parenthèses pour gérer les affaires de la cité équivaudrait en quelque sorte à la décapiter et à la priver de sa principale force de cohésion ; ce serait mettre aussi en péril tout l’ordre politique et éthique qui la constitue. Qui voudrait prendre ce risque suicidaire et pourquoi le prendrait-on ? Le politique et le religieux sont ressentis comme indissociables.
Approfondissons un instant ce diagnostic, en ajoutant deux précisions importantes. Le besoin de désolidariser le politique du religieux a pu naître principalement, me semble-t-il, de deux facteurs, d’une part d’une rivalité de pouvoir, d’autre part, d’une requête de liberté individuelle. Or aucun de ces deux facteurs n’a pas pu jouer à plein dans la Grèce antique. S’agissant du premier, il apparaît que la religion grecque n’a pas généré un pouvoir centralisé et hiérarchisé susceptible de porter ombrage au pouvoir politique. Les prêtres, qui sont le plus souvent des bénévoles à durée limitée ne forment pas une caste sacerdotale ; ils ne sont que des agents publics chargés de pourvoir au culte de telle divinité, honorée dans tel sanctuaire. Ils n’enseignent pas ce qu’il faut croire ni comment se comporter (si ce n’est dans les actes liturgiques), ils n’ont pas de mission pastorale ou spirituelle, ils ne cherchent pas non plus à convertir. L’archonte-roi qui, à Athènes, s’occupe des affaires religieuses n’est qu’un gestionnaire ; il n’est pas du tout un grand prêtre qui serait à la tête d’un magistère. Le contexte était donc très différent de ce que nous avons connu dans notre Occident, particulièrement après la reconnaissance du christianisme comme religion d’État. La Grèce n’a pas connu un pouvoir religieux qui pourrait, de quelque manière, rivaliser avec le pouvoir politique.
Quant à la liberté individuelle, même si on s’accorde à reconnaître tout ce que l’on doit aux Grecs en ce domaine, il faut convenir aussi que leur conception du politique imposait à cette liberté des limites que nous n’accepterions plus aujourd’hui, je pense particulièrement à la liberté d’opinion et de croyance ; il en sera question plus loin. Leur conception du politique, qu’on appelle parfois « holistique » (du grec holos qui signifie « tout »), considère que, le tout valant mieux que la partie, la cité vaut donc davantage que le citoyen et que dès lors le citoyen est fait pour la cité et non l’inverse. Le christianisme a sûrement contribué à faire naître une conception plus exigeante de la personne humaine, même si l’histoire des Églises chrétiennes n’en a pas toujours apporté, tant s’en faut, la démonstration. Au temps notamment de leurs querelles, l’Europe a vécu longtemps sous le régime du « cujus regio, illius religio » : il allait de soi que les habitants d’une région partagent la religion du prince de leur région.
Je conclurai donc cette partie de l’exposé en disant que le besoin, semble-t-il, ne s’est pas fait sentir en Grèce de dissocier le politique du religieux, mais que cette alliance n’a pas engendré une oppression systématique, car cette religion, qui ne comporte ni magistère, ni dogmes, ni livres sacrés servant de référence commune, n’avait rien généralement d’exclusif, de sectaire ou d’intolérant. Son polythéisme ne forme pas un système clos : à chaque époque on voit que des cultes, voire des dieux étrangers, sont accueillis et parfois intégrés dans les cultes officiels, au besoin après une période de vigilance et de contrôle. En ce sens, on pourrait dire de ces petites cités-état qu’elle ne sont nullement neutres, mais qu’elles pratiquent une forme de pluralisme.
On va voir à présent les distances que des poètes et des philosophes ont osé prendre à l’égard de la religion traditionnelle et parfois aussi du complexe qu’elle forme avec le politique. Ils l’ont fait souvent sans être inquiétés, mais il y eut cependant une époque où, se sentant menacée, la cité d’Athènes a réagi très durement.
Phénomènes de distanciation à l’égard de la religion traditionnelle et du complexe qu’elle forme avec le politique
mort de Socrate
Du côté des poètes. Si, en matière de cultes, les Grecs font preuve d’un conservatisme très scrupuleux, en matière de croyances, ils vivent sous le régime d’une pensée mytho-poétique très ondoyante. Les vieux mythes ont la vie dure, mais c’est au prix de renouvellements et parfois d’altérations profondes que leur font subir des poètes de génie comme Homère, Hésiode, Pindare, les grands Tragiques et d’autres encore, au gré de l’évolution des mentalités et aussi de leur propre réflexion, voire de leur propre fantaisie. A commencer par le prince des poètes à qui il arrive de prêter à ses héros des attitudes inconcevables dans le comportement religieux habituel. Ainsi fait-il dire à Achille, irrité contre Apollon, qu’il voudrait le châtier s’il en avait la possibilité (IIiade 22, 20). Quant à Ménélas, il s’en prend à Zeus en personne en lui lançant qu’il est le plus funeste de tous les dieux (Iliade 3, 365). La fiction littéraire permet beaucoup d’audace, car, sur base de propos prêtés à des personnages en colère, qui voudrait accuser d’impiété un aède qui se dit par ailleurs inspiré par la Muse ? Cependant, un poète de VIe siècle, Théognis de Mégare, ose souffler un petit vent de révolte : dans une prière qu’il adresse à Zeus, il dénonce la manière dont le père des dieux fait régner sur terre la justice :
« Cher Zeus, je m’étonne à ton sujet. Tu règnes sur tout, tu as ton prestige et une grande puissance : comment ton esprit peut-il allouer la même part à ceux qui agissent mal et aux hommes justes ? » (vers 373-8).
Il fallait un sacré culot pour oser s’adresser ainsi, dans une prière, au roi des dieux !
On n’est pas moins surpris par les irrévérences que des poètes s’autorisent sous couvert de l’humour. Il est, dans la mythologie, des épisodes assez salaces qu’Homère déjà prend plaisir à évoquer, telle la scène qui montre Aphrodite et Arès en position amoureuse, entravés dans un filet qui les offre en spectacle à tout le panthéon. Mais le comble de la dérision est sans doute atteint quand Aristophane, dans les Grenouilles, et Euripide, dans son drame satirique Le Cyclope, se payent la tête du dieu Dionysos. A vrai dire, il s’agit ici de caricatures déformantes qui trouvent sans doute leur origine dans des célébrations populaires apparentées au carnaval. Il reste qu’au théâtre, s’amuser aux dépens des dieux n’apparaissait pas aux Grecs comme une impiété. C’est sans doute, comme le remarque Platon (Cratyle, 406 c), parce que les dieux eux-mêmes se complaisent dans la plaisanterie.
Du côté des philosophes. Plus sérieuses sont les critiques sévères que très tôt, les philosophes vont faire des traditions religieuses, traditions mythiques le plus souvent, mais quelquefois cultuelles aussi, comme c’est le cas de Xénophane de Colophon, un philosophe-poète du VIe siècle avant notre ère qui, fuyant l’invasion perse, avait émigré de l’Ionie vers la Grande Grèce. La sagesse (sophia) qu’il préconise est conditionnée par une opinion droite, une orthodoxie dirions-nous, au sujet des dieux. Or deux poètes qu’il reconnaît comme éducateurs de la Grèce, Homère et Hésiode, méritent à cet égard d’être fustigés pour avoir « fait offrande aux dieux de toutes les actions qui sont l’objet d’opprobre et de blâme chez les hommes : vol, adultères et tromperies mutuelles » (fragment 11), et il promène ainsi son esprit critique partout où sont présentes des images qui lui paraissent heurter le sens religieux, le sens moral ou le bon sens tout court. Convaincu qu’une vision claire et assurée du divin est inaccessible aux hommes, il montre la relativité des représentations anthropomorphiques du divin et esquisse quant à lui une théologie originale Ce qui motive Xénophane dans sa démarche, ce sont aussi des préoccupations éthiques et politiques. Le redressement qu’il préconise lui paraît vital, en effet, pour la vie des cités. Œuvrer dans la justice, affirme-t-il (fragment 1), et invoquer à cette fin la divinité est pour tous un devoir prioritaire. Mais comment le pourrait-on sans inconséquence si on se complaît dans l’image de dieux en train de guerroyer et d’enfreindre une justice dont ils sont censés être les garants ? Ces mythes, ajoute-t-il, ne sont que des fictions (plasmata) d’autrefois.
Voilà bien une petite révolution culturelle à laquelle bien des philosophes et des poètes vont emboîter le pas. La religion traditionnelle en prend certes un mauvais coup, mais, vous l’avez compris, Xénophane ne se pose nullement en pourfendeur des dieux eux-mêmes et ne remet pas non plus en cause le système politico-religieux de la cité. S’agissant de ce dernier point, on ne peut en dire autant de son contemporain Pythagore, qui est issu lui aussi de la même région, l’île de Samos, et exilé pareillement en Grande Grèce. Son rationalisme mathématique, - les nombres sont les principes divins de toutes choses, - s’allie curieusement à une forme de mysticisme, car cette philosophie est en même temps une doctrine de salut : c’est en contemplant le nombre, dans une vie ascétique menée en communauté, que notre âme pourra échapper au cycle infernal des réincarnations. Cette doctrine, dont se moque Xénophane, rencontre un très vif succès en Italie. Des communautés pythagoriciennes se forment et prennent le pouvoir dans plusieurs cités, déstabilisant ainsi leur cadre traditionnel. Mais assez vite, le zèle fanatique des adeptes de Pythagore suscite des révoltes : ils sont massacrés ou chassés. Essai avorté donc, dont le programme politico-religieux n’est pas bien connu, mais on devine cependant qu’il devait tendre vers une forme de théocratie.
La philosophie a à peine un demi-siècle d’âge et voilà déjà que surgissent, relativement aux questions qui nous intéressent ici, deux positions originales, et en même temps très opposées. En réalité, c’est toute une gamme de conceptions et d’attitudes que nous pourrions découvrir chez les philosophes si nous en avions le temps, mais je vais me borner à relever celles d’entre elles qui me paraissent les plus significatives.
Démocrite, fondateur de l’atomisme, faisait l’économie des dieux pour expliquer la genèse du monde, les atomes et le vide suffisant à cette tâche. Pareillement, sa réflexion éthique n’avait rien à la base de religieux. Il insistait au contraire sur la nécessité de libérer l’âme des craintes aliénantes qu’entretiennent les mythes de l’au-delà. Enfin, à l’instar d’autres penseurs contemporains, il avait aussi réfléchi sur les origines de la croyance aux dieux et y allait d’une théorie psychologique originale : c’est la terreur causée par les phénomènes naturels, tels le tonnerre et la foudre, qui avait fait penser aux Anciens que les dieux en étaient les auteurs (A 75). Toutes ces avancées témoignent d’une grande liberté de pensée et, en particulier, d’une prise de distance audacieuse à l’égard de l’héritage religieux. On peut sûrement parler de démythologisation, comme pour Xénophane, et d’une désacralisation de la vision du monde, voire encore peut-être, mais dans un sens élargi, d’une laïcisation. Mais le nom de Démocrite n’apparaît pas dans les listes anciennes d’athées. S’il le fut, il s’agissait d’un athéisme assez théorique, car non seulement il lui arrive d’user encore du langage courant qui fait référence au divin et aux dieux, mais on ne le voit nullement plaider pour que les cités renoncent à cautionner et à régir les traditions religieuses dont elles étaient les héritières.
Ce ne fut là pas non plus l’option prise par son contemporain et concitoyen d’Abdère, Protagoras. Figure de proue de la sophistique, il était cependant un agnostique parfaitement avéré, ayant écrit sur les dieux un ouvrage qui commençait comme suit :
« Des dieux, je ne puis savoir (eidenai) ni qu’ils sont , ni qu’ils ne sont pas, ni quels ils sont quant à leur forme, car nombreux sont les obstacles à ce savoir : leur invisibilité et la brièveté de la vie humains » (fr. 4).
À Athènes, où il était venu enseigner, cette affirmation, comme nous le verrons, ne fit pas plaisir à tout le monde. Ce n’était pas là pourtant, à proprement parler, faire profession d’athéisme. Protagoras ne dit nullement, en effet, que les dieux n’existent pas, mais qu’il est impossible d’avoir à leur sujet un savoir certain (eidenai). C’est qu’à ses yeux, toute connaissance se fonde sur la connaissance sensible ; or les dieux, s’ils existent, sont invisibles. Impossible donc d’avoir en ce domaine un véritable savoir. Apparaît ainsi une distinction, qui deviendra familière, entre savoir et croire. Cela dit, libre à chacun d’avoir son opinion. Or Protagoras, pour sa part, n’était nullement d’avis de s’écarter du nomos, de la tradition, en matière religieuse en particulier, car il était conscient de l’importance de la piété pour la sauvegarde de la justice dans la cité.
C’est là une idée qu’on retrouve chez un contemporain, un athénien cette fois, du nom de Critias. Cependant, dans une sorte de tragédie philosophique intitulée Sisyphe, il donne à la religion civique le coup de butoir le plus violent , je crois, qu’elle ait jamais reçu. On est pas absolument sûr de l’auteur. Mais peu importe ici, car un long extrait de cette œuvre a été conservé dont voici un résumé fidèle. Comme d’autres penseurs l’avaient fait avant lui, Critias expliquait comment l’humanité était passée d’une vie primitive où régnait la loi du plus fort à des mœurs plus civilisées, grâce à l’invention des lois. Mais celles-ci échouaient à empêcher les méfaits qui se commettaient en cachette. C’est alors qu’un homme très malin imagina d’accréditer chez les mortels l’existence des dieux afin que la peur les retienne de commettre en cachette des fautes, y compris en pensée. Il enseigna donc qu’existait un être divin doué d’une vie impérissable et qui, par la force de son esprit, connaissait tout ce qui se dit et se fait chez les hommes. Par cette fable, « en dissimulant la vérité par un mensonge », il délivra « le plus agréable des enseignements ». Il prit soin de loger les dieux dans le ciel, c’est-à-dire le lieu d’où proviennent pour les hommes à la fois les terreurs, comme disait Démocrite, et aussi les bienfaits. Voilà comment, pour la première fois, conclut l’épisode, on persuada les mortels de croire à l’existence d’une race divine.
Critique radicale, que je trouve pour ma part assez extraordinaire, car elle fait coup double : elle discrédite la religion, mais aussi le complexe politico-religieux de la cité grecque puisqu’elle laisse entendre que la religion n’est que le fruit d’un grossier mensonge dont le pouvoir politique s’est rendu coupable. Mais faut-il vraiment parler ici de culpabilité ? Qu’a voulu vraiment Critias en racontant cette histoire ? Discréditer complètement la religion et le pouvoir politique ? Faire blâmer ce dirigeant menteur, dont le but louable était de faire respecter intégralement les lois, ou bien donner à penser, avec un brin de cynisme, qu’un pieux mensonge comme celui-là serait bien utile à la cité ou encore accréditer l’idée, plus cyniquement encore, que l’inexistence des dieux serait une bien agréable nouvelle, dès lors que commettre l’injustice en cachette ne serait plus à redouter, pourvu du moins que l’on parvienne à échapper au bras séculier. Bref la fable est éminemment ambiguë.
On ne sait pas non plus si la publication de cette pièce, à supposer que publication il y eut, a valu à Critias des réactions hostiles, mais à cette époque, - milieu du Ve siècle, - il est bien connu que la démocratique Athènes ne tolérait plus guère que puissent être impunément lancées des critiques mettant gravement en cause la religion traditionnelle. Un devin professionnel avait même obtenu qu’un décret fasse obligation aux Athéniens de dénoncer ceux qui ne croient pas aux êtres divins ou qui enseignent des théories qui concernent le ciel. Jusque là, les procès d’impiété n’étaient pas rares, pour sanctionner sévèrement, par exemple, les vols sacrilèges ou les profanations des mystères, mais après ce décret, les procès d’impiété visant à réprimer ce qu’on considérait comme des délits d’opinion en matière religieuse allèrent bon train.
C’est ainsi que le philosophe Anaxagore, visé directement par le décret en question parce qu’il avait osé dire que le soleil, vénéré unanimement comme un dieu, était un morceau de pierre en fusion, fut condamné, bien qu’il fût l’ami de Périclès, et contraint de quitter Athènes où il avait enseigné pendant trente ans. Une autre victime notable fut le sophiste Protagoras dont je viens de parler. Il eut droit lui aussi à un procès d’impiété à cause de la déclaration initiale de son livre sur les dieux et fut pareillement réduit à s’enfuir. La tradition ajoute que son livre fut brûlé publiquement à Athènes, ce qui serait le premier autodafé connu de l’histoire.
Il y eut encore, à cette époque, d’autres procès dont furent victimes des penseurs, mais le plus illustre incontestablement fut celui qui fut infligé à Socrate, en 399, et qui lui valut de boire la ciguë, coupable qu’il était, - je lis l’acte d’accusation (Platon, Apologie), - « de corrompre les jeunes, de ne pas croire aux dieux auxquels la cité croit et d’introduire des divinités nouvelles ». Nous n’allons pas refaire ici le procès de Socrate, rassurez-vous, mais je voudrais souligner un propos volontairement provocateur qu’il a prononcé dans sa défense, telle que Platon la rapporte, et qui pourrait bien lui avoir été fatal. A la réflexion, ce propos m’apparaît, dans ses effets, aussi subversif que l’histoire de Critias, mais d’une inspiration toute différente.
Socrate vient, avec brio, de réfuter les accusations ci-dessus, mais, convaincu que la cause lointaine de la menace qui pèse sur lui est à chercher dans le genre de vie qu’il a mené jusqu’ici, il entreprend de s’en justifier. Ce qu’il a fait et qui lui a valu bien des inimitiés, c’est le fait de soumettre les autres, comme il se soumet lui-même, à l’examen, ce qui s’appelle philosopher.Or cette vocation, il la tient d’un oracle de l’Apollon de Delphes et il n’entend donc nullement y renoncer. Dès lors, à supposer que les juges soient disposés à l’acquitter, mais à la condition expresse qu’il ne passe plus son temps à philosopher comme il l’a fait jusqu’ici, il ne pourra l’admettre :
« Citoyens, j’ai pour vous la considération et l’amitié la plus grande, mais j’obéirai au dieu plutôt qu’à vous ; jusqu’à mon dernier souffle et tant que je serai capable, je continuerai de philosopher, c’est-à-dire à vous adresser des recommandations et de faire la leçon à celui d’entre vous qu’en toute occasion, je rencontrerai » (Apol. 29 d).
Je trouve cette déclaration assez inouïe, au sens propre du terme : on n’a jamais entendu cela, en Grèce en tout cas. A-t-on idée, en effet, de lancer à la tête de ses juges qu’on est décidé à enfreindre leur verdict, quoi qu’il arrive. Socrate ne sait-il pas que ces quelque 500 juges réunis devant lui et qui composent le très prestigieux tribunal athénien de l’Héliée, officient en pleine légalité, au nom de la cité et de ses dieux protecteurs auxquels ils ont prêté un serment très solennel ? Il a certes commencé par leur dire qu’il voulait les respecter. Il n’empêche que leur déclarer tout de go que, s’ils lui interdisent de poursuivre la mission qu’il a reçue du dieu, il ne leur obéira pas, cela s’appelle de la provocation. Or, par delà les juges, c’est bien la cité et son pouvoir légitime que Socrate défie ainsi. Nous dirions aujourd’hui qu’il se fait objecteur de conscience : si vous m’ordonnez de me taire, dit-il en substance, je ne pourrai en conscience accepter votre verdict et je refuserai obstinément de vous obéir. Son objection de conscience est de nature religieuse, ce qui lui confère une autorité particulière, car c’est Apollon, à son estime, qui a ordonné sa mission. Mais il ne faut pas oublier que c’est aussi au nom des dieux de la cité que les juges rendent la justice ; de ce point de vue, les deux impératifs se neutralisent, pourrait-on dire.
Reste qu’un simple citoyen résiste à un haut tribunal qui représente toute une cité. Dans ce cas de figure, le holisme que j’évoquais tout à l’heure pour caractériser les conceptions politiques de l’époque ne laissait guère de chances à Socrate, d’autant que celui-ci y est allé au moins un pont trop loin. Aujourd’hui, nos objecteurs de conscience demandent poliment au tribunal de faire droit à leur objection. Notre Socrate, lui, se fait fort d’annoncer à la face de ses juges que, s’ils lui interdisent de poursuivre sa mission, il ne leur obéira pas, quoi qu’il arrive !
Et vous savez bien ce qui est arrivé… Notons cependant que, comme le raconte Platon dans le Criton, Socrate, par fidélité aux lois de sa patrie, a refusé la proposition qu’on lui faisait de s’évader et d’échapper ainsi au châtiment capital. C’était là une façon de rendre hommage aussi à l’autorité de la cité et de reconnaître une certaine transcendance à ses lois.
Le cas emblématique et problématique de Socrate pourrait être un point de chute tout à fait adéquat avant de conclure. Mais je serais impardonnable de n’avoir pas fait place, dans cet exposé, aux deux premiers philosophes dont nous avons conservé les œuvres et à qui nous devons des synthèses philosophiques complètes, ces deux immenses penseurs qu’ont été Platon et son disciple Aristote. Comment conçoivent-ils eux les rapports entre le politique et le religieux ? Voyons tout d’abord les options importantes qu’ils ont en commun :
- leur réflexion politique s’édifie essentiellement dans le cadre des petites cités-état que nous connaissons. Dans le cas de Platon, qui est athénien, ce n’est pas étonnant, mais Aristote qui est Macédonien, qui a été le précepteur d’Alexandre et qui a donc assisté à la naissance d’un immense empire ne pense pas autrement ;
- ils sont respectueux l’un et l’autre de la tradition, notamment en matière religieuse, ce qui ne les empêche pas évidemment une attitude critique, parfois très sévère, comme chez leurs. prédécesseurs. Mais on ne trouve aucune trace chez eux d’une volonté de séparer le religieux du politique ;
- enfin, leur cité est aussi, politiquement parlant, traditionnelle en ce qu’elle est régie par des lois écrites, ce qui exclut non seulement le régime arbitraire d’un tyran, mais aussi celui d’un chef charismatique qui concentrerait tous les pouvoirs.
Cependant, des différences très importantes se marquent :
-impressionné par la mort de son maître, Platon est convaincu que la cité a besoin d’une vigoureuse réforme et il va tenter, sa vie durant, d’élaborer pareil projet. Pour mesurer l’importance accordée à la dimension religieuse qu’il entend conférer à sa cité idéale, il suffit d’un bref extrait des Lois (IV, 716a sv.), son tout dernier ouvrage. Le législateur adresse ces recommandations aux colons qui s’en vont fonder la cité nouvelle :
« Ce n’est pas l’homme, comme certains l’affirment, mais la divinité qui doit être, au suprême degré, la mesure de toutes choses (Platon prend ici le contre-pied de Protagoras qui avait affirmé que l’homme est la mesure de toutes choses). Car c’est la divinité qui tient dans ses mains, suivant l’antique parole, le commencement, la fin et le milieu de tous les êtres. Toujours, à sa suite, se tient la Justice(Dikè), prête à venger les infractions à la loi divine. Chercher, autant qu’il est possible, à ressembler à la divinité et à lui être ami, tel est le but que l’homme doit viser. De là découle la plus belle et la plus vraie des règles : entrer sans cesse en relation avec les dieux par des sacrifices, des prières, des offrandes et tout le culte divin. C’est aussi le chemin le plus sûr vers une vie heureuse ».
Le ton est donné et on devine déjà que, dans sa législation, Platon va s’employer à sacraliser tout ce qui lui paraît important : le territoire, le calendrier, certaines fonctions, certaines coutumes, certaines personnes. Car, comme il le dit expressément, ce qui est sacré est objet de respect et résiste aux vicissitudes du temps. Le philosophe veille soigneusement à assurer une orthodoxie en matière de théologie et à réprimer l’impiété dont témoigne notamment l’athéisme. Croire aux dieux est rien moins qu’un devoir civique, et il n’est pas de vertu plus importante que la piété. Il accorde dès lors beaucoup d’attention aux fonctions religieuses. Sa constitution, qui est assez libérale, rappelle certaines institutions athéniennes, comme l’Assemblée du peuple, mais au sommet Platon institue un organe de sauvegarde de l’État, qui regroupe notamment les hauts magistrats, choisis aussi pour leur éminente vertu ; ils sont prêtres d’Apollon et d’Hélios dont ils habitent le sanctuaire juché sur l’acropole. La cité des Lois, on le voit, est dotée d’un régime que, par certains côtés, on pourrait peut-être qualifier de théocratique (je suis prudent, car je me méfie des étiquettes). Il y a, chez Platon, une volonté non seulement de définir une orthodoxie en matière de religion, et singulièrement de théologie, mais de l’imposer, de sanctionner sévèrement les possibles contrevenants et de faire contrôler par un organe suprême le fonctionnement de tout cet appareil. Peut-être retrouve-t-on ici quelque chose de la rigueur qui a dû inspirer Pythagore et ses adeptes.
On ne voit rien de tel chez son disciple Aristote, auteur aussi d’un copieux ouvrage en huit livres consacré à la Politique. Nul rejet chez lui, cependant, de la religion civique. Pour les citoyens, rendre un culte aux divinités poliades doit aller de soi, et il importe qu’une partie des revenus de la cité soit affectée aux liturgies en l’honneur des dieux. Ce respect de la tradition n’empêche pas Aristote, en matière de croyances, de faire un tri sévère parmi les mythes, tout en admettant qu’ils véhiculent parfois un fond de vérité, ni de défendre une théologie évoluée, qu’il ne songe nullement cependant à imposer. Il partage avec Platon l’idée qu’il faut chercher à se rendre semblable aux dieux, car ils offrent aux hommes le modèle d’une vie heureuse. En matière de culte, Aristote s’abstient, à la différence de son maître, d’énoncer les règles rituelles à adopter : cela relève à ses yeux du contingent. Il se borne à recommander les fêtes religieuses qui, par les réjouissances pieuses qu’elles offrent, favorisent l’union des citoyens.
Et voici encore un détail, mais important peut-être, que j’ai relevé en relisant certains chapitres. Au livre IV, (15, 1299 a sv.), Aristote indique que la fonction sacerdotale est la première parmi les fonctions de la cité, ce qui est logique étant donné l’excellence des dieux. Mais il ajoute que cette fonction sacerdotale n’est pas proprement politique et tient une place à part parmi les magistratures : il y a bien un magistrat qui décide de l’instauration d’un culte et qui en fixe les modalités, mais l’exercice du culte, c’est le prêtre qui l’assure. Je n’en conclus pas qu’Aristote songerait à dissocier le politique du religieux, mais s’agissant des magistratures en tout cas, il fait là une distinction importante qui lui vaudrait peut-être le titre de précurseur de la laïcité (encore faudrait-il voir cela de plus près…).
Ce besoin de distinguer les choses et les points de vue est un souci de méthode dont témoigne l’ensemble de l’œuvre d’Aristote, car chaque discipline a son objet et sa démarche qui lui est propre. La métaphysique n’est pas la politique et la politique n’est pas non plus l’éthique, chacune devant faire l’objet d’études distinctes, ce que ne fait guère Platon. J’ajoute qu’Aristote est aussi moins idéaliste, ou plus réaliste, si on préfère, que lui. Il est bien un régime politique qui, dans l’absolu, aurait sa préférence, - c’est le régime dit aristocratique, - mais il est d’autres régimes qui sont à ses yeux parfaitement acceptables, pourvu que le bien commun soit le but poursuivi. Toujours il importe de considérer non seulement ce qui est souhaitable, mais ce qui est aussi possible en fonction de l’histoire du pays concerné et des circonstances du moment.
Conclusion
tirage au sort des magistratures à Athènes
Mon but serait atteint si ce parcours trop rapide vous avait convaincus, ou confirmé dans votre conviction, qu’on ne perd pas son temps et qu’on ne s’ennuie pas souvent en étudiant les penseurs grecs, qu’ils soient poètes ou philosophes. De quelque bord que l’on soit, en effet, on peut y trouver son miel : il y en a pour tous les goûts. Et ma première conclusion sera donc d’observer qu’il ne faut donc pas être dupe quand on parle, au singulier, de lapensée grecque, de la religion grecque, de la philosophie grecque, comme si chacune d’elles formait une réalité unique ou un tout bien homogène. A ne considérer que la philosophie grecque, mon expérience m’amène à penser qu’il y a eu en Grèce autant de philosophies que de philosophes. Cela fait beaucoup, et cela n’a d’ailleurs guère changé depuis l’Antiquité…
S’agissant des prises de distance des philosophes à l’égard du complexe politico-religieux des cités, nous avons relevé plusieurs attitudes, - sans épuiser le sujet bien sûr :
- Xénophane est le premier à avoir, courageusement, lancé le pavé dans la mare mythologique. Son but est d’épurer cette tradition et il compte bien que pareil nettoyage sera salutaire aux cités. Rationalité, rigueur et aucune propension au mysticisme : c’est dans le sillage lointain de ce penseur que je situerais un Aristote (pour ce qui est évidemment de notre problématique) ;
- Au même siècle, avec une vision assez totalitaire et mystique qui tend à confondre philosophie, politique et religion, le pythagorisme a fait vaciller, dans le Sud de l’Italie, le fonctionnement politico-religieux des cités en lui substituant une sorte de théocratie ; c’est dans cette mouvance qu’avec bien des nuances on pourrait peut-être situer Platon ;
- Le siècle suivant a vu apparaître une catégorie de personnages qualifiés d’athéos,parmi lesquels on pourrait distinguer deux groupes :
- ceux qui, à la manière de Démocrite ou de Protagoras, n’entendent pas nier que les dieux existent et affirment, soit comme le second, qu’on ne peut pas vraiment le savoir, soit font quasiment, comme le premier,l’économie des dieux dansl’élaboration de leur philosophie, mais ne s’en prennent pas pour autant au conglomérat politico-religieux des cités ;
- il y a en second lieu ceux qui, comme l’athée présumé Critias, disqualifient à la fois la religion et le pouvoir politique des cités. Cette fiction littéraire est ambiguë et ne se présente pas telle une doctrine, mais j’imagine qu’il a bien dû y avoir des athées de cette trempe-là, même si on a quelque difficulté à trouver ici un nom d’une certaine importance ;
- enfin il y a le cas de Socrate, très différent de ceux qui précèdent : il ne s’en prend pas au complexe théologico-politique de la cité d’Athènes, mais face à ce pouvoir-là, il revendique la liberté d’agir selon ce que lui dicte sa conscience, en l’occurrence un impératif qui lui viendrait du dieu de Delphes.
La considération de ce tableau un peu trop simplifié m’a inspiré deux sortes de réflexion:
La première à rapport à la façon persistante dont le religieux et politique n’ont cessé en Grèce de se prêter un mutuel appui. Car, s’il faut rendre hommage aux courageux penseurs qui, au péril parfois de leur vie, ont osé secouer le cocotier, comme on dit, et sans nier que leurs interventions aient pu avoir, bien plus tard, d’importantes répercussions, il faut bien constater que, pendant toute la durée de l’histoire grecque, soit plus d’un millénaire, ces interventions n’ont pas réussi à ébranler vraiment les fondements de la cité, à l’atteindre dans ses racines. A l’époque classique, plusieurs milieux intellectuels ont dû être largement influencés par ce renouveau de la pensée, mais les politiques, appuyés par la grande majorité du peuple, n’ont rien voulu entendre et la cité s’est défendue assez âprement en s’appuyant notamment sur l’appareil judiciaire. Après le IVe siècle avant Jésus-Christ, on cite encore, de ci de là, quelques athées, mais ils ne sont plus jugés inquiétants et les procès d’impiété tombent en désuétude. Les petites cités ont certes perdu leur souveraineté, mais avec une compétence réduite, elles ont gardé jusqu’à la fin de l’Empire leurs organes politiques et leurs traditions religieuses. Ce n’est que bien plus tard que va naître une rivalité entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel, avec les péripéties parfois douloureuses que vous connaissez.
La longévité de l’alliance entre le politique et le religieux en Grèce ancienne et sa vigueur qui lui a permis de résister à certains assauts appelle, me semble-t-il, deux séries de questions
- le politique peut-il vivre seul, est-il vraiment capable de s’auto-fonder, n’a-t-il pas besoin de s’appuyer sur une forme de transcendance, les valeurs sur lesquelles il s’édifie et qu’il se charge de promouvoir ne sont-elles valeurs que parce qu’il les a lui-même décrétées telles, le vrai et le bien, par exemple, ne sont ils le vrai et le bien que parce que le pouvoir en a décidé ainsi, la loi est-elle juste du seul fait qu’il l’a promulguée ?
- mais l’expérience grecque suggère aussi, pour faire bonne mesure, une seconde question, qui n’est pas moins irritante que la première . La religion grecque n’a jamais développé un État dans l’État. Il est vrai qu’elle ne tendait pas du tout à l’universalité. Mais les religions qui ont aujourd’hui cette ambition doivent-elles être pour autant être organisées en un pouvoir fort, centralisé et hiérarchisé ? Il faut certes rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais Dieu a-t-il besoin lui-même, pour être servi, d’un autre César ?
Le cas de Socrate, enfin, peut lui aussi donner à penser. C’est mon second objet de réflexion. Pour les défenseurs de la personne humaine et de la liberté individuelle que nous sommes, son exemple est paradigmatique et c’est avec étonnement et une certaine condescendance que nous vous voyons la démocratique Athènes condamner à mort un de ses citoyens pour un simple délit d’opinion. Je rappelle cependant que, par respect de la loi, Socrate n’a pas voulu se soustraire à la peine qui lui était infligée. Et je remarque aussi qu’en matière de liberté d’expression, notre législation a depuis un certaine temps évolué. On peut être condamné aujourd’hui pour un délit semblable, comme affirmer que tel génocide n’a pas eu lieu ou que les chambres à gaz sont un détail de l’histoire. La question qui se pose ici est de savoir quelles limites il est légitime d’imposer à la liberté d’opinion et d’expression.
Voilà pour ce soir plus de questions qu’il n’en faut. Je vous remercie beaucoup de votre bonne attention.
André MOTTE
professeur honoraire à l’Université de Liège
____________
1) Aujourd’hui professeur honoraire, André Motte est licencié en philologie classique, agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, docteur en philosophie et lettres (philosophie). Sa carrière scientifique et académique s’est déroulée à l'Université de Liège, de 1960 à 2001 en tant que chercheur et professeur ordinaire. Ses domaines de compétence sont la philosophie morale (il fut assistant du professeur Marcel De Corte, dont il conserve aujourd’hui le travail scientifique archivé) ainsi que la philosophie et la pensée religieuse des Grecs. Il a piloté activement plusieurs unités de recherche : le centre d'études aristotéliciennes de l'Université de Liège (président), le groupe interuniversitaire de contact (FNRS) pour l'étude de la religion grecque (président), le centre International d'Étude dela Religion GrecqueAntique (vice-président). Il a dirigé plusieurs revues, entre autres et aujourd’hui encore « Kernos », Revue internationale et pluridisciplinaire de religion grecque antique.
On lui doit aussi un ouvrage sur l’éthique de Démocrite et une traduction commentée dela Rhétoriqued’Aristote. Il a collaboré au dictionnaire des religions (PUF) et à de nombreuses publications, entre autres avec les professeurs Julien Ries (UCL), Christian Rutten (Ulg) ou Jean Chelini (Université d’Aix-en-Provence).
(2) L’Union des Etudiants Catholiques de Liège est membre de l’asbl « Sursum Corda » vouée à la sauvegarde de l’église du Saint-Sacrement, aux activités de laquelle l’ « Union » est étroitement mêlée.
Les professeurs Paul Delnoy, François Ronday et André Motte devisent à l'issue du lunch débat
 Re: Forum Religion et Politique
Re: Forum Religion et Politique
Comment la religion continue à peser sur la politique aux Etats-Unis
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Donald Trump et Hilary Clinton
© Sipa Press et Reuters
La contre-attaque des opposants à Donald Trump au sein du parti républicain commence ce mardi 5 avril dans la primaire du Wisconsin. Dans les derniers sondages, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] est crédité de 40% à 43% des intentions de vote contre 30% à 37% pour Donald Trump et 18% à 21% pour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Le champion de la droite religieuse a le soutien de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], gouverneur de l’Etat et candidat malheureux à l’investiture du Grand Old Party. Côté démocrate, Bernie Sanders (49%) et Hillary Clinton (45%) sont donnés au coude à coude. Auteur de L’histoire religieuse des Etats-Unis, Lauric Henneton analyse le poids des évangéliques dans ces primaires.
A part le Pape François, qui [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], on n’a pas entendu les autres Eglises réagir face aux dérapages de Donald Trump…
C’est en partie structurel. Les Eglises américaines n’ont pas la même organisation pyramidale, hiérarchique et globale que l’Eglise catholique. Elles sont plus éclatées. Il n’y pas l’équivalent d’un pape dans les différentes sphères du protestantisme. Il y a eu toutefois des réactions négatives de dirigeants religieux américains à l’égard de Donald Trump. Mais ce n’est pas sorti du champ des Etats-Unis.
Les évangéliques ne paraissent pas très critiques à son égard alors que, par son style de vie, il paraît très éloigné de leurs valeurs. Pourquoi ?
Cela met en évidence la diversité des évangéliques dont on parlait jusque là d’une façon très monolithique. Aujourd’hui, il y a des lignes de fracture qui apparaissent clairement de part et d’autre du vote Trump. Les plus pratiquants – c’est-à-dire ceux qui vont au culte au moins une fois par semaine - se prononcent très largement en faveur de Ted Cruz. Donald Trump attire à lui ceux que l’on pourrait qualifier d’évangéliques « light ». On voit se dessiner aussi, au sein de cette même communauté, comme dans l’ensemble de la population américaine, une ligne de fracture entre le peuple et les élites. Les voix qui se sont élevées contre les propos excessifs du milliardaire new-yorkais venaient de Washington, des porte-parole de grandes structures comme la Southern Baptist Convention. Mais à la base, sur le terrain, dans les paroisses, le son de cloche est totalement différent. Certains ne se sentent pas représentés voire s’estiment trahis par ces institutions nationales.
Que représente aujourd’hui le poids des évangéliques sur le plan électoral ?
Il est difficile à jauger. C’est un ensemble plus composite que le terme le laisse penser. Il y a des sous-groupes. Le problème, c’est que l’on demande aux gens de s’identifier en tant que tels. Certains se déclarent évangéliques alors qu’en réalité ils ne le sont pas véritablement. C’est la raison pour laquelle les chiffres dont nous disposons ne sont pas très fiables. Même s’ils sont moins nombreux, les évangéliques purs et durs votent de façon très assidue. Leur taux de participation est bien supérieur à leur part dans la population. Du coup, leur poids électoral reste plus grand que leur poids démographique. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]qui cadre tout à fait avec l’évangélisme de droite, intransigeant sur les questions sociétales. Ils ne considèrent pas ceux qui votent Donald Trump comme faisant partie des leurs.
Quels sont leurs thèmes de prédilection ?
On se rend compte cette année que les préoccupations sociétales du type avortement, mariage homosexuel, petite boîte dans laquelle on les avait un peu trop enfermés, sont beaucoup moins prédominantes dans leurs choix électoraux qu’avant. Aujourd’hui, ce sont les thèmes sécuritaires qui l’emportent - que cela soit le terrorisme ou la sécurité économique. Sachant qu’en la matière, on est dans des perceptions plutôt que dans la réalité. Globalement, on se rend compte que les questions sociétales s’imposent généralement dans les périodes de prospérité. Cela a été flagrant lors de la réélection de Bill Clinton en 1996 où le grand thème a tourné autour des valeurs familiales.
Ces primaires ne montrent-elles pas néanmoins une certaine perte d’influence du Tea party au sein du Parti républicain ?
Cette mouvance qui a été très influente entre 2010 et 2012 est effectivement en déclin. Ce qui demeure en revanche, c’est la très forte polarisation et le jusqu’auboutisme de certains. Maintenant, on a présenté le Tea party comme un mouvement venu de la base alors que ce qui a surtout caractérisé ses débuts, ce sont ses riches donateurs. Derrière le vernis « mouvement citoyen », il y avait de grosses machines de financement de campagnes électorales, des lobbies, les frères Koch, etc. Ces organisations demeurent. Tout le monde se focalise sur les primaires au sein du parti républicain en vue de la présidentielle parce qu’elle est incarnée. Ce que l’on ne voit pas, c’est que les évangéliques et les groupes les plus à droite au niveau sociétal et économique du Grand Old Party (GOP, le surnom du Parti républicain) s’intéressent beaucoup plus aux élections pour la Chambre des représentants et pour le Sénat. Parce que c’est là que se font les lois et c’est là que l’on peut les bloquer. C’est un terrain où il y a quelques personnalités de premier plan mais où la plupart des candidats sont inconnus, même des Américains. Or c’est là, notamment au Sénat, que tout va se jouer prochainement, entre la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], la validation des accords de libre-échange transpacifique et transatlantique etc. S’il y a un [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour la Maison Blanche avec une possible victoire de la seconde, il est fort probable que l’on assiste à un vote anti-Clinton afin d’utiliser le Sénat comme un contre-pouvoir. Hillary Clinton est un sacré repoussoir chez bien des républicains. Notamment ces ouvriers blancs en colère qui en veulent tant aux traités de libre-échange comme celui conclu avec le Canada et le Mexique (Alena), mis en place sous… Bill Clinton, son mari. Et cela, ils ne l’ont pas oublié.
Les évangéliques ne seront pas les seuls à peser sur le scrutin…
De l’autre côté du spectre, il y a en effet ces « none » ou « unaffiliated ». C’est un groupe encore plus composite que les évangéliques, une sorte de fourre-tout auquel je m’intéresse de près depuis plusieurs années. Ils ne sont pas affiliés à des Eglises mais ils peuvent être pratiquants chez eux. La plupart sont croyants mais il y a aussi des athées. Ils ont un problème avec les institutions - y compris les partis politiques. Ils sont de plus en plus nombreux, notamment chez les jeunes (un tiers des 18-29 ans !) et ils sont résolument indépendants ou démocrates. Car à leurs yeux, les républicains mêlent trop politique et religion. Ils représentent en gros 23 % de la population mais seulement 12 % des votants. Ils sont largement sous-représentés dans les urnes. Se mobiliseront-ils davantage face au « péril Trump » ? Ils sont ce que j’appelle un « géant endormi », pour reprendre un terme utilisé pour décrire l’électorat hispanique qui offre la même configuration, à savoir qu’il est de plus en plus nombreux, représentant 17 % de la population mais seulement 7 % des votants.
Au final, quel sera le poids de la religion dans ce scrutin ?
Elle n’aura pas le même poids que dans les élections précédentes car un certain nombre de facteurs non sociétaux devraient prédominer. Et il y a un détachement religieux grandissant chez les jeunes électeurs. Maintenant, cela fait trente ans que l’on annonce la mort de la droite religieuse et cela fait trente ans qu’elle s’entête à ne pas mourir. On avait annoncé sa fin notamment en 1996, avec la réélection de Bill Clinton, et elle a ressuscité quatre ans plus tard avec l’arrivée de George W. Bush à la Maison Blanche… La situation s’est reproduite en 2010, deux ans après l’arrivée au pouvoir de Barack Obama. Les évangéliques diminuent en proportion mais ils continuent de voter avec discipline supérieure à leurs effectifs. Ce qui fait que leur pouvoir s’estompe plus lentement que prévu.
Avec deux personnalités comme Donald Trump et Hillary Clinton, la question religieuse risque d’être secondaire…
Cela dépend de la manière dont Hillary Clinton va communiquer. C’est une méthodiste très croyante et très pratiquante. Elle a expliqué que sa foi l’avait beaucoup aidé au moment des affaires extraconjugales de son mari. Même si cela peut surprendre au vu de ses frasques passées, on peut dire d’ailleurs la même chose de Bill Clinton qui connaît sa Bible sur le bout des doigts. Il faut savoir qu’Hillary dispose de très bons réseaux dans les Eglises du Sud. C’est toute la difficulté des démocrates. Ils parlent à des gens très croyants et pratiquants comme la population noire, aux yeux de laquelle l’Eglise est un lieu approprié à la politique, et à d’autres qui veulent justement séparer le politique du religieux.
 Re: Forum Religion et Politique
Re: Forum Religion et Politique
L’Imam, le Soufi et Satan : religion et politique à Bamako (Mali)
Françoise Bourdarias
p. 115-139
Texte intégral
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
1Ce texte propose quelques éléments de réflexion sur les formes d’articulation du religieux et du politique. Ils sont issus d’observations menées au sein d’une configuration sociale restreinte, singulière, bien que les dynamiques qui s’y inscrivent entretiennent de multiples affinités avec celles qui ont pu être décelées à la périphérie de nombreuses villes d’Afrique de l’Ouest.
2Au nord de Bamako, Bankoni est une zone récemment urbanisée en extension « spontanée » régulière[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], encore peuplée pour l’essentiel de foyers en situation d’insécurité économique (travailleurs précaires, chômeurs, petits artisans et commerçants …). Les procédures de lotissement engagées depuis 1992 par les autorités du gouvernorat, la dévaluation du Franc CFA, la fermeture des dernières entreprises d’État, ont provoqué de profondes perturbations. Selon les habitants, le désordre s’est installé, les règles qui régissaient les relations sociales ont été bouleversées[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
3D’année en année (depuis 1993), j’ai pu appréhender la variété des stratégies individuelles et collectives élaborées dans ce contexte, de la révolte violente (luttes foncières) au refus explicite de « la politique », en passant par les tentatives d’insertion individuelle dans les réseaux de dépendance et de clientélisme liés à l’État.
4Depuis 1998, la prolifération des mouvements religieux semble s’être accélérée, échappant largement au contrôle de l’AMUPI. L’Association Malienne pour l’Unité et le Progrès de l’Islam avait été conçue comme une instance permettant une régulation aussi bien des rapports entre les sphères étatique et religieuse que des relations entre mouvements islamiques[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
5L’un des mouvements dont il sera question ici, l’Ançar-Dine[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], se développe depuis la chute de Moussa Traore (1991). Mais depuis quelques années, les jeunes soufis sont de plus en plus nombreux à parcourir la zone, certains y fondent des établissements secondaires, manifestant ainsi le rayonnement de leur maître (Karamoko[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]). Dans la même période, les « féticheurs » (bolitigi)[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et les groupes de chasseurs (donso) se sont multipliés, proclamant leur fidélité à la « vraie tradition Bamanan[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] d’avant l’Islam ».
6Si cette nébuleuse religieuse est traversée de conflits plus ou moins ouverts, les pratiques des dirigeants et de leurs fidèles montrent l’étroite interdépendance des mouvements qui la composent. Les prêcheurs s’interpellent et s’affrontent dans les journaux, sur les ondes des radios indépendantes, à travers les prêches enregistrés sur cassettes et DVD diffusés sur tous les marchés. Les pratiques des fidèles (vêtements, chants…) évoluent sensiblement au gré des conflits et des alliances.
7Cette effervescence est perçue par les habitants des quartiers périphériques où elle donne lieu à d’inlassables débats au sein des groupes d’amis (grins) et des foyers, à l’extérieur aussi (au centre ville) où elle ne manque pas d’inquiéter une partie des élites politiques et économiques.
8Dès 1998, j’avais pu constater le durcissement des débats religieux, la reconfiguration progressive des liens amicaux et dans certains cas des réseaux d’alliances matrimoniales. À partir de 2002, les différents territoires religieux inscrits dans les quartiers sont bien situés par les habitants, les variations de leurs limites sont commentées, tout comme les mouvements de fidèles (nouvelles affiliations, exclusions, transferts d’allégeance).
9Le phénomène sera donc saisi au moment où il devient visible[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], où les agents sociaux (affiliés ou non) tentent collectivement de lui donner du sens, où les transformations relationnelles qui l’accompagnent posent problème.
10La situation religieuse (2003-2006) dont je sélectionnerai ici quelques traits est sans doute transitoire. Les observations effectuées antérieurement – développement des tensions entre les générations, entre les genres, pratiques thérapeutiques, transformation des activités économiques et du rapport au salariat, conflits politiques – m’ont toutefois permis de saisir quelques unes des dynamiques qui, selon moi, lui confèrent sa singularité.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
11L’analyse des formes d’articulation entre le religieux et le politique pose un certain nombre de problèmes largement débattus dans la littérature sociologique et anthropologique[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Les travaux réalisés notamment sur des terrains africains montrent bien la variété des modes d’investissement politique du religieux – mise en sens des rapports de domination, modes d’opposition au pouvoir d’État, élaboration de nouvelles légitimités politiques, réaménagement des rapports sociaux. Dans certains cas, le religieux peut devenir l’idiome privilégié du politique, notamment des pratiques de résistance, ou l’instrument le plus efficace de sa négation, de sa mise à l’écart[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
12J’adopterai ici une définition du politique qui peut sembler assez large, mais devrait permettre d’échapper aux apories du « tout est politique »[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Seront considérées comme relevant du politique l’ensemble des pratiques liées au contrôle des rapports de domination.
13Les ensembles pratiques (dispositifs) empruntent des formes différentes selon la position des groupes et les ressources matérielles et symboliques dont ils disposent – en position dominante, construction et renforcement des appareils de pouvoir et de leur légitimation, en position dominée, aménagement, contournement, résistance ou tentatives de construction d’une contre hégémonie.
14« En bas », ces procédures entretiennent des liens étroits (perçus ou non par les agents) avec « la politique », les politiques publiques notamment, avec le regard porté sur l’appareil d’État et ses élites, avec aussi le regard porté de l’extérieur sur les dispositifs locaux[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Ainsi, le politique ne sera pas considéré comme un secteur particulier de la vie sociale, mais comme « un ensemble de principes générateurs des relations que les hommes entretiennent entre eux et avec le monde »[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Si l’on se réfère aux analyses de Claude Lefort, les pratiques observables dans ce cadre relèvent d’un ensemble de normes implicites « commandant la notion de ce qui est juste et injuste, bien et mal, désirable et indésirable, noble et bas »[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. On voit bien que la définition de ces normes représente un enjeu fondamental et doit susciter des conflits qui traversent l’ensemble d’une configuration sociale.
15Selon la définition succincte proposée ici, les dynamiques religieuses dont il sera question me semblent relever aussi du politique. Cette dimension n’échappe pas plus aux fidèles concernés qu’à ceux qui les observent, au sein du quartier comme à l’extérieur[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Il s’agit bien dans tous les cas de mettre en œuvre et de diffuser les principes qui doivent orienter la mise en ordre de l’ici-bas et les rapports entre les êtres.
16Toutefois chacune des pratiques relevant explicitement du religieux (marquage et occupation de l’espace urbain, réaménagement des rapports sociaux intimes ou publics, du rapport au travail, des conceptions de l’autorité) peut être comparée à un palindrome à double sens[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Les fidèles, selon les situations observées, selon les contextes de recueil des discours[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] par le chercheur, privilégient tantôt le sens religieux, tantôt le sens politique qu’elle construit. Tantôt le souci du salut dans l’au-delà, tantôt la conquête de l’existence sociale dans le monde. Reste à éclaircir ce que chaque sens doit à l’autre.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
17Le quartier de Dianguinabougou est l’un des plus récemment urbanisés de Bankoni, à la limite nord du district urbain de Bamako. Les opérations de lotissement y ont suscité des réactions particulièrement violentes. Les observations utilisées ici concernent ce quartier qui peut être défini comme une « aire morale ». Vu du centre ville, il est considéré comme « dangereux », repaire de voleurs où la police refuse de s’aventurer. C’est aussi le séjour des nouveaux venus, ruraux « mal dégrossis », « broussards ». Dianguinabougou commence là où le goudron, les canalisations d’eau s’arrêtent (l’électricité n’y est parvenue qu’en 2004). Pour les habitants au contraire, le quartier a longtemps représenté un espace régi par l’ordre villageois, opposé aux désordres caractérisant le centre ville.
18L’analyse de récits d’installation recueillis depuis 1993 permet d’appréhender la diversité des trajectoires qui se croisent dans l’espace du quartier. Il semble qu’on puisse trouver là un principe de hiérarchisation des familles dans l’espace local. Il renvoie à la diversité des territoires relationnels d’appartenance, à la plus ou moins grande distance aux centres du pouvoir économique et politique qu’ils impliquent. La procédure de lotissement a accentué pour les habitants la visibilité de cette hiérarchie, elle se manifeste par une inégalité dans les conditions de la mobilité spatiale ou de l’installation légalisée. Les conditions de la maîtrise de l’espace ne vont plus de soi. Pour certains, les formes qu’emprunte ce pouvoir (la règle du jeu social qui les déconcerte) opposent le village à la ville, l’espace de l’ordre coutumier et celui du pouvoir brutal et arbitraire. D’autres englobent village et ville dans un espace que leur réseau d’alliances leur permet d’investir.
19Les premiers occupants (avant 1970) sont des cultivateurs, attirés par le marché urbain, qui sollicitent la concession de champs auprès des chefs de terre du village rural de Nafadji. Le « premier occupant », Dianguina, devient chef de quartier[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et concède à son tour des terrains. D’abord, dit-on, contre quelques Kolas qui fondent les liens d’allégeance coutumiers, puis contre des sommes de plus en plus élevées, réparties, en principe, entre les chefs de terre villageois et la nouvelle communauté de quartier.
20À partir des années 1980, de nombreux chefs de famille, fuyant le centre ville loti, obtiennent des parcelles. La construction d’un logement leur permet de mettre fin à une période de circulation dans l’espace urbain, de location en location, d’échapper au surpeuplement des concessions urbaines. Ils affirment ainsi leur autorité familiale (ils inaugurent un rapport de transmission) et leur statut au sein de leur lignage. Ils ont alors acquis une position économique qu’ils pensent stable, ouvriers d’une usine d'État, travailleurs des Travaux Publics et de la Voirie, artisans... Ils consolident leurs relations avec le village d’origine et sont alors considérés comme un point attractif de leur réseau d’alliances, ils accueillent les nouveaux migrants et les travailleurs saisonniers.
21Pour d’autres, l’arrivée dans le quartier n’est qu’une étape dans un parcours d’errance urbaine. Travailleurs précaires, locataires perpétuellement expulsés, ils fuient la hausse des loyers dans les zones loties et aussi parfois la disparition de leur clientèle. C’est le cas des petits artisans réparateurs, des porteurs d’eau... Ils recherchent avec leurs propriétaires des rapports sociaux « moins durs », fondés sur la proximité des conditions et la durée.
22Une décennie plus tard, tous, sous des formes diverses, ont connu une dégradation de leur situation et l’annonce du lotissement semble remettre en cause la stabilité conquise par les occupants de parcelles. Certains sont au chômage, leurs enfants adultes accumulent les « apprentissages », les emplois précaires, les expériences de « petit commerce ». Les activités des uns et des autres tendent à se concentrer dans l’espace du quartier ou des zones « spontanées » les plus proches et l’espace de leurs relations associatives, de leurs relations lignagères urbaines, coïncide avec celui des activités économiques. L’élaboration d’une tradition villageoise semble alors constituer un outil privilégié de négociation et d’interprétation des tensions sociales. Le village, espace de référence, est défini par l’ordre, la reproduction stable des rapports entre générations, des liens de subordination. Le quartier de Dianguinabougou est constitué en village lorsqu’il s’agit de définir la ville comme un espace d’insécurité, où rien ne vient modérer le pouvoir de l’argent, celui de l’administration. Dans le quartier, la population « punit les voleurs » et s’oppose à l’intervention de la police, la référence au modèle villageois se lit dans la mise en scène des conflits et de leur résolution.
23Pourtant le quartier appartient bien à la ville quand les habitants le confrontent à l’espace imaginaire du village pour décrire la violence qui s’y installe, la dégradation des rapports entre aînés et cadets, entre hommes et femmes. Ce désordre généralisé est évoqué par les chefs de famille et leurs fils célibataires lorsqu’ils évoquent la monétarisation de la « dot »[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], « inconnue au village », qui « empêche le mariage des pauvres ». Par les mères et leurs filles également lorsqu’elles dénoncent l’inconstance des jeunes gens qui « refusent de se marier » et abandonnent les jeunes filles enceintes. Les aînés et les pères au chômage stigmatisent l’irrespect des jeunes qui refusent de reconnaître leur statut et les cadets flétrissent les aînés incapables de jouer leur rôle traditionnel en leur procurant des épouses... La mémoire villageoise permet d’argumenter et de légitimer l’échec des perdants. Lorsqu’il s’agit de donner une cohérence aux perturbations enclenchées par le lotissement, l'État, la municipalité et leurs agents sont définis comme les incarnations d’un pouvoir étranger et opaque, on n’en peut appréhender les règles, donc en modérer l’appétit (« ils bouffent et c’est tout »), ou en attendre la moindre redistribution (« pour bouffer avec eux, il faut les connaître »). Les mésaventures des « déguerpis » sont commentées, tout comme celles des ouvriers « compressés » dont les actionnaires ont « mangé » l’usine[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
24À partir de 1995, le déplacement des habitants les plus précarisés favorise l’implantation dans le quartier d’une troisième catégorie d’occupants. Leur parcours urbain apparaît comme un parcours d’accumulation de ressources monétaires, de relations, parfois de titres scolaires. Commerçants, employés d’administrations, techniciens, ils perçoivent leur installation comme une étape de leur trajectoire ascendante. Ils instaurent dans le quartier des relations d’échange hiérarchisées, jouent le rôle d’intermédiaires avec l’administration, les employeurs du centre. Ils étendent en quelque sorte les relations de clientélisme qu’ils ont eux-mêmes nouées dans la ville et alors qu’ils y occupent des positions relativement dominées, ils se voient peu à peu reconnaître localement un statut de « notable ». Les stratégies des partis les constituent en intermédiaires privilégiés et leur permettent d’accéder au statut d’élu municipal. La gestion et la répartition des terres sont conçues comme une composante essentielle de ces responsabilités. Les détournements de parcelles loties par les élus municipaux sont dénoncées avec violence par les habitants les plus démunis et contribuent à argumenter le refus « de la politique et des politiciens ».
25En 1998, le lotissement est achevé. Les luttes foncières ont échoué[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Les dernières entreprises d’État privatisées ont fait faillite. Les luttes menées par les ouvriers « compressés » pour l’obtention de leurs indemnités n’ont le plus souvent remporté aucun succès[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
26Les quartiers « spontanés » se caractérisaient par l’homogénéité relative des conditions. Le lotissement se traduit par une hétérogénéité sociale croissante. La transition a été brutale. Le modèle du « quartier-village » protecteur devient inopérant, désormais objet de propos nostalgiques et désenchantés. La présence des nouveaux notables, dont les maisons massives tranchent sur les constructions de banco voisines, rend visible aux yeux de tous le primat des réseaux de dépendance et de clientélisme extérieurs, qui conditionnent la réussite sociale. Cette visibilité peut susciter le refus, la révolte des jeunes adultes. Cependant, on voit s’élaborer de nouvelles normes d’évaluation de la valeur sociale des individus et des lignages[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
27Dans un tel contexte l’espace familier lui-même, le foyer, le voisinage, sont perçus comme des lieux d’incertitude et de conflit – entre aînés et cadets, entre pères et fils, entre conjoints... Les jeunes hommes sont confrontés aux accusations de leurs aînés et des femmes qui les rendent responsables de leur situation de chômeur, de l’échec de leurs projets matrimoniaux, de la propagation de la « nouvelle maladie » (sida). Les jeunes femmes sont soupçonnées par les hommes de se livrer à la débauche, de refuser le mariage, de propager la maladie étrangère[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
28Les individus doivent remodeler la hiérarchisation des espaces de vie et de relations[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], redéfinir les conditions de l’équilibre, notamment en tentant de construire collectivement de nouveaux cadres sociaux de l’expérience.
29Différentes traditions religieuses peuvent alors être mobilisées, réaménagées et parfois articulées avec des outils symboliques empruntés, notamment certains éléments de l’imaginaire politique diffusé par les ONG occidentales et les institutions internationales[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
30Le Sheikh Haidara implante le siège de son mouvement à Dianguinabougou à la fin des années 80. Au départ simple concession périurbaine, l’établissement s’étend en même temps que se développe l’influence du prêcheur. Les affiliations se multiplient dans le quartier (chrétiens, « animistes »), de nombreux musulmans désertent les mosquées locales et « la maison de Haidara » devient un pôle d’attraction fréquenté par de nombreux fidèles venus d’autres quartiers périphériques, du centre ville, puis des villages les plus lointains. Aujourd’hui, de hauts bâtiments « en dur » surplombent les simples constructions qui les entourent, une mosquée, une école, la résidence du maître et de ses disciples, les dortoirs destinés à l’accueil des visiteurs. Progressivement « le tòn[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] de Haidara » a essaimé dans tous les quartiers périphériques.
31Lorsque l’on analyse les récits du Sheikh et de ses proches disciples, cet investissement progressif de l’espace urbain, puis villageois (de la périphérie) évoque l’épopée de Muhammad[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] après l’hidjra vers Médine, lorsque le prophète construit l’Umma avec l’appui des Muhādjirūn Mekkois et des Ansār (auxiliaires) Médinois[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
32Là aussi, la conquête religieuse ne va pas sans conflits et violences, conflits notamment avec les Wahhabites[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Les relations semblent aujourd’hui s’être pacifiées, mais les disciples pratiquent toujours les arts martiaux. Conflits également avec les dirigeants des mouvements islamiques rassemblés au sein de l’AMUPI (Haidara a aujourd’hui intégré cette association).
33Les prêches[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], qui adoptent le ton de la causerie familière émaillée parfois de plaisanteries, invitent les fidèles à une remise en ordre de leur vie quotidienne. En premier lieu, c’est la sphère la plus intime, la plus triviale en apparence qui est concernée : les rapports entre les conjoints, la régulation des conflits entre les co-épouses, les rapports d’autorité au sein de la famille, la répartition des ressources. Puis les comportements dans l’espace de proximité doivent rendre visible aux yeux de tous cette réforme de la famille : tenue vestimentaire et attitude des femmes et des enfants, déplacements dans l’espace urbain et rythmes de vie, rapports au travail et à l’argent des hommes adultes[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], relations de voisinage. Le respect des règles religieuses (prières, jeûne, aumônes…) est évalué à l’aune de cette maîtrise de la sphère domestique[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
34Il s’agit là d’une reconquête, d’une reconstruction de la hiérarchie familiale, qui doit permettre aux hommes et aux femmes, aux aînés et aux cadets de retrouver le statut dont les perturbations sociales les ont dépossédés. Cette remise en ordre peut nécessiter le conflit, la rupture : les anciens doivent être respectés, mais s’ils s’opposent, il convient de s’en éloigner, soit qu’ils soient les représentants d’une coutume entachée de paganisme, soit qu’ils aient eux même été pervertis par les « faux croyants »[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
35Dans les prêches, la référence à la tradition religieuse permet d’interpréter ces perturbations, d’en désigner les responsables.
36En premier lieu Haidara affirme aux jeunes gens qui l’écoutent qu’ils ne sont responsables en rien des échecs qu’ils subissent, il ne cesse de souligner l’injustice des accusations proférées, qu’il s’agisse du chômage, du célibat prolongé, du recours à la prostitution.
37Les responsables désignés sont les mauvais chefs de famille, indignes ou ignorants, les mauvais riches qui accaparent les ressources au lieu de les investir, les mauvais gouvernants, et au-delà, le FMI et les organisations internationales qui imposent leurs contraintes.
38Les règles qui doivent régir le groupe des vrais croyants anticipent l’avènement d’une société à la fois juste et pieuse. L’organisation sociale globale est ainsi conçue comme une extension de la sphère domestique. La mise en ordre du territoire social et religieux affirme le rôle fondamental du regard en instaurant en premier lieu la transparence au sein du groupe lui-même, en invitant les fidèles à exhiber aux yeux de tous, leur nouveau mode d’existence.
39En même temps, il semble que ce primat de la transparence permette d’inverser sous un angle particulier les rapports entre gouvernants et gouvernés. L’appareil d’État, l’ordre économique ne sont jamais dénoncés dans les prêches. La frontière passe entre les bons et les mauvais riches, entre les bons et les mauvais responsables politiques, les bons et les mauvais Imams. Mais les règles de vie des fidèles leur permettent le jugement et l’évaluation du comportement visible des puissants, de retourner en quelque sorte les accusations dont ils ont été la cible.
40Il arrive de plus en plus fréquemment (prêches et discours des proches disciples) que soit mentionné le terme « citoyen » (en français). Ce terme prend un contenu bien particulier tout en évoquant implicitement le modèle démocratique – affirmé par ailleurs par les instances gouvernementales. Le « citoyen » semble ici défini comme celui qui donne à voir sa capacité à maîtriser les rapports sociaux[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et à les conformer à la tradition religieuse – ce qui passe par l’abolition de cette frontière entre espace privé et espace public dont profitent les « hypocrites » pour satisfaire secrètement leurs vices. Il se caractérise aussi par sa capacité à diffuser, au-delà du cercle des croyants, des règles de vies conformes à l’intérêt public[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
41Pour les fidèles dont j’ai recueilli les récits de trajectoire et de conversion, ce modèle s’oppose à la figure de « l’homme perdu », individu coupé de tout lien donc privé de moyens d’existence – l’homme « transparent », diront certains, celui « que personne ne voit ».
42Les récits de trajectoire des convertis sont formulés en termes de ruptures successives, d’échecs. L’inscription territoriale proposée par le tòn constitue une protection. Tout se passe comme si la visibilité instaurée dans le groupe permettait de tenir à distance et de rendre intelligibles les pouvoirs arbitraires responsables des échecs, tout en permettant la conquête de l’existence sociale. Pour les hommes, l’affiliation suscite aussi l’espoir de s’insérer dans de nouveaux réseaux économiques dépassant l’espace restreint du quartier. Les jeunes filles mettront fréquemment l’accent sur l’assurance de « gagner un mari » dont le bon comportement sera garanti par la collectivité. Elles espèrent aussi être « considérées », être protégées des dangers qui dérivent de la polygamie, puisque cette situation représente pour elles une catastrophe particulièrement redoutée (les prêches incitent les maris à traiter les co-épouses et leurs enfants avec équité).
43Dans ce cadre, la conquête du salut dans l’au-delà (rarement évoquée dans les entretiens et les causeries) semble se confondre avec la conquête du statut dans le monde, à la fois signe d’élection et source d’émotion religieuse.
44Toutefois les vertus de la transparence peuvent aisément se retourner contre les fidèles et leur Sheikh. Les non affiliés, les adversaires, observent et commentent à leur tour les comportements des croyants. Ils détectent avec joie les moindres ambiguïtés, se gaussent des mésaventures (infidélités conjugales, faillites économiques, transgression des normes morales) qui témoignent d’un échec à la fois social et religieux. Les Ançar sont alors soupçonnés de poursuivre les objectifs les plus matérialistes, le Sheikh de dissimuler ses ambitions politiques et économiques. Les défaillances individuelles sont souvent source d’exclusion au sein du tòn. Elles peuvent aussi inciter les membres à rompre avec le groupe et parfois à fuir le quartier.
45Les prêches prennent fréquemment pour cible les mauvais Imams et de plus en plus les kafiri[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et les « féticheurs »[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Toutefois les Soufis ne sont jamais ouvertement évoqués.
46Lors de différents entretiens, le Sheikh s’étonnera devant moi de ce que de jeunes soufis viennent lui demander sa bénédiction[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (« Que veulent-ils de moi, que viennent-ils chercher… Je ne les comprends pas… ») Les fidèles quant à eux critiquent avec virulence les comportements vestimentaires des Soufis, le refus de la « vie normale » et de ses devoirs (familiaux, économiques), leur désinvolture vis-à-vis des pratiques religieuses formelles.
47Modes d’occupation de l’espace urbain, organisation du collectif, conceptions de la foi, tout en effet semble opposer l’Ançar-Dine et les mouvements Soufis qui s’implantent aujourd’hui dans le quartier et proposent un autre modèle de mise en ordre du monde.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
48La métaphore du branchement est fort prisée des jeunes disciples des deux karamoko. Elle a été précédée d’images issues de la mécanique automobile[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Aujourd’hui, l’exhibition du téléphone portable permet de signifier que les relations qui lient les disciples et leur maître, les disciples entre eux, sont directes et indépendantes des espaces parcourus et des distances, tout comme les relations qui s’instaurent entre l’individu croyant et Dieu. Le groupe des fidèles se libère ainsi des contraintes spatiales[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
49De nombreux travaux insistent sur le foisonnement des mouvements Soufis[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] en Afrique de l’Ouest et la multiplicité des traditions auxquels ils se réfèrent. Les deux mouvements étudiés ne se rattachent explicitement à aucune confrérie. L’un et l’autre sélectionnent des éléments issus d’une tradition Soufie globale qui, disent les maîtres, « les rassemble aux Soufis du monde entier, passés, présents et à venir »[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
50Les récits de trajectoire construits par les deux Karamoko sont classiques : retrait du monde et phase de vie érémitique dans la brousse[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], puis arrivée des disciples, fondation d’un établissement à la lisière de la ville, dans un espace encore vierge d’urbanisation.
51Les modalités d’occupation de l’espace les opposent au tòn de Haidara. Le maître et ses disciples les plus proches sont installés aux confins de la ville, dans un habitat sommaire (cases de banco, huttes de branchages), environnés d’animaux : chevaux bien entendu, moutons, bovins – dont on me fera observer qu’ils ne sont pas destinés à être sacrifiés, oiseaux apprivoisés… Puis au sein de l’espace urbanisé seront implantés de petits établissements où résident des disciples moins avancés qui doivent à leur tour attirer des élèves, faire la preuve de leur charisme auprès des populations. L’espace religieux et l’espace de vie quotidienne des habitants des quartiers coexistent alors mais ne se recouvrent pas. Rendre visite aux Soufis pour obtenir une bénédiction, participer aux prières et aux chants constitue en soi une rupture par rapport aux espaces-temps de la vie quotidienne. De retour dans leur milieu les nouveaux adeptes devront apprendre à faire respecter leur choix et leur singularité à ceux qui les entourent, ce qui ne va pas de soi[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
52À un autre niveau, la trajectoire spirituelle des disciples accentue ce modèle de retrait du monde.
53L’attraction exercée par le Karamoko, les progrès réalisés vers la fusion avec la divinité, s’accompagnent d’un processus de rééducation de l’individu qui vient de connaître une seconde naissance. Rompre avec le monde implique une phase de refus, d’agressivité. De nombreux disciples le formulaient ainsi : « Le monde devient dangereux, tu vois le diable partout, il faut repousser les autres » ; « les vêtements en loques, les longs cheveux te protègeront des tentations » ; « la vie avec le Maître et les autres élèves t’apprend à être sûr de toi, alors tu fais la paix avec les gens du dehors et tu deviens tolérant ».
54Soufi Adama, quant à lui, précisait qu’il faut être déjà bien avancé dans la voie pour savoir « que le diable c’est toi et personne d’autre ».
55Il semble alors que la quête mystique aille de pair avec la construction d’une nouvelle « famille », autour d’un père-modèle, où les positions sont hiérarchisées selon les degrés d’acquisition de la sagesse, selon les degrés d’intégration au nouveau monde social dans lequel on s’est inséré.
56Dans cette configuration, les regards sont orientés vers le Maître, les disciples les plus avancés et se détournent progressivement (en principe) du monde environnant. Il appartient aux habitants de ce monde là de s’engager ou non dans la même trajectoire de rupture.
57De ce fait, les riches, les gens de pouvoir ne font l’objet d’aucun jugement. Les seuls qui doivent susciter l’intérêt, dont on mentionne le nom, sont « les voitures cassées qui souhaitent se faire réparer », les puissants en échec notamment, quelles que soient les exactions qu’ils ont pu commettre. Ainsi Moussa Traoré, le dictateur déchu, visite le groupe d’Adama tous les vendredis. Des policiers, officiers de l’armée, visitent régulièrement le groupe de Soufi Bilal après avoir compris, déclarent-ils, les méfaits que leurs fonctions les avaient conduits à commettre.
58Cette inversion des regards et de la force d’attraction remet en cause les liens de clientélisme qui conditionnent la réussite sociale en milieu urbain. Ainsi se dessine « en creux » l’évaluation du monde politique et économique, les voies de sa réforme et le rôle dévolu aux croyants dispersés dans le monde[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
59L’accent mis sur la « tolérance » – peu importent les appartenances religieuses, le respect des pratiques religieuses formelles – doit être interprété dans ce cadre. Il reste que cette thématique irrite fortement les traditionalistes et réformateurs musulmans, qui face à l’influence croissante des Soufis dans les quartiers les plus déshérités en viennent à durcir les normes de comportement prescrites à leurs fidèles.
60Les récits de trajectoire sociale construits par les disciples, comme dans le cas des Ançar, sont scandés d’échecs, d’expériences de l’injustice. Toutefois le thème de la rupture volontaire, antérieure à l’apparition de la vocation religieuse, des liens familiaux apparaît fréquemment. Un certain nombre de disciples déclarent avoir connu des phases de délinquance[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Ils disent avoir trouvé là un refuge, une vraie famille[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], qui leur permet de plus de dépasser les limites étroites du monde social antérieur. Ils dépeignent ce dernier comme violent, sans pitié et voué à la monotonie. L’image du réseau unissant les Soufis du monde entier leur donne l’espoir de franchir les frontières. Pour devenir, déclarent de jeunes intellectuels, des « citoyens du monde », ce à quoi le soufisme constituerait la meilleure préparation qui soit…
61Les différences entre les deux mouvements tiennent à la trajectoire sociale du Karamoko (déjà évoquée plus haut), au recrutement des disciples : beaucoup d’anciens étudiants ou lycéens chez Bilal ; d’ouvriers, de paysans et de petits artisans chez Adama. Le rapport aux textes religieux les situe à l’opposé l’un de l’autre : Bilal est un lettré qui a une grande connaissance des traditions soufies ; Adama déclare qu’il ne pourra jamais lire le Coran et que cela importe peu[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
62Avant 2005, Adama et ses disciples affirment qu’ils participent de toutes les traditions religieuses, qui se valent en ce qu’elles incitent les croyants à chercher la même chose – le contact avec la divinité. La « religion traditionnelle des anciens Bamanan » n’est pas exclue de ce vaste ensemble[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Adama a élu domicile sur une colline surplombant un gué traversant le Niger, endroit où les bolitigi effectuent de nombreux sacrifices et où lui-même va méditer toutes les nuits.
63En 2003, il recevra la visite du « féticheur » le plus honni des dignitaires musulmans, (Daouda Yattara dit Sitane) qui de son coté vantera sur les ondes sa bonté et sa tolérance.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
64Depuis quelques années, les bolitigi se multiplient dans les zones urbaines périphériques. Les mouvements de chasseurs[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] deviennent de plus en plus visibles. Le processus de patrimonialisation de « la tradition » enclenché par l’État Malien a donné lieu à l’organisation de festivals, de « Fêtes des chasseurs », à l’érection d’un monument à leur gloire dans le centre ville.
Françoise Bourdarias
p. 115-139
Texte intégral
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
1Ce texte propose quelques éléments de réflexion sur les formes d’articulation du religieux et du politique. Ils sont issus d’observations menées au sein d’une configuration sociale restreinte, singulière, bien que les dynamiques qui s’y inscrivent entretiennent de multiples affinités avec celles qui ont pu être décelées à la périphérie de nombreuses villes d’Afrique de l’Ouest.
- 1 Bankoni (Commune I de Bamako) a vu le nombre de ses habitants (autour de 100 000 selon les dernièr [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- 2 BOURDARIAS (F.), « ONG et développement des élites », Journal des anthropologues, n° 9495, 2003, p [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
2Au nord de Bamako, Bankoni est une zone récemment urbanisée en extension « spontanée » régulière[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], encore peuplée pour l’essentiel de foyers en situation d’insécurité économique (travailleurs précaires, chômeurs, petits artisans et commerçants …). Les procédures de lotissement engagées depuis 1992 par les autorités du gouvernorat, la dévaluation du Franc CFA, la fermeture des dernières entreprises d’État, ont provoqué de profondes perturbations. Selon les habitants, le désordre s’est installé, les règles qui régissaient les relations sociales ont été bouleversées[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
3D’année en année (depuis 1993), j’ai pu appréhender la variété des stratégies individuelles et collectives élaborées dans ce contexte, de la révolte violente (luttes foncières) au refus explicite de « la politique », en passant par les tentatives d’insertion individuelle dans les réseaux de dépendance et de clientélisme liés à l’État.
- 3 L’association était censée englober l’ensemble des mouvements islamiques, ce qui n’a jamais été le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
4Depuis 1998, la prolifération des mouvements religieux semble s’être accélérée, échappant largement au contrôle de l’AMUPI. L’Association Malienne pour l’Unité et le Progrès de l’Islam avait été conçue comme une instance permettant une régulation aussi bien des rapports entre les sphères étatique et religieuse que des relations entre mouvements islamiques[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
- 4 Dont le siège est implanté dans l’un des quartiers les plus récemment urbanisés de Bankoni (Diangu [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- 5 Le terme Karamoko désigne le maître spirituel, celui qui dispense son savoir, se distingue par sa [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- 6 « Fétiche » (en bambara boli), « féticheur » (bolitigi), ces termes d’emprunt sont utilisés locale [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- 7 Bamanan, Bambara.
5L’un des mouvements dont il sera question ici, l’Ançar-Dine[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], se développe depuis la chute de Moussa Traore (1991). Mais depuis quelques années, les jeunes soufis sont de plus en plus nombreux à parcourir la zone, certains y fondent des établissements secondaires, manifestant ainsi le rayonnement de leur maître (Karamoko[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]). Dans la même période, les « féticheurs » (bolitigi)[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et les groupes de chasseurs (donso) se sont multipliés, proclamant leur fidélité à la « vraie tradition Bamanan[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] d’avant l’Islam ».
6Si cette nébuleuse religieuse est traversée de conflits plus ou moins ouverts, les pratiques des dirigeants et de leurs fidèles montrent l’étroite interdépendance des mouvements qui la composent. Les prêcheurs s’interpellent et s’affrontent dans les journaux, sur les ondes des radios indépendantes, à travers les prêches enregistrés sur cassettes et DVD diffusés sur tous les marchés. Les pratiques des fidèles (vêtements, chants…) évoluent sensiblement au gré des conflits et des alliances.
7Cette effervescence est perçue par les habitants des quartiers périphériques où elle donne lieu à d’inlassables débats au sein des groupes d’amis (grins) et des foyers, à l’extérieur aussi (au centre ville) où elle ne manque pas d’inquiéter une partie des élites politiques et économiques.
8Dès 1998, j’avais pu constater le durcissement des débats religieux, la reconfiguration progressive des liens amicaux et dans certains cas des réseaux d’alliances matrimoniales. À partir de 2002, les différents territoires religieux inscrits dans les quartiers sont bien situés par les habitants, les variations de leurs limites sont commentées, tout comme les mouvements de fidèles (nouvelles affiliations, exclusions, transferts d’allégeance).
- 8 Dès les premières phases d’investissement du terrain, j’ai pris le parti d’orienter mon regard sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
9Le phénomène sera donc saisi au moment où il devient visible[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], où les agents sociaux (affiliés ou non) tentent collectivement de lui donner du sens, où les transformations relationnelles qui l’accompagnent posent problème.
10La situation religieuse (2003-2006) dont je sélectionnerai ici quelques traits est sans doute transitoire. Les observations effectuées antérieurement – développement des tensions entre les générations, entre les genres, pratiques thérapeutiques, transformation des activités économiques et du rapport au salariat, conflits politiques – m’ont toutefois permis de saisir quelques unes des dynamiques qui, selon moi, lui confèrent sa singularité.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- 9 Voir notamment : PIGA (A.), éd., Islam et villes en Afrique au sud du Sahara, Karthala, 2003 ; KAN [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- 10 On peut concevoir aussi que des dynamiques religieuses n’entretiennent aucun lien avec le politiqu [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
11L’analyse des formes d’articulation entre le religieux et le politique pose un certain nombre de problèmes largement débattus dans la littérature sociologique et anthropologique[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Les travaux réalisés notamment sur des terrains africains montrent bien la variété des modes d’investissement politique du religieux – mise en sens des rapports de domination, modes d’opposition au pouvoir d’État, élaboration de nouvelles légitimités politiques, réaménagement des rapports sociaux. Dans certains cas, le religieux peut devenir l’idiome privilégié du politique, notamment des pratiques de résistance, ou l’instrument le plus efficace de sa négation, de sa mise à l’écart[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
- 11 Bien désignées notamment par BAYART (J.-F.), « Le politique par le bas en Afrique Noire », Politiq [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
12J’adopterai ici une définition du politique qui peut sembler assez large, mais devrait permettre d’échapper aux apories du « tout est politique »[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Seront considérées comme relevant du politique l’ensemble des pratiques liées au contrôle des rapports de domination.
13Les ensembles pratiques (dispositifs) empruntent des formes différentes selon la position des groupes et les ressources matérielles et symboliques dont ils disposent – en position dominante, construction et renforcement des appareils de pouvoir et de leur légitimation, en position dominée, aménagement, contournement, résistance ou tentatives de construction d’une contre hégémonie.
- 12 Le problème se pose alors de leur autonomie. Voir sur ce point les analyses de GRIGNON (C.) et PAS [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- 13 LEFORT (C.), Essais sur le politique, Paris, Seuil, Points Essais, 2001, p. 8.
- 14 LEFORT (C.), ibid.
14« En bas », ces procédures entretiennent des liens étroits (perçus ou non par les agents) avec « la politique », les politiques publiques notamment, avec le regard porté sur l’appareil d’État et ses élites, avec aussi le regard porté de l’extérieur sur les dispositifs locaux[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Ainsi, le politique ne sera pas considéré comme un secteur particulier de la vie sociale, mais comme « un ensemble de principes générateurs des relations que les hommes entretiennent entre eux et avec le monde »[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Si l’on se réfère aux analyses de Claude Lefort, les pratiques observables dans ce cadre relèvent d’un ensemble de normes implicites « commandant la notion de ce qui est juste et injuste, bien et mal, désirable et indésirable, noble et bas »[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. On voit bien que la définition de ces normes représente un enjeu fondamental et doit susciter des conflits qui traversent l’ensemble d’une configuration sociale.
- 15 BAYART (J.-F.), 1981, op. cit., se référant à P. Veyne, s’interroge ainsi sur les critères qui p [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
15Selon la définition succincte proposée ici, les dynamiques religieuses dont il sera question me semblent relever aussi du politique. Cette dimension n’échappe pas plus aux fidèles concernés qu’à ceux qui les observent, au sein du quartier comme à l’extérieur[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Il s’agit bien dans tous les cas de mettre en œuvre et de diffuser les principes qui doivent orienter la mise en ordre de l’ici-bas et les rapports entre les êtres.
- 16 C'est-à-dire que chaque sens de lecture donne à voir une signification différente.
- 17 Entretien formel ou informel en face à face, entretien de groupe, causeries informelles entre amis [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
16Toutefois chacune des pratiques relevant explicitement du religieux (marquage et occupation de l’espace urbain, réaménagement des rapports sociaux intimes ou publics, du rapport au travail, des conceptions de l’autorité) peut être comparée à un palindrome à double sens[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Les fidèles, selon les situations observées, selon les contextes de recueil des discours[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] par le chercheur, privilégient tantôt le sens religieux, tantôt le sens politique qu’elle construit. Tantôt le souci du salut dans l’au-delà, tantôt la conquête de l’existence sociale dans le monde. Reste à éclaircir ce que chaque sens doit à l’autre.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
17Le quartier de Dianguinabougou est l’un des plus récemment urbanisés de Bankoni, à la limite nord du district urbain de Bamako. Les opérations de lotissement y ont suscité des réactions particulièrement violentes. Les observations utilisées ici concernent ce quartier qui peut être défini comme une « aire morale ». Vu du centre ville, il est considéré comme « dangereux », repaire de voleurs où la police refuse de s’aventurer. C’est aussi le séjour des nouveaux venus, ruraux « mal dégrossis », « broussards ». Dianguinabougou commence là où le goudron, les canalisations d’eau s’arrêtent (l’électricité n’y est parvenue qu’en 2004). Pour les habitants au contraire, le quartier a longtemps représenté un espace régi par l’ordre villageois, opposé aux désordres caractérisant le centre ville.
18L’analyse de récits d’installation recueillis depuis 1993 permet d’appréhender la diversité des trajectoires qui se croisent dans l’espace du quartier. Il semble qu’on puisse trouver là un principe de hiérarchisation des familles dans l’espace local. Il renvoie à la diversité des territoires relationnels d’appartenance, à la plus ou moins grande distance aux centres du pouvoir économique et politique qu’ils impliquent. La procédure de lotissement a accentué pour les habitants la visibilité de cette hiérarchie, elle se manifeste par une inégalité dans les conditions de la mobilité spatiale ou de l’installation légalisée. Les conditions de la maîtrise de l’espace ne vont plus de soi. Pour certains, les formes qu’emprunte ce pouvoir (la règle du jeu social qui les déconcerte) opposent le village à la ville, l’espace de l’ordre coutumier et celui du pouvoir brutal et arbitraire. D’autres englobent village et ville dans un espace que leur réseau d’alliances leur permet d’investir.
- 18 Dugutigi, se dit aussi bien d’un chef de village que d’un chef de quartier urbain.
19Les premiers occupants (avant 1970) sont des cultivateurs, attirés par le marché urbain, qui sollicitent la concession de champs auprès des chefs de terre du village rural de Nafadji. Le « premier occupant », Dianguina, devient chef de quartier[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et concède à son tour des terrains. D’abord, dit-on, contre quelques Kolas qui fondent les liens d’allégeance coutumiers, puis contre des sommes de plus en plus élevées, réparties, en principe, entre les chefs de terre villageois et la nouvelle communauté de quartier.
20À partir des années 1980, de nombreux chefs de famille, fuyant le centre ville loti, obtiennent des parcelles. La construction d’un logement leur permet de mettre fin à une période de circulation dans l’espace urbain, de location en location, d’échapper au surpeuplement des concessions urbaines. Ils affirment ainsi leur autorité familiale (ils inaugurent un rapport de transmission) et leur statut au sein de leur lignage. Ils ont alors acquis une position économique qu’ils pensent stable, ouvriers d’une usine d'État, travailleurs des Travaux Publics et de la Voirie, artisans... Ils consolident leurs relations avec le village d’origine et sont alors considérés comme un point attractif de leur réseau d’alliances, ils accueillent les nouveaux migrants et les travailleurs saisonniers.
21Pour d’autres, l’arrivée dans le quartier n’est qu’une étape dans un parcours d’errance urbaine. Travailleurs précaires, locataires perpétuellement expulsés, ils fuient la hausse des loyers dans les zones loties et aussi parfois la disparition de leur clientèle. C’est le cas des petits artisans réparateurs, des porteurs d’eau... Ils recherchent avec leurs propriétaires des rapports sociaux « moins durs », fondés sur la proximité des conditions et la durée.
22Une décennie plus tard, tous, sous des formes diverses, ont connu une dégradation de leur situation et l’annonce du lotissement semble remettre en cause la stabilité conquise par les occupants de parcelles. Certains sont au chômage, leurs enfants adultes accumulent les « apprentissages », les emplois précaires, les expériences de « petit commerce ». Les activités des uns et des autres tendent à se concentrer dans l’espace du quartier ou des zones « spontanées » les plus proches et l’espace de leurs relations associatives, de leurs relations lignagères urbaines, coïncide avec celui des activités économiques. L’élaboration d’une tradition villageoise semble alors constituer un outil privilégié de négociation et d’interprétation des tensions sociales. Le village, espace de référence, est défini par l’ordre, la reproduction stable des rapports entre générations, des liens de subordination. Le quartier de Dianguinabougou est constitué en village lorsqu’il s’agit de définir la ville comme un espace d’insécurité, où rien ne vient modérer le pouvoir de l’argent, celui de l’administration. Dans le quartier, la population « punit les voleurs » et s’oppose à l’intervention de la police, la référence au modèle villageois se lit dans la mise en scène des conflits et de leur résolution.
- 19 Furu wari, compensation matrimoniale, terme que les habitants traduisent en français par « dot ».
- 20 Fuir et franchir la frontière du District de Bamako peut être alors perçu comme un moyen de recons [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
23Pourtant le quartier appartient bien à la ville quand les habitants le confrontent à l’espace imaginaire du village pour décrire la violence qui s’y installe, la dégradation des rapports entre aînés et cadets, entre hommes et femmes. Ce désordre généralisé est évoqué par les chefs de famille et leurs fils célibataires lorsqu’ils évoquent la monétarisation de la « dot »[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], « inconnue au village », qui « empêche le mariage des pauvres ». Par les mères et leurs filles également lorsqu’elles dénoncent l’inconstance des jeunes gens qui « refusent de se marier » et abandonnent les jeunes filles enceintes. Les aînés et les pères au chômage stigmatisent l’irrespect des jeunes qui refusent de reconnaître leur statut et les cadets flétrissent les aînés incapables de jouer leur rôle traditionnel en leur procurant des épouses... La mémoire villageoise permet d’argumenter et de légitimer l’échec des perdants. Lorsqu’il s’agit de donner une cohérence aux perturbations enclenchées par le lotissement, l'État, la municipalité et leurs agents sont définis comme les incarnations d’un pouvoir étranger et opaque, on n’en peut appréhender les règles, donc en modérer l’appétit (« ils bouffent et c’est tout »), ou en attendre la moindre redistribution (« pour bouffer avec eux, il faut les connaître »). Les mésaventures des « déguerpis » sont commentées, tout comme celles des ouvriers « compressés » dont les actionnaires ont « mangé » l’usine[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
24À partir de 1995, le déplacement des habitants les plus précarisés favorise l’implantation dans le quartier d’une troisième catégorie d’occupants. Leur parcours urbain apparaît comme un parcours d’accumulation de ressources monétaires, de relations, parfois de titres scolaires. Commerçants, employés d’administrations, techniciens, ils perçoivent leur installation comme une étape de leur trajectoire ascendante. Ils instaurent dans le quartier des relations d’échange hiérarchisées, jouent le rôle d’intermédiaires avec l’administration, les employeurs du centre. Ils étendent en quelque sorte les relations de clientélisme qu’ils ont eux-mêmes nouées dans la ville et alors qu’ils y occupent des positions relativement dominées, ils se voient peu à peu reconnaître localement un statut de « notable ». Les stratégies des partis les constituent en intermédiaires privilégiés et leur permettent d’accéder au statut d’élu municipal. La gestion et la répartition des terres sont conçues comme une composante essentielle de ces responsabilités. Les détournements de parcelles loties par les élus municipaux sont dénoncées avec violence par les habitants les plus démunis et contribuent à argumenter le refus « de la politique et des politiciens ».
- 21 Elles se sont progressivement déplacées dans les communes rurales où elles ont parfois abouti, au [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- 22 C’est le cas d’ITEMA, l’une des dernières usines textiles du Mali, dont de nombreux ouvriers résid [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
25En 1998, le lotissement est achevé. Les luttes foncières ont échoué[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Les dernières entreprises d’État privatisées ont fait faillite. Les luttes menées par les ouvriers « compressés » pour l’obtention de leurs indemnités n’ont le plus souvent remporté aucun succès[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
- 23 Les conversations entre amis et voisins manifestent bien cette activité fébrile d’évaluation et de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
26Les quartiers « spontanés » se caractérisaient par l’homogénéité relative des conditions. Le lotissement se traduit par une hétérogénéité sociale croissante. La transition a été brutale. Le modèle du « quartier-village » protecteur devient inopérant, désormais objet de propos nostalgiques et désenchantés. La présence des nouveaux notables, dont les maisons massives tranchent sur les constructions de banco voisines, rend visible aux yeux de tous le primat des réseaux de dépendance et de clientélisme extérieurs, qui conditionnent la réussite sociale. Cette visibilité peut susciter le refus, la révolte des jeunes adultes. Cependant, on voit s’élaborer de nouvelles normes d’évaluation de la valeur sociale des individus et des lignages[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
- 24 Les messages de santé diffusés à cette période ont contribué largement à alimenter ces accusations [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
27Dans un tel contexte l’espace familier lui-même, le foyer, le voisinage, sont perçus comme des lieux d’incertitude et de conflit – entre aînés et cadets, entre pères et fils, entre conjoints... Les jeunes hommes sont confrontés aux accusations de leurs aînés et des femmes qui les rendent responsables de leur situation de chômeur, de l’échec de leurs projets matrimoniaux, de la propagation de la « nouvelle maladie » (sida). Les jeunes femmes sont soupçonnées par les hommes de se livrer à la débauche, de refuser le mariage, de propager la maladie étrangère[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
- 25 Les jeunes adultes tendent à définir et hiérarchiser les différents espaces investis, parcourus ou [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
28Les individus doivent remodeler la hiérarchisation des espaces de vie et de relations[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], redéfinir les conditions de l’équilibre, notamment en tentant de construire collectivement de nouveaux cadres sociaux de l’expérience.
- 26 Citoyenneté, société civile, cosmopolitisme…
29Différentes traditions religieuses peuvent alors être mobilisées, réaménagées et parfois articulées avec des outils symboliques empruntés, notamment certains éléments de l’imaginaire politique diffusé par les ONG occidentales et les institutions internationales[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- 27 En bambara tòn désigne une association, un groupe organisé autour d’un intérêt commun, il désigne [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
30Le Sheikh Haidara implante le siège de son mouvement à Dianguinabougou à la fin des années 80. Au départ simple concession périurbaine, l’établissement s’étend en même temps que se développe l’influence du prêcheur. Les affiliations se multiplient dans le quartier (chrétiens, « animistes »), de nombreux musulmans désertent les mosquées locales et « la maison de Haidara » devient un pôle d’attraction fréquenté par de nombreux fidèles venus d’autres quartiers périphériques, du centre ville, puis des villages les plus lointains. Aujourd’hui, de hauts bâtiments « en dur » surplombent les simples constructions qui les entourent, une mosquée, une école, la résidence du maître et de ses disciples, les dortoirs destinés à l’accueil des visiteurs. Progressivement « le tòn[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] de Haidara » a essaimé dans tous les quartiers périphériques.
- 28 Schème courant semble-t-il dans les récits de fondation de nouveaux mouvements religieux tradition [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- 29 La biographie du Sheikh (dont l’évolution est perceptible sur la durée) présentée dans les prêches [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
31Lorsque l’on analyse les récits du Sheikh et de ses proches disciples, cet investissement progressif de l’espace urbain, puis villageois (de la périphérie) évoque l’épopée de Muhammad[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] après l’hidjra vers Médine, lorsque le prophète construit l’Umma avec l’appui des Muhādjirūn Mekkois et des Ansār (auxiliaires) Médinois[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
- 30 La Wahhabyya (sunnite) est un mouvement particulièrement influent au Mali, surtout dans les villes [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
32Là aussi, la conquête religieuse ne va pas sans conflits et violences, conflits notamment avec les Wahhabites[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Les relations semblent aujourd’hui s’être pacifiées, mais les disciples pratiquent toujours les arts martiaux. Conflits également avec les dirigeants des mouvements islamiques rassemblés au sein de l’AMUPI (Haidara a aujourd’hui intégré cette association).
- 31 Les quelques éléments présentés ici sont issus de l’analyse de prêches diffusés sur cassettes (199 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- 32 L’Ançar-Dine propose entre ses membres la suppression du furu wari (compensation matrimoniale), ob [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- 33 On peut retrouver là les caractéristiques de « l’islamisation par le bas », que certains auteurs a [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
33Les prêches[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], qui adoptent le ton de la causerie familière émaillée parfois de plaisanteries, invitent les fidèles à une remise en ordre de leur vie quotidienne. En premier lieu, c’est la sphère la plus intime, la plus triviale en apparence qui est concernée : les rapports entre les conjoints, la régulation des conflits entre les co-épouses, les rapports d’autorité au sein de la famille, la répartition des ressources. Puis les comportements dans l’espace de proximité doivent rendre visible aux yeux de tous cette réforme de la famille : tenue vestimentaire et attitude des femmes et des enfants, déplacements dans l’espace urbain et rythmes de vie, rapports au travail et à l’argent des hommes adultes[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], relations de voisinage. Le respect des règles religieuses (prières, jeûne, aumônes…) est évalué à l’aune de cette maîtrise de la sphère domestique[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
- 34 Ainsi de nombreux jeunes gens, mariés ou célibataires quittent la concession familiale, certains c [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
34Il s’agit là d’une reconquête, d’une reconstruction de la hiérarchie familiale, qui doit permettre aux hommes et aux femmes, aux aînés et aux cadets de retrouver le statut dont les perturbations sociales les ont dépossédés. Cette remise en ordre peut nécessiter le conflit, la rupture : les anciens doivent être respectés, mais s’ils s’opposent, il convient de s’en éloigner, soit qu’ils soient les représentants d’une coutume entachée de paganisme, soit qu’ils aient eux même été pervertis par les « faux croyants »[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
35Dans les prêches, la référence à la tradition religieuse permet d’interpréter ces perturbations, d’en désigner les responsables.
36En premier lieu Haidara affirme aux jeunes gens qui l’écoutent qu’ils ne sont responsables en rien des échecs qu’ils subissent, il ne cesse de souligner l’injustice des accusations proférées, qu’il s’agisse du chômage, du célibat prolongé, du recours à la prostitution.
37Les responsables désignés sont les mauvais chefs de famille, indignes ou ignorants, les mauvais riches qui accaparent les ressources au lieu de les investir, les mauvais gouvernants, et au-delà, le FMI et les organisations internationales qui imposent leurs contraintes.
38Les règles qui doivent régir le groupe des vrais croyants anticipent l’avènement d’une société à la fois juste et pieuse. L’organisation sociale globale est ainsi conçue comme une extension de la sphère domestique. La mise en ordre du territoire social et religieux affirme le rôle fondamental du regard en instaurant en premier lieu la transparence au sein du groupe lui-même, en invitant les fidèles à exhiber aux yeux de tous, leur nouveau mode d’existence.
39En même temps, il semble que ce primat de la transparence permette d’inverser sous un angle particulier les rapports entre gouvernants et gouvernés. L’appareil d’État, l’ordre économique ne sont jamais dénoncés dans les prêches. La frontière passe entre les bons et les mauvais riches, entre les bons et les mauvais responsables politiques, les bons et les mauvais Imams. Mais les règles de vie des fidèles leur permettent le jugement et l’évaluation du comportement visible des puissants, de retourner en quelque sorte les accusations dont ils ont été la cible.
- 35 On peut remarquer cependant que le modèle de l’individu qui s’élabore ici entretient des affinités [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- 36 Ainsi, depuis 2005, le « tapage nocturne » (notion absente jusque là des discours des habitants) a [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
40Il arrive de plus en plus fréquemment (prêches et discours des proches disciples) que soit mentionné le terme « citoyen » (en français). Ce terme prend un contenu bien particulier tout en évoquant implicitement le modèle démocratique – affirmé par ailleurs par les instances gouvernementales. Le « citoyen » semble ici défini comme celui qui donne à voir sa capacité à maîtriser les rapports sociaux[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et à les conformer à la tradition religieuse – ce qui passe par l’abolition de cette frontière entre espace privé et espace public dont profitent les « hypocrites » pour satisfaire secrètement leurs vices. Il se caractérise aussi par sa capacité à diffuser, au-delà du cercle des croyants, des règles de vies conformes à l’intérêt public[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
41Pour les fidèles dont j’ai recueilli les récits de trajectoire et de conversion, ce modèle s’oppose à la figure de « l’homme perdu », individu coupé de tout lien donc privé de moyens d’existence – l’homme « transparent », diront certains, celui « que personne ne voit ».
42Les récits de trajectoire des convertis sont formulés en termes de ruptures successives, d’échecs. L’inscription territoriale proposée par le tòn constitue une protection. Tout se passe comme si la visibilité instaurée dans le groupe permettait de tenir à distance et de rendre intelligibles les pouvoirs arbitraires responsables des échecs, tout en permettant la conquête de l’existence sociale. Pour les hommes, l’affiliation suscite aussi l’espoir de s’insérer dans de nouveaux réseaux économiques dépassant l’espace restreint du quartier. Les jeunes filles mettront fréquemment l’accent sur l’assurance de « gagner un mari » dont le bon comportement sera garanti par la collectivité. Elles espèrent aussi être « considérées », être protégées des dangers qui dérivent de la polygamie, puisque cette situation représente pour elles une catastrophe particulièrement redoutée (les prêches incitent les maris à traiter les co-épouses et leurs enfants avec équité).
43Dans ce cadre, la conquête du salut dans l’au-delà (rarement évoquée dans les entretiens et les causeries) semble se confondre avec la conquête du statut dans le monde, à la fois signe d’élection et source d’émotion religieuse.
44Toutefois les vertus de la transparence peuvent aisément se retourner contre les fidèles et leur Sheikh. Les non affiliés, les adversaires, observent et commentent à leur tour les comportements des croyants. Ils détectent avec joie les moindres ambiguïtés, se gaussent des mésaventures (infidélités conjugales, faillites économiques, transgression des normes morales) qui témoignent d’un échec à la fois social et religieux. Les Ançar sont alors soupçonnés de poursuivre les objectifs les plus matérialistes, le Sheikh de dissimuler ses ambitions politiques et économiques. Les défaillances individuelles sont souvent source d’exclusion au sein du tòn. Elles peuvent aussi inciter les membres à rompre avec le groupe et parfois à fuir le quartier.
- 37 Terme englobant ici les « animistes » (« païens ») et les « sans religion ».
- 38 Depuis 2003 environ, les récits de conversions de féticheurs endurcis opérées par Haidara se multi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
45Les prêches prennent fréquemment pour cible les mauvais Imams et de plus en plus les kafiri[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et les « féticheurs »[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Toutefois les Soufis ne sont jamais ouvertement évoqués.
- 39 Alors qu’ils visitent ainsi tous les Karamoko prestigieux.
46Lors de différents entretiens, le Sheikh s’étonnera devant moi de ce que de jeunes soufis viennent lui demander sa bénédiction[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (« Que veulent-ils de moi, que viennent-ils chercher… Je ne les comprends pas… ») Les fidèles quant à eux critiquent avec virulence les comportements vestimentaires des Soufis, le refus de la « vie normale » et de ses devoirs (familiaux, économiques), leur désinvolture vis-à-vis des pratiques religieuses formelles.
47Modes d’occupation de l’espace urbain, organisation du collectif, conceptions de la foi, tout en effet semble opposer l’Ançar-Dine et les mouvements Soufis qui s’implantent aujourd’hui dans le quartier et proposent un autre modèle de mise en ordre du monde.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- 40 « Notre maître est le chef mécanicien, nous autres, nous sommes les apprentis et on progresse dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- 41 « Cet appareil est vraiment ce qui convient aux Soufis » (Un disciple de Soufi Bilal, 2006).
48La métaphore du branchement est fort prisée des jeunes disciples des deux karamoko. Elle a été précédée d’images issues de la mécanique automobile[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Aujourd’hui, l’exhibition du téléphone portable permet de signifier que les relations qui lient les disciples et leur maître, les disciples entre eux, sont directes et indépendantes des espaces parcourus et des distances, tout comme les relations qui s’instaurent entre l’individu croyant et Dieu. Le groupe des fidèles se libère ainsi des contraintes spatiales[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
- 42 On ne prendra en compte ici que les deux groupes les plus actifs dans le quartier de référence (pr [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- 43 On repère bien dans les pratiques des éléments de ces traditions (il est impossible de développer [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
49De nombreux travaux insistent sur le foisonnement des mouvements Soufis[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] en Afrique de l’Ouest et la multiplicité des traditions auxquels ils se réfèrent. Les deux mouvements étudiés ne se rattachent explicitement à aucune confrérie. L’un et l’autre sélectionnent des éléments issus d’une tradition Soufie globale qui, disent les maîtres, « les rassemble aux Soufis du monde entier, passés, présents et à venir »[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
- 44 À cela près que Soufi Bilal, intellectuel diplômé, mentionne une révélation divine, et que Soufi A [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
50Les récits de trajectoire construits par les deux Karamoko sont classiques : retrait du monde et phase de vie érémitique dans la brousse[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], puis arrivée des disciples, fondation d’un établissement à la lisière de la ville, dans un espace encore vierge d’urbanisation.
- 45 De très jeunes filles qui suivent l’enseignement d’un disciple de Bilal installé dans le quartier [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
51Les modalités d’occupation de l’espace les opposent au tòn de Haidara. Le maître et ses disciples les plus proches sont installés aux confins de la ville, dans un habitat sommaire (cases de banco, huttes de branchages), environnés d’animaux : chevaux bien entendu, moutons, bovins – dont on me fera observer qu’ils ne sont pas destinés à être sacrifiés, oiseaux apprivoisés… Puis au sein de l’espace urbanisé seront implantés de petits établissements où résident des disciples moins avancés qui doivent à leur tour attirer des élèves, faire la preuve de leur charisme auprès des populations. L’espace religieux et l’espace de vie quotidienne des habitants des quartiers coexistent alors mais ne se recouvrent pas. Rendre visite aux Soufis pour obtenir une bénédiction, participer aux prières et aux chants constitue en soi une rupture par rapport aux espaces-temps de la vie quotidienne. De retour dans leur milieu les nouveaux adeptes devront apprendre à faire respecter leur choix et leur singularité à ceux qui les entourent, ce qui ne va pas de soi[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
52À un autre niveau, la trajectoire spirituelle des disciples accentue ce modèle de retrait du monde.
53L’attraction exercée par le Karamoko, les progrès réalisés vers la fusion avec la divinité, s’accompagnent d’un processus de rééducation de l’individu qui vient de connaître une seconde naissance. Rompre avec le monde implique une phase de refus, d’agressivité. De nombreux disciples le formulaient ainsi : « Le monde devient dangereux, tu vois le diable partout, il faut repousser les autres » ; « les vêtements en loques, les longs cheveux te protègeront des tentations » ; « la vie avec le Maître et les autres élèves t’apprend à être sûr de toi, alors tu fais la paix avec les gens du dehors et tu deviens tolérant ».
54Soufi Adama, quant à lui, précisait qu’il faut être déjà bien avancé dans la voie pour savoir « que le diable c’est toi et personne d’autre ».
55Il semble alors que la quête mystique aille de pair avec la construction d’une nouvelle « famille », autour d’un père-modèle, où les positions sont hiérarchisées selon les degrés d’acquisition de la sagesse, selon les degrés d’intégration au nouveau monde social dans lequel on s’est inséré.
56Dans cette configuration, les regards sont orientés vers le Maître, les disciples les plus avancés et se détournent progressivement (en principe) du monde environnant. Il appartient aux habitants de ce monde là de s’engager ou non dans la même trajectoire de rupture.
57De ce fait, les riches, les gens de pouvoir ne font l’objet d’aucun jugement. Les seuls qui doivent susciter l’intérêt, dont on mentionne le nom, sont « les voitures cassées qui souhaitent se faire réparer », les puissants en échec notamment, quelles que soient les exactions qu’ils ont pu commettre. Ainsi Moussa Traoré, le dictateur déchu, visite le groupe d’Adama tous les vendredis. Des policiers, officiers de l’armée, visitent régulièrement le groupe de Soufi Bilal après avoir compris, déclarent-ils, les méfaits que leurs fonctions les avaient conduits à commettre.
- 46 « Que les hommes et les femmes tournés vers Dieu se multiplient et le monde changera de lui-même »[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
58Cette inversion des regards et de la force d’attraction remet en cause les liens de clientélisme qui conditionnent la réussite sociale en milieu urbain. Ainsi se dessine « en creux » l’évaluation du monde politique et économique, les voies de sa réforme et le rôle dévolu aux croyants dispersés dans le monde[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
59L’accent mis sur la « tolérance » – peu importent les appartenances religieuses, le respect des pratiques religieuses formelles – doit être interprété dans ce cadre. Il reste que cette thématique irrite fortement les traditionalistes et réformateurs musulmans, qui face à l’influence croissante des Soufis dans les quartiers les plus déshérités en viennent à durcir les normes de comportement prescrites à leurs fidèles.
- 47 Quelques uns auraient appartenu à des tòns de bandits. Certains d’ailleurs semblent avoir rejoint [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- 48 En père attentif, le Maître procurera des épouses aux disciples les plus avancés.
60Les récits de trajectoire sociale construits par les disciples, comme dans le cas des Ançar, sont scandés d’échecs, d’expériences de l’injustice. Toutefois le thème de la rupture volontaire, antérieure à l’apparition de la vocation religieuse, des liens familiaux apparaît fréquemment. Un certain nombre de disciples déclarent avoir connu des phases de délinquance[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Ils disent avoir trouvé là un refuge, une vraie famille[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], qui leur permet de plus de dépasser les limites étroites du monde social antérieur. Ils dépeignent ce dernier comme violent, sans pitié et voué à la monotonie. L’image du réseau unissant les Soufis du monde entier leur donne l’espoir de franchir les frontières. Pour devenir, déclarent de jeunes intellectuels, des « citoyens du monde », ce à quoi le soufisme constituerait la meilleure préparation qui soit…
- 49 Lors d’entretiens réalisés auprès d’Adama en 2003, ce dernier insistait sur ce point : « Soufi Ada [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
61Les différences entre les deux mouvements tiennent à la trajectoire sociale du Karamoko (déjà évoquée plus haut), au recrutement des disciples : beaucoup d’anciens étudiants ou lycéens chez Bilal ; d’ouvriers, de paysans et de petits artisans chez Adama. Le rapport aux textes religieux les situe à l’opposé l’un de l’autre : Bilal est un lettré qui a une grande connaissance des traditions soufies ; Adama déclare qu’il ne pourra jamais lire le Coran et que cela importe peu[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
- 50 De tels phénomènes de syncrétisme n’ont rien de nouveau ni d’exceptionnel, mais la situation dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
62Avant 2005, Adama et ses disciples affirment qu’ils participent de toutes les traditions religieuses, qui se valent en ce qu’elles incitent les croyants à chercher la même chose – le contact avec la divinité. La « religion traditionnelle des anciens Bamanan » n’est pas exclue de ce vaste ensemble[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Adama a élu domicile sur une colline surplombant un gué traversant le Niger, endroit où les bolitigi effectuent de nombreux sacrifices et où lui-même va méditer toutes les nuits.
63En 2003, il recevra la visite du « féticheur » le plus honni des dignitaires musulmans, (Daouda Yattara dit Sitane) qui de son coté vantera sur les ondes sa bonté et sa tolérance.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- 51 Les chasseurs sont devenus l’un des symboles privilégiés de la « tradition du Mandé ». Dans chaque [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
64Depuis quelques années, les bolitigi se multiplient dans les zones urbaines périphériques. Les mouvements de chasseurs[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] deviennent de plus en plus visibles. Le processus de patrimonialisation de « la tradition » enclenché par l’État Malien a donné lieu à l’organisation de festivals, de « Fêtes des chasseurs », à l’érection d’un monument à leur gloire dans le centre ville.
 Re: Forum Religion et Politique
Re: Forum Religion et Politique
65Toutefois, dans les quartiers périphériques, la mobilisation de la tradition, confortée par la politique étatique de patrimonialisation, est investie de sens bien différents. Et entre autres d’un sens explicitement politique. Un certain nombre d’événements (2003-2006) ont attiré mon attention sur ce phénomène : « meetings » de chasseurs organisés dans les quartiers où étaient prononcés des discours particulièrement violents, dénonçant l’oppression exercée par les musulmans liés au pouvoir en place, préconisant le retour à la société paisible et égalitaire « d’avant la conquête musulmane » – le tout ponctué d’horribles blasphèmes qui semblaient réjouir les nombreux assistants. Recours aussi, en 2003 à une société de chasseurs pour protéger un marché qui venait d’être pillé par des bandits.
66Si alors de nombreux bolitigi s’exprimaient sur les ondes des radios indépendantes, l’un d’entre eux semblait avoir conquis un prestige particulier[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Fait intéressant, Daouda Yattara s’était attribué le nom de Satan (Sitane), inscription tenant lieu, sur son véhicule, de plaque d’immatriculation. Le siège de Satan (Sitanébougou) s’élève à la lisière Sud de la ville, à coté de la centrale électrique. Avant d’obtenir quelques entretiens, j’ai pu passer là-bas plusieurs journées qui m’ont permis d’évaluer le nombre impressionnant de ceux qui venaient solliciter ses services, « animistes », musulmans et chrétiens confondus. Dans la cour, entre deux entretiens privés, Satan rendait la justice, faisait châtier les voleurs par ses aides[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], tandis que des groupes de chasseurs exécutaient quelques « chants traditionnels » glorifiant à la fois les boli et Satan.
67La biographie présentée par Daouda Yattara est celle d’un « jeune homme en colère » qui dit avoir été confronté dès son enfance à l’injustice et à l’oppression. Les événements qui articulent les récits mettent en scène une famille rurale appauvrie et exploitée par de riches musulmans. Si la scène de la révélation, le récit de formation de maître en maître dans toute l’Afrique de l’Ouest sont des plus conventionnels, les réaménagements de la tradition le sont beaucoup moins.
68Les croyances des « vieux bamanan », religion respectueuse de la nature de l’homme – être dont les besoins sont légitimes et doivent être satisfaits – entretiennent une lutte séculaire[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] contre les religions monothéistes[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], qui « divisent » les hommes et dont la seule fonction est de réprimer cette nature. La référence constante à Satan doit sans doute être interprétée dans ce cadre. Les défaites de la religion traditionnelle viendraient de ce que les bolitigi, qui utilisaient les forces de la nature au profit de la collectivité villageoise, se les sont appropriées en ville pour leur usage personnel. La restauration de la religion passe donc par la restauration de la coutume villageoise et des liens sociaux qu’elle impliquait.
69Si les intérêts sociaux, la conquête du pouvoir politique et économique individuel, divisent et isolent les hommes, il apparaît dans ce discours que les besoins (māgo)[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] fondent la ressemblance entre tous les êtres et leurs liens avec la nature. En ce sens, me fera-t-on souvent remarquer, la coutume bamanan est valable pour tous, dans le monde entier. De nombreux bolitigi précisent que les musulmans qui viennent les consulter en secret témoignent de la force de ce que leur religion réprime. Ainsi « la coutume progresse dans l’ombre ». Ici les jeux du secret (de l’opacité) et de la mise en scène (fêtes de chasseurs, utilisation des média…) mériteraient d’être analysés.
70En 2005, D. Yattara a été emprisonné, il est toujours incarcéré, au secret à la grande prison de Bamako[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], accusé de complicité de meurtre, puis de trafic d’organes humains. Cet événement a rapidement été constitué en affaire d’État. D’autant que d’autres arrestations ont été effectuées (officiers de l’armée et de la police notamment). L’analyse des articles de presse, montrant bien les pressions exercées par les hiérarchies religieuses et l’embarras du pouvoir d’État, permet de déceler la dimension politique conférée « en haut » à ce qui est parfois qualifié de « complot souterrain » contre l’ordre social et la démocratie. Dans les zones périphériques, les causeries entre amis et voisins voient s’affronter les tenants de la défense de l’Islam et ceux qui accusent le pouvoir étatique de complot contre les pauvres. Des groupes de jeunes écoutent, le soir, les cassettes de Sitane. Pour les Imams les plus médiatiques, la conversion du prisonnier est devenue un enjeu.
71Ce dernier mouvement est difficilement comparable aux précédents. Il ne suscite pas la formation d’un collectif stable, repérable dans l’espace de la ville et ne propose pas bien entendu une voie vers le salut. Il ne se constitue pas en « aménageur » de l’espace urbain et des relations. Les références au « village de la tradition » semblent relever à la fois de la nostalgie et de la convention. Les pratiques cultuelles, leur localisation (espace « domestique », demeure des bolitigi locaux et plus rarement siège de Sitane), les manifestations publiques des associations de chasseurs, révèlent les représentations d’un milieu urbain fragmenté, hostile, conflictuel. Il ne s’agit pas d’y conquérir un territoire d’appartenance, mais de susciter « dans l’ombre » l’adhésion des individus. Adhésion d’adeptes, qui « pauvres ou puissants reviendront à la coutume » et se rallieront secrètement[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] au tòn de Sitane, adhésion occasionnelle et inavouée de fidèles des religions monothéistes qui transgressent les interdits en venant consulter les bolitigi, légitimant ainsi leur pouvoir, tout en manifestant qu’ils ont bien eux-mêmes « les mêmes besoins que tous les hommes ».
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
72L’interdépendance des mouvements religieux sélectionnés ici peut-être considérée selon différentes échelles d’observation et d’analyse.
73Adoptons une « focale moyenne », prenant pour objet la configuration religieuse locale, on voit alors que tous recrutent pour une grande part leurs fidèles dans les populations les plus précarisées des quartiers périphériques. Tous définissent leur spécificité en sélectionnant et en articulant les traits d’une pratique islamique formelle, désignant ainsi les formes religieuses et sociales qu’ils entendent combattre.
74Chaque collectif religieux fonde son autorité sur le rattachement à une lignée croyante (Islam, « religion des anciens bamanan »), propose aux adeptes un retour à un univers de significations collectives immuable. La conquête de la légitimité procède du respect de la tradition religieuse dont le détournement (le dévoiement) serait à la fois le principe et l’effet du désordre social vécu.
75Les quelques éléments d’observation présentés plus haut indiquent un processus de sélection et de réinvestissement des éléments pertinents de ces traditions, choisis à un moment donné pour leur « valeur d’usage »[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] lorsqu’il s’agit de donner du sens[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] aux perturbations sociales et aux conflits qui traversent le champ religieux. Au sein de chaque mouvement, la transformation des pratiques, observable sur une durée relativement courte, permet de déceler les effets de la compétition qui s’instaure. Nous verrons plus loin que ce phénomène se manifeste, à un niveau micro social, à travers les transferts d’allégeance des fidèles.
76Je restreindrai ici mon propos aux mouvements musulmans. Les observations réalisées auprès de Sitane et de ses disciples se sont déroulées sur une trop courte durée. Les entretiens, les interventions radiophoniques du maître permettent de percevoir l’élaboration des argumentations face à celles des prêcheurs musulmans qui l’attaquent et lui répondent, mais ces matériaux discursifs sont insuffisants.
77Au départ, les mouvements musulmans (Ançar-Dine et Soufis) élaborent leurs traditions respectives contre « l’Islam officiel », celui des mouvements fédérés au sein de l’AMUPI, dont la proximité avec le pouvoir politique est fréquemment dénoncée par les fidèles (bien que les prêcheurs eux-mêmes n’y fassent que les allusions voilées). Les Ançar notamment critiquent la séparation des sphères politique et religieuse, « imposée par le pouvoir et acceptée par l’AMUPI ».
78Si l’on met en perspective les modes d’occupation de l’espace urbain, les formes de lien social préconisées, les conceptions de l’individu et du collectif, on peut voir se manifester le refus de la coupure entre espace public et espace privé, le refus de la disjonction entre vie quotidienne et vie spirituelle. Ces caractéristiques sont associées à une pratique religieuse formelle et machinale. L’exhibition de la conformité religieuse dissimulerait alors des pratiques sociales contraires à la vraie foi. Le thème de la transparence, fréquemment évoqué plus haut, apparaît comme une composante essentielle des discours et des pratiques observables. De là semblent bien dériver les conceptions de l’individu qui s’élaborent dans ce cadre.
79Les religions monothéistes, dont l’Islam, constituent les croyants en individus – faisant abstraction, dans la sphère religieuse, des liens sociaux concrets qui les territorialisent[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Les mouvements musulmans dont il est question ici affirment la primauté de la maîtrise des liens sociaux, à la fois garant et symbole de l’existence religieuse et sociale de l’individu, en fait de l’accès au statut d’individu. On pourrait avancer que l’inscription dans un collectif concret, localisé, conditionne l’universalité de la religion, c'est-à-dire l’existence même de la véritable Umma, qui ne saurait être conçue comme un agrégat d’individus pratiquants.
80Dans ce contexte, le thème de la responsabilité individuelle[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], attribué aux prêcheurs conformistes, fera l’objet d’attaques répétées. Y est substituée, sous des formes diverses, une prise en compte des contraintes sociales, des rapports de domination politiques et économiques. Les Ançar et les Soufi dessinent ainsi le modèle d’une société croyante authentique et la ligne d’affrontement qui la sépare d’un monde en proie au désordre. Ces constructions sont bien entendu relativement instables. Elles sont réajustées au gré des accusations formulées par l’adversaire commun, de l’évaluation des forces et des faiblesses des mouvements concurrents[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
81Les indices de ces ajustements sont multiples et nécessiteraient une description minutieuse, je n’en évoquerai que quelques éléments, choisis pour les formes d’articulation au politique qu’ils indiquent.
82On peut observer depuis deux ou trois ans une valorisation croissante de la réussite économique au sein de l’Ançar-Dine. Le Sheikh Haidara lui-même donne l’exemple puisqu’il a fondé une agence de voyage assez prospère (pèlerinages à la Mecque). Tout se passe comme si la sécurité garantie aux individus dans le collectif devait leur permettre aujourd’hui de faire la preuve de leurs mérites, comme si l’austérité du mode de vie prescrit pouvait conduire à la stabilité économique, sinon à l’accumulation. Le comportement économique des adeptes fait de plus en plus l’objet d’évaluations, de jugements au sein du tòn[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
83Par ailleurs, la pression exercée sur les femmes du tòn, la sévérité des prêches qui les concernent se sont quelque peu relâchées, au profit d’une intense activité d’éducation religieuse des fillettes. Les transferts d’allégeance de nombreuses femmes vers les mouvements Soufi y ont sans doute contribué.
84Les mouvements Soufi, au rebours, accentuent leurs critiques du monde économique et des valeurs qui y prévalent, tandis que les dons de nourriture aux pauvres se développent. Les critiques du formalisme religieux, par contre se sont atténuées. Les deux Karamoko ne prêchent toujours pas[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], mais le Vendredi, un Imam extérieur vient conduire la prière et prononce un prêche devant les disciples et les fidèles. Les pratiques vestimentaires des disciples se sont aussi transformées en l’espace d’une année (entre 2005 et 2006). Les vêtements « en loques », les tissus Baye Fall[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ont disparu au profit d’étoffes de laine ou de coton tissées manuellement et non teintes – renvoyant à la fois à l’image des premiers Soufi… et à la tradition vestimentaire supposée de l’ancien Mandé. Enfin, chez Adama, les chants semblent refléter une plus stricte orthodoxie, tandis que les références à la religion des Bamanan disparaissent des discours publics des disciples. L’arrestation de Sitane et les scandales qui l’entourent ont sans doute exercé là une influence essentielle.
85En même temps, la transformation du contestataire religieux en criminel de droit commun contraint bolitigi et chasseurs à « se réfugier dans l’ombre » ou à nier tout lien avec le prisonnier. Les attaques proférées contre l’Islam par Sitane sont ainsi assimilées à une forme de délinquance sociale et politique[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
86Les transferts d’allégeance entre les mouvements permettent quelques réflexions concernant les formes micro-sociales d’articulation du religieux et du politique. Les individus concernés lient toujours leur décision aux relations sociales qui prévalent dans chaque tòn religieux, au statut social lié à l’appartenance.
87Les femmes qui délaissent l’Ançar-Dine pour rejoindre un groupe Soufi déclarent souvent qu’elles ont trouvé là un groupe où « on est moins soupçonneux envers les femmes », où « l’amitié et la gaîté entre hommes et femmes est possible »[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Des hommes en échec, dévalorisés au sein de l’Ançar-Dine, prendront le même chemin ou « reviendront à la religion des ancêtres »[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Les passages d’un groupe Soufi à un autre sont rapportés au prestige social du Karamoko, à l’étendue du réseau dont il dispose au Mali et à l’étranger.
88Les mouvements (et pour les mouvements islamiques la voie vers le salut qu’ils proposent), sont donc évalués à l’aune de l’existence sociale qu’ils garantissent, de la protection qu’ils assurent contre les contraintes de l’ordre économique et social. Dans cette situation particulière, il semble que la perception de ces contraintes et de ce qui les génère oriente les constructions religieuses, la sélection et l’appropriation des éléments de tradition[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
89De tels processus se développent localement au moment où les mouvements de lutte explicitement dirigés contre l’État ont été mis en échec (révoltes foncières, militantisme, pour certains, dans les partis politiques, luttes syndicales), où la crise économique se développe.
90Les dynamiques religieuses peuvent alors constituer une forme de manifestation du politique. Il s’agit bien de reconfigurer les relations sociales locales, d’élaborer une légitimation de ce nouvel ordre en articulant des principes qui transcendent le local, relevant de l’universel (universalité de la religion monothéiste, universalité de la « religion traditionnelle »). En même temps sont désignées les causes du désordre. Les figures de l’État et des élites qui se dessinent apparaissent « en creux » à travers les regards qui les évaluent (Ançar-Dine), s’en détournent (Soufis), à travers les jeux de l’opacité et de l’exhibition propres aux adeptes de la « coutume Bamanan », à travers aussi les formes d’organisation socio spatiales.
91Dans une situation vécue comme incertaine, où les formes admises de solidarité et de valorisation sociale semblent inopérantes, on voit ici des groupes sociaux, en position particulièrement dominée, évaluer, retravailler les principes qui doivent régir les interdépendances sociales. Si l’on se réfère aux conceptions du politique développées par C. Lefort, il s’agit bien ici d’un processus d’institution de la société, à travers lequel se trouvent mis en sens et en scène les normes qui devraient orienter un ordre social à la fois juste et conforme aux vraies traditions religieuses. Une telle perspective constitue le politique en phénomène diffus, que l’on ne saurait assigner à un lieu particulier du social ni attribuer à une catégorie spécifique d’agents sociaux.
92L’institution de la société, quelque soit le niveau auquel on l’observe, suscite des dynamiques sociales conflictuelles, liées à la lutte pour la définition des normes et plus largement au contrôle des rapports de domination. On ne peut toutefois constituer ces phénomènes en productions sociales et symboliques autonomes[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Les mobilisations religieuses dont il a été question ici entretiennent des liens d’interdépendance étroits avec la sphère étatique et les conflits qui s’y développent. Ainsi les politiques publiques d’aménagement de l’espace urbain (lotissement), les orientations économiques mises en œuvre par l’État imposent un cadre contraignant aux dynamiques sociales locales qu’elles contribuent fortement à orienter. Elles proposent aussi une bonne partie des matériaux[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] dont s’emparent les dispositifs locaux – énoncés politiques, éthiques, principes économiques, normes d’aménagement de l’espace urbain, qui seront tantôt retournés, tantôt réinvestis, articulés à des énoncés inscrits dans d’autres sphères, ici le religieux.
93Les mobilisations locales, en retour, conduisent à des réaménagements des politiques publiques[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], des discours de légitimation étatiques. Lorsqu’elles concernent les enjeux politiques fondamentaux, elles peuvent aussi durcir les conflits qui opposent les différentes fractions des élites. Les relations entre l’État et la sphère religieuse constituent l’un de ces enjeux. Les débats concernant la notion de laïcité, l’autonomie du politique, traversent les formations politiques alliées au sein de l’appareil d’État. La prolifération de mouvements islamiques réformistes et néo traditionalistes accentue ces tensions. Certains refusent d’intégrer l’AMUPI, instance qui devait permettre la régulation des rapports entre les instances politiques et religieuses, une autre association a donc été créée, intégrant l’AMUPI et certains mouvements « dissidents », mais elle ne parvient pas à les englober tous[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
94Même s’il a été choisi ici de privilégier l’analyse des configurations religieuses à l’échelle locale, on voit bien que la compréhension des formes d’articulation du politique et du religieux qui s’y élaborent impliquerait la prise en compte d’espaces d’observation plus larges englobant les associations religieuses nationales et les rapports qu’elles entretiennent avec l’État, et au-delà les réseaux transnationaux en formation[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
95Dans ce contexte, la question de l’autonomie des formes religieuses et sociales observées n’est guère pertinente. Par contre la volonté d’autonomie, les compétences symboliques et sociales des populations concernées se lisent dans les modalités de sélection et de mise en sens des outils proposés par les traditions, par les discours politiques et sociaux extérieurs. Elles sont également perceptibles dans la rapidité des réajustements symboliques opérés, dans les changements d’affiliation des individus et des groupes, dans la multiplicité des formes d’action politique investies.
Bibliographie
BIBLIOGRAPHIE
Amselle (J.-L.), « Le Wahhabisme à Bamako (1945-1985) », Canadian Journal of African Studies, 1985, p. 345-357.
Amselle (J.-L.) et Sibeud (E.), éd., Maurice Delafosse. Entre orientalisme et ethnographie : l’itinéraire d’un africaniste (1870-1926), Paris, Maisonneuve et Larose, 1998.
Balandier (G.), Le désordre, éloge du mouvement, Paris, Fayard, 1988.
Balandier (G.), Anthropologiques, Paris, L.G.F., 1985.
Balandier (G.), Anthropologie politique, Paris, P.U.F., Collection Quadrige, 2004.
J.F. Bayart (J.-F.), éd., Religion et modernité politique en Afrique Noire, Paris, Karthala, 1993.
Bayart (J.-F.), « Le politique par le bas en Afrique Noire », Politique Africaine, n° 1, 1981, p. 53-82.
Bourdarias (F.), « ONG et développement des élites », Journal des anthropologues, n° 94-95, 2003, p. 23-52.
Bourdarias (F.), « La ville mange la terre. Conflits fonciers à la périphérie de Bamako (Mali) », dans Fay (C.) et Quiminal (C.), éd., Pouvoirs et décentralisation en Afrique de l'Ouest, Paris, IRD, 2006.
Brenner (L.), « Constructing muslim identities in Mali », in Brenner (L.), éd., Muslim Identity and Social Change in Sub-Saharan Africa, Londres, Hurst, 1993, p. 50-78.
Certeau de (M.), L’invention du quotidien – I Arts de faire, Paris, UGE, 1980.
Colloque du Cnrs, La notion de personne en Afrique Noire, Paris CNRS, 1973.
Foucault (M.), La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976.
Guolo (R.), « Le fondamentalisme islamique. Radicalisme et néo-traditionalisme », dans Piga (A.), éd., Islam et villes en Afrique au sud du Sahara, Paris, Karthala, 2003, p. 57-64.
Grignon (C.) et Passeron (J.-C.), Le savant et le populaire, misérabilisme et populisme en sociologie et en littérature, Paris, EHESS, Gallimard/Seuil, 1989.
Halbwachs (M.), La mémoire collective, Paris, PUF, 1968.
Hervieu-Léger (D.), La religion pour mémoire, Paris, Cerf, 1993.
Kane (O.) et Triaud (J.-L.), éd., Islam et islamismes au sud du Sahara, Iremam-Karthala-MSH Paris, 1998.
Lefort (C.), Essais sur le politique, Paris, Seuil, Points Essais, 2001.
Piga (A.), éd., Islam et villes en Afrique au sud du Sahara, Paris, Karthala, 2003.
Revel (J.), éd., Jeux d’échelles, Paris, Gallimard/Le Seuil, 1996.
Tocqueville de (A.), L’ancien régime et la révolution, Paris, Gallimard, Folio-Histoire, p. 68-72.
Notes
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Bankoni (Commune I de Bamako) a vu le nombre de ses habitants (autour de 100 000 selon les dernières estimations) à peu près doubler depuis le recensement de 1997. Les quartiers qui composent cette zone se sont multipliés et s’étendent aujourd’hui jusqu’aux limites du district urbain. Au-delà, les terres des villages ruraux sont progressivement urbanisées. Les procédures administratives de lotissement provoquent régulièrement la fuite d’une partie des habitants (« déguerpis ») et l’extension des occupations « spontanées », en fait régies par les règles coutumières de concession des parcelles. À travers les procédures de lotissement, l’État entendait exercer son droit prééminent sur le sol. Il s’agissait à la fois d’aménager les zones périphériques (tracé de voies notamment) et d’instaurer un marché foncier « formel ». Les habitants dont les habitations n’ont pas été détruites par les tracés de voies ont été mis en demeure de payer une « lettre d’attribution » afin de légaliser leur droit d’usage de la parcelle, ou de l’acheter en toute propriété.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] BOURDARIAS (F.), « ONG et développement des élites », Journal des anthropologues, n° 9495, 2003, p. 23-52 ; « La ville mange la terre. Conflits fonciers à la périphérie de Bamako (Mali) », dans FAY (C.) et QUIMINAL (C.), éd., Pouvoirs et décentralisation en Afrique de l'Ouest, Éd. de l’IRD, 2007, p. 221-238.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] L’association était censée englober l’ensemble des mouvements islamiques, ce qui n’a jamais été le cas, bien que la participation à l’association semble représenter une étape décisive du développement et de la légitimation d’un mouvement religieux.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Dont le siège est implanté dans l’un des quartiers les plus récemment urbanisés de Bankoni (Dianguinabougou).
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Le terme Karamoko désigne le maître spirituel, celui qui dispense son savoir, se distingue par sa sagesse et son pouvoir d’attraction.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] « Fétiche » (en bambara boli), « féticheur » (bolitigi), ces termes d’emprunt sont utilisés localement en milieu urbain, aussi bien par les musulmans que par les adeptes des religions traditionnelles.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Bamanan, Bambara.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Dès les premières phases d’investissement du terrain, j’ai pris le parti d’orienter mon regard sur ce qui, à un moment donné, mobilisait les habitants (au-delà bien sûr des discours convenus élaborés pour un nouveau visiteur), sur ce qui semblait représenter un ensemble de risques sociaux à négocier. Il devenait alors pertinent de décrypter les perturbations relationnelles sous tendant les constructions sociales de ces risques, l’élaboration de modes d’action individuels et collectifs, les constructions symboliques qui les accompagnent.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Voir notamment : PIGA (A.), éd., Islam et villes en Afrique au sud du Sahara, Karthala, 2003 ; KANE (O.) et TRIAUD (J.-L.), éd., Islam et islamismes au sud du Sahara, Iremam-Karthala-MSH, Paris, 1998 ; BAYART (J.-F.), éd., Religion et modernité politique en Afrique Noire, Karthala, 1993.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] On peut concevoir aussi que des dynamiques religieuses n’entretiennent aucun lien avec le politique. Voir l’argumentation de J.P. OLIVIER DE SARDAN : « La surinterprétation politique : les cultes de possession hawka du Niger », dans BAYART (J.-F.), éd., 1993, op. cit., p. 163-214.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Bien désignées notamment par BAYART (J.-F.), « Le politique par le bas en Afrique Noire », Politique Africaine, n° 1, 1981, p. 53-82.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Le problème se pose alors de leur autonomie. Voir sur ce point les analyses de GRIGNON (C.) et PASSERON (J.-C.), Le savant et le populaire, misérabilisme et populisme en sociologie et en littérature, Paris, EHESS, Gallimard/Seuil, 1989.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] LEFORT (C.), Essais sur le politique, Paris, Seuil, Points Essais, 2001, p. 8.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] LEFORT (C.), ibid.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] BAYART (J.-F.), 1981, op. cit., se référant à P. Veyne, s’interroge ainsi sur les critères qui permettraient de situer un ensemble de conduites dans le champ du politique : désignation par les individus et groupes concernés, par l’extérieur, par le chercheur lui-même.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] C'est-à-dire que chaque sens de lecture donne à voir une signification différente.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Entretien formel ou informel en face à face, entretien de groupe, causeries informelles entre amis ou voisins, réactions à un événement… et, bien sûr, représentation de l’observateur et des buts qu’il poursuit (ou des desseins de Dieu à son égard).
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Dugutigi, se dit aussi bien d’un chef de village que d’un chef de quartier urbain.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Furu wari, compensation matrimoniale, terme que les habitants traduisent en français par « dot ».
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Fuir et franchir la frontière du District de Bamako peut être alors perçu comme un moyen de reconstituer un territoire menacé. Les chefs de villages ruraux sont alors opposés aux autorités du District de Bamako comme la coutume préservée l’est au désordre urbain.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Elles se sont progressivement déplacées dans les communes rurales où elles ont parfois abouti, au moins provisoirement. Sur ce point, BOURDARIAS (F.), 2007, op. cit.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] C’est le cas d’ITEMA, l’une des dernières usines textiles du Mali, dont de nombreux ouvriers résident à Bankoni.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Les conversations entre amis et voisins manifestent bien cette activité fébrile d’évaluation et de classement. Les stratégies d’intégration aux réseaux, les échecs et les réussites sont analysés collectivement. Certains s’efforceront alors d’en dévoiler les facettes les plus obscures (compromissions, lâchetés, sorcellerie).
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Les messages de santé diffusés à cette période ont contribué largement à alimenter ces accusations croisées. BOURDARIAS (F.), « Le sida à Bamako : risques et dynamiques des tensions sociales », dans FAY (C.) et VIDAL (L.), éd., Face au sida, négociation des risques en Côte d’Ivoire et au Mali, Rapport de recherche, Centre d’Études Africaines/ANRS, 1999, p. 46-88.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Les jeunes adultes tendent à définir et hiérarchiser les différents espaces investis, parcourus ou évités en fonction des distances sociales qu’ils impliquent, de la plus ou moins grande transparence qui caractérise les rapports sociaux. L’espace le plus familier (le moins opaque et le plus sécurisant) n’en recèle pas moins des dangers, la trop grande proximité entre les êtres (famille, couple, voisinage) générant la contrainte liée à la trop grande visibilité. La distance, périlleuse, permet cependant l’évaluation et la négociation. Qu’il s’agisse des activités économiques, des rapports de séduction ou de l’amitié, il s’agit de définir la bonne distance, celle qui permet « le regard qui perce ».
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Citoyenneté, société civile, cosmopolitisme…
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] En bambara tòn désigne une association, un groupe organisé autour d’un intérêt commun, il désigne aussi les règles qui régissent le groupe.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Schème courant semble-t-il dans les récits de fondation de nouveaux mouvements religieux traditionalistes.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] La biographie du Sheikh (dont l’évolution est perceptible sur la durée) présentée dans les prêches, les récits des fidèles et du Karamoko lui-même mériterait une analyse minutieuse que je n’ai pas encore entreprise.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] La Wahhabyya (sunnite) est un mouvement particulièrement influent au Mali, surtout dans les villes. Les fidèles sont cependant peu présents dans la zone urbaine concernée. Les Wahhabites sont considérés comme issus d’une classe de commerçants aisés et d’une élite d’intellectuels arabisants. Voir notamment : AMSELLE (J.-L.), 1985, « Le Wahhabisme à Bamako (19451985) », Canadian Journal of African Studies, 1985, p. 345-357 ; BRENNER (L.), « Constructing muslim identities in Mali », in BRENNER (L.), éd., Muslim Identity and Social Change in Sub-Saharan Africa, Londres, Hurst, 1993, p. 50-78.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Les quelques éléments présentés ici sont issus de l’analyse de prêches diffusés sur cassettes (1996-2005), de récits de trajectoire de convertis (1995-2000) dont j’ai pu suivre l’évolution ces dernières années.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] L’Ançar-Dine propose entre ses membres la suppression du furu wari (compensation matrimoniale), obstacle au mariage des plus pauvres, la construction de relations économiques privilégiées qui doivent donner aux jeunes « l’occasion de montrer ce qu’ils savent faire et de réussir s’ils le méritent ».
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] On peut retrouver là les caractéristiques de « l’islamisation par le bas », que certains auteurs associent aux mouvements islamiques « néo traditionalistes ». Voir notamment : GUOLO (R.), « Le fondamentalisme islamique. Radicalisme et néotraditionalisme », dans PIGA (A.), éd., Islam et villes en Afrique au sud du Sahara, Paris, Karthala, 2003, p. 57-64.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Ainsi de nombreux jeunes gens, mariés ou célibataires quittent la concession familiale, certains choisissent une épouse parmi les « vrais croyants », sans même en informer leurs parents. Des liens amicaux sont rompus lorsque l’ami refuse de s’affilier au tòn… Là encore rappel de l’épopée de Muhammad et de ses compagnons.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] On peut remarquer cependant que le modèle de l’individu qui s’élabore ici entretient des affinités avec la conception privilégiée par de nombreuses sociétés lignagères en Afrique de l’Ouest. Le statut d’individu remarquable est lié notamment à l’accumulation et à la maîtrise des relations sociales, dans les domaines les plus valorisés par la collectivité. Voir : Colloque du CNRS, La notion de personne en Afrique Noire, Paris CNRS, 1973.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Ainsi, depuis 2005, le « tapage nocturne » (notion absente jusque là des discours des habitants) a disparu dans le voisinage du siège de l’Ançar-Dine. Plus de veillées de baptême joyeuses et bruyantes, lors des mariages les fêtes organisées par les femmes cessent au coucher du soleil. Les musiciens professionnels, les griots, n’y sont plus admis. Le groupe vocal de Haidara y exécute des chants religieux auxquels les danseuses tentent d’adapter leurs pas. Il s’agit, nous dira-t-on, de respecter les voisins, d’éviter les dépenses excessives tout en bannissant les comportements indécents. Ceux qui passeraient outre, quelque soit leur appartenance religieuse, risqueraient d’encourir le blâme du voisinage.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Terme englobant ici les « animistes » (« païens ») et les « sans religion ».
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Depuis 2003 environ, les récits de conversions de féticheurs endurcis opérées par Haidara se multiplient, les événements les plus marquants sont filmés et diffusés sur cassettes et DVD.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Alors qu’ils visitent ainsi tous les Karamoko prestigieux.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] « Notre maître est le chef mécanicien, nous autres, nous sommes les apprentis et on progresse dans le métier ! Les voitures viennent se faire réparer, ce n’est pas un hasard, toi qui es venue, ton moteur doit avoir des ratés ! » (un disciple de Soufi Adama, 2001)
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] « Cet appareil est vraiment ce qui convient aux Soufis » (Un disciple de Soufi Bilal, 2006).
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] On ne prendra en compte ici que les deux groupes les plus actifs dans le quartier de référence (prosélytisme, installation de disciples). Les Mourides, présents à Bamako, ne se manifestent pas à Bankoni. Le collectif que j’ai rencontré au sud de la ville recrute parmi les techniciens, les cadres moyens.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] On repère bien dans les pratiques des éléments de ces traditions (il est impossible de développer ce point ici). On peut relever de multiples références aux « premiers Soufis ». La non proclamation d’allégeance à l’une des nombreuses confréries implantées en Afrique de l’Ouest est peut-être transitoire. En tous cas les thématiques du « retour aux origines », du refus des affrontements entre mouvements sont prégnantes. Peut-être sont-elles caractéristiques de mouvements émergents, peut-être sont-elles aussi liées aux ambitions religieuses et sociales des maîtres.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] À cela près que Soufi Bilal, intellectuel diplômé, mentionne une révélation divine, et que Soufi Adama, illettré, lie sa retraite à l’expérience du malheur et de la maladie (lèpre), comme le font les furakela (guérisseurs).
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] De très jeunes filles qui suivent l’enseignement d’un disciple de Bilal installé dans le quartier m’ont fait part des difficultés rencontrées auprès de leurs parents et du voisinage.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] « Que les hommes et les femmes tournés vers Dieu se multiplient et le monde changera de lui-même ». Les disciples développent volontiers cette thématique.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Quelques uns auraient appartenu à des tòns de bandits. Certains d’ailleurs semblent avoir rejoint leur premier groupe d’appartenance.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] En père attentif, le Maître procurera des épouses aux disciples les plus avancés.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Lors d’entretiens réalisés auprès d’Adama en 2003, ce dernier insistait sur ce point : « Soufi Adama, on m’appelle comme ça … Je ne sais pas si je suis Soufi ! Je suis venu, j’ai prié ici tout seul … Des gens sont venus autour de moi, ils m’ont appelé Soufi et m’ont dit qu’ils étaient Soufi… C’est tout ».
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] De tels phénomènes de syncrétisme n’ont rien de nouveau ni d’exceptionnel, mais la situation dans laquelle ils se manifestent ici leur donne un sens particulier.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Les chasseurs sont devenus l’un des symboles privilégiés de la « tradition du Mandé ». Dans chaque association aujourd’hui, l’initiation des membres implique l’attachement à un maître : acquisition des savoirs cynégétiques, mais aussi des savoirs ésotériques permettant d’établir des liens avec les forces qui régissent les processus naturels. En ce sens, chasseurs et bolitigi entretiennent de nombreuses affinités.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Large diffusion de ses cassettes sur les marchés, multiplication du nombre de ses élèves dans les quartiers, attaques répétées de la part des dignitaires religieux dans les prêches et dans la presse.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Quelques coups de fouet appliqués avec une certaine « bienveillance » : « Allez, courage… encore trois coups et c’est fini ! Tu pourras dormir tranquille après ».
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Les travaux de nombreux historiens retracent la longue cohabitation de l’Islam et des religions locales en Afrique subsaharienne : syncrétismes, emprunts, périodes d’affrontements et de paix. Ils critiquent également la rigidification des identités religieuses opérée par les administrateurs coloniaux et les premiers ethnologues. Voir notamment : AMSELLE (J.-L.) et SIBEUD (E.), éd., Maurice Delafosse. Entre orientalisme et ethnographie : l’itinéraire d’un africaniste (1870-1926), Paris, Maisonneuve et Larose, 1998.) La construction qui apparaît ici mérite d’autant plus d’attirer l’attention.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Ici l’ennemi désigné est l’Islam, car « le christianisme, maintenant, laisse les gens tranquilles ».
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Semblent ainsi être opposés le désir d’imposer sa loi aux autres (politique) et le « besoin ». Interrogés sur ce point, Satan et ses disciples énumèrent : faire que ton champ ou ton commerce gagne beaucoup, que tu gagnes au tiercé, que tu puisses avoir la femme que tu aimes et qu’elle te soit fidèle, que tu guérisses de ta maladie…
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Son procès a eu lieu au début du mois de juillet 2007 et il a été condamné à sept ans d’incarcération.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Cette thématique du secret, les reformulations des formes religieuses traditionnelles et de la notion d’individu devraient permettre d’appréhender les conceptions du pouvoir qui s’élaborent ici, dans un contexte conflictuel singulier. Le caractère lacunaire de mes observations ne me permet pas encore d’aborder ce point pourtant essentiel.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Ce terme permet de désigner la valeur circonstancielle, (locale) accordée à des éléments de tradition. On peut penser ici aux analyses de M. HALBWACHS concernant les usages de la mémoire individuelle et collective (1968, La mémoire collective, PUF).
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] On se référera sur ce point aux définitions de la tradition proposées et mises à l’épreuve par G. BALANDIER (notamment Le désordre, éloge du mouvement, Paris, Fayard, 1988), et à leur utilisation par D. HERVIEU-LÉGER, La religion pour mémoire, Paris, Cerf, 1993.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] L’analyse de Tocqueville est éclairante sur ce point, lorsqu’il établit un parallèle entre les révolutions politiques et le développement des religions monothéistes (L’ancien régime et la révolution, Gallimard, Folio-Histoire, p. 68-72).
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Face à l’échec social, à l’extension de la nouvelle maladie (sida)…
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Ajoutons à cela qu’à un certain stade de son développement, un mouvement religieux contestataire tente fréquemment d’acquérir une légitimité auprès d’une population plus large et plus diversifiée. C’est aujourd’hui semble-t-il le cas le l’Ançar-Dine et des deux mouvements Soufi.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Certains fidèles feront remarquer non sans fierté que les commerçants du centre sont de plus en plus nombreux à visiter Haidara « avec leurs grosses voitures »… Haidara a intégré l’AMUPI, « pour y défendre la bonne voie religieuse ».
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Bilal et Adama prononcent quelques phrases de bienvenue devant les fidèles qui affluent le Vendredi, puis les reçoivent individuellement ou par petits groupes après la prière.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Tissus faits de morceaux cousus, sorte de « patchwork » caractéristique du vêtement adopté par les mourides du mouvement Baye Fall (Sénégal).
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Rappelons que des gradés de l’armée et de la police avaient été « séduits » et détournés « de leurs devoirs envers l’État et la démocratie ». L’analyse de la presse malienne depuis 2005 permet d’appréhender l’importance politique et religieuse de ces événements.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Certaines, lors de leurs visites à la résidence du Karamoko soufi insistent sur le sentiment de liberté qu’elles y ressentent, sur le fait qu’elles échappent momentanément aux contraintes exercées par le milieu familial et le voisinage.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] « Qui ne fait pas de l’homme un coupable, un prisonnier » (propos tenu par un « transfuge » de l’Ançar-Dine, 2005).
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Il conviendrait alors de s’interroger, à une échelle plus micro sociale encore, sur ce qui oriente ces perceptions différenciées et relativement fluctuantes des tensions qui caractérisent une configuration sociale saisie par l’observateur dans la durée. Lorsque l’on confronte les transformations des pratiques religieuses et politiques, celles qui affectent les rapports entre les sexes et les générations, les pratiques économiques, on est conduit à s’interroger sur l’élaboration de nouveaux modèles « d’économie affective » (N. Elias utilise encore le terme d’économie pulsionnelle). Alors seulement les notions d’autonomie, de contrainte perçue, de construction de modèles d’action et de mobilisation pourraient devenir des outils efficaces d’analyse. L’articulation des différents niveaux d’observation serait également plus satisfaisante.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Les degrés d’autonomie ou de dépendance que les chercheurs attribuent aux constructions sociales et symboliques opérées en situation dominée ont donné lieu à de nombreux débats (histoire, sociologie, anthropologie, politologie). Voir : GRIGNON (C.) et PASSERON (J.-C.), 1989, op. cit. ; CERTEAU DE (M.), L’invention du quotidien – I Arts de faire, Paris, UGE, 1980 ; FOUCAULT (M.), La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976 ; REVEL (J.), éd., Jeux d’échelles, Paris, Gallimard/Le Seuil, 1996.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Thématiques de la pacification des rapports sociaux, de l’aménagement rationnel de l’espace urbain, de la lutte contre la délinquance, de la valorisation des traditions nationales ; notions de bien public, de citoyenneté, de mérite individuel…
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Ainsi, les révoltes suscitées par le lotissement et l’instauration d’un marché foncier dans les zones périphériques ont contraint les instances administratives à prendre en compte les règles coutumières de concession des parcelles, les intérêts des chefs de terre et des occupants… Ce qui a d’ailleurs accéléré le développement d’un marché foncier illégal particulièrement actif (certains représentants de l’administration locale et centrale savent en tirer profit).
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Phénomène constant dans l’histoire des interdépendances entre l’État et les mouvements religieux islamiques au Mali depuis l’indépendance.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Sans exclure les formes de circulation des savoirs religieux et les circuits d’apprentissage propres aux bolitigi urbains, qui, selon mes premières observations s’étendent sur plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest (Mali, Guinée, Sénégal, Côte d’Ivoire).
Auteur
Françoise Bourdarias
Université François-Rabelais, Tours. UMR CNRS 6173 CITERES
- 52 Large diffusion de ses cassettes sur les marchés, multiplication du nombre de ses élèves dans les [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- 53 Quelques coups de fouet appliqués avec une certaine « bienveillance » : « Allez, courage… encore t [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
66Si alors de nombreux bolitigi s’exprimaient sur les ondes des radios indépendantes, l’un d’entre eux semblait avoir conquis un prestige particulier[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Fait intéressant, Daouda Yattara s’était attribué le nom de Satan (Sitane), inscription tenant lieu, sur son véhicule, de plaque d’immatriculation. Le siège de Satan (Sitanébougou) s’élève à la lisière Sud de la ville, à coté de la centrale électrique. Avant d’obtenir quelques entretiens, j’ai pu passer là-bas plusieurs journées qui m’ont permis d’évaluer le nombre impressionnant de ceux qui venaient solliciter ses services, « animistes », musulmans et chrétiens confondus. Dans la cour, entre deux entretiens privés, Satan rendait la justice, faisait châtier les voleurs par ses aides[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], tandis que des groupes de chasseurs exécutaient quelques « chants traditionnels » glorifiant à la fois les boli et Satan.
67La biographie présentée par Daouda Yattara est celle d’un « jeune homme en colère » qui dit avoir été confronté dès son enfance à l’injustice et à l’oppression. Les événements qui articulent les récits mettent en scène une famille rurale appauvrie et exploitée par de riches musulmans. Si la scène de la révélation, le récit de formation de maître en maître dans toute l’Afrique de l’Ouest sont des plus conventionnels, les réaménagements de la tradition le sont beaucoup moins.
- 54 Les travaux de nombreux historiens retracent la longue cohabitation de l’Islam et des religions lo [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- 55 Ici l’ennemi désigné est l’Islam, car « le christianisme, maintenant, laisse les gens tranquilles [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
68Les croyances des « vieux bamanan », religion respectueuse de la nature de l’homme – être dont les besoins sont légitimes et doivent être satisfaits – entretiennent une lutte séculaire[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] contre les religions monothéistes[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], qui « divisent » les hommes et dont la seule fonction est de réprimer cette nature. La référence constante à Satan doit sans doute être interprétée dans ce cadre. Les défaites de la religion traditionnelle viendraient de ce que les bolitigi, qui utilisaient les forces de la nature au profit de la collectivité villageoise, se les sont appropriées en ville pour leur usage personnel. La restauration de la religion passe donc par la restauration de la coutume villageoise et des liens sociaux qu’elle impliquait.
- 56 Semblent ainsi être opposés le désir d’imposer sa loi aux autres (politique) et le « besoin ». Int [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
69Si les intérêts sociaux, la conquête du pouvoir politique et économique individuel, divisent et isolent les hommes, il apparaît dans ce discours que les besoins (māgo)[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] fondent la ressemblance entre tous les êtres et leurs liens avec la nature. En ce sens, me fera-t-on souvent remarquer, la coutume bamanan est valable pour tous, dans le monde entier. De nombreux bolitigi précisent que les musulmans qui viennent les consulter en secret témoignent de la force de ce que leur religion réprime. Ainsi « la coutume progresse dans l’ombre ». Ici les jeux du secret (de l’opacité) et de la mise en scène (fêtes de chasseurs, utilisation des média…) mériteraient d’être analysés.
- 57 Son procès a eu lieu au début du mois de juillet 2007 et il a été condamné à sept ans d’incarcérat [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
70En 2005, D. Yattara a été emprisonné, il est toujours incarcéré, au secret à la grande prison de Bamako[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], accusé de complicité de meurtre, puis de trafic d’organes humains. Cet événement a rapidement été constitué en affaire d’État. D’autant que d’autres arrestations ont été effectuées (officiers de l’armée et de la police notamment). L’analyse des articles de presse, montrant bien les pressions exercées par les hiérarchies religieuses et l’embarras du pouvoir d’État, permet de déceler la dimension politique conférée « en haut » à ce qui est parfois qualifié de « complot souterrain » contre l’ordre social et la démocratie. Dans les zones périphériques, les causeries entre amis et voisins voient s’affronter les tenants de la défense de l’Islam et ceux qui accusent le pouvoir étatique de complot contre les pauvres. Des groupes de jeunes écoutent, le soir, les cassettes de Sitane. Pour les Imams les plus médiatiques, la conversion du prisonnier est devenue un enjeu.
- 58 Cette thématique du secret, les reformulations des formes religieuses traditionnelles et de la not [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
71Ce dernier mouvement est difficilement comparable aux précédents. Il ne suscite pas la formation d’un collectif stable, repérable dans l’espace de la ville et ne propose pas bien entendu une voie vers le salut. Il ne se constitue pas en « aménageur » de l’espace urbain et des relations. Les références au « village de la tradition » semblent relever à la fois de la nostalgie et de la convention. Les pratiques cultuelles, leur localisation (espace « domestique », demeure des bolitigi locaux et plus rarement siège de Sitane), les manifestations publiques des associations de chasseurs, révèlent les représentations d’un milieu urbain fragmenté, hostile, conflictuel. Il ne s’agit pas d’y conquérir un territoire d’appartenance, mais de susciter « dans l’ombre » l’adhésion des individus. Adhésion d’adeptes, qui « pauvres ou puissants reviendront à la coutume » et se rallieront secrètement[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] au tòn de Sitane, adhésion occasionnelle et inavouée de fidèles des religions monothéistes qui transgressent les interdits en venant consulter les bolitigi, légitimant ainsi leur pouvoir, tout en manifestant qu’ils ont bien eux-mêmes « les mêmes besoins que tous les hommes ».
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
72L’interdépendance des mouvements religieux sélectionnés ici peut-être considérée selon différentes échelles d’observation et d’analyse.
73Adoptons une « focale moyenne », prenant pour objet la configuration religieuse locale, on voit alors que tous recrutent pour une grande part leurs fidèles dans les populations les plus précarisées des quartiers périphériques. Tous définissent leur spécificité en sélectionnant et en articulant les traits d’une pratique islamique formelle, désignant ainsi les formes religieuses et sociales qu’ils entendent combattre.
74Chaque collectif religieux fonde son autorité sur le rattachement à une lignée croyante (Islam, « religion des anciens bamanan »), propose aux adeptes un retour à un univers de significations collectives immuable. La conquête de la légitimité procède du respect de la tradition religieuse dont le détournement (le dévoiement) serait à la fois le principe et l’effet du désordre social vécu.
- 59 Ce terme permet de désigner la valeur circonstancielle, (locale) accordée à des éléments de tradit [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- 60 On se référera sur ce point aux définitions de la tradition proposées et mises à l’épreuve par G. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
75Les quelques éléments d’observation présentés plus haut indiquent un processus de sélection et de réinvestissement des éléments pertinents de ces traditions, choisis à un moment donné pour leur « valeur d’usage »[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] lorsqu’il s’agit de donner du sens[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] aux perturbations sociales et aux conflits qui traversent le champ religieux. Au sein de chaque mouvement, la transformation des pratiques, observable sur une durée relativement courte, permet de déceler les effets de la compétition qui s’instaure. Nous verrons plus loin que ce phénomène se manifeste, à un niveau micro social, à travers les transferts d’allégeance des fidèles.
76Je restreindrai ici mon propos aux mouvements musulmans. Les observations réalisées auprès de Sitane et de ses disciples se sont déroulées sur une trop courte durée. Les entretiens, les interventions radiophoniques du maître permettent de percevoir l’élaboration des argumentations face à celles des prêcheurs musulmans qui l’attaquent et lui répondent, mais ces matériaux discursifs sont insuffisants.
77Au départ, les mouvements musulmans (Ançar-Dine et Soufis) élaborent leurs traditions respectives contre « l’Islam officiel », celui des mouvements fédérés au sein de l’AMUPI, dont la proximité avec le pouvoir politique est fréquemment dénoncée par les fidèles (bien que les prêcheurs eux-mêmes n’y fassent que les allusions voilées). Les Ançar notamment critiquent la séparation des sphères politique et religieuse, « imposée par le pouvoir et acceptée par l’AMUPI ».
78Si l’on met en perspective les modes d’occupation de l’espace urbain, les formes de lien social préconisées, les conceptions de l’individu et du collectif, on peut voir se manifester le refus de la coupure entre espace public et espace privé, le refus de la disjonction entre vie quotidienne et vie spirituelle. Ces caractéristiques sont associées à une pratique religieuse formelle et machinale. L’exhibition de la conformité religieuse dissimulerait alors des pratiques sociales contraires à la vraie foi. Le thème de la transparence, fréquemment évoqué plus haut, apparaît comme une composante essentielle des discours et des pratiques observables. De là semblent bien dériver les conceptions de l’individu qui s’élaborent dans ce cadre.
- 61 L’analyse de Tocqueville est éclairante sur ce point, lorsqu’il établit un parallèle entre les rév [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
79Les religions monothéistes, dont l’Islam, constituent les croyants en individus – faisant abstraction, dans la sphère religieuse, des liens sociaux concrets qui les territorialisent[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Les mouvements musulmans dont il est question ici affirment la primauté de la maîtrise des liens sociaux, à la fois garant et symbole de l’existence religieuse et sociale de l’individu, en fait de l’accès au statut d’individu. On pourrait avancer que l’inscription dans un collectif concret, localisé, conditionne l’universalité de la religion, c'est-à-dire l’existence même de la véritable Umma, qui ne saurait être conçue comme un agrégat d’individus pratiquants.
- 62 Face à l’échec social, à l’extension de la nouvelle maladie (sida)…
- 63 Ajoutons à cela qu’à un certain stade de son développement, un mouvement religieux contestataire t [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
80Dans ce contexte, le thème de la responsabilité individuelle[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], attribué aux prêcheurs conformistes, fera l’objet d’attaques répétées. Y est substituée, sous des formes diverses, une prise en compte des contraintes sociales, des rapports de domination politiques et économiques. Les Ançar et les Soufi dessinent ainsi le modèle d’une société croyante authentique et la ligne d’affrontement qui la sépare d’un monde en proie au désordre. Ces constructions sont bien entendu relativement instables. Elles sont réajustées au gré des accusations formulées par l’adversaire commun, de l’évaluation des forces et des faiblesses des mouvements concurrents[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
81Les indices de ces ajustements sont multiples et nécessiteraient une description minutieuse, je n’en évoquerai que quelques éléments, choisis pour les formes d’articulation au politique qu’ils indiquent.
- 64 Certains fidèles feront remarquer non sans fierté que les commerçants du centre sont de plus en pl [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
82On peut observer depuis deux ou trois ans une valorisation croissante de la réussite économique au sein de l’Ançar-Dine. Le Sheikh Haidara lui-même donne l’exemple puisqu’il a fondé une agence de voyage assez prospère (pèlerinages à la Mecque). Tout se passe comme si la sécurité garantie aux individus dans le collectif devait leur permettre aujourd’hui de faire la preuve de leurs mérites, comme si l’austérité du mode de vie prescrit pouvait conduire à la stabilité économique, sinon à l’accumulation. Le comportement économique des adeptes fait de plus en plus l’objet d’évaluations, de jugements au sein du tòn[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
83Par ailleurs, la pression exercée sur les femmes du tòn, la sévérité des prêches qui les concernent se sont quelque peu relâchées, au profit d’une intense activité d’éducation religieuse des fillettes. Les transferts d’allégeance de nombreuses femmes vers les mouvements Soufi y ont sans doute contribué.
- 65 Bilal et Adama prononcent quelques phrases de bienvenue devant les fidèles qui affluent le Vendred [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- 66 Tissus faits de morceaux cousus, sorte de « patchwork » caractéristique du vêtement adopté par les [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
84Les mouvements Soufi, au rebours, accentuent leurs critiques du monde économique et des valeurs qui y prévalent, tandis que les dons de nourriture aux pauvres se développent. Les critiques du formalisme religieux, par contre se sont atténuées. Les deux Karamoko ne prêchent toujours pas[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], mais le Vendredi, un Imam extérieur vient conduire la prière et prononce un prêche devant les disciples et les fidèles. Les pratiques vestimentaires des disciples se sont aussi transformées en l’espace d’une année (entre 2005 et 2006). Les vêtements « en loques », les tissus Baye Fall[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ont disparu au profit d’étoffes de laine ou de coton tissées manuellement et non teintes – renvoyant à la fois à l’image des premiers Soufi… et à la tradition vestimentaire supposée de l’ancien Mandé. Enfin, chez Adama, les chants semblent refléter une plus stricte orthodoxie, tandis que les références à la religion des Bamanan disparaissent des discours publics des disciples. L’arrestation de Sitane et les scandales qui l’entourent ont sans doute exercé là une influence essentielle.
- 67 Rappelons que des gradés de l’armée et de la police avaient été « séduits » et détournés « de leur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
85En même temps, la transformation du contestataire religieux en criminel de droit commun contraint bolitigi et chasseurs à « se réfugier dans l’ombre » ou à nier tout lien avec le prisonnier. Les attaques proférées contre l’Islam par Sitane sont ainsi assimilées à une forme de délinquance sociale et politique[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
86Les transferts d’allégeance entre les mouvements permettent quelques réflexions concernant les formes micro-sociales d’articulation du religieux et du politique. Les individus concernés lient toujours leur décision aux relations sociales qui prévalent dans chaque tòn religieux, au statut social lié à l’appartenance.
- 68 Certaines, lors de leurs visites à la résidence du Karamoko soufi insistent sur le sentiment de li [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- 69 « Qui ne fait pas de l’homme un coupable, un prisonnier » (propos tenu par un « transfuge » de l’A [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
87Les femmes qui délaissent l’Ançar-Dine pour rejoindre un groupe Soufi déclarent souvent qu’elles ont trouvé là un groupe où « on est moins soupçonneux envers les femmes », où « l’amitié et la gaîté entre hommes et femmes est possible »[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Des hommes en échec, dévalorisés au sein de l’Ançar-Dine, prendront le même chemin ou « reviendront à la religion des ancêtres »[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Les passages d’un groupe Soufi à un autre sont rapportés au prestige social du Karamoko, à l’étendue du réseau dont il dispose au Mali et à l’étranger.
- 70 Il conviendrait alors de s’interroger, à une échelle plus micro sociale encore, sur ce qui oriente [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
88Les mouvements (et pour les mouvements islamiques la voie vers le salut qu’ils proposent), sont donc évalués à l’aune de l’existence sociale qu’ils garantissent, de la protection qu’ils assurent contre les contraintes de l’ordre économique et social. Dans cette situation particulière, il semble que la perception de ces contraintes et de ce qui les génère oriente les constructions religieuses, la sélection et l’appropriation des éléments de tradition[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
89De tels processus se développent localement au moment où les mouvements de lutte explicitement dirigés contre l’État ont été mis en échec (révoltes foncières, militantisme, pour certains, dans les partis politiques, luttes syndicales), où la crise économique se développe.
90Les dynamiques religieuses peuvent alors constituer une forme de manifestation du politique. Il s’agit bien de reconfigurer les relations sociales locales, d’élaborer une légitimation de ce nouvel ordre en articulant des principes qui transcendent le local, relevant de l’universel (universalité de la religion monothéiste, universalité de la « religion traditionnelle »). En même temps sont désignées les causes du désordre. Les figures de l’État et des élites qui se dessinent apparaissent « en creux » à travers les regards qui les évaluent (Ançar-Dine), s’en détournent (Soufis), à travers les jeux de l’opacité et de l’exhibition propres aux adeptes de la « coutume Bamanan », à travers aussi les formes d’organisation socio spatiales.
91Dans une situation vécue comme incertaine, où les formes admises de solidarité et de valorisation sociale semblent inopérantes, on voit ici des groupes sociaux, en position particulièrement dominée, évaluer, retravailler les principes qui doivent régir les interdépendances sociales. Si l’on se réfère aux conceptions du politique développées par C. Lefort, il s’agit bien ici d’un processus d’institution de la société, à travers lequel se trouvent mis en sens et en scène les normes qui devraient orienter un ordre social à la fois juste et conforme aux vraies traditions religieuses. Une telle perspective constitue le politique en phénomène diffus, que l’on ne saurait assigner à un lieu particulier du social ni attribuer à une catégorie spécifique d’agents sociaux.
- 71 Les degrés d’autonomie ou de dépendance que les chercheurs attribuent aux constructions sociales e [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- 72 Thématiques de la pacification des rapports sociaux, de l’aménagement rationnel de l’espace urbain [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
92L’institution de la société, quelque soit le niveau auquel on l’observe, suscite des dynamiques sociales conflictuelles, liées à la lutte pour la définition des normes et plus largement au contrôle des rapports de domination. On ne peut toutefois constituer ces phénomènes en productions sociales et symboliques autonomes[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Les mobilisations religieuses dont il a été question ici entretiennent des liens d’interdépendance étroits avec la sphère étatique et les conflits qui s’y développent. Ainsi les politiques publiques d’aménagement de l’espace urbain (lotissement), les orientations économiques mises en œuvre par l’État imposent un cadre contraignant aux dynamiques sociales locales qu’elles contribuent fortement à orienter. Elles proposent aussi une bonne partie des matériaux[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] dont s’emparent les dispositifs locaux – énoncés politiques, éthiques, principes économiques, normes d’aménagement de l’espace urbain, qui seront tantôt retournés, tantôt réinvestis, articulés à des énoncés inscrits dans d’autres sphères, ici le religieux.
- 73 Ainsi, les révoltes suscitées par le lotissement et l’instauration d’un marché foncier dans les zo [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- 74 Phénomène constant dans l’histoire des interdépendances entre l’État et les mouvements religieux i [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
93Les mobilisations locales, en retour, conduisent à des réaménagements des politiques publiques[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], des discours de légitimation étatiques. Lorsqu’elles concernent les enjeux politiques fondamentaux, elles peuvent aussi durcir les conflits qui opposent les différentes fractions des élites. Les relations entre l’État et la sphère religieuse constituent l’un de ces enjeux. Les débats concernant la notion de laïcité, l’autonomie du politique, traversent les formations politiques alliées au sein de l’appareil d’État. La prolifération de mouvements islamiques réformistes et néo traditionalistes accentue ces tensions. Certains refusent d’intégrer l’AMUPI, instance qui devait permettre la régulation des rapports entre les instances politiques et religieuses, une autre association a donc été créée, intégrant l’AMUPI et certains mouvements « dissidents », mais elle ne parvient pas à les englober tous[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
- 75 Sans exclure les formes de circulation des savoirs religieux et les circuits d’apprentissage propr [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
94Même s’il a été choisi ici de privilégier l’analyse des configurations religieuses à l’échelle locale, on voit bien que la compréhension des formes d’articulation du politique et du religieux qui s’y élaborent impliquerait la prise en compte d’espaces d’observation plus larges englobant les associations religieuses nationales et les rapports qu’elles entretiennent avec l’État, et au-delà les réseaux transnationaux en formation[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
95Dans ce contexte, la question de l’autonomie des formes religieuses et sociales observées n’est guère pertinente. Par contre la volonté d’autonomie, les compétences symboliques et sociales des populations concernées se lisent dans les modalités de sélection et de mise en sens des outils proposés par les traditions, par les discours politiques et sociaux extérieurs. Elles sont également perceptibles dans la rapidité des réajustements symboliques opérés, dans les changements d’affiliation des individus et des groupes, dans la multiplicité des formes d’action politique investies.
Bibliographie
BIBLIOGRAPHIE
Amselle (J.-L.), « Le Wahhabisme à Bamako (1945-1985) », Canadian Journal of African Studies, 1985, p. 345-357.
Amselle (J.-L.) et Sibeud (E.), éd., Maurice Delafosse. Entre orientalisme et ethnographie : l’itinéraire d’un africaniste (1870-1926), Paris, Maisonneuve et Larose, 1998.
Balandier (G.), Le désordre, éloge du mouvement, Paris, Fayard, 1988.
Balandier (G.), Anthropologiques, Paris, L.G.F., 1985.
Balandier (G.), Anthropologie politique, Paris, P.U.F., Collection Quadrige, 2004.
J.F. Bayart (J.-F.), éd., Religion et modernité politique en Afrique Noire, Paris, Karthala, 1993.
Bayart (J.-F.), « Le politique par le bas en Afrique Noire », Politique Africaine, n° 1, 1981, p. 53-82.
Bourdarias (F.), « ONG et développement des élites », Journal des anthropologues, n° 94-95, 2003, p. 23-52.
Bourdarias (F.), « La ville mange la terre. Conflits fonciers à la périphérie de Bamako (Mali) », dans Fay (C.) et Quiminal (C.), éd., Pouvoirs et décentralisation en Afrique de l'Ouest, Paris, IRD, 2006.
Brenner (L.), « Constructing muslim identities in Mali », in Brenner (L.), éd., Muslim Identity and Social Change in Sub-Saharan Africa, Londres, Hurst, 1993, p. 50-78.
Certeau de (M.), L’invention du quotidien – I Arts de faire, Paris, UGE, 1980.
Colloque du Cnrs, La notion de personne en Afrique Noire, Paris CNRS, 1973.
Foucault (M.), La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976.
Guolo (R.), « Le fondamentalisme islamique. Radicalisme et néo-traditionalisme », dans Piga (A.), éd., Islam et villes en Afrique au sud du Sahara, Paris, Karthala, 2003, p. 57-64.
Grignon (C.) et Passeron (J.-C.), Le savant et le populaire, misérabilisme et populisme en sociologie et en littérature, Paris, EHESS, Gallimard/Seuil, 1989.
Halbwachs (M.), La mémoire collective, Paris, PUF, 1968.
Hervieu-Léger (D.), La religion pour mémoire, Paris, Cerf, 1993.
Kane (O.) et Triaud (J.-L.), éd., Islam et islamismes au sud du Sahara, Iremam-Karthala-MSH Paris, 1998.
Lefort (C.), Essais sur le politique, Paris, Seuil, Points Essais, 2001.
Piga (A.), éd., Islam et villes en Afrique au sud du Sahara, Paris, Karthala, 2003.
Revel (J.), éd., Jeux d’échelles, Paris, Gallimard/Le Seuil, 1996.
Tocqueville de (A.), L’ancien régime et la révolution, Paris, Gallimard, Folio-Histoire, p. 68-72.
Notes
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Bankoni (Commune I de Bamako) a vu le nombre de ses habitants (autour de 100 000 selon les dernières estimations) à peu près doubler depuis le recensement de 1997. Les quartiers qui composent cette zone se sont multipliés et s’étendent aujourd’hui jusqu’aux limites du district urbain. Au-delà, les terres des villages ruraux sont progressivement urbanisées. Les procédures administratives de lotissement provoquent régulièrement la fuite d’une partie des habitants (« déguerpis ») et l’extension des occupations « spontanées », en fait régies par les règles coutumières de concession des parcelles. À travers les procédures de lotissement, l’État entendait exercer son droit prééminent sur le sol. Il s’agissait à la fois d’aménager les zones périphériques (tracé de voies notamment) et d’instaurer un marché foncier « formel ». Les habitants dont les habitations n’ont pas été détruites par les tracés de voies ont été mis en demeure de payer une « lettre d’attribution » afin de légaliser leur droit d’usage de la parcelle, ou de l’acheter en toute propriété.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] BOURDARIAS (F.), « ONG et développement des élites », Journal des anthropologues, n° 9495, 2003, p. 23-52 ; « La ville mange la terre. Conflits fonciers à la périphérie de Bamako (Mali) », dans FAY (C.) et QUIMINAL (C.), éd., Pouvoirs et décentralisation en Afrique de l'Ouest, Éd. de l’IRD, 2007, p. 221-238.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] L’association était censée englober l’ensemble des mouvements islamiques, ce qui n’a jamais été le cas, bien que la participation à l’association semble représenter une étape décisive du développement et de la légitimation d’un mouvement religieux.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Dont le siège est implanté dans l’un des quartiers les plus récemment urbanisés de Bankoni (Dianguinabougou).
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Le terme Karamoko désigne le maître spirituel, celui qui dispense son savoir, se distingue par sa sagesse et son pouvoir d’attraction.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] « Fétiche » (en bambara boli), « féticheur » (bolitigi), ces termes d’emprunt sont utilisés localement en milieu urbain, aussi bien par les musulmans que par les adeptes des religions traditionnelles.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Bamanan, Bambara.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Dès les premières phases d’investissement du terrain, j’ai pris le parti d’orienter mon regard sur ce qui, à un moment donné, mobilisait les habitants (au-delà bien sûr des discours convenus élaborés pour un nouveau visiteur), sur ce qui semblait représenter un ensemble de risques sociaux à négocier. Il devenait alors pertinent de décrypter les perturbations relationnelles sous tendant les constructions sociales de ces risques, l’élaboration de modes d’action individuels et collectifs, les constructions symboliques qui les accompagnent.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Voir notamment : PIGA (A.), éd., Islam et villes en Afrique au sud du Sahara, Karthala, 2003 ; KANE (O.) et TRIAUD (J.-L.), éd., Islam et islamismes au sud du Sahara, Iremam-Karthala-MSH, Paris, 1998 ; BAYART (J.-F.), éd., Religion et modernité politique en Afrique Noire, Karthala, 1993.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] On peut concevoir aussi que des dynamiques religieuses n’entretiennent aucun lien avec le politique. Voir l’argumentation de J.P. OLIVIER DE SARDAN : « La surinterprétation politique : les cultes de possession hawka du Niger », dans BAYART (J.-F.), éd., 1993, op. cit., p. 163-214.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Bien désignées notamment par BAYART (J.-F.), « Le politique par le bas en Afrique Noire », Politique Africaine, n° 1, 1981, p. 53-82.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Le problème se pose alors de leur autonomie. Voir sur ce point les analyses de GRIGNON (C.) et PASSERON (J.-C.), Le savant et le populaire, misérabilisme et populisme en sociologie et en littérature, Paris, EHESS, Gallimard/Seuil, 1989.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] LEFORT (C.), Essais sur le politique, Paris, Seuil, Points Essais, 2001, p. 8.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] LEFORT (C.), ibid.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] BAYART (J.-F.), 1981, op. cit., se référant à P. Veyne, s’interroge ainsi sur les critères qui permettraient de situer un ensemble de conduites dans le champ du politique : désignation par les individus et groupes concernés, par l’extérieur, par le chercheur lui-même.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] C'est-à-dire que chaque sens de lecture donne à voir une signification différente.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Entretien formel ou informel en face à face, entretien de groupe, causeries informelles entre amis ou voisins, réactions à un événement… et, bien sûr, représentation de l’observateur et des buts qu’il poursuit (ou des desseins de Dieu à son égard).
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Dugutigi, se dit aussi bien d’un chef de village que d’un chef de quartier urbain.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Furu wari, compensation matrimoniale, terme que les habitants traduisent en français par « dot ».
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Fuir et franchir la frontière du District de Bamako peut être alors perçu comme un moyen de reconstituer un territoire menacé. Les chefs de villages ruraux sont alors opposés aux autorités du District de Bamako comme la coutume préservée l’est au désordre urbain.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Elles se sont progressivement déplacées dans les communes rurales où elles ont parfois abouti, au moins provisoirement. Sur ce point, BOURDARIAS (F.), 2007, op. cit.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] C’est le cas d’ITEMA, l’une des dernières usines textiles du Mali, dont de nombreux ouvriers résident à Bankoni.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Les conversations entre amis et voisins manifestent bien cette activité fébrile d’évaluation et de classement. Les stratégies d’intégration aux réseaux, les échecs et les réussites sont analysés collectivement. Certains s’efforceront alors d’en dévoiler les facettes les plus obscures (compromissions, lâchetés, sorcellerie).
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Les messages de santé diffusés à cette période ont contribué largement à alimenter ces accusations croisées. BOURDARIAS (F.), « Le sida à Bamako : risques et dynamiques des tensions sociales », dans FAY (C.) et VIDAL (L.), éd., Face au sida, négociation des risques en Côte d’Ivoire et au Mali, Rapport de recherche, Centre d’Études Africaines/ANRS, 1999, p. 46-88.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Les jeunes adultes tendent à définir et hiérarchiser les différents espaces investis, parcourus ou évités en fonction des distances sociales qu’ils impliquent, de la plus ou moins grande transparence qui caractérise les rapports sociaux. L’espace le plus familier (le moins opaque et le plus sécurisant) n’en recèle pas moins des dangers, la trop grande proximité entre les êtres (famille, couple, voisinage) générant la contrainte liée à la trop grande visibilité. La distance, périlleuse, permet cependant l’évaluation et la négociation. Qu’il s’agisse des activités économiques, des rapports de séduction ou de l’amitié, il s’agit de définir la bonne distance, celle qui permet « le regard qui perce ».
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Citoyenneté, société civile, cosmopolitisme…
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] En bambara tòn désigne une association, un groupe organisé autour d’un intérêt commun, il désigne aussi les règles qui régissent le groupe.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Schème courant semble-t-il dans les récits de fondation de nouveaux mouvements religieux traditionalistes.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] La biographie du Sheikh (dont l’évolution est perceptible sur la durée) présentée dans les prêches, les récits des fidèles et du Karamoko lui-même mériterait une analyse minutieuse que je n’ai pas encore entreprise.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] La Wahhabyya (sunnite) est un mouvement particulièrement influent au Mali, surtout dans les villes. Les fidèles sont cependant peu présents dans la zone urbaine concernée. Les Wahhabites sont considérés comme issus d’une classe de commerçants aisés et d’une élite d’intellectuels arabisants. Voir notamment : AMSELLE (J.-L.), 1985, « Le Wahhabisme à Bamako (19451985) », Canadian Journal of African Studies, 1985, p. 345-357 ; BRENNER (L.), « Constructing muslim identities in Mali », in BRENNER (L.), éd., Muslim Identity and Social Change in Sub-Saharan Africa, Londres, Hurst, 1993, p. 50-78.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Les quelques éléments présentés ici sont issus de l’analyse de prêches diffusés sur cassettes (1996-2005), de récits de trajectoire de convertis (1995-2000) dont j’ai pu suivre l’évolution ces dernières années.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] L’Ançar-Dine propose entre ses membres la suppression du furu wari (compensation matrimoniale), obstacle au mariage des plus pauvres, la construction de relations économiques privilégiées qui doivent donner aux jeunes « l’occasion de montrer ce qu’ils savent faire et de réussir s’ils le méritent ».
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] On peut retrouver là les caractéristiques de « l’islamisation par le bas », que certains auteurs associent aux mouvements islamiques « néo traditionalistes ». Voir notamment : GUOLO (R.), « Le fondamentalisme islamique. Radicalisme et néotraditionalisme », dans PIGA (A.), éd., Islam et villes en Afrique au sud du Sahara, Paris, Karthala, 2003, p. 57-64.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Ainsi de nombreux jeunes gens, mariés ou célibataires quittent la concession familiale, certains choisissent une épouse parmi les « vrais croyants », sans même en informer leurs parents. Des liens amicaux sont rompus lorsque l’ami refuse de s’affilier au tòn… Là encore rappel de l’épopée de Muhammad et de ses compagnons.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] On peut remarquer cependant que le modèle de l’individu qui s’élabore ici entretient des affinités avec la conception privilégiée par de nombreuses sociétés lignagères en Afrique de l’Ouest. Le statut d’individu remarquable est lié notamment à l’accumulation et à la maîtrise des relations sociales, dans les domaines les plus valorisés par la collectivité. Voir : Colloque du CNRS, La notion de personne en Afrique Noire, Paris CNRS, 1973.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Ainsi, depuis 2005, le « tapage nocturne » (notion absente jusque là des discours des habitants) a disparu dans le voisinage du siège de l’Ançar-Dine. Plus de veillées de baptême joyeuses et bruyantes, lors des mariages les fêtes organisées par les femmes cessent au coucher du soleil. Les musiciens professionnels, les griots, n’y sont plus admis. Le groupe vocal de Haidara y exécute des chants religieux auxquels les danseuses tentent d’adapter leurs pas. Il s’agit, nous dira-t-on, de respecter les voisins, d’éviter les dépenses excessives tout en bannissant les comportements indécents. Ceux qui passeraient outre, quelque soit leur appartenance religieuse, risqueraient d’encourir le blâme du voisinage.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Terme englobant ici les « animistes » (« païens ») et les « sans religion ».
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Depuis 2003 environ, les récits de conversions de féticheurs endurcis opérées par Haidara se multiplient, les événements les plus marquants sont filmés et diffusés sur cassettes et DVD.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Alors qu’ils visitent ainsi tous les Karamoko prestigieux.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] « Notre maître est le chef mécanicien, nous autres, nous sommes les apprentis et on progresse dans le métier ! Les voitures viennent se faire réparer, ce n’est pas un hasard, toi qui es venue, ton moteur doit avoir des ratés ! » (un disciple de Soufi Adama, 2001)
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] « Cet appareil est vraiment ce qui convient aux Soufis » (Un disciple de Soufi Bilal, 2006).
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] On ne prendra en compte ici que les deux groupes les plus actifs dans le quartier de référence (prosélytisme, installation de disciples). Les Mourides, présents à Bamako, ne se manifestent pas à Bankoni. Le collectif que j’ai rencontré au sud de la ville recrute parmi les techniciens, les cadres moyens.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] On repère bien dans les pratiques des éléments de ces traditions (il est impossible de développer ce point ici). On peut relever de multiples références aux « premiers Soufis ». La non proclamation d’allégeance à l’une des nombreuses confréries implantées en Afrique de l’Ouest est peut-être transitoire. En tous cas les thématiques du « retour aux origines », du refus des affrontements entre mouvements sont prégnantes. Peut-être sont-elles caractéristiques de mouvements émergents, peut-être sont-elles aussi liées aux ambitions religieuses et sociales des maîtres.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] À cela près que Soufi Bilal, intellectuel diplômé, mentionne une révélation divine, et que Soufi Adama, illettré, lie sa retraite à l’expérience du malheur et de la maladie (lèpre), comme le font les furakela (guérisseurs).
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] De très jeunes filles qui suivent l’enseignement d’un disciple de Bilal installé dans le quartier m’ont fait part des difficultés rencontrées auprès de leurs parents et du voisinage.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] « Que les hommes et les femmes tournés vers Dieu se multiplient et le monde changera de lui-même ». Les disciples développent volontiers cette thématique.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Quelques uns auraient appartenu à des tòns de bandits. Certains d’ailleurs semblent avoir rejoint leur premier groupe d’appartenance.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] En père attentif, le Maître procurera des épouses aux disciples les plus avancés.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Lors d’entretiens réalisés auprès d’Adama en 2003, ce dernier insistait sur ce point : « Soufi Adama, on m’appelle comme ça … Je ne sais pas si je suis Soufi ! Je suis venu, j’ai prié ici tout seul … Des gens sont venus autour de moi, ils m’ont appelé Soufi et m’ont dit qu’ils étaient Soufi… C’est tout ».
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] De tels phénomènes de syncrétisme n’ont rien de nouveau ni d’exceptionnel, mais la situation dans laquelle ils se manifestent ici leur donne un sens particulier.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Les chasseurs sont devenus l’un des symboles privilégiés de la « tradition du Mandé ». Dans chaque association aujourd’hui, l’initiation des membres implique l’attachement à un maître : acquisition des savoirs cynégétiques, mais aussi des savoirs ésotériques permettant d’établir des liens avec les forces qui régissent les processus naturels. En ce sens, chasseurs et bolitigi entretiennent de nombreuses affinités.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Large diffusion de ses cassettes sur les marchés, multiplication du nombre de ses élèves dans les quartiers, attaques répétées de la part des dignitaires religieux dans les prêches et dans la presse.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Quelques coups de fouet appliqués avec une certaine « bienveillance » : « Allez, courage… encore trois coups et c’est fini ! Tu pourras dormir tranquille après ».
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Les travaux de nombreux historiens retracent la longue cohabitation de l’Islam et des religions locales en Afrique subsaharienne : syncrétismes, emprunts, périodes d’affrontements et de paix. Ils critiquent également la rigidification des identités religieuses opérée par les administrateurs coloniaux et les premiers ethnologues. Voir notamment : AMSELLE (J.-L.) et SIBEUD (E.), éd., Maurice Delafosse. Entre orientalisme et ethnographie : l’itinéraire d’un africaniste (1870-1926), Paris, Maisonneuve et Larose, 1998.) La construction qui apparaît ici mérite d’autant plus d’attirer l’attention.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Ici l’ennemi désigné est l’Islam, car « le christianisme, maintenant, laisse les gens tranquilles ».
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Semblent ainsi être opposés le désir d’imposer sa loi aux autres (politique) et le « besoin ». Interrogés sur ce point, Satan et ses disciples énumèrent : faire que ton champ ou ton commerce gagne beaucoup, que tu gagnes au tiercé, que tu puisses avoir la femme que tu aimes et qu’elle te soit fidèle, que tu guérisses de ta maladie…
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Son procès a eu lieu au début du mois de juillet 2007 et il a été condamné à sept ans d’incarcération.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Cette thématique du secret, les reformulations des formes religieuses traditionnelles et de la notion d’individu devraient permettre d’appréhender les conceptions du pouvoir qui s’élaborent ici, dans un contexte conflictuel singulier. Le caractère lacunaire de mes observations ne me permet pas encore d’aborder ce point pourtant essentiel.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Ce terme permet de désigner la valeur circonstancielle, (locale) accordée à des éléments de tradition. On peut penser ici aux analyses de M. HALBWACHS concernant les usages de la mémoire individuelle et collective (1968, La mémoire collective, PUF).
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] On se référera sur ce point aux définitions de la tradition proposées et mises à l’épreuve par G. BALANDIER (notamment Le désordre, éloge du mouvement, Paris, Fayard, 1988), et à leur utilisation par D. HERVIEU-LÉGER, La religion pour mémoire, Paris, Cerf, 1993.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] L’analyse de Tocqueville est éclairante sur ce point, lorsqu’il établit un parallèle entre les révolutions politiques et le développement des religions monothéistes (L’ancien régime et la révolution, Gallimard, Folio-Histoire, p. 68-72).
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Face à l’échec social, à l’extension de la nouvelle maladie (sida)…
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Ajoutons à cela qu’à un certain stade de son développement, un mouvement religieux contestataire tente fréquemment d’acquérir une légitimité auprès d’une population plus large et plus diversifiée. C’est aujourd’hui semble-t-il le cas le l’Ançar-Dine et des deux mouvements Soufi.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Certains fidèles feront remarquer non sans fierté que les commerçants du centre sont de plus en plus nombreux à visiter Haidara « avec leurs grosses voitures »… Haidara a intégré l’AMUPI, « pour y défendre la bonne voie religieuse ».
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Bilal et Adama prononcent quelques phrases de bienvenue devant les fidèles qui affluent le Vendredi, puis les reçoivent individuellement ou par petits groupes après la prière.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Tissus faits de morceaux cousus, sorte de « patchwork » caractéristique du vêtement adopté par les mourides du mouvement Baye Fall (Sénégal).
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Rappelons que des gradés de l’armée et de la police avaient été « séduits » et détournés « de leurs devoirs envers l’État et la démocratie ». L’analyse de la presse malienne depuis 2005 permet d’appréhender l’importance politique et religieuse de ces événements.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Certaines, lors de leurs visites à la résidence du Karamoko soufi insistent sur le sentiment de liberté qu’elles y ressentent, sur le fait qu’elles échappent momentanément aux contraintes exercées par le milieu familial et le voisinage.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] « Qui ne fait pas de l’homme un coupable, un prisonnier » (propos tenu par un « transfuge » de l’Ançar-Dine, 2005).
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Il conviendrait alors de s’interroger, à une échelle plus micro sociale encore, sur ce qui oriente ces perceptions différenciées et relativement fluctuantes des tensions qui caractérisent une configuration sociale saisie par l’observateur dans la durée. Lorsque l’on confronte les transformations des pratiques religieuses et politiques, celles qui affectent les rapports entre les sexes et les générations, les pratiques économiques, on est conduit à s’interroger sur l’élaboration de nouveaux modèles « d’économie affective » (N. Elias utilise encore le terme d’économie pulsionnelle). Alors seulement les notions d’autonomie, de contrainte perçue, de construction de modèles d’action et de mobilisation pourraient devenir des outils efficaces d’analyse. L’articulation des différents niveaux d’observation serait également plus satisfaisante.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Les degrés d’autonomie ou de dépendance que les chercheurs attribuent aux constructions sociales et symboliques opérées en situation dominée ont donné lieu à de nombreux débats (histoire, sociologie, anthropologie, politologie). Voir : GRIGNON (C.) et PASSERON (J.-C.), 1989, op. cit. ; CERTEAU DE (M.), L’invention du quotidien – I Arts de faire, Paris, UGE, 1980 ; FOUCAULT (M.), La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976 ; REVEL (J.), éd., Jeux d’échelles, Paris, Gallimard/Le Seuil, 1996.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Thématiques de la pacification des rapports sociaux, de l’aménagement rationnel de l’espace urbain, de la lutte contre la délinquance, de la valorisation des traditions nationales ; notions de bien public, de citoyenneté, de mérite individuel…
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Ainsi, les révoltes suscitées par le lotissement et l’instauration d’un marché foncier dans les zones périphériques ont contraint les instances administratives à prendre en compte les règles coutumières de concession des parcelles, les intérêts des chefs de terre et des occupants… Ce qui a d’ailleurs accéléré le développement d’un marché foncier illégal particulièrement actif (certains représentants de l’administration locale et centrale savent en tirer profit).
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Phénomène constant dans l’histoire des interdépendances entre l’État et les mouvements religieux islamiques au Mali depuis l’indépendance.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Sans exclure les formes de circulation des savoirs religieux et les circuits d’apprentissage propres aux bolitigi urbains, qui, selon mes premières observations s’étendent sur plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest (Mali, Guinée, Sénégal, Côte d’Ivoire).
Auteur
Françoise Bourdarias
Université François-Rabelais, Tours. UMR CNRS 6173 CITERES
Page 2 sur 3 •  1, 2, 3
1, 2, 3 
 Sujets similaires
Sujets similaires» Politique et Religion
» Yvon Quiniou : "La religion demeure une imposture morale, intellectuelle et politique"
» Forum Religion et Art
» Forum Religion et Sociologie
» Forum Religion et Musique
» Yvon Quiniou : "La religion demeure une imposture morale, intellectuelle et politique"
» Forum Religion et Art
» Forum Religion et Sociologie
» Forum Religion et Musique
Forum Religion : Le Forum des Religions Pluriel :: ○ Babylone la Grande :: Babylone :: La "Politique"
Page 2 sur 3
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum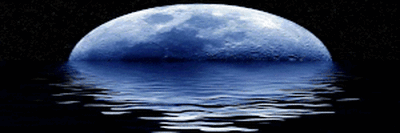
 S'enregistrer
S'enregistrer

